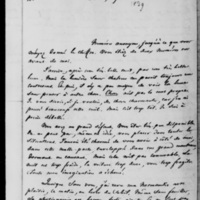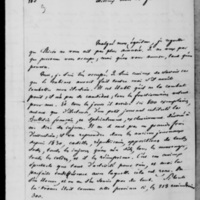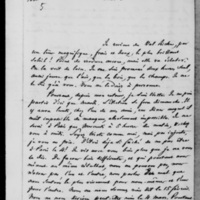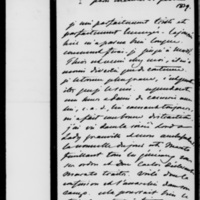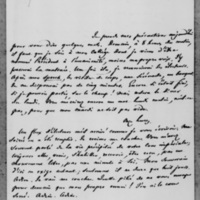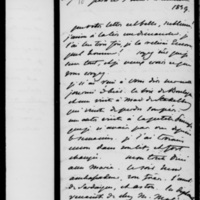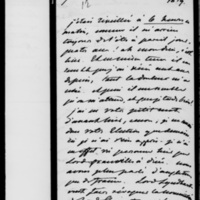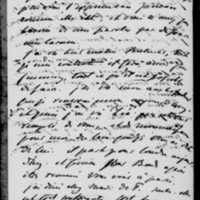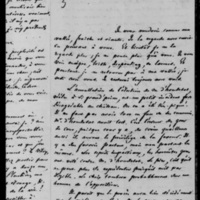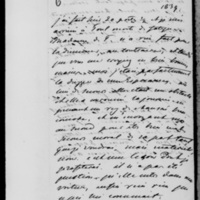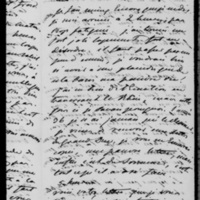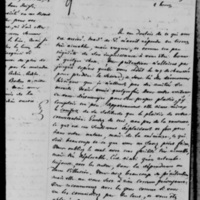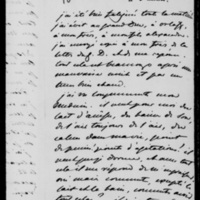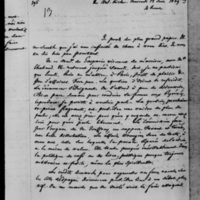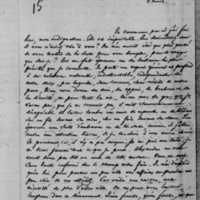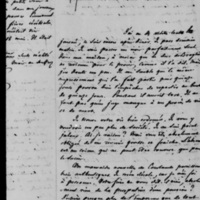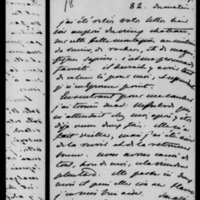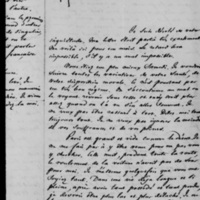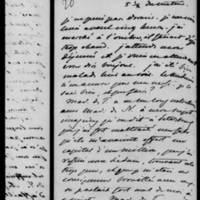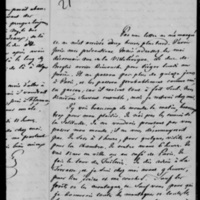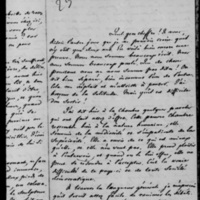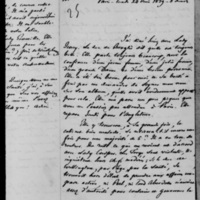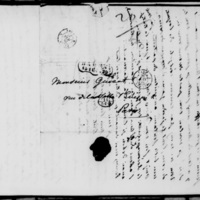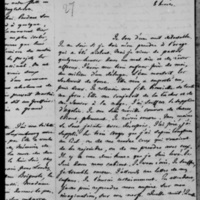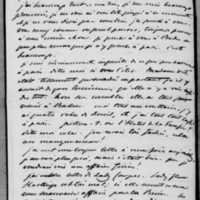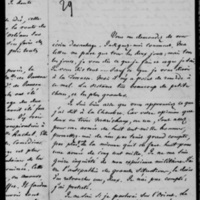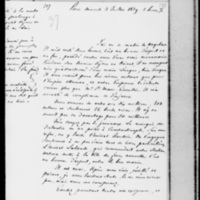Votre recherche dans le corpus : 263 résultats dans 5770 notices du site.Collection : 1839 : De la Chambre à l'Ambassade (1837-1839 : Vacances gouvernementales)
Trier par :
182. Lisieux, Mercredi 27 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
N° Lisieux 27 Février, 8 heures
Numéro anonyme, jusqu'à ce que vous m'ayez donné le chiffre. Vous étiez de deux numéros en avant de moi. J'arrive après une très belle nuit, par une très belle lune. Mais la lumière sans chaleur me parait toujours un contresens. Et puis, il n’y a pas moyen de voir la lune sans penser à autre chose. Chose n’est pas le mot propre. Je vous dirais si je voulais des choses charmantes, car j’en ai pensé beaucoup cette nuit. Mais c’est trop tôt. Je suis à peine débotté.
Vous avez un grand défaut. Vous êtes très peu disponible. On ne peut pas, même en idée, vous placer dans toutes les situations. J'aurais été charmé de vous avoir à côté de moi, dans cette malle-poste enveloppée dans un grand manteau, dormant ou causant. Mais cela n’est pas concevable. La nuit est trop froide, la voiture trop dure, vous trop fragile. Toute mon imagination a échoué. Quoique sans vous, j'ai revu ma Normandie avec plaisir, ce matin, au lever du soleil. Même sans feuilles, sa physionomie est bonne, forte, riante. Ce ne sont pas les aspects que j'aurais choisis, ce n'est pas la grande nature, qui émeut et élève ; mais c’est la nature, saine et gracieuse, qui nourrit et repose. Cela convient aux âmes un peu lasses et pourtant encore animées. Nous nous y trouverions à merveille quand nous serons vieux. Est-ce que nous serons jamais vieux ?
On voulait me faire coucher en arrivant. J’ai mieux aimé faire ce que je fais.
Midi.
J’ai déjà vu bien du monde. On me paraît ici très animé, et très confiant. On compte sur le succès dans presque toute la province. Vous avez bien tort, je vous jure de douter de l'avenir du gouvernement représentatif dans ce pays-ci. Si vous aviez été élevée dans la monarchie de l'Empereur de la Chine, croiriez-vous à la Monarchie de la Reine Victoria ? Il en sera de même des Parlements. Le nôtre ne ressemblera pas à celui de Londres ; mais il sera et à sa façon, il sera grand, sans quoi on n'est pas. Je parlais tout-à-l'heure de la maladie du Duc de Wellington. J’ai trouvé une disposition bienveillante et généreuse, qui m’a fait plaisir. Je ne l’aurais pas trouvée il y a douze ans, avant 1830. Vous m'avez dit, n’est-ce pas, que vous ne feriez pas partir votre lettre au comte Nesselrode, et les autres, avant mon retour. Je vous le rappelle. Il m'est venu en idée deux ou trois choses qui y doivent être. Voilà des visites. Adieu.
Je ne vous ai pourtant rien dit. J’ai cru cette nuit que j’allais avoir, sur les épaules, un rhumatisme pareil au vôtre. Il n'en est rien. C’était un rêve comme tant d'autres. Adieu. Adieu.
Numéro anonyme, jusqu'à ce que vous m'ayez donné le chiffre. Vous étiez de deux numéros en avant de moi. J'arrive après une très belle nuit, par une très belle lune. Mais la lumière sans chaleur me parait toujours un contresens. Et puis, il n’y a pas moyen de voir la lune sans penser à autre chose. Chose n’est pas le mot propre. Je vous dirais si je voulais des choses charmantes, car j’en ai pensé beaucoup cette nuit. Mais c’est trop tôt. Je suis à peine débotté.
Vous avez un grand défaut. Vous êtes très peu disponible. On ne peut pas, même en idée, vous placer dans toutes les situations. J'aurais été charmé de vous avoir à côté de moi, dans cette malle-poste enveloppée dans un grand manteau, dormant ou causant. Mais cela n’est pas concevable. La nuit est trop froide, la voiture trop dure, vous trop fragile. Toute mon imagination a échoué. Quoique sans vous, j'ai revu ma Normandie avec plaisir, ce matin, au lever du soleil. Même sans feuilles, sa physionomie est bonne, forte, riante. Ce ne sont pas les aspects que j'aurais choisis, ce n'est pas la grande nature, qui émeut et élève ; mais c’est la nature, saine et gracieuse, qui nourrit et repose. Cela convient aux âmes un peu lasses et pourtant encore animées. Nous nous y trouverions à merveille quand nous serons vieux. Est-ce que nous serons jamais vieux ?
On voulait me faire coucher en arrivant. J’ai mieux aimé faire ce que je fais.
Midi.
J’ai déjà vu bien du monde. On me paraît ici très animé, et très confiant. On compte sur le succès dans presque toute la province. Vous avez bien tort, je vous jure de douter de l'avenir du gouvernement représentatif dans ce pays-ci. Si vous aviez été élevée dans la monarchie de l'Empereur de la Chine, croiriez-vous à la Monarchie de la Reine Victoria ? Il en sera de même des Parlements. Le nôtre ne ressemblera pas à celui de Londres ; mais il sera et à sa façon, il sera grand, sans quoi on n'est pas. Je parlais tout-à-l'heure de la maladie du Duc de Wellington. J’ai trouvé une disposition bienveillante et généreuse, qui m’a fait plaisir. Je ne l’aurais pas trouvée il y a douze ans, avant 1830. Vous m'avez dit, n’est-ce pas, que vous ne feriez pas partir votre lettre au comte Nesselrode, et les autres, avant mon retour. Je vous le rappelle. Il m'est venu en idée deux ou trois choses qui y doivent être. Voilà des visites. Adieu.
Je ne vous ai pourtant rien dit. J’ai cru cette nuit que j’allais avoir, sur les épaules, un rhumatisme pareil au vôtre. Il n'en est rien. C’était un rêve comme tant d'autres. Adieu. Adieu.
183. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
183 Lisieux jeudi 28 février
Malgré mon égoïsme, je regrette que Thiers ne vous ait pas plus amusée. Je ne veux pas que personne vous occupe ; mais qu’on vous amuse, tant qu’on pourra. Moi, je suis très occupé. Je suis curieux de savoir ce que le cabinet aurait fait contre moi s’il avait combattu mon élection. Il est établi qu’il ne la combat point ; il n’a pas de candida t; tous les fonctionnaires votent pour moi. Et tous les jours il arrive ici 800 exemplaires autant que d’électeurs, d’un petit journal intitulé le Bulletin français, et spécialement, exclusivement dévoué à me dire des injures. Il ne se met pas en grands frais d'invention ; il va reprendre dans les anciens journaux depuis 1830, carlistes, républicains, oppositions de toutes sortes, toutes les injures qu’on m'a dites, tous les mensonges, toutes les colères, et il les réimprime. C’est un curieux spectacle que tant d'activité pour rien, et aussi la parfaite indifférence avec laquelle cela est reçu. On s’en étonne et on ne s’en soucie pas du tout. Si toute la France était comme cette province-ci, les 213 reviendraient 300.
Je vais ce matin au Val-Richer. J’y aurai le plaisir d’être seul quelques heures. Après vous, ce que je désire la plus en ce moment, c’est un peu de votre solitude. Depuis quelque temps, ma disposition est assez combattue. Je ne suis point las de la vie active et des affaires ; elles me plaisent toujours ; il me semble même que ce que j'y voudrais faire est à peine commencé. J’ai la tête de la volonté encore très pleines. Pourtant je suis un peu las des hommes ; j'en ai assez de leur conversation de leur figure. Je suis au milieu d'eux comme dans une foule qu’on est pressé de traverser pour rentrer chez soi. Rentrerais-je jamais chez moi ?
Maroto ne me rejoint ni ne m'afflige comme Granville ou Pahlen. Il me prouve que j'ai raison de ne rien attendre de personne en Espagne. On y fera ce qu’on y fait ; on y restera comme on est. Il n’y a là point de vainqueur. C’est parce que nous sommes des Européens que nous nous en étonnons. Il y a un pays dix fois grand comme l’Europe, où les choses se passent et demeurent ainsi depuis des siècles. Ce pays s’appelle l'Asie. Là par exemple, on a bien raison d'être las des hommes. Quoique vous ne sachiez pas le Latin, vous savez que Tacite a dit en parlant des statues de Brutus et de Cassius : « Elles brillaient d’autant plus qu’elles n’y étaient pas." C’est votre condition dans toutes ces conversations, ces correspondances, ces articles de journaux à propos de Prince de Lieven. Laissez- moi vous répéter ce que je vous ai dit. Vous êtes trop fière pour être faible. Et vous n'êtes pas plus fière qu’il ne convient.
On a tort en Belgique d'attendre l'issue de nos élections. Elles n'enverront pas cinq hommes et un caporal dans le Limbourg. Si j’avais eu besoin d'apprendre que ce pays-ci veut la paix, je l'apprendrais au milieu de toutes les oppositions, n'importe laquelle. Il a raison. La guerre pour de grandes raisons, à la bonne heure ; mais la guerre pour des querelles de journalistes ou pour des fantaisies, de gens d’esprit, c'est absurde. Adieu. De loin, je cause avec vous de ce qui ne me fait rien, ou pas grand chose. Voyez à quels scrupules d'exactitude vous m'avez accoutumé. Au fait, vous ne savez pas, personne ne saura jamais combien tout ce qui ne me tient pas au fond du cœur est peu pour moi, et quel abyme il y a en moi entre une chose et toutes les autres. Adieu. Vous ne me donnez pas des nouvelles de votre rhumatisme. A la vérité, il était passé quand je suis parti. Mais il me semble que de ce qui vous touche, rien ne passe. Adieu, Adieu.
Malgré mon égoïsme, je regrette que Thiers ne vous ait pas plus amusée. Je ne veux pas que personne vous occupe ; mais qu’on vous amuse, tant qu’on pourra. Moi, je suis très occupé. Je suis curieux de savoir ce que le cabinet aurait fait contre moi s’il avait combattu mon élection. Il est établi qu’il ne la combat point ; il n’a pas de candida t; tous les fonctionnaires votent pour moi. Et tous les jours il arrive ici 800 exemplaires autant que d’électeurs, d’un petit journal intitulé le Bulletin français, et spécialement, exclusivement dévoué à me dire des injures. Il ne se met pas en grands frais d'invention ; il va reprendre dans les anciens journaux depuis 1830, carlistes, républicains, oppositions de toutes sortes, toutes les injures qu’on m'a dites, tous les mensonges, toutes les colères, et il les réimprime. C’est un curieux spectacle que tant d'activité pour rien, et aussi la parfaite indifférence avec laquelle cela est reçu. On s’en étonne et on ne s’en soucie pas du tout. Si toute la France était comme cette province-ci, les 213 reviendraient 300.
Je vais ce matin au Val-Richer. J’y aurai le plaisir d’être seul quelques heures. Après vous, ce que je désire la plus en ce moment, c’est un peu de votre solitude. Depuis quelque temps, ma disposition est assez combattue. Je ne suis point las de la vie active et des affaires ; elles me plaisent toujours ; il me semble même que ce que j'y voudrais faire est à peine commencé. J’ai la tête de la volonté encore très pleines. Pourtant je suis un peu las des hommes ; j'en ai assez de leur conversation de leur figure. Je suis au milieu d'eux comme dans une foule qu’on est pressé de traverser pour rentrer chez soi. Rentrerais-je jamais chez moi ?
Maroto ne me rejoint ni ne m'afflige comme Granville ou Pahlen. Il me prouve que j'ai raison de ne rien attendre de personne en Espagne. On y fera ce qu’on y fait ; on y restera comme on est. Il n’y a là point de vainqueur. C’est parce que nous sommes des Européens que nous nous en étonnons. Il y a un pays dix fois grand comme l’Europe, où les choses se passent et demeurent ainsi depuis des siècles. Ce pays s’appelle l'Asie. Là par exemple, on a bien raison d'être las des hommes. Quoique vous ne sachiez pas le Latin, vous savez que Tacite a dit en parlant des statues de Brutus et de Cassius : « Elles brillaient d’autant plus qu’elles n’y étaient pas." C’est votre condition dans toutes ces conversations, ces correspondances, ces articles de journaux à propos de Prince de Lieven. Laissez- moi vous répéter ce que je vous ai dit. Vous êtes trop fière pour être faible. Et vous n'êtes pas plus fière qu’il ne convient.
On a tort en Belgique d'attendre l'issue de nos élections. Elles n'enverront pas cinq hommes et un caporal dans le Limbourg. Si j’avais eu besoin d'apprendre que ce pays-ci veut la paix, je l'apprendrais au milieu de toutes les oppositions, n'importe laquelle. Il a raison. La guerre pour de grandes raisons, à la bonne heure ; mais la guerre pour des querelles de journalistes ou pour des fantaisies, de gens d’esprit, c'est absurde. Adieu. De loin, je cause avec vous de ce qui ne me fait rien, ou pas grand chose. Voyez à quels scrupules d'exactitude vous m'avez accoutumé. Au fait, vous ne savez pas, personne ne saura jamais combien tout ce qui ne me tient pas au fond du cœur est peu pour moi, et quel abyme il y a en moi entre une chose et toutes les autres. Adieu. Vous ne me donnez pas des nouvelles de votre rhumatisme. A la vérité, il était passé quand je suis parti. Mais il me semble que de ce qui vous touche, rien ne passe. Adieu, Adieu.
184. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
184 Jeudi 28. 5 heures
Je reviens du Val Richer, par un temps magnifique, frais et doux ; le plus brillant soleil ! Point de verdure encore, mais elle va éclater. On la voit de loin. Je me suis promené deux heures seul, aussi jeune que l’air, que les bois, que les champs. Je ne le dis qu'à vous. Vous ne le direz à personne. Pourtant depuis mon retour, je suis triste. Je ne puis partir d’ici que mardi. L’élection se fera dimanche. Il y aura lundi chez l’un de mes amis, un dîner auquel il m'est impossible de manquer absolument impossible. Je ne serai à Paris que Mercredi à 5 heures du matin, & chez vous à midi. Soyez triste comme moi, mais pas injuste, je vous en prie. J'étais déjà si fâché de ne pas être à Paris, le 4. Je vis avec vous bien plus que je ne vous le dis. De façons bien différentes et qui pourtant nous mènent au même résultat, nous ne pouvons pas, nous n'osons pas l’un et l'autre, nous parler du mal que nous sentons le plus vivement pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes rien dit le 15 février. Nous ne nous dirions peut-être rien le 4 mars. Pourtant je voudrais être là ; je voudrais vous voir. En vérité, il y a des tendresses, auxquelles Dieu devrait accorder de paraître telles qu’elles sont et de donner tout ce qu’elles ont, sans démonstration extérieure, sans parole. Dearest for ever dearest !
Vendredi 7 heures et demie
J’ai été réveillé cette nuit à une heure du matin, par un singulier message. Des électeurs de Rouen m’ont envoyé l'un d'entre eux pour me conjurer, c’est bien le mot d'aller passer quelques heures à Rouen et de prendre la parole dans un grand meeting où il s’agit d'assurer le succès des candidats de l'opposition entr'autres de M. Duvergier de Hauranne qu'on veut porter à Rouen. Il leur faut un virtuose pour porter le dernier coup. Avec un virtuose ils se tiennent pour vainqueurs. Je me suis excusé, comme vous pensez bien. J’ai à faire ici. J’ai donné une belle lettre au lieu de ma personne. On la lira dans le meeting. Mais vous savez le peu qu’est une lettre. En voilà pourtant une qu’on m’apporte, et qui est beaucoup. Certainement, Lady William Bentinck est une bonne femme. Je le savais. A présent, je lui en sais gré. A-t-elle été jusqu'à vous offrir son perroquet, ce perroquet favori qui va se promener avec elle ? Je suis bien aise que le Duc de Wellington, n'ait pas notre rhumatisme. Je dis notre, car décidément j'ai les épaules un peu entreprises. Je n’ai pas même le temps de lire les journaux. J'ai laissé les miens à Paris. Il faudrait ici aller Ies chercher au Club. On me les raconte. Et je n’ai pas besoin qu’on me les raconte. Je les fais bien tout seul, amis ou ennemis. Le rabâchage règne et gouverne dans le monde. J’ai bien remarqué l'âpreté anglaise dans cette affaire du Pilote. Il y a quelque chose de plus que l'humeur de l'affaire même. C’est une humeur générale, et qui prend plaisir à se faire sentir, les plus simples en sont frappés, et frappés aussi de la chose même, de l'étourderie de ce jeune Prince, et de l’inconvénient des étourderies princières. On va de là aux faiblesses royales. Et de là on vient à moi, pour me donner raison. Le Duc d'Orléans a passé ici, cette nuit. Il va sans doute au devant du Prince de Joinville. Nous sommes sur la route de Brest.
Adieu. A mercredi. J’ai ces 24 heures là bien lourdes, sur le cœur. Il n'y a pas moyen. Adieu.
Je reviens du Val Richer, par un temps magnifique, frais et doux ; le plus brillant soleil ! Point de verdure encore, mais elle va éclater. On la voit de loin. Je me suis promené deux heures seul, aussi jeune que l’air, que les bois, que les champs. Je ne le dis qu'à vous. Vous ne le direz à personne. Pourtant depuis mon retour, je suis triste. Je ne puis partir d’ici que mardi. L’élection se fera dimanche. Il y aura lundi chez l’un de mes amis, un dîner auquel il m'est impossible de manquer absolument impossible. Je ne serai à Paris que Mercredi à 5 heures du matin, & chez vous à midi. Soyez triste comme moi, mais pas injuste, je vous en prie. J'étais déjà si fâché de ne pas être à Paris, le 4. Je vis avec vous bien plus que je ne vous le dis. De façons bien différentes et qui pourtant nous mènent au même résultat, nous ne pouvons pas, nous n'osons pas l’un et l'autre, nous parler du mal que nous sentons le plus vivement pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes rien dit le 15 février. Nous ne nous dirions peut-être rien le 4 mars. Pourtant je voudrais être là ; je voudrais vous voir. En vérité, il y a des tendresses, auxquelles Dieu devrait accorder de paraître telles qu’elles sont et de donner tout ce qu’elles ont, sans démonstration extérieure, sans parole. Dearest for ever dearest !
Vendredi 7 heures et demie
J’ai été réveillé cette nuit à une heure du matin, par un singulier message. Des électeurs de Rouen m’ont envoyé l'un d'entre eux pour me conjurer, c’est bien le mot d'aller passer quelques heures à Rouen et de prendre la parole dans un grand meeting où il s’agit d'assurer le succès des candidats de l'opposition entr'autres de M. Duvergier de Hauranne qu'on veut porter à Rouen. Il leur faut un virtuose pour porter le dernier coup. Avec un virtuose ils se tiennent pour vainqueurs. Je me suis excusé, comme vous pensez bien. J’ai à faire ici. J’ai donné une belle lettre au lieu de ma personne. On la lira dans le meeting. Mais vous savez le peu qu’est une lettre. En voilà pourtant une qu’on m’apporte, et qui est beaucoup. Certainement, Lady William Bentinck est une bonne femme. Je le savais. A présent, je lui en sais gré. A-t-elle été jusqu'à vous offrir son perroquet, ce perroquet favori qui va se promener avec elle ? Je suis bien aise que le Duc de Wellington, n'ait pas notre rhumatisme. Je dis notre, car décidément j'ai les épaules un peu entreprises. Je n’ai pas même le temps de lire les journaux. J'ai laissé les miens à Paris. Il faudrait ici aller Ies chercher au Club. On me les raconte. Et je n’ai pas besoin qu’on me les raconte. Je les fais bien tout seul, amis ou ennemis. Le rabâchage règne et gouverne dans le monde. J’ai bien remarqué l'âpreté anglaise dans cette affaire du Pilote. Il y a quelque chose de plus que l'humeur de l'affaire même. C’est une humeur générale, et qui prend plaisir à se faire sentir, les plus simples en sont frappés, et frappés aussi de la chose même, de l'étourderie de ce jeune Prince, et de l’inconvénient des étourderies princières. On va de là aux faiblesses royales. Et de là on vient à moi, pour me donner raison. Le Duc d'Orléans a passé ici, cette nuit. Il va sans doute au devant du Prince de Joinville. Nous sommes sur la route de Brest.
Adieu. A mercredi. J’ai ces 24 heures là bien lourdes, sur le cœur. Il n'y a pas moyen. Adieu.
184. Paris, Mercredi 27 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
184 Paris, Mercredi 21 février 1839
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
185. Paris, Jeudi 28 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
185 Paris, le 28 février jeudi 1839
Votre lettre m’a réjoui le cœur ce matin, je vous en remercie. Vous saurez que le duc de Wellington a eu une paralysie à ma façon, un rhumatisme dans les épaules, pas autre chose. Il se porte bien. J’ai vu chez moi hier matin, mon ambassadeur, M. de Montrond, et Lady William Bentinck. La bonne femme ! Je pleurais. lorsqu'elle est entrée, car je pleure souvent. Cela l’a fort touchée. Elle m’a fait toutes les propositions imaginables. Elle voulait m’envoyer un espagnol un homme qu’elle aime beaucoup, un excellent homme à ce qu’elle dit qui viendrait chez moi tous les jours pour me distraire ! Et puis elle m’a demandé si elle pourrait m’envoyer des oiseaux, elle dit que les oiseaux distraient. Enfin elle m’a envoyé des gravures, et puis elle veut que j'aille dîner demain seule avec elle et son mari. Comprenez-vous qu’on puisse rire et s’attendrir tout à la fois ? Il y avait tant de bon cœur et tant de bêtise dans tout cela que je ne savais comment m'arranger entre mes larmes et un peu d’envie de me moquer d’elle la reconnaissance l’a emportée, et je range Lady Wlliam dans la catégorie des plus excellentes femmes, que j'aie jamais rencontrée.
Je n’ai trouvé chez Mad. de Talleyrand à dîner que M. de Montrond. Elle est inquiète de ce que le consentement de son mari au mariage de Pauline tarde tant. Palhen en est maigrie.
Le soir j'ai vu chez moi Messieurs d’Armin, de Pahlen, et de Noailles et M. Molé ; qui est fort bien touché. Il avait sa plus douce mine, et de la bonne humeur. Il attend, comme tout le monde attend. Mercredi si le temps est clair, il saura tout. Il m’a confirmé ce que je vous disais d’Espagne. Maroto est mis hors de la loi déclaré traître. Vous voyez dans les journaux à quel point on s'émeut en Angleterre pour l’affaire du pilote. Lisez la discussion à la Chambre basse. Adieu votre lettre est charmante et bonne. Mais je n’aime pas les lettres. Adieu. Adieu.
Votre lettre m’a réjoui le cœur ce matin, je vous en remercie. Vous saurez que le duc de Wellington a eu une paralysie à ma façon, un rhumatisme dans les épaules, pas autre chose. Il se porte bien. J’ai vu chez moi hier matin, mon ambassadeur, M. de Montrond, et Lady William Bentinck. La bonne femme ! Je pleurais. lorsqu'elle est entrée, car je pleure souvent. Cela l’a fort touchée. Elle m’a fait toutes les propositions imaginables. Elle voulait m’envoyer un espagnol un homme qu’elle aime beaucoup, un excellent homme à ce qu’elle dit qui viendrait chez moi tous les jours pour me distraire ! Et puis elle m’a demandé si elle pourrait m’envoyer des oiseaux, elle dit que les oiseaux distraient. Enfin elle m’a envoyé des gravures, et puis elle veut que j'aille dîner demain seule avec elle et son mari. Comprenez-vous qu’on puisse rire et s’attendrir tout à la fois ? Il y avait tant de bon cœur et tant de bêtise dans tout cela que je ne savais comment m'arranger entre mes larmes et un peu d’envie de me moquer d’elle la reconnaissance l’a emportée, et je range Lady Wlliam dans la catégorie des plus excellentes femmes, que j'aie jamais rencontrée.
Je n’ai trouvé chez Mad. de Talleyrand à dîner que M. de Montrond. Elle est inquiète de ce que le consentement de son mari au mariage de Pauline tarde tant. Palhen en est maigrie.
Le soir j'ai vu chez moi Messieurs d’Armin, de Pahlen, et de Noailles et M. Molé ; qui est fort bien touché. Il avait sa plus douce mine, et de la bonne humeur. Il attend, comme tout le monde attend. Mercredi si le temps est clair, il saura tout. Il m’a confirmé ce que je vous disais d’Espagne. Maroto est mis hors de la loi déclaré traître. Vous voyez dans les journaux à quel point on s'émeut en Angleterre pour l’affaire du pilote. Lisez la discussion à la Chambre basse. Adieu votre lettre est charmante et bonne. Mais je n’aime pas les lettres. Adieu. Adieu.
186. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
186. Samedi 2 mars 7 heures et demie
Le soleil a beau briller la rivière, a beau couler gaiement devant ma fenêtre ; tout ce qui m'entoure a beau prendre soin de m'animer et de me plaire. Je pense tristement à vous, si triste ! Je me sens seul loin de vous, si seul !
Je vous l'ai dit bien souvent; je puis me répandre au dehors ; je puis paraître, je puis être très occupé, très actif, et que tout cela soit point un mensonge, point un effort, mais très superficiel, très indifférent pour moi, pour ce qui est vraiment moi. Moi, c’est ce qui m’aime et ce que j'aime. Moi, c’est vous, vous de loin vu de près, triste ou gaie, pleurant ou souriant, juste ou injuste même. Mais ne soyez pas injuste ; ne le soyez jamais !
J'ai bien raison d'être triste avec vous. Voilà votre pauvre lettre. C’est bien assez du mal des jours ; les mots devraient être un repos. Je regrette quelque fois que vous ne soyez pas en état et aussi en nécessité absolue de vous fatiguer physiquement. Je l’ai éprouvé ; l'extrême fatigue endort la douleur ; quand le corps s'affaisse, l’âme s’apaise. Paix stérile, paix sans joie, mais qui donne quelque relâche et rend quelque force. Et puis, quand de cruelles images vous assiègent, quand vous n'êtes entourée que de morts, faites un effort, prenez votre élan ; sortez de ces tombeaux. Ils en sont sortis ; ils sont ailleurs. Nous serons où ils sont. Je me suis longtemps épuisé à chercher où ils sont et comment ils y sont. Je ne recueillais de mon travail que ténèbres et anxiété. C’est qu’il ne nous est pas donné, il ne nous est pas permis de voir clair d’une rive à l'autre. Si nous y voyions clair, s'ils étaient là devant nos yeux, nous appelant, nous attendant, supporterions-nous de rester où nous sommes aussi longtemps que Dieu l’ordonne ? Ferions-nous jusqu'au bout notre tâche ? Nous nous refuserions à tout, nous abandonnerions tout ; nous jetterions là notre fardeau, notre devoir, et nous nous précipiterions vers cette rive où nous les verrions clairement. Dieu ne le veut pas, mon amie. Dieu veut que nous restions où il nous a mis, tant qu’il nous y laisse. C'est pourquoi, il nous refuse cette lumière certaine, vive qui nous attirerait invinciblement ailleurs ; c'est pourquoi il couvre d'obscurité ce séjour inconnu où ceux qui nous sont chers emporteraient toute notre âme. Mais l’obscurité ne détruit pas ce qu’elle cache ; mais cette autre rêve où ils nous ont devancés, n'en existe pas moins parce qu'un nuage s'étend sur le fleuve qui nous en sépare. Il faut renoncer à voir dearest, il faut renoncer à comprendre. Il faut croire en Dieu. Depuis que je me suis renfermé dans la foi en Dieu, depuis que j’ai jeté à ses pieds toutes les prétentions de mon intelligence, et même les ambitions prématurées de mon âme, j'avance en paix quoique dans la nuit, et j'ai atteint la certitude, en acceptant mon ignorance. Que je voudrais vous donner la même sécurité la même paix ! Je ne renonce pas, je ne veux pas renoncer à l’espérer.
Midi
Je vais aller voter pour la formation du bureau. Demain, je serai retenu toute la journée, car on veut me nommer Président du Collège. Je ne pourrai probablement vous écrire que quelques lignes. Je les retarderai jusqu’au dernier moment ; il est possible que le scrutin soit dépouillé avant le départ du courrier. Je vous en dirais le résultat. Moi aussi, j’attends. Je viens de recevoir une lettre de M. Jaubert qui me rassure tout à fait sur l’élection de M. Duvergier. D'autant que Jaubert est disposé à voir en noir. Je suis préoccupé de celle de M. Joseph Poirier. J'y tiens et j'en ai toujours été un peu inquiet. Nous verrons. Je ne crains pas grand chose du résultat définitif, quel qu’il soit. Si la victoire ne nous est pas donnée du premier coup, nous aurons certainement de quoi la prendre. Peut-être cela vaudrait-il mieux. En tous cas, je suis résigné et prêt. Adieu. Ne soyez pas trop souffrante, je vous en prie. Mon ambition est bien modeste. Adieu. G.
Le soleil a beau briller la rivière, a beau couler gaiement devant ma fenêtre ; tout ce qui m'entoure a beau prendre soin de m'animer et de me plaire. Je pense tristement à vous, si triste ! Je me sens seul loin de vous, si seul !
Je vous l'ai dit bien souvent; je puis me répandre au dehors ; je puis paraître, je puis être très occupé, très actif, et que tout cela soit point un mensonge, point un effort, mais très superficiel, très indifférent pour moi, pour ce qui est vraiment moi. Moi, c’est ce qui m’aime et ce que j'aime. Moi, c’est vous, vous de loin vu de près, triste ou gaie, pleurant ou souriant, juste ou injuste même. Mais ne soyez pas injuste ; ne le soyez jamais !
J'ai bien raison d'être triste avec vous. Voilà votre pauvre lettre. C’est bien assez du mal des jours ; les mots devraient être un repos. Je regrette quelque fois que vous ne soyez pas en état et aussi en nécessité absolue de vous fatiguer physiquement. Je l’ai éprouvé ; l'extrême fatigue endort la douleur ; quand le corps s'affaisse, l’âme s’apaise. Paix stérile, paix sans joie, mais qui donne quelque relâche et rend quelque force. Et puis, quand de cruelles images vous assiègent, quand vous n'êtes entourée que de morts, faites un effort, prenez votre élan ; sortez de ces tombeaux. Ils en sont sortis ; ils sont ailleurs. Nous serons où ils sont. Je me suis longtemps épuisé à chercher où ils sont et comment ils y sont. Je ne recueillais de mon travail que ténèbres et anxiété. C’est qu’il ne nous est pas donné, il ne nous est pas permis de voir clair d’une rive à l'autre. Si nous y voyions clair, s'ils étaient là devant nos yeux, nous appelant, nous attendant, supporterions-nous de rester où nous sommes aussi longtemps que Dieu l’ordonne ? Ferions-nous jusqu'au bout notre tâche ? Nous nous refuserions à tout, nous abandonnerions tout ; nous jetterions là notre fardeau, notre devoir, et nous nous précipiterions vers cette rive où nous les verrions clairement. Dieu ne le veut pas, mon amie. Dieu veut que nous restions où il nous a mis, tant qu’il nous y laisse. C'est pourquoi, il nous refuse cette lumière certaine, vive qui nous attirerait invinciblement ailleurs ; c'est pourquoi il couvre d'obscurité ce séjour inconnu où ceux qui nous sont chers emporteraient toute notre âme. Mais l’obscurité ne détruit pas ce qu’elle cache ; mais cette autre rêve où ils nous ont devancés, n'en existe pas moins parce qu'un nuage s'étend sur le fleuve qui nous en sépare. Il faut renoncer à voir dearest, il faut renoncer à comprendre. Il faut croire en Dieu. Depuis que je me suis renfermé dans la foi en Dieu, depuis que j’ai jeté à ses pieds toutes les prétentions de mon intelligence, et même les ambitions prématurées de mon âme, j'avance en paix quoique dans la nuit, et j'ai atteint la certitude, en acceptant mon ignorance. Que je voudrais vous donner la même sécurité la même paix ! Je ne renonce pas, je ne veux pas renoncer à l’espérer.
Midi
Je vais aller voter pour la formation du bureau. Demain, je serai retenu toute la journée, car on veut me nommer Président du Collège. Je ne pourrai probablement vous écrire que quelques lignes. Je les retarderai jusqu’au dernier moment ; il est possible que le scrutin soit dépouillé avant le départ du courrier. Je vous en dirais le résultat. Moi aussi, j’attends. Je viens de recevoir une lettre de M. Jaubert qui me rassure tout à fait sur l’élection de M. Duvergier. D'autant que Jaubert est disposé à voir en noir. Je suis préoccupé de celle de M. Joseph Poirier. J'y tiens et j'en ai toujours été un peu inquiet. Nous verrons. Je ne crains pas grand chose du résultat définitif, quel qu’il soit. Si la victoire ne nous est pas donnée du premier coup, nous aurons certainement de quoi la prendre. Peut-être cela vaudrait-il mieux. En tous cas, je suis résigné et prêt. Adieu. Ne soyez pas trop souffrante, je vous en prie. Mon ambition est bien modeste. Adieu. G.
186. Paris, Vendredi 1er Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
186 Paris le 1er mars, vendredi 1839
J’ai passé une nuit affreuse. de l’insomnie, & des rêves l'un plus hideux que l’autre. Des meurtres et rien que des morts autour de moi. Des morts chéris, d'autres indifférents, mais enfin je n'étais pas de ce monde. Et je me suis tout-à-fait brisée ce matin. Votre lettre m’a remise un peu, je vous en remercie. Je vous vois content et je le suis.
Les journaux disent que M. Duvergier de Hauranne n’est pas aussi content que vous et qu'il va perdre son élection, ah cela par exemple fera un grand plaisir dans le camp ministériel. M. Appony m'a fait une longue visite hier matin. Il n’est pas tranquille. L'avènement possible de M. Thiers le trouble à un degré un peu excessif. Il y a là quelque mystère, quelque personnalité dont je n’ai pas la clé. La discussion à Bruxelles est remise à la semaine prochaine. Les troupes prussiennes sont en force sur la frontière. Partout on s’émeut fort de la situation des affaires en France. Vous êtes de grands perturbateurs.
J'ai vu longtemps hier matin Lady Granville et son mari. J'ai fait une longue promenade au bois de Boulogne par un temps. charmant. Le soir j’ai reçu mon ambassadeur, la Sardaigne, Naples, la Suisse, et le Duc de Richelieu. Le faubourg St Germain a une grande admiration pour le duc de Joinville. Messieurs ses frères sont partis hier pour aller à sa rencontre. Ils le ramènent aujourd’hui à Paris. Voilà toutes mes nouvelles.
J'écris aujourd’hui à mes deux fils, et à la Duchesse de Sutherland. Elle prolongera son séjour en Italie, ce dont je suis fâchée. M. Ellice sera ici le 20, il est dans une fort grande admiration de la coalition ! Adieu vous ne concevez pas comme je me sens souffrante. C’est peut être le temps. Je n’en sais rien, mais je ne vaux rien. Adieu. Adieu.
J’ai passé une nuit affreuse. de l’insomnie, & des rêves l'un plus hideux que l’autre. Des meurtres et rien que des morts autour de moi. Des morts chéris, d'autres indifférents, mais enfin je n'étais pas de ce monde. Et je me suis tout-à-fait brisée ce matin. Votre lettre m’a remise un peu, je vous en remercie. Je vous vois content et je le suis.
Les journaux disent que M. Duvergier de Hauranne n’est pas aussi content que vous et qu'il va perdre son élection, ah cela par exemple fera un grand plaisir dans le camp ministériel. M. Appony m'a fait une longue visite hier matin. Il n’est pas tranquille. L'avènement possible de M. Thiers le trouble à un degré un peu excessif. Il y a là quelque mystère, quelque personnalité dont je n’ai pas la clé. La discussion à Bruxelles est remise à la semaine prochaine. Les troupes prussiennes sont en force sur la frontière. Partout on s’émeut fort de la situation des affaires en France. Vous êtes de grands perturbateurs.
J'ai vu longtemps hier matin Lady Granville et son mari. J'ai fait une longue promenade au bois de Boulogne par un temps. charmant. Le soir j’ai reçu mon ambassadeur, la Sardaigne, Naples, la Suisse, et le Duc de Richelieu. Le faubourg St Germain a une grande admiration pour le duc de Joinville. Messieurs ses frères sont partis hier pour aller à sa rencontre. Ils le ramènent aujourd’hui à Paris. Voilà toutes mes nouvelles.
J'écris aujourd’hui à mes deux fils, et à la Duchesse de Sutherland. Elle prolongera son séjour en Italie, ce dont je suis fâchée. M. Ellice sera ici le 20, il est dans une fort grande admiration de la coalition ! Adieu vous ne concevez pas comme je me sens souffrante. C’est peut être le temps. Je n’en sais rien, mais je ne vaux rien. Adieu. Adieu.
187. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
187 Lisieux. Samedi 2 mars, 5 heures
Je prends mes précautions aujourd’hui pour vous dire quelques mots. Demain à 8 heures du matin, il faut que je sois à mon collège dont je viens d'être nommé Président à l'unanimité, moins ma propre voix. J’y passerai la matinée. Une fois élu je remercierai les électeurs. Après mon speech, les visites de corps, une sérénade, un banquet. Je ne disposerai pas de cinq minutes. Encore si c'était fini, si je pouvais partir sur le champ ! Mais restera le dîner du lundi. Vous m'écrirez encore un mot lundi matin, n’est-ce pas, pour que mon mardi ne soit pas vide. Onze heures Un flux d’électeurs m'est arrivé comme je vous écrivais. Ma soirée en a été remplie. Je reviens me coucher. Vous m’avez souvent parlé de la vie précipitée de votre cour impériale ; toujours aller, venir, s'habiller, recevoir, être reçu, pas un mouvement libre, pas une minute à soi. Mon souverain d'ici en exige autant ; seulement il ne dure que huit jours. Adieu. Je vais me coucher. Quelle pitié de ne vous envoyer pour demain que mon propre ennui ! J'en ai le cœur serré. Adieu. Adieu.
Je prends mes précautions aujourd’hui pour vous dire quelques mots. Demain à 8 heures du matin, il faut que je sois à mon collège dont je viens d'être nommé Président à l'unanimité, moins ma propre voix. J’y passerai la matinée. Une fois élu je remercierai les électeurs. Après mon speech, les visites de corps, une sérénade, un banquet. Je ne disposerai pas de cinq minutes. Encore si c'était fini, si je pouvais partir sur le champ ! Mais restera le dîner du lundi. Vous m'écrirez encore un mot lundi matin, n’est-ce pas, pour que mon mardi ne soit pas vide. Onze heures Un flux d’électeurs m'est arrivé comme je vous écrivais. Ma soirée en a été remplie. Je reviens me coucher. Vous m’avez souvent parlé de la vie précipitée de votre cour impériale ; toujours aller, venir, s'habiller, recevoir, être reçu, pas un mouvement libre, pas une minute à soi. Mon souverain d'ici en exige autant ; seulement il ne dure que huit jours. Adieu. Je vais me coucher. Quelle pitié de ne vous envoyer pour demain que mon propre ennui ! J'en ai le cœur serré. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Mandat local
187. Paris, Samedi 2 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
187 Samedi 2 mars 1839
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
188. Lisieux, Lundi 4 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
188 Lundi 2 heures
C’est aujourd’hui que je ne puis vous écrire qu’un mot au milieu de trente visites. Ma Chambre ne désemplit pas. J’ai eu un succès complet, comme il me convenait. Les Républicains et les Carlistes se sont abstenus. Et j’ai eu presque l'unanimité, 477 voix sur 525, c'est-à-dire 156 voix de plus qu’à ma dernière élection, et 67 voix de plus que dans l’élection où j'en avais le plus obtenu. Le pays est charmé de moi, & moi de lui. Vous verrez dans les journaux ce que je leur ai dit après l'élection. Toute la population m’a suivi dans les rues jusqu'à ma porte. On ne me dira plus que je ne suis pas populaire du moins jusqu’à ce que j’y aie mis ordre moi-même. Tout va assez bien autour de moi. Je ne connais encore que 8 élections. Le Ministère y a déjà perdu 2 voix, et nous point. J’en saurai davantage mercredi matin, car je pars demain bien décidément, & je vous verrai mercredi.
J’espère que le retard de Paul n'aura pas pour lui de suite fâcheuse. Mais à sa place je serais parti sur le champ. J'estime trop l'indépendance pour la mettre à toute sauce. Nous causerons de tout cela Mercredi. Farewell, farewell fom the deepest of my heart !
C’est aujourd’hui que je ne puis vous écrire qu’un mot au milieu de trente visites. Ma Chambre ne désemplit pas. J’ai eu un succès complet, comme il me convenait. Les Républicains et les Carlistes se sont abstenus. Et j’ai eu presque l'unanimité, 477 voix sur 525, c'est-à-dire 156 voix de plus qu’à ma dernière élection, et 67 voix de plus que dans l’élection où j'en avais le plus obtenu. Le pays est charmé de moi, & moi de lui. Vous verrez dans les journaux ce que je leur ai dit après l'élection. Toute la population m’a suivi dans les rues jusqu'à ma porte. On ne me dira plus que je ne suis pas populaire du moins jusqu’à ce que j’y aie mis ordre moi-même. Tout va assez bien autour de moi. Je ne connais encore que 8 élections. Le Ministère y a déjà perdu 2 voix, et nous point. J’en saurai davantage mercredi matin, car je pars demain bien décidément, & je vous verrai mercredi.
J’espère que le retard de Paul n'aura pas pour lui de suite fâcheuse. Mais à sa place je serais parti sur le champ. J'estime trop l'indépendance pour la mettre à toute sauce. Nous causerons de tout cela Mercredi. Farewell, farewell fom the deepest of my heart !
Mots-clés : Elections (France), Enfants (Benckendorff), Mandat local
188. Paris, Dimanche 3 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
188 Paris 3 mars Dimanche 1839
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 (27 février - 4 mars)
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
189 Paris Lundi le 4 mars. 1839
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
190. Paris, Dimanche 2 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
190 Paris, Dimanche le 2 juin 1839
Je ne veux pas vous dire ma tristesse, je ne vous l’exprimerai jamais comme elle est et vous n'avez pas besoin de mes paroles pas dessus mes larmes. J’ai vu hier matin Bulwer, dont Je suis contente. Il fera ainsi que Cumming tout ce qu’il est possible de faire. J’ai vu mon ambassadeur que je verrai encore aujourd'hui et puis j’ai vu Zéa qui est tout rempli de vous et de reconnaissance pour moi du bien que je vous ai dit de lui. Il part pour Londres aujourd'hui et finira par Bade après être revenu vous voir à Paris. J’ai dîné chez Mad. de Talleyrand seule. Elle est fort souffrante, fort bonne pour moi. Elle m’a parlé de vous sans me parler de votre lettre comme de raison. Elle part à onze heures et moi à 9. Je l'attendrai à Sézanne et puis nous verrons. J'ai passé le soir chez Lady Granville. Son mari est malade, j'y dîne aujourd'hui. Je me suis couché à 10 heures. J’ai peu et mal dormi. Vous savez ce qui m'a occupé - ce qui m'occupera toute ma vie mais ce qui devrait me laisser dormir. J'espère que vous ne vous trompez pas pour ma nuit dernière. Je suis excédée de fatigue, je voudrais être partie. Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse plus que je n’y ai jamais pensé. Dites moi que nous nous reverrons. Adieu.
Je ne veux pas vous dire ma tristesse, je ne vous l’exprimerai jamais comme elle est et vous n'avez pas besoin de mes paroles pas dessus mes larmes. J’ai vu hier matin Bulwer, dont Je suis contente. Il fera ainsi que Cumming tout ce qu’il est possible de faire. J’ai vu mon ambassadeur que je verrai encore aujourd'hui et puis j’ai vu Zéa qui est tout rempli de vous et de reconnaissance pour moi du bien que je vous ai dit de lui. Il part pour Londres aujourd'hui et finira par Bade après être revenu vous voir à Paris. J’ai dîné chez Mad. de Talleyrand seule. Elle est fort souffrante, fort bonne pour moi. Elle m’a parlé de vous sans me parler de votre lettre comme de raison. Elle part à onze heures et moi à 9. Je l'attendrai à Sézanne et puis nous verrons. J'ai passé le soir chez Lady Granville. Son mari est malade, j'y dîne aujourd'hui. Je me suis couché à 10 heures. J’ai peu et mal dormi. Vous savez ce qui m'a occupé - ce qui m'occupera toute ma vie mais ce qui devrait me laisser dormir. J'espère que vous ne vous trompez pas pour ma nuit dernière. Je suis excédée de fatigue, je voudrais être partie. Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse plus que je n’y ai jamais pensé. Dites moi que nous nous reverrons. Adieu.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
190 je crois.
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
191. Sézanne, Lundi 3 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
191 Sézanne lundi 3 juin 1839 7 heures
Vous voulez savoir de mes nouvelles. J’ai cheminé tristement, bien tristement. Mais me voici. Je vais dîner, je fais comme à Boulogne je vous prends avant mon dîné et j'ai bien faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire ; je ne vous les dirai que de Baden, de très mauvaises nouvelles de mes affaires. C'est de mal en pire en Courlande rien rien du tout. Il me semble que lorsque on saura cela, il est difficile qu'on en fasse pas quelque chose. Comment vont se conduire mes fils ? Voulez- vous que je vous le dise ? Mon inquiétude porte sur l’opinion qu’ils vont donner d’eux ! Adieu. Adieu que ce sera long, long, triste. Je pense à vous sans cesse. Oubliez la calèche. Je reviendrai riche ou pauvre. Mon orgueil s'abaisse devant mon amour. Adieu. Je suis morte de fatigue mais adieu mille fois.
Vous voulez savoir de mes nouvelles. J’ai cheminé tristement, bien tristement. Mais me voici. Je vais dîner, je fais comme à Boulogne je vous prends avant mon dîné et j'ai bien faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire ; je ne vous les dirai que de Baden, de très mauvaises nouvelles de mes affaires. C'est de mal en pire en Courlande rien rien du tout. Il me semble que lorsque on saura cela, il est difficile qu'on en fasse pas quelque chose. Comment vont se conduire mes fils ? Voulez- vous que je vous le dise ? Mon inquiétude porte sur l’opinion qu’ils vont donner d’eux ! Adieu. Adieu que ce sera long, long, triste. Je pense à vous sans cesse. Oubliez la calèche. Je reviendrai riche ou pauvre. Mon orgueil s'abaisse devant mon amour. Adieu. Je suis morte de fatigue mais adieu mille fois.
191. Val-Richer, Mardi 4 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
191 Du Val Richer - Mardi 4 juin 1839
Je vous voudrais comme ma vallée, fraiche et riante. Je la regarde avec envie en pensant à vous. Et bientôt je ne la regarde plus ; je ne pense plus qu'à vous. Je vous vois maigre, triste, desponding, en larmes. Et pourtant je ne retourne pas à ma vallée ; je reste avec vous. Je resterai toujours avec vous.
L’annulation de l'élection de M. d’Houdetot, réélu à si grand'peine, est un petit incident fort désagréable au château. On en a été très piqué. Il ne faut pas avoir tort en face de ses ennemis Mr d’Houdetot avait tort. C’est l'erreur des gens de cour, puisque cour y a, de croire qu'ailleurs aussi, ils auront le privilège de la faveur. Il y a des favoris partout, mais non partout les mêmes. Les esprits impartiaux, les honnêtes gens ont voté contre M. d’Houderot. Le pire, c’est qu’il ne peut plus se représenter puisqu’il n’est pas éligible. Le choix tombera probablement sur un homme de l'opposition.
Il paraît que le procès aura lieu décidément vers le milieu de Juin. On le presse ; on ne veut pas que, s’il doit y avoir des exécutions, elles soient trop voisines des fêtes de Juillet ; et très probablement il y en aura. L'assassinat est prouvé, dit-on, contre deux des accusés, et des principaux. L’un, le nommé Barbès a tué de sa main l'officier qui commandait le poste du Palais de justice, l'autre Milon, Miron, je ne sais pas bien, a fait fusiller trois soldats, après avoir enlevé un corps de garde. Plusieurs témoins les reconnaissent.
Après les fêtes de Juillet, le Roi veut aller à Bordeaux. Il a formé plusieurs fois ce projet. Je doute qu'il l'exécute encore. Cependant il le promet. Bordeaux le demande beaucoup, et comme une réparation. Ils disent que jamais Roi ou Empereur ne les a laissés neuf ans sans aller les voir. Le Maréchal Vallée avait demandé plusieurs fois à être rappelé. On s'est montré disposé à le lui accorder. On lui aurait donné le Général Cubieres pour successeur. Il ne s'en est plus soucié, et il reste. J’en suis bien aise. A travers toutes les manies d’un esprit systématique et d’un caractère insociable, c’est un homme honnête, capable et prudent. Qualités dont notre établissement d'Afrique à grand besoin. Je m'intéresse à cet établissement. Je m’en suis beaucoup mêlé.
Mon sac est vidé, madame. Bien petit sac cette fois, et probablement souvent jusqu'à ce que je retourne à Paris. On ne m'écrit guères les petites choses, et il n’y en a pas de grandes. Vous n’avez probablement jamais ouvert un livre intitulé : Historiettes de Tallemant des Réaux. C'était un abbé du 17e siècle qui écrivait tous les soirs tout ce qu’il avait entendu dire sur toutes les personnes dont tout le monde parlait. Il a écrit ainsi six gros volumes curieux et amusants, quoique pleins d'énormes sottises. Quelqu'un de votre connaissance, mon Génie, se donne le même plaisir sur notre temps. Il laissera des volumes beaucoup plus convenables, j’en suis sûr que ceux de l'abbé Tallemant, et peut-être assez piquants. On oublie beaucoup trop en ce monde. En attendant de vraies nouvelles d'Orient, j’ai apporté ici et je lisais tout à l'heure l'ouvrage de M. Urquhart de la Turquie et de ses ressources. Savez-vous au juste quel cas on fait à Londres de l'auteur ? Le livre me semble bien vide, avec de grandes prétentions.
Adieu pour aujourd'hui. Je vous quitte pour aller assister à des plantations de fleurs ; je devrais dire coopérer. Je transporte le jardin du Roi au Val-Richer. Je mentirais si je disais que cela ne m'amuse pas du tout ; et je mentirais bien davantage si je disais que cela m'intéresse vraiment. On peut vivre superficiellement ; mais il n'y a pas moyen de s’y tromper. Pour moi, je n'y prétends pas.
Mercredi 7 heures Depuis que je ne vous vois plus, ma perplexité est extrême. Je suis bien plus inquiet ; j'ai besoin que vous me rassuriez, et j'hésite à vous le demander, à vous occuper de votre santé. Convenons d'une chose ; c’est que vous me direz tout, absolument tout ; je n'ignorerai aucun détail, ni aucune de vos inquiétudes. Ce sera comme si je vous voyais, sauf le plaisir de vous voir. A cette condition, je ne vous agiterai pas, de mon tourment. J’attends presque avec humeur le moment où j’attendrai vos lettres à jour fixe. En aurai-je ? N'en aurai-je pas ? Cette ignorance m'est insupportable. J’en ai encore pour huit jours avant que vous vous soyiez posée, que je le sache du moins et que jen éprouve l'effet. Où êtes-vous en ce moment ? à Vitry, je pense. Vous vous levez. Vous allez partir pour Nancy. J’ai fait cette route-là, il y a douze ans, le cœur bien déchiré. Je conduisais à Plombières ma femme mourante.
Que notre âme est étrange, & tout ce qui s’y passe dans le cours de la vie ! Quels contrastes, quels désaccords, impossibles à concevoir ensemble, et qui coexistent pourtant & s'effacent et disparaissent dans cette mer du temps qui couvre de son uniformité tout ce qu'elle engloutit Adieu. Adieu.
9 heures. Voilà le facteur, et deux lettres de Paris qui ne m’apportent rien à vous envoyer. Adieu encore.
Je vous voudrais comme ma vallée, fraiche et riante. Je la regarde avec envie en pensant à vous. Et bientôt je ne la regarde plus ; je ne pense plus qu'à vous. Je vous vois maigre, triste, desponding, en larmes. Et pourtant je ne retourne pas à ma vallée ; je reste avec vous. Je resterai toujours avec vous.
L’annulation de l'élection de M. d’Houdetot, réélu à si grand'peine, est un petit incident fort désagréable au château. On en a été très piqué. Il ne faut pas avoir tort en face de ses ennemis Mr d’Houdetot avait tort. C’est l'erreur des gens de cour, puisque cour y a, de croire qu'ailleurs aussi, ils auront le privilège de la faveur. Il y a des favoris partout, mais non partout les mêmes. Les esprits impartiaux, les honnêtes gens ont voté contre M. d’Houderot. Le pire, c’est qu’il ne peut plus se représenter puisqu’il n’est pas éligible. Le choix tombera probablement sur un homme de l'opposition.
Il paraît que le procès aura lieu décidément vers le milieu de Juin. On le presse ; on ne veut pas que, s’il doit y avoir des exécutions, elles soient trop voisines des fêtes de Juillet ; et très probablement il y en aura. L'assassinat est prouvé, dit-on, contre deux des accusés, et des principaux. L’un, le nommé Barbès a tué de sa main l'officier qui commandait le poste du Palais de justice, l'autre Milon, Miron, je ne sais pas bien, a fait fusiller trois soldats, après avoir enlevé un corps de garde. Plusieurs témoins les reconnaissent.
Après les fêtes de Juillet, le Roi veut aller à Bordeaux. Il a formé plusieurs fois ce projet. Je doute qu'il l'exécute encore. Cependant il le promet. Bordeaux le demande beaucoup, et comme une réparation. Ils disent que jamais Roi ou Empereur ne les a laissés neuf ans sans aller les voir. Le Maréchal Vallée avait demandé plusieurs fois à être rappelé. On s'est montré disposé à le lui accorder. On lui aurait donné le Général Cubieres pour successeur. Il ne s'en est plus soucié, et il reste. J’en suis bien aise. A travers toutes les manies d’un esprit systématique et d’un caractère insociable, c’est un homme honnête, capable et prudent. Qualités dont notre établissement d'Afrique à grand besoin. Je m'intéresse à cet établissement. Je m’en suis beaucoup mêlé.
Mon sac est vidé, madame. Bien petit sac cette fois, et probablement souvent jusqu'à ce que je retourne à Paris. On ne m'écrit guères les petites choses, et il n’y en a pas de grandes. Vous n’avez probablement jamais ouvert un livre intitulé : Historiettes de Tallemant des Réaux. C'était un abbé du 17e siècle qui écrivait tous les soirs tout ce qu’il avait entendu dire sur toutes les personnes dont tout le monde parlait. Il a écrit ainsi six gros volumes curieux et amusants, quoique pleins d'énormes sottises. Quelqu'un de votre connaissance, mon Génie, se donne le même plaisir sur notre temps. Il laissera des volumes beaucoup plus convenables, j’en suis sûr que ceux de l'abbé Tallemant, et peut-être assez piquants. On oublie beaucoup trop en ce monde. En attendant de vraies nouvelles d'Orient, j’ai apporté ici et je lisais tout à l'heure l'ouvrage de M. Urquhart de la Turquie et de ses ressources. Savez-vous au juste quel cas on fait à Londres de l'auteur ? Le livre me semble bien vide, avec de grandes prétentions.
Adieu pour aujourd'hui. Je vous quitte pour aller assister à des plantations de fleurs ; je devrais dire coopérer. Je transporte le jardin du Roi au Val-Richer. Je mentirais si je disais que cela ne m'amuse pas du tout ; et je mentirais bien davantage si je disais que cela m'intéresse vraiment. On peut vivre superficiellement ; mais il n'y a pas moyen de s’y tromper. Pour moi, je n'y prétends pas.
Mercredi 7 heures Depuis que je ne vous vois plus, ma perplexité est extrême. Je suis bien plus inquiet ; j'ai besoin que vous me rassuriez, et j'hésite à vous le demander, à vous occuper de votre santé. Convenons d'une chose ; c’est que vous me direz tout, absolument tout ; je n'ignorerai aucun détail, ni aucune de vos inquiétudes. Ce sera comme si je vous voyais, sauf le plaisir de vous voir. A cette condition, je ne vous agiterai pas, de mon tourment. J’attends presque avec humeur le moment où j’attendrai vos lettres à jour fixe. En aurai-je ? N'en aurai-je pas ? Cette ignorance m'est insupportable. J’en ai encore pour huit jours avant que vous vous soyiez posée, que je le sache du moins et que jen éprouve l'effet. Où êtes-vous en ce moment ? à Vitry, je pense. Vous vous levez. Vous allez partir pour Nancy. J’ai fait cette route-là, il y a douze ans, le cœur bien déchiré. Je conduisais à Plombières ma femme mourante.
Que notre âme est étrange, & tout ce qui s’y passe dans le cours de la vie ! Quels contrastes, quels désaccords, impossibles à concevoir ensemble, et qui coexistent pourtant & s'effacent et disparaissent dans cette mer du temps qui couvre de son uniformité tout ce qu'elle engloutit Adieu. Adieu.
9 heures. Voilà le facteur, et deux lettres de Paris qui ne m’apportent rien à vous envoyer. Adieu encore.
192. Safnern, Mercredi 5 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
192 Saverne Mercredi 5 juin 7 heures du soir 1839
J'ai fait hier 20 postes 1/2 et je suis arrivée à Soul morte de fatigue. Madame de T. n'a rien fait pour la diminuer, au contraire, attendu que vous me croyiez en bien bonnes mains. Moi j’étais parfaitement la dupe de mes espérances. Au lieu de secours elle était un obstacle et elle a couronnée la journée en prenant un rez-de-chaussée bien commode, et m’envoyant moi 35 au second pour être bien mal. Secours moral de sa part tant que je voudrais, mais matériel non. C'est une leçon dont je profiterai. Il n’a pas été question qu’elle entre dans ma voiture, enfin rien rien que ce qui lui convenait. Vous voyez que j'ai de la rancune.
En voilà une page toute éclairée. Ici je suis seule heureusement, est bien, je vais manger et me reposer demain je serai à Baden vers les quatre heures, sauf accident. Il pleut des torrents, les routes sont gâtées. Aujourd’hui je me sens mieux et j'ai hâte de vous le dire, et de vous dire aussi que j’ai passé ma journée au Val-Richer et que j’y resterai certainement jusqu’à dimanche. Il me tarde bien d’avoir une lettre J'espère la trouver demain. Adieu, adieux et encore adieu.
J'ai fait hier 20 postes 1/2 et je suis arrivée à Soul morte de fatigue. Madame de T. n'a rien fait pour la diminuer, au contraire, attendu que vous me croyiez en bien bonnes mains. Moi j’étais parfaitement la dupe de mes espérances. Au lieu de secours elle était un obstacle et elle a couronnée la journée en prenant un rez-de-chaussée bien commode, et m’envoyant moi 35 au second pour être bien mal. Secours moral de sa part tant que je voudrais, mais matériel non. C'est une leçon dont je profiterai. Il n’a pas été question qu’elle entre dans ma voiture, enfin rien rien que ce qui lui convenait. Vous voyez que j'ai de la rancune.
En voilà une page toute éclairée. Ici je suis seule heureusement, est bien, je vais manger et me reposer demain je serai à Baden vers les quatre heures, sauf accident. Il pleut des torrents, les routes sont gâtées. Aujourd’hui je me sens mieux et j'ai hâte de vous le dire, et de vous dire aussi que j’ai passé ma journée au Val-Richer et que j’y resterai certainement jusqu’à dimanche. Il me tarde bien d’avoir une lettre J'espère la trouver demain. Adieu, adieux et encore adieu.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
192 Du Val Richer, jeudi 6 juin 1839 2 heures
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
193. Baden, Jeudi 6 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
193 Baden Jeudi 3 heures le 6 juin 1839
Je fais mieux encore que je ne dis. Je suis arrivée à 2 heures, pas. trop fatiguée. J ai trouvé un fort joli logement fort en désordre, il faut passer par un peu d'ennui, je voudrais bien n’avoir à me plaindre que de cela dans ma pauvre vie ! J’ai eu bien de l'émotion en traversant le Rhin, mais cette fois-ci je savais pourquoi ; l'année 36 je n'ai jamais pu le deviner. Je viens de recevoir une lettre du grand Duc, je vous en écrirai copie, une pauvre lettre ; mais enfin c'est du souvenir, c'est tout ce qu'il a à se faire.
5 heures
Voici votre lettre, que je vous remercie ! Je suis triste mais j'essaierai de l'être le moins possible avez-vous eu ma lettre de Sezanne. & de Saverne ? Voyez bien à m'accuser réception de tous mes N°. Voici la lettre du grand duc orthographe & tout.
Londres 19/31 mai 1839
Madame,
Avant de quitter ce pays où vous avez passé tant d’années et où tout ceux que vous ont connu, vous aiment et vous conservent un attachement bien sincères, permettez-moi de vous adresser ce peu de mots pour vous dire, chère Princesse, la peine que j'éprouve de ce que les circonstances ne nous aient pas permis de nous rencontrer. Le séjour que j’ai fait en Angleterre et l'accueil vraiment amical que j’y ai reçu de la part de la Reine, de ses ministres, et je puis le dire avec vérité de le part de tous les partis, me laisseront un souvenir bien agréable pour toute ma vie. Soyez persuadée, Madame que je serais éternellement reconnaissant à la veuve du Prince de Lieven pour l'amitié que son défunt mari n'a jamais cessé de me témoigner et que j'ai su apprécier.
Recevez Madame les assurances des sentiments que je vous ai voués.
Alexandre
Je vais répondre, et vous en aurez copie aussi. Vous ai-je dit qu'Orloff était inquiet de n'avoir rien eu de moi depuis sa lettre. C'est Lady Cowper qui me mande. Je ne sais encore qui est à Baden. Je crois, personne. Au reste je n’ai pas regardé par la fenêtre. Il pleut et fait froid. Bonsoir mais surtout adieu.
Vendredi 7 à 7 heures du matin.
Je me suis coucher à 9 heures levée à 6. J'ai fait une longue promenade pas un beau soleil dans un pays ravissant, j’ai déjeuné et me voici à vous, à vous toujours. Il me semble que je m'arrangerai de ceci très bien pourvu qu'il ne pleuve pas. Vraiment mon logement est charmant, gai, environné de rosiers, d’orangers. Je vous enverrai le dessin, le plan. 2 heures J’ai vu du monde des Russes, que vous ne connaissez pas. M. de Bacourt qui me dit que ma lettre doit être porté de suite à la poste. Adieu donc, adieu, il fait beau, il fait chaud, si vous étiez ici ! God bless you.
Je fais mieux encore que je ne dis. Je suis arrivée à 2 heures, pas. trop fatiguée. J ai trouvé un fort joli logement fort en désordre, il faut passer par un peu d'ennui, je voudrais bien n’avoir à me plaindre que de cela dans ma pauvre vie ! J’ai eu bien de l'émotion en traversant le Rhin, mais cette fois-ci je savais pourquoi ; l'année 36 je n'ai jamais pu le deviner. Je viens de recevoir une lettre du grand Duc, je vous en écrirai copie, une pauvre lettre ; mais enfin c'est du souvenir, c'est tout ce qu'il a à se faire.
5 heures
Voici votre lettre, que je vous remercie ! Je suis triste mais j'essaierai de l'être le moins possible avez-vous eu ma lettre de Sezanne. & de Saverne ? Voyez bien à m'accuser réception de tous mes N°. Voici la lettre du grand duc orthographe & tout.
Londres 19/31 mai 1839
Madame,
Avant de quitter ce pays où vous avez passé tant d’années et où tout ceux que vous ont connu, vous aiment et vous conservent un attachement bien sincères, permettez-moi de vous adresser ce peu de mots pour vous dire, chère Princesse, la peine que j'éprouve de ce que les circonstances ne nous aient pas permis de nous rencontrer. Le séjour que j’ai fait en Angleterre et l'accueil vraiment amical que j’y ai reçu de la part de la Reine, de ses ministres, et je puis le dire avec vérité de le part de tous les partis, me laisseront un souvenir bien agréable pour toute ma vie. Soyez persuadée, Madame que je serais éternellement reconnaissant à la veuve du Prince de Lieven pour l'amitié que son défunt mari n'a jamais cessé de me témoigner et que j'ai su apprécier.
Recevez Madame les assurances des sentiments que je vous ai voués.
Alexandre
Je vais répondre, et vous en aurez copie aussi. Vous ai-je dit qu'Orloff était inquiet de n'avoir rien eu de moi depuis sa lettre. C'est Lady Cowper qui me mande. Je ne sais encore qui est à Baden. Je crois, personne. Au reste je n’ai pas regardé par la fenêtre. Il pleut et fait froid. Bonsoir mais surtout adieu.
Vendredi 7 à 7 heures du matin.
Je me suis coucher à 9 heures levée à 6. J'ai fait une longue promenade pas un beau soleil dans un pays ravissant, j’ai déjeuné et me voici à vous, à vous toujours. Il me semble que je m'arrangerai de ceci très bien pourvu qu'il ne pleuve pas. Vraiment mon logement est charmant, gai, environné de rosiers, d’orangers. Je vous enverrai le dessin, le plan. 2 heures J’ai vu du monde des Russes, que vous ne connaissez pas. M. de Bacourt qui me dit que ma lettre doit être porté de suite à la poste. Adieu donc, adieu, il fait beau, il fait chaud, si vous étiez ici ! God bless you.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
193 Du Val-Richer, Samedi 8 juin 1839 2 heures
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
194. Baden, Samedi 8 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
194 Baden Samedi 8 juin 1839 à 3 heures
J'ai été bien fatiguée toute la matinée j’ai écrit au grand Duc, à Orloff, à mon frère, à mon fils Alexandre. J'ai envoyé copie à mon frère de la lettre du grand Duc et de ma réponse. Tout cela est beaucoup après une mauvaise nuit et par un temps bien chaud. J’ai vu longuement mon médecin. Il veut pour moi du lait d'ânesse, des bains de son, de l’air toujours de l'air, du calme dans ma vie, point de peines ! Point d'agitations ! Il veut que je dorme et avec tout cela il me répond de m'engraisser. Oui mais comment, excepté le lait et le bain, comment avoir tout cela ? Il m’a trouvé extrêmement changée et maigrie il y a longtemps que cela me frappe.
Je ne vois Mad. de Talleyrand qu’une demi-heure par jour, voilà tout, et puis je ne vois personne que Marie qui vient se promener avec moi le soir. Voilà mes dissipations de Baden. Mais le lieu est charmant, le temps superbe. Je ne me plaindrai pas, mais je suis bien seule.
Dimanche 9. à 8 heures du matin.
J'ai reçu hier au soir votre N°191. Je suis avide et heureuse de vos lettres, mettez-vous bien en tête qu’il ne se passe pas de minute où je ne pense à vous. J'ai des nouvelles de mon fils Alexandre. Il est arrivé à Pétersbourg le 22. Mon frère est tout de suite accouru chez mon fils, et les à reçus avec la plus grande tendresse. Alexandre a l’air fort content. Je n’ai rien de mon frère.
Une longue lettre d’Ellice qui ne pense pas que le ministère anglais tienne longtemps. Il croit que Lord Howick fera la brèche. Il est question de dissolution. J'ai presque bien dormi cette nuit.
J’ai commencé ce matin le lait d’ânesse. Je reviens de mon bain qui m’a plu. J'ai marché, j'ai déjeuné et il n’est que huit heures. Hier au soir je me suis fait miner au vieux château. On monte pendant une heure. C’est beau, c’est superbe. Des points de vue admirables des ombrages charmants, venez donc voir cela. Je défie que vous ayez rien vu de comparable. J’étais seule, toujours seule, ah ! que c’est triste ! midi. Je reviens de l'église. J'ai entendu mon excellent sermon, qui m’a bien émue. Vous ne savez pas comme j'ai l’âme tendre et triste. Je vous envoie copie de ma lettre au grand Duc. Dites-moi si elle est bien. Adieu, Adieu, que d'adieux à 120 lieux de distance. Ah que j'aimerai à repasser le Rhin ! Si on s’avisait de me le défendre, qu’est-ce que je ferais ? Adieu. Adieu.
J'ai été bien fatiguée toute la matinée j’ai écrit au grand Duc, à Orloff, à mon frère, à mon fils Alexandre. J'ai envoyé copie à mon frère de la lettre du grand Duc et de ma réponse. Tout cela est beaucoup après une mauvaise nuit et par un temps bien chaud. J’ai vu longuement mon médecin. Il veut pour moi du lait d'ânesse, des bains de son, de l’air toujours de l'air, du calme dans ma vie, point de peines ! Point d'agitations ! Il veut que je dorme et avec tout cela il me répond de m'engraisser. Oui mais comment, excepté le lait et le bain, comment avoir tout cela ? Il m’a trouvé extrêmement changée et maigrie il y a longtemps que cela me frappe.
Je ne vois Mad. de Talleyrand qu’une demi-heure par jour, voilà tout, et puis je ne vois personne que Marie qui vient se promener avec moi le soir. Voilà mes dissipations de Baden. Mais le lieu est charmant, le temps superbe. Je ne me plaindrai pas, mais je suis bien seule.
Dimanche 9. à 8 heures du matin.
J'ai reçu hier au soir votre N°191. Je suis avide et heureuse de vos lettres, mettez-vous bien en tête qu’il ne se passe pas de minute où je ne pense à vous. J'ai des nouvelles de mon fils Alexandre. Il est arrivé à Pétersbourg le 22. Mon frère est tout de suite accouru chez mon fils, et les à reçus avec la plus grande tendresse. Alexandre a l’air fort content. Je n’ai rien de mon frère.
Une longue lettre d’Ellice qui ne pense pas que le ministère anglais tienne longtemps. Il croit que Lord Howick fera la brèche. Il est question de dissolution. J'ai presque bien dormi cette nuit.
J’ai commencé ce matin le lait d’ânesse. Je reviens de mon bain qui m’a plu. J'ai marché, j'ai déjeuné et il n’est que huit heures. Hier au soir je me suis fait miner au vieux château. On monte pendant une heure. C’est beau, c’est superbe. Des points de vue admirables des ombrages charmants, venez donc voir cela. Je défie que vous ayez rien vu de comparable. J’étais seule, toujours seule, ah ! que c’est triste ! midi. Je reviens de l'église. J'ai entendu mon excellent sermon, qui m’a bien émue. Vous ne savez pas comme j'ai l’âme tendre et triste. Je vous envoie copie de ma lettre au grand Duc. Dites-moi si elle est bien. Adieu, Adieu, que d'adieux à 120 lieux de distance. Ah que j'aimerai à repasser le Rhin ! Si on s’avisait de me le défendre, qu’est-ce que je ferais ? Adieu. Adieu.
194. Val-Richer, Lundi 10 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
194 Du Val Richer Lundi 10 juin 1839 4 heures
J’espère que vous avez à Baden un climat moins variable que le mien. Je ne puis garder le soleil deux jours de suite. Je n’aime pas cela. J’aime l’égalité et la durée. Plus ce qui me plaît dure, et dure toujours le même, plus j'en jouis. Je n’ai jamais compris ce que c'était que de se blaser. Il m'est arrivé (et même bien rarement) de reconnaitre que je m'étais trompé, que j’avais eu tort de prendre plaisir à quelque chose ou à quelqu'un ; mais m'en lasser à cause du temps seul, non. Bien loin d'user pour moi ce que j'aime, le temps m’est trop court pour en jouir, selon mon cœur. L’éternité seule y suffirait. Vous êtes-vous jamais figurée ce que serait le bonheur avec la perspective de l'éternité ? Il n'y a d'éternel que mon rhume de cerveau. Ceci, par exemple, je m'en ennuie. Depuis quelques jours, je ne vois rien qu’à travers un nuage, ma vallée, mes enfants, mes idées, sauf une qui est toujours claire et vive. A force d'éternuements de brouillards, de larmes, je me suis endormi hier sur mon canapé en lisant l'Orient. Car décidément je regarde beaucoup à l'Orient. J’en saurai très long sur ces affaires-là. C’est bien dommage que nous ne puissions pas en causer encore avant que j'en parle. Evidemment les évènements ne marchent pas vite, là, et les efforts de l’Europe pour les ajourner arriveront à temps. D'après ce qui me revient, pour peu que l'affaire fût bien conduite, l’hérédité de Méhémet-Ali sortirait de cette crise, et le statu quo, dont on parle toujours après un changement, recommencerait pour un temps.
8 heures et demie
Je viens de faire placer mes orangers. On peut prendre beaucoup d’intérêt à ce qu’on fait par cela seul qu'on le fait. Mais, c’est seulement pendant. qu'on le fait. J’ai planté un monde de fleurs. Dans six semaines le Val Richer sera un bouquet. Que vous revient-il de Londres? Le Cabinet me semble dans une situation de plus en plus précaire Lord Melbourne et Lord John ont l’air d’honnêtes gens à bout de voie, qui ont de l'humeur contre tout le monde, contre qui tout le monde a de l'humeur, et qui ne voulant par aller plus loin, ne peuvent plus aller du tout. On ne me mande rien de Paris, sinon que les grands projets historiques de Thiers, ne sont pas si sérieux qu’on l'affiche, et que tout cet étalage de 500 000 fr. a surtout pour but de rassurer des créanciers, et de les engager à prendre patience. A défaut du Ministère, on leur montre en perspective l'histoire de l'Empire. La Chambre des Pairs s’est bien échauffée sur la Légion d’honneur. Le Ministère y a repris ses avantages. Décidément M. Villemain est l'homme résolu et agissant aussi bien qu'éloquent du Cabinet. Il est toujours question du voyage du Roi à Bordeaux. M. Dufaure l'accompagnerait. Le Roi prend tout à fait possession de M. Dufaure. Il ( je veux dire M. Dufaure) avait aussi votre faveur, Madame ; mais je doute qu'il la conservât de près. Il n’a d’esprit et de talent qu'à la tribune.
Mardi 9 h. J’attends le courrier ce matin avec un surcroit d'impatience. Je n’ai pas eu de lettre depuis deux jours. Enfin celle-ci ouvrira une ère régulière. C’est bien le moins qu’elle soit régulière. Vote embonpoint et vos lettres, je veux ces deux choses-là de votre absence.
1 heure Voilà enfin votre N°193. Encore un nouveau retard de la malle poste. Je suis désolé d'avoir dit qu'il ne fallait pas destituer M. Conte. A demain ma réponse. Il faut que je donne tout de suite ceci. Je suis charmé de vous savoir arrivée bien logée. Adieu. Adieu. Mille et un.
J’espère que vous avez à Baden un climat moins variable que le mien. Je ne puis garder le soleil deux jours de suite. Je n’aime pas cela. J’aime l’égalité et la durée. Plus ce qui me plaît dure, et dure toujours le même, plus j'en jouis. Je n’ai jamais compris ce que c'était que de se blaser. Il m'est arrivé (et même bien rarement) de reconnaitre que je m'étais trompé, que j’avais eu tort de prendre plaisir à quelque chose ou à quelqu'un ; mais m'en lasser à cause du temps seul, non. Bien loin d'user pour moi ce que j'aime, le temps m’est trop court pour en jouir, selon mon cœur. L’éternité seule y suffirait. Vous êtes-vous jamais figurée ce que serait le bonheur avec la perspective de l'éternité ? Il n'y a d'éternel que mon rhume de cerveau. Ceci, par exemple, je m'en ennuie. Depuis quelques jours, je ne vois rien qu’à travers un nuage, ma vallée, mes enfants, mes idées, sauf une qui est toujours claire et vive. A force d'éternuements de brouillards, de larmes, je me suis endormi hier sur mon canapé en lisant l'Orient. Car décidément je regarde beaucoup à l'Orient. J’en saurai très long sur ces affaires-là. C’est bien dommage que nous ne puissions pas en causer encore avant que j'en parle. Evidemment les évènements ne marchent pas vite, là, et les efforts de l’Europe pour les ajourner arriveront à temps. D'après ce qui me revient, pour peu que l'affaire fût bien conduite, l’hérédité de Méhémet-Ali sortirait de cette crise, et le statu quo, dont on parle toujours après un changement, recommencerait pour un temps.
8 heures et demie
Je viens de faire placer mes orangers. On peut prendre beaucoup d’intérêt à ce qu’on fait par cela seul qu'on le fait. Mais, c’est seulement pendant. qu'on le fait. J’ai planté un monde de fleurs. Dans six semaines le Val Richer sera un bouquet. Que vous revient-il de Londres? Le Cabinet me semble dans une situation de plus en plus précaire Lord Melbourne et Lord John ont l’air d’honnêtes gens à bout de voie, qui ont de l'humeur contre tout le monde, contre qui tout le monde a de l'humeur, et qui ne voulant par aller plus loin, ne peuvent plus aller du tout. On ne me mande rien de Paris, sinon que les grands projets historiques de Thiers, ne sont pas si sérieux qu’on l'affiche, et que tout cet étalage de 500 000 fr. a surtout pour but de rassurer des créanciers, et de les engager à prendre patience. A défaut du Ministère, on leur montre en perspective l'histoire de l'Empire. La Chambre des Pairs s’est bien échauffée sur la Légion d’honneur. Le Ministère y a repris ses avantages. Décidément M. Villemain est l'homme résolu et agissant aussi bien qu'éloquent du Cabinet. Il est toujours question du voyage du Roi à Bordeaux. M. Dufaure l'accompagnerait. Le Roi prend tout à fait possession de M. Dufaure. Il ( je veux dire M. Dufaure) avait aussi votre faveur, Madame ; mais je doute qu'il la conservât de près. Il n’a d’esprit et de talent qu'à la tribune.
Mardi 9 h. J’attends le courrier ce matin avec un surcroit d'impatience. Je n’ai pas eu de lettre depuis deux jours. Enfin celle-ci ouvrira une ère régulière. C’est bien le moins qu’elle soit régulière. Vote embonpoint et vos lettres, je veux ces deux choses-là de votre absence.
1 heure Voilà enfin votre N°193. Encore un nouveau retard de la malle poste. Je suis désolé d'avoir dit qu'il ne fallait pas destituer M. Conte. A demain ma réponse. Il faut que je donne tout de suite ceci. Je suis charmé de vous savoir arrivée bien logée. Adieu. Adieu. Mille et un.
195. Baden, Lundi 10 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
195. Baden lundi le 10 juin, 1839, à 8 h matin.
Je n’ai dormi que deux heures cette nuit la lettre de mon banquier m’avait de nouveau renversée. Vous savez comme je le suis aisément. Je m’en vais écrire à moi frère et Matonchewitz. Et j'ai bien peu de forces. Si vous étiez là vous m'en donneriez, et un peu de courage. Mais mes seules ressources ! C’est pitoyable.
Mardi 8 h. du matin
J’ai écrit, je vous enverrai copie si cela ne me coûte pas trop de peine. J’ai reçu votre n° 192. Je serai bien aise de vous écrire à Paris nous serons plus près. J’ai vu Mad. de Talleyrand. Ah que nous sommes loin. Hier un peu plus que de coutume, elle redevient très bonne ; je vous ai dit ; le secours moral, j’y puis compter, l’autre non. Elle me prendra mes chevaux et mes chambres, mais elle me donnera de bons conseils. Voici ma vie à 6 heures hors de mon lit et un verre de lait d’ânesse. Une heure de promenade à pied. Une demi-heure de repos à 7 1/2 un bain de son et de lait à 27 degrés. Dix minutes de bain, à 8 h mon déjeuner, et puis mes lettres à 9 1/2 ma toilette, à 11 heures seconde promenade à pied. à Midi le lunchon. Après de la lecture de 2 à 3 promenade en calèche ; de 3 à 4 je me repose dans le jardin. à 4 heures mon Dieu ! à 5 h., on m'apporte mes lettres et mes journaux, à 6 heures en calèche jusqu'après 8 heures. Ensuite une demi-heure de mon jardin, et à 9 heures mon lit. Voilà exactement mes faits et gestes. Ensuite, Marie vient me voir un quart d’heure dans la matinée pas davantage. Mad. de Talleyrand se promène en calèche avec moi ou le matin ou le soir. Et voilà toutes mes ressources. A propos elle me charge de la rappeler à vous. Dans quelques temps elle vous écrira pour vous dire de mes nouvelles.
1 heure
Je vois par votre lettre que j’ai négligé de vous dire d'où m'étaient venu les mauvaises nouvelles sur mes affaires en Courlande. C'est de copies des textes de la loi en Courlande très volumineux, très embrouillés, mais d'où il appert, que j'aurai une année du revenu entier de la terre de Courlande une fois payé ce qui fait je crois 60 m. francs. Rien du tout d’une autre terre en Lituanie achetée par mon mari, et rien non plus d'une belle arende en Lituanie. La 7ème partie de l’arende en Courlande qui sera peut être 2 mille francs par an. Vous voyez que cela me réduit au 7ème de la terre de Russie & à la quatrième part du capital en Angleterre. Mes fils auront chacun entre 80 à 90 mille roubles de rentes. Voilà mes notions pour le moment. Ces papiers Courlandais dont je vous parle m'ont été remis par la princesse Mescherscky. C'est un cousin à elle qui les lui a envoyés de Mittan. Je vous envoie les copies promises, dites-moi si j'ai bien fait sans ma lettre à Matonchevitz, j’ai été un peu plus claire. Il n’y a personne encore à Baden que je connaisse beaucoup de russes petites gens. Quelques Anglais ditto Le lieu est fort embellie. L'entrepreneur des jeux à Paris est venu ici, il y a déjà dépensé un million 300 m. francs pour embellir le salon et les promenades. Je suis la voisine immédiate. C’est même lui qui me nourrit. Le temps est charmant pas trop chaud, les promenades les plus belles du monde. Que ce serait joli se vous étiez ici ! Je n’ai pas une nouvelle à vous mander je ne sais absolument rien. Je ne saurai rien que par vous.
5 heures
Je reçois dans ce moment, une lettre de mon frère, fort bonne et amicale. Il me parle avec tendresse de mes fils, dont il parait fort content. Il me dit que Pahlen accepte, et que lui mon frère se réserve le rôle de super arbitre. Il fait faire un recueil des lois en Russie et en Courlande, qui m’indiquera ce qui me revient, et il ajoute. " Le reste sera une négociation j'espère aisée avec deux fils qui paraissent si comme il faut. " A présent j'attendrais avec plus de patience et de confiance, car je crois que vraiment mes affaires sont dans les meilleurs mains possibles. Je transcrirai demain ce qu'il me dit de vos affaires qui est assez drôle. Adieu. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi tout. J’attends vos lettres avec tant d’impatience ! Adieu.
Je n’ai dormi que deux heures cette nuit la lettre de mon banquier m’avait de nouveau renversée. Vous savez comme je le suis aisément. Je m’en vais écrire à moi frère et Matonchewitz. Et j'ai bien peu de forces. Si vous étiez là vous m'en donneriez, et un peu de courage. Mais mes seules ressources ! C’est pitoyable.
Mardi 8 h. du matin
J’ai écrit, je vous enverrai copie si cela ne me coûte pas trop de peine. J’ai reçu votre n° 192. Je serai bien aise de vous écrire à Paris nous serons plus près. J’ai vu Mad. de Talleyrand. Ah que nous sommes loin. Hier un peu plus que de coutume, elle redevient très bonne ; je vous ai dit ; le secours moral, j’y puis compter, l’autre non. Elle me prendra mes chevaux et mes chambres, mais elle me donnera de bons conseils. Voici ma vie à 6 heures hors de mon lit et un verre de lait d’ânesse. Une heure de promenade à pied. Une demi-heure de repos à 7 1/2 un bain de son et de lait à 27 degrés. Dix minutes de bain, à 8 h mon déjeuner, et puis mes lettres à 9 1/2 ma toilette, à 11 heures seconde promenade à pied. à Midi le lunchon. Après de la lecture de 2 à 3 promenade en calèche ; de 3 à 4 je me repose dans le jardin. à 4 heures mon Dieu ! à 5 h., on m'apporte mes lettres et mes journaux, à 6 heures en calèche jusqu'après 8 heures. Ensuite une demi-heure de mon jardin, et à 9 heures mon lit. Voilà exactement mes faits et gestes. Ensuite, Marie vient me voir un quart d’heure dans la matinée pas davantage. Mad. de Talleyrand se promène en calèche avec moi ou le matin ou le soir. Et voilà toutes mes ressources. A propos elle me charge de la rappeler à vous. Dans quelques temps elle vous écrira pour vous dire de mes nouvelles.
1 heure
Je vois par votre lettre que j’ai négligé de vous dire d'où m'étaient venu les mauvaises nouvelles sur mes affaires en Courlande. C'est de copies des textes de la loi en Courlande très volumineux, très embrouillés, mais d'où il appert, que j'aurai une année du revenu entier de la terre de Courlande une fois payé ce qui fait je crois 60 m. francs. Rien du tout d’une autre terre en Lituanie achetée par mon mari, et rien non plus d'une belle arende en Lituanie. La 7ème partie de l’arende en Courlande qui sera peut être 2 mille francs par an. Vous voyez que cela me réduit au 7ème de la terre de Russie & à la quatrième part du capital en Angleterre. Mes fils auront chacun entre 80 à 90 mille roubles de rentes. Voilà mes notions pour le moment. Ces papiers Courlandais dont je vous parle m'ont été remis par la princesse Mescherscky. C'est un cousin à elle qui les lui a envoyés de Mittan. Je vous envoie les copies promises, dites-moi si j'ai bien fait sans ma lettre à Matonchevitz, j’ai été un peu plus claire. Il n’y a personne encore à Baden que je connaisse beaucoup de russes petites gens. Quelques Anglais ditto Le lieu est fort embellie. L'entrepreneur des jeux à Paris est venu ici, il y a déjà dépensé un million 300 m. francs pour embellir le salon et les promenades. Je suis la voisine immédiate. C’est même lui qui me nourrit. Le temps est charmant pas trop chaud, les promenades les plus belles du monde. Que ce serait joli se vous étiez ici ! Je n’ai pas une nouvelle à vous mander je ne sais absolument rien. Je ne saurai rien que par vous.
5 heures
Je reçois dans ce moment, une lettre de mon frère, fort bonne et amicale. Il me parle avec tendresse de mes fils, dont il parait fort content. Il me dit que Pahlen accepte, et que lui mon frère se réserve le rôle de super arbitre. Il fait faire un recueil des lois en Russie et en Courlande, qui m’indiquera ce qui me revient, et il ajoute. " Le reste sera une négociation j'espère aisée avec deux fils qui paraissent si comme il faut. " A présent j'attendrais avec plus de patience et de confiance, car je crois que vraiment mes affaires sont dans les meilleurs mains possibles. Je transcrirai demain ce qu'il me dit de vos affaires qui est assez drôle. Adieu. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi tout. J’attends vos lettres avec tant d’impatience ! Adieu.
195. Val-Richer, Mercredi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
195 Du Val Richer, Mercredi 12 juin 1839 4 heures
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
Je prends du plus grand papier. Il me semble que j’ai une infinité de choses à vous dire. Je vous en dis bien peu pourtant. M. et Mad. de Gasparin viennent de m’arriver avec M. Chabaud. Ils resteront jusqu'à samedi. Moi, je ne partirais que lundi. Rien ne m’attire à Paris, point de plaisir et peu d'affaires. Fort peu. La question d'Orient se refroidit. Les événements s'éloignent. On s'attend à peu de discussion. Thiers part demain pour conduire sa femme aux Pyrénées. Cependant je persiste à vouloir parler. La question, prochaine et point flagrante, est peut-être une raison de plus de parler ; elle est assez près pour qu’on y regarde et encore assez loin pour qu’on parle librement. La commission fera par l'organe de M. Jouffroy, un rapport savant et terne, une belle dissertation. Les Affaires Etrangères sont de toutes, à mon avis, celles sur lesquelles la parole séparée de l'action, a le moins de valeur. Elle tombe presque inévitablement dans la politique de café, ou de livre ; politique presque toujours arbitraire et futile, même la plus spirituelle. Les crédits demandés pour augmenter nos forces navales sur les côtes d'Espagne donneront peut-être lieu à un débat plus vif. On me mande que M. Molé veut les faire attaquer. Si le cabinet, dit-il, entend continuer l'ancienne politique, l’argent qu’il demande est inutile. S’il veut adopter une politique nouvelle et s’engager plus avant dans les Affaires d’Espagne, c’est dangereux. Si en faisant comme ses prédécesseurs, il veut seulement avoir l’air de faire plus qu'eux, on ne lui doit pas des millions pour qu’il se donne ce petit plaisir. En tout le cabinet ne gagne pas de terrain. Tout le monde le trouve petit et le lui témoigne, la Chambre des Pairs et M. Bresson. Cette démission de M. Bresson a été une affaire. Le Roi, dit-on, l’en a hautement approuvé. Et pour obtenir la réintégration de M. Legrand aux forêts, il a fallu que M. Passy menaçât de sa retraite. Je vous envoie toutes les pauvretés qui m’arrivent. Pourquoi pas ? Je vous les dirais. M. de Broglie a voulu conduire lui-même sa fille à Coppet. Je ne le trouverai donc pas à Paris. Mais il y sera de retour du 20 au 25 de ce mois, pour le procès, qui durera au moins quinze jours.
On m’appelle pour la promenade. Le temps est magnifique et la verdure aussi brillante que le soleil. Je n'aime pas à faire ce qui me plaît avec quelqu'un qui n’est pas vous. Adieu au moins.
Jeudi 6 heures
La lettre de votre grand Duc est une lettre d'enfant. Je suis toujours bien aise qu'il vous l’ait écrite, et qu'Orloff ait envie d'avoir votre réponse. Je suis curieux de savoir qu’elle sera la valeur des paroles de celui-ci. Vous dites toujours qu’il a de l'esprit. Nous verrons. J’espère bien que votre pauvre Castillon aura une course de courrier. J’insisterai jusqu'à ce qu’il en ait une. On me l’a promis et je graduerai mon humeur sur l'accomplissement de la promesse. Nous avons, aussi nos barbares, nos esprits grossiers quoique rusés qui feront toutes les platitudes du monde, et manqueront de bons procédés. Mais il faut le leur faire sentir. Je ne trouverai plus personne à Paris. Mad. de Rémusat est partie pour le Languedoc. Mad. de Boigne est à Chastenay. J'irai quelque fois. Si cela peut s’appeler aller à Chastenay ! Je reviendrai vers le 15 juillet.
Mes enfants sont ici d’un bonheur charmant à voir. Je les trouve déjà engraissés. Bien des fois dans le jour, je voudrais vous envoyer la société de ma petite Henriette. Elle vous calmerait en vous amusant. Je n’ai jamais vu une créature plus sereine, et plus animée. C’est la vie et l’ordre en personne. Jamais de trouble ni de langueur. Et ayant ce qui donne et justifie l'autorité, l’instinct naturel du commandement, et la disposition au dévouement. J'en jouis avec plus de tremblement que je ne veux me le dire à moi-même. Je ne me sens plus en état de résister à de nouveaux coups. Soignez-vous bien.
9 heures Je serai très bref. Le post-scriptum de votre n°194 me met dans une indignation que je ne veux pas comprimer. Je n’ai rien vu de pareil. Qu’avez-vous donc fait ? De quoi vos fils veulent-ils vous punir ? Adieu. Adieu. Je voudrais pouvoir mettre dans cet adieu tout ce que je ne dis pas, et de quoi vous faire oublier tout ce qui vous arrive. J’attends bien impatiemment une lettre de votre frère. G.
196. Baden, Mercredi 12 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
196 Baden le 12 juin 1839, mercredi 10 heures 1/2
Savez-vous que je me sens si faible et malade que j’ai de la peine à vous écrire. Probablement ni le lait ni les bains ne me conviennent, Mes jambes me manquent, j’ai des vertiges. Mon dîner me fait mal, j’ai encore beaucoup maigri. Il ne restera plus rien. Je suis fort découragée, fort triste. Le pire de mes maux sans doute est la solitude. Je ne puis pas m’en guérir à Baden. Je vous écris aujourd'hui par devoir, pas par plaisir, je ne puis en avoir aucun à vous entretenir de mes souffrances. C’est mauvais pour moi, mauvais pour vous. Ah mon Dieu que je suis triste !
Voici l'extrait de l'autre partie de la lettre de mon frère. Vous voyez que les dispositions ne sont pas améliorées.
Jeudi 6 heures du matin.
Merci de votre bonne lettre. Je crains que les miennes ne vous soient pas arrivées puisque les deux dernières étaient adressées à Paris, l’une à votre maison l'autre chez M. de Broglie. Vous ne serez donc à Paris que dimanche. Je vous y désire pour moi ; mais pour vous je souhaiterais la campagne. Le temps est si beau, vous y êtes si heureux. Je n'ai rien mangé hier de toute la journée, il en résulte une grande faiblesse. Je me suis fait traîner le soir avec Marie, Marie est une grande distraction. Jugez ! On parle beaucoup de Darmstadz. Le grand Duc y reste encore. L’étonnement est grand. La petite princesse est patiemment la fille d'un M. Groney dont la sœur est sa gouvernante. Le grand duc son père officiel ne lui parle jamais. Il n'y a que mon prince Emile qui en aie pitié par conformité de situation parce que lui aussi est arrivée comme cela dans le monde. Il a fait venir pour sa nièce il y a trois semaines un trousseau complet de Paris, afin qu’elle fût mise convenablement pendant cette visite. De toutes les princesses d’Allemagne c'est la seule qui n'ai jamais rêvé qu’elle pût être sur les rangs. Elle n’est pas jolie, mais piquante et spirituelle à ce qu'on dit. Je voudrais bien la voir. J’ai retrouvé ici une petite madame Wiallesby sœur de Lord de Ros. Son mari est fils de Lord Cowley. Elle est trop jeune et trop commère pour moi. Du reste animée et assez agréable. Je vais me promener ce soir avec elle.
3 heures
Je rentre d'une promenade avec Mad. de Talleyrand cela dure une demi-heure, et cela compte pour la journée. J'accepte ce qu’elle me donne, et je ne demande pas davantage, parce qu'en fait je ne crois pas que je l’amuse. Je ne me crois plus guère capable d’amuser personne. Je suis trop triste. Adieu. Adieu. Il me semble que nous nous parlons rarement. Il me semble que nous nous disons peu de chose. Qu’il y a de temps que je vous ai vu ! Mon Dieu qu’il me parait long sans vous ! Adieu mille fois.
Savez-vous que je me sens si faible et malade que j’ai de la peine à vous écrire. Probablement ni le lait ni les bains ne me conviennent, Mes jambes me manquent, j’ai des vertiges. Mon dîner me fait mal, j’ai encore beaucoup maigri. Il ne restera plus rien. Je suis fort découragée, fort triste. Le pire de mes maux sans doute est la solitude. Je ne puis pas m’en guérir à Baden. Je vous écris aujourd'hui par devoir, pas par plaisir, je ne puis en avoir aucun à vous entretenir de mes souffrances. C’est mauvais pour moi, mauvais pour vous. Ah mon Dieu que je suis triste !
Voici l'extrait de l'autre partie de la lettre de mon frère. Vous voyez que les dispositions ne sont pas améliorées.
Jeudi 6 heures du matin.
Merci de votre bonne lettre. Je crains que les miennes ne vous soient pas arrivées puisque les deux dernières étaient adressées à Paris, l’une à votre maison l'autre chez M. de Broglie. Vous ne serez donc à Paris que dimanche. Je vous y désire pour moi ; mais pour vous je souhaiterais la campagne. Le temps est si beau, vous y êtes si heureux. Je n'ai rien mangé hier de toute la journée, il en résulte une grande faiblesse. Je me suis fait traîner le soir avec Marie, Marie est une grande distraction. Jugez ! On parle beaucoup de Darmstadz. Le grand Duc y reste encore. L’étonnement est grand. La petite princesse est patiemment la fille d'un M. Groney dont la sœur est sa gouvernante. Le grand duc son père officiel ne lui parle jamais. Il n'y a que mon prince Emile qui en aie pitié par conformité de situation parce que lui aussi est arrivée comme cela dans le monde. Il a fait venir pour sa nièce il y a trois semaines un trousseau complet de Paris, afin qu’elle fût mise convenablement pendant cette visite. De toutes les princesses d’Allemagne c'est la seule qui n'ai jamais rêvé qu’elle pût être sur les rangs. Elle n’est pas jolie, mais piquante et spirituelle à ce qu'on dit. Je voudrais bien la voir. J’ai retrouvé ici une petite madame Wiallesby sœur de Lord de Ros. Son mari est fils de Lord Cowley. Elle est trop jeune et trop commère pour moi. Du reste animée et assez agréable. Je vais me promener ce soir avec elle.
3 heures
Je rentre d'une promenade avec Mad. de Talleyrand cela dure une demi-heure, et cela compte pour la journée. J'accepte ce qu’elle me donne, et je ne demande pas davantage, parce qu'en fait je ne crois pas que je l’amuse. Je ne me crois plus guère capable d’amuser personne. Je suis trop triste. Adieu. Adieu. Il me semble que nous nous parlons rarement. Il me semble que nous nous disons peu de chose. Qu’il y a de temps que je vous ai vu ! Mon Dieu qu’il me parait long sans vous ! Adieu mille fois.
196. Val-Richer, Vendredi 14 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
196 Du Val-Richer. Vendredi 14 juin 1839 3 heures
Je commence par où j’ai fini hier, mon indignation. Elle est inépuisable. Que deviendriez-vous si vous n'aviez rien à vous ? On n'en aurait été que plus pressé de vous traiter de la sorte pour vous dompter, pour se venger que sais-je ? Ceci me fait éprouver un des sentiments les plus pénibles que je connaisse. Je porte un respect général et profond à ces relations naturelles, indestructibles, indépendantes de notre choix, par lesquelles, sans concours, sans mérite de notre part, dieu nous donne des amis, des appuis, du bonheur et de la sécurité ; et pour toute la vie. Même avec des gens que je n’aime pas, que je ne connais pas, il m'est souverainement désagréable de laisser tomber un mot de reproche ou de blâmer sur un fils devant sa mère, sur un frère devant sa sœur. J'en éprouve une sorte d’embarras et de tristesse comme si j'allais contre une intention divine, si je touchais à une œuvre sacrée. Et pourtant ici, il n'y a pas moyen. Je ne puis me taire ; je ne dirai jamais tout ce que je pense. Alexandre ne vous avait donc pas dit un mot de cette mesure. Vous en avez sans doute informé sur le champ votre frère. Je n'ai d'espoir qu'en lui pour pousser un peu vite vos affaires et prendre un peu soin de vos intérêts. Car voilà une raison, une nécessité de plus d’aller vite. On ne peut vous laisser longtemps dans ce dénuement. Qu’on finisse, qu’on finisse, et que vous puissiez ne plus penser qu'au lait d’ânesse et aux bains de son. Votre médecin de Baden est plein de bon sens ; il sait ce qu’il vous faut. Pour dieu, qu’on le laisse faire.
Je trouve votre réponse au Grand Duc excellente. Pour tout dire, je ne lis pas sans quelque mouvement d’impatience ces belles paroles, ces tendres épanchements de votre âme jetés à un pauvre jeune homme qui ne comprend pas, qui n'ose pas, devant qui tout cela passe comme les élans de la piété et de la prière devant une idole. Il y a un Dieu au-dessus de l’idole, dont l’idole n’est que l’image, et qui comprend l'âme qui prie. Mais ici... Décidément, je ne vaux rien pour l’idolâtrie. J’admire, j’aime le respect et le dévouement, deux vertus rares, beaucoup trop rares de mon temps et dans mon pays ; mais j'y porte, je l'avoue, un peu d'exigence superbe. Passé cette explosion de fierté libérale, je ne vois pas le moindre mot à redire dans votre lettre ; elle est triste, pénétrante, et très digne dans sa ferveur impériale. C’était le problème et vous l’avez résolu.
Samedi 9 heures
Mes hôtes viennent de partir, et moi je partirai après demain pour un mois, je présume. Si vous étiez à Paris, ce mois serait charmant. On est assez occupé du procès. Concevez-vous l'audace de ces gens-là qui font fabriquer une pièce de canon & la trainent dans les rues de Paris ? On l'a saisie. C'était une machine pitoyable ; mais enfin, au dire des ingénieurs, elle aurait pu tirer encore 40 ou 50 coups. Les sociétés secrètes viennent de modifier, leur organisation ; elles se sont constituées par armées ; à un homme par jour. Cinq armées sont organisées, formant donc à peu près 2000 hommes. Elles se sont épurées dans ce nouveau travail, comme tous les partis en déclin, mais très vivaces, qui opposent le redoublement du fanatisme au progrès de l'impuissance. La dernière insurrection n'a pas eu, dans les Provinces, le moindre retentissement. Presque toujours quand un orage éclatait à Paris, il grondait à Lyon à Strasbourg, à Marseille. Rien de semblable cette fois. L’épreuve a même été très complète car il y a eu à Lyon, un peu de tumulte parmi les ouvriers pour une question de salaires, et la politique n’y a paru en rien.
Voilà votre n°195. Merci de vos détails. J'en avais besoin. La lettre de votre frère me rassure un peu. Mais j'aspire à la fin. Du reste, après l'acceptation de vos pouvoirs par le comte de Pahlen et la surveillance déclarée de votre frère, vous pouvez certainement être plus tranquille. Il me faut la permission de l'Empereur. Ce qui vous revient de droit sera trop peu. Votre lettre à votre frère est très convenable. Adieu. Je vous dirai en arrivant à Paris, s'il faut m’écrire rue de l'Université ou rue Ville l'évêque. Adieu. Adieu. Commencez-vous à engraisser ? G.
Je commence par où j’ai fini hier, mon indignation. Elle est inépuisable. Que deviendriez-vous si vous n'aviez rien à vous ? On n'en aurait été que plus pressé de vous traiter de la sorte pour vous dompter, pour se venger que sais-je ? Ceci me fait éprouver un des sentiments les plus pénibles que je connaisse. Je porte un respect général et profond à ces relations naturelles, indestructibles, indépendantes de notre choix, par lesquelles, sans concours, sans mérite de notre part, dieu nous donne des amis, des appuis, du bonheur et de la sécurité ; et pour toute la vie. Même avec des gens que je n’aime pas, que je ne connais pas, il m'est souverainement désagréable de laisser tomber un mot de reproche ou de blâmer sur un fils devant sa mère, sur un frère devant sa sœur. J'en éprouve une sorte d’embarras et de tristesse comme si j'allais contre une intention divine, si je touchais à une œuvre sacrée. Et pourtant ici, il n'y a pas moyen. Je ne puis me taire ; je ne dirai jamais tout ce que je pense. Alexandre ne vous avait donc pas dit un mot de cette mesure. Vous en avez sans doute informé sur le champ votre frère. Je n'ai d'espoir qu'en lui pour pousser un peu vite vos affaires et prendre un peu soin de vos intérêts. Car voilà une raison, une nécessité de plus d’aller vite. On ne peut vous laisser longtemps dans ce dénuement. Qu’on finisse, qu’on finisse, et que vous puissiez ne plus penser qu'au lait d’ânesse et aux bains de son. Votre médecin de Baden est plein de bon sens ; il sait ce qu’il vous faut. Pour dieu, qu’on le laisse faire.
Je trouve votre réponse au Grand Duc excellente. Pour tout dire, je ne lis pas sans quelque mouvement d’impatience ces belles paroles, ces tendres épanchements de votre âme jetés à un pauvre jeune homme qui ne comprend pas, qui n'ose pas, devant qui tout cela passe comme les élans de la piété et de la prière devant une idole. Il y a un Dieu au-dessus de l’idole, dont l’idole n’est que l’image, et qui comprend l'âme qui prie. Mais ici... Décidément, je ne vaux rien pour l’idolâtrie. J’admire, j’aime le respect et le dévouement, deux vertus rares, beaucoup trop rares de mon temps et dans mon pays ; mais j'y porte, je l'avoue, un peu d'exigence superbe. Passé cette explosion de fierté libérale, je ne vois pas le moindre mot à redire dans votre lettre ; elle est triste, pénétrante, et très digne dans sa ferveur impériale. C’était le problème et vous l’avez résolu.
Samedi 9 heures
Mes hôtes viennent de partir, et moi je partirai après demain pour un mois, je présume. Si vous étiez à Paris, ce mois serait charmant. On est assez occupé du procès. Concevez-vous l'audace de ces gens-là qui font fabriquer une pièce de canon & la trainent dans les rues de Paris ? On l'a saisie. C'était une machine pitoyable ; mais enfin, au dire des ingénieurs, elle aurait pu tirer encore 40 ou 50 coups. Les sociétés secrètes viennent de modifier, leur organisation ; elles se sont constituées par armées ; à un homme par jour. Cinq armées sont organisées, formant donc à peu près 2000 hommes. Elles se sont épurées dans ce nouveau travail, comme tous les partis en déclin, mais très vivaces, qui opposent le redoublement du fanatisme au progrès de l'impuissance. La dernière insurrection n'a pas eu, dans les Provinces, le moindre retentissement. Presque toujours quand un orage éclatait à Paris, il grondait à Lyon à Strasbourg, à Marseille. Rien de semblable cette fois. L’épreuve a même été très complète car il y a eu à Lyon, un peu de tumulte parmi les ouvriers pour une question de salaires, et la politique n’y a paru en rien.
Voilà votre n°195. Merci de vos détails. J'en avais besoin. La lettre de votre frère me rassure un peu. Mais j'aspire à la fin. Du reste, après l'acceptation de vos pouvoirs par le comte de Pahlen et la surveillance déclarée de votre frère, vous pouvez certainement être plus tranquille. Il me faut la permission de l'Empereur. Ce qui vous revient de droit sera trop peu. Votre lettre à votre frère est très convenable. Adieu. Je vous dirai en arrivant à Paris, s'il faut m’écrire rue de l'Université ou rue Ville l'évêque. Adieu. Adieu. Commencez-vous à engraisser ? G.
197. Baden, Vendredi 14 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
197 Baden le 14 juin 1839, 7 heures du matin
Ma nuit a été meilleure, mais une mine est affreuse. Baden est ravissant pour tout le monde mais si triste pour moi. Je n’y vois pas une personne isolée. Il n'y a que moi seule, seule. Et vous savez comme cela me va. Je n’ai pas eu de lettres. Je me remets au courant de mes correspondances, je devais des réponses partout, mais au fond les lettres que je vais recevoir ne me feront aucun plaisir. Il n'y a que les vôtres qui comptent, sans les quelles je ne pourrais vivre. Et puis il y a les nouvelles de Pétersbourg qui me font quelque chose, mais ces lettres là, je ne sais jamais si je dois les ouvrir. J'aurais envie de vous les envoyer cachetées. Ah que vous me manquez pour tout, pour tout ! Soyez bien sûr de cela et qu'il n'y a pas une minute de la journée où vous ne soyez présent à ma pensée.
Samedi le 13 à 8 heures
Comment pas de lettres de vous ! Au nom de Dieu ne me donnez pas ces inquiétudes, je n’y pense pas suffire. Il me semble maintenant que le plus grand des malheurs pour moi serait de rester deux jours sans nouvelles de vous. Je ne pense qu'à cela depuis hier cinq heures, l'heure de la poste. J'ai été bien loin dans les montagnes, les forêts, il faisait si beau, il y ferait si beau avec vous. Je n'avais besoin de rien, de personne ; ce qui se passe dans le monde me serait indifférent, vous ne savez pas à quel point cette image me plait. Et puis j’étais si triste si triste. Vous êtes si loin. Ce grand fleuve qui nous sépare, je le regardais du haut de cette grande montagne et j'avais le cœur serré.
Je continue dans ma solitude, je vois Mad. de Talleyrand une fois le jour de 2 à 3 voilà tout. Et Marie part pour une semaine pour Carlsruhe ainsi pas même sa petite visite du matin d’un quart d’heure. Ah, que je suis seule ! Et puis je me sens malade, je deviens très faible. Je ne sais ce que c'est ; je me portais mieux à Paris où je me portais mal. Enfin jusqu'ici je ne vois pas que j'aie bien fait de vous quitter. Pourquoi ne m'avez-vous pas retenue ?
5 heures
Voilà votre lettre, et me voilà rassurée. Mais pourquoi est elle venue si tard ! J’espère que votre rhume est passé. Aujourd'hui vous allez à Paris, n'est-ce pas. Tout ira mieux de là. Il faut remettre ma lettre à la poste. Il faut donc vous quitter Adieu. Adieu. Ecrivez-moi, aimez- moi, Adieu.
Ma nuit a été meilleure, mais une mine est affreuse. Baden est ravissant pour tout le monde mais si triste pour moi. Je n’y vois pas une personne isolée. Il n'y a que moi seule, seule. Et vous savez comme cela me va. Je n’ai pas eu de lettres. Je me remets au courant de mes correspondances, je devais des réponses partout, mais au fond les lettres que je vais recevoir ne me feront aucun plaisir. Il n'y a que les vôtres qui comptent, sans les quelles je ne pourrais vivre. Et puis il y a les nouvelles de Pétersbourg qui me font quelque chose, mais ces lettres là, je ne sais jamais si je dois les ouvrir. J'aurais envie de vous les envoyer cachetées. Ah que vous me manquez pour tout, pour tout ! Soyez bien sûr de cela et qu'il n'y a pas une minute de la journée où vous ne soyez présent à ma pensée.
Samedi le 13 à 8 heures
Comment pas de lettres de vous ! Au nom de Dieu ne me donnez pas ces inquiétudes, je n’y pense pas suffire. Il me semble maintenant que le plus grand des malheurs pour moi serait de rester deux jours sans nouvelles de vous. Je ne pense qu'à cela depuis hier cinq heures, l'heure de la poste. J'ai été bien loin dans les montagnes, les forêts, il faisait si beau, il y ferait si beau avec vous. Je n'avais besoin de rien, de personne ; ce qui se passe dans le monde me serait indifférent, vous ne savez pas à quel point cette image me plait. Et puis j’étais si triste si triste. Vous êtes si loin. Ce grand fleuve qui nous sépare, je le regardais du haut de cette grande montagne et j'avais le cœur serré.
Je continue dans ma solitude, je vois Mad. de Talleyrand une fois le jour de 2 à 3 voilà tout. Et Marie part pour une semaine pour Carlsruhe ainsi pas même sa petite visite du matin d’un quart d’heure. Ah, que je suis seule ! Et puis je me sens malade, je deviens très faible. Je ne sais ce que c'est ; je me portais mieux à Paris où je me portais mal. Enfin jusqu'ici je ne vois pas que j'aie bien fait de vous quitter. Pourquoi ne m'avez-vous pas retenue ?
5 heures
Voilà votre lettre, et me voilà rassurée. Mais pourquoi est elle venue si tard ! J’espère que votre rhume est passé. Aujourd'hui vous allez à Paris, n'est-ce pas. Tout ira mieux de là. Il faut remettre ma lettre à la poste. Il faut donc vous quitter Adieu. Adieu. Ecrivez-moi, aimez- moi, Adieu.
197. Val-Richer, Dimanche 16 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
197 Du Val-Richer. Dimanche 16 Juin 1839 9 heures
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
J’ai eu des visites toute la journée, ce soir encore après dîner. Je pars demain matin. Je vais passer un mois parfaitement seul dans ma maison ; à moins que le Duc de Broglie ne revienne pour le procès, comme il l'a dit. Mais j'en doute un peu. Il me semble que le même empressement qui l’a fait partir pour quinze jours pourra bien l'empêcher de repartir au bout de quinze jours. Pourtant il aurait tort. Il ne faut pas qu’un juge manque à un procès de vie et de mort.
Je trouve votre vie bien ordonnée. Je vous y voudrais un peu plus de société. Je ne suis point jaloux. Ai-je raison ? Mais vous êtes absolument obligée de me revenir grasse et fraîche. L'absence est un crime qui ne peut-être couvert que par le succès.
Vos mauvaises nouvelles de Courlande paraissent bien authentiques. Je m'en désole, car je n'ai foi à personne. Votre frère ne vous dit-il rien, absolu ment rien de la perspective d'une pension ? J'espère presque plus de l'Empereur que de tout autre. Je ne croirai jamais qu’il soit impossible aux trois hommes qui l’entourent de faire luire dans son cœur, s'ils le veulent, un éclair de justice et de générosité.
Lundi 9 heures
Je me lève par le plus beau soleil. Si je devais vous revoir, demain, je serais aussi gai que le soleil. Voilà la première fois depuis deux ans que je vais à Paris sans vous y retrouver. Quel ennui de partir quand on n'a pas envie d’arriver ! C’est bien deux ans, avant hier 15 Juin. Comment n’y a-t-il que deux ans ? Il me semble que c’est toute une vie.
Eternité, néant, passé, sombres abymes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez ; nous rendrez-vous les extases sublimes
Que vous nous ravissez ?
C’est M. de Lamartine qui dit cela. Vous savez que j’aime la poésie. Elle entre et reste très avant dans ma mémoire. Elle agit sur moi comme un écho de l'âme. Elle me rend des sons que j'ai entendus. J’aime mieux la voix que l’écho. Pourtant l’écho est très doux. Mon fils aimait passionnément la poésie. Et sans y porter cette disposition un peu vague et romanesque de la jeunesse. C’était l’esprit le plus net et le plus simple du monde, choqué par instinct dès qu’il apercevait du brouillard ou de l'emphase ; mais d’un cœur si élevé et si délicat, d'une nature si parfaitement élégante et rare que la poésie lui allait d'elle-même et comme par une harmonie spontanée. Je n'ai vu aucune créature, qui semblât créée à ce point pour plaire ! Et c’est à moi seul qu’il a plu. J’ai connu seul le parfum charmant de cette fleur ! C'est l’un de mes plus amers regrets. Il me semble que je l’aurais moins perdu si d’autres en avaient joui comme moi.
9 h. 1/2 Le numéro 196 me désole. Je les ai tous reçus, aucun si triste. J’espérais, et je veux encore espérer mieux du lait d’ânesse, des bains de son, de tout ce régime doux et tranquille. En grâce, si votre médecin persiste à le croire bon, ne le cessez pas parce que vous vous trouvez plus souffrante un jour ou deux. Il faut bien accepter ces mauvaises alternatives. Je n’ai pas la superstition des médecins. J'y crois pourtant un peu plus qu'à notre ignorance. Je craignais bien la solitude de Baden. Vous ne supportez pas la société médiocre et vous avez raison. Il est si rare d'en rencontrer une autre !
Madame de Talleyrand travaille à se désintéresser de toutes choses, à ne penser qu'à elle-même à ses affaires, à ses conforts, à ses habitudes. Ce n’est pas une manière d'animer les autres. Moi aussi, je trouve que nous nous disons peu de chose. Adieu. Adieu.
J’ai une foule de petits soins à prendre avant de partir. Je trouve dans mes journaux de ce matin une triste nouvelle. Ce pauvre Emmanuel de Grouchy est mort à Turin d’une fièvre cérébrale. J’avais de l’amitié pour lui, et il m'était très dévoué. Il s’était marié il y a 18 mois. Il était heureux. Adieu encore. J'aime mille fois mieux une sotte réalité que mille fictions. Adieu pourtant. Mais ne souffrez pas ; ne maigrissez pas. G.
198. Baden, Dimanche 16 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
198 Baden dimanche 16 juin 1839 8 h. du matin.
J’ai été relire votre lettre hier soir auprès du vieux château, sur cette belle montagne au milieu de ruines, de rochers et de magnifiques sapin. C’est ma promenade favorite. Il devrait y avoir tant de calme là pour moi, et cependant je n’en éprouve point. En rentrant pour me coucher, j’ai trouvé Mad. Nesselrode qui m’attendait chez moi après y être déjà venue deux fois. Elle m'a fait veiller, mais j’ai été aise de la revoir et de la retrouver bonne. Nous avons causé de tout, hors de moi, cela viendra plus tard. Elle passe ici deux mois il puis elle ira au Havre. J'en suis bien aise. Son arrivée va me faire une petite ressource ; le grand Duc a dû quitter Darmstadt hier. La jeune Princesse est très maladive, cela ne nous va pas. Aussi je crois qu'on ne décidera rien encore. Elle n’a pas quinze ans. Dans ce moment même est malade, et elle ne paraissait qu'une heure dans la journée. Le grand Duc sera à Pétersbourg dans quinze jours.
Lundi le 17 à 8 heures
Votre N°195 m’est parvenu hier. Votre retour en ville étant encore. retardé je ne doute pas que vous ne soyez resté quelques jours sans lettre. J’ai adressé selon vos ordres, mais vos mouvements ont changé depuis. Vous ne me dites pas si malgré l'absence du Duc de Broglie. C’est chez lui que vous allez descendre j’y adresse ma lettre puisque vous m'avez dit de le faire dans une de vos lettres. J'ai suspendu le lait d'ânesse J’ai recommencé les bains. J’ai été voir Mad. de Nesselrode hier matin. Et puis à l’église à 2 h. ma promenade avec Mad. de Talleyrand à 6 heures avec ma petite Ellice nièce de notre Ellice, qui veut bien rem placer Marie pendant quelques jours. à 9 heures dans mon lit et à deux heures du matin encore éveillée.
J'ai eu un vilain accès de nerfs qui m’a pris au moment de me coucher. Décidément je ne me porte pas bien. Si vous êtes ici ; il me semble que j'y serais à merveille. Mais sans vous, et sur le, cela n'ira pas. Ah rien ne va. Vos affaires me semblent être very flat. J’attends la discussion sur l'Orient, c.a.d. votre discours avec une grande impatience. Savez-vous ce que j’attends surtout ? l’époque de quitter Baden ; j'y suis trop triste, trop seule. Ah l'horreur que la solitude au milieu de l’affliction.
11 heures
Je viens de voir Mad. de Nesselrode. Pour la première fois j’ai parlé de moi. Même de mes affaires du moment. Vous en sauriez concevoir son étonnement lorsqu’elle apprit que mes fils en n’avaient fait aucune proposition. Le dire de Péterstourg était qu’ils m'avaient cédé le capital en Angleterre. En général elle me dit que bien que la loi prescrive ce qui revient à une veuve, il n’y a pas d’exemple en Russie que cette loi soit suivie. Les fils cèdent à leur mère à peu près tout ; l’opinion la gouverne beaucoup plus que la loi, et enfin elle ne peut pas croire que Paul se soustraie à cette opinion. Elle a été fort bien sur ce chapitre, et m’a laissé l’intime conviction qu’il faudra bien que mes fils se conduisent bien pour moi. Nous allons voir. Dans tous les cas mes affaires sont en bonnes mains. Le dernier procédé l’a renversée d’étonnement. Elle ne peut pas le croire enfin tout ce qu’elle me dit me promet que l’atmosphère de Pétersbourg doit agir sur l’esprit de Paul, car c’est les antipodes de toute sa conduite envers moi. Ah mon Dieu si on y savait tout, quel étonnement cela causerait ! Je n’ai parlé à Mad. de Nesselrode que d'une manière très réservée, elle ne sait pas l'essentiel. Je répugne trop à le dire. Adieu. Adieu.
Mad. de Talleyrand veut que je vous parle d'elle, Dites-moi un mot sur un compte bon à lui être montré. Elle est de nouveau un très bon train pour moi, et pour faire du bien auprès de Mad. de Nesselrode Adieu encore bien tendrement.
J’ai été relire votre lettre hier soir auprès du vieux château, sur cette belle montagne au milieu de ruines, de rochers et de magnifiques sapin. C’est ma promenade favorite. Il devrait y avoir tant de calme là pour moi, et cependant je n’en éprouve point. En rentrant pour me coucher, j’ai trouvé Mad. Nesselrode qui m’attendait chez moi après y être déjà venue deux fois. Elle m'a fait veiller, mais j’ai été aise de la revoir et de la retrouver bonne. Nous avons causé de tout, hors de moi, cela viendra plus tard. Elle passe ici deux mois il puis elle ira au Havre. J'en suis bien aise. Son arrivée va me faire une petite ressource ; le grand Duc a dû quitter Darmstadt hier. La jeune Princesse est très maladive, cela ne nous va pas. Aussi je crois qu'on ne décidera rien encore. Elle n’a pas quinze ans. Dans ce moment même est malade, et elle ne paraissait qu'une heure dans la journée. Le grand Duc sera à Pétersbourg dans quinze jours.
Lundi le 17 à 8 heures
Votre N°195 m’est parvenu hier. Votre retour en ville étant encore. retardé je ne doute pas que vous ne soyez resté quelques jours sans lettre. J’ai adressé selon vos ordres, mais vos mouvements ont changé depuis. Vous ne me dites pas si malgré l'absence du Duc de Broglie. C’est chez lui que vous allez descendre j’y adresse ma lettre puisque vous m'avez dit de le faire dans une de vos lettres. J'ai suspendu le lait d'ânesse J’ai recommencé les bains. J’ai été voir Mad. de Nesselrode hier matin. Et puis à l’église à 2 h. ma promenade avec Mad. de Talleyrand à 6 heures avec ma petite Ellice nièce de notre Ellice, qui veut bien rem placer Marie pendant quelques jours. à 9 heures dans mon lit et à deux heures du matin encore éveillée.
J'ai eu un vilain accès de nerfs qui m’a pris au moment de me coucher. Décidément je ne me porte pas bien. Si vous êtes ici ; il me semble que j'y serais à merveille. Mais sans vous, et sur le, cela n'ira pas. Ah rien ne va. Vos affaires me semblent être very flat. J’attends la discussion sur l'Orient, c.a.d. votre discours avec une grande impatience. Savez-vous ce que j’attends surtout ? l’époque de quitter Baden ; j'y suis trop triste, trop seule. Ah l'horreur que la solitude au milieu de l’affliction.
11 heures
Je viens de voir Mad. de Nesselrode. Pour la première fois j’ai parlé de moi. Même de mes affaires du moment. Vous en sauriez concevoir son étonnement lorsqu’elle apprit que mes fils en n’avaient fait aucune proposition. Le dire de Péterstourg était qu’ils m'avaient cédé le capital en Angleterre. En général elle me dit que bien que la loi prescrive ce qui revient à une veuve, il n’y a pas d’exemple en Russie que cette loi soit suivie. Les fils cèdent à leur mère à peu près tout ; l’opinion la gouverne beaucoup plus que la loi, et enfin elle ne peut pas croire que Paul se soustraie à cette opinion. Elle a été fort bien sur ce chapitre, et m’a laissé l’intime conviction qu’il faudra bien que mes fils se conduisent bien pour moi. Nous allons voir. Dans tous les cas mes affaires sont en bonnes mains. Le dernier procédé l’a renversée d’étonnement. Elle ne peut pas le croire enfin tout ce qu’elle me dit me promet que l’atmosphère de Pétersbourg doit agir sur l’esprit de Paul, car c’est les antipodes de toute sa conduite envers moi. Ah mon Dieu si on y savait tout, quel étonnement cela causerait ! Je n’ai parlé à Mad. de Nesselrode que d'une manière très réservée, elle ne sait pas l'essentiel. Je répugne trop à le dire. Adieu. Adieu.
Mad. de Talleyrand veut que je vous parle d'elle, Dites-moi un mot sur un compte bon à lui être montré. Elle est de nouveau un très bon train pour moi, et pour faire du bien auprès de Mad. de Nesselrode Adieu encore bien tendrement.
198. Paris, Mardi 18 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
198 Paris. Mardi 18 Juin 1839, 2 heures
Je suis désolé de votre inquiétude. Ma lettre était partie très exactement. Me voilà ici pour un mois. Le retard sera impossible, s'il y a un mal impossible. Vous étiez un peu mieux samedi. Je voudrais suivre toutes les variations de votre santé, de votre disposition morale. Ce n'est pourtant pas un très bon régime. On s'accoutume au mal en le voyant revenir sans cesse, et on n'y croit plus assez quand on l’a vu s’en aller souvent. Je ne veux pas être rassuré à tort. Dites-moi tout, toujours tout. Je ne veux pas ignorer la moindre de vos souffrances et de vos peines.
Paris est grand et vide comme le désert. Je ne me fais pas à y être venu pour ne pas vous y chercher. Cette nuit, pendant toute la route le roulement de la voiture n’avait pas de sens pour moi. Je m'étonne quelquefois que vous me soyez tant. Dans une vie déjà longue et si pleine, après avoir tant possédé et tant perdu, je devrais être plus las et plus détaché. Je ne le suis pas du tout quant à vous. J’ai, quant à vous, cette ambition vive, indomptable et pleine d'espoir de la jeunesse. Je ne renonce à rien, je ne me résigne à rien. Je veux tout et que tout soit parfait. Je ne sais quelles années Dieu me réserve, ni quelles épreuves encore dans ces années. Mais il y a en moi un côté, un point que la vie la plus longue n'usera pas, et qui descendra jeune dans le tombeau.
8 h. 1/2
Je rentre. Je viens de traverser la place Louis XV par le plus magnifique spectacle. Sur ma tête, le ciel noir, parfaitement noir, le déluge près de tomber, et ce voile noir jeté tout autour de la place, entr'autres sur les deux colonnades. Au bout des Champs-Elysées, derrière les Champs-Elysées, le soleil couchant dans un cercle de feu, sur un bûcher embrasé, comme pour braver au moment de s'étendre, la nuit et l'orage. Et la moitié supérieure de l'obélisque brillante, rouge des derniers rayons du soleil, un jet de flammes suspendu au milieu des ténèbres, et les hiéroglyphes visibles et inintelligibles, comme des caractères cabalistiques. Effet étrange et grand qui ne se reproduira peut-être jamais. Je regrette que nous ne l’ayions pas vu ensemble. Je vous ai désirée au moment où il a frappé mes yeux. J’ai passé ma matinée à la Chambre, le seul lieu de Paris où il n’y ait point d'orage. Tout le monde repart de la session comme finie. Ministres et députés ont l’air de s'entendre pour ne rien faire et ne rien dire. Le Cabinet a perdu ce qu'il n’avait pas. Le Maréchal a été la risée de la Chambre des Pairs à propos des fonds secrets. M. Villemain y a été battu avec gloire à propos de la légion d’honneur. Le Ministre de la guerre ne se bat nulle part. M. Duchâtel est ce qu’il était. M. Dufaure ne devient rien, M. Passy paraît le plus sérieux ; c’est lui qui cause de l’Europe dans les couloirs. Tout va cependant, et tout ira cla se, comme le monde. Convenez qu'il est plaisant d'entendre un Russe dire dédaigneusement que " tout cela finira par un bon petit despotisme, le seul gouvernement possible avec les Français. " Du fait, ce ne sont là que les petits moments d'une grande histoire. Et il y a beaucoup de petit dans le plus grand. Le petit s’en va & le grand seul demeure. Nous ne supporterions pas la lecture du passé s’il nous était arrivé chargé de tout son bagage. L'Assemblée constituante, l'Empire, la Charte, la Révolution de 1830, c’est un manteau assez large pour couvrir bien des misères.
On me dit que M. Molé s’est beaucoup remué contre le Cabinet dans l'affaire de la Légion d’honneur tandis que M. de Montalivet se faisait très ministériel. Aussi ils se renient l’un l’autre. M. Molé part pour Plombières dans les premiers jours de Juillet. La fantaisie lui reprend d'entrer à l'Académie française. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu'elle lui reprend sans qu’il y ait en ce moment aucune vacance. On m'en fait parler par avance. Est-ce bien de l'Académie française qu’on veut me parler ?
Mercredi 1 heure
J’ai eu du monde depuis que je suis levé. Je vais à la Chambre. C’est aujourd'hui mon mauvais jour. Je n’ai pas de lettre. Adieu. Adieu. Je viens de revoir la mine de M. Saint. Rendez-la moi. Adieu. G.
Je suis désolé de votre inquiétude. Ma lettre était partie très exactement. Me voilà ici pour un mois. Le retard sera impossible, s'il y a un mal impossible. Vous étiez un peu mieux samedi. Je voudrais suivre toutes les variations de votre santé, de votre disposition morale. Ce n'est pourtant pas un très bon régime. On s'accoutume au mal en le voyant revenir sans cesse, et on n'y croit plus assez quand on l’a vu s’en aller souvent. Je ne veux pas être rassuré à tort. Dites-moi tout, toujours tout. Je ne veux pas ignorer la moindre de vos souffrances et de vos peines.
Paris est grand et vide comme le désert. Je ne me fais pas à y être venu pour ne pas vous y chercher. Cette nuit, pendant toute la route le roulement de la voiture n’avait pas de sens pour moi. Je m'étonne quelquefois que vous me soyez tant. Dans une vie déjà longue et si pleine, après avoir tant possédé et tant perdu, je devrais être plus las et plus détaché. Je ne le suis pas du tout quant à vous. J’ai, quant à vous, cette ambition vive, indomptable et pleine d'espoir de la jeunesse. Je ne renonce à rien, je ne me résigne à rien. Je veux tout et que tout soit parfait. Je ne sais quelles années Dieu me réserve, ni quelles épreuves encore dans ces années. Mais il y a en moi un côté, un point que la vie la plus longue n'usera pas, et qui descendra jeune dans le tombeau.
8 h. 1/2
Je rentre. Je viens de traverser la place Louis XV par le plus magnifique spectacle. Sur ma tête, le ciel noir, parfaitement noir, le déluge près de tomber, et ce voile noir jeté tout autour de la place, entr'autres sur les deux colonnades. Au bout des Champs-Elysées, derrière les Champs-Elysées, le soleil couchant dans un cercle de feu, sur un bûcher embrasé, comme pour braver au moment de s'étendre, la nuit et l'orage. Et la moitié supérieure de l'obélisque brillante, rouge des derniers rayons du soleil, un jet de flammes suspendu au milieu des ténèbres, et les hiéroglyphes visibles et inintelligibles, comme des caractères cabalistiques. Effet étrange et grand qui ne se reproduira peut-être jamais. Je regrette que nous ne l’ayions pas vu ensemble. Je vous ai désirée au moment où il a frappé mes yeux. J’ai passé ma matinée à la Chambre, le seul lieu de Paris où il n’y ait point d'orage. Tout le monde repart de la session comme finie. Ministres et députés ont l’air de s'entendre pour ne rien faire et ne rien dire. Le Cabinet a perdu ce qu'il n’avait pas. Le Maréchal a été la risée de la Chambre des Pairs à propos des fonds secrets. M. Villemain y a été battu avec gloire à propos de la légion d’honneur. Le Ministre de la guerre ne se bat nulle part. M. Duchâtel est ce qu’il était. M. Dufaure ne devient rien, M. Passy paraît le plus sérieux ; c’est lui qui cause de l’Europe dans les couloirs. Tout va cependant, et tout ira cla se, comme le monde. Convenez qu'il est plaisant d'entendre un Russe dire dédaigneusement que " tout cela finira par un bon petit despotisme, le seul gouvernement possible avec les Français. " Du fait, ce ne sont là que les petits moments d'une grande histoire. Et il y a beaucoup de petit dans le plus grand. Le petit s’en va & le grand seul demeure. Nous ne supporterions pas la lecture du passé s’il nous était arrivé chargé de tout son bagage. L'Assemblée constituante, l'Empire, la Charte, la Révolution de 1830, c’est un manteau assez large pour couvrir bien des misères.
On me dit que M. Molé s’est beaucoup remué contre le Cabinet dans l'affaire de la Légion d’honneur tandis que M. de Montalivet se faisait très ministériel. Aussi ils se renient l’un l’autre. M. Molé part pour Plombières dans les premiers jours de Juillet. La fantaisie lui reprend d'entrer à l'Académie française. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu'elle lui reprend sans qu’il y ait en ce moment aucune vacance. On m'en fait parler par avance. Est-ce bien de l'Académie française qu’on veut me parler ?
Mercredi 1 heure
J’ai eu du monde depuis que je suis levé. Je vais à la Chambre. C’est aujourd'hui mon mauvais jour. Je n’ai pas de lettre. Adieu. Adieu. Je viens de revoir la mine de M. Saint. Rendez-la moi. Adieu. G.
199. Baden, Mardi 18 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
199 Baden Mardi le 18 juin 1839
5 1/2 du matin
Je ne puis pas dormir. Je me suis levée avant cinq heures. J'ai marché à l'ombre il faisait de déjà trop chaud. J’attends mon déjeuner et je viens en attendant vous dire bonjour. J’ai été bien malade hier au soir. Le médecin n'en accuse que mes nerfs. Je le sais bien, et que faire ? Mad. de Talleyrand à eu un long entretien avec Mad. de Nesselrode à mon sujet. Imaginez qu’on dit à Pétersbourg que j’ai fort maltraité mes fils qu'ils m'avaient offert un capital d’un million, que j'ai refusé avec dédain, trouvant cela trop peu, et que je m’étais en conséquence brouillée avec eux on parlait fort mal de moi à ce sujet. Mad. de Talleyrand a rétabli la vérité des faits, et la comtesse Nesselrode veut en écrire de suite à son mari et à Matonshewitz. Celui ci peut à peine avoir reçu ma longue lettre. L'arrivé de Pahlen, à Petersbourg me fera du bien aussi si toutes fois, il ouvre la bouche pour ma défendre. Je crois qu’il quitte Paris dans peu du jour. Comprenez-vous tout ce que ceci me donne d’agitation. Vraiment je passe par de dures épreuves !
3 heures
La comtesse Nesselrode m’a fait une longue visite ce matin. Nous avons parlé de tout excepté de moi. Je n’ai pas voulu le faire. 1° parce que mes forces ne suffisent plus à un entretien, 2° parce qu’elle est suffisamment instruite par Mad. de Talleyrand et qu’il ne faut pas risquer d’affaiblir une impression en revenant trop sur le même sujet. Voici ce que j’ai relevé de plus marquant de son entretien avec Mad. de Talleyrand. Le maître ne m’a pas. pardonné et ne me pardonnera jamais. Il est vraisemblable qu'on ne me molestera plus, mais il est invraisemblable qu'on me donne la pension, cependant le comte de Nesselrode veut le tenter. Je pense que cet essai sera fait après l'arrivée d’Orloff, je le désire, ce ne serait que par lui qu’il y aurait quelque chance. Maintenant vous savez tout. Je crois que Mad. de Nesselrode et une bonne fortune pour moi. Ce que je n’aurais jamais dit, elle le dira, et on la croira.
Mercredi 19 à 8 heures du matin.
Votre N° 196 est charmant. Il y a une page à propos de ma lettre au grand Duc est incomparable. ma nuit a été un peu meilleure je continue mes bains ; mais quant à l'embonpoint, vous êtes un peu pressé. Il n’y a pas encore d'apparence, et je n'ai que d’espoir, j’ai l’esprit trop agité. J’ai eu une réponse du comte F. Pahlen, très convenable pour me dire simplement qu'il accepte et qu’il ne doute pas, qu’il ne puisse très incessamment me soumettre un plan d’arrangement. Il m'écrivait cependant, avant d'avoir vu mes fils. C’est une très vieille lettre. Je vous préviens que dans quatre ou cinq jours on fait partir un nouveau courrier pour Pétersbourg. Et Castillon ? Sera-t-il envoyé ? Vous êtes à Paris. Vous y avez chaud sans doute. Que faites vous de votre temps ? Au fond comment êtes-vous resté à longtemps absent ? Aura-t-on pris cela pour de la bouderie. Vous me raconterez beaucoup de choses n’est-ce pas ?
Adieu. Adieu. Moi je n’ai à vous parler que de ma pauvre personne et de mes plus pauvres affaires. Je ne veux pas vous faire l'injure de vous demander si je vous ennuie. Mais il n’y aurait rien de plus naturel. Adieu encore mille fois.
5 1/2 du matin
Je ne puis pas dormir. Je me suis levée avant cinq heures. J'ai marché à l'ombre il faisait de déjà trop chaud. J’attends mon déjeuner et je viens en attendant vous dire bonjour. J’ai été bien malade hier au soir. Le médecin n'en accuse que mes nerfs. Je le sais bien, et que faire ? Mad. de Talleyrand à eu un long entretien avec Mad. de Nesselrode à mon sujet. Imaginez qu’on dit à Pétersbourg que j’ai fort maltraité mes fils qu'ils m'avaient offert un capital d’un million, que j'ai refusé avec dédain, trouvant cela trop peu, et que je m’étais en conséquence brouillée avec eux on parlait fort mal de moi à ce sujet. Mad. de Talleyrand a rétabli la vérité des faits, et la comtesse Nesselrode veut en écrire de suite à son mari et à Matonshewitz. Celui ci peut à peine avoir reçu ma longue lettre. L'arrivé de Pahlen, à Petersbourg me fera du bien aussi si toutes fois, il ouvre la bouche pour ma défendre. Je crois qu’il quitte Paris dans peu du jour. Comprenez-vous tout ce que ceci me donne d’agitation. Vraiment je passe par de dures épreuves !
3 heures
La comtesse Nesselrode m’a fait une longue visite ce matin. Nous avons parlé de tout excepté de moi. Je n’ai pas voulu le faire. 1° parce que mes forces ne suffisent plus à un entretien, 2° parce qu’elle est suffisamment instruite par Mad. de Talleyrand et qu’il ne faut pas risquer d’affaiblir une impression en revenant trop sur le même sujet. Voici ce que j’ai relevé de plus marquant de son entretien avec Mad. de Talleyrand. Le maître ne m’a pas. pardonné et ne me pardonnera jamais. Il est vraisemblable qu'on ne me molestera plus, mais il est invraisemblable qu'on me donne la pension, cependant le comte de Nesselrode veut le tenter. Je pense que cet essai sera fait après l'arrivée d’Orloff, je le désire, ce ne serait que par lui qu’il y aurait quelque chance. Maintenant vous savez tout. Je crois que Mad. de Nesselrode et une bonne fortune pour moi. Ce que je n’aurais jamais dit, elle le dira, et on la croira.
Mercredi 19 à 8 heures du matin.
Votre N° 196 est charmant. Il y a une page à propos de ma lettre au grand Duc est incomparable. ma nuit a été un peu meilleure je continue mes bains ; mais quant à l'embonpoint, vous êtes un peu pressé. Il n’y a pas encore d'apparence, et je n'ai que d’espoir, j’ai l’esprit trop agité. J’ai eu une réponse du comte F. Pahlen, très convenable pour me dire simplement qu'il accepte et qu’il ne doute pas, qu’il ne puisse très incessamment me soumettre un plan d’arrangement. Il m'écrivait cependant, avant d'avoir vu mes fils. C’est une très vieille lettre. Je vous préviens que dans quatre ou cinq jours on fait partir un nouveau courrier pour Pétersbourg. Et Castillon ? Sera-t-il envoyé ? Vous êtes à Paris. Vous y avez chaud sans doute. Que faites vous de votre temps ? Au fond comment êtes-vous resté à longtemps absent ? Aura-t-on pris cela pour de la bouderie. Vous me raconterez beaucoup de choses n’est-ce pas ?
Adieu. Adieu. Moi je n’ai à vous parler que de ma pauvre personne et de mes plus pauvres affaires. Je ne veux pas vous faire l'injure de vous demander si je vous ennuie. Mais il n’y aurait rien de plus naturel. Adieu encore mille fois.
199. Paris, Jeudi 20 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
199. Paris, jeudi 20 Juin 1839, Midi.
Pas une lettre ne m'a manqué et ne m'est arrivée deux heures plus tard. J’avais pris mes précautions. Mais adressez-les moi désormais rue de la Ville l'évêque.
Le Duc de Broglie arrive dimanche pour siéger lundi au procès. Il ne passera pas plus de quinze jours à Paris, et les passera probablement, comme moi en garçon ; car il revient tout à fait seul. Nous dinerons souvent ensemble, mais je resterai chez moi. J’y vois beaucoup de monde le matin beaucoup trop pour mon plaisir. Je n’ai pas les ennuis de la solitude. Je ne voudrais pourtant pas vous passer mon monde ; il ne vous désennuierait pas. Je sors à 1 heure, pour quelques visites et pour la chambre. Je rentre avant 6 heures. Je vais dîner en ville ou au café de Paris. Je fais le tour des Tuileries. Je dis adieu à la Terrasse; et je suis chez moi avant 9 heures pour lire, écrire et me coucher. Sauf les forêts et les montagnes, et sauf vous pour qui je donnerais toutes les montagnes et toutes les forêts du monde, cette vie ressemble un peu à la vôtre. J’en ai jusque vers la fin de juillet, du 20 au 25. La Chambre est endormie et pressée, partagée entre la précipitation et l’apathie. J’espère pourtant la réveiller et la ralentir un peu sur l'Orient. Le rapport se fait attendre. M. Jouffroy est malade. M. de Castillon sort de chez moi, bien content. Il partira pour Pétersbourg dans quinze jours. Il aurait pu partir hier et le marquis de Dalmatie me l’avait dit à la Chambre. Mais par un arrangement intérieur du département, on a mieux aimé, et il a mieux aimé lui-même ne partir que dans quinze jours. L’envoi des courriers est fréquent. Nous sommes contents des dépêches qui nous viennent de chez vous. Vous avez trouvé que nous nous étions bien pressés de demander des millions, que cela avait un peu trop ému l’Europe. Mais au fond, vous savez que nous serons raisonnables, et vous le serez vous-mêmes. L’Autriche l’est beaucoup, la Prusse beaucoup. L'Angleterre est fort contente de nous. L'hérédité du Pacha en Egypte est à peu près convenue entre quatre. Mais il lui faut l'hérédité de la Syrie, ou d'une portion de la Syrie. Sur cela, on négociera et on enverra à Constantinople des négociations conclues. Voulez-vous que j'aille à Constantinople ? J'ai lieu de croire que d'autres que vous m’y verraient avec plaisir. Passons en Occident. Ce pauvre Zéa doit être désolé. Les Cortès espagnoles dissoutes et le baron de Meer destitué du gouvernement de la Catalogne. C'est le renversement de sa politique et de toutes ses espérances. J’ai tort de dire toutes. Il retrouvera de l’espérance, car il a de la foi.
5 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez Madame de Nesselrode et qu’elle soit bonne. Quiconque a de l’esprit devrait être bon, et toujours bon. La méchanceté, pour dire le plus gros mot, même quand elle réussit ne donne que des plaisirs tristes comme sont tous les plaisirs solitaires. Ce serait une chose charmante que de se promener dans ce beau pays dont vous me parlez avec Madame de Talleyrand et vous. Puisque je n’y suis pas, parlez-lui de moi, je vous prie. J’ai cru quelques fois que pour n'être pas oublié d'elle, j’avais besoin que quelqu'un prit soin de l'en empêcher. Mauvaise condition, qu'il ne faut jamais accepter, n’est-ce pas ? Mais il me semble que son bon souvenir m'est revenu, et j'en jouis beaucoup. J'en jouirai encore mieux si vous voulez bien veiller à ce qu’il me reste.
Toute idée de voyage du Roi me parait abandonnée. Il ne faut pas aller au devant des velléités d'assassinat qui succèdent presque toujours aux tentatives d’insurrection. Mais Mgr le duc d'Orléans pourra bien aller à Bordeaux ; de la à Bayonne au devant de Mgr, le Duc de Nemours qui viendra y débarquer après avoir visite le Tage et Lisbonne ; de là le long des Pyrénées où nous avons des troupes ; de là à Alger pour voit l’armée d'Afrique. J’ai vu hier Montrond qui a envie d'aller à Baden. Je l’y ai fort encouragé. Mais il voudrait aller auparavant aux eaux d'Aix, puis à Florence, puis à Palerme. C'est beaucoup pour un été. Vendredi 11 heures.
Voilà Montrond qui sort encore de chez moi. C'est beaucoup. Adieu. Quelques uns me parlent. & d'autres m'attendent. J’aimerais bien mieux être à Baden. Adieu Adieu. G.
Pas une lettre ne m'a manqué et ne m'est arrivée deux heures plus tard. J’avais pris mes précautions. Mais adressez-les moi désormais rue de la Ville l'évêque.
Le Duc de Broglie arrive dimanche pour siéger lundi au procès. Il ne passera pas plus de quinze jours à Paris, et les passera probablement, comme moi en garçon ; car il revient tout à fait seul. Nous dinerons souvent ensemble, mais je resterai chez moi. J’y vois beaucoup de monde le matin beaucoup trop pour mon plaisir. Je n’ai pas les ennuis de la solitude. Je ne voudrais pourtant pas vous passer mon monde ; il ne vous désennuierait pas. Je sors à 1 heure, pour quelques visites et pour la chambre. Je rentre avant 6 heures. Je vais dîner en ville ou au café de Paris. Je fais le tour des Tuileries. Je dis adieu à la Terrasse; et je suis chez moi avant 9 heures pour lire, écrire et me coucher. Sauf les forêts et les montagnes, et sauf vous pour qui je donnerais toutes les montagnes et toutes les forêts du monde, cette vie ressemble un peu à la vôtre. J’en ai jusque vers la fin de juillet, du 20 au 25. La Chambre est endormie et pressée, partagée entre la précipitation et l’apathie. J’espère pourtant la réveiller et la ralentir un peu sur l'Orient. Le rapport se fait attendre. M. Jouffroy est malade. M. de Castillon sort de chez moi, bien content. Il partira pour Pétersbourg dans quinze jours. Il aurait pu partir hier et le marquis de Dalmatie me l’avait dit à la Chambre. Mais par un arrangement intérieur du département, on a mieux aimé, et il a mieux aimé lui-même ne partir que dans quinze jours. L’envoi des courriers est fréquent. Nous sommes contents des dépêches qui nous viennent de chez vous. Vous avez trouvé que nous nous étions bien pressés de demander des millions, que cela avait un peu trop ému l’Europe. Mais au fond, vous savez que nous serons raisonnables, et vous le serez vous-mêmes. L’Autriche l’est beaucoup, la Prusse beaucoup. L'Angleterre est fort contente de nous. L'hérédité du Pacha en Egypte est à peu près convenue entre quatre. Mais il lui faut l'hérédité de la Syrie, ou d'une portion de la Syrie. Sur cela, on négociera et on enverra à Constantinople des négociations conclues. Voulez-vous que j'aille à Constantinople ? J'ai lieu de croire que d'autres que vous m’y verraient avec plaisir. Passons en Occident. Ce pauvre Zéa doit être désolé. Les Cortès espagnoles dissoutes et le baron de Meer destitué du gouvernement de la Catalogne. C'est le renversement de sa politique et de toutes ses espérances. J’ai tort de dire toutes. Il retrouvera de l’espérance, car il a de la foi.
5 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez Madame de Nesselrode et qu’elle soit bonne. Quiconque a de l’esprit devrait être bon, et toujours bon. La méchanceté, pour dire le plus gros mot, même quand elle réussit ne donne que des plaisirs tristes comme sont tous les plaisirs solitaires. Ce serait une chose charmante que de se promener dans ce beau pays dont vous me parlez avec Madame de Talleyrand et vous. Puisque je n’y suis pas, parlez-lui de moi, je vous prie. J’ai cru quelques fois que pour n'être pas oublié d'elle, j’avais besoin que quelqu'un prit soin de l'en empêcher. Mauvaise condition, qu'il ne faut jamais accepter, n’est-ce pas ? Mais il me semble que son bon souvenir m'est revenu, et j'en jouis beaucoup. J'en jouirai encore mieux si vous voulez bien veiller à ce qu’il me reste.
Toute idée de voyage du Roi me parait abandonnée. Il ne faut pas aller au devant des velléités d'assassinat qui succèdent presque toujours aux tentatives d’insurrection. Mais Mgr le duc d'Orléans pourra bien aller à Bordeaux ; de la à Bayonne au devant de Mgr, le Duc de Nemours qui viendra y débarquer après avoir visite le Tage et Lisbonne ; de là le long des Pyrénées où nous avons des troupes ; de là à Alger pour voit l’armée d'Afrique. J’ai vu hier Montrond qui a envie d'aller à Baden. Je l’y ai fort encouragé. Mais il voudrait aller auparavant aux eaux d'Aix, puis à Florence, puis à Palerme. C'est beaucoup pour un été. Vendredi 11 heures.
Voilà Montrond qui sort encore de chez moi. C'est beaucoup. Adieu. Quelques uns me parlent. & d'autres m'attendent. J’aimerais bien mieux être à Baden. Adieu Adieu. G.
200. Baden, Jeudi 20 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
200 Baden le 20 juin 1839 jeudi 6 1/2 du matin.
Je n’ai vu personne hier, ni Mad. de Talleyrand ni Mad. de Nesselrode ma seule récréation a été une promenade le soir avec Mad. Wellesley. Vous voyez que c’est trop peu pour moi et que la journée est bien longue ! Et il y a encore au moins deux grands mois à passer de la sorte. Mon fils Alexandre me doit bien des lettres. La Dernière était du 23 mai. c’est long.
Vendredi 21 à 11 heures
Voilà tout ce que j'avais pu vous dire hier, j’étais fatiguée, triste, découragée, et dans l’angoisse d'une lettre de mon fils Alexandre venus à 5 h. et que mon médecin m'avait prié de ne pas ouvrir. afin de ne pas déranger ma nuit je l'ai donc envoyée à Mad. de Talleyrand et je ne l’ai ouverte que ce matin. Elle ne renferme rien absolument. Il est à la campagne chez ma sœur, il va tous les matins en ville pour les affaires voilà tout ce qu'il me dit. Et au fait je suis charmée qu'il ne me parle pas affaires. Ce n’est pas par lui que j'en apprendrai rien, cela doit en venir de mon frère pourvu que cela vienne bientôt ! Je suis surprise du complet silence de Matonchewitz. Je ne veux pas vous parler de ma santé jusqu'à ce que j’ai quelque chose de bon à vous en dire. Jusqu'à présent je suis comme j’étais.
3 heures 1/2
La comtesse Nesselrode est venue m’interrompre. Elle est certainement très bien disposée, elle écrit à son mari, j'ai bien insisté sur ce que je préfère la carrière de mon fils à mes propres intérêts ; ainsi je ne veux pas qu’on dise rien qui puisse lui nuire, en même temps je ne veux pas qu'on puisse me croire des torts envers lui. Tout cela est bien délicat, tout cela est difficile à ménager, c'est une mauvaise situation, et tous les jours cela m’afflige davantage Notre Ambassadeur Pahlen. m'écrit pour me dire qu'il quitte Paris aujourd'hui même. Il sera à Pétersbourg le 2 de juillet et me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je lui écrirai pour le prier de me défendre s'il entend dire qu’on m'attaque, je ne veux pas autre chose. Mad. de Talleyrand prétend qu'aujourd’hui tout à l’air de se placer mieux pour moi et elle croit que de tout cela ressortira un bon dénouement. Moi je ne crois encore à rien de bon je suis si accoutumée au mauvais.
Lady Cowper me mande que son frère est bien fatigué, bien tracassé, que les Torys sont très violents que s'il y avait un changement elle et lord Melbourne viendraient, tout de suite de ce côté-ci. Le chevalier Courrey quitte l'Angleterre. C’est le grand événement de Londres. Peut être cela ramènera-t-il la paix entre la mère et la fille ? Lady Cowper est très désappointée de ce que je n’aille pas en Angleterre, elle m’attend en automne. Elle me reparle d’Orloff, de ses promesses. Elle me fait des messages d’amitié de Palmerston, voilà la lettre. J'aurais dû vous l’envoyer ce matin, et vous aurez dû me la rapporter à midi 1/2 ! Ah le bon temps passé !
Puisque vous allez avoir du loisir voyez un peu si vous ne pourriez pas me trouver une maison. Ne soyez pas trop exclusif pour le Fbg St. Honoré. Au fond les bonnes maisons ne sont que de l’autre côté. Vous savez qu'il me faut le soleil avant toutes choses. Non pas, pas avant vous; mais après vous. Adieu. Adieux, je suis impatiente de vos lettres de Paris que pensez-vous de la situation, éclairez- moi, racontez-moi. Adieu. Adieu.
6 h. Voici votre lettre de Paris, & il faut que la même partie. Je vous remercie tendrement, bien tendrement. Ecrivez, Ecrivez. Vous êtes dans votre maison je suppose ?
Je n’ai vu personne hier, ni Mad. de Talleyrand ni Mad. de Nesselrode ma seule récréation a été une promenade le soir avec Mad. Wellesley. Vous voyez que c’est trop peu pour moi et que la journée est bien longue ! Et il y a encore au moins deux grands mois à passer de la sorte. Mon fils Alexandre me doit bien des lettres. La Dernière était du 23 mai. c’est long.
Vendredi 21 à 11 heures
Voilà tout ce que j'avais pu vous dire hier, j’étais fatiguée, triste, découragée, et dans l’angoisse d'une lettre de mon fils Alexandre venus à 5 h. et que mon médecin m'avait prié de ne pas ouvrir. afin de ne pas déranger ma nuit je l'ai donc envoyée à Mad. de Talleyrand et je ne l’ai ouverte que ce matin. Elle ne renferme rien absolument. Il est à la campagne chez ma sœur, il va tous les matins en ville pour les affaires voilà tout ce qu'il me dit. Et au fait je suis charmée qu'il ne me parle pas affaires. Ce n’est pas par lui que j'en apprendrai rien, cela doit en venir de mon frère pourvu que cela vienne bientôt ! Je suis surprise du complet silence de Matonchewitz. Je ne veux pas vous parler de ma santé jusqu'à ce que j’ai quelque chose de bon à vous en dire. Jusqu'à présent je suis comme j’étais.
3 heures 1/2
La comtesse Nesselrode est venue m’interrompre. Elle est certainement très bien disposée, elle écrit à son mari, j'ai bien insisté sur ce que je préfère la carrière de mon fils à mes propres intérêts ; ainsi je ne veux pas qu’on dise rien qui puisse lui nuire, en même temps je ne veux pas qu'on puisse me croire des torts envers lui. Tout cela est bien délicat, tout cela est difficile à ménager, c'est une mauvaise situation, et tous les jours cela m’afflige davantage Notre Ambassadeur Pahlen. m'écrit pour me dire qu'il quitte Paris aujourd'hui même. Il sera à Pétersbourg le 2 de juillet et me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je lui écrirai pour le prier de me défendre s'il entend dire qu’on m'attaque, je ne veux pas autre chose. Mad. de Talleyrand prétend qu'aujourd’hui tout à l’air de se placer mieux pour moi et elle croit que de tout cela ressortira un bon dénouement. Moi je ne crois encore à rien de bon je suis si accoutumée au mauvais.
Lady Cowper me mande que son frère est bien fatigué, bien tracassé, que les Torys sont très violents que s'il y avait un changement elle et lord Melbourne viendraient, tout de suite de ce côté-ci. Le chevalier Courrey quitte l'Angleterre. C’est le grand événement de Londres. Peut être cela ramènera-t-il la paix entre la mère et la fille ? Lady Cowper est très désappointée de ce que je n’aille pas en Angleterre, elle m’attend en automne. Elle me reparle d’Orloff, de ses promesses. Elle me fait des messages d’amitié de Palmerston, voilà la lettre. J'aurais dû vous l’envoyer ce matin, et vous aurez dû me la rapporter à midi 1/2 ! Ah le bon temps passé !
Puisque vous allez avoir du loisir voyez un peu si vous ne pourriez pas me trouver une maison. Ne soyez pas trop exclusif pour le Fbg St. Honoré. Au fond les bonnes maisons ne sont que de l’autre côté. Vous savez qu'il me faut le soleil avant toutes choses. Non pas, pas avant vous; mais après vous. Adieu. Adieux, je suis impatiente de vos lettres de Paris que pensez-vous de la situation, éclairez- moi, racontez-moi. Adieu. Adieu.
6 h. Voici votre lettre de Paris, & il faut que la même partie. Je vous remercie tendrement, bien tendrement. Ecrivez, Ecrivez. Vous êtes dans votre maison je suppose ?
200. Paris, Samedi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
Paris, Samedi 22 Juin 1839 -7 heures
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
201. Baden, Samedi 22 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
201 Baden Samedi le 22 juin 1839 7 heures du matin
Le petit paquet m’ennuie, je donne aujourd'hui dans l’autre excès. Votre description de la place Louis XV est superbe. Celle de la chambre si elle se soutient vous dispenserait presque d'être à Paris. J’aime bien cependant vous y savoir. Vous êtes plus près, tout est plus régulier. J’ai fini ma journée hier par une promenade avec Mad. Wellesley. Elle bavarde et m’amuse un peu. Nous avons connu les mêmes personnes. Cela fait un lien. Je ne manque jamais de me coucher à 9 heures. Je ne manque rien de ce qui peut me faire me bien porter. Si je n’y réussis pas, il n’y aura pas de ma faute. Il me semble que Pozzo va vous arriver. Vous le verrez n’est-ce pas ? Faites le causer et vous me redirez s'il sait causer encore et de quoi ?
Dimanche 23. 7 heures du matin
Ma journée s’est mal passée hier. Je ne me suis pas sentie bien. Je ne le suis pas encore aujourd’hui. Je ne sais ce que c’est ; je sors cependant de mon bain, car je fais tout comme on me l’ordonne On mange très mal ici ; voilà peut- être ce qui me dérange, je n'engraisserai pas avec cela.
Onze heures. Je reviens de l'église. J’y vais tous les dimanche. Il y a un prédicateur admirable qui est le plus mauvais sujet du pays. Un homme à prendre pour toutes sortes de méfaits et le prédicateur le plus éloquent, le plus touchant que j'ai jamais entendu. Je reçois dans ce moment une lettre d’Alexandre. Lui et son frère avaient vu l’Empereur et l’Impératrice par faveur extraordinaire ils ont passé une soirée intime avec la famille impériale. Ils ont été comblés. L’Empereur attendri à leur vue. Les traitant comme des proches parents. Leur répétant vous me tenez de près et je veux que ces rapports là subsistent toujours entre nous. " Enfin c’est comme cela devait être mais comme je ne l'espérais pas. Alexandre trouve moyen par une phrase convenue de me dire qu'on continue à être très mal pour moi. Vous voyez bien qu’il ne s’agira pas de pension. Je suis toujours enchantée qu'il soit si bien pour mes enfants.
5 heures
Voici l’heure de la poste. J’attends votre lettre, et il faut que je fasse partir la mienne. J’ai vu Mad. de Nesselrode ce matin. Elle est vraiment bonne pour moi, mais je l'incommode le moins possible. Cependant je la tiendrai au courant de mes affaires. Elle a mandé à son mari d’interroger Pahlen sur mes relations avec Paul ! Tout pourra se concilier avec les intérêts de service de Paul. On a de lui bonne opinion comme capacité. Il faut le pousser. Et il pourrait être pour moi plus mal encore que cela ne doit faire aucune différence pour sa carrière. Son intérêt doit aller avant le mien, c’est comme cela que je l’entends. voilà votre lettre, intéressante bonne aimable. Je vous remercie bien de Castillon. Adieu. Je suis pressée par la poste, adieu adieu milles fois.
Le petit paquet m’ennuie, je donne aujourd'hui dans l’autre excès. Votre description de la place Louis XV est superbe. Celle de la chambre si elle se soutient vous dispenserait presque d'être à Paris. J’aime bien cependant vous y savoir. Vous êtes plus près, tout est plus régulier. J’ai fini ma journée hier par une promenade avec Mad. Wellesley. Elle bavarde et m’amuse un peu. Nous avons connu les mêmes personnes. Cela fait un lien. Je ne manque jamais de me coucher à 9 heures. Je ne manque rien de ce qui peut me faire me bien porter. Si je n’y réussis pas, il n’y aura pas de ma faute. Il me semble que Pozzo va vous arriver. Vous le verrez n’est-ce pas ? Faites le causer et vous me redirez s'il sait causer encore et de quoi ?
Dimanche 23. 7 heures du matin
Ma journée s’est mal passée hier. Je ne me suis pas sentie bien. Je ne le suis pas encore aujourd’hui. Je ne sais ce que c’est ; je sors cependant de mon bain, car je fais tout comme on me l’ordonne On mange très mal ici ; voilà peut- être ce qui me dérange, je n'engraisserai pas avec cela.
Onze heures. Je reviens de l'église. J’y vais tous les dimanche. Il y a un prédicateur admirable qui est le plus mauvais sujet du pays. Un homme à prendre pour toutes sortes de méfaits et le prédicateur le plus éloquent, le plus touchant que j'ai jamais entendu. Je reçois dans ce moment une lettre d’Alexandre. Lui et son frère avaient vu l’Empereur et l’Impératrice par faveur extraordinaire ils ont passé une soirée intime avec la famille impériale. Ils ont été comblés. L’Empereur attendri à leur vue. Les traitant comme des proches parents. Leur répétant vous me tenez de près et je veux que ces rapports là subsistent toujours entre nous. " Enfin c’est comme cela devait être mais comme je ne l'espérais pas. Alexandre trouve moyen par une phrase convenue de me dire qu'on continue à être très mal pour moi. Vous voyez bien qu’il ne s’agira pas de pension. Je suis toujours enchantée qu'il soit si bien pour mes enfants.
5 heures
Voici l’heure de la poste. J’attends votre lettre, et il faut que je fasse partir la mienne. J’ai vu Mad. de Nesselrode ce matin. Elle est vraiment bonne pour moi, mais je l'incommode le moins possible. Cependant je la tiendrai au courant de mes affaires. Elle a mandé à son mari d’interroger Pahlen sur mes relations avec Paul ! Tout pourra se concilier avec les intérêts de service de Paul. On a de lui bonne opinion comme capacité. Il faut le pousser. Et il pourrait être pour moi plus mal encore que cela ne doit faire aucune différence pour sa carrière. Son intérêt doit aller avant le mien, c’est comme cela que je l’entends. voilà votre lettre, intéressante bonne aimable. Je vous remercie bien de Castillon. Adieu. Je suis pressée par la poste, adieu adieu milles fois.
201. Paris, Lundi 24 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
201 Paris lundi 24 Juin 1839 8 heures
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
202. Baden, Lundi 24 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
202 Baden lundi le 24 juin 1839
Il y a deux ans aujourd’hui que nous sommes allé dîner à Chatenay. Et que nous en sommes revenus ! Vous en souvenez-vous ? Je vous remercie de toute votre lettre d’hier. Je voudrais avoir entendu votre conversation avec Montrond. Je voudrais entendre bien des choses. A propos, je vous prie de lui dire mes amitiés, je voudrais bien le voir ici. Je crois moi qu’il s’y plairait beaucoup et que cela lui ferait du bien. Il plairait à Mad. de Nesselrode qui aime beaucoup les gens d’esprit. Je commence toujours ma journée avec elle. Nous nous rencontrons à 6 h du matin, et jusqu’à 7 1/2 nous nous promenons ou nous asseyons ensemble selon qu'il fait chaud ou frais. Aujoud’hui il fait frais. J'ai marché.
Mardi 25 à 8 heures du matin
J'ai lu dans les journaux la discussion à la chambre sur l’armée. Vous avez été très brillant, mais je ne suis pas de votre avis. Et la raison est que nous en Russie dans une armée de huit cent mille hommes, nous avons deux maréchaux depuis que je suis au monde, je n’en ai jamais vu que trois en même temps. Je crois même qu'aujourd’hui notre seul maréchal est Paskient nous ne le faisons qu'en temps de guerre. Il y a eu des époques où il n'y en avait pas un seul. Je suis bien aise du journal des Débats, il me paraît avoir tout-à-fait passé de votre côté. Je ne vois pas que vous ayez fait visite à Neuilly. Dites-moi un peu bien des choses que vous me diriez à la Terrasse. Je ne sais rien du tout.
Mad. de Talleyrand a été sensible à votre souvenir. Elle parle de vous très bien. Que je serais aise si Montrond venait ici ! Mon existence est very dull. Je n’ai certainement pas souri une fois depuis que je vous ai quitté. Et je ne crois pas que cela m’arrive tant que nous resterons séparés. Je ne sais pas s'il est possible d’engraisser quand on est toujours triste , mais assurément il n'y a pas le moindre signe de changement en ma personne. Et voici trois semaines cependant.
11 heures
L’air est charmant, je reviens des montagnes. Marie est de retour de Carlsruhe. On lui cherche un mari. Elle préfère les vieux, j’imagine que cela sera facile à rencontrer. Je voudrais bien la voir bien établie. Au fond c'est une bonne fille. Je vous remercie beaucoup de la promesse pour Castillon pour cette fois j'y compte. Je viens de relire encore votre discours. Il est fort beau, et vous avez raison all circunstances considered Il ne faut point de comparaison quand il s’agit de l’état actuel de la France, & moi j'ai tort.
5 heures
Voici votre n° 200 ! Sûrement j'ai bien peine à ce gros chiffre en vous écrivant, mais il y a tant de choses auxquelles je pense sans vous les dire. Je voulais vous parler de mes roses ici. Vous ne savez pas comme c'est joli des bouquets de roses ; tout le jardin garni d’orangers, de rosiers, une belle fontaine au milieu du parterre. J'ai voulu vingt fois vous décrire tout cela et puis la tristesse, le découragement me saisissent, & je ne dis rien. L’odeur des fleurs dans les chambres m’incommode mais dehors je trouve cela charmant. Ecrivez-moi davantage, dites-moi tout. Je suis curieuse et puis je suis bien seule, bien triste. Vos lettres sont mon seul plaisir. Adieu. Adieu. Adieu.
Il y a deux ans aujourd’hui que nous sommes allé dîner à Chatenay. Et que nous en sommes revenus ! Vous en souvenez-vous ? Je vous remercie de toute votre lettre d’hier. Je voudrais avoir entendu votre conversation avec Montrond. Je voudrais entendre bien des choses. A propos, je vous prie de lui dire mes amitiés, je voudrais bien le voir ici. Je crois moi qu’il s’y plairait beaucoup et que cela lui ferait du bien. Il plairait à Mad. de Nesselrode qui aime beaucoup les gens d’esprit. Je commence toujours ma journée avec elle. Nous nous rencontrons à 6 h du matin, et jusqu’à 7 1/2 nous nous promenons ou nous asseyons ensemble selon qu'il fait chaud ou frais. Aujoud’hui il fait frais. J'ai marché.
Mardi 25 à 8 heures du matin
J'ai lu dans les journaux la discussion à la chambre sur l’armée. Vous avez été très brillant, mais je ne suis pas de votre avis. Et la raison est que nous en Russie dans une armée de huit cent mille hommes, nous avons deux maréchaux depuis que je suis au monde, je n’en ai jamais vu que trois en même temps. Je crois même qu'aujourd’hui notre seul maréchal est Paskient nous ne le faisons qu'en temps de guerre. Il y a eu des époques où il n'y en avait pas un seul. Je suis bien aise du journal des Débats, il me paraît avoir tout-à-fait passé de votre côté. Je ne vois pas que vous ayez fait visite à Neuilly. Dites-moi un peu bien des choses que vous me diriez à la Terrasse. Je ne sais rien du tout.
Mad. de Talleyrand a été sensible à votre souvenir. Elle parle de vous très bien. Que je serais aise si Montrond venait ici ! Mon existence est very dull. Je n’ai certainement pas souri une fois depuis que je vous ai quitté. Et je ne crois pas que cela m’arrive tant que nous resterons séparés. Je ne sais pas s'il est possible d’engraisser quand on est toujours triste , mais assurément il n'y a pas le moindre signe de changement en ma personne. Et voici trois semaines cependant.
11 heures
L’air est charmant, je reviens des montagnes. Marie est de retour de Carlsruhe. On lui cherche un mari. Elle préfère les vieux, j’imagine que cela sera facile à rencontrer. Je voudrais bien la voir bien établie. Au fond c'est une bonne fille. Je vous remercie beaucoup de la promesse pour Castillon pour cette fois j'y compte. Je viens de relire encore votre discours. Il est fort beau, et vous avez raison all circunstances considered Il ne faut point de comparaison quand il s’agit de l’état actuel de la France, & moi j'ai tort.
5 heures
Voici votre n° 200 ! Sûrement j'ai bien peine à ce gros chiffre en vous écrivant, mais il y a tant de choses auxquelles je pense sans vous les dire. Je voulais vous parler de mes roses ici. Vous ne savez pas comme c'est joli des bouquets de roses ; tout le jardin garni d’orangers, de rosiers, une belle fontaine au milieu du parterre. J'ai voulu vingt fois vous décrire tout cela et puis la tristesse, le découragement me saisissent, & je ne dis rien. L’odeur des fleurs dans les chambres m’incommode mais dehors je trouve cela charmant. Ecrivez-moi davantage, dites-moi tout. Je suis curieuse et puis je suis bien seule, bien triste. Vos lettres sont mon seul plaisir. Adieu. Adieu. Adieu.
202. Paris, Mercredi 26 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
202 Paris. Mercredi 26 Juin 1839 8 heures
Je sors d’une nuit détestable. Je ne sais si je dois m'en prendre à l'orage qui a été violent. Mais je viens de passer quelques heures dans un mal aise et des rêves affreux. J’avais mes trois enfants près de moi, au milieu d'un déluge. L'eau montait, les soulevait de terre. Elle m'en a emporté un, puis deux. Je retenais ma fille Henriette de toute ma force. Elle me conjurait de la lâcher et de me sauver à la nage. J’ai souffert le supplice d'Ugolin. Je me suis réveillé couvert de sueur, criant, pleurant. Je revois encore. Mes mains se sont jointes avec désespoir. J’ai prié, j’ai supplié les trois Anges que j’ai depuis longtemps au Ciel, ou de me rendre ceux qui venaient de les rejoindre, ou de me prendre avec eux. Il y a une des heure que je suis levé. Je suis dans mon cabinet. Je vous écris. Je souffre, je tremble encore. J’attends une lettre de mes enfants. Je l’aurai certainement. En attendant, je ne puis reprendre mon empire sur mon imagination sur mes nerfs. Quelle nuit ! Quelle horreur que la douleur dont le rêve est une telle torture ! Pardon de vous parler de la mienne. Mais vraiment, je souffre encore beaucoup. Je suis très ébranlé. J’attends mes lettres avec angoisse. Il me semble que je me rassure en vous parlant.
10 heures
Voilà une lettre de Pauline et de ma mère. Dieu soit loué ! Il n’y en a point de noyé. J’étais vraiment fou il y a deux heures, je ne voyais rien que ma pièce d'eau. Mes enfants tombés dans ma pièce d’eau. Il faut que je parle d'autre chose, car je retomberais. Que nous sommes de faibles créatures ! Et avec une telle faiblesse, toujours à la porte de tels dangers, de telles douleurs ! Une étourderie, un faux pas, une minute de négligence d’une bonne, rien, vraiment rien, entre nous et le supplice ! Et nous marchons, nous vivons nous dormons au bord de ces abymes ! Ah, nous sommes aussi légers que faibles. Nous oublions tout, les maux passés, les maux possibles, les maux qui sont là peut-être là tout près ! Que nous sommes dignes de pitié ! Et quelle pitié que ce que nous sommes ! Il faut que je vous quitte encore. Je ne puis m’arracher à mon impression de cette nuit. J’aime pourtant bien votre grand papier, car j'ai aussi votre N°201.
Jeudi 27 7 h et demie
Les débats de la Chambre s’animent un peu. Le Cabinet avait eu avant-hier sur l'affaire du Mexique, une pitoyable séance. Les hésitations et les contradictions du Maréchal et de son avocat le Garde de sceaux, avaient soulevé le cœur. Hier sur l’Espagne, M. Passy et M. Dufaure est assez bien parlé. Je doute que le Roi soit content de ce qu’ils ont dit surtout M. Dufaure ; mais ils ont réussi. Pour qui les deux séances ont été bien mauvaises, c’est M. Molé. Défendre dans l'une par M. de Salvandy, sans le moindre effet, et dans l'autre, attaquant le cabinet actuel par M. de Chasseloup qui est resté seul, absolument seul. Tout le monde en a été frappé ! Demain ou après-demain, le débat sur l'Orient. Vous voyez les nouvelles. Les gens qui connaissent le pays ne croient pas que le Pacha dirige son effort sur Constantinople ; ce qui mettrait ses amis d'Europe dans l’embarras et les empêcherait de lui donner l'appui dont il a besoin. La guerre une fois engagée et s’il bat les Turcs, il marchera plutôt de l'Ossoff à l'Elbe que du Sud au Nord et vers Bagdad que vers Constantinople. Conquérir l'hérédité, c’est son grand but. Il y subordonnera toute sa conduite. Nos instructions partent pour notre flotte en Orient, analogues à celles de l'Angleterre.
Le procès commence aujourd’hui. Pendant son cours, le gouvernement s'attend à quelque nouvelle attaque. Ces gens-là l’annoncent très haut. Ce sont des sectaires de plus en plus isolés, et qui redoublent de rage à mesure que leur nombre diminue. Dans leurs réunions du matin et du soir ils mettent en avant les projets les plus frénétiques, l'incendie, l'assassinat. On est fort sur ses gardes. On a fait venir deux régiments de plus. Je doute fort d’un nouveau coup. Les Chefs des accusés refusent absolument de parler. Avant-hier le Chancelier pressait Martin. Bernard de questions. Celui-ci a dit au greffier : " Ne pourriez-vous pas faire taire ce grand Monsieur qui m’ennuie ? " Il faut que je vous quitte. J'ai ma toilette à faire Je vais déjeuner au Luxembourg avec Lady Jersey. Nous ne nous quittons pas. Elle a voulu entendre la lecture du Chapitre des Mémoires de Mad. de Rémusat qui raconte la mort du Duc d'Enghien. M. de Rémusat l'a lu hier au soir chez Mad. Anisson. Elle part demain pour Londres. L'autre jour à dîner chez Madame Brignole, la Princesse de Ligne était là aussi. Madame Brignole ne savait trop à qui donner le pas. Elle a imaginé d'aller confier son embarras à Lady Jersey elle-même qui lui a répondu. " Il n'y a rien de plus simple. Je suis femme d’un lord d’Angleterre. Vous ne pouvez pas hésiter. " Je suis de son avis. L’aristocratie passe avant la noblesse. Adieu. Adieu. Votre grand papier a son mérite mais il est traitre comme le petit du reste. Vous n’écrivez pas sur le verso. On n'a que la moitié de ce qu’on attend. Adieu encore.
Je sors d’une nuit détestable. Je ne sais si je dois m'en prendre à l'orage qui a été violent. Mais je viens de passer quelques heures dans un mal aise et des rêves affreux. J’avais mes trois enfants près de moi, au milieu d'un déluge. L'eau montait, les soulevait de terre. Elle m'en a emporté un, puis deux. Je retenais ma fille Henriette de toute ma force. Elle me conjurait de la lâcher et de me sauver à la nage. J’ai souffert le supplice d'Ugolin. Je me suis réveillé couvert de sueur, criant, pleurant. Je revois encore. Mes mains se sont jointes avec désespoir. J’ai prié, j’ai supplié les trois Anges que j’ai depuis longtemps au Ciel, ou de me rendre ceux qui venaient de les rejoindre, ou de me prendre avec eux. Il y a une des heure que je suis levé. Je suis dans mon cabinet. Je vous écris. Je souffre, je tremble encore. J’attends une lettre de mes enfants. Je l’aurai certainement. En attendant, je ne puis reprendre mon empire sur mon imagination sur mes nerfs. Quelle nuit ! Quelle horreur que la douleur dont le rêve est une telle torture ! Pardon de vous parler de la mienne. Mais vraiment, je souffre encore beaucoup. Je suis très ébranlé. J’attends mes lettres avec angoisse. Il me semble que je me rassure en vous parlant.
10 heures
Voilà une lettre de Pauline et de ma mère. Dieu soit loué ! Il n’y en a point de noyé. J’étais vraiment fou il y a deux heures, je ne voyais rien que ma pièce d'eau. Mes enfants tombés dans ma pièce d’eau. Il faut que je parle d'autre chose, car je retomberais. Que nous sommes de faibles créatures ! Et avec une telle faiblesse, toujours à la porte de tels dangers, de telles douleurs ! Une étourderie, un faux pas, une minute de négligence d’une bonne, rien, vraiment rien, entre nous et le supplice ! Et nous marchons, nous vivons nous dormons au bord de ces abymes ! Ah, nous sommes aussi légers que faibles. Nous oublions tout, les maux passés, les maux possibles, les maux qui sont là peut-être là tout près ! Que nous sommes dignes de pitié ! Et quelle pitié que ce que nous sommes ! Il faut que je vous quitte encore. Je ne puis m’arracher à mon impression de cette nuit. J’aime pourtant bien votre grand papier, car j'ai aussi votre N°201.
Jeudi 27 7 h et demie
Les débats de la Chambre s’animent un peu. Le Cabinet avait eu avant-hier sur l'affaire du Mexique, une pitoyable séance. Les hésitations et les contradictions du Maréchal et de son avocat le Garde de sceaux, avaient soulevé le cœur. Hier sur l’Espagne, M. Passy et M. Dufaure est assez bien parlé. Je doute que le Roi soit content de ce qu’ils ont dit surtout M. Dufaure ; mais ils ont réussi. Pour qui les deux séances ont été bien mauvaises, c’est M. Molé. Défendre dans l'une par M. de Salvandy, sans le moindre effet, et dans l'autre, attaquant le cabinet actuel par M. de Chasseloup qui est resté seul, absolument seul. Tout le monde en a été frappé ! Demain ou après-demain, le débat sur l'Orient. Vous voyez les nouvelles. Les gens qui connaissent le pays ne croient pas que le Pacha dirige son effort sur Constantinople ; ce qui mettrait ses amis d'Europe dans l’embarras et les empêcherait de lui donner l'appui dont il a besoin. La guerre une fois engagée et s’il bat les Turcs, il marchera plutôt de l'Ossoff à l'Elbe que du Sud au Nord et vers Bagdad que vers Constantinople. Conquérir l'hérédité, c’est son grand but. Il y subordonnera toute sa conduite. Nos instructions partent pour notre flotte en Orient, analogues à celles de l'Angleterre.
Le procès commence aujourd’hui. Pendant son cours, le gouvernement s'attend à quelque nouvelle attaque. Ces gens-là l’annoncent très haut. Ce sont des sectaires de plus en plus isolés, et qui redoublent de rage à mesure que leur nombre diminue. Dans leurs réunions du matin et du soir ils mettent en avant les projets les plus frénétiques, l'incendie, l'assassinat. On est fort sur ses gardes. On a fait venir deux régiments de plus. Je doute fort d’un nouveau coup. Les Chefs des accusés refusent absolument de parler. Avant-hier le Chancelier pressait Martin. Bernard de questions. Celui-ci a dit au greffier : " Ne pourriez-vous pas faire taire ce grand Monsieur qui m’ennuie ? " Il faut que je vous quitte. J'ai ma toilette à faire Je vais déjeuner au Luxembourg avec Lady Jersey. Nous ne nous quittons pas. Elle a voulu entendre la lecture du Chapitre des Mémoires de Mad. de Rémusat qui raconte la mort du Duc d'Enghien. M. de Rémusat l'a lu hier au soir chez Mad. Anisson. Elle part demain pour Londres. L'autre jour à dîner chez Madame Brignole, la Princesse de Ligne était là aussi. Madame Brignole ne savait trop à qui donner le pas. Elle a imaginé d'aller confier son embarras à Lady Jersey elle-même qui lui a répondu. " Il n'y a rien de plus simple. Je suis femme d’un lord d’Angleterre. Vous ne pouvez pas hésiter. " Je suis de son avis. L’aristocratie passe avant la noblesse. Adieu. Adieu. Votre grand papier a son mérite mais il est traitre comme le petit du reste. Vous n’écrivez pas sur le verso. On n'a que la moitié de ce qu’on attend. Adieu encore.
203. Baden, Mercredi 26 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
203 Baden le 26 juin, 1839 5 heures après midi.
J'ai beaucoup écrit ce matin, je me suis beaucoup promené, je ne vous ai rien dit jusqu’à ce moment et je ne vous dirai pas combien j’ai pensé à vous, vous savez comme on peut penser, toujours pensé à une même chose. Je pense à vous à Baden un peu plus encore que je n’y pense à Paris. C’est beaucoup.
Je suis sérieusement inquiète de ce qui peut arriver à Paris, dites-moi si vous l’êtes. Madame de Talleyrand était tellement persuadé en partant qu’il aurait de gros événements qu’elle n'y a rien laissé du tout. Hors ses combles, elle a tout fait venir à Baden. Moi tout au contraire, j'y ai quatre robes de deuil, et j’ai tout tout laissé à Paris. Pillera-t-on l’hôtel de la Terrasse ? Dites-moi cela, J'en serais très fâchée, cela me manque encore. J'ai écrit une longue lettre à mon frère aujourd'hui, je ne sais plus quoi mais c’était bien, que je voudrais voir mes affaire finies !
J'ai eu une lettre de Lady Cowper. Lady Flora Hastings est très mal . Si elle meurt ce sera une mauvaise affaire pour la Reine. Les Ministres espèrent arriver dans dix jours à la fin de la session. Lady Cowper n’admet pas de discussions dans le Cabinet. Lord Normanby ne pense pas à supplanter Lord Melbourne. Pozzo très faible et hors d’état même de partir. Lady Cowper, Mad. de Flahaut d’autres encore veulent venir à Baden. Je ne crois à rien de cela parce que cela me serait agréable, et je crois à de mauvais moments à Paris parce que j’en serais désolée. Voilà la foi que j'ai dans ma fortune !
Jeudi 27 à 8 h. du matin.
Le temps est beaucoup rafraîchi, il fait même froid et ma promenade hier au soir ne m'a fait aucun plaisir. Ah que les jours coulent lourdement ici ! Je n'en puis plus. Si je voyais mes bras s’arrondir selon votre volonté, je supporterais Baden gaiement peut-être. Mais sans bras, sans société, sans un moment de bon temps ou de plaisir dans la journée, c’est bien dur ! J’ai laissé le lait d'ânesse, il n'allait pas à mon estomac. Je continue les bains, et il me semble qu'ils m’affaiblissent. Ainsi, il y a décadence au lieu de progrès.
5 heures
Merci de votre N°201. Il m'arrive au moment où je suis obligée de remettre le mien. Je n’ai rien de nouveau à vous dire. Je me suis trouvé mal ce matin. Le Médecin trouve mon pouls très affaibli, on va changer en bains. Moi j'aimerais bien mieux ne rien faire. Je suis sûre que tout ceci va me tuer. Je me sens très souffrante. Adieu. Adieu. Pensez bien moi.
J'ai beaucoup écrit ce matin, je me suis beaucoup promené, je ne vous ai rien dit jusqu’à ce moment et je ne vous dirai pas combien j’ai pensé à vous, vous savez comme on peut penser, toujours pensé à une même chose. Je pense à vous à Baden un peu plus encore que je n’y pense à Paris. C’est beaucoup.
Je suis sérieusement inquiète de ce qui peut arriver à Paris, dites-moi si vous l’êtes. Madame de Talleyrand était tellement persuadé en partant qu’il aurait de gros événements qu’elle n'y a rien laissé du tout. Hors ses combles, elle a tout fait venir à Baden. Moi tout au contraire, j'y ai quatre robes de deuil, et j’ai tout tout laissé à Paris. Pillera-t-on l’hôtel de la Terrasse ? Dites-moi cela, J'en serais très fâchée, cela me manque encore. J'ai écrit une longue lettre à mon frère aujourd'hui, je ne sais plus quoi mais c’était bien, que je voudrais voir mes affaire finies !
J'ai eu une lettre de Lady Cowper. Lady Flora Hastings est très mal . Si elle meurt ce sera une mauvaise affaire pour la Reine. Les Ministres espèrent arriver dans dix jours à la fin de la session. Lady Cowper n’admet pas de discussions dans le Cabinet. Lord Normanby ne pense pas à supplanter Lord Melbourne. Pozzo très faible et hors d’état même de partir. Lady Cowper, Mad. de Flahaut d’autres encore veulent venir à Baden. Je ne crois à rien de cela parce que cela me serait agréable, et je crois à de mauvais moments à Paris parce que j’en serais désolée. Voilà la foi que j'ai dans ma fortune !
Jeudi 27 à 8 h. du matin.
Le temps est beaucoup rafraîchi, il fait même froid et ma promenade hier au soir ne m'a fait aucun plaisir. Ah que les jours coulent lourdement ici ! Je n'en puis plus. Si je voyais mes bras s’arrondir selon votre volonté, je supporterais Baden gaiement peut-être. Mais sans bras, sans société, sans un moment de bon temps ou de plaisir dans la journée, c’est bien dur ! J’ai laissé le lait d'ânesse, il n'allait pas à mon estomac. Je continue les bains, et il me semble qu'ils m’affaiblissent. Ainsi, il y a décadence au lieu de progrès.
5 heures
Merci de votre N°201. Il m'arrive au moment où je suis obligée de remettre le mien. Je n’ai rien de nouveau à vous dire. Je me suis trouvé mal ce matin. Le Médecin trouve mon pouls très affaibli, on va changer en bains. Moi j'aimerais bien mieux ne rien faire. Je suis sûre que tout ceci va me tuer. Je me sens très souffrante. Adieu. Adieu. Pensez bien moi.
203. Paris, Vendredi 28 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
203 Paris. Vendredi 28 Juin 1839. Midi
Vous me demandez de vous écrire davantage. Indiquez-moi comment. Ma lettre ne part que tous les deux jours ; mais tous les jours, je vous dis ce que je fais et ce que je sais. Je vous dis tout... sauf ce que je vous dirais à la Terrasse. Mais il n'y a point de remède à ce mal. La distance tue beaucoup de petites choses, et les plus grandes.
Je suis bien aise que vous approuviez ce que j'ai dit à la Chambre. Car votre opinion que deux ou trois Maréchaux, ou un, sont assez pour une armée de huit cent mille hommes, permettez-moi de n'en pas tenir grand compte, pas plus que de la mienne qu'il en faut huit pour une armée de cinq cent mille. Je ne me suis guère inquiété de mon expérience militaire. J’ai vu l’antipathie des grandes situations, le désir d'en retrancher une, deux. Je n’ai pas compté ; j’ai protesté. Je ne sais si je parlerai sur l'Orient. Le débat commencera Lundi. J’ai peur qu'on ne me fournisse aucun bon prétexte. C’est déjà beaucoup pour moi de parler sans cause et seulement sur un prétexte. Au moins il me le faut bon. Il n’est pas nécessaire que je parle ; il faut qu’on le trouve au moins naturel. Je regretterais de me taire. Je crois que ce que j'ai à dire est bon, pour la question et pour moi. Du reste les nouvelles s'accordent de plus en plus avec ce que je vous ai dit. Le Pacha aura le bon sens de ne battre les Turcs que s'il y est forcé. Et quand il les aura battus, de ne faire de conquêtes que d’un côté qui ne mette pas ses amis d’Europe dans l'embarras. Il ne passera point le Taurus. Rien ne vous appellera à Constantinople. Pourtant le Pacha pourra bien gagner son hérédité. Ce sera une nouvelle pierre tombée sans bruit de l’édifice ottoman. A moins qu’un succès momentané des Turcs ne fasse éclater leur folie, et que leur folie ne pousse le Pacha hors de son bon sens c'est-à-dire vers le Nord au lieu de l’Est. Et ce pauvre Prince Miloch. On vous impute fort cet échec du pouvoir absolu en Serbie.
8 heures
J'ai dîné chez M. Devaines. Je rentre. Je m'ennuie d’aller chercher des gens qui m'ennuient. Quand je fais un effort, je parviens à ne pas m'ennuyer même de ceux-là, et à en tirer un passetemps. Je veux tenter ce soir un effort plus doux, celui de me persuader que nous causons, et de causer en effet comme si nous causions. Pauvre ressource pour un homme aussi peu enclin que moi aux illusions, et qui en fait aussi peu de cas !
Nous avons voté ce matin, sans la moindre objection et presque à l'unanimité, ce doublement, de la garde municipale qu’on osait à peine demander. Il y a trois ou quatre ans, nous nous sérions arraché les yeux pendant huit jours sur cette question, et il y aurait eu 160 voix de minorité. Tout le monde est las. Et puis sérieusement parlant, les lois de septembre ont fait leur effet. Le principe que la révolte est illégitime, en paroles comme en actes, est admis par tout le monde excepté par cette poignée de frénétiques que les Pairs jugent depuis hier. Personne ne veut ou n'ose plus les soutenir. Ils ont eu quelque peine à trouver des avocats. Les craintes de nouveaux troubles pendant le procès se dissipent. Non qu'ils ne les annoncent eux-mêmes, et ne se les promettent en effet tous les jours. Mais ils n’ont point d’armes, point de poudre. Je doute qu’ils tentent quelque chose. Ils avaient conçu une horrible idée, celle d'enlever un des petits Princes sur la route du Collège, ou Madame la duchesse d'Orléans sur celle de l’Eglise des Billettes pour s'en faire des otages. Vous pensez bien qu’on a pris toutes les précautions imaginables.
Au milieu des complots et des procès, le monde ordinaire, va son train. Mlle de Janson épouse le Duc de Beaufort, Mad. de Janson a beaucoup hésité. Enfin les paroles ont été données hier. Le bruit du mariage du Duc de Broglie avec Mad. de Stael avait été fort répandu, grâce à M. Molé dit-on. J’y crois moins que jamais.
Il y a une conspiration à la Comédie Française contre Melle Rachel. Elle fait la fortune et le désespoir des comédiens. Là comme ailleurs, l'amour propre est plus fort que l’intérêt. L’une des fontaines de la place Louis XV est près d’être terminée. Cette masse de fer en coupes, en hommes, en amours, en poissons, fait un singulier effet. Il faudra beaucoup, beaucoup d'eau pour couvrir tout cela. On dit qu'il y en aura beaucoup, et par dessous l'eau entre les statues des réverbères qui brilleront à travers l’eau. M. de Rambuteau épuisera là son génie. Il a fait mettre au-dessus des candélabres et des colonnes rostrales, des lanternes dorées qui sont très riches. Voilà mon feuilleton. Vous ne me demanderez plus de vous en dire davantage. Adieu. Je vais me coucher. Je vous dirai encore adieu demain avant d'envoyer ma lettre à la poste. La journée a été encore pleine d'orages. J'espère qu’il n’y en aura pas cette nuit. J'en ai horreur.
Tout va bien au Val-Richer. J’ai eu ce matin une lettre d'Henriette. Très gentille, mais je ne puis obtenir d’elle la moindre ponctuation. Je lui ai répondu, pour lui en faire comprendre la nécessité et le mérite, la plus belle lettre du monde, un petit chef d’œuvre de grammaire. de morale. Vous s’avez que j’ai quelque talent pour la grammaire. Adieu enfin.
Samedi 10 heures
Adieu encore. On m’apporte mon déjeuner, du beurre et du chocolat. Vous ne vous en contenteriez pas. Je suis fâché que vous n'ayez, pas à Baden un bon cuisinier. Je dîne aujourd’hui chez Mad. Eynard, demain au café de Paris, après-demain chez Mad. Delessert. Je ferai meilleure chair que vous. G.
Vous me demandez de vous écrire davantage. Indiquez-moi comment. Ma lettre ne part que tous les deux jours ; mais tous les jours, je vous dis ce que je fais et ce que je sais. Je vous dis tout... sauf ce que je vous dirais à la Terrasse. Mais il n'y a point de remède à ce mal. La distance tue beaucoup de petites choses, et les plus grandes.
Je suis bien aise que vous approuviez ce que j'ai dit à la Chambre. Car votre opinion que deux ou trois Maréchaux, ou un, sont assez pour une armée de huit cent mille hommes, permettez-moi de n'en pas tenir grand compte, pas plus que de la mienne qu'il en faut huit pour une armée de cinq cent mille. Je ne me suis guère inquiété de mon expérience militaire. J’ai vu l’antipathie des grandes situations, le désir d'en retrancher une, deux. Je n’ai pas compté ; j’ai protesté. Je ne sais si je parlerai sur l'Orient. Le débat commencera Lundi. J’ai peur qu'on ne me fournisse aucun bon prétexte. C’est déjà beaucoup pour moi de parler sans cause et seulement sur un prétexte. Au moins il me le faut bon. Il n’est pas nécessaire que je parle ; il faut qu’on le trouve au moins naturel. Je regretterais de me taire. Je crois que ce que j'ai à dire est bon, pour la question et pour moi. Du reste les nouvelles s'accordent de plus en plus avec ce que je vous ai dit. Le Pacha aura le bon sens de ne battre les Turcs que s'il y est forcé. Et quand il les aura battus, de ne faire de conquêtes que d’un côté qui ne mette pas ses amis d’Europe dans l'embarras. Il ne passera point le Taurus. Rien ne vous appellera à Constantinople. Pourtant le Pacha pourra bien gagner son hérédité. Ce sera une nouvelle pierre tombée sans bruit de l’édifice ottoman. A moins qu’un succès momentané des Turcs ne fasse éclater leur folie, et que leur folie ne pousse le Pacha hors de son bon sens c'est-à-dire vers le Nord au lieu de l’Est. Et ce pauvre Prince Miloch. On vous impute fort cet échec du pouvoir absolu en Serbie.
8 heures
J'ai dîné chez M. Devaines. Je rentre. Je m'ennuie d’aller chercher des gens qui m'ennuient. Quand je fais un effort, je parviens à ne pas m'ennuyer même de ceux-là, et à en tirer un passetemps. Je veux tenter ce soir un effort plus doux, celui de me persuader que nous causons, et de causer en effet comme si nous causions. Pauvre ressource pour un homme aussi peu enclin que moi aux illusions, et qui en fait aussi peu de cas !
Nous avons voté ce matin, sans la moindre objection et presque à l'unanimité, ce doublement, de la garde municipale qu’on osait à peine demander. Il y a trois ou quatre ans, nous nous sérions arraché les yeux pendant huit jours sur cette question, et il y aurait eu 160 voix de minorité. Tout le monde est las. Et puis sérieusement parlant, les lois de septembre ont fait leur effet. Le principe que la révolte est illégitime, en paroles comme en actes, est admis par tout le monde excepté par cette poignée de frénétiques que les Pairs jugent depuis hier. Personne ne veut ou n'ose plus les soutenir. Ils ont eu quelque peine à trouver des avocats. Les craintes de nouveaux troubles pendant le procès se dissipent. Non qu'ils ne les annoncent eux-mêmes, et ne se les promettent en effet tous les jours. Mais ils n’ont point d’armes, point de poudre. Je doute qu’ils tentent quelque chose. Ils avaient conçu une horrible idée, celle d'enlever un des petits Princes sur la route du Collège, ou Madame la duchesse d'Orléans sur celle de l’Eglise des Billettes pour s'en faire des otages. Vous pensez bien qu’on a pris toutes les précautions imaginables.
Au milieu des complots et des procès, le monde ordinaire, va son train. Mlle de Janson épouse le Duc de Beaufort, Mad. de Janson a beaucoup hésité. Enfin les paroles ont été données hier. Le bruit du mariage du Duc de Broglie avec Mad. de Stael avait été fort répandu, grâce à M. Molé dit-on. J’y crois moins que jamais.
Il y a une conspiration à la Comédie Française contre Melle Rachel. Elle fait la fortune et le désespoir des comédiens. Là comme ailleurs, l'amour propre est plus fort que l’intérêt. L’une des fontaines de la place Louis XV est près d’être terminée. Cette masse de fer en coupes, en hommes, en amours, en poissons, fait un singulier effet. Il faudra beaucoup, beaucoup d'eau pour couvrir tout cela. On dit qu'il y en aura beaucoup, et par dessous l'eau entre les statues des réverbères qui brilleront à travers l’eau. M. de Rambuteau épuisera là son génie. Il a fait mettre au-dessus des candélabres et des colonnes rostrales, des lanternes dorées qui sont très riches. Voilà mon feuilleton. Vous ne me demanderez plus de vous en dire davantage. Adieu. Je vais me coucher. Je vous dirai encore adieu demain avant d'envoyer ma lettre à la poste. La journée a été encore pleine d'orages. J'espère qu’il n’y en aura pas cette nuit. J'en ai horreur.
Tout va bien au Val-Richer. J’ai eu ce matin une lettre d'Henriette. Très gentille, mais je ne puis obtenir d’elle la moindre ponctuation. Je lui ai répondu, pour lui en faire comprendre la nécessité et le mérite, la plus belle lettre du monde, un petit chef d’œuvre de grammaire. de morale. Vous s’avez que j’ai quelque talent pour la grammaire. Adieu enfin.
Samedi 10 heures
Adieu encore. On m’apporte mon déjeuner, du beurre et du chocolat. Vous ne vous en contenteriez pas. Je suis fâché que vous n'ayez, pas à Baden un bon cuisinier. Je dîne aujourd’hui chez Mad. Eynard, demain au café de Paris, après-demain chez Mad. Delessert. Je ferai meilleure chair que vous. G.
204. Baden, Vendredi 28 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
204 Baden le 28 juin vendredi 1839 9 heures du matin
J'ai lu les rapports de M. Jouffroy. Il est très bien, on ne peut mieux. Mais le conseil qu’il donne impraticable. Nous ne laisserons par les puissances de l'Europe se mêler de cette affaire, soyez persuadé qu’il ne peut pas y avoir de congrès. Vous serez très content de nous, moins cela.
Vous m'écrivez de courtes lettres. Je manque d’appétit pour mon dîner mais j’en ai toujours, toujours un très grand pour vos lettres, songez à cela. Vous m'avez promis de me tout dire, mais vous ce qui arrive. Quand vous êtes à Paris vous avez beau coup à me dire et vous n'en avez pas le temps. A la campagne, beaucoup de temps et point de nouvelles vous êtes un peu dissipé à Paris. Racontez-moi mieux vos journées. Est-ce que par hasard vous feriez des visites comme l’année dernière, dont je n’entends parler que l’hiver d’ensuite ? Vous voyez que c’est une vieille querelle que je veux réchauffer. Mais trois petites pages et demi pour deux jours, cela, me parait d'une grande avarice. Comment ne trouvez-vous pas de temps pour m'écrire davantage. On trouve toujours du temps quand on veut ! Je vous prie, je vous prie écrivez-moi davantage. Vous me maltraitez, & moi je suis triste, je suis seule, je me fais des dragons. Et si dans ce moment, je continuais, je vous dirais quelques sottises. Adieu. Je vais me promener.
11 heures
Je rentre et je suis plus tranquille, mais ne dérangez pas ma tranquillité. Ecrivez-moi, écrivez- moi davantage. Eh bien, de Paris envoyez-moi une lettre tous les jours. Vous aurez honte de ne m’écrire que deux pages, il faudra bien que je vous occupe un peu plus que cela. Ce sera mieux pour vous, pour moi, pour moi surtout. A la campagne vous donnez des leçons à vos enfants, je n'en suis pas jaloux, vous donnez des ordres à les ouvriers, je n'en suis pas jalouse. Vous aidez Mad. de Meulan à caler des gravures, je n'en suis pas jalouse. Je vous laisse faire. à Paris, sans moi ; je ne vous laisse pas tant de liberté ; il faut que je vous aie à moi davantage toujours, quand vous n'avez pas des affaires. Est-ce convenu ? Je fais parler cette lettre aujourdhui lors de ma règle mais c’est pour que vous soyez plutôt informé de mes exigences. Ainsi de Paris vous m'écrirez tous les jours. Promettez-le moi je vous en supplie.
Ma nuit a été un peu meilleure. Mais le médecin a été forcé de renverser toutes ses ordonnances, au lieu de son et de lait, c'est des bains de sel et d’aromates que je vais commencer demain, & si au bout de huit jours ils ne me font pas de bien, je suis décidé à ne plus rien faire. Je suis plus faible que je ne l’étais à Paris. Il n’y a pas le sens commun à être venu ici pour être plus mal. Le prince Toufackin est venu me voir ce matin. Imaginez que j’ai eu presque du plaisir à le revoir. C’est fort. Adieu. Adieu. Il me semble que je me sens déjà. soulagé par l’arrangement que je vous propose. Adieu. Vous comprenez comment je vous dis Adieu.
J'ai lu les rapports de M. Jouffroy. Il est très bien, on ne peut mieux. Mais le conseil qu’il donne impraticable. Nous ne laisserons par les puissances de l'Europe se mêler de cette affaire, soyez persuadé qu’il ne peut pas y avoir de congrès. Vous serez très content de nous, moins cela.
Vous m'écrivez de courtes lettres. Je manque d’appétit pour mon dîner mais j’en ai toujours, toujours un très grand pour vos lettres, songez à cela. Vous m'avez promis de me tout dire, mais vous ce qui arrive. Quand vous êtes à Paris vous avez beau coup à me dire et vous n'en avez pas le temps. A la campagne, beaucoup de temps et point de nouvelles vous êtes un peu dissipé à Paris. Racontez-moi mieux vos journées. Est-ce que par hasard vous feriez des visites comme l’année dernière, dont je n’entends parler que l’hiver d’ensuite ? Vous voyez que c’est une vieille querelle que je veux réchauffer. Mais trois petites pages et demi pour deux jours, cela, me parait d'une grande avarice. Comment ne trouvez-vous pas de temps pour m'écrire davantage. On trouve toujours du temps quand on veut ! Je vous prie, je vous prie écrivez-moi davantage. Vous me maltraitez, & moi je suis triste, je suis seule, je me fais des dragons. Et si dans ce moment, je continuais, je vous dirais quelques sottises. Adieu. Je vais me promener.
11 heures
Je rentre et je suis plus tranquille, mais ne dérangez pas ma tranquillité. Ecrivez-moi, écrivez- moi davantage. Eh bien, de Paris envoyez-moi une lettre tous les jours. Vous aurez honte de ne m’écrire que deux pages, il faudra bien que je vous occupe un peu plus que cela. Ce sera mieux pour vous, pour moi, pour moi surtout. A la campagne vous donnez des leçons à vos enfants, je n'en suis pas jaloux, vous donnez des ordres à les ouvriers, je n'en suis pas jalouse. Vous aidez Mad. de Meulan à caler des gravures, je n'en suis pas jalouse. Je vous laisse faire. à Paris, sans moi ; je ne vous laisse pas tant de liberté ; il faut que je vous aie à moi davantage toujours, quand vous n'avez pas des affaires. Est-ce convenu ? Je fais parler cette lettre aujourdhui lors de ma règle mais c’est pour que vous soyez plutôt informé de mes exigences. Ainsi de Paris vous m'écrirez tous les jours. Promettez-le moi je vous en supplie.
Ma nuit a été un peu meilleure. Mais le médecin a été forcé de renverser toutes ses ordonnances, au lieu de son et de lait, c'est des bains de sel et d’aromates que je vais commencer demain, & si au bout de huit jours ils ne me font pas de bien, je suis décidé à ne plus rien faire. Je suis plus faible que je ne l’étais à Paris. Il n’y a pas le sens commun à être venu ici pour être plus mal. Le prince Toufackin est venu me voir ce matin. Imaginez que j’ai eu presque du plaisir à le revoir. C’est fort. Adieu. Adieu. Il me semble que je me sens déjà. soulagé par l’arrangement que je vous propose. Adieu. Vous comprenez comment je vous dis Adieu.
204. Paris, Dimanche 30 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
204 Dimanche 30 Juin 1839, 5 heures
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux ! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades, tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie, je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute. On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner & puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux ! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades, tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie, je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute. On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner & puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
205. Paris, Mardi 2 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
205 Paris, mardi 2 Juillet 1839 9 h 1/2
A mon grand regret, et contre mon dessein, je ne puis vous écrire aujourd’hui qu’en courant. La discussion d'Orient a pris hier plus détendue et d'importance qu’on ne s’y attendait. Je parlerai aujourd'hui. La politique du Cabinet du 11 octobre en 1833 a été attaquée par le duc de Valmy. Je la défendrai en passant mais je la défendrai, et il faut que j'en cause ce matin avec le Duc de Broglie qui a les dépêches. Mon temps est pris. Quatre discours ont été écoutés hier et le méritaient. M. de Valmy et très habilement mêlé et confondue le fond de la question avec la tactique Carliste. Si vous le lisez, vous me direz ce que vous pensez d’un Ambassadeur qui écrit des lettres particulières contre les instructions qu’il a reçues et exécutées. M. de Valmy n'a jamais voulu prononcer à la tribune le nom de l’amiral Roussin, quoique j'aie pu faire pour l'y obliger. Il a eu raison. Mais alors il ne fallait pas lire la lettre. M. de Carné a bien défendu le Pacha. M. de Lamartine a été très brillant. Il a du bon sens une demi-heure et il l'emploie à la critique des idées d'autrui. Cela fait, quand il parle de ses propres idées et pour son propre compte, ce sont les mille et une nuits. Mais elles vaut mieux à l'Orient qu'ailleurs, M. Villemin a été sensé vif, et quelquefois éloquent. Il a eu du succès. Vous voyez que je suis plein de mon sujet. Je suis très convaincu que vous ne viendrez pas à un congrès, quoique j’aie rencontré l’espérance contraire. Mais on est crédule à l'espérance. Sachez seulement que cette affaire là vient d’entrer dans les préoccupations publiques. C'est pour la première fois.
Rien de nouveau du Procès. Il se trame. Le Chancelier est las et mou. La Chambre n’est pas dirigée. Nous sommes fort tranquilles. Adieu. Voilà le Duc de Broglie. J’attendrai avec impatience des nouvelles de vos bains de sel et d’aromates. J'attendais presque, un mot de vous ce matin, un mot seulement, mais le début de notre nouveau régime. Vous voulez des nouvelles tous les jours, et moi je veux de vos nouvelles tous les jours. Rien de plus. Je ne veux pas vous fatiguer. Vous m'écrirez longuement quand vous pourrez. Mais de vos nouvelles. Adieu. Adieu. G
A mon grand regret, et contre mon dessein, je ne puis vous écrire aujourd’hui qu’en courant. La discussion d'Orient a pris hier plus détendue et d'importance qu’on ne s’y attendait. Je parlerai aujourd'hui. La politique du Cabinet du 11 octobre en 1833 a été attaquée par le duc de Valmy. Je la défendrai en passant mais je la défendrai, et il faut que j'en cause ce matin avec le Duc de Broglie qui a les dépêches. Mon temps est pris. Quatre discours ont été écoutés hier et le méritaient. M. de Valmy et très habilement mêlé et confondue le fond de la question avec la tactique Carliste. Si vous le lisez, vous me direz ce que vous pensez d’un Ambassadeur qui écrit des lettres particulières contre les instructions qu’il a reçues et exécutées. M. de Valmy n'a jamais voulu prononcer à la tribune le nom de l’amiral Roussin, quoique j'aie pu faire pour l'y obliger. Il a eu raison. Mais alors il ne fallait pas lire la lettre. M. de Carné a bien défendu le Pacha. M. de Lamartine a été très brillant. Il a du bon sens une demi-heure et il l'emploie à la critique des idées d'autrui. Cela fait, quand il parle de ses propres idées et pour son propre compte, ce sont les mille et une nuits. Mais elles vaut mieux à l'Orient qu'ailleurs, M. Villemin a été sensé vif, et quelquefois éloquent. Il a eu du succès. Vous voyez que je suis plein de mon sujet. Je suis très convaincu que vous ne viendrez pas à un congrès, quoique j’aie rencontré l’espérance contraire. Mais on est crédule à l'espérance. Sachez seulement que cette affaire là vient d’entrer dans les préoccupations publiques. C'est pour la première fois.
Rien de nouveau du Procès. Il se trame. Le Chancelier est las et mou. La Chambre n’est pas dirigée. Nous sommes fort tranquilles. Adieu. Voilà le Duc de Broglie. J’attendrai avec impatience des nouvelles de vos bains de sel et d’aromates. J'attendais presque, un mot de vous ce matin, un mot seulement, mais le début de notre nouveau régime. Vous voulez des nouvelles tous les jours, et moi je veux de vos nouvelles tous les jours. Rien de plus. Je ne veux pas vous fatiguer. Vous m'écrirez longuement quand vous pourrez. Mais de vos nouvelles. Adieu. Adieu. G
206. Baden, Lundi 1er juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
206 Baden lundi 1er juillet 1849, à 2 heures
Le temps est vraiment atroce. 8 degrés seulement. Le médecin ordonne à tout le monde de discontinuer les bains. Il pleut des torrents, on ne peut pas bouger ; c'est affreux ceci par un temps pareil. J’attends votre lettre tantôt. C'est la seule chose que j’attends que je désire surtout à Baden.
Vous voyez qu'on ne se presse pas de m’informer de mes affaires. Je n'ai pas d’idée comment elles vont, si elles vont. Je pense qu’il n’y aura que les lettres de Mad. de Nesselrode à son mari qui les fera aller parce qu'elle aura écrit très énergiquement qu'il faut en tirer de l’incertitude où je languis depuis si longtemps. J'ai beau m'en plaindre moi-même cela me touche pas trop ; mais le témoignage d’un turc aura du poids. Voilà comme nous sommes faits ! Un nouvel incident nous donne de l'espoir ; nous croyons si aisément ; je devrais cependant être désabusée.
Mardi 2. à 8 heures du matin Je reçois dans ce moment trois lettres de Pétersbourg. L’une de mon frère ne me parlant que de fêtes- approuvant fort ma réponse au grand duc ! me disant que Paul s’occupe de mes affaires. Voilà tout. L’autre de mon fils Alexandre qui m'annonce prochainement des voyages dans leur terre de Courlande et de Russie, ce qui fait qu’il ne viendra pas me rejoindre à Baden. La troisième de Matonchewitz. Il venait de recevoir ma grande lettre. Il en est très surpris, très peiné, et affirme que s’il n’avait pas été instruit par moi de ces tristes affaires, jamais il ne les eut soupçonnées rien dans la conduite ou le langage de Paul en laissant plus à cette idée. Dans tout cela vous voyez que mes affaires d’intérêts n'ont pas fait un pas. Et il me parait assez probable que rien ne se fera avant le voyage de mes fils, c.-a.-d. que je suis renvoyée à l'automne ou l’hiver.
Après vous avoir parlé de ce qui me tracasse, j’en viens à ce qui me plait. Votre N° 203, dont je vous remercie beaucoup. Vous me dites un peu plus de détails sur vous c’est ce que j’aime. Quand je les recevrai tous les jours je serai contente.
J’ai vu les dépêches de Constantinople du 12 juin adressées à Vienne. Elles laissent fort peu d’espoir de conserver la paix. Le manifeste contre le Pacha d’Egypte devait paraître le lendemain. Le Sultan est très malade ; il est attaqué de la poitrine, il ne peut pas durer. La Hongrie donne du souci au Cabinet de Vienne. Il aura là bien de l'embarras.
Le temps est si laid qu'au lieu de promenade on est venu chez moi hier. J’y ai eu longtemps Mad. de Nesselrode Mad. de Talleyrand et le comte Maltzan Ministre de Prusse à Vienne. Il a un peu d'esprit, une préoccupation continuelle des affaires. Et il est très bien informé de tout ce qui ce passe malgré son absence de son poste. Cela me sera une ressource.
2 heures
Je viens de recevoir des lettres de Londres. Bulner m'annonce sa nomination à Paris. Il venait d'écrire à Paul une lettre qu’il croit bonne, il me rendra compte des résultat. Ellice m'écrit aussi ; l’un et l’autre disent que battus ou battant les Ministres resteront. Il n’est pas possible de songer à un changement. La Reine est devenue Whig enragé. Les Torys c.a.d. Wellington & Peel seraient désolés d'une crise, ainsi il y n’y a aucune apparence quelconque qu’elle arrive. Lady Flora Hastings est mourante. Cela fait un très mauvais effet.
5 heures
J’ai vu ce matin chez moi, Mesdames Nesselrode, Talleyran, Albufera, la Redote. J'ai marché par un bien vilain temps. Je viens de faire mon triste dîner toute seule. Voilà un sot bulletin. Adieu, Adieu, tout ce que vous me dites m'intéresse. Je suis avide de toutes les nouvelles et avide surtout de vous. Ne trouvez-vous pas qu’il y a bien bien longtemps que nous sommes séparés, que c’est bien triste ? Ah mon Dieu que c’est triste ! Adieu.
Le temps est vraiment atroce. 8 degrés seulement. Le médecin ordonne à tout le monde de discontinuer les bains. Il pleut des torrents, on ne peut pas bouger ; c'est affreux ceci par un temps pareil. J’attends votre lettre tantôt. C'est la seule chose que j’attends que je désire surtout à Baden.
Vous voyez qu'on ne se presse pas de m’informer de mes affaires. Je n'ai pas d’idée comment elles vont, si elles vont. Je pense qu’il n’y aura que les lettres de Mad. de Nesselrode à son mari qui les fera aller parce qu'elle aura écrit très énergiquement qu'il faut en tirer de l’incertitude où je languis depuis si longtemps. J'ai beau m'en plaindre moi-même cela me touche pas trop ; mais le témoignage d’un turc aura du poids. Voilà comme nous sommes faits ! Un nouvel incident nous donne de l'espoir ; nous croyons si aisément ; je devrais cependant être désabusée.
Mardi 2. à 8 heures du matin Je reçois dans ce moment trois lettres de Pétersbourg. L’une de mon frère ne me parlant que de fêtes- approuvant fort ma réponse au grand duc ! me disant que Paul s’occupe de mes affaires. Voilà tout. L’autre de mon fils Alexandre qui m'annonce prochainement des voyages dans leur terre de Courlande et de Russie, ce qui fait qu’il ne viendra pas me rejoindre à Baden. La troisième de Matonchewitz. Il venait de recevoir ma grande lettre. Il en est très surpris, très peiné, et affirme que s’il n’avait pas été instruit par moi de ces tristes affaires, jamais il ne les eut soupçonnées rien dans la conduite ou le langage de Paul en laissant plus à cette idée. Dans tout cela vous voyez que mes affaires d’intérêts n'ont pas fait un pas. Et il me parait assez probable que rien ne se fera avant le voyage de mes fils, c.-a.-d. que je suis renvoyée à l'automne ou l’hiver.
Après vous avoir parlé de ce qui me tracasse, j’en viens à ce qui me plait. Votre N° 203, dont je vous remercie beaucoup. Vous me dites un peu plus de détails sur vous c’est ce que j’aime. Quand je les recevrai tous les jours je serai contente.
J’ai vu les dépêches de Constantinople du 12 juin adressées à Vienne. Elles laissent fort peu d’espoir de conserver la paix. Le manifeste contre le Pacha d’Egypte devait paraître le lendemain. Le Sultan est très malade ; il est attaqué de la poitrine, il ne peut pas durer. La Hongrie donne du souci au Cabinet de Vienne. Il aura là bien de l'embarras.
Le temps est si laid qu'au lieu de promenade on est venu chez moi hier. J’y ai eu longtemps Mad. de Nesselrode Mad. de Talleyrand et le comte Maltzan Ministre de Prusse à Vienne. Il a un peu d'esprit, une préoccupation continuelle des affaires. Et il est très bien informé de tout ce qui ce passe malgré son absence de son poste. Cela me sera une ressource.
2 heures
Je viens de recevoir des lettres de Londres. Bulner m'annonce sa nomination à Paris. Il venait d'écrire à Paul une lettre qu’il croit bonne, il me rendra compte des résultat. Ellice m'écrit aussi ; l’un et l’autre disent que battus ou battant les Ministres resteront. Il n’est pas possible de songer à un changement. La Reine est devenue Whig enragé. Les Torys c.a.d. Wellington & Peel seraient désolés d'une crise, ainsi il y n’y a aucune apparence quelconque qu’elle arrive. Lady Flora Hastings est mourante. Cela fait un très mauvais effet.
5 heures
J’ai vu ce matin chez moi, Mesdames Nesselrode, Talleyran, Albufera, la Redote. J'ai marché par un bien vilain temps. Je viens de faire mon triste dîner toute seule. Voilà un sot bulletin. Adieu, Adieu, tout ce que vous me dites m'intéresse. Je suis avide de toutes les nouvelles et avide surtout de vous. Ne trouvez-vous pas qu’il y a bien bien longtemps que nous sommes séparés, que c’est bien triste ? Ah mon Dieu que c’est triste ! Adieu.
206. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
206 Paris, mercredi 3 Juillet 1839, 8 heures
J’ai parlé hier. Vous lirez cela. Je regrette bien que nous ne puissions en causer à l'aise. Je suis sûr que j’ai bien parlé. J’ai réussi beaucoup auprès des connaisseurs, convenablement auprès des autres. La portée de ce que j'ai dit n'a pas été vue de tous. De M. Dupin, par exemple qui n’y a rien compris. Quelques uns ont trouvé que je parlais trop bien de votre Empereur, & se sont étonnés qu’en parlant si bien, je n'en parlais pas encore beaucoup mieux. Je crois avoir quant aux choses mêmes, touché au fond, et quant à moi pris la position qui me convient. Vous savez que je suis optimiste, pour moi comme pour les choses. A tout prendre, je ne pense pas que mon optimisme m'ait souvent trompé. Et puis si vous étiez là, je vous dirais bien qu'elle en est la vraie source. Mais vous êtes trop loin. En tout, c’est un grand débat. Et n'oubliez pas ce que je vous disais hier. Pour la première fois, la question est entrée très avant dans la pensée publique. Elle y restera. Elle s’y enfoncera. A mesure que les événements se développeront. S’ils se développent, le Gouvernement peut venir demander aux Chambres ce qu’il voudra, elles le lui donneront. Et si les événements se développent sans lui, il aura grand peine à rester en arrière. Du reste, je crois au bon sens de tout le monde, en ceci. Je ne vous dis rien des nouvelles. Les dépêches télégraphiques sont publiées textuellement. M. Urquart, sur qui je vous avais demandé si vous pouviez me donner quelques renseignements est à Paris, et m’a fait demander à me voir ce matin. Tout brouillé qu’il est avec Lord Palmerston, il me paraît un des hommes les plus curieux à entendre sur l'Orient. Si je vous répétais ce que tout le monde dit, je vous dirais que la session est finie, que ceci est le dernier débat que la Chambre est extenuée et n'écoutera plus rien. J’en doute. La Chambre écoute quand on parle. Ce sont des esprits très médiocres, très ignorants, très subalternes, mais au fond plus embarrassés que fatigués, et qui n'hésiteraient pas tant s’ils y voyaient un peu plus clair.
10 heures
J’ai été interrompu par des visites. Elles prennent beaucoup de place dans ma journée. Je ne me lève guère avant 8 heures et depuis que je suis levé jusqu'au moment où je pars pour la Chambre, j'ai du monde. Je ne ferme point ma porte. Je suis seul ici ; je n’y suis pas venu pour travailler. Je travaillerai au Val-Richer. Ici j'écoute et je cause. Bien dans une vue d’utilité car pour du plaisir je n’y prétends pas. Je suis très difficile, en fait de plaisir. J'en puis supporter l'absence, mais non la médiocrité. Je déjeune à 1 heures. Je vais à la Chambre à l'heure. Quelques fois, je sors une demi-heure plutôt pour passer au ministère de l’Intérieur. Je passe à la Chambre toute, ma matinée. Je lis les journaux. Je cause encore. J’écoute un peu. Je rentre au sortir de la séance. Je m'habille. Je vais dîner bien rarement au café de Paris, trois fois seulement depuis que je suis ici ; hier chez Mad. de Gasparin, aujourd’hui chez Mad. Eymard avec le Duc de Broglie. Jeudi chez M. le Ministre de l’instruction publique, Vendredi, chez M. Devaines etc. Je rentre de très bonne heure. Je lis. Je me couche et je dors ou je rêve, quelquefois bien mal, comme vous savez, souvent mieux. Quand je dis que je dors, je me vante un peu. Depuis quelque temps je dors moins bien. Je rallume mes bougies. Je lis ou je pense. Je n’ai pas deux pensées.
11 heures
Voilà votre Numéro 205. Je viens de faire ce que vous me demandez. Je vous ai raconté mes journées. Elles se ressemblent beaucoup. Les vôtres me chagrinent. Vous savez que je déteste les sentiments combattus. Vous m’y condamnez. J’aime le vide que je fais dans votre vie, et celui que vous souffrez ne désole. Je vous pardonne tous vos reproches. Adieu. J’ai ma toilette à faire, et à déjeuner. Je veux être à la Chambre de bonne heure, M. Douffroy résumera la discussion. Ce ne sera pas brillant, mais sensé et bien dit. Adieu. Adieu. Tout est insuffisant, tout ; et c’est le mal de notre relation qu'elle est vouée à l’insuffisance. Je supporte ce mal avec une peine extrême, et je le retrouve à chaque instant pourtant. Adieu
J’ai parlé hier. Vous lirez cela. Je regrette bien que nous ne puissions en causer à l'aise. Je suis sûr que j’ai bien parlé. J’ai réussi beaucoup auprès des connaisseurs, convenablement auprès des autres. La portée de ce que j'ai dit n'a pas été vue de tous. De M. Dupin, par exemple qui n’y a rien compris. Quelques uns ont trouvé que je parlais trop bien de votre Empereur, & se sont étonnés qu’en parlant si bien, je n'en parlais pas encore beaucoup mieux. Je crois avoir quant aux choses mêmes, touché au fond, et quant à moi pris la position qui me convient. Vous savez que je suis optimiste, pour moi comme pour les choses. A tout prendre, je ne pense pas que mon optimisme m'ait souvent trompé. Et puis si vous étiez là, je vous dirais bien qu'elle en est la vraie source. Mais vous êtes trop loin. En tout, c’est un grand débat. Et n'oubliez pas ce que je vous disais hier. Pour la première fois, la question est entrée très avant dans la pensée publique. Elle y restera. Elle s’y enfoncera. A mesure que les événements se développeront. S’ils se développent, le Gouvernement peut venir demander aux Chambres ce qu’il voudra, elles le lui donneront. Et si les événements se développent sans lui, il aura grand peine à rester en arrière. Du reste, je crois au bon sens de tout le monde, en ceci. Je ne vous dis rien des nouvelles. Les dépêches télégraphiques sont publiées textuellement. M. Urquart, sur qui je vous avais demandé si vous pouviez me donner quelques renseignements est à Paris, et m’a fait demander à me voir ce matin. Tout brouillé qu’il est avec Lord Palmerston, il me paraît un des hommes les plus curieux à entendre sur l'Orient. Si je vous répétais ce que tout le monde dit, je vous dirais que la session est finie, que ceci est le dernier débat que la Chambre est extenuée et n'écoutera plus rien. J’en doute. La Chambre écoute quand on parle. Ce sont des esprits très médiocres, très ignorants, très subalternes, mais au fond plus embarrassés que fatigués, et qui n'hésiteraient pas tant s’ils y voyaient un peu plus clair.
10 heures
J’ai été interrompu par des visites. Elles prennent beaucoup de place dans ma journée. Je ne me lève guère avant 8 heures et depuis que je suis levé jusqu'au moment où je pars pour la Chambre, j'ai du monde. Je ne ferme point ma porte. Je suis seul ici ; je n’y suis pas venu pour travailler. Je travaillerai au Val-Richer. Ici j'écoute et je cause. Bien dans une vue d’utilité car pour du plaisir je n’y prétends pas. Je suis très difficile, en fait de plaisir. J'en puis supporter l'absence, mais non la médiocrité. Je déjeune à 1 heures. Je vais à la Chambre à l'heure. Quelques fois, je sors une demi-heure plutôt pour passer au ministère de l’Intérieur. Je passe à la Chambre toute, ma matinée. Je lis les journaux. Je cause encore. J’écoute un peu. Je rentre au sortir de la séance. Je m'habille. Je vais dîner bien rarement au café de Paris, trois fois seulement depuis que je suis ici ; hier chez Mad. de Gasparin, aujourd’hui chez Mad. Eymard avec le Duc de Broglie. Jeudi chez M. le Ministre de l’instruction publique, Vendredi, chez M. Devaines etc. Je rentre de très bonne heure. Je lis. Je me couche et je dors ou je rêve, quelquefois bien mal, comme vous savez, souvent mieux. Quand je dis que je dors, je me vante un peu. Depuis quelque temps je dors moins bien. Je rallume mes bougies. Je lis ou je pense. Je n’ai pas deux pensées.
11 heures
Voilà votre Numéro 205. Je viens de faire ce que vous me demandez. Je vous ai raconté mes journées. Elles se ressemblent beaucoup. Les vôtres me chagrinent. Vous savez que je déteste les sentiments combattus. Vous m’y condamnez. J’aime le vide que je fais dans votre vie, et celui que vous souffrez ne désole. Je vous pardonne tous vos reproches. Adieu. J’ai ma toilette à faire, et à déjeuner. Je veux être à la Chambre de bonne heure, M. Douffroy résumera la discussion. Ce ne sera pas brillant, mais sensé et bien dit. Adieu. Adieu. Tout est insuffisant, tout ; et c’est le mal de notre relation qu'elle est vouée à l’insuffisance. Je supporte ce mal avec une peine extrême, et je le retrouve à chaque instant pourtant. Adieu
207. Baden, Mercredi 3 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
207 Baden le 3 juillet. 2 heures 1839
Je n’ai rien à vous dire que mon impatience de vos lettres, ma mauvaise humeur du mauvais temps.
J’ai écrit aujourd’hui à Matonchewitz et à Frédéric Pahlen, je les presse tous les deux de me dire quelque chose, et je les avertis assez clairement que mes fils pourraient vouloir traîner ; que ce qui n'a aucun inconvénient pour eux, parce que leur fortune est assurée, en a de très grands pour moi qui ne sais pas le premier mot de ce que sera ma fortune, & qui suis obligé de vivre en attendant dans un provisoire très pénible. Je crois avoir fort bien expliqué tout cela. Mais il me semble que je fais toujours des merveilles, et je ne vois rien avancer ; c’est plus qu’ennuyeux.
Jeudi 4 à 8 heures
Votre n°204 m’a donné de la joie personne n’a jamais su comme vous redire toujours la même chose sous une forme toujours nouvelle. Et il y a des lignes charmantes dans votre lettre, des paroles si pénétrantes, si douces. Je vous remercie de toute la lettre, et je vous remercie de toutes les lettres que vous me promettez et que je mérite pas le plaisir qu’elles me font, et par ma reconnaissance qui sait être si vive ! Il fait toujours froid, toujours laid. J'en marche davantage, mais je n’engraisse pas. Je me baigne. J’ai quelque idée que les bains ne me conviennent pas. Mais on n'ose pas avoir d'avis avec les médecins aussi absolus que le mien. Cependant si d'ici à huit jours je ne vais pas mieux. Je crois que je romprai avec le Médecin. Qu’est-ce que veut dire un mois de régime qui n’aboutit à rien ? Je me couche à 9 heures, je me lève à 6. Je dors mieux que je ne dormais à Paris dans les dernier temps, voilà ce que j'ai gagné, mais de l’embonpoint non. Et le médecin qui ne saura pas me procurer cela sera un sot.
Le journal de Francfort renferme des commentaires sur le rapport de M. Jouffroy qui sont très bien et très vrais. Lisez cela parce que cela vient de source. Je suis même un peu surprise que nous ayons là quelqu'un d’aussi bien renseigné. Il faut qu’on ait muni à tout événement notre ministre de documents étrangers aux affaires qu'il a à traiter à la Diète. Le grand duc doit être arrivé hier à Petersbourg. Cela pourrait faire époque pour moi si je n’étais payée pour ne plus croire à rien. Ce pauvre grand Duc a éprouvé bien des pertes à Rome. Son chirurgien y est mort très peu de temps avant mon mari. Plus tard son valet de Chambre de confiance qui ne l'avait jamais quitté depuis son enfance. Et tout à l’heure son jeune camarade le comte Wulhomsky élevé avec lui et avec lequel il était entièrement lié. Tout cela mort à Rome. Ce jeune homme était tombé malade pendant que le grand Duc y était encore et n’avait plus été en état de le suivre.
5 heures.
Voici votre petit mot 205. Je ne savais pas que vous attendrez mes lettres comme moi j'attends les vôtres. Puisque vous le voulez vous les aurez tous les jours, mais quelles tristes lettres que les miennes ! Si j’allais vous ennuyer ! Car enfin je ne vous parle que de moi, Et si c'était moi florissante avec des bras, à la bonne heure. Mais moi comme vous m'avez vue ! Ah mon Dieu ! Vous me rendrez bien curieuse de la discussion sur l'Orient. Adieu. Adieu mille fois adieu, From the bottom of my heart.
Je n’ai rien à vous dire que mon impatience de vos lettres, ma mauvaise humeur du mauvais temps.
J’ai écrit aujourd’hui à Matonchewitz et à Frédéric Pahlen, je les presse tous les deux de me dire quelque chose, et je les avertis assez clairement que mes fils pourraient vouloir traîner ; que ce qui n'a aucun inconvénient pour eux, parce que leur fortune est assurée, en a de très grands pour moi qui ne sais pas le premier mot de ce que sera ma fortune, & qui suis obligé de vivre en attendant dans un provisoire très pénible. Je crois avoir fort bien expliqué tout cela. Mais il me semble que je fais toujours des merveilles, et je ne vois rien avancer ; c’est plus qu’ennuyeux.
Jeudi 4 à 8 heures
Votre n°204 m’a donné de la joie personne n’a jamais su comme vous redire toujours la même chose sous une forme toujours nouvelle. Et il y a des lignes charmantes dans votre lettre, des paroles si pénétrantes, si douces. Je vous remercie de toute la lettre, et je vous remercie de toutes les lettres que vous me promettez et que je mérite pas le plaisir qu’elles me font, et par ma reconnaissance qui sait être si vive ! Il fait toujours froid, toujours laid. J'en marche davantage, mais je n’engraisse pas. Je me baigne. J’ai quelque idée que les bains ne me conviennent pas. Mais on n'ose pas avoir d'avis avec les médecins aussi absolus que le mien. Cependant si d'ici à huit jours je ne vais pas mieux. Je crois que je romprai avec le Médecin. Qu’est-ce que veut dire un mois de régime qui n’aboutit à rien ? Je me couche à 9 heures, je me lève à 6. Je dors mieux que je ne dormais à Paris dans les dernier temps, voilà ce que j'ai gagné, mais de l’embonpoint non. Et le médecin qui ne saura pas me procurer cela sera un sot.
Le journal de Francfort renferme des commentaires sur le rapport de M. Jouffroy qui sont très bien et très vrais. Lisez cela parce que cela vient de source. Je suis même un peu surprise que nous ayons là quelqu'un d’aussi bien renseigné. Il faut qu’on ait muni à tout événement notre ministre de documents étrangers aux affaires qu'il a à traiter à la Diète. Le grand duc doit être arrivé hier à Petersbourg. Cela pourrait faire époque pour moi si je n’étais payée pour ne plus croire à rien. Ce pauvre grand Duc a éprouvé bien des pertes à Rome. Son chirurgien y est mort très peu de temps avant mon mari. Plus tard son valet de Chambre de confiance qui ne l'avait jamais quitté depuis son enfance. Et tout à l’heure son jeune camarade le comte Wulhomsky élevé avec lui et avec lequel il était entièrement lié. Tout cela mort à Rome. Ce jeune homme était tombé malade pendant que le grand Duc y était encore et n’avait plus été en état de le suivre.
5 heures.
Voici votre petit mot 205. Je ne savais pas que vous attendrez mes lettres comme moi j'attends les vôtres. Puisque vous le voulez vous les aurez tous les jours, mais quelles tristes lettres que les miennes ! Si j’allais vous ennuyer ! Car enfin je ne vous parle que de moi, Et si c'était moi florissante avec des bras, à la bonne heure. Mais moi comme vous m'avez vue ! Ah mon Dieu ! Vous me rendrez bien curieuse de la discussion sur l'Orient. Adieu. Adieu mille fois adieu, From the bottom of my heart.
207. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
207 Paris, mercredi 3 Juillet 1839, 5 heures 1/2
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
J'ai vu ce matin, M. Urquhart. Il m'est resté deux heures. C’est un homme d’esprit et un fou, possédé contre vous d'une vrai monomanie. Pendant son dernier séjour en Orient, il ne mangeait rien qu'assaisonné d’une main Turque, bien Turque, Il vous craint pour lui-même autant que pour l'Empire Ottoman et votre Empereur le déteste encore plus que M. Marc Girardin. Il m'a accablé de compliments et d'injures. Nous venons de voter nos dix millions. 313 votants et seulement 21 boules noires. Il n’y en aurait pas eu d'avantage pour 10 millions. N'en croyez pas les journaux. Le marquis de Dalmatie ne va point à Constantinople. Sur mon refus, on y laisse l’amiral Roussin. On l’engagera seulement à ne pas écrire tant de lettres particulières. L’Amiral Lalande, qui commandait notre station, restera aussi à la tête des forces nouvelles. C’est un homme d’esprit, outre le bon marin. Il est vrai.
Après mon rêve éveillé et priant, je vous laissais seule. Je ne m'en excuse pas, mais vous me comprenez. Gardez pourtant toutes vos exigences, et repoussez toutes vos défiances. Celles ci n'auront jamais raison et les autres jamais tort. Un moment j’ai espéré suffire à votre âme à votre vie. Je n'y compte guère plus. Mais vous ne désirerez jamais rien de moi que je ne sois prêt à vous donner, et au delà. Adieu jusqu'à demain. Je vais dîner chez Madame Eynard.
Onze heures
Je rentre. Adieu encore avant de me coucher. La Grèce était là, bien contente de moi. Pauvre Grèce ! J’ai soutenu votre ouvrage. Vous auriez souri d'entendre ce matin, M. Urquhart me raconter toutes vos perfidies, quel immense et imperceptible filet vous aviez jeté sur M. Canning pour l'amener à vous, et comment il était déplorable qu’il fût mort, car il commençait à se reconnaître et à se débattre; il vous aurait échappé ; il se serait vengé ; il aurait vengé et sauvé l'Empire Ottoman. Heureusement pour vous, il est mort. Et pour la Grèce aussi, car, selon, M. Urquhart, il l’aurait défaite. Un jour aussi, vous voudrez la défaire, et c’est encore une des terreurs de M. Urquhart. Je l'ai rassuré. Je ne sais ce qui arrivera en Orient. Mais à coup sûr bien des prévisions y seront déjouées, et beaucoup de choses que nous y aurons faites, vous ou nous, pour notre compte et en passant, subsisteront et prendront une place et joueront un rôle que nous ne leur destinions pas.
Jeudi, 8 heures et demie Les amis de Thiers se désespèrent qu’il n'ait pas été ici pour cette discussion. Si vous lisez ses journaux, vous y verrez qu’'ils ont grand peur que l'envie ne me prenne d'être ministre des Affaires Etrangères. Ils m'attaquent à ce titre comme si je l'étais. A propos de Thiers, un homme de ma connaissance qui arrive de Lombardie me contait l'autre jour qu’en se promenant sur le lac de Côme le batelier qui le conduisait lui avait dit en lui montrant une villa : " C’est là que demeurait ce fameux ministre de France, avec Sa femme et sa fille. "
9 h 3/4
Je suis sans cesse interrompu. Je voudrais vous renvoyer tous les doutes, toutes les inquiétudes que suscite mon discours. Suis- je Anglais ? Suis-je Russe ? Pourquoi ai-je dit que l'Angleterre se trompait quelquefois ? Pourquoi ai-je fait tant de compliments à l'Empereur ? J'admire les badauds et les malices qu’ils voient partout.
Vous avez bien raison sur Lady Jersey. Mais ce n’est pas la persévérance de sa volonté qui fait faire ici attention à elle. Elle a été à la mode à Londres, et la mode de Londres se prolonge à Paris. Elle est partie contente de son petit séjour et un peu malade ; chargée d’emplettes. Je ne sais combien de caisses elle a emportées. Soyez tranquille sur Paris. Je n'aurai pas à faire le curieux. Le procès devient tous les jours plus petit et les précautions plus grandes. Je ne cours pas le moindre risque et la terrasse encore un peu moins que moi. Adieu. Adieu.
Nous avons froid comme, vous ; mais je fais du feu. Adieu. Pas froid. G. Ce pauvre Montrond m'écrit qu'il est malade retenu dans son lit à Versailles, par un érésipèle à la tête et des remèdes assez violents. Il me dit qu’il en a encore pour quelques jours. Si ça va bien.
208. Bade, Vendredi 5 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
208 Bade le 5 juillet vendredi 1839, 8 heures
Je cherche ce que j’ai à vous conter. Il a gelé cette nuit positivement gelé. Ce matin il y a un beau magnifique soleil du mois de janvier voilà le beau pays que je suis venu chercher ! Personne ne se baigne, personne ne boit, tout est suspendu. J’ai mal dormi, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Cela fait une intéressante 2 lettre n'est-ce pas ? Que je voudrais voir ces deux mois écoulés, car enfin je me crois obligée de rester puisque j’ai dit que je resterai, et je suis cependant que ceci ne convient pas à ma santé. Les bains de mer me feraient du bien, ils m’en ont toujours fait, mais où les chercher ? Ah s je n’étais pas seule, tout serait facile. Mais seule, seule, voilà ma vraie maladie. J’attends avec impatience votre discours. Je n’ai pas lu encore la séance de lundi.
1 heures
Je viens de lire. M. de la Lamartine a dû être très brillant. M. Villemain a eu un grand mérite à savoir si bien lui répondra. Je suis curieuse de la suite du Débat. Il n’en ressortira cependant rien de pratique. Cela est évident. C'est une question sur laquelle on peut parler, mais on ne peut pas faire. Personne ne veut faire. le médecin n’est pas content de moi, et je le suis très peu de lui. Il va changer les bains. Demain on y mettra du houblon au lieu d’aromates et toujours du sel. Tout cela sont des bêtises, rien ne me fera du bien. Dites-moi si je dois continuer à faire la volonté du médecin. J'ai bien envie de ne plus rien faire. Mon pouls est fort affaibli. Vous voulez la vérité et je vous la dis. Mad. de Talleyrand me conseille de partir. Elle a bien raison. Ma vue seule est de l'ennui pour tout le monde.
5 heures
Voici le N°206. C'est le premier c’est le seul bon moment de ma triste journée. Je vous remercie de me le donner. Je serai bien avide de lire votre discours demain matin ; ce n’est que le matin qu'on me l'apporte. Adieu. Adieu mille tendres adieux.
Je cherche ce que j’ai à vous conter. Il a gelé cette nuit positivement gelé. Ce matin il y a un beau magnifique soleil du mois de janvier voilà le beau pays que je suis venu chercher ! Personne ne se baigne, personne ne boit, tout est suspendu. J’ai mal dormi, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Cela fait une intéressante 2 lettre n'est-ce pas ? Que je voudrais voir ces deux mois écoulés, car enfin je me crois obligée de rester puisque j’ai dit que je resterai, et je suis cependant que ceci ne convient pas à ma santé. Les bains de mer me feraient du bien, ils m’en ont toujours fait, mais où les chercher ? Ah s je n’étais pas seule, tout serait facile. Mais seule, seule, voilà ma vraie maladie. J’attends avec impatience votre discours. Je n’ai pas lu encore la séance de lundi.
1 heures
Je viens de lire. M. de la Lamartine a dû être très brillant. M. Villemain a eu un grand mérite à savoir si bien lui répondra. Je suis curieuse de la suite du Débat. Il n’en ressortira cependant rien de pratique. Cela est évident. C'est une question sur laquelle on peut parler, mais on ne peut pas faire. Personne ne veut faire. le médecin n’est pas content de moi, et je le suis très peu de lui. Il va changer les bains. Demain on y mettra du houblon au lieu d’aromates et toujours du sel. Tout cela sont des bêtises, rien ne me fera du bien. Dites-moi si je dois continuer à faire la volonté du médecin. J'ai bien envie de ne plus rien faire. Mon pouls est fort affaibli. Vous voulez la vérité et je vous la dis. Mad. de Talleyrand me conseille de partir. Elle a bien raison. Ma vue seule est de l'ennui pour tout le monde.
5 heures
Voici le N°206. C'est le premier c’est le seul bon moment de ma triste journée. Je vous remercie de me le donner. Je serai bien avide de lire votre discours demain matin ; ce n’est que le matin qu'on me l'apporte. Adieu. Adieu mille tendres adieux.
208. Paris, Vendredi 5 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Guizot, François (1787-1874)
208. Paris, Vendredi 5 Juillet 1839
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
209. Bade, Samedi 6 juillet 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteurs : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
209 Bade Samedi 6 juillet 1839 1 heure
J’ai lu et relu votre discours. Relu surtout le passage sur l’Empereur dans l’intention de bien me rendre compte de l’effet qu'il peut produire chez nous. Le personnage principal ne peut pas en méconnaître la vérité, mais elle ne lui plaira pas. Ceux qui après lui comprennent seront contents. Moi je suis très contente de tout votre discours et soyez sûr que je suis difficile. J’ai voulu commencer ma lettre par vous dire cela.
J'ai mal dormi, mes forces m’ont manqué pour la promenade du matin, j’ai pris mon bain de houblon quelle idée ! J’ai dormi depuis il me semble que je suis un peu mieux que ce matin. Vous voyez que je vous dis minutieusement tout. Le temps redevient beau mais je crains que cela ne dure pas.
5 heures
Votre lettre m’attriste, j'y répondrai demain. Je vaux mieux que je ne parais. Je vous aime plus, mille fois plus que vous le pensez. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon cœur ! Mais on ne voit jamais la dedans. Ah mon Dieu que vous aimeriez y regarder. A présent dans ce moment. Et ce moment, et sera toujours. Adieu. Je ne me sens pas bien, je ne puis pas continuer. Adieu.
J’ai lu et relu votre discours. Relu surtout le passage sur l’Empereur dans l’intention de bien me rendre compte de l’effet qu'il peut produire chez nous. Le personnage principal ne peut pas en méconnaître la vérité, mais elle ne lui plaira pas. Ceux qui après lui comprennent seront contents. Moi je suis très contente de tout votre discours et soyez sûr que je suis difficile. J’ai voulu commencer ma lettre par vous dire cela.
J'ai mal dormi, mes forces m’ont manqué pour la promenade du matin, j’ai pris mon bain de houblon quelle idée ! J’ai dormi depuis il me semble que je suis un peu mieux que ce matin. Vous voyez que je vous dis minutieusement tout. Le temps redevient beau mais je crains que cela ne dure pas.
5 heures
Votre lettre m’attriste, j'y répondrai demain. Je vaux mieux que je ne parais. Je vous aime plus, mille fois plus que vous le pensez. Si vous pouviez voir tout ce qu’il y a dans mon cœur ! Mais on ne voit jamais la dedans. Ah mon Dieu que vous aimeriez y regarder. A présent dans ce moment. Et ce moment, et sera toujours. Adieu. Je ne me sens pas bien, je ne puis pas continuer. Adieu.