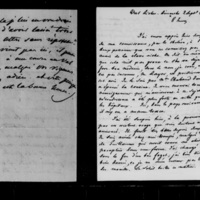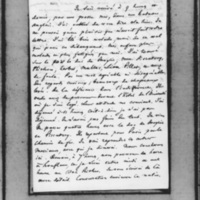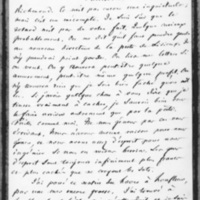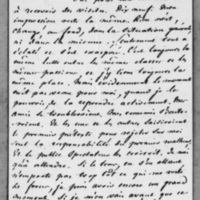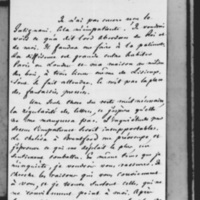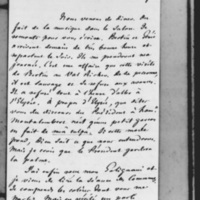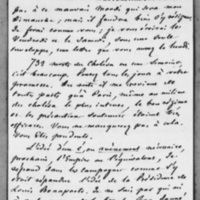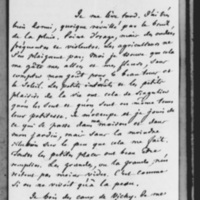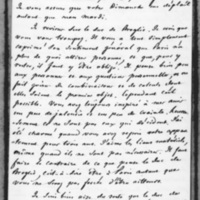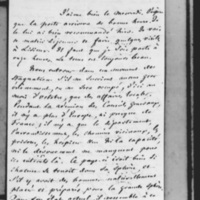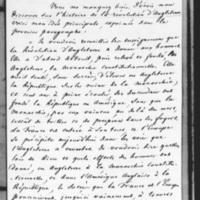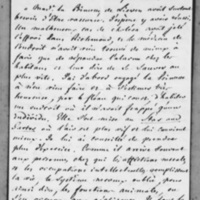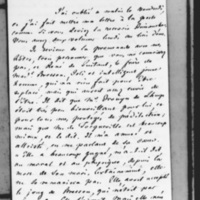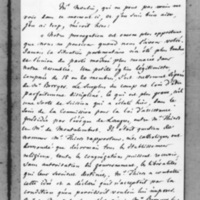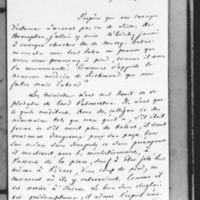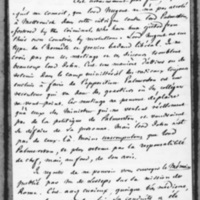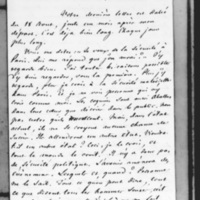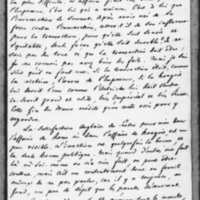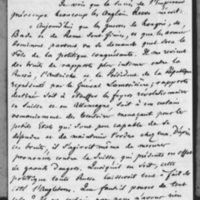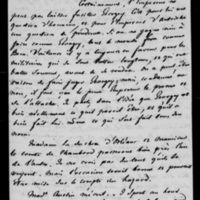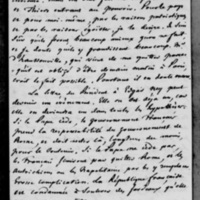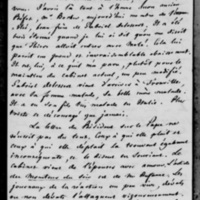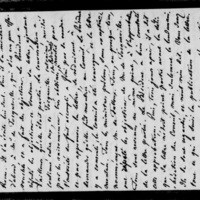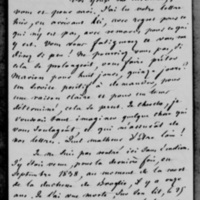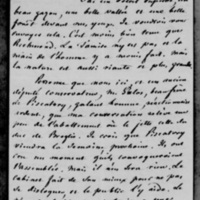Votre recherche dans le corpus : 209 résultats dans 3827 notices du site.Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ? (La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856)
Val Richer, Dimanche 2 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Dimanche 2 sept 1849
8 heures
J'ai encore appris hier deux morts de ma connaissance, par le choléra, à Paris. Deux personnes que vous ne connaissez pas du tout, mais de la classe riche. On dit en même temps que cela n'est pas grave et s'en va déjà. Un fort bon médecin, dont le nom, je crois, ne vous est pas inconnu, M. Rayer, est positivement de cet avis. Je le vois pour Mlle Chabaud, dont il a épousé la cousine. Je vous enverrai tous les renseignements qui m'arriveront à ce sujet. La recrudescence a été plus forte en ville que dans les hôpitaux. Ici, dans le pays environnant, il n'y en a aucune trace.
J'ai été surpris hier, à la promenade, par un violent orage que rien du tout n'avait annoncé. Il faisait très beau depuis deux jours. Je suis arrivé chez moi trempé, malgré les soins de Guillaume qui avait couru me chercher un parapluie dans une ferme. J'ai changé de tout, sous le feu d'un bon fagot ; j'ai bien dîné, très bien dormi, et je ne m'en ressens pas le moins du monde. Le soleil brille ce matin.
Palmerston ruiné m'étonne. Je lui croyais une conduite plus prévoyante et plus réglée. Quoiqu'il reçoive du monde, je ne lui vois pas un établissement ruineux. J'ai entendu dire, il est vrai, que les terres d'Irlande ne lui rapportent plus rien depuis longtemps, car il en employait tout le revenu en secours et en améliorations pour la population.
Je reviens sur une chose que m'a dite Dalmatie, et que je crois vraie. Indépendamment de la question ministérielle, il y aura, au retour de l'Assemblée et pendant sa session d'hiver, deux grosses questions, les deux seules, les finances et les lois sur l'enseignement. En matière de finances, la nécessité de remettre les impôts au niveau des dépenses est l'idée dominante dans le parti modéré ; idée très sensée et très honnête, mais de très difficile et très douloureuse exécution, car le suffrage universel ne permet rien en fait d'impôts, sinon de les réduire. Il y aura là un grand combat entre l'intérêt public et les intérêts privés, entre la nécessité et la timidité devant les électeurs. Les lois sur l'enseignement seront la pierre d'achoppement entre les deux fractions du parti modéré. Les légitimistes et les catholiques veulent avoir plus que le gros du parti modéré ne veut leur donner. La brouillerie qui a recommencé entre Thiers et Montalembert s'aggravera. Ce dont là les deux sources d'où il peut, dans l'intérieur de l'assemblée, découler des événements graves.
Onze heures
Pas de lettre. C'est bien ennuyeux. Heureusement demain n'est pas mardi. Mais c'est bien ennuyeux.Adieu. Adieu quand même. G.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (France), Vie quotidienne (François)
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer, Lundi 3 septembre 1849
Sept heures.
On dit que Titus disait, quand il n'avait pas fait au moins un heureux, « J'ai perdu ma journée. » Moi, je crois qu'il disait cela quand il n'avait pas vu Bérénice. Quand votre lettre me manque, ma journée est perdue. J'ai beau faire ; je ne parviens pas à la remplir. J'ai beaucoup travaillé hier ; j'ai lu ; j'ai écrit de mon histoire ; j'ai écrit des lettres. Ma journée est restée vide. Peut-être votre lettre, que j'aurais dû avoir hier, contenait la feuille volante de Metternich, et les curieux auront eu envie de la lire. Je saurai cela ce matin. Ils auraient dû être un peu plus prompts à la lire que lui à l'écrire.
Je pense beaucoup à l'Allemagne, et soit que je veuille arranger l'avenir, ou seulement le prévoir, je ne me satisfais pas. Il y a là des éléments inconciliables entre eux et indestructibles les uns pour les autres, à moins d'un bouleversement général. Des petits États évidemment incapables, soit de contenter, soit de contenir leurs peuples, un grand État qui voudrait dompter les révolutionnaires chez lui, en restant populaire parmi les révolutionnaires du dehors, dont il a besoin pour absorber les petits États, et au moment même où il envoie des troupes pour empêcher ces révolutionnaires là de triompher chez eux. Des peuples qui, petits ou grands, révolutionnaires ou non, veulent jouir de la vie politique dont ils ont commencé à goûter, et se croient humiliés s'ils ne font pas, ou n'entendent pas autant de bruit qu'on en entend et qu'on en fait à Paris et à Londres. Des gouvernements qui ont encore toutes les habitudes du pouvoir absolu, et qui, en quelques mois, ont touché, et vont encore, aux dernières limites du radicalisme, car ils ont accepté le suffrage universel, ou à peu près. Ce sont là des confusions, des ambitions, des contradictions, des nécessités et des impossibilités dont je ne me tire pas. Certainement on ne sortira pas comme on est ; mais je ne crois pas qu'on redevienne purement et simplement comme on était, et je ne vois pas ce qu'on pourra être, ni même ce qu'on voudra essayer d'être.
Attendons. J'attends l'Allemagne et votre lettre. Si j'avais la lettre, je crois que j'arrangerais mieux l'Allemagne.
Onze heures
Voilà mes deux lettres. Et moi bien content. Vous recevrez aujourd'hui celle où je vous parle du choléra. C'est ma préoccupation habituelle pour vous à Paris. On me parle aujourd'hui de nouveaux cas. Je crois décidément qu'il faut attendre un peu.
Je ne comprends rien à ce que vous dit Montebello. Je n'ai pas reçu un mot, un seul mot de lui depuis que je suis ici. Je m'en suis étonné, et je crois vous l'avoir dit. Je vais lui écrire ce matin même.
Adieu, adieu, my dearest. Soignez-vous bien. L'orage ne m'a fait aucun mal. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Politique, Politique (Allemagne), Révolution
[Le Havre], Jeudi 19 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Je suis arrivé à 9 heures et demie, par une grosse mer, dans un bateau anglais. J’ai oublié de vous dire cela hier. Je ne pensais qu’au plaisir que m’avait fait votre lettre. J’ai été bien malade, mais de ce mal qui passe en débarquant. Mes enfants plus malades et plus fatigués que moi. J’ai trouvé sur le port le duc de Broglie, MM. Piscatory, Plichon, Herbet, Mallac, Léon Pillet, et assez de foule. Pas un mot agréable, ni désagréable. Des regards curieux ; beaucoup de chapeaux levés. De la déférence dans l’indifférence. Il reste assez de personnes devant l'hôtel de l’Amirauté où je suis logé. Leur attitude me convient. J’ai déjeuné à 11 heures, c’est-à-dire, je n’ai pas déjeuné. Je n'avais pas faim du tout. Je viens de passer quatre heures avec le duc de Broglie et Piscatory. Ils repartent pour Paris par le chemin de fer. Je vais reprendre ces autres messieurs avec qui je dinerai. Nous coucherons ici. Demain à 7 heures, nous passerons du Havre à Honfleur, et je serai entre midi et une heure au Val Richer. Je vous écrirai de là avec détail.
Conversation curieuse le matin. Au fond très rassurante pour l’ordre matériel. La prorogation de l’Assemblée, du 17 août à je ne sais quel jour d'octobre, sera votée, plutôt parce que les Montagnards n'en veulent pas que parce que tous les modérés en sont d'accord. Le Ministère ne sera certainement pas renversé avant la prorogation. Peut-être après. J’ai relu bien des fois votre lettre d’hier. Même malade. Grande preuve du plaisir qu’elle m’a fait car c'est un mal bien déplaisant. Adieu. Adieu. Ces messieurs sont là, qui m’attendent. Je leur dois d'être poli pour eux. Adieu. Adieu, mauvais jour aujourd’hui. Je compte trouve une lettre demain en arrivant. Adieu encore. Adieu toujours. G.
Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 23 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai passé ma matinée hier à recevoir des visites. Dix-neuf. Mon impression reste la même. Rien n’est changé au fond, dans la situation générale, ni dans la mienne. Seulement tout a éclaté et s'est exaspéré. C’est toujours la même lutte entre les mêmes classes et les mêmes passions, et j'y tiens toujours la même place. Mais évidemment le moment n'est pas venu pour moi, quand je le pourrais de la reprendre activement. Mes amis se troubleraient. Mes ennemis s’irriteraient. Et les uns et les autres saisiraient le premier prétexte pour rejeter sur moi seul la responsabilité du premier malheur. Et le public spectateur les croirait. Je n’ai qu'à attendre, si le temps, en s'en allant, n'emporte pas trop tôt ce qui me reste de forces, je puis avoir encore un grand moment. Si je m'en vais avant que ce moment n’arrive, j'ai lieu d'espérer aujourd’hui que justice sera faite à mon nom. Fait général. Les honnêtes gens ont moins peur des coquins que je ne m’y attendais. Ils prévoient de nouvelles luttes, sont très décidés à les soutenir, et comptent sur la victoire. Ceci je le vois. Les coquins que je ne vois pas, sont à ce qu'on me dit, assez découragés et sans confiance dans l'avenir. Ce qui ne les empêchera pas de recommencer. L’esprit manque aux uns et aux autres. Ils sont tous de très petite taille et de vue très courte. C’est une guerre entre des nains aveugles. Il y a dans les deux camps, plus de force et de courage qu’il n'en faut pour se livrer de bien autres combats que ceux qu’ils se livrent des combats au bout desquels viendrait nécessairement la grande défaite ou la grande victoire. Mais ils ont, les uns et les autres, si peu d'intelligence et de portée d'esprit, ils sont tellement au-dessous des questions et des événements qu’ils remuent, qu’il pourra fort bien leur arriver de s’agiter longtemps et misérablement sans rien finir. Il ne serait pas, je crois, bien difficile de faire agir efficacement les honnêtes gens si on pouvait leur faire réellement voir ce dont il s’agit. Ils ne voient pas. Je vous envoie mes réflexions, n'ayant point de faits. La prorogation de l'assemblée sera probablement plus courte qu’on ne l’avait dit. Le sentiment général, dans le parti de l'ordre, est contre. On craint de laisser tout seul un pouvoir si faible et un cabinet si douteux. Ce n'est plus la république seule, c’est la Montagne elle-même qui est l’objet des moqueries populaires. Autrefois, dit-on, la montagne accouchait ; aujourd’hui elle découche.
Onze heures et demie
Je regrette que Brougham et Aberdeen aient perdu leur bataille à 12 voix. Je vais les lire. Je me suis abonné, au Galignani pour rester au courant de l’Angleterre. C'est pourtant le lieu où vous êtes ! Vous ne me dites rien de votre santé. J’en conclus que ce n'est pas mal. Je vous le redemande en grâce ; n'oubliez pas ce que vous m'aurez promis. Adieu, Adieu. Le facteur et le déjeuner m'attendent. G.
Val-Richer, Mardi 24 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai pas encore reçu le Galignani. Cela m'impatiente. Je voudrais voir ce qu'a dit Lord Aberdeen du Roi, et de moi. Il faudra me faire à la patience. La différence est grande entre habiter Paris ou Londres et ma maison au milieu des bois, à trois lieues même de Lisieux. Tout se fait attendre. Ce n’est pas la place des fantaisies pressées. Une seule chose du reste m'est nécessaire, la régularité des lettres, et j'espère qu’elle ne me manquera pas. L'inquiétude par dessus l’impatience serait insupportable. Le choléra à Brentford me préoccupe et j’éprouve ce qui me déplait le plus, un sentiment combattu. En même temps que je m'inquiète, je voudrais vous rassurer. Je cherche les raisons qui vous conviennent à vous, et je trouve surtout celles qui ne me conviennent point à moi. Après tout voici ce qui me rassure le plus. Ne vous en inquiétez pas. Il y a eu et il y a encore dans ce pays-ci quelques cas de choléra, épars et rares. Quand l'épidémie n’est pas plus intense, elle n'attaque presque jamais que ceux qui commettent vraiment des excès ou des imprudences. J'ai vu depuis trois jours trois médecins, un de Paris, et deux d'ici, qui me l'ont tous affirmé et prouvé par les exemples. Il en est très probablement de même en Angleterre, et à Richmond comme à Lisieux. Je vous répèterai sans cesse ; point d'imprudence et votre promesse.
Le discours de M. de Montalembert vous aura plu, beaucoup d'esprit, de l’esprit de bonne compagnie, et un cœur chaud et sincère. Jules Favre, un sophiste habile, qui excelle à dire des généralités à peu près vraies et à en faire des applications parfaitement fausses. C'est le grand art des révolutionnaires ; moralistes sur la scène coquins dans la coulisse et glissant très adroitement de l’une dans l'autre. Odilon Barrot a été bien ridicule avec ses prétentions, à la fois pompeuses et embarrassées, à la consistance et à la libéralité imperturbable. C’est toujours le même homme. Le repentir même ne le change pas.
Onze heures
Point de lettre. J’ai envie de dire comme vous ; c’est parce que j'ai parlé de la régularité de notre correspondance ! Toute vanterie porte malheur. J'espère que le dimanche est pour quelque chose dans ce retard. J'attendrai demain avec une double, triple impatience. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 25 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie du soir.
Nous venons de dîner. On fait de la musique dans le salon. Je remonte pour vous écrire. Bertin et Génie arrivent demain de très bonne heure et repartent le soir. Ils me prendront ma journée. C’est une affaire que cette visite de Bertin au Val Richer.
De sa personne, il est sauvage et se refuse aux avances. Il a refusé tout à l'heure d'aller à l’Elysée. A propos d'’Elysée, que dîtes-vous du discours du Président à Ham ? Montalembert n’est qu'un petit garçon en fait de mea culpa. Si cette mode prend. Dieu sait ce que nous entendrons. Mais je crois que le Président gardera la palme. J'ai enfin reçu mon Galignani et je viens de lire la séance des Communes. Je comprends les colères dont vous me parlez. Mais en vérité un parti conservateur, qui se laisse dire tout cela sans ouvrir la bouche, mérite bien qu’on le lui dise. Il était si aisé de concéder ce que la cause des Hongrois à de juste, et de frapper ensuite d’autant plus fort sur ce qu'elle a de révolutionnaire. L’esprit révolutionnaire est un poison qui infecte et déshonore, et perd de nos jours toutes les bonnes causes. Un rebelle (gardez m'en le secret) ; peut quelques fois avoir raison, un Jacobin jamais Tous les rebelles de notre temps deviennent en huit jours des Jacobins, s'ils ne l’étaient pas le premier jour.
Jeudi matin. 7 heures
Mad de Metternich et Madame de Flahaut m'amusent. Faites exprès pour se quereller. Mad de Mett serait battue. Il y a encore de la femme en elle et beaucoup d'enfant gâté. Ni de l'un ni de l'autre dans Mad. de Flah. Un vieux sergent de mauvais caractère, et toujours de mauvaise humeur. Je sais gré à Mad. Delmas de ses soins. Trouvez, je vous prie l'occasion de leur dire un mot de politesse de ma part. Malgré l'horreur de l'aveugle pour les constitutions.
Je ne me promène seul que dans mon jardin. Soyez tranquille ; je serai attentif. Je suis sûr, et tout me le prouve que la disposition générale du pays est bonne pour moi. Mais, dans la meilleure disposition générale, il y a toujours autant de coquins, et de fous qu’il en faut. Je suis décidé à me préserver pour vous et à me réserver pour je ne sais quoi. Mad. Lenormant m'écrit : " Au nom du ciel et au nom de la France, gardez votre situation hors de tout. Réservez-vous. Le duc de Noailles me charge expressément de vous le dire. " Et elle ajoute : " Je ne puis vous dire assez quel ami admirable, dévoué, courageux, s'est montré, pour la mémoire de ma pauvre tante et pour moi, cet excellent duc de Noailles dans la circonstance de mon triste procès. Il vient de nous quitter, et il était hier à Paris faisant son troisième voyage pour m'aider de ses conseils, de ses démarches et de son affection. Il a fait avec moi les visites aux magistrats. Il a voulu que se femme aussi témoignât dans l'affaire, et il y a une lettre d’elle dans le dossier de Chaix d'Estange. Dans ce temps de mollesse et d’indifférence de semblables témoignages de respects, de souvenir, et d’amitié sont bien rares. Il a bien envie de causer avec vous. Ce serait désirable et nécessaire. Comment cela se pourrait-il ? C’est ce que je ne sais guères, ni l’un ni l'autre de vous ne pouvant en ce moment aller l’un chez l'autre. »
Je suis bien décidé, quant à présent. à ne point sortir de chez moi. Onze heures Bertin est arrivé. Puis Salvandy. Voilà la poste. Je n’ai que le temps de fermer ma lettre. Mes hôtes repartent ce soir. Adieu. Adieu. Que j’aime votre lettre ! Bien moins que vous pourtant. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 27 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma journée d'hier a été une conversation continue. D’abord avec Salvandy, arrivé à 9 heures et demie, parti à une heure. Puis, avec Bertin et Génie, partis après dîner à 8 heures et demie. Presque toujours dans la maison, à cause de la pluie, vent, orage, grêle. Pourtant quelques intervalles lucides pour se promener en causant. Mon sol est promptement sec.
Salvandy très vieilli. Sa loupe presque doublée. Ses cheveux très longs, pour la couvrir, et très éclaircis, ce qui fait qu’ils la couvrent mal. Toujours en train, mais d’un entrain aussi un peu vieux. Il m'a dit qu’il réimprimait une ancienne brochure de lui, de 1831. Il fait de ses conversations comme de ses brochures. Il est à Paris depuis trois semaines, et y retourne aujourd’hui pour y rester jusqu'aux premiers jours d’août. Après quoi, il revient dans sa terre, à Graveron à 18 lieues de chez moi. Il viendra me voir souvent. A Paris il a vu et il voit tout le monde, excepté Thiers qui ne l'a pas cherché et qu’il n'a pas rencontré. Il raconte Molé, Berryer, Changarnier, le pauvre Bugeaud.
Molé plus animé, plus actif, écrivant plus de billets, faisant plus de visites donnant plus d’aparté que jamais. Président universel et perpétuel, de la réunion du Conseil d'état, de la société pour la propagande, anti-socialiste, de son bureau à l'Assemblée de je ne sais combien de commissions, de tout, excepté de la République. On a fait de lui une caricature très ressemblante, mais où on l'a vieilli de dix ans, avec cette devise : Espoir de notre jeune République.
Il était vendredi dernier à un dîner du Président, faisant les honneurs du salon à MM. S Marc Girardin, Véron, Jules Janin, Janvier & & C'est le dîner où Bertin a refusé d'aller. Le Président, en habit noir cravate blanche, bas de soie, tenue très correcte. M Molé en habit marron, cravate noire, et pantalon gris. Le plus heureux des hommes d’aujourd’hui fort sensé, fort écouté, fort compté, satisfait dans ses prétentions pour lui-même, espérant peu, se contentant de peu, et peu puissant pour le fond des choses. Laissant tomber l'idée de la fusion et s’attachant de plus en plus à la combinaison actuelle n'importe quelle forme nouvelle elle prenne tôt ou tard, car tout le monde croit à une forme nouvelle.
Les voyages du Président préoccupent beaucoup, en espérance ou en crainte. Il est très bien reçu. Il est très vrai qu'on lui crie : Vive l'Empereur et pas de bêtises ! M. Dufaure était un peu troublé à Amiens, et disait : "Je ne croyais pas ce pays-ci tant de goût pour l'autorité. " On se demande ce qui arrivera à Tours, à Angers, à Saumur, à Nantes, surtout à Strasbourg, où il ira ensuite, et qui paraît le principal foyer des espérances impériales. Je suis porté à croire qu’il n’arrivera rien. Tout le monde me paraît s'attendre à un changement et attendre que le voisin prenne l'initiative du mouvement. Point de désir vif, grande défiance du résultat, grande crainte de la responsabilité. Ni fois, ni ambition, ni amour, ni haine. On se trouve mal ; mais on pourrait être plus mal et il faudrait un effort pour être mieux. Et quel mieux ? Un mieux obscur, peut-être pas sûr, qui durerait combien ? Voilà le vrai état des esprits. Le Président ne pousse lui-même à rien. Ceux qui le connaissent le plus le croient ambitieux. Mais personne ne le connait. Il n’a un peu d'abandon. que pour faire sa confession de son passé. Le sang hollandais domine en lui. Il fera comme tout le monde ; il attendra. En attendant ses voyages et ses dîners le ruinent. Il ne peut pas aller. On va redemander de l'argent pour lui. Douze cent mille francs de plus. L'assemblée les donnera. Tristement, car l'état des finances est fort triste. M. Passy tarde à présenter son budget parce qu’il se sent forcé d'avouer, pour 1849, un déficit de 250 millions, & d’en prévoir un de 320 millions pour 1850. On espère ressaisir 90 à 100 millions de l'impôt sur les boissons. Mais comment faire un emprunt pour le reste ? Les habiles sont très perplexes.
La Hongrie n'est pas si populaire à Paris qu'à Londres. Toute l’Europe est impopulaire à Paris les révolutions et les gouvernements. On craint Kessuth et votre Empereur. On croit que c’est l’Autriche qui ne veut pas en finir avec le Piémont afin de tenir en occident une question ouverte qui puisse motiver l’intervention en Italie quand on en aura fini avec la Hongrie.
Il y a eu un temps, déjà ancien de 1789 à 1814, qui était le temps des confiances aveugles. C’est aujourd’hui le temps des méfiances aveugles, suite naturelle de tant de déceptions et de revers. Et la suite naturelle de la méfiance, c'est l'inertie. La France ne demande qu’à se tenir tranquille en Europe. Elle ne se mêlera des affaires de l'Europe qu'à la dernière extrémité, par force et toujours plutôt dans le bon sens, à travers toutes les indécisions et toutes les hypocrisies, comme à Rome. Le gouvernement de Juillet, qui n’a pas su se fonder lui-même, a fondé bien des choses, et on commence à s'en apercevoir. Sa politique extérieure surtout est un fait acquis que tout le monde veut maintenir. Et non seulement on la maintient, mais on en convient et bientôt en s'en vanterai. On m'assure, et je vois bien que comme Ministre des Affaires Etrangères, je suis déjà plus que réhabilité, même auprès des sots. Je vous quitte pour répondre autour Préfet du Havre qui m’a écrit la lettre la plus respectueuse et la plus heureuse que j'aie approuvé sa conduite. Il me dit : " En conformité du désir que vous en avez exprimé, j'ai l’honneur de vous apprendre que les individus qui avaient été arrêtés vendredi dernier ont déjà été relâchés à l'exception de deux que la justice revendique comme habitués de la police correctionnelle, et comme étant d'ailleurs coupables d'avoir joint à leurs cris stupides une tentative d’escroquerie chez un boucher de la rue de Paris. Votre approbation m’a été précieuse et m’a prouvé que j’avais eu raison de ne pas donner à cette ridicule gaminerie les proportions d’une émeute en l’honorant de la présence des baïonnettes citoyennes ou militaires. "
Je reçois beaucoup de lettres, des connus et des inconnus, des fidèles, et des revenants Bourqueney, de qui je n’avais pas entendu parler depuis le 21 février m’écrit avec une tendresse de Marivaux embarrassé : « Dites-vous bien, en recevant cette tardive expression de mon dévouement, que les cœurs les moins pleins ne sont pas ceux dont il n’était encore rien sorti. " Il a voulu dire : " que les cœurs dont il n'était encore rien sorti ne sont pas les moins pleins " Mettez cela à côté de ce billet que m’écrit Aberdeen : " It has been a great satisfaction to me, to see the universal respect and esteem with which you have been regarded in this country. At the same time, it has been to me a cause of sincere regret that I have been so little able to afford you any proofs of m’y cordial friendship during your stay among us. " Je ne le reverrais jamais, je l’aimerai toujours de tout mon cœur.
Merci de m'avoir envoyé le Morning Chronicle J’oublie mon sous Préfet du Havre. Je cause comme si j'étais dans mon fauteuil du Royal Hotel. Pauvre illusion ! Adieu. Adieu. Je vous redirai adieu après la poste. Que de choses j’aurais encore à vous dire.
Onze heures
Voilà votre lettre. Mais mon papier et mon temps sont pleins. Adieu, adieu. à demain. Que l’ancien demain était charmant. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 28 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
D’une heure à cinq hier ma maison n'a pas désempli. Orléanistes, quelques légitimistes quelques quasi républicains honteux. Pour moi de la bienveillance, et de la curiosité. En soi, toujours les mêmes dispositions, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Du bon sens, de l’honnêteté, même du courage ; tout cela trop petit et trop court. C'est la taille qui leur manque à tous. Ils ne sont pas au niveau de leurs affaires. Ils n'atteignent pas ou il faudrait atteindre pour faire quelque chose. Grandiront-ils assez et assez vite ? Mes arbres ont très bien poussé. Je ne suis pas aussi sûr des hommes que des arbres. Je suis content de la visite d’Armand Bertin. Le Journal restera dans une bonne ligne ; impartialement en dehors du présent, fidèle avec indépendance au passé. Et fidèle à moi avec amitié si j'étais à Paris pouvant causer deux ou trois fois par semaine, il ne s’y dirait pas un mot qui ne me convint. Spécialement sur les Affaires Etrangères. D’ici, il n’y a pas moyen d'y regarder de si près. Pourtant on marchera toujours du bon côté.
Des lettres de Barante, de Philippe de Ségur, de Glicksbierg. Barrante affectueux et triste, voyant toutes choses avec la sagacité un peu stérile d’un esprit juste et d’un cœur abattu. Un grand pays à moins qu’il ne soit réellement destiné à périr, n'est jamais si dépourvu de forces et de remèdes qu’il en a l’air. Il supporte et attend deux choses qui nous sont bien difficiles à nous passagers éphémères sur la scène, sans en avoir le projet formel, évidemment Barante finira par venir à Paris. " J’ai un bien vif regret, me dit-il, que mon lieu de retraite, soit si loin du vôtre. Sans cela, je serais allé tout de suite vous revoir. Si quelque circonstance de famille ou d'affaire m'appelle à Paris, je serai bientôt après au Val Richer On fait ce qu’on prévoit si clairement. Ségur très amical, croyant que ma maison à Paris n'est plus à ma disposition, et voulant. que, si j’y vais, j'aille occuper la sienne. Il n’y reviendra que tard, en hiver. Glücksbing est toujours à Madrid. Il m’écrit qu’il va publier quelque chose sur la réforme douanière et financière de l'Espagne, et finit par cette phrase : " M. Mon dit qu’il va vous écrire pour vous engager à venir passer quelques mois en Espagne. A part les bouffées de jalousie entre lui et le général Narvaez, dont il adviendra ce que Dieu voudra, tout marche admira blement ici. Les nouvelles d’Andalousie sont excellentes, et vous aurez remarqué l'accueil que le duc et la duchesse de Montpensier ont reçu à Gibraltar. "
En avez-vous vu quelque chose dans les journaux Anglais ? Si nous étions ensemble, je vous lirais les lettres, et elles vous amuseraient. Elles ne méritent pas d'être envoyées si loin. Je vous donne ce qu’il y a de mieux. Voulez-vous, je vous prie, faire mettre à la poste cette lettre pour Lord Aberdeen, en y ajoutant son adresse actuelle ? Je ne sais où le prendre. Onze heures Votre lettre m’arrive. Et Hébert en même temps. Pour la journée seulement. J’aime assez qu'on prenne cette habitude de venir me voir sans s’établir chez moi pour plusieurs jours. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 29 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne m'accoutumerai certainement pas à ce mauvais mardi qui sera mon dimanche ; mais il faudra bien s’y résigner. Je ferai comme vous ; je vous écrirai le vendredi et le samedi, sous une seule enveloppe, une lettre que vous aurez le lundi. 732 morts du Choléra en une semaine, c’est beaucoup. Pensez tous les jours à votre promesse. Du reste il me revient de toutes parts qu’à Paris même au milieu du choléra le plus intense, le bon régime, et les précautions soutenues, étaient très efficaces. Vous ne manquerez pas à cela. vous êtes prudente.
L’idée d'un événement, ou avènement nécessaire, prochain, l’Empire ou l’équivalent se répand dans les campagnes comme s'y était répandue, l'idée de la Présidence de Louis Bonaparte. Je ne sais pas qui, ni à quel moment le branle sera donné, mais il deviendra sur le champ général. On se trouve mal sous ce qui est, et on n’y croit pas. Ni foi, ni santé. On essaiera de tous les remèdes seulement, il y aura, quant au plus prochain remède, sinon lutte au moins dissidence, entre l’Assemblée et la population. Evidemment l’Assemblée ne croit pas à l'empire comme remède, ni à Louis Napoléon connue dynastie. Elle est bien pour lui, et lui donnera volontiers et du pouvoir, et de la durée, mais sans grandes idées ni longues espérances. La population n'en est pas encore là. Et si la population se met en mouvement l'assemblée suivra. J'ai lu le discours de Thiers. Sensé, spirituel et à propos. Petit. Et puis se donnant comme le représentant de tout le Gouvernement passé contre toutes les oppositions. Il a raison, puisque personne ne le contredit et ne lui rappelle ce qu’il a fait. Mais c’est drôle à lire. Toujours grande affluence de visites. Et je n'ai jamais été plus seul. Je ne dis pas deux paroles qui me plaisent à dire. Adieu, adieu jusqu'à la poste.
Onze heures
Voilà votre lettre d'avant hier vendredi. L'affranchissement ne l'a pas retardée. Je voudrais bien que votre grand orage eût tué le choléra à Londres, avez-vous eu peur pendant l'orage ? Que je voudrais avoir été là ! J’espère qu’on a raccommodé le plafond de votre chambre de manière à ce qu’il n’y pleuve plus. Rien d'important de Paris. Un ancien conservateur, membre de l'Assemblée, M. Moulin m'écrit : " Nous allons discuter la prorogation. Je la voterai ; non pour mes affaires et mes plaisirs personnels mais par ce motif, tout puissant à mes yeux qu’au milieu de nos impuissances constitutionnelles et financières, en présence d'un avenir qui n’est plus de trois ans il devient nécessaire que nous puissions porter dans nos départements nos impressions de Paris et rapporter à Paris les impressions des départements. " Adieu. Adieu. La seconde cloche du déjeuner sonne. Adieu, dearest beloved. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 30 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai très bien dormi, quoique réveillé par le bruit de la pluie, point d’orage, mais des ondées fréquentes et violentes. Les agriculteurs ne s'en plaignent pas. Moi je trouve que cela me gâte mes allées et mes fleurs, sans compter mon goût pour le beau temps et le soleil. Les petits intérêts et les petits plaisirs de la vie ont cela de singulier qu'on les sent et qu’on sent en même temps leur petitesse. Je m'occupe et je jouis de ce qui se passe dans ma maison et dans mon jardin, mais sans la moindre illusion sur le peu que cela me fait. Toutes les petites pièces ont beau être remplies. Les grandes, ou la grande, n'en restent pas moins vides. C'est comme si on ne vivait qu'à la peau. Je bois des eaux de Vichy. Je me suis senti quelques velléités de calculs biliaires. Deux verres d’eau de Vichy par jour m’en débarrasseront. C'étaient des velléités lointaines et sourdes. Dans les trois ou quatre premiers jours de mon arrivée, j'ai eu aussi un peu d’émotion dans les entrailles, un certain sentiment d'une influence atmosphérique différente. J'ai été très attentif dans mon régime de nourriture. Il n'en est plus question du tout. Je me porte très bien.
Je suis jour par jour dans le Galignani, la marche du choléra à Londres et en Angleterre. On ne cite jusqu'ici, à peu près point de noms. Je vous demande positivement, instamment en grâce, pour peu que vous vous sentiez indisposée d'envoyer chercher M. Guéneau de Mussy (26 Maddox-Street. Regent street) Vous le croirez ou vous ne le croirez pas vous lui obéirez ou vous ne lui obéirez pas mais voyez-le et entendez le en même temps que vos médecins anglais. Je le crois un excellent médecin, et je suis sûr que l'homme ne vous dégoûtera pas du médecin.
Curieux spectacle que ce mouvement d'opinion en Angleterre, en faveur des Hongrois. Mouvement naturel, car les Anglais, sont toujours portés à prendre intérêt aux causes libérales. Et factice car ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit en Hongrie ni si c’est vraiment une cause libérale ; ils sont remués aveuglément par quelques mots, et par quelques hommes qui n’en savent pas plus qu'eux, ou qui veulent tout autre chose qu'eux. Il y a bien des manières d'être un peuple d’enfant. Et tout cela est l'ouvrage de Lord Palmerston et de la Chambre des communes. Si la politique de Lord Palmerston était bonne ou si la vérité avait été dite dans la Chambre des Communes, la nation anglaise penserait et sentirait autrement. Quand l'Angleterre juge ou agit mal, ce sont toujours les chefs qui sont coupables car elle a assez de bon sens et d’honnêteté pour juger et agir bien si ses chefs lui montraient la voie. Mais elle n’en a pas assez pour trouver à elle seule la vraie voie, et pour y faire marcher ses chefs, surtout en matière d'affaires étrangères, qu’elle voit de si loin et dont au fond, elle se soucie si peu.
Onze heures
Quelle désolation! J'avais le présentiment que la lettre d’aujourd’hui me désolerait. Et je n'en aurais pas demain ! Mais je ne ne pardonne pas de penser à moi. C’est de vous qu’il s’agit, si vous pouviez être un peu moins troublée ! Si je pouvais vous envoyer, vous apporter un peu de calme et de courage ! Je suis disposé à approuver Brighton. Avez-vous quelque nouvelle de ce qui s’y passe en fait de choléra ? Si le mal se répand et augmente, quittez l’Angleterre. Il n’y en a presque plus en France. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il va souvent à St. Léonard, mais il n’y habite point. Il est de bon conseil, et même de ressource au besoin. Que je voudrais être à après-demain. Adieu. Adieu. Dearest, si j'étais là, vous auriez moins peur. G.
Val-Richer, Mardi 31 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu'aurez-vous fait ? Où êtes- vous ? Comment êtes-vous ? Je ne puis pas penser à autre chose. J'espère que vous serez allée à Brighton. J'en ai eu hier des nouvelles. Sir John Boileau y est. Il parle du bon état de l’endroit, de la bonne disposition de ceux qui y sont, sans doute le choléra n’y est pas. Et la peur que vous avez du choléra m'inquiète autant que le choléra même. Quand je l’ai eu en 1832. Mes médecins, Andral et Lerminier, ont dit que, si j'en avais eu peur il aurait été bien plus grave. Je n'en avais point peur. Que je voudrais vous envoyer ma disposition ! Et aujourd’hui mardi, je n'aurai même pas de nouvelles de ces nouvelles déjà vieilles de 48 heures. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il me paraît bon pour donner un bon conseil et de l’appui, aussi bien que des soins. Je serais étonné s’il ne s’était pas mis complètement à votre disposition. Demain, demain enfin, je saurai quelque chose. Quoi ?
Dearest, je veux parler d’autre chose. Voilà l'Assemblée prorogée. Avec une bien forte minorité contre la prorogation. Je doute que ce soit une bonne mesure. Dumon, qui va venir me voir, m'écrit : " Vous êtes arrivé au milieu d’une crise avortée. Le Président ne fera pas son 18 Brumaire dans une inauguration de chemin de fer et l’Assemblée n'a d’énergie que pour aller en vacances. Le parti modéré n'a ce me semble, que les inconvénients de sa victoire. A quoi lui serviront les lois qu’il fait si péniblement ! Est-ce le mode pénal qui nous manque ? Mais déjà les dissentiments percent, dans la majorité. Elle se divise comme si elle n’avait plus d'ennemis. Je crains bien que le parti légitimiste ne soit avant longtemps, un obstacle à la formation, si nécessaire du grand parti qui comprendrait les libéraux désabusés, les conservateurs courageux, et les légitimistes raisonnables. Il a bien bonne envie d'exploiter à son seul profit, cet accès de sincérité qui fait faire depuis huit jours tant de confessions publiques, et il semble disposé à marchander l'absolution à tout le monde, sans vouloir l'accepter de personne. Tout ce que je vois, tout ce que j’entends dire me donne une triste idée de la situation du pays. Avec l'économie sociale d’une nation civilisée nous avons l’état politique d’une nation à demi barbare. L'industrie et le crédit ne peuvent s’accommoder de l’instabilité du pouvoir ; la douceur de nos mœurs est incompatible avec sa faiblesse. Nous ne pouvons rester tels que nous sommes ; il faut remonter ou descendre encore. Notre faiblesse s'effraie de remonter ; notre sybaritisme s'effraie de descendre. Il faut bien pourtant ou travailler pour le mieux, ou se résigner au pis : tout avenir me semble possible excepté la durée du présent. Je ne crois pas que la prolongation (je ne dirai pas la durée) du présent soit si impossible. Le pays me paraît précisément avoir assez de bon sens et de courage pour ne pas tomber plus bas, pas assez pour remonter. On compte beaucoup, pour le contraindre à remonter sur l’absolue nécessité où il va être de retrouver un peu de prospérité et de crédit qui ne reviendront qu’avec un meilleur ordre politique. Je compte aussi, sur cette nécessité ; mais je ne la crois pas si urgente qu’on le dit. Nous oublions toujours le mot de Fénelon : " Dieu est patient parce qu'il est éternel. " Nous croyons que tout ira vite parce qu’il nous le faut, à nous qui ne sommes par éternels. Je suis tombé dans cette erreur-là, comme tout le monde. Je veille sans cesse pour m’en défendre. Je conviens qu’il est triste d'y réussir ; on y gagne de ne pas désespérer pour le genre humain ; mais on y perd d’espérer pour soi-même.
Dîtes-moi qu’il n’y a plus de choléra autour de vous et que vous n'en avez plus peur, je serai content, comme si j’espérais beaucoup, et pour demain.
Onze heures Je n'attendais rien de la poste et pourtant. il me semble que c’est un mécompte. Adieu, adieu, adieu, dearest. God bless and preserve you, for me ! Adieu.
Val-Richer, Mercredi 1er août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève d'impatience. J’attends la poste. Elle n’arrivera qu'à 10 heures et demie. Que m'apportera- t-elle ? J'ai reçu hier une lettre de Mad. Austin qui me dit que son mari, qui est à Brighton lui écrit que tout le monde s'y porte bien. Je désire beaucoup que vous ayez vu MM. Guéneau de Mussy. Mais que sert tout ce que je puis vous dire de loin ?
Avez-vous remarqué, dans le Times de samedi dernier 28, un excellent article sur l'état de la France que je retrouve dans le Galignani d'avant- hier 30 ? Vraiment excellent. Jamais la conduite de l’ancienne opposition dynastique, et de Thiers en particulier, n’a été mieux peinte et mieux appréciée. Beaucoup de gens en France voient et disent tout cela ; mais ils n'en font ni plus ni moins. Le bon sens porte ses fruits en Angleterre. Là où, il se rencontre en France, c'est une fleur sans fruits. Rien ne se ressemble moins chez les peuples du midi, que la conversation et la conduite ; ce qu’ils pensent et disent ne décide pas du tout de ce qu’ils font. Pleins d’intelligence et de jugement comme spectateurs, quand ils deviennent acteurs il n’y paraît plus. Bresson et Bulwer m’ont souvent dit cela, des Espagnols. Bien pis encore qu'ici, me disaient-ils. Nous n'avons plus le droit d’être sévères pour les Espagnols. Les Hongrois se défendent énergiquement. Je ne sais pas bien cette affaire-là. Je crains que le Cabinet de Vienne par routine ne se soit engagé dans des prétentions et des déclarations excessives non part contre le parti révolutionnaire de Hongrie, mais contre les anciens droits et l’esprit constitutionnel de la nation. On ne saurait séparer avec trop de soin ce qui est national de ce qui est révolutionnaire, ce qui a un fondement en droit et dans les mœurs du pays de ce qui n’est que rêverie et insolence de l’esprit d'anarchie. Le Prince de Schwartzemberg, est-il en état et en disposition de faire ce partage ? Je parle d'autre chose pour me distraire d’une seule chose. Je n'y réussis guères. Adieu. Adieu jusqu'à la poste.
10 heures trois quarts
M. de Lavergne et M. Mallac m’arrivent de Paris, et la poste n'est pas encore là. Parce que j’en suis plus pressé que jamais. Je n'ai pas encore causé du tout avec ces messieurs. Ils sont dans leurs chambres. Je ne pourrai causer avec personne que lorsque j'aurai ma lettre et pourvu qu’elle soit bonne. Voilà ma lettre. Excellente. J’ai le cœur à l'aise. J’étais sûr que M. Gueneau de Mussy vous plairait. Croyez-le et obéissez-lui autant que vous le pourrez faire pour un médecin. Il m’est très dévoué. Il vous soignera bien. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre-mes hôtes. Adieu dearest. J’espère que le bien se soutiendra. G.
Val-Richer, Jeudi 2 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J’ai été bien heureux hier tout le jour. Je crois que mes hôtes m'ont trouvé bien gai. Comme notre âme tombe tout entière sous le joug de son impression du moment. Vous savoir un peu tranquille et être moi-même un peu tranquille, sur votre compte, me suffisait. J'étais presque content comme si vous aviez été là. Ce n’est pas vrai.
J’ai sous les yeux une image de l’extrême éparpillement et dispersion des esprits en France. Mes deux hôtes au fond, pensent et veulent tous deux la même chose; ce sont deux hommes du même parti, et deux hommes d’esprits. L’un croit au retour de la Monarchie pure, l'autre croit au succès définitif tant bien que mal de la République. L'avenir est si obscur et si incertain que des yeux qui y cherchent, et y souhaitent la même chose y voient. des choses contraires. Cela fait peur pour notre destinée et pitié pour l’esprit humain. Tous deux sont fort tristes et inquiets, à cause de la bêtise et de la platitude universelles. Un garde national de Paris disait le 25 février 1848, en criant contre les ouvriers, la populace et l’anarchie : " Puisqu'on leur livre tout, qu’ils nous laissent tranquilles. " Le pays livre soit tout volontiers, l’avenir comme le passé, pourvu qu’on le laissât tranquille. Heureusement que le bon Dieu ne se contente pas à si bon marché que les hommes ; et me permet pas qu’ils soient tranquilles à tout prix. Le Cabinet actuel moins près de tomber qu'on ne le croit. Dufaure et Tocqueville, ses vrais chefs, charmés du régime actuel, comme des acteurs d'une ville de province appelés à jouer sur le théâtre de Paris, et décidés à s'y maintenir. Sincèrement attachés à la République et à la Constitution, et se flattant qu'ils y contiendront le Président. Plus ennemis de Thiers que jamais. Tocqueville a dit à M. de Lavergne : " Il faut que M. Guizot entre dans l'Assemblée ; il n’y a que lui qui puisse nous délivrer de M. Thiers. " M. Molé renonce à l'Empire comme il a renoncé à la fusion. Il renonce même à la Présidence à vie ou décennale. Il faut rester dans la Constitution. Mais quand on en viendra à l'élection d'un président, dans trois ans, il faut que le peuple réélise Louis Napoléon malgré la Constitution qui le défend. Le peuple seul est au-dessus de la Constitution, et peut la violer s'il veut. Tout le monde se soumettra alors. C’est avec cette perspective que M. Molé tâche de calmer un peu les amis impatients du président ; et de gagner du temps, sa seule politique au milieu de toutes les impossibilités d’aujourd’hui.
J'ai vu un Belge intelligent, et fort au courant de son pays et de sa cour. Le Roi Léopold assuré et tranquille mais supportant avec humeur, quoique patiemment, le joug de son cabinet actuel, les Barrot et les Dufaure de Bruxelles, qui ne lui épargnent pas les impertinences et les désagréments. Onze heures Votre lettre confirme celle d’hier. Vous n'êtes pas mal, et vous verrez de temps en temps M. Guéneau de Mussy. Adieu Dearest, à demain la conversation. La cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu. G. Vous vous trompez sur le sentiment qui fait dire au Duc de Broglie ce qu'il vous dit. Peu importe du reste. Adieu encore et toujours.
Val-Richer, Vendredi 3 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 5 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
J'allume mon feu, en me levant. André le prépare la veille ; un bon petit fagot ; je n'ai qu’une allumette à y mettre. J’ai toujours avec plaisir du feu pendant deux heures le matin pour ma toilette. Il fait très beau, mais point chaud. Décidément du moins jusqu’à ce que l’automne se fasse sentir, je garde l’appartement que j’avais ; je le préfère beaucoup ; il m'est plus commode mes deux cabinets de toilette sont beaucoup plus grands ; j'ai beaucoup plus de place pour mes papiers. Il est plus loin du service de la maison ; c'est de l'autre côté que se font les affaires de ménage, qu'on va et vient. D'ailleurs pas la moindre trace d’humidité pas plus de mon côté que de l'autre. Enfin j'aime mieux, pour moi, rester où je suis si je m’aperçois plus tard que l'exposition à quelque inconvénient ; je changerai. Jusqu'à présent, à mon goûts je perdrais au change.
Vous voyez que les bruits de 18 Brumaire et d'Empire s'en vont en fumée. Je vous l'ai dit ; personne ne croit que la durée du régime actuel sait possible ; mais personne n'a et n'aura le courage de prendre l'initiative d’un changement. La République et la Constitution seront, non pas respectées, mais pas touchées, parce qu'elles sont ce qu'on appelle le fait établi et l’ordre légal et parce que personne n'a bien envie de ni bien confiance sans ce qui viendront après. On attendra la nécessité de changer, la nécessité évidente, urgente, absolue. Et cette nécessité ne viendra si elle vient que lorsqu'on approchera d’une nouvelle élection du président et de l'Assemblée ; jamais une société n'a été plus résignée à l'état horrible et précaire, au pain et à l'eau, ce qu’il faut strictement pour vous aujourd’hui, sans certitude de l'avoir demain. Cela même ne peut pas durer j’en suis bien sûr. Mais combien de jours, de mois, d'années Pour la vie des grands états, nous m'avons pas la mesure du temps. La honte est immense ; le danger matériel et personnel peu de chose. A la condition d'abaisser à ce point leurs prétentions, les honnêtes gens sont les maîtres du terrain. Restent les évènements imprévus, les nécessités inattendues les coups du sort, qui sont les décrets de Dieu. Pour ceci, la France actuelle, n'est pas en état d’y pourvoir, et si elle y est forcée, il faudra bien quelle change. Je n’entrevois, pour le moment, rien de semblable à l'horizon. Il n’y a plus en Italie que des embarras. Le Pape bataillera plus ou moins longtemps pour avoir dans son gouvernement plus ou moins de laïques ; le Roi de Sardaigne luttera comme il pourra contre sa nouvelle chambre quasi-belliqueuse et républicaine mais l’un et l'autre vivront sous la tutelle du trio Français, Autrichien et Anglais qui sera plus ou moins d'accord, mais qui le sera assez pour maintenir ce qui vient de se rétablir. La Hongrie traine, malgré les prédictions de Lord Ponsonby. Les élections Prussiennes, à ce qu’il paraît modérées. L'Allemagne, qui a un avenir bien plus gros que l'Italie, semble faire une halte après une orgie. Les deux états sont Londres et Pétersbourg, ne demandent qu'à se tenir tranquilles en veillant auprès des Etats malades. Mes pronostics sont donc à l'immobilité pour demain, après-demain. Nous verrons plus tard. Je ne vois personne qui ait la moindre inquiétude pour la tranquillité de Paris.
Onze heures
Je suis bien aise que vous ayez revu M. Guéneau de Mussy. Je désire que même bien portante, il vous voie de temps en temps. Adieu. Adieu. J’ai reçu je ne sais combien de lettres insignifiantes deux ou trois exigent une réponse sur le champ. Adieu, dearest. G.
Val-Richer, Dimanche 5 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Voici ce que m’écrit M. Piscatory de retour à Paris avec le Président : " Mon métier de représentant m’a mené à Tours, et ma curiosité m’a poussé jusqu'à Angers. J'ai vu qu’il n’y avait rien à voir, rien à conclure de toute cette curiosité de tous ce cri de toutes couleurs. Le héros de la fête est certainement celui qui avait le plus de bon sens et qui conservait le mieux son sang froid. Quel pays, grand Dieu ? " La majorité a été mise hier à sa première épreuve financière, et le grand Passy n’a rien trouvé de mieux que de l’entraîner à frapper de mort lente, un impôt de plus. J’avais bien envie de faire une charge à fond sur ce pauvre Cabinet. Ce n'était pas difficile. Mais je ne sentais pas clairement ce que la situation y aurait gagné. " Nous nous occupons de préparer la liste des 25 personnes qui doivent veiller sur la Constitution en l'absence de l'Assemblée. Je cours grand risque d'être du nombre avec M. Molé qui se dévoue. M. Thiers n'est pas si patriote. M. de Broglie va à son conseil général. M. Berryer représentera avec six autres, son parti. La part faite au centre gauche sera de cinq. Nous n'aurons rien autre chose à faire que de ne pas profiter de la prorogation. " " La maladie des corps et des esprits est toujours la même. Plus il y a de calme apparent, moins on voit l'issue. Comme l'a dit le Président, nous sommes et nous resterons, dans une rade plus ou moins bonne. Remettre du lest et des mâts n’est pas chose facile. " Vous voyez que cela est d'accord avec ce que je vous écris. On me dit d'ailleurs que l'Assemblée n'aura pas fini avant le 20 les lois qu’elle veut absolument avoir faites avant de se proroger. D'autres m'écrivant qu’elle partira bien certainement le 14, le même jour où les écoliers des collèges de Paris prennent leurs vacances. Je crois plutôt à ceux-ci.
Charles Albert n’avait rien de mieux à faire que de mourir. Je trouve le discours de son fils aux chambres Piémontaises bon, assez digne et sensé. Adieu pour aujourd’hui. J’allais dîner avec vous le Dimanche. Adieu. Adieu. Adieu.
Le Général Trezel m’arrive demain. Je n’ai pas entendu parler de Montebello. C’est drôle. Je ne serais pas bien étonné, si le Moniteur me l'apportait ambassadeur à Vienne. En mission temporaire, comme M. Drouyn de Lhuys.
Lundi matin 6 août. 7 heures
Je craignais de m'être enrhumé hier soir, au serein. Les gens d'un village voisins sont venus à 10 heures du soir, et pour me fêter, faire partir un ballon devant ma porte. Il a bien fallu sortir et rester un peu dehors. Le ballon est peu parti ; les paysans Normands ne sont pas de grands physiciens, mais l’intention était amicale. Je ne me suis pas enrhumé. Le soleil est magnifique ce matin. J'espère qu’il durera. Le temps a tourné hier au froid, et au sec. Que je voudrais vous envoyer, ou plutôt vous apporter, la moitié de mon soleil ; ce serait charmant à Richmond. Je pense que la Princesse Chrasalcovitch aussi aime le soleil. Parlez-lui de moi, je vous prie, et de mon respect reconnaissant. Elle me permet, j’en suis sûr d'employer ce mot à cause de ses soins pour vous. Elle a du cœur, et de l’esprit, et de l’indépendance d’esprit, Que faisait-elle de tout cela à Vienne ?
Onze heures Je suis charmé que M. Guéneau de Mussy vous plaise si vous y tenez, je suis sûr qu’il vous conduira à Paris. Je ne connais personne avec qui vous fussiez plus en sûreté. Trezet vient de m’arriver et la cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu, dearest. Bonne petite lettre ce matin. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 6 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Trezet vient de repartir. J’aime bien les gens qui viennent passer la journée et ne couchent pas. C’est beaucoup plus commode quand on a peu de domestiques. Il ne m’a rien appris et je n'attendais rien de lui. Quelques détails, sur le passé ; quelques souvenirs que je l’ai prié d’écrire. Je veux que chacun de mes collègues me donne son récit du 20 au 24 février. Je m’en servirai un jour. Duchâtel m’a promis le soir qui est le plus important. Il l'a déjà écrit. Il m’a écrit en partant de Londres. Ce qu’il vous avait dit. Il rentrera plus de deux jours à Paris.
La lettre de Morny est assez curieuse. Il en sera pour ses peines d’embauchage impérial. A moins de quelque gros incident nouveau qui le jette de force dans l'Empire, le Président n'ira pas. Personne ne fait plus, et ne veut plus rien faire aujourd’hui que par force. Personne ne veut avoir à répondre de ce qu’il fait " Je n’ai pas pu faire autrement. " C'est l’ambition de tous. Ils ne sont pas fiers. M. de Metternich non plus n'est pas fier. Quand on est petit, je comprends qu’on mente pour se faire croire grand. On a tort ; on est découvert ; on devient ridicule ce qui est un grand obstacle à devenir grand. Pourtant je le comprends. Mais quand on est grand mentir pour faire croire que les Princes sont reconnaissants, et qu'on a encore leur faveur ce n’est pas de l’orgueil quoi que vous lui fassiez l’honneur de ce nom, c’est une vanité d'antichambre. J’en suis fâché. A en croire les apparences, M. de Metternich prend bien sa disgrâce, simplement et fermement. Et il a raison ; un chêne reste chêne, même déraciné, quand il a fallu un tremblement de terre pour le déraciner. Je suis fâché que M. de Metternich soit au fond et dans le secret de la vie intérieure, moins digne qu’il n'en a l’air.
Dearest cette phrase de votre lettre me va au cœur : " Vous, et du repos, voilà ce que je demande. " Je ne voudrais pas vous donner plus de sécurité qu'il n'en faut avoir. Je n’ai que trop eu déjà trop de sécurité (Phrase bizarre que vous comprendrez). Mais vraiment je crois et tout le monde croit qu'il y aura désormais du repos à Paris du repos matériel ; pas de bruit et pas de danger dans les rues. C'est, pour longtemps, le seul repos auquel nous puissions prétendre. J’espère que celui-là vous suffira.
Mardi 7 8 heures
Je reçois beaucoup de lettres dont quelques paragraphes, quelques phrases vous intéresse raient. Je ne puis ni vous tout envoyer ni tout copier. L'absence. L'absence ! Je trouve dans ces lettres des symptômes curieux, des traits de lumière, sur le présent et sur l'avenir. Curieuse société à la fois si inerte et si active, qui se laisse tout faire et ne se laisse définitivement prendre par personne gardant toute l’indépendance de son esprit dans la servilité et l’impuissance de sa conduite ! J’en suis honteux. Mais je n'en désespère pas.
Avez-vous lu l’article de M. Forcade dans la Revue des deux Mondes (N° du 15 Juillet) sur l’histoire de la révolution de Février de M. de Lamartine ? Plein de talent et d'honnêteté. C'est le commencement de la flagellation publique de M. de Lamartine. Et le 5° Numéro qui vient de paraître, du Conseiller du Peuple de M. de Lamartine. Une Philippique contre Thiers. Ces deux choses valent la peine que vous les lisiez.
Onze heures
Je fais toujours la découverte du mardi au moment où la poste arrive. Elle ne m’apporte rien d'ailleurs. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 8 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime bien le Mercredi. J’espère que la poste arrivera de bonne heure je le lui ai bien recommandé hier. Je vais ce matin déjeuner et faire quelques visites à Lisieux. Il faut que je sois parti à onze heures. Le temps est toujours beau. Nous entrons dans un moment de stagnation. S'il ne survient aucun gros évènement, on ne sera occupé, d’ici au mois d'octobre, que des affaires locales. Pendant la réunion des Conseils généraux, il n’y a plus d'Europe, ni presque de France ; il n’y a que le département, l’arrondissement, les chemins vicinaux, les prisons, les hospices, &etc. Ni la capacité ni le dévouement ne manquent pour ces intérêts-là. Ce pays-ci irait bien si chacun se tenait dans sa sphère, et s'il y avait des hommes naturellement placés et préparés, pour la grande sphère. Dans son état actuel il ressemble à ce que serait le système du monde si toutes les planètes voulaient sortir de leur orbite, et devenir le soleil. Les Phaétons sont notre fléau. Pardonnez-moi mon érudition, astronomique et mythologique. Vous avez habituellement la prétention d'être ignorante. Mais j’ai toujours trouvé quand j’y ai regardé de près ; que vous ne l'étiez pas du tout.
J’ai eu hier la visite des deux anciens députés de l’arrondissement de Caen, Mon. de La Cour et Abel Vautier deux bons conservateurs, très braves gens et fidèles pour moi. Bons types de la bonne moyenne, en fait d’honnêteté et d’esprit. Ils ont toutes leurs anciennes idées, leurs anciens sentiments. Ils regrettent ardemment ce qui n’est plus ; ils ne croient pas à la durée de ce qui est. Et pourtant ils s’arrangent et se résignent comme si ce qui est devait durer toujours. On ne voit pas d'issue et on a grand peur des efforts qu’il faudrait faire et de ce qu’il en couterait pour en trouver une. Je ne les trouble point dans leur disposition. Je prends avec tout le monde, mon attitude de tranquillité parfaite.
Un autre de mes anciens amis dont le nom ne vous est pas inconnu, M. Plichon qui était venu m'attendre au Havre, m'écrit de Paris : « Votre retour a fait une sensation réelle dans le pays ; tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, gens de la veille, du jour et du lendemain, cherche à savoir ce que vous pensez et demande ce que vous ferez. Le sentiment public à votre endroit sera d’autant plus vif que votre attitude sera plus réservée. Moins on connaitra votre pensée sur les hommes et sur les choses plus on dérivera la connaitre ; plus vous vous tairez, plus on attachera de prix à vous entendre parler. Ce sentiment grandira dans le pays à mesure que la situation se développera et ce qui n’aura été d’abord que curiosité deviendra une aspiration réelle et profonde. »
Vous voyez qu’un bon bourgeois des environs de Lille peut être tout à fait de votre avis.
10 h. 3/4
Voilà votre longue lettre. Cela m'est bien dû le mardi. Il faut que je parte pour Lisieux. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 9 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous me manquez bien. J’écris mon Discours sur l’histoire de la révolution d'Angleterre. Voici mon idée principale exprimée dans le premier paragraphe : « Je voudrais recueillir les enseignements que la Révolution d’Angleterre a donnés aux hommes. Elle a d’abord détruit, puis relevé et fondé en Angleterre la monarchie constitutionnelle. Elle avait tenté sans succès d'élever en Angleterre. La République sur les ruines de la Monarchie ; et cent ans à peine écoulés ses descendants ont fondé la République en Amérique, sans que la monarchie, par eux vaincue au-delà des mers, cessât de briller, et de prospérer dans ses foyers. La France est entrée à son tour, et l’Europe se précipite aujourd’hui dans les voies que l'Angleterre a ouvertes. Je voudrais dire quelles lois de Dieu et quels efforts des hommes ont donné, en Angleterre à la Monarchie constitutionnelle, et dans l’Amérique Anglaise à la République, le succès que la France et l’Europe poursuivent jusqu'ici vainement ,à travers les épreuves mystérieuses des Révolutions qui grandissent ou égarent pour des siècles l'humanité."
Vous entrevoyez ce qui suit : l'exposé à grands traits des causes qui ont fait que la Monarchie constitutionnelle a réussi en Angleterre, et la République aux Etats-Unis d'Amérique, et que ni l’une ni l’autre ne réussit parmi nous. Cela peut être frappant. Mais je n’ai pas une âme avec qui échanger, sur ceci une idée. Vous n'êtes ni bien savante, ni bien littéraire ; mais vous avez l'esprit juste et exigeant dans le grand, soit qu’il s’agisse d’écrits ou d'actions. Vous voyez tout de suite tout l'horizon, et vous n'y voulez pas un nuage. C'est là ce qui est rare et indispensable. Vous m'êtes indispensable. Heureusement nous nous serons rejoints avant que j'aie terminé et publié mon Discours. Ne montrez, je vous prie, à personne ce premier paragraphe.
Voilà la pluie. Savez-vous pourquoi elle me contrarie le plus ; pour mes allées dont elle entraine le sable. J’aime que mes allées soient bien tenues, et je ne peux pas les faire réparer tous les matins. J’ai passé hier ma matinée à Lisieux à faire des visites, très paisiblement dans les rues et très amicalement dans les maisons. Beaucoup d'accueil bienveillant et pas un mot hostile ; sauf cette phrase que j'aie vue écrite au charbon sur un mur : « Peuple, garde-toi de Guizot ; il revient pour être encore le maître. » Il est en effet question de me nommer au conseil général. Par un singulier hasard le membre du Conseil, pour le canton où est situé le Val Richer est mort quelques jours avant mon arrivée. J'ai dit aux personnes qui sont venues m'en parler, que si j'étais nommé spontanément presque unanimement, j'accepterais ; mais que je ne voulais pas être nommé autrement, ni porté si on n’était pas sûr que je le serais ainsi. Je ne pouvais répondre autrement. Je crois que je ne serai ni nommé, ni porté. En tous cas soyez tranquille ; il n’y aurait pas l’ombre de danger pour moi à Caen pas plus qu'à Lisieux. Les dispositions y sont les mêmes. La Normandie est évidemment la province de France la plus sensée.
10 heures et demie
Certainement il faut que M. Guéneau de Mussy vous ramène. Personne ne le vaudra. Il reviendra en septembre. J’ai une longue lettre de lui, il me parle beaucoup de vous, de votre santé. Je vous dirai ce qu’il me dit. Galant homme de l’esprit et du dévouement. Mad. Lenormant a gagné son procès. Elle reste seule et absolue maîtresse des papiers de Mad. Récamier. Défense à Mad. Colet et à tout autre d'en rien publier. C'est un arrêt moral et qui arrêtera bien de petites infamie. Adieu, adieu, dearest, Adieu donc. G.
Val-Richer, Vendredi 10 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
M. Guéneau de Mussy m'écrit: « Mad. la Princesse de Lieven avait surtout besoin d'être rassurée. J’espère y avoir réussi. Un malheureux cas de choléra avait jeté l'effroi dans Richmond, et le médecin de l'endroit n’avait rien trouvé de mieux à faire que de répandre l'alarme chez les habitants et leur dire de se sauver au plus vite. J’ai d’abord engagé la Princesse à n'en rien faire et à s'estimer très heureuse, par le fléau qui court d'habiter un endroit où il n’avait frappé qu’un individu. Elle s'est mise au Star and Garter où l’air est plus vif et lui convient mieux. Je lui ai conseillé de prendre plus d’exercice. Comme il arrive souvent aux personnes chez qui les affections morales et les occupations intellectuelles remplissent la vie, le système nerveux oublie, pour ainsi dire, les fonctions animales, ou s’en occupe avec négligence. Il faut le rappeler à ses devoirs en exerçant la machine. C’est ce que la Princesse m’a promis de faire. La reconnaissance que je garde de son accueil se porte, Monsieur vers une personne à laquelle je serais trop heureux de témoigner en toute occasion le dévouement entier qu’elle m’inspire. Votre lettre du 3 août, m'est arrivée trop tard pour que ma réponse pût partir hier. Je ne ferme la mienne que ce matin pour vous envoyer des nouvelles toutes fraîches de le Princesse que je quitte et que je laisse en très bonne santé. Vous pouvez compter que mes soins ne lui manqueront pas. "
Il me donne, sur Clarencourt, quelques détails qu’il vous a sans doute dits; et il ajoute : « La famille royale me congédie avec une facilité qui m’attriste et me satisfait plus encore. Elle me donne une dernière marque de confiance en me déclarant qu’elle ne prendra jamais que le successeur de mon choix. Je ne sais si je le trouverai. "
J'ai ri de l’histoire de Duchâtel et j'y crois. J’ai rencontré plusieurs fois chez lui cette Miss Mayo, avec sa tante Lady Gurwood ( Est-ce Lady ou Mistriss ?) veuve du colonel de ce nom qui a publié les dépêches du Duc de Wellington dont il avait été l’aide de camp. Toutes deux jolies, hardies, et vulgaires. A Londres et à Paris. cela peut aller ; la foule couvre tout. Mais il a tort s'il l’emmène à la campagne. Dans l’isolement et l’oisiveté de la campagne les voisins ne passent pas même ce que le ménage tolère.
Lord John n'y pense pas de vouloir que la République réduise son armée. Ce n'est pas contre les Russes qu'elle a besoin de 60 000 hommes à Paris. Les réductions qu’elle pourrait faire seraient financièrement peu importantes, et produiraient moralement un effet qui couterait bientôt beaucoup plus cher. La liberté et l'économie deux choses auxquelles, il faut renoncer aujourd’hui. Et quant à la stabilité, que Lord John se désabuse également ; et peut-être un peu vous aussi ; l'Empire ne la donnerait pas plus, peut-être moins que la République. Ce serait un mot et point un fait. Pas d'Empereur, et pas de dynastie. Avez-vous entendu parler des ouvertures de mariage qui ont été faites de divers côtés ? à Stuttgart, à Stockholm. Partout on a éludé. Son oncle gagnait des batailles, quand on avait éludé avec lui. Je doute qu’il en fasse autant. Et il me paraît avoir le bon sens de ne pas le tenter.
Onze heures
Voilà votre lettre. Montebello prend un long détour pour m’arriver. Adieu. Adieu. Je suis fâché pour ce pauvre Ragenpohl. Il m'écrit pas du tout l'air à la paralysie. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 10 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
J’ai oublié ce matin le vendredi et j’ai fait mettre ma lettre à la poste comme si vous deviez la recevoir Dimanche. Vous aurez deux volumes lundi au lieu d'un. Je reviens de la promenade avec mes hôtes, trois personnes que vous ne connaissez pas et René de Guitaut, le faire de Mad. Bresson. Joli et intelligent jeune homme, qui n’a rien fait pour être replacé, mais qui aurait assez envie de l'être. Il dit que M. Drouyn de Lhuys était très peu bienveillant pour lui, et pour tous mes protégés de prédilection : mais que M. de Tocqueville est beaucoup mieux, et le dit.
Il m'a amusé, et attristé, en me parlant de sa sœur. " Elle a beaucoup gagné, m'a-t-il dit, au moral et au physique, depuis la mort de son mari, Certainement, elle ne se remariera pas. Elle avait accepté le joug de Bresson, qui n’était pas commode. Elle l'aimait. Mais elle n’en acceptera aucun autre. Elle est forte et fière, et jouit beaucoup de son indépendance. " Evidemment le plaisir de la liberté, surpasse dans Mad. Bresson, le regret du bonheur. Bossuet dit quelque part : " Ainsi s’en vont les amitiés de la terre avec les années et les intérêts. " Je reconnais ces vérités communes générales. Je ne les et jamais acceptées, je ne les accepte point comme universelles. Je ne me fais point d'illusions sur le gros de la nature, et de la condition humaine ; mais je crois aux cœurs, comme aux esprits d'élite ; il y a de grandes affections comme de grandes idées, et tout ne se passe pas et ne passe pas pareillement dans toutes les âmes, si je n’avais pas cette confiance et cette expérience là je pourrais cacher, (il le faudrait bien), mon incurable tristesse et mépris de toute personne et de toute chose, mais je vivrais dans un complet isolement intérieur. De toutes les médiocrités, celle des affections est la seule que je ne puisse pas tolérer.
J’ai eu beaucoup de monde toute la matinée ; quatorze gros bonnets d’une petite ville des environs venus en masse, et de Caen le meneur des légitimistes les plus vifs, l’ami intime de Charles de Bourmont, homme d'assez d’esprit et qui a le verbe haut dans le pays. Je suis le même avec tous ; langage très ouvert conduite très réservée ; rien à cacher et rien à faire. L’idée de me nommer au Conseil général court toujours, bien accueillie par la masse de la population repoussée par les gros timides et les rivaux cachés. Anciens rivaux de Paris actifs partout et en toute occasion, quoique affectant une très bonne apparence. Evidemment, ils ne doutent plus que jamais de me revoir sur la scène et feront tout ce qu’ils pourront pour m'en fermer toutes les portes. Je ne me prête point à leurs manœuvres, ni ne m’en défends. Je laisse faire le public et le temps, si je dois revenir, c’est par ces deux forces là seules que je dois et que je puis revenir comme il me convient. Je ne crois pas au Conseil général.
Samedi 7 heures
Voilà M. de Guizard qui m’arrive, l’ami intime de M. de Rémusat. Je sais qu’il voit tous les jours Thiers et sa coterie. Il m'apprendra beaucoup de petites choses. Assez d’esprit et vrai gentleman.
Onze heures Moi aussi, je reçois chaque matin votre lettre avec un plaisir nouveau. Autre chose serait encore plus nouveau et encore mieux. Adieu, Adieu, adieu. Dearest, ever dearest. G.
Val-Richer, Samedi 11 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
M. Moulin qui ne peut pas venir me voir dans ce moment-ci et j’en suis bien aise, j'en ai trop, m’écrit hier : " Notre prorogation est encore plus opportune que nous ne pensions quand nous l’avons votée. Jamais la situation parlementaire n’a été plus tendue, et l’union du parti modéré plus menacée dans notre assemblée. Une petite église légitimiste composée de 15 ou 20 membres, s'est nettement séparée de M. Berryer. Le surplus du Camp est loin d'être parfaitement discipliné. Ce qui est plus grave c’est une sorte de scission qui a éclaté hier dans le soin de la Commission pour la loi d'assistance présidée par l’évêque de Langres entre M. Thiers, et M. de Montalembert. Il était question de nommer M. Thiers rapporteur. Les catholiques ont demandé que désormais tous les établissements religieux, toutes les congrégations puissent recevoir sans autorisation du gouvernement les libéralités qui leur seraient destinées. M. Thiers a combattu cette idée, et a déclaré qu’il n'acceptait pas la condition qu'on paraissait vouloir lui imposer. M. de Montalembert s'est aigri, M. Berryer lui-même a soutenu la thèse avec une vivacité contraire à l’attitude conciliante qu’il paraissait avoir adoptée depuis la révolution de Février. En fin de compte, M. Thiers n'a été nommé rapporteur qu'à la plus simple majorité, la moitié plus un. Si l'on n'est pas définitivement brouillé, en est fort refroidi. La constitution d’un Ministère Thiers est de plus en plus difficile pour ne pas dire impossible. Le règne de MM. Barrot et Dufaure n'est pas fini. Les lois fiscales, devenues nécessaires seront très mal accueillies, par nos départements et nous donneraient de tristes élections si le suffrage universel était encore consulté. Tout ordre financier me parait incompatible avec l’institution électorale de Février. "
M. de Guizard me confirme tout cela. Mauvaise situation de Thiers dans l’assemblée, à cause de ses qualités comme de ses défauts. Il est trop franc. Il ne cache aucun de ses dégouts. Il brusque à tout moment les bêtes et les rêveurs. Il n'est le chef du parti modéré que le jour où il a fait un grand discours, et deux jours après, hors de là, c'est Molé, aussi adroit, aussi persévérant aussi agréable courtisan des malotrus que des Rois. Ainsi, est-il heureux de sa situation. Pas grande envie qu’elle change. Pas très pressé que ceci finisse. Hardi dans son langage ; longtemps partisan déclaré des coups d'état conservateurs et impériaux. Beaucoup plus calme aujourd’hui. Décidé à attendre trois ans la réélection du Président, que le peuple réélira alors, en dépit de le constitution. Ceci est également l’avis, même confidentiel et intime, du Président lui-même. Il s'en est expliqué en ce sens dans un petit dîner à quatre, Molé, Thiers, le général Changarnier et lui. " Je désire que personne ne se mêle de mes affaires avec le peuple. Le peuple m'a bien traité. Il me traitera bien encore, si je l'ai bien servi." On doute qu'au fond du cœur, ce soit là son vrai mot. Il cherche évidemment les occasions qui peuvent presser la bonne volonté du peuple. A la vérité ces occasions ne répondent guères quand il les cherche ; et quand même elles répondraient, il hésiterait probablement beaucoup à en profiter. Un coup d'Etat, même pour l'Empire, c’est recommencer Strasbourg et Boulogne. Il est devenu trop sage. Le probabilité est de plus en plus contre les coups d'Etat. Il faudrait que la nécessité les commandât. Ce qui n’est pas probable non plus. Quant au changement de cabinet, le voilà ajourné de six semaines au moins. Thiers toujours décidé à s'efforcer sérieusement d’éviter d'entrer. Molé moins décidé. Moins dynastique, moins fidèle que Thiers. Rémusat, dans la même disposition, que Thiers à cet égard, quoique bien moins intime avec lui. Rémusat aussi noir sur l’avenir que le Duc de Broglie. Plein de regret, et on croit de repentir, quant au passé mais n'en laissant rien percer. M. de Tocqueville presque aussi vif et aussi franc que M. de Montalembert dans un mea culpa, mais me le faisant que pour l'opposition, en général, non pour lui-même, et dans les conversations, non à la tribune. Barrot à l’état de repentir mais toujours aigre contre ses amis eux adversaires, c'est-à-dire contre moi. C'est la compensation qu’il se donne. Du reste chef de parti toujours incapable. Il n’a pas su rallier dans le camp du gouvernement toute l'ancienne gauche qui ne demandait pas mieux. Le plus paresseux des hommes. Ses chefs en service ne peuvent lui arracher des signatures. Il passe son temps à se promener à l'exposition des produits de l'industrie ou des tableaux. Je vous redis tout ce qui me revient ; petit ou gros. Il n’y a pas moyen d'employer le mot grand.
Onze heures
J'ai ri de la boutade de Flahaut. La réponse du Roi est bonne. Je reçois une lettre de Barante qui me dit qu’il va vous écrire. Adieu, adieu, dearest. Il faisait hier un temps admirable. Aujourd’hui il pleut. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 13 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Il y avait hier assez de mouvement à Lisieux et dans le pays ; mouvement très tranquille ; on allait au Havre voir le président et les régates. Une députation de la garde nationale de Lisieux y allait. Elle a pour commandant un vieil officier de l’Empire, en retraite très bon soldat et très brave homme. Il a dit que, si la députation était au moins de 150 hommes il irait lui-même au Havre, avec le drapeau du bataillon. C'est le règlement ; le drapeau ne se déplace pas sans ce nombre. Il ne s’est présenté, pour aller que 78 hommes. Le commandant a déclaré qu’il n'irait. pas. On lui a demandé le drapeau. Il l'a refusé, Ceux qui voulaient aller se sont fâchés, et ont dit qu'ils voulaient le drapeau, qu’ils l'auraient de force. « Venez le prendre chez moi, c’est là qu’il faudra le prendre de force. Ils sont partis sans le drapeau. Ceci m'a assez frappé comme mesure de l’unanimité et de l’enthousiasme. Vous n’avez pas d'idée de l'effet que font dans le public, dans le plus gros public des scènes comme le soufflet de Pierre Bonaparte à M. Gastier. Cela choque bien plus que les plus graves fautes de constitution et de gouvernement. Cela choque une foule de gens qui, s'ils étaient à l'assemblée courraient grand risque d'en faire autant. Ce pays-ci a le goût des formes et la prétention de l'élégance. Il ne pardonne pas ce qui l’humilie sous ce rapport. Si la République et l’Assemblée avaient les belles manières et le beau langage du temps de Louis XIV, il leur passerait presque tout le reste. Cette combinaison là lui plairait beaucoup. Mais il n’a pas, ce plaisir là.
Avez-vous remarqué, il y a quelques jours, la fin du discours de M. de Tocqueville sur l’affaire de Rome ? Il y a été assez dur pour le Pape et en faveur de la politique vaguement libérale. On dit que c’est moins pour plaire à la gauche que pour se préparer une porte de sortie dans le cas, qu’il prévoit où cette politique ne prévaudrait pas à Rome. Il est déjà las du Ministère, et des injures qu’il faut subir, et des luttes qu’il faut soutenir, et des nécessités qu’il faut accepter. Il ne se résigne pas aussi facilement que M. Barrot, à la flagellation publique d’une repentance quotidienne. Et il s’y attend. On m'assure qu’il désire ardemment se retirer. Vous savez qu'on appelle M. Passy le passif des finances de la France. M. Vitet m'écrit qu'il viendra dîner aujourd'hui avec moi. Je suppose que Duchâtel n’arrive à Paris que demain ou après demain. M. et Mad Lenormant me viennent aussi aujourd’hui. Ils me diront les détails et le vrai de la querelle de Thiers et de Montalembert. Si cela est sérieux cela deviendra important. Barante m'écrit ceci : "L'opinion publique commence évidemment à avoir le courage de regretter le passé ; mais elle ne s'émeut pas plus pour le ramener qu’elle ne s’est émue pour le défendre." Rien du reste que des lamentations et des tendresses. Il finit par cette phrase : "Je vais écrire à Madame de Lieven, encore que ma correspondance soit vide et stérile. Autrefois, elle avait la bonté de ne point trop s'ennuyer d'un commerce où j’avais tout à gagner." Adieu. Je vais travailler en attendant la poste. Vous écrire, c'est mon plaisir. Adieu, adieu, dearest.
Onze heures et demie
La poste vient tard. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Vous voyez qu’il n’y a rien eu à Rouen. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 13 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
M. et Mad. Lenormant arrivent. Je n'ai pas encore causé avec eux. Ils m'ont dit seulement que dans son voyage à Chartres, le président avait dû aller déjeuner chez le Duc de Noailles, à Maintenon. Il ne l'a pas pu, ou pas voulu ; mais, à l'aller et au retour il a pris dans son wagon, le Duc de Noailles, qui en a été très content, plus content qu’il ne s'y attendait, quoiqu’il s’y attendît. Le voyage de Rouen ressemble aux autres. Convenable et froid. On restera comme on est. Chaque jour me confirme dans cette conviction. Il n’y a plus que Dieu qui ose faire quelque chose. Dimanche ou lundi dernier, MM. Odilon Barrot et Defaure sont allés en personne chez Napoléon Daru ( l’aîné, l’ancien Pair) pour lui offrir le Ministère des Finances. Il a refusé. Ils ont insisté. Il a refusé péremptoirement, disant qu’il ne croyait point à tout ceci et n’y voulait pas prendre plus de part qu’il n'en prenait déjà, comme représentant. Dufaure s'est montré, comme de raison beaucoup plus confiant. La Constitution toute mauvaise qu’elle est, peut bien vivre trois ans. En 1852, on la révisera. Daru a tenu bon, et leur a conseillé de garder M. Passy : " C’est un bon caissier ; contentez vous d’un bon caissier. Il n’y a pas moyen aujourd’hui d'avoir autre chose. " Mardi 14 août 6 heures M. Vitet est arrivé hier, pendant le dîner. Il venait de Rouen et du Havre, où il a tout vu et pris part à tout, comme député du département à Rouen, bonne réception, pas d’enthousiasme mais très bonne réception, public très décidé. Beaucoup de "Viva le Président ", ou Napoléon. Assez de "Vive l'Empereur", non pour avoir l'Empire, mais pour adhérer au neveu de l'Empereur. Très peu de "Vive la République". Au banquet, ovation pour le Président, ovation pour Changarnier, ovation pour Thiers, au Havre, autre chose. Grand concours de population ; 25 ou 30 000 étrangers venus de tout le pays. A l'arrivée du Président, dès le débarcadère, et pendant la revue, une démonstration désagréable, évidemment organisée ; de petits groupes épars criant à tue-tête et sous son nez : "Vive la République, vive la Constitution". Peu de " Vive le Président" en réponse. La masse Froide, étrangère à la démonstration, hostile, mais froide. Il a été reçu au Havre, sauf la grande foule, comme je l'ai été ; peut-être même moins soutenu par les amis contre les ennemis. Au banquet, et au spectacle des régates s’est un peu relevé ; bon accueil, pas mal de Vive le Président mais toujours dans un coin de la salle du banquet et du spectacle, un certain nombre de cris furibonds obstinés : " Vive la République, vive la Constitution". Il a senti le désagrément et témoigne qu’il le sentait. Il était fatigué, souffrant de mauvaise mine ; un peu de cholérine. Il n'a pu ni recevoir solennellement les autorités, ni assister à tout le banquet ; il n’est venu qu’au dessert ; et quand il a répondu au toast, il l’a fait brièvement, sèchement : " Je bois à la santé de la ville du Havre. Je fais des vœux pour sa prospérité. J'espère qu’elle sentira tous les jours davantage que le respect de l'ordre, des autorités qui maintiennent l'ordre, peut seul assurer cette prospérité" ; et quelques phrases, dans ce sens. Voilà le récit d’un observateur très intelligent, très exact, et bien placé pour bien voir. Vous en conclurez comme moi, comme M. Vitet comme tout esprit clairvoyant que ce qui est aujourd’hui a tout juste ce qu’il faut de force pour être, et ne fera rien de plus.
Je ne comprends pas que Madame la Duchesse d'Orléans n'ait pas fait visite à la Duchesse de Cambridge comme aux autres membres de la famille royale d’Angleterre. Peut-être parce qu’elle la croit peu bienveillante. Mais ce n'est pas une raison. Peut-être quelque secrète humeur entre Princesses allemandes. Je ne sais pas. Moi aussi, la Hongrie m'étonne. Je ne puis pas ne pas croire qu'on en finira bientôt. S’il en était autrement, ce serait un grave échec. Peut-être qu'on négocie en même temps qu’on se bat. Il y a là, ce me semble, nécessité et matière à transaction. Nous verrons. C'est le mot qu'on redit à propos de tout.
Onze heures
C'est mardi ! Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Opinion publique, Politique (France), Réseau social et politique
Val-Richer, Mercredi 15 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Tenir à ce qui doit durer en laissant tomber ce qui s'en va et en acceptant ce qui vient, c’est aujourd’hui plus que jamais, la grande difficulté, et le grand secret du gouvernement. C'est dommage que, sachant ce que je sais et pensant ce que je pense aujourd’hui, je ne sois pas jeune et inconnu.
Je vous fais lire mes lettres. Voici M. Cousin, arrivé hier : " Mon cher ami, j’arrive des eaux de Néris, et à peine rentré à la Sorbonne et dans mes tranquilles habitudes, je m'empresse de vous dire combien je suis charmé de votre retour. Puisse-t-il marquer une époque meilleure dans nos affaires ! Unissons-nous tous contre l’ennemi commun. Grace à Dieu, l'union entre nous est bien facile car elle n'a jamais été troublée que par des dissentiments aujourd’hui bien loin de nous. Dans nos démêlés politiques, nous sommes restés bons amis ; il nous est donc bien aisé de redevenir ce que nous n'avons jamais cesse d'être seulement le malheur commun accroîtra notre intimité, si vous le permettez. Quand vous viendrez à Paris, n'oubliez pas l’Hermite de la Sorbonne. En attendant que je vous serre la main, laissez-moi vous offrir cette 4e série de mes ouvrages qui parait en ce moment. "
C’est revenir de bonne grâce. Je ne sais si tout le monde en fera autant. Je ne crois pas. On m'assure que plusieurs en ont bien envie.
Encore une lettre. Piscatory m'écrit. " Je suis décidément une des oies du Capitole, et c’est aujourd’hui que je commence à garder le temple que personne, quoi qu'on en dise, n'a la pensée sérieuse de violer. Je ne crois pas à un changement de Cabinet dans l'absence de l'assemblée ; mais je crois qu’à son retour la majorité sera de mauvaise humeur, et qu’elle pourra bien chercher querelle à Dufaure sur la question, souvent reproduite à la réunion du quai d'Orsay, des fonctionnaires maintenus en dépit de toutes les remontrances. Je ne crois pas à l’efficacité d’un changement de Cabinet, à moins qu'il n’en résulte un ministre des finances capable et ce ministre là, je ne le devine pas. Benoist n’est rien, ou presque rien et Thiers est une grosse entreprise. Aujourd’hui, à titre de membres de la majorité nous défendons l’ordre avec désintéressement, avec abnégation, et sans être en quoi que ce soit responsables des actes du pouvoir. Le jour où Molé, Thiers, et autres seront ministres, les conditions et la composition de la majorité seront différentes. Vous avez lu ce qui s’est passé dans la Commission d'assistance. Tenez pour certain que c’est très sérieux. J’ai le droit de me vanter d'avoir fermé la plaie qu’on s'obstinait à ouvrir et à montrer ; mais la plaie n'en existe pas moins. Une partie des légitimistes et tous les catholiques sont fous. Thiers non plus n’est pas prudent, et je crains bien que dans la question de l’enseignement, nous ne lui voyions faire une nouvelle gambade. Quant au rapport dont il est chargé, s'il y met tout ce qu’il a dit, ce sera certainement très amusant, mais certes point fait pour calmer les esprits. Les caisses de retraite avec dépôt obligatoire, la colonisation, la direction des travaux réservés. (Vous ne comprendrez pas ceci, mais peu importe, je vous ennuierais si je vous expliquais Thiers et Piscatory sur toutes ces questions) tout cela, on a beau dire, est du socialisme. Si parce qu’il faut, à ce qu’on dit, faire quelque chose nous ferons des folies, nous sommes perdus. "
Les Copies valent mieux que les extraits, et n'ont pas besoin de commentaires.
M. Vitet est reparti. Les Lenormant me restent jusqu'à vendredi. J’ai eu hier aussi un ancien député conservateur, inconnu et sensé du même département que le duc de Noailles, et qui devait être nommé avec lui au mois de mai dernier s'ils avaient réussi. Les mêmes faits et les mêmes impressions viennent de toutes parts. Soyez tranquille ; je ne serai pas nommée au Conseil général. Adieu. Adieu. Adieu. Voilà votre lettre des 12 et 13. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 16 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 Heures
J'espère que vos crampes d'estomac n’auront pas eu de suite. De Brompton, j’allais y voir. N'hésitez jamais à envoyer chercher M. de Mussy. Votre rencontre avec Lord John me prouve que vous vous promenez à pied, comme il vous l’a recommandé. Comment s’appelle le nouveau médecin de Richmond que vous faites venir d'abord ?
Les Ministres n’ont nul droit de se plaindre de Lord Palmerston. Ils n'ont que ce qu’ils méritent. Avec des collègues, et des adversaires tels que ceux qu’il a, s’il était jeune et s’il avait plus de talent, il serait vraiment dangereux pour son pays, dans son audace sans scrupule et sans prévoyance il monterait avec les révolutionnaires, à l'assaut de la place, sauf à être jeté lui- même à l’écart d’un coup de pied, au moment où ils y entreraient. Comme il est arrivé à Thiers. Le bon sens anglais est présomptueux ; il admet l’esprit révolutionnaire à ses côtés se croyant sûr qu'il le mettra à la porte le jour où il le faudra. Je souhaite qu’il ait raison et je l'espère. Mais le jeu est périlleux. Et en tous cas quand le jour viendra de mettre l’esprit révolutionnaire à la porte, l’honneur n’en sera certainement pas aux collègues, ni aux adversaires actuels de Lord Palmerston, ni à aucun de ceux qui auront laissé entrer et grandir l'ennemi. Il faudra des hommes nouveaux à cette œuvre-là. J’ai confiance dans l'Angleterre. Ils s’y trouveront. Quant à ses colonies, je ne suis pas sûr du tout qu'elle les garde, s’il faut les défendre. Les grands efforts ne sont plus du goût de personne, même des grands gouvernements, et des grands peuples. Et les raisons ne manqueront pas pour s'en dispenser.
J’ai eu un jour à ce sujet une curieuse conversation avec M. Gladstone, très bon échantillon du bon esprit anglais actuel, plus prudent que grand, plus ingénieux que persévérant, et ayant assez de goût aux innovations, pour sortir d’embarras. Du reste, il serait puéril de le méconnaitre ; le monde est partout, en train de se transformer ; les bons principes resteront toujours les bons principes, et pas plus qu'autrefois on ne fera de l’ordre avec le désordre, et du gouvernement avec l’anarchie. Mais les éléments, les méthodes, les formes de l'ordre et du gouvernement ne seront plus les mêmes et l’ancien système colonial de l'Angleterre ne lui suffira pas plus que l’ancien système gouvernemental ne suffira au continent. Je me serais intéressé davantage au Duc de Leuchtenberg si sa femme l’avait accompagné à Madère. S'en allant seul, il m’a l’air d’un parvenu abandonné. On en devrait être plus touché, et ce que je vous dis est mal. Je vous dis ce qui est. Onze heures Voilà votre lettre qui me fait grand plaisir d’abord parce que vous êtes mieux, puis parce qu'elle est longue. Je vois que le Duc de Leuchtenberg vous a plu, et que l'Empereur lui a fait, pour son voyage, de beaux dehors. S'il n'aime pas beaucoup sa femme, c’est bien ; s’il l’aime, c'est triste. Adieu. Adieu. Continuez à être mieux. Adieu, dearest G.
Val-Richer, Vendredi 17 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
C’est certainement pas grave, et parce qu’il me connait, que Lord Nugent ne m'a pas accolé à Metternich, dans cette intrigue contre Lord Palmerston, " fostered by the criminals whe have been ejected from their own countries by revolutions. " Lord Nugent est un type de l’honnête et grossier badaud libéral. Je ne crois pas que ces meetings et ces discours troublent beaucoup Lord John. C’est une manière d’attirer ou de retenir dans le camp ministériel des radicaux toujours enclin à faire de l'opposition. Palmerston est un recruteur qui va dans des quartiers ou ses collègues ne vont point. Ces meetings ne peuvent déplaire qu'à ceux des Ministres qui ne veulent réellement pas de la politique de Palmerston et voudraient se défaire de sa personne. Mais Lord John n’est pas de ceux-là, moins unscrupulous que lord Palmerston, et plus retenu par la responsabilité de chef, mais, au fond, de son avis.
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer le Mémoire publié par M. de Lesseps sur sa mission de Rome. C'est assez curieux quoique très médiocre, et concluant contre lui. Sa conduite a été simplement le reflet des faiblesses de ses chefs de Paris ; faiblesses qui l’ont fait croire au triomphe des rouges. Il est justement puni ; mais d'autres devraient l'être comme lui. Les Lenormant sont partis ce matin fort peu légitimistes, mais bien engagés, et assez influents dans le parti catholique. La brouillerie de Thiers et de Montalembert, leur plaît et ils pousseront à ce qu’elle soit prise au sérieux. Ils reprochaient fort, à Montalembert de se laisser prendre par Thiers.
On me dit aussi ce que vous écrit Lady Holland, que Molé est désolé de cet incident et dit qu’il ne sait plus d’où peut venir le salut. Toutes les dissentions dans le parti modéré tourneront au profit du président, et du Statu quo jusqu'à l'approche des nouvelles élections. Et si le Statu quo va jusque-là, les élections seront perdues, et Dieu sait quoi après. La réflexion me plonge toujours dans le noir ; il n’y a que l’instinct qui m’en défende. M. Fould a quelque esprit à force d’égoïsme, et point de jugement à force de pusillanimité. Il est bon à vous donner des nouvelles de Paris. Il les reçoit plutôt que personne. Pas bon à autre chose, et ne lui dîtes que ce que vous voulez qu'on redise. Vous avez raison de le trouver bien laid. Lui et Crémieux sont les plus bassement laids des juifs, par conséquent des hommes.
Samedi 7 heures
Je me lève. Le soleil est superbe. Si je n’aimais pas mieux vous écrire, j'irais me promener. Dites-moi pourquoi, ou pour qui Mad de Caraman reste à Richmond. Est-ce pour lord Lansdowne ? Tirez-vous d’elle dans le tête-à-tête un peu de conversation moins arrangée et moins complimenteuse ? Voici une lettre que je reçois d'une Ecossaise, Miss Stirling, excellente personne, que je connais depuis longtemps, très bonne musicienne, par exception ce qui fait qu’elle s’intéresse beaucoup à Chopin qui lui a donné des leçons. Chopin est réellement un habile artiste, parfaitement étranger à la politique et fort malade. Pouvez-vous quelque chose pour la charité qu’il demande ? Je ne répondrai que quand vous m'aurez répondu. Après le départ des Lenormant j’ai passé hier ma journée seul, sauf quatre visites pourtant. Mais enfin, je n’avais personne chez moi, j'ai dîné et je me suis promenée sans hôtes. Cela m'a plu. La liberté de la solitude me plaît. Il n’y a que l’intimité qui vaille mieux. Le procès de Madame Lenormant pour les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier va recommencer. Girardin et Madame Colet en appellent. Derrière les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, il y a pour Girardin un autre intérêt. M. de Châteaubriand a écrit dans ses Mémoires d'Outretombe, un livre (le 10e) entièrement consacré à Mad. Récamier. Le manuscrit de ce livre daté et signé de la main de M. de Châteaubriand, a été donné par lui à Mad. Récamier pour qu’elle en fit ce qui lui plairait et il a mis en même temps dans son testament que toute autre copie de ce 10e livre n’avait aucune valeur, et ne pourrait être public. Mad. Lenormant à l’exemplaire donné par M. de Châteaubriand à Mad. Récamier et n'en veut, comme de raison, aucune publication. Girardin s'est procuré, par un secrétaire de M. de Châteaubriand des fragments, brouillon en copie de ce Livre. Il paye ce secrétaire pour qu'il étende les fragments avec ses souvenirs ou de toute autre manière, et il tient beaucoup à publier ce 10e livre, sans lequel les Mémoires d’outre tombe de son journal seraient incomplets. Le jugement qui vient d'être rendu sur les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, lui rend cela impossible s'il subsiste. Voilà pourquoi il appelle Mad. Lenormant espère bien gagner son procès en cour d'appel. Elle est très mécontente de la façon dont Chaix d’Estange a planté pour elle. Par ménagement pour Girardin, Mad. Colet, M. Cousin le chansonnier Béranger &, il n’a pas fait usage de plusieurs moyens et pièces curieuses qu’elle lui avait remis. Mad. Colet est une drôle de personne. Naguères fort belle, grande forte une quasi Corinne provençale. Elle a été au mieux avec M. Cousin on prétend même qu’il y a entre eux deux petits cousins. Elle a donné un jour un soufflet à M. Alphonse Karr (l’auteur des Guêpes) parce qu'il avait dit quelque chose dans ses Guêpes sur M. Cousin et sur elle. Il n'y a pas plus à plaisanter avec elle qu'avec M. Pierre Bonaparte. Il y a dans le 10e livre de M. de Châteaubriand des lettres insérées de beaucoup de personnes à Mad. Récamier ; entr’autres quinze lettres de Mad. de Staël. Bien des gens désirent donc que ce livre ne soit pas publié. Adieu jusqu’à la poste. Adieu, Adieu.
Onze heures
Pour Dieu, ne continuez pas à être souffrante. Et dites-moi ce que vous aura dit M. de Mussy. Adieu. Adieu. Je vous parlerai demain de Rome. Adieu, dearest. G.
Val-Richer, Dimanche 19 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Vous trouvez la conduite du Pape insensée. Peut-être. Mais tenez pour certain que, s’il suit les conseils de MM. Od. Barrot et de Tocqueville, il se tue infailliblement, lui et la Papauté. C'est là ce qu'on lui demande, car on lui demande de donner à Rome une Constitution, ou l’apparence d’une Constitution. Or en fait de Constitution, aujourd’hui, il n’y a plus de mensonge possible ; l’apparence, c’est bientôt la réalité, ou l’anarchie. Une constitution à Rome, c’est le Pape mort et Mazzini ressuscité. Les amis de Mazzini savaient très bien ce qu’ils faisaient quand ils ont assassiné Rossi. Je ne sais pas si Rossi serait devenu un grand homme, mais il était en train de le devenir. Lui aussi avant d’être à Rome Ambassadeur et Ministre, il avait cru et aspiré, là à une Constitution. Même pendant son Ambassade, j’ai souvent retrouvé dans ses lettres d'abord cette espérance, puis un désir sans espérance, puis un regret sans désir. Puis à la fin de son Ambassade, et surtout quand il est devenu Ministre du Pape, je suis convaincu qu'il ne croyait plus et qu’il ne tendait plus à une constitution romaine. Il voulait sérieusement avant tout, le maintien de la Papauté, la dernière grande chose de l'Italie comme il le disait à Grégoire XVI, et la chose nécessaire à l’Europe. Il avait compris que la Papauté et la constitution, le Pape coupé en deux, infaillible comme souverain spirituel, responsable et discuté tout le jour comme souverain temporel, cela était impossible. Rossi se détournait de cette chimère, et se mettait avec ardeur à une autre œuvre, à la reforme réelle, efficace, de la détestable administration romaine de ses abus de justice, de finances de police, de gouvernement intérieur subalterne, de petit et inintelligent népotisme. Il voulait donner, dans toutes ces affaires-là, satisfaction aux intérêts quotidiens de la population romaine, et une part de pouvoir, de pouvoir décisif à la portion, un peu riche et considérable, et laïque de cette population. Il y a deux choses impossibles aujourd’hui à Rome comme ailleurs ; l’une, qu’on prenne de l'argent à tort et à travers dans les poches du public qu’on dépense à tort et à travers l’argent pris dans les poches du public, qu'on juge à tort, et à travers les procès du public, qu’on ne paye pas ses dettes au public qu’il n’y ait point de sureté sur les routes, point de réverbères dans les rues, des imbéciles et des fainéants dans les fonctions publiques ; l'autre, que toutes ces affaires-là, qui sont les affaires des familles qui sont le peuple, toutes les affaires civiles de la population laïque, soient, en réalité et en définitive entre les mains et sous l'influence des ecclésiastiques ; je dirais des prêtres si je voulais reproduire le sentiment qui s’attache aujourd’hui à ce mot, à cause de ce fait. Le Prince de Metternich dit, et m'a dit que le fait n'existait plus, que depuis 1831 l'administration civile Romaine avait été sécularisée et était entre les mains des laïques. M. de Metternich se trompe ; certains changements, il est vrai avaient été faits dans ce sens ; changements vains, pures apparences nominales et dilatoires. Le pouvoir efficace, définitif, dans l'administration civile comme ailleurs était toujours entre les mains du Clergé ; et les abus choquants, l’inertie insurmontable, l'incapacité ridicule de cette administration subsistaient toujours. Ce sont là les deux choses que Rossi voulait changer. Il voulait que l'administration civile des Etats Romains devînt réellement bonne, et que pour devenir bonne ; elle devînt essentiellement laïque. C’est dans les limites et vers ce but que de mon temps, je l’ai constamment ramené, et qu’il avait fini lui-même par se diriger positivement. Il croyait, et je croyais aussi que cela se pouvait faire en laissant intacte, non seulement la souveraineté spirituelle du Pape, mais sa souveraineté temporelle et en n'enlevant point, non seulement l’autorité souveraine dans l’Eglise mais le gouvernement politique de l'Eglise et des Etats Romains, au Pape et au grand régiment ecclésiastique, Cardinaux et autres, dont il est et dont il doit être entouré. Avais-je raison de croire cela possible ? Rossi a -t-il eu raison de l’entreprendre ? Il y a de quoi douter et discuter. La manie des constitutions, c’est-à-dire la manie d'appliquer partout, à tort et à travers dans les plus petits pays comme dans les plus grands, les plus grosses, et plus fortes machines de gouvernement, cette manie stupide est devenue bien générale et bien intraitable. Ce n’est plus une question de bon gouvernement et de garantie pour les droits ou les intérêts réels des citoyens ; c'est une question de bruit et de vanité. Il faut que chaque état soit une salle de spectacle où tout le peuple soit tour à tour acteur ou spectateur et dont le plus souvent possible, le monde entier entende parler. Il se peut que la population Romaine, la population bruyante, et remuante qui entraine ou annule le reste, veuille cela absolument, et que la meilleure et la plus laïque administration civile ne suffise pas à la contenter. Cependant je ne le crois pas. Je crois qu'avec l'adhésion claire et l'appui concerté des grands gouvernements européens, le Pape pourrait faire prévaloir cette politique là. Je crois en tout cas que c’est la seule à tenter, car c’est la seule qui ait des chances de succès. Hors de là, on alternera entre Mazzini et les petits abbés, deux pouvoirs également impossibles aujourd'hui et qui, l'un et l'autre, mènent Rome à sa ruine, et l’Europe à un perpétuel embarras. au sujet de Rome.
En voilà bien long, si long que je n'ai pas le temps de vous parler d’autre chose. Soyez tranquille ; je vous répète que je ne serai point de Conseil général. J'ai fait ce qu’il fallait pour cela. L’élection se fait aujourd’hui. C’est un conservateur de mes voisins M. Thiron, qui sera nommé. Adieu, Adieu. Adieu. Je vais faire ma toilette
Onze heures
Votre lettre est très intéressante, ne vous occupez pas de le sœur de Chopin. Elle a eu un passeport et est arrivée à Paris, une permission de six semaines. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mardi 21 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Votre dernière lettre est datée du 18 Août, juste un mois après mon départ. C'est déjà bien long. Chaque jour plus long. Vous me dîtes : " Je veux de la sécurité à Paris. Qui me répond que j'en aurai ? " J'y regarde bien. J’ai toutes les raisons possibles d'y bien regarder, vous la première. Plus j’y regarde, plus je crois à la sécurité matérielle dans Paris. Et je ne vois personne qui n’y croie comme moi. Les coquins sont aussi abattus dans leur cœur que décriés dans le public. Non pas certes qu’ils renoncent. Mais dans l'état actuel, ils ne se croient aucune chance de succès. Ils attendront un autre état. Viendra- t-il un autre état ? Ceci, je le crois, et tout le monde, le croit. Il n’y a donc pas de sécurité politique. L'avenir amènera des évènements. Lesquels et quand ? Personne ne le sait. Tout ce qu'on peut dire, tout ce que disent tous les hommes sensés, c’est que dans trois ans, si d'ici là on ne fait rien, la réélection du Président et de l'assemblée fera une révolution, bonne ou mauvaise plus probablement mauvaise. Et probablement avant ce terme, aux approches de ce terme, pour éviter cette révolution inconnue, les pouvoirs aujourd’hui établis, et certainement, les plus forts, l'Assemblée, le Président, le Général Changarnier feront quelque chose. Personne ne sait quoi, ni quand. Tout le monde croit à quelque chose et croit que quelque chose sera nécessaire. Je reviens donc à mon point de départ. De la sécurité matérielle, oui. Pas de troubles dans la rue. De la sécurité politique, pas d’évènements graves. Personne ne peut vous promettre cela. La question se réduit donc à ceci : quel genre et quel degré de sécurité vous faut-il ?
M. de Metternich a raison ; l'exécution du prêtre à Bologne est stupide. C’est du bois sur un feu qui s'éteint. Les gouvernements vainqueurs ne savent pas le mal qu’ils se préparent quand ils redonnent un bon thème aux mauvaises passions vaincues. Ce que veulent surtout les révolutionnaires, c’est un fait, un acte, un nom-propre, de quoi parler. Ils excellent ensuite à commenter et à répandre.
Je ne comprends pas Brünnow à votre égard. Non seulement de la négligence, mais de la malveillance, c’est trop bête pour un homme même pour un subalterne d’esprit. Il faut que je ne sais quand, je ne sais comment, vous l’ayez blessé dans quelque secret repli de son cœur subalterne. Vous pouvez avoir le Génie de l'offense ; quelque fois le voulant bien, quelquefois sans le savoir. Peu importe du reste cette occasion-ci. M. de Brünnow n'apprendra rien à Lord Palmerston sur l’amitié que vous lui portez.
Je regrette bien Lord Beauvale pour vous. C'est évidemment la conversation qui vous plaît le plus. Pourquoi les Ellice ne veulent-ils plus venir à Paris ? Est-ce que le père et la mère ont peur ? Avez-vous des nouvelles de Bav. Ellice ? Est-il en Ecosse ? J’ai vu arriver hier un petit anglais, le second fils de Sir John Boileau. Il vient passer huit jours au Val Richer. L’aîné est aux Etats Unis. Milnes veut venir me voir ici. Bon homme et fidèle, malgré la promiscuité de son amitié.
Onze heures
J'ai beau faire ; j’attends la poste le mardi comme les autres jours. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 22 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Je n’ai aucune nouvelle à vous envoyer. Vitet, de retour à Paris, m’écrit : " Paris est plus mort que jamais. Il n'y reste absolument personne. La politique est partie pour les Conseils généraux ; je ne crois pas qu’elle y fasse grand bruit. C’est un temps de sommeil. On essaiera quelques petites parodies d’Etats provinciaux ; mais ce seront des bluettes. Il n'y a pour le quart d'heure, de sérieux nulle part. " Il en sera ainsi jusqu'au retour de l’assemblée, c’est-à-dire jusqu'aux premiers jours d'octobre. Alors commencera une crise ministérielle. L’assemblée voudra faire, un ministère plus à son image. Elle y réussira probablement. Mais l'image sera pâle, et aura peur d'elle-même en se regardant. En sorte que l'opposition y gagnera plus que la réaction ; et on entrera, dans une série d’oscillations, et de combinaisons batardes où la République modérée et la Monarchie honteuse s’useront, l’une contre l'autre, sans que ni l’une ni l’autre fasse rien de sérieux. Mon instinct est de plus en plus qu’on se traînera, tout le monde jusqu’au bord du fossé. Sautera- t-on alors, ou tombera-t-on au fond ? Je ne sais vraiment pas. Je regrette que vous ne connaissiez pas M. Vitet. C’est un des esprits les plus justes, les plus fins, les plus agréables et aussi les plus fermés, que nous ayons aujourd'hui. Et tout-à-fait de bonne compagnie, malgré un peu trop d’insouciance et de laisser aller. Voici une nouvelle. J’ai fait vendre à Paris ma voiture, mon coupé bleu. On l’a revu dans les rues. Cela a fait un petit bruit.
Je trouve dans l'Opinion publique, journal légitimiste : " Ce matin à midi et demi, un élégant et massif coupé de ville, bleu de roi, cheminait à petits pas sur la chaussée du boulevard des Capucines. La curiosité nous ayant poussé vers cet équipage que nous avions cru reconnaître, nous nous sommes en effet assurés que c'était bien comme nous l'avions jugé à distance, la voiture de M. Guizot, son écusson y est intact, avec sa devise : Recta omnium brevissima, et le cordon rouge en sautoir autour de l’écu. Pourquoi cette voiture errait-elle autour de l’hôtel qu’elle a hanté si longtemps ? Nous ne savons." Si j’avais été à Paris, j'aurais fait dire dans quelque journal, le lendemain, que ma voiture roulait parce que je l’avais vendue. Vous avez bien raison, l'immobilité et le silence me servent parfaitement.
En fait de folie, je n'en connais point de supérieure à celle de la Chambre des représentants de Turin. Elle ne peut pas faire la guerre ; elle le dit elle-même, et elle ne veut pas faire la paix. Point de dévouement à la lutte et point de résignation à la défaite ; je ne me souviens pas que le monde ait jamais vu cela. Il est probable que la nécessité finira par triompher, même de la folie. Mais il y a là un symptôme bien inquiétant pour l’Autriche, l'impuissance ne guérira point l'Italie de la rage. Le monde est plein aujourd’hui de problèmes insolubles. Insolubles pour nous, qui sommes si impatients dans une vie si courte. Le bon Dieu en trouvera bien la solution.
Vous ne me manquez pas plus que je ne croyais, mais bien, bien autant. Je parle, j'écoute, je cause sans rien dire et sans rien entendre qui mérite que j'ouvre la bouche ou les oreilles. La surface de la vie assez pleine, le fond, tout-à-fait vide. Je suis entouré d'affection, de dévouement, de soins, de respect. Il me manque l’égalité et l’intimité. Et combien il manque encore à notre intimité même quand elle est là ! La vie reste toujours bien imparfaite, quoi qu’elle aie de quoi ne pas l’être. Je m’y soumets mais je ne m'en console pas.
Onze heures
Pas de lettre. Pourquoi ? Et je l’attends plus impatiemment le mercredi que tout autre jour. Il a fait beau. Ce n’est pas la mer. Je suis très contrarié. Je me sers d’un pauvre mot. Adieu. Adieu. Adieu. Ce sera bien long d’ici à demain. Adieu. Guizot.
Val-Richer, Mercredi 22 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Si j’avais eu une lettre ce matin, je ne vous écrirais pas à cette heure-ci. Mais je ne puis pas tenir loin de vous. Il faut que je me rapproche de vous, n'importe comment. Je n’ai rien du tout à vous dire. Je ne comprends pas pourquoi, je n'ai pas de lettre, si elle a été mise trop tard à la poste, lavez bien la tête à Jean, je vous prie. Si c’est la faute de l’affranchissement, n'affranchissez plus du tout. Si vous étiez réellement malade, vous m'auriez fait écrire par quelqu'un. Je compte sur la bonne Princesse Crazalcovitch. Qu'il y a loin encore d’ici à demain ! Je viens de lire les journaux. Je n’y trouve rien à commenter. Il se fait, si je ne me trompe, un travail de décomposition, assez important dans le parti légitimiste. Le corps du parti se révolte contre la guerre, et se plaint de n'avoir pas de tête. Si la République dure quelque temps, ce travail portera ses fruits quelque soit le prétendant appelé à en profiter. Car je ne regarde point comme impossible que le parti légitimiste se décompose un jour, au profit de la branche cadette, comme le parti des Stuart s'est décomposé en Angleterre contre Jacques 2 donnant à la révolution de 1688 la plupart des Torys et ne laissant aux Stuart que les Jacobites. Mais ce jour ne viendra en France que s’il est encore bien loin car le parti légitimiste est encore bien loin de comprendre et la situation du pays et sa propre situation. Il lui faut, il faut à tout le monde en France de bien autres leçons. Cela fait trembler à dire. Quelles leçons nous ont manqué ? Je me dégoûte un peu d'ailleurs de chercher, dans les destinées de l'Angleterre, le secret de celles de la France. Peut-être n’est-il point du tout là. J'essaie de vous parler d’autre chose. Je ne réussis pas à penser à autre chose. Je vais me promener.
Onze heures
Voilà le Duc de Broglie et son fils. Et ce qui vaut mille fois mieux, vos deux lettres. Merci mille fois. Je chercherai d’où vient la faute du retard. Je ne veux aujourd’hui que la joie de l’arrivée. Mais je n'ai point de temps pour écrire. Adieu. Adieu, dearest. Mille fois. G.
Val-Richer, Vendredi 24 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc les affaires de Hongrie terminées. J'en suis fort aise. Terminer pour la part Russe, non pour la part Autrichienne qui commence, et qui sera la plus difficile. L'affaire finit très bien pour l'Empereur. C'est lui qui a vaincu. C’est à lui que l’insurrection se soumet. Après avoir usé de sa force contre l’insurrection, usera-t-il de son influence pour la transaction, pour qu’elle soit sensée, et équitable, seule façon qu’elle soit durable ? Je ne sais pas du tout ce que la transaction doit être ; je ne connais pas assez bien les faits. Mais je suis sûr qu’il en faut une. Si la transaction était, comme la victoire, l'œuvre de l'Empereur, si la Hongrie lui devait l’une comme l’Autriche lui doit l'autre, ce serait grand et utile très impérial et très Russe. Cette fin du drame mérite qu'on reste assis pour y regarder. La satisfaction anglaise de n'être pour rien dans l'affaire de Rome ni dans l'affaire de Hongrie est un peu risible. L’inaction est quelquefois la bonne et la seule bonne politique. Mais quand d'autres ont fait là où soi-même on n'a rien fait, on peut être content, mais c’est un contentement dont en ferait. mieux de ne pas parler car il y a toujours, au fond, un peu de dépit que les paroles découvrent. En tout, il me semble qu'avec tout le monde, vous comprise, Lord & Lady Palmerston se remuent et parlent beaucoup. Cela n'est pas très digne, et cela n'indique pas des gens très satisfaits, ni très assurés dans leur situation.
3 heures et demie
Encore du monde. M. Janvier m’arrive pour 24 heures. Amusant ; rien de plus. Confirmant tout ce que nous pensons. Pas d'Empire. On n'en veut plus parce que cela aurait un air définitif sans l'être. On aime mieux le provisoire avoué. Peu m'importe que M. de Metternich voie dans ma lettre sur Rome qu'il s'est trompé une fois. Je ne serai même pas fâché qu’il voie que je le pense. Si c’est là la raison qui vous empêche de lui montrer ma lettre je suis d’avis que vous la lui montriez. Je serai charmé que Madame de Caraman fasse votre portrait, à condition qu’il sera pour moi. Elle y réussira peut-être mieux que Madame D. [?]. Essayez, je vous prie. Décidément il paraît que les voyages ne réussissent pas au président. Ses amis lui conseillent de n'en plus faire. Une bonne réception, dans une ville ne compense pas une mauvaise réception dans une autre. Il ne lui vaut rien qu'on le voie ainsi maltraité alternativement. Et quoi qu’il ne fasse pas de fautes, il ne fait pas non plus de conquêtes.
Samedi 25 onze heures
Pas de lettre ce matin. Evidemment on les trouve très intéressantes quelque part. Je ne suppose pas au rebond d'autre cause. C'est bien ennuyeux. Ma journée est gâtée quand ma lettre me manque. Adieu. Adieu. Adieu. Vous êtes bien heureuse. Vous n’avez pas encore eu cet ennui. Adieu, dearest. G.
Val-Richer, Dimanche 26 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Val Richer 7 heures et demie
Je n'ai point été nommé au Conseil Général. C'est le voisin que je vous ai indiqué. Malgré ce que j'ai dit on m’a encore donné 300 voix. Ma commune et deux communes voisines n’ont pas voulu aller voter du tout, plutôt que de ne pas voter pour moi. Bien des poltrons ont encore peur de moi. Bien des esprits faibles sont encore incertains. Dans les premiers temps de la révolution, les Républicains de toute nuance, et plus récemment mes anciens adversaires politiques, ont ardemment travaillé contre moi, dans tout le pays. Journaux, petits pamphlets caricatures, lettres particulières, mensonges spécieux ou effrontés, odieux ou stupides, tout a été mis en œuvre et non sans quelque succès dans quelques parties de cette masse qui n’a point d’yeux pour voir, ni de temps pour regarder. Il reste, et il restera longtemps encore des traces de ce travail. Mais évidemment le vent souffle aujourd’hui de mon côté. Le courage revient à mes amis. La faveur des indifférents me revient. On fait de tout côté, honte à ceux qui ont menti ou qui ont cru aux mensonges. Ma présence et mon immobilité plaisent. Je n'ai qu'à continuer, et je continuerai certainement. Je suis sur le flot qui monte. S’il monte assez haut pour me relever, à la bonne heure. Je ne suis point pressé et je ne me contenterai pas à bon marché.
Ce qui me contentera parfaitement dans trois heures, j’espère, c’est votre lettre vos deux lettres. Comment se fait-il que ces irrégularités aient attendu jusqu'à présent pour se produire et qu’elles se renouvèlent à si peu de jours de distance ? Si on lit nos lettres, et si ceux qui les lisent ont un peu d’esprit, ils doivent voir bien clairement deux choses, que nous ne nous gênons pas, et que nous n’avons rien à cacher. Ce n’est vraiment pas la peine de nous causer le très vif déplaisir d’un retard.
J’ai reçu hier un mot de Dalmatie qui m’a annoncé sa visite pour cette semaine. On me dit que M. de Corcelle est très malade, et qu’il pourrait bien mourir à Castellamare. Ce serait une perte pour le Pape dont il a épousé avec passion la cause. On me dit aussi qu’il y aura, un peu plutôt ou un peu plus tard nouvelle explosion en Piémont, au moment où le Roi sera obligé de dissoudre la Chambre actuelle. La Suisse redevient le foyer du volcan, et c’est sur le Piémont que la flamme se dirige. Suisse et Piémont seront envahis s’ils éclatent, et la République Française fera comme les autres, on laissera faire les autres. Si les gouvernements sensés, sont assez sensés, leur chance est bonne. Les fous sont faibles et bêtes. Je crains que la brouillerie qui a éclaté entre Narvaez et Mon ne se raccommode pas cette fois. Ce serait bien dommage. Adieu jusqu'à la poste. Adieu, adieu. Je vais faire ma toilette.
Onze heures
Voilà seulement la lettre de jeudi 23. Je devrais avoir aussi celle d'avant-hier vendredi. Est-ce que les lettres mettraient désormais trois jours à m’arriver ? Je ne puis pas le croire. Il faut qu’il y ait quelque méprise, quelque retard dans l’ajustement de Richmond à Londres, et de Londres à Paris. Vous y prenez surement grand soin, dearest. Pourtant, j'ai bien envie que nous retrouvions notre exactitude accoutumée. Jusqu'ici cela marchait si bien ! Adieu, adieu. Nous verrons si j'aurai deux lettres demain, ou seulement celle de Vendredi. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 27 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je vois que le succès de l'Empereur préoccupe beaucoup les Anglais. Reeve m'écrit : " Aujourd’hui que les guerres de Hongrie, de Bade et de Rome sont finies, et que les armées dominent partout on se demande quel sera le rôle de la politique conquérante. Il me revient des bruits de rapports plus intimes, entre la Russie, l’Autriche et le président de la République représenté par le général Lamoricière ; rapports destinés soit à étouffer les foyers révolutionnaires en Suisse et en Allemagne soit à un certain remaniement des territoires menaçant pour les petits états qui sont peu capables de se défendre et de maintenir l’ordre chez eux. D'après ces bruits, il s’agirait même de mesures prononcées contre la Suisse qui présente en effet de grands dangers. Quoiqu’il en soit, cette politique toute Russe, laisserait tout-à-fait de côté l’Angleterre. Que faut-il penser de tout cela ? Il est certain que nous n'avons rien fait pour nous attirer la confiance de l’Europe ; et personnellement il n'est pas impossible que les yeux de Louis Napoléon se tournent du côté de St Pétersbourg. Mais le sol de l’Europe est peu affermi pour tenter de pareilles expériences."
Vous voyez qu’ils prennent bien vite l'alarme. Les hommes sont toujours, beaucoup plus prompts qu’il ne faut à l'espérance et à la crainte. Que d'agitations perdues? Ici, dans le gros du public on n'a pas l’esprit si éveillé. Les idées sont plus courtes, et les sentiments plus vagues. On n’était pas sans quelque intérêt de routine pour les Hongrois. Cependant votre succès ne déplait pas ; c’est un gage d’ordre et de paix. Cependant on n’est pas sans quelque inquiétude de votre puissance. Aurez-vous envie de vous mêler d'autres affaires ? On espère que non ; mais on n’est pas sûr ; si votre armée rentre tranquillement, en Pologne, vous serez presque populaires, comme puissants et comme modérés. Le mouvement de reprise des Affaires commerciales continue. Rouen, Le Havre, Lisieux, Elbeuf, Lyon sont assez contents. Paris souffre toujours, et les villes de province n’en sont pas fâchés. Il y a vraiment un sentiment de rancune profonde contre Paris. Mais de rancune plutôt que d'émancipation. Il me parait impossible que ce soit par bêtise que Lord & Lady Palmerston prennent si publiquement le deuil de la Hongrie. Il y a là un parti pris, un parti politique. Ils croient qu’il leur vaut mieux d'être populaires parmi les vaincus qu'agréables aux vainqueurs. Et puis la routine, les engagements, les relations personnelles. En tout cas, je conviens que fermer sa porte ce jour-là, c’est bien fort.
Mardi 20 août. 9 heures
Pour la première fois, je me souviens aujourd’hui que je n'aurai rien et j'attends la poste avec indifférence. Je vais dîner chez un de mes amis à six lieues d’ici. Il y aura beaucoup de monde ; un seul homme notable de la société de Lisieux est exclu, le gendre de M. Duvergier de Hauranne M. Target. Il s'est mal conduit envers moi, et j'ai déclaré en arrivant, que je ne le verrais pas. Il me fallait un bouc émissaire, un seul, pour les lâchetés et les trahisons. J’ai pris celui-là à l'approbation générale du pays. Je suis le plus amnistiant des hommes ; si peu d’entre eux peuvent me blesser ! Mais il y a un sentiment public de justice et de convenance auquel il faut donner une certaine mesure de satisfaction.
Onze heures
Adieu. Adieu. Je n'ai que cela à vous dire, et j’aimerais mieux vous le dire de près. Adieu. G. J’ai mes deux lettres aujourd’hui. Certainement je ferai comme vous ; j'irai les demander et me plaindre si cette irrégularité se renouvelle. Vous avez raison sur Milner. C’est un bon homme et intelligent. Cela m'amuse toujours de voir comme nous nous rencontrons, toujours dans le même avis. Je vous disais cela de Milnes, il y a quelques jours. Adieu, adieu, dearest. Je suis charmé de mes deux lettres. Il pleut. Je ne me promènerai pas autant qu’hier. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 29 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Je me lève tard. Je suis rentré tard hier. 37 personnes à dîner. On s'est mis à table à 6 heures et demie. Sorti de table à 8 et demie. En voiture à 9 heures un quart. 6 lieues à faire. Par le plus beau temps, et la plus belle lune du monde. J’étais un peu fatigué de m'être tenu trois heures sur mes jambes à me promener dans un assez joli parc montant et descendant, sur le flanc d’un côté. J’ai très bien dormi. Je ne pouvais refuser cette invitation-là. C'est le manufacturier le plus considérable de Lisieux, et qui m'a été le plus hautement fidèle. Je refuse toutes les invitations ordinaires. Il y avait là deux membres de l'Assemblée législative ; modérés parmi les modérés, mais à peu près convaincus que le Cabinet Dufaure ne tiendra pas quand l’Assemblée reviendra. Passy, Lacrosse et Tracy à peu près certainement. Dufaure et Tocqueville probablement. Pour mon compte, je n'y crois pas, et je les en ai plutôt détournés ; du moins pour Dufaure et Tocqueville. Si l’Assemblée avait de quoi les remplacer par un cabinet décidé, et capable qui eût vraiment envie de gouverner, et qui pût, en tenant toujours la majorité unie, la conduire fermement à son but, à la bonne heure. Mais cela n'est pas ; Molé et Thiers, les seuls plus capables veulent et ne veulent pas du pouvoir. Et s'ils le prenaient très probablement la majorité se diviserait au lieu d'avancer. Je suis pour qu’on redoute, et améliore par degrés le Cabinet actuel, sans toucher aux grosses pièces.
La fin de l'affaire de Hongrie tue la politique extérieure. On n'y pense plus. Rome seule embarrasse encore. On voudrait bien en sortir vite, et on n’ose pas trop si on n’y fait pas prévaloir, un peu de politique libérale. On finira par oser et par s’en aller quand même si le Pape ou son monde continue à résister. Le gouvernement actuel n’est pas, en état de pratiquer à Rome le bonne politique. Il ne la sait pas, et s’il la savait, il n’oserait pas l'avouer. Et pour la pratiquer avec succès, la première condition c’est de l'avouer très haut, et d’en faire une politique de l’Europe envers Rome ; politique adaptée, conseillée, soutenue et payée à Rome par les Puissances catholiques. Un Budget du Pape, comme chef de l'Eglise catholique, réglé et alimente de concert par les Puissances catholiques est le seul moyen d'assurer le succès de cette politique. Il faut que le Pape puisse vivre comme chef de l’église catholique, et en soutenir le grand état-major dont il est entouré sans être obligé de pressurer, par tous les abus imaginables, le petit pays dont il est le souverain temporel. Les Papes d’autrefois vivaient avec les revenus très gros qu’ils tiraient par toutes sortes de voies, les unes reconnues, les autres contestées, des états catholiques. Aujourd’hui, ils ne retirent plus rien, ou presque plus rien, du dehors ; et on veut qu’ils restent vraiment Papes, qu'ils gardent, et qu’ils soutiennent tous ces cardinaux, tout ce clergé, tout ce peuple d'ecclésiastiques qui est le cortège et l’armée de la Papauté ; et il faut que les petits états Romains suffisent à tout cela. C'est impossible. Cette fourmilière de prêtres ne peut pas vivre aux dépens de ce coin de terre sans un irrémédiable déluge d'abus. Que la Papauté soit épousée et soutenue par toute le catholicité ; et le Pape pourra laisser la population des états Romains faire elle-même ses affaires locales les discuter et les régler dans les communes dans les Provinces, sans que la souveraineté temporelle et spirituelle du Pape lui-même soit entamée, tant qu’on n’entrera pas ouvertement, et en disant pourquoi, dans cette voie, on s'embourbera de plus en plus dans les embarras et les complications dont on ne sait comment sortir.
Onze heures
J’ai été interrompu par la visite d’un ancien député conservateur, M. Leprevost. On m’arrive quelques fois à 9 heures du matin, quand on a couché la veille à Lisieux. Vous voyez que Rome est une de mes questions favorites. Je croyais avoir trouvé et commencé là quelque chose qui pouvait réussir, et qui valait la peine qu’on le fit réussir. Votre lettre de Dimanche et lundi arrive, et j’ai ma toilette à faire. Adieu. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 30 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collaredo a bien fait de s'excuser de la soirée de Lady Palmerston parce qu’il dinait chez vous. Bonne réponse au billet de Lady Palmerston à Koller pour le Mercredi. Je persiste dans mon dire ; tout cela n’est pour Lord Palmerston qu’une affaire de situation et de tactique, pour son pays et pour lui-même. Il veut pour l’Angleterre, la popularité auprès des radicaux Européens, et pour lui-même la popularité auprès des radicaux anglais. Cela obtenu il n’est pas aussi fâché qu’il en a l’air des victoires anti radicales. Encore une fois ce serait trop bête. Autre motif. Il ne veut point d'influence prépondérante, point de grandeur croissante sur le continent. Les radicaux sont bons à empêcher cela. Du trouble, de la faiblesse de l’anarchie à Paris et à Vienne, et à Rome, et à Naples, cela est bon. C’est dommage qu’il n’y en ait pas un peu à St Pétersbourg. On appelle cela de la politique. On n'a pas tout à fait tort. Il en faut bien un peu de celle-là L’erreur, c’est de lui faire une part beaucoup trop grande dans des temps qui en appellent une autre. Le Machiavélisme est une routine des esprits de second ordre. Ceux du premier ne la dédaignent pas, mais la mettent à sa place et savent en sortir.
Que dites-vous du discours de Radowitz à Bertin et de l'effet qu’il a produit, même sur les radicaux ? Je voudrais le lire dans un journal allemand. Je n'ai vu que l'extrait donné dans Galignani. La Prusse marchera toujours à son but. Il y a là vraiment une passion nationale qui se servira de tout pour se satisfaire du Roi, des démagogues, des émeutes, de l’armée, et que tout le monde dans le pays servira, chacun à sa façon et à son tour, parce que tout le monde, la partage. Nation d’ambitieux, qui veut être l'Allemagne. Il faut que l’Europe trouve moyen de résoudre cette question-là, car elle ne la supprimera pas. Lord Beauvale avait raison de croire à une dépêche de Lord Palmerston in extremis de la Hongrie, et je vois que le Prince de Schwartzemberg a bien répondu. Je sais qu'au Journal des Débats d'avoir répété ce petit article de la Gazette d’Augsbourg. Que faites-vous de Lady Alice Peel ? J'espère qu'elle n’est plus souffrante. Demandez-lui, je vous prie de ne pas m'oublier. J’y ai quelque droit, car je pense souvent à elle. Non seulement à cause de vous mais à cause d'elle-même. Il y a de l’inconnu en elle, quelque chose qui aurait pu se développer beaucoup. Et puis elle change d’amis moins souvent que de cuisiniers. Que devient votre portrait par Mad. de Caraman ? Les petites questions après les grandes. Adieu, adieu jusqu'à la poste.
10 heures 3/4
J'attends encore. Voilà mon ami Mon brouillé avec Narvaez et Narvaez malade. J’en suis bien fâché. Je voudrais que l’Espagne restât longtemps comme elle est. Voilà votre lettre. Fort exactement depuis quatre jours. Continuez, je vous prie, de les donner à une heure. Adieu, adieu. Je n’ai rien de Paris que les journaux. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 30 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Cinq heures
Dalmatie est ici. Toujours très fidèle, Pensant et parlant comme les autres. Plus prononcé seulement qu'aucun autre. Très décidé contre Dufaure et affirmant qu’il sera si vivement attaqué au retour de l'Assemblée, qu’il ne pourra pas tenir. On ne lui pardonne pas de laisser partout en place les hommes qui laissent pénétrer partout le Socialisme. On voudrait remettre Léon Faucher à l'Intérieur. Dalmatie ne croit ni à Molé, ni à Thiers, mais à des nouveaux venus de seconde et troisième ligne. Il dit que Molé est bien vieilli, et ne supporterait pas le poids du pouvoir. Que Thiers est bien hésitant et en a bien peur. Il a lui-même une énorme peur de ce qu’il a vu dans le midi, et des progrès du socialisme dans les populations inférieures. Il dit que dans le département de l'Hérault où il a été élu et qu’il a parcouru, on ne fait pas dans une maison aisée, un dîner de quelque apparat sans que la multitude ne se rassemble autour comme pour en avoir sa part. Il est prêt à tout accepter et à tout faire contre ce danger. Au fond, penchant fort vers les légitimistes, et le disant. En attendant, tout au Président. Son père, le Maréchal extrêmement vieilli. Moralement encore plus que physiquement. Il est à St Amand et n'en sortira plus. Il ne se promène plus, que quelquefois en voiture. Il ne joue plus au whist le soir. Il ne parle presque plus, et reste souvent trois ou quatre heures dans son fauteuil sans ouvrir la bouche. La Maréchale, qui n'a qu’un an de moins que son mari, est très saine et très vivante, d’esprit comme de corps. Souvenirs de Berlin. Au moment même où il venait d'apprendre le renvoi du Cabinet, le 23 février, Dalmatie fit dire la nouvelle à M. de Meyendorff qui la mande sur le champ par le télégraphe à Pétersbourg on y ajoutant : " Nous apprendrons probablement demain l'abdication du Roi, et la Régence. " La Duchesse de Talleyrand toujours inconsolable de la mort du Prince Lichnowski. Extrêmement vieillie. Il avait pour elle l’attrait d’une dernière affection & d’une grande espérance politique. Elle le croyait destiné à jouer un rôle important à Berlin, et se promettait de l’y aider. Elle a toujours. Un grand état à Sagan, dans une grande solitude. Fort populaire d'ailleurs aux environs. Au milieu des troubles de la Sibérie, la population a fait, en sa faveur toutes sortes de démonstrations. Elle a fondé là toutes sortes d'établissements publics. Elle a des capitaux dans toutes les entreprises, manufactures & Dalmatie s’est évidemment séparé d’elle dans les meilleurs termes. Elle lui écrit souvent.
Vendredi 31 août 3 heures.
La poste m'a apporté un chagrin. Cette pauvre Mad. de Mirbel vient de mourir à Paris, du choléra. Elle a été atteinte dans la journée de dimanche ; elle est morte dans la nuit de mardi à mercredi. Excellente personne, très capable d’amitié, de dévouement, et de courage et qui me l’a bien prouvé. Elle devait venir ici au mois d'Octobre, et s’en fesait une fête. Je la regrette par amitié, par reconnaissance. Je la regrette pour elle-même. Elle aimait la vie et en jouissait avec vivacité. J’ai reçu d'elle il y a cinq ou six jours une de ces longues lettres que vous savez, pleine encore de son intimité avec les Bonaparte. Elle en attendait un nouveau, Antoine, frère de Pierre, qui venait passer quelques semaines à Paris, et qui devait loger chez elle. Le Président venait de lui accorder la grâce d’un pauvre homme auquel elle s’intéressait. Pierre lui demandait souvent de mes nouvelles. Elle avait reçu, la veille, la visite de Lucien Murat. Elle me racontait tout cela avec ce mélange de bonté et de vanité qui ne la quittait pas. Pauvre femme ! Butenval me dit : " Elle a senti la mort et l’a acceptée avec sérénité. "
Vous voyez qu’il y a de nouveau du choléra à Paris. Il n'y a pas moyen de le méconnaitre. Deux personnes de ma connaissance en quatre jours Mad. de Mirbel et M. Victor Grandin membre de l'Assemblée, chez Mad. Lutteroth, place Vendôme une mère et son enfant sont morts en quelques heures. Combien durera cette recrudescence ? En tout cas ne venez pas la chercher sitôt. Vous êtes acclimatée à Richmond. Il y a eu là, au fait bien peu de cas. Pour mon plaisir, mon plaisir d’esprit et d’attente. je vous aime bien mieux à Paris. J’irais vous y voir dès que vous y seriez. Mais je n'y resterais pas à présent. Par toutes sortes de raisons, politiques et domestiques, il faut que je reste tard au Val Richer. Attendez en Angleterre que nous voyons tout-à-fait clair dans le choléra de France. Quand M. Guéneau de Mussy compte-t-il décidément revenir, ne pourrait-il pas vous attendre un peu ? Ce choléra me préoccupe. Cette mort de Mad. de Mirbel me frappe. Je veux pour vous autant de soins et aussi peu de risques que possible. Nous allons voir dans trois ou quatre semaines. Mad. de Nesselrode était-elle âgée ?
Cinq heures et demie
Dalmatie est parti, et je reviens de me promener. J’aime mieux la promenade dans le jardin de la Duchesse de Bucclengh Si vous ne lisez pas le factum de M. Metternich, vous me l’enverrez. Ce qu’il pense vaut toujours la peine qu'on aille le chercher, quelques fouilles qu’il y ait à faire. Je m'attends à quelques amendements à sa complète approbation de mon avis. Il commence toujours par penser comme les gens à qui il veut plaire. Puis, il revient à sa propre pensée dont l'erreur n'a jamais approché. Du reste, je ne demande pas mieux que d'être sûr qu'il pense comme moi. Je me surprends quelquefois à ne pas croire que mon avis n'ait pas toujours la même importance, et à désirer qu'on l'adopte comme s’il devait régler les évènements. Je suis charmé que Constantin soit général. Faites-lui en mon compliment, je vous prie, point par pur compliment. Tout ce qui lui arrivera d'heureux me plaira toujours. Il est bon, brave et droit. Je lui souhaite autant de bonheur qu’il en mérite. Je pense bien que vous ne sortirez pas de Hongrie avant que Comorn et tout le reste soient soumis. Vous vous conduisez trop bien pour qu'on vous fasse de petites chicanes.
Samedi 1er sept. 1849 Onze heures
Voilà votre lettre. Vous avez bien raison ; nous devrions toujours être ensemble le 30 août. Je me reproche l'avoir laissé passer avant-hier cette chère date sans vous en parler. Je vois que vous avez, sur le choléra la même impression que moi, si j'étais [Il n’y a pas le dernier folio de la lettre.] Marion et le [?] qui m’arrivent. Quel plaisir !
Mots-clés : Femme (santé), Mort, Politique (France), Portrait, Réseau social et politique, Tristesse
Val-Richer, Mardi 4 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait comme je vous ai dit. J’ai travaillé et je me suis promené. Mon travail m'intéresse. C’est dommage que la vie soit si courte. Le vase est trop petit pour ce que j’y voudrais mettre.
Il paraît que le Président a été extrêmement bien reçu en Champagne, mieux que partout ailleurs. Montebello nous dira si les journaux disent vrai. Je les trouve bien vides. Ils ne savent que mettre à la place des scandales de l'assemblée. Les légitimistes, ce me semble. baissent un peu de ton. Ils se résignent d’assez mauvaise grâce à répéter le mot de M. le comte de Chambord sur M. le comte de Paris. Voilà vraiment un grand effort de raison. Cela coupe un peu l'herbe sous le pied au comte de Montemolin. Collaredo m’avait étonné. Il a bien fait de s'en excuser. J’ai des lettres de Genève. On y est inquiet des menées des réfugiés. On craint qu'elles ne forcent les Puissances à une intervention. Vous verrez que la République française ira mettre à la raison, celle de Berne comme celle de Rome et qu’elle remettra le Sonderbund sur pied.
Mercredi, 5 huit heures
Je me suis levé de bonne heure, malgré un accès, ou plutôt à cause d’un accès d’éternuement qui m'a empêché de me rendormir. Cette disposition a pourtant plutôt diminué qu’augmenté depuis quelque temps. J’attends la poste avec mon impatience du mercredi. J’irai chez le Duc de Broglie, pour dix ou douze jours, vers le milieu de la semaine prochaine. Vous m'adresserez alors vos lettres : chez M. de Broglie, à Broglie. Eure. Je vous dirai le jour précis. Vous avez surement remarqué, le petit article du Globe en réponse au Times à propos de la réponse du Prince de Schwartzemberg à Lord Ponsonby. C'est à mon avis, la meilleure preuve que la réponse a vraiment été faite. Il y a, dans l'article, une violence d'humeur contre Schwartzemberg et un dessein de le blesser qui ne peuvent venir que de Lord Palmerston et qui ne se rencontreraient pas, même dans Lord Palmerston. Si Schwartzemberg ne les y avait pas soulevés. Je regrette de voir que le grand Duc Michel est encore bien malade. Je n’ai rien fait dire au Journal des Débats sur l’attitude à prendre envers le Cabinet. C’est de lui-même qu’il prend celle que vous aurez vue dans son article d’hier. Il a raison. Ce n’est pas la peine de faire un grand effort pour amener les hommes qu'on amènerait à la place de ceux-là, et pour ce que feraient, aujourd’hui les hommes même qu'on amènerait. Il est peut-être bon que M. Dufaure soit vivement attaqué et même renversé. Il ne faut pas que ce soit par les mains de mes amis. Ils ont encore bien des choses à tirer de lui, et autre chose à faire après lui.
Onze heures
Voilà votre lettre. J'en aime tout, et surtout la fin. Votre disposition est toujours de venir à Paris à la fin du mois, malgré le choléra. La peur me prend quelquefois à la gorge, pour vous. Et dans d’autres moments, la conscience. Je me fais un devoir de vous tout dire. Mais j'aime mille fois mieux que vous veniez. Et certainement M. Gueneau de Mussy est une excellente occasion. Adieu, adieu. Je suis bien content d'avoir atteint le mercredi. J’ai six bons jours devant moi. Adieu G.
Val-Richer, Mercredi 5 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement, l'Empereur ne peut pas laisser fusiller Georgey. C'est pour lui une question d’honneur, et pour l'Empereur d’Autriche une question de prudence. Si on ne gagne rien à faire comme Georgey, tout le monde fera comme Bem. D'ailleurs, il y a toujours eu faveur pour les militaires qui se sont battus longtemps, et qui ont battu souvent, avant de se rendre. On a peut-être raison de faire juger Georgey ; mais condamné ou non, il faut que le jeune Empereur le prenne et se l’attache. Je parle dans l’idée que Georgey est bien réellement ce qu’il paraît être, et qu’il a bien fait lui-même ce qui s’est fait sous son nom.
Madame la Duchesse d'Orléans et Monsieur le comte de Chambord passeront bien près, l’un de l'autre. Je ne crois pas du tout qu’ils se voient. Mais l’occasion serait bonne et pourrait être mise sur le compte du hasard. Mad. Austin m'écrit : " I spent an hour tête à tête with the Duchers ef Orleans, and found her admirable, at all points, even beyond my expectation. I think I never came near a more perfectly balanced mind, one in which every sentiment had so exactly its just measure. Our people are firmly persuaded thatt her son will neign ; why they can hardly tell ; but so it is. " Je serais assez curieux de savoir pourquoi la bouderie avec la Duchesse de Cambridge, et par qui les marques de mauvais vouloir ont commencé.
Il y a eu conflit à Paris, entre les deux nuances du parti légitimiste. Réunion, solennelle et nombreuse. Les modérés ont lavé la tête aux emportés. On a lu des lettres des Provinces, qui se plaignaient amèrement de l’amertume étalée contre la monarchie de 1830, disant que cela aliénait partout les conservateurs, et qu’on n'entendait pas se laisser gouverner par de telles folies. Les emportés de sont défendus, même assez vivement mais sortis de là, ils ont mis de l’eau dans leur vin, et il y a évidemment une oscillation dans le sens de la modération et de la fusion. Tout cela pour passetemps d'oisifs. Il n'y a de sérieux que le travail lent qui se fait dans tous les esprits, et qui est bien loin du but vers lequel il marche.
Jeudi 6
7 heures Je vous ai quittée hier pour recevoir une visite puis deux autres de Lisieux et des environs. Je suis un peu frappé de l'effet que produit la bonne réception du président à Epernay. L'Empire était hier à l'ordre du jour, dans toutes les conversations. Mettez cela d'accord avec le silence presque absolu des conseils généraux qui ne demandent ni l'Empire, ni seulement la révision de la Constitution, et qui se contentant de discuter leurs affaires locales comme si la France était depuis cent ans en République et bien tranquille en république. Il ne faut jamais se fier aux mouvements superficiels et soudains de ce pays-ci ; ils ne prouvent rien. Il ne faut-pas se fier davantage à ses plus sérieuses et plus calmes démonstrations ; elles ne garantissent rien. Tout est ici également vain, ce qui dure comme ce qui passe et il n’y a pas plus de racines au fond qu'à la surface. Et pourtant quand on vit au milieu de ce pays-ci, quand on y regarde attentivement, il est impossible de croire à sa décadence, de ne pas croire à son avenir. On voit clairement que la prospérité, le bien être, l'activité, la confiance, l'ordre, le bon sens, l'honnêteté tout cela ne demande qu'à venir à s’établer à se développer. Mais il ne suffit pas de demander en ce monde ; il faut vouloir. On ne sait pas vouloir ici ; les honnêtes gens et les gens d’ordre moins que d'autres. Ils cherchent, ils hésitent, ils doutent, ils tâtonnent, ils changent. Et puis ils s'étonnent que tout soit bouleversé autour d’eux ils s’étonnent que leur société ne soit pas forte et stable quand ils sont eux-mêmes, si mobiles et chancelants ! Je suis toujours sur le point de dire à tous les gens là, en causant avec eux : " Mais, malheureux, c’est votre faute ! " Beaucoup en conviendraient, mais du bout des lèvres sans cette conviction forte qui détermine la longue. prévoyance, et le travail soutenu. Un tempérament excellent, un mal très grave, un remède certain, et un malade qui ne sait pas, ou n’ose pas, ou ne veut pas l'avaler ; voilà où nous en sommes. Connaissez-vous rien de plus désespérant ? Pourtant, je me désespère pas Onze heures La poste n’arrive pas, et je suis obligé de partir pour aller déjeuner à Lisieux. Je rencontrerai le facteur en route, et je prendrai votre lettre. Mais il faut que je ferme celle-ci. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 7 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai déjeuné hier avec dix huit personnes, quelques une venues de Rouen, de Trouville et de Paris. J’ai été frappé de l’uniformité de leur langage. Elles disent que, dans les villes, dans la bourgeoisie, Henri V et le comte de Paris ensemble gagnent beaucoup de terrain ; dans les campagnes, l’Empereur. Les paysans ne veulent de la légitimité, ni de la République. Je parie toujours, d’ici à assez longtemps, pour le statu quo, ou à peu près. Mais le sentiment de l’instabilité domine évidemment toujours dans les esprits. Il renait pourtant une peu de prospérité. Rouen, Le Havre, Lyon, sont contents. Quand l’Assemblée se réunira, le cabinet pourra se targuer de la tranquillité publique pendant l’entracte, du silence des Conseils généraux et de la renaissance des Affaires. C’est assez, ce me semble, pour ralentir l’attaque. Il y avait là hier, deux membres de l’Assemblée qui disaient tout haut : " Si nos gros bonnets veulent prendre le pouvoir, nous renverserons le cabinet sur le champ ; sinon, ce n’est pas la peine. " Il ne me revient sur les dispositions de Molé et de Thiers, que ce que je vous ai déjà dit. On évalue, dans l’Assemblée, les rouges à 200 ; le tiers-parti, amis de Dufaure à 150 ; décidés, légitimistes ou Orléanistes à 400. Je n’ai rien de plus dans mon sac pour l’intérieur. Au dehors, je sais que Georgey est déjà gracié. J’en suis charmé. J’ai peu de confiance dans la magnanimité par habilité. Au reste, les affaires de l’Autriche en Italie, bien que plus simples et plus finies en apparence que les affaires en Hongrie, me semblent, au fond, plus mauvaises et moins finissables. Je comprends une vraie pacification entre l’Autriche et la Hongrie ; il y a là des bases d’arrangement, une semi-indépendance, une constitution ancienne et reconnue, et qui peut être rajeunie. Entre l’Autriche et la Haute Italie, il n’y a que de la force ; point de passé autre que la conquête ; point de droits naturellement acceptés. La force est probablement très suffisante pour rester. Mais rester, ce n’est pas pousser des racines ; et il faut des racines, surtout de notre temps où les orages sont toujours à prévoir. Il y assez de mauvaise humeur en effet dans le billet de lord John. Je crois, comme vous, qu’on ne s’épargnera pas pour vous brouiller, et qu’on n’y réussira pas. Ce serait trop bête. Pour vous, vous avez beau jeu à être patient. Et pour l’Autriche, elle ne peut se rétablir que par la patience. Je ne la connais pas assez bien pour savoir. Quelles sont les ressources de régénération intérieure. Je suis porté à croire qu’elle en a, qu’elle se relèvera. Mais il faut qu’elle se relève. Sans quoi, ce sera lord John qui aura raison, et vous serez vis à vis de l’Autriche, comme vis-à-vis de la Turquie et de la Perse, des protecteurs-héritiers. Le monde sera curieux à voir dans un siècle ou deux. Il aura résolu bien des problèmes.
Je rentre dans le Val Richer. J’y attends demain D’Haussonville. J’y ai aujourd’hui Lady Anna Maria Domkin qui me raconte des commérages de Richmond, Madame de Caraman cherchant un mari anglais et disant aux personnes qui lui demandent pourquoi elle n’en prend pas un : « Ma vie est voué aux arts. » Elle (Lady Anna-Maria) s’étonne que vous vous plaisiez à Richmond, entre Lady Alice Peel, Madame de Metternich et les Berry. J’ai défendu vos sociétés et dit du bien de Lady John. Votre lettre à lord John est très bien tournée. Vous avez le don de la malice dans la franchise.
Samedi 8 Sept heures
Je relis votre lettre. Je voudrais précisément vous demander des nouvelles de Marion. Faites-lui, je vous prie, toutes mes tendresses, mes anciennes et constantes tendresses. Je ne puis souffrir ces longs silences, ne point parler et ne rien entendre des personnes qu’on aime, comme si l’amitié n’était plus ou si la mort était déjà là. Interrompez cela pour moi, de temps en temps, avec Marion. C’est vraiment bien triste que ses parents ne veuillent plus de Paris. Est-ce qu’elle ne pourrait pas, elle, y venir passer six semaines ou deux mois avec vous, quand vous y serez, pour sa santé ? Comment va Aggy ? Je suis sûr que vous ne faites pas attention au concile provincial qui va se tenir à Paris. Vous avez tort. C’est un événement. Soyez sûr que les questions religieuses reprendront en France une grande place, ne fût-ce que parce qu’on n’en a pas parlé depuis longtemps. Les libertés politiques pourront souffrir de tout ceci ; les libertés religieuses, non. Celles-là seront nouvelles, et sacrées. Et elles fourniront, autant que les autres, de quoi parler et se quereller.
Avez-vous remarqué ces dernières paroles de Manin quittant Venise : « Quoiqu’il arrive, dites : cet homme s’est trompé ; mais ne dites jamais cet homme nous a trompés. Je n’ai jamais trompé personne ; je n’ai jamais donné des illusions que je n’avais point ; je n’ai jamais dit que j’espérais lorsque je n’espérais pas. » C’est bien beau. Je m’intéresse à cet homme-là.
Onze heures
Votre lettre arrive, plein d’intérêt. Si ce que vous dit Marny est vrai, le changement de cabinet sera un événement. Adieu, adieu. Adieu, G.
Val-Richer, Samedi 8 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
La conversation de Morny est curieuse. Mais un seul fait est important : Molé et Thiers entrant au pouvoir. Pour le pays et pour moi-même, par les raisons patriotiques et par les raisons égoïstes, je le désire. Je suis sûr qu’ils feront beaucoup mieux qu’on ne fait et je doute qu’ils y grandissent beaucoup. M. d'Haussonville, qui vient de me quitter parce qu’il est obligé d'être demain matin, à Paris, croit le fait possible. Pourtant il en doute encore. La lettre du Président à Edgar Ney peut devenir un événement. Elle en est déjà un, car elle ne deviendra un dans toutes les hypothèses. Si le Pape cède, le Gouvernement français prend la responsabilité du gouvernement de Rome et doit rester là, longtemps du moins pour le soutenir, si le Pape ne cède pas, les Français finiront par quitter Rome, et les Autrichiens ou les Napolitains par les y remplacer. Grosse complication. La République française est condamnée à soulever des fardeaux qu’elle ne peut pas porter. Je penche à croire qu’au premier moment le Pape cèdera. Que dit le Prince de Metternich de ceci. J’en suis plus curieux que de sa feuille volante. sa petite lettre est spirituelle, et il a raison au fond. Si l’union devait rester dans les limbes là, elle ne serait que ridicule. Je serais bien trompé, si elle n’en sortait pas et ne devenait pas plus précise. Je reçois ce matin même des nouvelles de Piscatory ? " Rien ne se passe ici. Le Président a été vivement reçu dans son dernier voyage. Je ne crois pas cependant qu’il pense, ni qu’on pense pour lui à autre chose que ce qui est. Le pays refait un peu ses affaires; le pays de promène et chasse. Il ne faut pas qu’on le trouble dans cette illusion, et les Conseils généraux eussent été très mal venus à parler révision de la Constitution. Ils parlent impôts. C'est à peu près aussi grave, et peut-être plus dangereux. L[?] fait tout ce qu’il peut dans le Midi de la question des boissons. Il en peut sortir des orages. Vous allez à Broglie. Dites-moi quand. Je voudrais pouvoir m'échapper pour vous y joindre. J’ai beaucoup à vous dire, et bien plus encore à entendre. Il serait même possible que j'eusse un sérieux conseil à vous demander. " Les derniers mots sentent bien le cabinet. Je suis assez porté à croire que Morny a raison sur toutes les personnes. Je ne sais rien de Claremont. Je ne crois pas à l'Italie. Le Roi tiendra toujours à l'Angleterre. Rome n’est pas possible. On serait bien embarrassant à Naples. Il serait plaisant que Palerme fût le lieu de repos. La maison offerte ( je dis trop, n’est-ce pas ?) à l'Impératrice. La joie de la Reine d'Angleterre me plait. J’ai objection pourtant à ce ravisse ment du sans-gêne de la vie privée. C’est aujourd’hui la manie des Rois. Preuve qu’ils ne prennent pas leur métier assez au sérieux, ou qu’ils le trouvent trop lourd. à propos une hut, s'écrit une hutte.
Dimanche 9 - 7 heures
Quand vous reverrez Morny, si mes questions vous arrivent à temps faites-vous dire par lui je vous prie, 1° la statistique de l’Assemblée combien pour chaque parti à son avis ; 2° Quelle est, dans l’intérieur du parti légitimistes la force relative des [ ?] Berryer en tête et des pointus, MM. Nettement et du Fougerais en tête. Je suis curieux de contrôler, par Morny les renseignements qu'on me donne. J’irai à Broglie jeudi prochain 12. Ecrivez moi donc là, après-demain mardi, en réponse à cette lettre ci. Vos lettres m’arriveront le surlendemain comme ici. Au château de Broglie, par Broglie. Eure. Je serai de retour ici au plus tard, le 28 septembre. Adieu, adieu, en attendant la poste. Onze heures Merci de votre longue et intéressante lettre mais ménagez vos yeux. J'en reçois une de Montebello qui est à la campagne. Il vous a déjà dit; je suppose, ce qu’il me dit. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 9 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les visites s'en vont et je viens à vous. J’avais là tout à l'heure, mon ancien préfet, M. Bocher, aujourd’hui membre de l'Assemblée , beau frère de Gabriel Delessert. Il a été bien étonné quand je lui ai dit qu'on me disait que Thiers allait entrer avec Molé. Cela lui parait un grand et invraisemblable abaissement. Il est, lui, à ce qu’il m’a paru, plutôt pour le maintien du Cabinet actuel, un peu modifié. Gabriel Delessert vient d'arriver à Trouville avec sa femme malade, sa belle-mère malade. Il a eu son fils trés malade en Italie. Plus triste et découragé que jamais. La lettre du président sur le Pape ne réussit pas du tout. Ceux à qui elle plaît et ceux à qui elle déplait la trouvent également inconséquente, et le disent en souriant. Le Cabinet vient de l’épouser avec amour. L’article du Moniteur du soir est de M. Dufaure. Les journaux de la réaction un peu vive, dévots ou non dévots l’attaquent vigoureusement. L’Univers avec colère. L'Assemblée nationale. dit : " Nous ne voyons pas pourquoi demain le Conseil d'Etat ne réhabiliterait pas M. de Lesseps. C'est sa potitique qu’on adopte ; c'est sa diplomatie qu’on veut faire triompher aujourd’hui à Rome. " Cela deviendra une grosse affaire, très grosse dans l’Assemblée et en Europe.
Il est vrai que le Code Napoléon et le gouvernement libéral sont bien enfantins. C'est là mon impression de tous les moments ; ce sont des enfants, sans prévoyance et sans consistance. Si M. de Falloux n’est pas un enfant, il sera embarrassé. Comment n’a-t-il pas su ? Et, s'il a su, comment n'a-t-il pas empêché ? On ne peut agir sensément et efficacement à Rome qu'en agissant de concert avec l'Autriche. L’Autriche peut être raisonnable. Je me suis conduit d'après cette idée là. Et je suppose qu’elle est encore juste aujourd’hui. Regardez un peu attentivement, je vous prie, à tout ce qui va se développer dans cette affaire. Elle mérite votre curiosité. Je ne vous cite de la lettre de Montebello que cette phrase-ci : " J’ai lu dans quelques journaux que j’avais été au devant du Président jusqu'à Château Thierry. Je vous prie de croire qu’il n'en est rien, et que je n’ai pas commis cet excès de zèle. J’ai été, avec la plupart de mes collègues, le recevoir à Epernay où nous étions convoqués. "
Lundi 10. six heures Je plains l'Empereur. Perdre un ami est toujours affreux. Bien plus pour un Roi. Même pour un Roi égoïste. L’égoïsme ne sauve pas des tristesses de l'isolement. Vous m'avez toujours dit que l'Empereur était capable d'affection. Sauf son chagrin, il doit être content. Il a très bien réussi dans une très bonne politique. Il a fait preuve de sagesse dans la force et de force dans la sagesse. C'est le problème que Dieu donne à résoudre à tous les grands souverains et que bien peu résolvent. J'espère pour lui et pour l'Europe, qu’il persistera dans la même conduite et toujours avec le même succès. Je suis bien préoccupé de la réorganisation de l’Autriche ; aussi nécessaire à l’Europe qu'à elle-même. Belle occasion pour ce jeune Empereur d'être un grand homme. Le mot de votre Empereur à Lamoricière est excellent. Et Lamoricière n'aura pas compris que l'Empereur le louait trop. Ce qui fait qu'il n’aura point été embarrassé de l'éloge.
Onze heures
Les Adieu du lundi ne me consolent point du mardi je n'ai rien de Paris. Adieu adieu. G.
Val-Richer, Mardi 11 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous ne sortons pas ici des orages. Mais soyez tranquille ; je ne me laisserai plus mouiller. Je n’avais vraiment pas eu grand tort d’oublier mon parapluie ; il faisait très beau depuis plusieurs jours, et pas la moindre apparence d’un changement de temps. Je ne me croyais plus à Londres. Je vais à Broglie après-demain 10. Je serai de retour au Val Richer le 22. J’ai promis de passer là quinze jours. Je ne veux pas me déplacer, ce qui est toujours un peu cher, même pour aller si près pour trois jours seulement. J'y vais avec mes enfants. Melle Chabaud qui est ici, est également invitée. Si vous venez à Paris à la fin de septembre, j'irai vous y voir dans les premiers jours d'Octobre, après mon retour au Val-Richer. Vous voir, quel bonheur ! Mais ne vous voir que pour vous quitter si tôt! Je devrais être fait aux sentiments combattus. Ma vie en a été et en est pleine. Je ne m’y accoutume pas du tout. Je suis vieux ; mais je jouirais encore, si vivement du bonheur complet et simple !
Duchâtel a quitté Paris, assez ennuyé et toujours perplexe. Il voudrait bien n'avoir ni doutes d’esprit, ni embarras de décision, voir toujours clair et être toujours sûr du succès. La prétention du Sybaritisme dans la vie commune est déjà beaucoup ; mais dans la vie publique, c’est trop. Du reste, je sais qu’il se promet beaucoup d’agréments de votre salon à Paris cet hiver " un salon neutre, dit-il, où nous verrons tout le monde et où nous pourrons dire notre avis à et sur tout le monde, sans nous gêner. " Les légitimistes se disent, et ont été, je crois vraiment très fâchés, que Madame la Duchesse d'Orléans et M. le Duc de Bordeaux, aient passé si près l’un de l'autre pour rien : " Mais c’est donc un parti pris, disent ils, de ne pas se rencontrer. Si nous l'avions su M. le comte de Chambord aurait attendu. C'est sûr." M. Véron parle bien de M. le comte de Chambord : " Intelligent et sympathique" ce sont les expressions.
Onze heures Voilà, mon triste courrier du Mardi. Il ne m’apporte rien de Paris. Mais j’aurai des visites ce matin. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 11 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Voici l’histoire de la lettre du Président sur Rome. Il l’a écrite lui seul. Puis il l’a montrée d'abord à M. de Tocqueville, qui s’est un peu effarouché, et a fait des objections. Le Président a réfuté les objections et soutenu sa lettre ajoutant d'ailleurs, qu’elle était partie. La conversation a continué entre eux et Tocqueville entrainé, moitié par les raisonnements, très obstinés (du président) moitié par l'autorité du fait accompli, a fini par se rendre et par approuver la lettre se réduisant à demander qu’elle fût montrée au Conseil. Le président y a consenti ; le conseil a été convoqué et la lettre montrée. Tous les ministres présents, sans exception ; nommément M. de Falloux. Tous, ou presque tous, ont répété les objections de M. de Tocqueville. Tous sont revenus au même point, à l’approbation de la lettre partie. Le Président a bien constaté cette approbation. Puis, trois jours après, il a dit que sa lettre n'était point partie avant la délibération du Consul mais seulement le lendemain. Ils se sont regardés, et n’ont rien dit. Vous savez tout ce qui a suivi la publication de la lettre. On dit qu'elle a été écrite par l'inspiration de Dufaure. C'est vraisemblable, et tout le monde le croit. Le parti légitimiste a fait dire au Président, par un intermédiaire fort accrédité auprès de lui, qu'ils étaient bien fâchés mois qu'il leur serait impossible de voter pour lui, sur cette question, dans l'assemblée, qu’ils ne pourraient se dispenser de voter avec le petit parti catholique (30 ou 40 membres) qu’il s’était aliéné par sa lettre. Que la majorité courait donc grand risque d'être disloquée. Le général Changarnier blâme ouvertement la lettre et paraît, en tout, moins intime avec le Président. Les conséquences de ceci à l’intérieur, peuvent donc être grosses. Quant aux conséquences à l'extérieure, il faut attendre ce que diront le Pape et l’Autriche. Je doute qu'ils fassent comme les ministres du Président et qu'ils avalent la lettre parce qu'elle est écrite et publiée. Le rédacteur du journal légitimiste de Caen vient de m’arriver en hâte pour me dire que la réconciliation des deux familles était faite, que M. le Duc d’Escars le lui écrivait positivement, et que son journal l’annoncerait demain. Ils sont évidemment en grand travail pour faire faire, et surtout pour faire croire. On dit que M. de Montalivet, agit fort dans ce sens. Vous en revient-il quelque chose ?
Autre bruit de Dieppe. Thiers a fait une longue promenade en mer, dans un bon canot, avec trois hommes sûrs. Il a rencontré au large M. le Prince de Joinville, et ils ont passé deux heures ensemble. L’attaque contre Dufaure, pour sa répugnance à écarter les fonctionnaires rouges au quasi-rouges, sera très vive. Chacun a des faits choquants à citer. La coïncidence de deux attaques vives sur la politique du dedans, et celle du dehors, fera plus que doubler l'effet. Le cabinet peut sortir de la mort, et le Président blessé. Je ne rencontre personne qui croie au dire de Morny sur Thiers et Molé prenant le pouvoir. Le choléra devient plus rare à Paris. Toujours grave quand il vient, mais plus rare. On dirait aujourd’hui qu’Odilon Barrot, en était atteint. Ce qui est sûr, c’est qu’il a été assez souffrant pour demander instamment qu’on le laissât. tranquille pendant huit jours, sans lui parler de rien, dans sa maison de campagne de Bougival. Il y était en effet quand la publication de la lettre du Président est venue l’en tirer. M. de Villèle est fort malade, dans sa terre près de Toulouse. Plus malade encore d'esprit que de corps. La tête très affaiblie, presque en enfance. Il n'a que 75 ans. M. Ravez sera remplacé à l'Assemblée par son fils. Il me semble que j'ai vidé mon sac. J’ai eu du monde toute la matinée de Paris, Trouville et Caen.
Lady Anna Maria Domkin est partie ce matin. Encore un orage tout à l'heure. Mercredi 12, huit heures Toujours la pluie, et assez froid. J’ai eu hier un assez bon échantillon de la disposition des fonctionnaires qui servent ce gouvernement-ci. Le Préfet du département est venu me voir. Il n’était pas encore venu, moitié par lâcheté, moitié à cause de la session du Conseil général. C’est un homme sensé, intelligent, honnête tout cela dans la région moyenne, et préfet sous la monarchie. Il a l’esprit très libre, et la langue assez libre sur toutes choses, y compris toutes les personnes. Il m’a raconté le séjour du Président au Havre où il était la session de son Conseil Général, les circulaires des Ministres, les discours en promenade de M. Léon Faucher, en spectateur qui ne prend pas grand intérêt au spectacle et n'admire pas beaucoup les acteurs. Les hommes de ce temps-ci ont l'art d'avoir de l’impartialité sans indépendance et de la liberté d’esprit sans dignité. Au fait, ce n’est rien de plus que la nature humaine, déshabillée et courbée par des coups de vent trop forts pour elle.
Onze heures
Ménagez vos yeux. C'est beau à moi de vous dire cela en présence d'une lettre un peu courte. N'importe ; ménagez vos yeux, et adieu sans fin. G.
Val-Richer, Mercredi 12 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars demain à onze heures pour Broglie, après l’arrivée de la poste qui ne m’apportera rien de vous. Je vous ai dit de m'écrire là hier. J’aurais pu retarder d'un cour. Je compte bien trouver votre lettre-là, en arrivant à quatre heures.
Voici de longs extraits d’une lettre de Piscatory qui m’arrive ce matin. Je vous l’enverrais si vous aviez des yeux pour lire cette infernale écriture. " On vient de me demander, et je viens de refuser d’aller à Berlin. Je ne suis pas de ceux qui couvrent avec de la dignité et de la fidélité, la nonchalance et la crainte de la responsabilité. Mais ce qu’il y a à faire à Berlin, quoique considérable, ne me plait pas, et ne me semble pas avoir une chance suffisante de succès. Aux yeux du public, Berlin est un poste, non pas une affaire actuelle et déterminée. Le choix et l'acceptation ne s'appliqueraient pas. Cependant je passerai par là dessus, si je croyais que le Roi de Prusse et les sujets, jacobins et caporaux, pussent être détournés de la voie dans laquelle ils sont engagés et où Palmerston les entraine. Mais je crois qu’on aura beau faire les derniers efforts pour les retirer ; en échouera. Alors la mission se borne à une observation plus ou moins intelligente. On a mieux à observer à Paris qu'à Berlin. Pour vous prouver que ce n’est pas la peur qui m'arrête, je vous avouerai que si on m'offrait Rome, j'aurais bien de la peine à m'empêcher de courir cette très chanceuse. aventure. " Viennent des détails sur la lettre du Président. Moins précis que ceux que je vous ai donnés : " Barrot explique la lettre en disant que c’est l’épanchement d’un jeune Prince qui cause avec un serviteur fidèle. Qu’il vienne dire cela à la tribune, et les plus modérés des républicains jetteront de beaux cris ... En lisant dans le Moniteur le démenti donné par Falloux à la note communiquée à la Patrie, j'ai cru le Cabinet détraqué ; mais on me dit ce soir que Falloux reste. Je ne sais si on viendra à bout d’apaiser tout cela ; mais certainement, quand l'Assemblée reviendra, l'affaire reprendra sa valeur pour désunir le majorité. Evidemment Dufaure l'emporte ; la lettre est à son profit et sur les consuls généraux il a eu influence. " Raisonnements pour établir que cela est inévitable, et qu’il faut lisser, M. Dufaure tranquille. " Nous devons, travailler à remonter le courant en nageant à côté du bateau, et non pas en ramant dans le bateau. Et d'abord est-il bien sûr que nous soyons décidés à ramer ? Thiers y répugne beaucoup. M. Molé n'a qu’une envie de femme grosse, ou plutôt il a appétit parce qu’il prévoit le moment où il n'aura plus de dents pour manger. " Les gros bonnets ainsi écartés, vient une question. " Peut-être est-il vrai que nous devrions avoir notre part dans le Cabinet. Je ne crois pas que cela fût difficile. Mais si les gens de mon opinion et de ma mesure y entrent un jour, je leur prédis que ce sera en victimes dévouées. " Je vous fais grâce des gémissements de la victime. Elle finit par me demander mon avis sur son sacrifice. Il doute que sa qualité de membre de la commission permanente, lui permette de venir me voir à Broglie. Je compatis fort aux embarras de l’Autriche point aux vôtres avec elle. Persistez dans votre très bonne conduite ; allez-vous en et tenez-vous tranquilles. Vous y grandirez encore, et l'Autriche délivrée de votre poids, pourra respirer et se relever. Il me semble que M. de Metternich doit regretter de ne plus gouverner son pays dans ce moment. C’est un grand moment. Sans doute il est fort dur d'avoir été sauvé ; mais c’est beaucoup d'être sauvé. Et d'ailleurs l’Autriche s'est si bien sauvée elle-même en Italie qu’elle peut le consoler de n'avoir pu en faire autant partout.
Pourquoi cherchez-vous une maison pour Lord Beauvale? Est-ce qu'il va revenir à Richmond ? J'apprends ce matin la mort d’un bon homme, l’évêque de Norwich. Rien étourdi et bruyant pour un évêque. Mais très honnête et très bon. Ami intime de mes amis les Boileau, qui en sont désolés. Je suis bien aise que Madame de Caraman vous soit bonne à quelque chose.
Jeudi onze heures
Adieu, adieu. Je pars. Je vais chercher votre lettre. Adieu. G.
Broglie, Vendredi 14 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos yeux me désolent, pour vous et pour moi. J’ai lu votre lettre hier, en arrivant ici, avec regret pour ce qui n’y est pas, avec remords pour ce qui y est. Vous vous fatiguerez et vous me direz si peu ! Ne pourriez-vous pas, si cela se prolongeait, vous faire prêter Marion pour huit jours, quinze jours ? Un service positif à demander pour une raison claire et pour un temps déterminé cela se peut. Je cherche, je voudrais tant imaginer quelque chose qui vous soulagent, el qui m'assurât de nos lettres. Quel malheur d'être loin !
Je ne suis pas rentré ici sans émotion. J’y étais venu, pour la dernière fois, en septembre 1838, au moment de la mort de la Duchesse de Broglie, il y a onze ans. Je l'ai vue morte sur son lit, le 27 ou le 26 septembre, je crois. Le lieu est toujours beau. La jeune femme qui l'habite aujourd’hui est jolie et gracieuse, et semble prendre, à ce qui se passe et se dit autour d'elle un intérêt intelligent. Mais la différence est grande. Est-ce qu’il y a vraiment du déclin dans les personnes comme dans les choses, ou seulement du déplacement ? On mène ici une vie à peu près semblable à celle du Val-Richer, déjeuner à midi dîner à 7 heures On se couche à onze. C’est un peu plus tard que mon habitude. Je remonterai chez moi à 10 heures, si plus tard me dérange. Je ne veux par interrompre, mon travail pendant quinze jours. J’ai un bon appartement avec une vue charmante. Il fait presque froid. J’ai un bon feu. Je viens de me lever. Je prendrai du thé dans ma chambre avec du beurre à 9 heures et demie ; votre déjeuner. Je ne descendrai qu’à midi. On est fort libre tout le jour. On fait une promenade, ensemble s’il fait beau.
Voilà votre lettre d'avant-hier. Quel bonheur. Je n'espérais pas la poste sitôt. Elle arrive à 7 heures et demie, et repart à 2 heures Et une longue lettre que je lis presque sans remords puisque vos yeux vont un peu mieux. Je m'inquiète pourtant, vous n'auriez pas du m'en écrire si long. Je tiens plus à vos yeux qu'à la politique de Lord John, et de Lord Ponsonby. Merci mille fois. Lord Ponsonby est curieux. Comorn se rendra comme, le reste. Ce ne sont plus que des malheurs particuliers de l'héroïsme perdu. C’est grand dommage ! Il y a des pays où l'on emploierait si utilement ce qui n’est bon à voir là. Le Duc de Broglie est convaincu que l'affaire de Rome tombera à plat comme toutes les autres. Personne ne sortira du Ministère. Personne, en y restant, ne poussera rien un peu loin. Les légitimistes veulent que M. de Falloux reste ministre et leur fasse faire une part un peu plus grosse dans le pouvoir. Les conservateurs ne pensent qu'à rester tranquilles, pourquoi ils laisseront tout le monde, tranquille, président et ministres. S’il faut rester à Rome avec ou sans le Pape, on y restera. S’il faut s’en aller de Rome, et que d'autres y viennent, ou s'en ira et on les laissera venir. Je me méfie d’une despondency, si absolue. Je suis certes bien loin aujourd’hui d'espérer beaucoup de mon pays. Mais je le connais. Il a des retours subits qui mettent fin brusquement à ses plus profondes léthargies. Je me suis trompé pour m'être fié à sa sagesse. Ceux qui se fient à son abattement se trompent de même. Il me paraît pourtant probable que Dufaure résistera aux attaques dirigées contre lui, et que le Cabinet ne sera que partiellement modifié. Personne, je vous le répète, ne croit ce que croit Morny. Cependant ce qui est le probable, n'est pas tout le possible.
Plusieurs de mes journaux me manquent ce matin. Adieu, adieu. J’espère que votre lettre, qui me fait tant de plaisir, n'aura pas fait de mal à vos yeux. Adieu, adieu dearest. G. Je suis bien fâché que Lord Beauvale ne revienne pas de Richmond.
Broglie, Vendredi 14 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous revenons d’une longue promenade, tous ensemble sauf Melle Chabaud qui ne peut marcher ni vite, ni longtemps. Nous causons beaucoup. Je crois que ma visite leur est très agréable. C’est du mouvement porté chez les gens qui l’aiment et qui ne savent pas s’en donner. Nous connaissons, vous et moi, ce genre de succès.
Samedi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier par des visites qui m'ont retenu jusqu'à l’heure du dîner. Je m’aperçois ce matin que c’est samedi et que j'ai mis hier ma lettre à la poste comme si vous pouviez l'avoir demain. Peu importe du reste. Le Duc de Broglie ne désespère pas au fond, autant qu’il le dit et qu’il le croit. Une idée le préoccupe constamment, et c’est une idée d'avenir. Comment faudrait-il reconstituer le Gouvernement si on avait à le reconstituer, mettant de côté la question du nom propre de ce gouvernement. Faire un bon lit, n'importe qui doive y coucher. Son avis est qu'on obtiendra beaucoup plus avant qu’on ne ferait après, en fait de garanties d’ordre, et de pouvoir. Parce que tant qu’il ne sera pas question de nom propre, tout le parti conservateur sera uni. Parce que, sous le manteau de la République on ira plus loin que sous aucun autre en fait de conservation. Parce qu'il faut que le gouvernement qui devra durer, trouve, quand il viendra, ses affaires essentielles toutes faites, faites par la France elle-même, sous sa responsabilité nationale, et ne soit pas obligé de les faire lui-même, et de répondre de la solution des questions. Le Duc de Broglie cherche donc la solution de toutes les questions constitutionnelles, la meilleure solution possible. Il ne croit pas qu'on révise la Constitution bientôt, ni par des coups d'Etat ; mais il ne croit pas non plus qu’on s’expose à une nouvelle épreuve de la constitution actuelle à la réélection d’une assemblée et d'un président par le suffrage universel, tel qu’il est établi aujourd’hui. Aux approches de cette épreuve-là, on prendra son parti de sauter le fossé plutôt que d’y tomber. 10 heures Je ne m'étonne pas que la malle ne soit pas arrivée en Angleterre. Nous avons vécu quatre jours au milieu des orages. Cela se calme.
Si les Holland sont en Angleterre, pourriez vous éclairer ceci ? Le Duc de Broglie était très lié avec eux et allait sans cesse à Holland House pendant son dernier séjour à Londres. Dés qu’il les a sus à Paris, il est allé les chercher et ne les a pas trouvés. Ils ont mis simplement une carte chez lui et il n’en a plus entendu parler du tout. Il ne comprend pas. Ils ne vivent, dit-il, que sur la frontière la plus rapprochée des rouges, et avec Jérôme Bonaparte. Il suppose que la froideur vient de là. La rigueur envers Gilberti est en effet un peu drôle. Pendant qu’Albert de Broglie, était encore à Rome, Gilberti y est venu. Le Pape l’a reçu, complimenté, embrassé, comblé. Et son livre avait paru. Les gouvernements oublient trop qu'aujourd’hui on n'oublie rien sur leur compte du moins. Ils sont condamnés à plus de prévoyance, et de conséquence que n’en comporte peut-être la faiblesse humaine.
A cela près du contraste trop choquant, je trouve fort simple que le Pape mette à l’Index, les livres, qu’il trouve mauvais et dangereux. C’est de sa part une simple déclaration de son jugement qui ne coûte pas un cheveu aux auteurs, et un avertisse ment à la conscience des Catholiques qu'il a charge de diriger. Quand on interdit au Pape l'index, et qu'on lui commande un gouvernement libéral, on lui interdit tout simplement d'être le Pape. Adieu. Adieu. Je suis préoccupé du Choléra de Londres. Celui de Paris est stationnaire. Adieu. G. Je n’ai pas su lire le nom de Lord .... avec qui vous avez dîné chez Lady Alice. Je trouve pourtant votre écriture meilleure que vos yeux ne se comportent.
Broglie, Dimanche 16 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai un soleil superbe, un beau gazon, une belle vallée, et une belle forêt devant mes yeux. Je voudrais vous envoyer cela. C'est moins bien tenu que Richmnond. La Tamise n’y est pas et la main de l'homme y a moins fait. Mais la nature est aussi riante, et plus grande. Personne que nous ici, et un ancien député conservateur, M. Galos, beau-frère de Piscatory, galant homme, réactionnaire ardent, que ma conversation relève un peu de l'abattement où le jette celle du Duc de Broglie. Je crois que Piscatory viendra la semaine prochaine. Ils ont cru un moment qu'ils convoqueraient l’assemblée. Mais il n’en sera rien. Le Cabinet fait de son mieux pour ne pas se disloquer et le public l’y aide. Le plus probable paraît toujours une modification partielle ; MM. Benoît. Piscatory et Daru entrant aux finances à la Marine et aux travaux publics à la place de MM. Passy, Tracy et Lacrosse. Ne prenez pas cela pour ma propre opinion. Je n'en sais rien. C'est ce qu’on me dit.
Voilà votre lettre. Je ne vois et n’entends rien, absolument rien, qui confirme ce que Lord Normanby attribue au Gal Changarnier, sur une nouvelle bataille dans les rues. Tout le monde dit toujours que tout est possible. Mais personne ne croit à cela. C'est le procès des Ledru Rollin, Felix Pyat &&, annoncé à Versailles pour le 10 octobre, qui fait dire ou supposer ce que mande Lord Normanby. Et en effet, il se pourrait bien que les rouges, à cette occasion, fissent un peu de train. Mais les forces sont énormes à Versailles comme à Paris, et je ne puis découvrir aucune inquiétude, tant soit peu sérieuse de ce côté. Sachez bien que la position de Lord Normanby est plus ridicule qu’elle nait jamais été. Sauf ce qu’il dit de la part de l’Angleterre, personne ne le prend une minute au sérieux lui-même, ni ce qu’il dit ; ni ce qu’on lui dit. Le Marquis Italien est son nom populaire. Et les Italiens n’ont pas grandi depuis dix-huit mois. Ni les marquis. Les intrigues intérieures, du Cabinet à propos de l'affaire de Rome, les lettres, réponses, répliques, contre lettres de tout le monde, et la santé de M. de Falloux, voilà les seules choses qui préoccupent le public qui s’occupe d'autre chose que de ses affaires privées. Le Duc de Broglie persiste à croire que de tout cela, il ne sortira pas même une vraie crise ministérielle. Et je vois qu’il n’est pas seul de son avis car je lis dans une lettre d’un correspondant assez spirituel au journal Belge l’Emancipation : " La question romaine est déjà bien loin. Ce n'est plus de la guerre que l’on s'effraye ; c’est d’une crise à l’intérieur. Allons, vite, qu’on s'embrasse ; voilà ce que c’est que de trop parler. On a failli se brouiller pour avoir dit que l'on était d'accord. Dans les temps où nous vivons, il est bien permis de s'injurier de se diffamer de se calomnier, de se renier, de se trahir. Mais ce n’est pas une raison pour se brouiller. Au contraire." Du reste, je regarderai avec soin du côté où l'on vous montre un point noir.
Adieu. Adieu. Demain est encore un bon jour. Mais après-demain mardi, rien. Adieu. Adieu G.