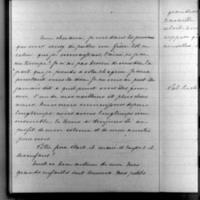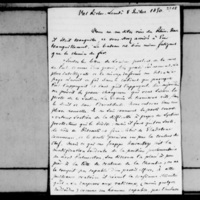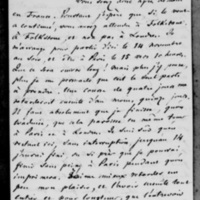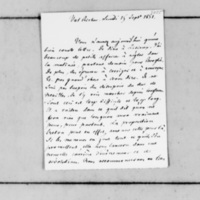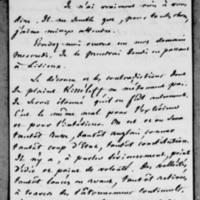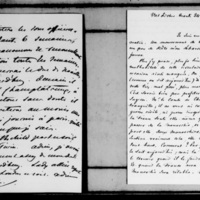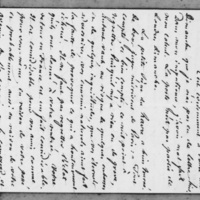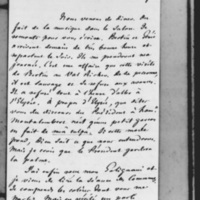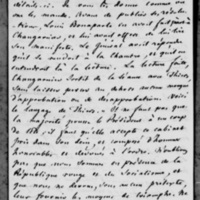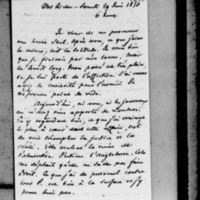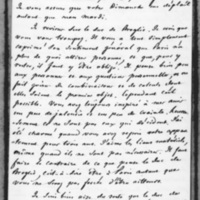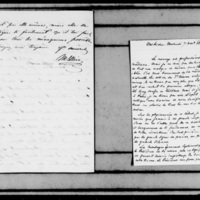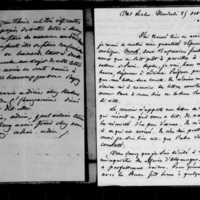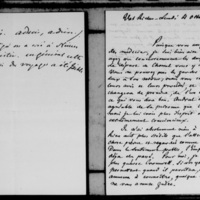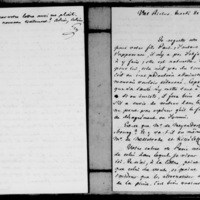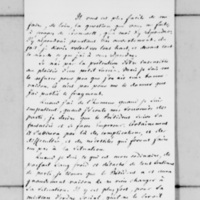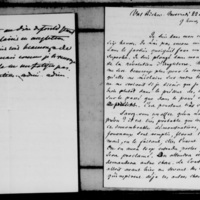Votre recherche dans le corpus : 81 résultats dans 3341 notices du site.
Trier par :
Val-Richer, Jeudi 23 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer 23 Oct. 1851
Je voulais rentrer à Paris du 2 au 5 novembre. Ma réponse à M. de Montalembert exige, absolument huit jours de plus. Je veux l'apporter à peu près terminée, et il n'y a pas moyen pour moi de travailler un peu de suite à Paris surtout quand j’y arrive. Je ne rentrerais donc que du 10 au 12. Et Falaise me fait perdre deux jours. Ce retard me déplaît beaucoup, et à vous, j'espère autant qu'à moi. Bien à cause de vous seule, et de mon plaisir à me retrouver auprès de vous, car je ne me sens aucun empressement à rentrer dans cette atmosphère d'activité bavarde et vaine. La solitude rend sérieux et difficile. Je le deviens tous les jours davantage. D'autant plus que je vois clairement, pour le bon parti, une bonne conduite à tenir, je ne dis pas qui le conduirait promptement à son but mais qui certainement, l’y ferait marcher et qui en attendant, le lierait intimement au pays de l'aveu et de l’appui duquel il ne peut se passer. Mais cette bonne conduite, on ne la tiendra pas ; elle exige trop de bon sens de patience, et de sacrifice des fantaisies personnelles. Connaissez-vous un pire ennui que de voir faire et défaire soi-même de compagnie, des fautes qui déplaisent autant qu'elles nuiront, et de se donner beaucoup de mouvement pour aboutir, le sachant, à beaucoup d'impuissance ?
Le discours de M. de Montalembert est un ouvrage, un long ouvrage beaucoup trop bong, excellent au fond, très hardi, et souvent très beau dans la forme. Ni l'Académie ni son public n’ont jamais rien entendu de si hautement et brutalement anti-révolutionnaire. La vérité y abonde ; la mesure et le tact y manquent. Ceci entre nous. C’est toujours l'homme qui, selon le dire de M. Doudan, commence toujours par les paroles : " Soit dit pour vous offenser " Certainement, ni la Commission de l'Académie, ni l'Académie elle-même, si on est obligé de recourir à elle avant la séance, ne laisseront passer ce discours tel qu'il est. Je m'attends à une vive, controverse intérieure et antérieure. On demandera à M. de Montalembert beaucoup de changements, et le changement d'abrègement sont indispensables, pour son propre succès J'appuierai auprès de lui ces changements-là car je désire son succès autant que lui-même ; d'abord parce qu'il le mérite et aussi parce que son succès sera bon pour la bonne cause Quant au fond des choses, je défendrai son discours contre les gens à qui il déplaira et contre ceux qui en auront peur, sans qu’il leur déplaise. Ne parlez de ceci, je vous prie qu'à des amis de M. de Montalembert ; je ne veux pas qu’il puisse me reprocher d'avoir ébruité d'avant son discours. Mais si vous voyez son beau frère Menode, il n’y à pas de mal qu’il sache un peu mon impression et ma prévoyance.
Berryer a raison de se présenter pour l'Académie. Je crois pleinement à son succès. Cependant il faudra en prendre soin. Bien des gens croiront faire par là de la politique et en auront peur. Le Gouvernement qui, à la vérité, n'a à peu près aucune influence dans l’Académie, lui sera certainement fort contraire. S'est-il assuré de ce que fera Thiers ?
Si vous voyez Vitet soyez assez bonne pour lui demander de ma part des nouvelles de Duchâtel. Il m’a écrit. Je lui ai répondu au moment de la mort de ma petite-fille, depuis, je n'ai rien reçu de lui. Je pense pourtant que ma lettre lui est arrivée.
Onze heures
Il ne faut pas de défaillance et je suppose que Chomel n'a pas compté pour longtemps sur l'artichaut strict. Adieu, Adieu. G.
Je voulais rentrer à Paris du 2 au 5 novembre. Ma réponse à M. de Montalembert exige, absolument huit jours de plus. Je veux l'apporter à peu près terminée, et il n'y a pas moyen pour moi de travailler un peu de suite à Paris surtout quand j’y arrive. Je ne rentrerais donc que du 10 au 12. Et Falaise me fait perdre deux jours. Ce retard me déplaît beaucoup, et à vous, j'espère autant qu'à moi. Bien à cause de vous seule, et de mon plaisir à me retrouver auprès de vous, car je ne me sens aucun empressement à rentrer dans cette atmosphère d'activité bavarde et vaine. La solitude rend sérieux et difficile. Je le deviens tous les jours davantage. D'autant plus que je vois clairement, pour le bon parti, une bonne conduite à tenir, je ne dis pas qui le conduirait promptement à son but mais qui certainement, l’y ferait marcher et qui en attendant, le lierait intimement au pays de l'aveu et de l’appui duquel il ne peut se passer. Mais cette bonne conduite, on ne la tiendra pas ; elle exige trop de bon sens de patience, et de sacrifice des fantaisies personnelles. Connaissez-vous un pire ennui que de voir faire et défaire soi-même de compagnie, des fautes qui déplaisent autant qu'elles nuiront, et de se donner beaucoup de mouvement pour aboutir, le sachant, à beaucoup d'impuissance ?
Le discours de M. de Montalembert est un ouvrage, un long ouvrage beaucoup trop bong, excellent au fond, très hardi, et souvent très beau dans la forme. Ni l'Académie ni son public n’ont jamais rien entendu de si hautement et brutalement anti-révolutionnaire. La vérité y abonde ; la mesure et le tact y manquent. Ceci entre nous. C’est toujours l'homme qui, selon le dire de M. Doudan, commence toujours par les paroles : " Soit dit pour vous offenser " Certainement, ni la Commission de l'Académie, ni l'Académie elle-même, si on est obligé de recourir à elle avant la séance, ne laisseront passer ce discours tel qu'il est. Je m'attends à une vive, controverse intérieure et antérieure. On demandera à M. de Montalembert beaucoup de changements, et le changement d'abrègement sont indispensables, pour son propre succès J'appuierai auprès de lui ces changements-là car je désire son succès autant que lui-même ; d'abord parce qu'il le mérite et aussi parce que son succès sera bon pour la bonne cause Quant au fond des choses, je défendrai son discours contre les gens à qui il déplaira et contre ceux qui en auront peur, sans qu’il leur déplaise. Ne parlez de ceci, je vous prie qu'à des amis de M. de Montalembert ; je ne veux pas qu’il puisse me reprocher d'avoir ébruité d'avant son discours. Mais si vous voyez son beau frère Menode, il n’y à pas de mal qu’il sache un peu mon impression et ma prévoyance.
Berryer a raison de se présenter pour l'Académie. Je crois pleinement à son succès. Cependant il faudra en prendre soin. Bien des gens croiront faire par là de la politique et en auront peur. Le Gouvernement qui, à la vérité, n'a à peu près aucune influence dans l’Académie, lui sera certainement fort contraire. S'est-il assuré de ce que fera Thiers ?
Si vous voyez Vitet soyez assez bonne pour lui demander de ma part des nouvelles de Duchâtel. Il m’a écrit. Je lui ai répondu au moment de la mort de ma petite-fille, depuis, je n'ai rien reçu de lui. Je pense pourtant que ma lettre lui est arrivée.
Onze heures
Il ne faut pas de défaillance et je suppose que Chomel n'a pas compté pour longtemps sur l'artichaut strict. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, le 6 juin 1854, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer, le 14 septembre 1866, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer, Lundi 8 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 8 Juillet 1850
Vous ne me dites rien du Rhin. Donc il était tranquille, et vous serez arrivée à Ems tranquillement. Le bateau est bien moins fatigant que le chemin de fer.
Toutes les lettres de Londres parlent de la mort de Peel comme d’un grand, très grand événement. La plus intelligente et la mieux informée me dit : " Le pays n’avait de foi dans le cabinet que parce que Peel l’appuyait, et tant qu'il l’appuyait. Dès aujourd’hui on prévoit les graves changements qui vont suivre la perte de ce soutien. La session se terminera vite, dans le deuil et dans l’incertitude. Nous entrons dans une phase nouvelle. Je ne sais comment le parti conservateur sortira de la difficulté à propos du système protecteur qui le divise ; mais il faut qu’il en sorte. Le rôle de Disraeli est fini. Celui de Gladstone commence, et le parti prendra un peu la couleur du chef. Mais ce qui me frappe davantage c’est la modification évidente de la position parlementaire de Lord Palmerston, son discours l'a placé à peu près à la tête des orateurs de la Chambre ; on ne le croyait pas capable d'un pareil effort. A cette puissance oratoire il réunit la confiance illimitée qu’il a su inspirer aux radicaux, (moins quelques individus) comme un homme capable, par l'audace et l'absence de principes, de faire ce que John Russel ne fera pas. Il a su déjà maîtriser un cabinet composé d'hommes plus faibles que lui. S’arrêtera-t-il en si beau chemin, sans vouloir monter au sommet de l’édifice ? Ou plutôt, si nous sommes destinés à revoir un Ministère Tory, ne sera-t-il pas poursuivi et renversé par une opposition dont Lord Palmerston serait l’âme et le chef ? C'est assez vous dire que toutes les idées de modification dans un sens opposé à lui ont totalement disparu, et que, par la force des choses, il s’élève au lieu de s'abaisser. En fait de politique étrangère, je le crois cependant disposer à suivre un marche plus régulière et moins dangereuse; plus il aura de vues à l’intérieur, moins il voudra s'embarrasser au dehors. Mais le caractère de l'homme restera toujours le même. Nature sans mesure. Ambition de dominer, sans bornes- destiné peut-être à occuper une plus grande place dans nos annales, mais à donner le signal de nouveaux orages. " Voilà l'Angleterre.
Voici la France; de très bonne source aussi ; un de mes meilleurs et plus intelligents amis dans l'Assemblée; vous ne le connaissez que de nom. " La situation intérieure de notre assemblée sans être bonne encore, me paraît améliorée dans le sens que nous désirons. La tendance à la fusion est beaucoup mieux marquée. Il importe de s’entendre sur la conduite à tenir dans les conseils généraux, sur la composition de la Commission intérimaire qui veillera pendant notre absence. Cette nécessité est comprise. Nous ne pouvons plus nous faire illusion sur les projets de l’Elysée, ni sur les chances de succès qu’il peut trouver dans les divisions du parti monarchique. Le Président médite plusieurs voyages à Lyon, dans l'Est, peut-être à Bordeaux. Il méditait aussi sérieusement le camp de Versailles ; mais on lui a représenté que cette démonstration empêcherait l'assemblée de se proroger... Les légitimistes ne veulent pas plus de deux mois de prorogation. Je crois qu'ils ont raison. Il importerait de hâter nos vacances pour qu’il s'écoulât le moins de temps possible entre la fin de la session des conseils généraux, et notre retour. " Je vous envoie textuellement. C'est plus vrai. Je n’ai rien à ajouter. J’ai passé hier ma journée enfermé dans mon Cabinet ; un temps affreux vent, pluie. Il fait moins mauvais aujourd'hui. J’irai me promener tout-à-l'heure. Après-demain mercredi, je vais passer la journée à Trouville. J’échange l’un de mes jeunes ménages contre l'autre. Adieu, Adieu. Je pense avec plaisir que vous ne voyagez plus. Adieu. G.
Vous ne me dites rien du Rhin. Donc il était tranquille, et vous serez arrivée à Ems tranquillement. Le bateau est bien moins fatigant que le chemin de fer.
Toutes les lettres de Londres parlent de la mort de Peel comme d’un grand, très grand événement. La plus intelligente et la mieux informée me dit : " Le pays n’avait de foi dans le cabinet que parce que Peel l’appuyait, et tant qu'il l’appuyait. Dès aujourd’hui on prévoit les graves changements qui vont suivre la perte de ce soutien. La session se terminera vite, dans le deuil et dans l’incertitude. Nous entrons dans une phase nouvelle. Je ne sais comment le parti conservateur sortira de la difficulté à propos du système protecteur qui le divise ; mais il faut qu’il en sorte. Le rôle de Disraeli est fini. Celui de Gladstone commence, et le parti prendra un peu la couleur du chef. Mais ce qui me frappe davantage c’est la modification évidente de la position parlementaire de Lord Palmerston, son discours l'a placé à peu près à la tête des orateurs de la Chambre ; on ne le croyait pas capable d'un pareil effort. A cette puissance oratoire il réunit la confiance illimitée qu’il a su inspirer aux radicaux, (moins quelques individus) comme un homme capable, par l'audace et l'absence de principes, de faire ce que John Russel ne fera pas. Il a su déjà maîtriser un cabinet composé d'hommes plus faibles que lui. S’arrêtera-t-il en si beau chemin, sans vouloir monter au sommet de l’édifice ? Ou plutôt, si nous sommes destinés à revoir un Ministère Tory, ne sera-t-il pas poursuivi et renversé par une opposition dont Lord Palmerston serait l’âme et le chef ? C'est assez vous dire que toutes les idées de modification dans un sens opposé à lui ont totalement disparu, et que, par la force des choses, il s’élève au lieu de s'abaisser. En fait de politique étrangère, je le crois cependant disposer à suivre un marche plus régulière et moins dangereuse; plus il aura de vues à l’intérieur, moins il voudra s'embarrasser au dehors. Mais le caractère de l'homme restera toujours le même. Nature sans mesure. Ambition de dominer, sans bornes- destiné peut-être à occuper une plus grande place dans nos annales, mais à donner le signal de nouveaux orages. " Voilà l'Angleterre.
Voici la France; de très bonne source aussi ; un de mes meilleurs et plus intelligents amis dans l'Assemblée; vous ne le connaissez que de nom. " La situation intérieure de notre assemblée sans être bonne encore, me paraît améliorée dans le sens que nous désirons. La tendance à la fusion est beaucoup mieux marquée. Il importe de s’entendre sur la conduite à tenir dans les conseils généraux, sur la composition de la Commission intérimaire qui veillera pendant notre absence. Cette nécessité est comprise. Nous ne pouvons plus nous faire illusion sur les projets de l’Elysée, ni sur les chances de succès qu’il peut trouver dans les divisions du parti monarchique. Le Président médite plusieurs voyages à Lyon, dans l'Est, peut-être à Bordeaux. Il méditait aussi sérieusement le camp de Versailles ; mais on lui a représenté que cette démonstration empêcherait l'assemblée de se proroger... Les légitimistes ne veulent pas plus de deux mois de prorogation. Je crois qu'ils ont raison. Il importerait de hâter nos vacances pour qu’il s'écoulât le moins de temps possible entre la fin de la session des conseils généraux, et notre retour. " Je vous envoie textuellement. C'est plus vrai. Je n’ai rien à ajouter. J’ai passé hier ma journée enfermé dans mon Cabinet ; un temps affreux vent, pluie. Il fait moins mauvais aujourd'hui. J’irai me promener tout-à-l'heure. Après-demain mercredi, je vais passer la journée à Trouville. J’échange l’un de mes jeunes ménages contre l'autre. Adieu, Adieu. Je pense avec plaisir que vous ne voyagez plus. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 13 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Lundi 13 août 1849
6 heures
Il y avait hier assez de mouvement à Lisieux et dans le pays ; mouvement très tranquille ; on allait au Havre voir le président et les régates. Une députation de la garde nationale de Lisieux y allait. Elle a pour commandant un vieil officier de l’Empire, en retraite très bon soldat et très brave homme. Il a dit que, si la députation était au moins de 150 hommes il irait lui-même au Havre, avec le drapeau du bataillon. C'est le règlement ; le drapeau ne se déplace pas sans ce nombre. Il ne s’est présenté, pour aller que 78 hommes. Le commandant a déclaré qu’il n'irait. pas. On lui a demandé le drapeau. Il l'a refusé, Ceux qui voulaient aller se sont fâchés, et ont dit qu'ils voulaient le drapeau, qu’ils l'auraient de force. « Venez le prendre chez moi, c’est là qu’il faudra le prendre de force. Ils sont partis sans le drapeau. Ceci m'a assez frappé comme mesure de l’unanimité et de l’enthousiasme. Vous n’avez pas d'idée de l'effet que font dans le public, dans le plus gros public des scènes comme le soufflet de Pierre Bonaparte à M. Gastier. Cela choque bien plus que les plus graves fautes de constitution et de gouvernement. Cela choque une foule de gens qui, s'ils étaient à l'assemblée courraient grand risque d'en faire autant. Ce pays-ci a le goût des formes et la prétention de l'élégance. Il ne pardonne pas ce qui l’humilie sous ce rapport. Si la République et l’Assemblée avaient les belles manières et le beau langage du temps de Louis XIV, il leur passerait presque tout le reste. Cette combinaison là lui plairait beaucoup. Mais il n’a pas, ce plaisir là.
Avez-vous remarqué, il y a quelques jours, la fin du discours de M. de Tocqueville sur l’affaire de Rome ? Il y a été assez dur pour le Pape et en faveur de la politique vaguement libérale. On dit que c’est moins pour plaire à la gauche que pour se préparer une porte de sortie dans le cas, qu’il prévoit où cette politique ne prévaudrait pas à Rome. Il est déjà las du Ministère, et des injures qu’il faut subir, et des luttes qu’il faut soutenir, et des nécessités qu’il faut accepter. Il ne se résigne pas aussi facilement que M. Barrot, à la flagellation publique d’une repentance quotidienne. Et il s’y attend. On m'assure qu’il désire ardemment se retirer. Vous savez qu'on appelle M. Passy le passif des finances de la France. M. Vitet m'écrit qu'il viendra dîner aujourd'hui avec moi. Je suppose que Duchâtel n’arrive à Paris que demain ou après demain. M. et Mad Lenormant me viennent aussi aujourd’hui. Ils me diront les détails et le vrai de la querelle de Thiers et de Montalembert. Si cela est sérieux cela deviendra important. Barante m'écrit ceci : "L'opinion publique commence évidemment à avoir le courage de regretter le passé ; mais elle ne s'émeut pas plus pour le ramener qu’elle ne s’est émue pour le défendre." Rien du reste que des lamentations et des tendresses. Il finit par cette phrase : "Je vais écrire à Madame de Lieven, encore que ma correspondance soit vide et stérile. Autrefois, elle avait la bonté de ne point trop s'ennuyer d'un commerce où j’avais tout à gagner." Adieu. Je vais travailler en attendant la poste. Vous écrire, c'est mon plaisir. Adieu, adieu, dearest.
Onze heures et demie
La poste vient tard. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Vous voyez qu’il n’y a rien eu à Rouen. Adieu. G.
6 heures
Il y avait hier assez de mouvement à Lisieux et dans le pays ; mouvement très tranquille ; on allait au Havre voir le président et les régates. Une députation de la garde nationale de Lisieux y allait. Elle a pour commandant un vieil officier de l’Empire, en retraite très bon soldat et très brave homme. Il a dit que, si la députation était au moins de 150 hommes il irait lui-même au Havre, avec le drapeau du bataillon. C'est le règlement ; le drapeau ne se déplace pas sans ce nombre. Il ne s’est présenté, pour aller que 78 hommes. Le commandant a déclaré qu’il n'irait. pas. On lui a demandé le drapeau. Il l'a refusé, Ceux qui voulaient aller se sont fâchés, et ont dit qu'ils voulaient le drapeau, qu’ils l'auraient de force. « Venez le prendre chez moi, c’est là qu’il faudra le prendre de force. Ils sont partis sans le drapeau. Ceci m'a assez frappé comme mesure de l’unanimité et de l’enthousiasme. Vous n’avez pas d'idée de l'effet que font dans le public, dans le plus gros public des scènes comme le soufflet de Pierre Bonaparte à M. Gastier. Cela choque bien plus que les plus graves fautes de constitution et de gouvernement. Cela choque une foule de gens qui, s'ils étaient à l'assemblée courraient grand risque d'en faire autant. Ce pays-ci a le goût des formes et la prétention de l'élégance. Il ne pardonne pas ce qui l’humilie sous ce rapport. Si la République et l’Assemblée avaient les belles manières et le beau langage du temps de Louis XIV, il leur passerait presque tout le reste. Cette combinaison là lui plairait beaucoup. Mais il n’a pas, ce plaisir là.
Avez-vous remarqué, il y a quelques jours, la fin du discours de M. de Tocqueville sur l’affaire de Rome ? Il y a été assez dur pour le Pape et en faveur de la politique vaguement libérale. On dit que c’est moins pour plaire à la gauche que pour se préparer une porte de sortie dans le cas, qu’il prévoit où cette politique ne prévaudrait pas à Rome. Il est déjà las du Ministère, et des injures qu’il faut subir, et des luttes qu’il faut soutenir, et des nécessités qu’il faut accepter. Il ne se résigne pas aussi facilement que M. Barrot, à la flagellation publique d’une repentance quotidienne. Et il s’y attend. On m'assure qu’il désire ardemment se retirer. Vous savez qu'on appelle M. Passy le passif des finances de la France. M. Vitet m'écrit qu'il viendra dîner aujourd'hui avec moi. Je suppose que Duchâtel n’arrive à Paris que demain ou après demain. M. et Mad Lenormant me viennent aussi aujourd’hui. Ils me diront les détails et le vrai de la querelle de Thiers et de Montalembert. Si cela est sérieux cela deviendra important. Barante m'écrit ceci : "L'opinion publique commence évidemment à avoir le courage de regretter le passé ; mais elle ne s'émeut pas plus pour le ramener qu’elle ne s’est émue pour le défendre." Rien du reste que des lamentations et des tendresses. Il finit par cette phrase : "Je vais écrire à Madame de Lieven, encore que ma correspondance soit vide et stérile. Autrefois, elle avait la bonté de ne point trop s'ennuyer d'un commerce où j’avais tout à gagner." Adieu. Je vais travailler en attendant la poste. Vous écrire, c'est mon plaisir. Adieu, adieu, dearest.
Onze heures et demie
La poste vient tard. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Adieu. Vous voyez qu’il n’y a rien eu à Rouen. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 15 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 15 oct. 1849
8 heures
Vous serez donc après-demain en France. Pourtant j’espère que si le vent a continué, vous aurez attendu à Folkstone. A Folkstone et non pas à Londres. Je m’arrange pour partir d’ici le 14 novembre au soir, et être à Paris, le 15 vers 10 heures. Que ce sera encore long ! Mais plus j’y pense plus je me persuade que c'est le seul parti à prendre. Une course de quatre jours me retarderait ensuite d’au moins quinze jours, Il faut absolument que je finisse, qu’on traduise que cela paraisse en même temps à Paris et à Londres. Je suis sûr qu'en restant ici, sans interruption jusqu'au 14 j’aurai fini, ou si près que je pourrai, finir sans peine à Paris pendant qu’on imprimera. J'aime mieux retarder un peu mon plaisir, et l’avoir ensuite tout entier et pour longtemps, que l’entrevoir un moment pour ne le retrouver que plus tard, et avec des ennuis d'affaires retardées. Que je voudrais que vous fussiez tout de suite de mon avis. Je crois que nous avons, devant nous une assez longue période de tranquillité à Paris. Peut-être un peu d’agitation apparente pendant quelques jours, à cause du procès de Versailles ; mais rien de Lisieux, ni seulement de bruyant. J’ai bien envie que rien ne vous tourmente à votre arrivée. Que trouverez-vous là de votre société ? Vous ne m’avez pas dit ce que devenaient les Holland, ni si vous les aviez enfin vus. Je les suppose de retour à Paris. Je regrette Thom pour vous, non pas comme fécondité, mais comme sureté de conversation. Ste Aulaire et Barante n’y seront pas, je crois, avant le mois de décembre. Faites causer Boislecomte. Vous verrez qu’il a bien de l’esprit. Et il est très honnête. Je l’attends ce matin. Adieu, adieu.
Je vous quitte pour vous écrire à Londres. Quel dommage que je ne suis pas à Boulogne pour vous y recevoir, et vous amener à Paris ! Je dois avoir deux lettres ce matin. Je n’ai eu hier que celle de Jeudi que j'aurais dû avoir samedi. J’ai vu que la poste d’Angleterre avait manqué vendredi pour tout le monde. Onze heures Une seule lettre de Vendredi, Toujours une poste en retard. Adieu, adieu.
8 heures
Vous serez donc après-demain en France. Pourtant j’espère que si le vent a continué, vous aurez attendu à Folkstone. A Folkstone et non pas à Londres. Je m’arrange pour partir d’ici le 14 novembre au soir, et être à Paris, le 15 vers 10 heures. Que ce sera encore long ! Mais plus j’y pense plus je me persuade que c'est le seul parti à prendre. Une course de quatre jours me retarderait ensuite d’au moins quinze jours, Il faut absolument que je finisse, qu’on traduise que cela paraisse en même temps à Paris et à Londres. Je suis sûr qu'en restant ici, sans interruption jusqu'au 14 j’aurai fini, ou si près que je pourrai, finir sans peine à Paris pendant qu’on imprimera. J'aime mieux retarder un peu mon plaisir, et l’avoir ensuite tout entier et pour longtemps, que l’entrevoir un moment pour ne le retrouver que plus tard, et avec des ennuis d'affaires retardées. Que je voudrais que vous fussiez tout de suite de mon avis. Je crois que nous avons, devant nous une assez longue période de tranquillité à Paris. Peut-être un peu d’agitation apparente pendant quelques jours, à cause du procès de Versailles ; mais rien de Lisieux, ni seulement de bruyant. J’ai bien envie que rien ne vous tourmente à votre arrivée. Que trouverez-vous là de votre société ? Vous ne m’avez pas dit ce que devenaient les Holland, ni si vous les aviez enfin vus. Je les suppose de retour à Paris. Je regrette Thom pour vous, non pas comme fécondité, mais comme sureté de conversation. Ste Aulaire et Barante n’y seront pas, je crois, avant le mois de décembre. Faites causer Boislecomte. Vous verrez qu’il a bien de l’esprit. Et il est très honnête. Je l’attends ce matin. Adieu, adieu.
Je vous quitte pour vous écrire à Londres. Quel dommage que je ne suis pas à Boulogne pour vous y recevoir, et vous amener à Paris ! Je dois avoir deux lettres ce matin. Je n’ai eu hier que celle de Jeudi que j'aurais dû avoir samedi. J’ai vu que la poste d’Angleterre avait manqué vendredi pour tout le monde. Onze heures Une seule lettre de Vendredi, Toujours une poste en retard. Adieu, adieu.
Val-Richer, Lundi 15 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Lundi 15 sept 1851
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 4 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Mardi 4 sept. 1849 6 heures
J’ai fait comme je vous ai dit. J’ai travaillé et je me suis promené. Mon travail m'intéresse. C’est dommage que la vie soit si courte. Le vase est trop petit pour ce que j’y voudrais mettre.
Il paraît que le Président a été extrêmement bien reçu en Champagne, mieux que partout ailleurs. Montebello nous dira si les journaux disent vrai. Je les trouve bien vides. Ils ne savent que mettre à la place des scandales de l'assemblée. Les légitimistes, ce me semble. baissent un peu de ton. Ils se résignent d’assez mauvaise grâce à répéter le mot de M. le comte de Chambord sur M. le comte de Paris. Voilà vraiment un grand effort de raison. Cela coupe un peu l'herbe sous le pied au comte de Montemolin. Collaredo m’avait étonné. Il a bien fait de s'en excuser. J’ai des lettres de Genève. On y est inquiet des menées des réfugiés. On craint qu'elles ne forcent les Puissances à une intervention. Vous verrez que la République française ira mettre à la raison, celle de Berne comme celle de Rome et qu’elle remettra le Sonderbund sur pied.
Mercredi, 5 huit heures
Je me suis levé de bonne heure, malgré un accès, ou plutôt à cause d’un accès d’éternuement qui m'a empêché de me rendormir. Cette disposition a pourtant plutôt diminué qu’augmenté depuis quelque temps. J’attends la poste avec mon impatience du mercredi. J’irai chez le Duc de Broglie, pour dix ou douze jours, vers le milieu de la semaine prochaine. Vous m'adresserez alors vos lettres : chez M. de Broglie, à Broglie. Eure. Je vous dirai le jour précis. Vous avez surement remarqué, le petit article du Globe en réponse au Times à propos de la réponse du Prince de Schwartzemberg à Lord Ponsonby. C'est à mon avis, la meilleure preuve que la réponse a vraiment été faite. Il y a, dans l'article, une violence d'humeur contre Schwartzemberg et un dessein de le blesser qui ne peuvent venir que de Lord Palmerston et qui ne se rencontreraient pas, même dans Lord Palmerston. Si Schwartzemberg ne les y avait pas soulevés. Je regrette de voir que le grand Duc Michel est encore bien malade. Je n’ai rien fait dire au Journal des Débats sur l’attitude à prendre envers le Cabinet. C’est de lui-même qu’il prend celle que vous aurez vue dans son article d’hier. Il a raison. Ce n’est pas la peine de faire un grand effort pour amener les hommes qu'on amènerait à la place de ceux-là, et pour ce que feraient, aujourd’hui les hommes même qu'on amènerait. Il est peut-être bon que M. Dufaure soit vivement attaqué et même renversé. Il ne faut pas que ce soit par les mains de mes amis. Ils ont encore bien des choses à tirer de lui, et autre chose à faire après lui.
Onze heures
Voilà votre lettre. J'en aime tout, et surtout la fin. Votre disposition est toujours de venir à Paris à la fin du mois, malgré le choléra. La peur me prend quelquefois à la gorge, pour vous. Et dans d’autres moments, la conscience. Je me fais un devoir de vous tout dire. Mais j'aime mille fois mieux que vous veniez. Et certainement M. Gueneau de Mussy est une excellente occasion. Adieu, adieu. Je suis bien content d'avoir atteint le mercredi. J’ai six bons jours devant moi. Adieu G.
J’ai fait comme je vous ai dit. J’ai travaillé et je me suis promené. Mon travail m'intéresse. C’est dommage que la vie soit si courte. Le vase est trop petit pour ce que j’y voudrais mettre.
Il paraît que le Président a été extrêmement bien reçu en Champagne, mieux que partout ailleurs. Montebello nous dira si les journaux disent vrai. Je les trouve bien vides. Ils ne savent que mettre à la place des scandales de l'assemblée. Les légitimistes, ce me semble. baissent un peu de ton. Ils se résignent d’assez mauvaise grâce à répéter le mot de M. le comte de Chambord sur M. le comte de Paris. Voilà vraiment un grand effort de raison. Cela coupe un peu l'herbe sous le pied au comte de Montemolin. Collaredo m’avait étonné. Il a bien fait de s'en excuser. J’ai des lettres de Genève. On y est inquiet des menées des réfugiés. On craint qu'elles ne forcent les Puissances à une intervention. Vous verrez que la République française ira mettre à la raison, celle de Berne comme celle de Rome et qu’elle remettra le Sonderbund sur pied.
Mercredi, 5 huit heures
Je me suis levé de bonne heure, malgré un accès, ou plutôt à cause d’un accès d’éternuement qui m'a empêché de me rendormir. Cette disposition a pourtant plutôt diminué qu’augmenté depuis quelque temps. J’attends la poste avec mon impatience du mercredi. J’irai chez le Duc de Broglie, pour dix ou douze jours, vers le milieu de la semaine prochaine. Vous m'adresserez alors vos lettres : chez M. de Broglie, à Broglie. Eure. Je vous dirai le jour précis. Vous avez surement remarqué, le petit article du Globe en réponse au Times à propos de la réponse du Prince de Schwartzemberg à Lord Ponsonby. C'est à mon avis, la meilleure preuve que la réponse a vraiment été faite. Il y a, dans l'article, une violence d'humeur contre Schwartzemberg et un dessein de le blesser qui ne peuvent venir que de Lord Palmerston et qui ne se rencontreraient pas, même dans Lord Palmerston. Si Schwartzemberg ne les y avait pas soulevés. Je regrette de voir que le grand Duc Michel est encore bien malade. Je n’ai rien fait dire au Journal des Débats sur l’attitude à prendre envers le Cabinet. C’est de lui-même qu’il prend celle que vous aurez vue dans son article d’hier. Il a raison. Ce n’est pas la peine de faire un grand effort pour amener les hommes qu'on amènerait à la place de ceux-là, et pour ce que feraient, aujourd’hui les hommes même qu'on amènerait. Il est peut-être bon que M. Dufaure soit vivement attaqué et même renversé. Il ne faut pas que ce soit par les mains de mes amis. Ils ont encore bien des choses à tirer de lui, et autre chose à faire après lui.
Onze heures
Voilà votre lettre. J'en aime tout, et surtout la fin. Votre disposition est toujours de venir à Paris à la fin du mois, malgré le choléra. La peur me prend quelquefois à la gorge, pour vous. Et dans d’autres moments, la conscience. Je me fais un devoir de vous tout dire. Mais j'aime mille fois mieux que vous veniez. Et certainement M. Gueneau de Mussy est une excellente occasion. Adieu, adieu. Je suis bien content d'avoir atteint le mercredi. J’ai six bons jours devant moi. Adieu G.
Val-Richer, Mardi 7 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 7 Oct. 1851
Voici une lettre de M. de Carné qui n'est pas sans intérêt. Je voudrais que vous la fissiez lire au Duc de Noaille, s'il vient un de ces jours à Paris. Il est bon que les légitimistes voient combien le danger est réel, et ce qu'en pense un homme d'esprit, autrefois, un des leurs est devenu l’un des miens. L'expédient qu’il indique de l'Assemblée remettant la question de la révision au vote populaire n’est peut-être pas sans valeur. Renvoyez-moi, je vous prie cette lettre. Il faut que je réponde.
Dimanche 26 octobre, on inaugure à Falaise la Statue équestre de Guillaume le Conquérant. J’ai reçu hier du maire et de la commission municipale, l’invitation d'assister à cette cérémonie où se rendront tous les bons normands. Et on me demande d'y dire quelques paroles en l'honneur de Guillaume et de notre vieille histoire. Je ne puis pas refuser et cela ne me déplait pas. J'irai donc.
Ce ne sera pas loin du moment, très doux, où nous nous retrouverons. Que de choses nous aurons à nous dire ! On se dit bien peu, même en s'écrivant tous les jours. Je voudrais seulement avoir achevé, ou à peu près, mon discours en réponse à M. de Montalembert. Je m’en occupe, quoiqu'il ne m'ait pas encore envoyé le sien. J’espère que je le recevrai le 15, ou le 16 de ce mois.
Vous m'avez appris qu’il y avait au Français, des Demoiselles de St. Cyr. Je ne lis pas les articles Spectacles. J’aimerais mieux que vous vous fussiez amusée. Mon amusement à moi, depuis deux jours, c'est les Mémoires d’Outre tombe. J’avois besoin de revoir les détails de la brouillerie de M. de Châteaubriand avec M. de Villèle. Lecture attachante, quand même. C'est l'explosion désespérée d'un égoïsme malade qui n'ayant pas trouvé en ce monde la satisfaction d’un orgueil et d’une vanité incommensurables, a voulu se donner au moins en mourant le plaisir de les étaler sans gêne, sans la forme du dédain et du dégoût. Cet homme-là a dû beaucoup souffrir, autant qu’on peut souffrir ailleurs que dans le cœur car il avait bien peu de cœur. Mais infiniment d’esprit, presque grand, et de talent, toujours grand et brillant, même dans son déclin ; d'éclatants rayons du soleil couchant, dans un ciel sombre et triste.
Savez-vous qu'Alexis de St. Priest est presque mourant à Mâcon ?
11 heures
Adieu, Adieu. Votre solitude me pèse autant qu'à vous ; mais je pense comme vous que l'apparence de l'agitation stérile ne vaudrait rien du tout pour moi. Adieu. G.
Voici une lettre de M. de Carné qui n'est pas sans intérêt. Je voudrais que vous la fissiez lire au Duc de Noaille, s'il vient un de ces jours à Paris. Il est bon que les légitimistes voient combien le danger est réel, et ce qu'en pense un homme d'esprit, autrefois, un des leurs est devenu l’un des miens. L'expédient qu’il indique de l'Assemblée remettant la question de la révision au vote populaire n’est peut-être pas sans valeur. Renvoyez-moi, je vous prie cette lettre. Il faut que je réponde.
Dimanche 26 octobre, on inaugure à Falaise la Statue équestre de Guillaume le Conquérant. J’ai reçu hier du maire et de la commission municipale, l’invitation d'assister à cette cérémonie où se rendront tous les bons normands. Et on me demande d'y dire quelques paroles en l'honneur de Guillaume et de notre vieille histoire. Je ne puis pas refuser et cela ne me déplait pas. J'irai donc.
Ce ne sera pas loin du moment, très doux, où nous nous retrouverons. Que de choses nous aurons à nous dire ! On se dit bien peu, même en s'écrivant tous les jours. Je voudrais seulement avoir achevé, ou à peu près, mon discours en réponse à M. de Montalembert. Je m’en occupe, quoiqu'il ne m'ait pas encore envoyé le sien. J’espère que je le recevrai le 15, ou le 16 de ce mois.
Vous m'avez appris qu’il y avait au Français, des Demoiselles de St. Cyr. Je ne lis pas les articles Spectacles. J’aimerais mieux que vous vous fussiez amusée. Mon amusement à moi, depuis deux jours, c'est les Mémoires d’Outre tombe. J’avois besoin de revoir les détails de la brouillerie de M. de Châteaubriand avec M. de Villèle. Lecture attachante, quand même. C'est l'explosion désespérée d'un égoïsme malade qui n'ayant pas trouvé en ce monde la satisfaction d’un orgueil et d’une vanité incommensurables, a voulu se donner au moins en mourant le plaisir de les étaler sans gêne, sans la forme du dédain et du dégoût. Cet homme-là a dû beaucoup souffrir, autant qu’on peut souffrir ailleurs que dans le cœur car il avait bien peu de cœur. Mais infiniment d’esprit, presque grand, et de talent, toujours grand et brillant, même dans son déclin ; d'éclatants rayons du soleil couchant, dans un ciel sombre et triste.
Savez-vous qu'Alexis de St. Priest est presque mourant à Mâcon ?
11 heures
Adieu, Adieu. Votre solitude me pèse autant qu'à vous ; mais je pense comme vous que l'apparence de l'agitation stérile ne vaudrait rien du tout pour moi. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 13 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Mardi 10 Nov. 1849
8 heures
Je n'ai vraiment rien à vous dire. Il me semble que, pour toutes choses, j’aime mieux attendre. Ecrivez-moi encore un mot demain mercredi. Je le prendrai Jeudi en passant à Lisieux. Le décousu et les contradictions dont se plaint Kisseleff, ne m'étonnent pas. Je serais étonné qu’il en fût autrement. C'est le même mal pour l'extérieur et pour l’intérieur. On est et on sera tantôt Russe, tantôt anglais, comme tantôt coup d’Etat, tantôt constitution. Il n'y a, à parler sérieusement, point d’idée et point de volonté, Des velléités, tantôt lancés en avant, tantôt retirées à travers des tâtonnements continuels. Et on ne sort des tâtonnements que par des essais de coup de tête qui avortent. Avorteront-ils toujours ? Je ne sais. En tous cas, il n'y a pour les hommes sensés, qu’une conduite à tenir soutenir le pouvoir, quels que soient son nom et sa forme, tant qu’il voudra faire de l’ordre et du pouvoir. Toutes les susceptibilités, exigences, oppositions, dissidences, me paraissent aujourd'hui des puérilités. Je me crois sûr que la commission auprès de lord Lansdowne, sera faite, et bien faite. Est-ce que vous n’avez pas vu Salvandy ? Mad. Lenormant m’écrit qu’elle l’a rencontré chez Mad de Boignes, et qu’il s'est laissé croître une crinière qui lui donne l’air d’un bison. Il est toujours au courant et raconte tout. Je retrouverai à Paris tous les anciens ministres, à l’exception de Duchâtel qui ne reviendra qu’en Décembre. Je dois avoir conservé, ma bonne mine d’Angleterre, car je me porte bien J’ai eu pendant quelques jours des commencements désagréables de crampes d'estomac qui revenaient à la même heure. Cela est passé. Je vous quitte pour mettre des livres en ordre. Je laisserai ici ma maison bien rangée. J'aurai absolument besoin à Paris de me réserver les premières heures de la matinée. Je tiens à finir et à finir bientôt ce que j'ai commencé. Onze heures J’ai certainement un vif plaisir à faire mes arrangements. Malgré un beau soleil qui persiste. Adieu, adieu, adieu. G.
8 heures
Je n'ai vraiment rien à vous dire. Il me semble que, pour toutes choses, j’aime mieux attendre. Ecrivez-moi encore un mot demain mercredi. Je le prendrai Jeudi en passant à Lisieux. Le décousu et les contradictions dont se plaint Kisseleff, ne m'étonnent pas. Je serais étonné qu’il en fût autrement. C'est le même mal pour l'extérieur et pour l’intérieur. On est et on sera tantôt Russe, tantôt anglais, comme tantôt coup d’Etat, tantôt constitution. Il n'y a, à parler sérieusement, point d’idée et point de volonté, Des velléités, tantôt lancés en avant, tantôt retirées à travers des tâtonnements continuels. Et on ne sort des tâtonnements que par des essais de coup de tête qui avortent. Avorteront-ils toujours ? Je ne sais. En tous cas, il n'y a pour les hommes sensés, qu’une conduite à tenir soutenir le pouvoir, quels que soient son nom et sa forme, tant qu’il voudra faire de l’ordre et du pouvoir. Toutes les susceptibilités, exigences, oppositions, dissidences, me paraissent aujourd'hui des puérilités. Je me crois sûr que la commission auprès de lord Lansdowne, sera faite, et bien faite. Est-ce que vous n’avez pas vu Salvandy ? Mad. Lenormant m’écrit qu’elle l’a rencontré chez Mad de Boignes, et qu’il s'est laissé croître une crinière qui lui donne l’air d’un bison. Il est toujours au courant et raconte tout. Je retrouverai à Paris tous les anciens ministres, à l’exception de Duchâtel qui ne reviendra qu’en Décembre. Je dois avoir conservé, ma bonne mine d’Angleterre, car je me porte bien J’ai eu pendant quelques jours des commencements désagréables de crampes d'estomac qui revenaient à la même heure. Cela est passé. Je vous quitte pour mettre des livres en ordre. Je laisserai ici ma maison bien rangée. J'aurai absolument besoin à Paris de me réserver les premières heures de la matinée. Je tiens à finir et à finir bientôt ce que j'ai commencé. Onze heures J’ai certainement un vif plaisir à faire mes arrangements. Malgré un beau soleil qui persiste. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mardi 15 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Mardi 15 oct. 1850
Voici une question que je ne trouve pas, dans ma bibliothèque d’ici, les moyens de résoudre et sur laquelle mon petit visiteur ira peut-être vous consulter. mon libraire veut mettre sur le titre de Washington, les armes des Etats-Unis d’Amérique, et sur le titre de Monk, les armes d'Angleterre. Mais ce sont les armes d’Angleterre sous les Stuart qu’il faut là et non pas les armes d'Angleterre sous la maison de Hanovre. Je ne me rappelle pas bien et je ne puis indiquer d’ici les différences. On fera la vérification, à la Bibliothèque du Roi, (nationale aujourd’hui) et je pense qu’on trouvera là tout ce qu’il faut pour la faire. Mais si quelque renseignement manquait aurait-on, à l'Ambassade d'Angleterre, et votre ami Edwards pourrait-il procurer de là un modèle des armes de Charles 2 en 1660 ? J'espère qu’il ne sera pas du tout nécessaire que vous preniez cette peine, mais je veux vous prévenir qu’il est possible qu’on vienne vous en parler.
Ce que vous a dit de Cazes ne m'étonne pas. Bien des gens le pensent. C'est peut-être le plus grand danger qu’il y ait à courir. J’ai très mauvaise idée de ce que serait le résultat. Probablement encore un abaissement de plus. Mais la tentation serait forte. Je dois dire que les dernières paroles qui m’ont été dites à ce sujet ont été très bonnes et très formelles.
Avez-vous revu Morny ? Je suis assez curieux de savoir, s'il vous dira quelque chose de mes quelques lignes, et de l’usage qu’il en a fait.
La corde est en effet bien tendue en Allemagne. Pourtant il me semble que Radowitz prend déjà son tournant pour la détendre un peu. Que vaut ce que disent les journaux de son travail pour amener l'union restreinte à n'être qu'une union militaire comme il y a une union douanière ? Ce serait encore un grand pas pour la Prusse et je ne comprendrais pas que les petits États se laissassent ainsi absorber par la Prusse sans avoir au moins le voile et le profit de la grande unité germanique. Mais il y aurait là un commencement de reculade. Je persiste en tout cas à ne point croire à la guerre. Personne n'en veut, excepté la révolution qui a peu prospéré en Allemagne. L'indécision même de votre Empereur entre Berlin et Vienne est un gage de paix. Y eût-il guerre, le Président ne serait pas en état, le voulût-il de faire prendre parti pour la Prusse. On ne prendrait point de parti de Paris comme de Pétersbourg et de Londres on remuerait ciel et terre pour empêcher la guerre, qui serait de nouveau la révolution. Je ne viens pas à bout d'être inquiet de ce côté, malgré le duo de bravoure de Radowitz et de Hübner.
10 heures
Je vois beaucoup de bruit dans les journaux et rien de plus. Pas plus de coup d’Etat en France que de guerre en Allemagne. Je n'ai qu'une raison de me méfier de mon impression ; c’est qu’il ne faut pas aujourd’hui trop croire au bon sens. Notre temps a trouvé le moyen d'être à la fois faible et fou. Adieu, adieu.
Je reçois de mauvaises nouvelles du midi de la France. On m’écrit que les rouges y redeviennent très actifs. Adieu. G.
Voici une question que je ne trouve pas, dans ma bibliothèque d’ici, les moyens de résoudre et sur laquelle mon petit visiteur ira peut-être vous consulter. mon libraire veut mettre sur le titre de Washington, les armes des Etats-Unis d’Amérique, et sur le titre de Monk, les armes d'Angleterre. Mais ce sont les armes d’Angleterre sous les Stuart qu’il faut là et non pas les armes d'Angleterre sous la maison de Hanovre. Je ne me rappelle pas bien et je ne puis indiquer d’ici les différences. On fera la vérification, à la Bibliothèque du Roi, (nationale aujourd’hui) et je pense qu’on trouvera là tout ce qu’il faut pour la faire. Mais si quelque renseignement manquait aurait-on, à l'Ambassade d'Angleterre, et votre ami Edwards pourrait-il procurer de là un modèle des armes de Charles 2 en 1660 ? J'espère qu’il ne sera pas du tout nécessaire que vous preniez cette peine, mais je veux vous prévenir qu’il est possible qu’on vienne vous en parler.
Ce que vous a dit de Cazes ne m'étonne pas. Bien des gens le pensent. C'est peut-être le plus grand danger qu’il y ait à courir. J’ai très mauvaise idée de ce que serait le résultat. Probablement encore un abaissement de plus. Mais la tentation serait forte. Je dois dire que les dernières paroles qui m’ont été dites à ce sujet ont été très bonnes et très formelles.
Avez-vous revu Morny ? Je suis assez curieux de savoir, s'il vous dira quelque chose de mes quelques lignes, et de l’usage qu’il en a fait.
La corde est en effet bien tendue en Allemagne. Pourtant il me semble que Radowitz prend déjà son tournant pour la détendre un peu. Que vaut ce que disent les journaux de son travail pour amener l'union restreinte à n'être qu'une union militaire comme il y a une union douanière ? Ce serait encore un grand pas pour la Prusse et je ne comprendrais pas que les petits États se laissassent ainsi absorber par la Prusse sans avoir au moins le voile et le profit de la grande unité germanique. Mais il y aurait là un commencement de reculade. Je persiste en tout cas à ne point croire à la guerre. Personne n'en veut, excepté la révolution qui a peu prospéré en Allemagne. L'indécision même de votre Empereur entre Berlin et Vienne est un gage de paix. Y eût-il guerre, le Président ne serait pas en état, le voulût-il de faire prendre parti pour la Prusse. On ne prendrait point de parti de Paris comme de Pétersbourg et de Londres on remuerait ciel et terre pour empêcher la guerre, qui serait de nouveau la révolution. Je ne viens pas à bout d'être inquiet de ce côté, malgré le duo de bravoure de Radowitz et de Hübner.
10 heures
Je vois beaucoup de bruit dans les journaux et rien de plus. Pas plus de coup d’Etat en France que de guerre en Allemagne. Je n'ai qu'une raison de me méfier de mon impression ; c’est qu’il ne faut pas aujourd’hui trop croire au bon sens. Notre temps a trouvé le moyen d'être à la fois faible et fou. Adieu, adieu.
Je reçois de mauvaises nouvelles du midi de la France. On m’écrit que les rouges y redeviennent très actifs. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 24 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 24 sept. 1850
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Val-Richer, Mercredi 1er octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Mercredi 1 Oct. 1851
Je reviens à ce qu'on vous à dit des alarmes de Thiers. Quoique je le sache très prompt et crédule en fait d'alarmes, il a trop d’esprit pour avoir toutes celles des badauds. Il faut que les coups d'Etat aient été et soient encore dans l’air de l'Elysée, plus que je ne l'ai cru. Je persiste cependant à n’y point croire. On en parle probablement beaucoup ; on les arrange, on les discute ; on ne les fera pas. Race de bavards pleins d'imagination, qui s'amusent de leurs plans et s'enivrent de leurs paroles, mais à qui les plans et les paroles suffisent.
Il m’est bien revenu quelque chose de cette fameuse lettre de Thiers dont vous me parlez, et que Normanby a montrée à Rogier. Mais je n'en sais rien que d'incomplet et de vague. C’était, je crois une désapprobation de la lettre de Rogier. Si vous pouvez me donner, à ce sujet quelques détails un peu précis, soyez assez bonne pour me les donner.
Je vois qu’on me fait aller tous les jours à Champlâtreux et assister à toutes les réunions possibles. L’Assemblée nationale a bien fait de rappeler que je suis ici fort tranquille. Je suis très décidé, et très hautement contre la proposition Créton ; mais il ne me convient pas de paraître toujours présent, et actif dans les réunions purement légitimistes, où on la repousse. C’est une malice de Thiers ou de ses gens à l'adresse de Claremont.
Je vous ai dit que Montalembert m'écrit qu’il n’est pas prêt pour son discours qu’il devait m’apporter ici à la fin de septembre. " Je suis bien confus d'avoir à vous avouer aujourd’hui que je n'ai pas encore terminé ce travail. Pour me justifier, je dois dire que j’ai été indisposé au commencement de la prorogation puis distrait et absorbé par une foule de devoirs et d'ennuis électoraux. Cela ne diminue pas le remords que j'éprouve de ne pas vous tenir parole. Je viens donc vous demander humblement quelques jours de délai. "
Je parie qu'il ne sera pas prêt avant la fin d'octobre. Assez grand ennui pour moi, car je ne puis pas faire mon discours sans avoir vu le sien et il me faut bien autant de semaines qu'il lui a fallu de mois, et un peu de loisir. Ce discours sera fort écouté. Il faut qu’il soit bon.
Montalembert ajoute : " J’ai pris la liberté de faire remettre chez vous tout ce que j'ai jamais dit ou écrit. Il y a beaucoup de générosité de ma part à vous faire cette communication aussi complète, car vous pourrez y trouver plus d'une attaque contre vous et contre le Gouvernement que vous dirigiez. Mais la révolution de Février, si elle m'a donné raison sur quelques points, vous a si bien vengé sur tant d'autres qu'il ne saurait rester de ressentiment dans votre cœur contre ceux d'entre vos anciens adversaires qui étaient au fond vos alliés naturels. "
Il a bien raison. Je n’ai pas le moindre ressentiment contre lui. Je suis assez frappé du Firman de la Porte. au Pacha d’Egypte contre le chemin de fer d'Alexandrie à Suez. Je croyais à Sir Stratford Canning plus de crédit à Constantinople. C'est un gros désagrément pour Lord Palmerston qui met à ce chemin beaucoup d'importance. Vous verrez qu’il finira par prendre le parti d'Abbas Pacha contre le Sultan, comme nous avons pris en 1840, le parti de Méhémet Ali. Êtes-vous pour quelque chose dans cette résistance si décidée de la Porte, ou n’est-elle due qu’au travail de Paris et de Vienne ?
Onze heures
Merci de votre lettre très intéressante. Et j'en remercie aussi un peu Marion, excellent reporter. Le mot, si je ne me trompe est plus poli que celui de rapporteur. Adieu, Adieu. G.
Je reviens à ce qu'on vous à dit des alarmes de Thiers. Quoique je le sache très prompt et crédule en fait d'alarmes, il a trop d’esprit pour avoir toutes celles des badauds. Il faut que les coups d'Etat aient été et soient encore dans l’air de l'Elysée, plus que je ne l'ai cru. Je persiste cependant à n’y point croire. On en parle probablement beaucoup ; on les arrange, on les discute ; on ne les fera pas. Race de bavards pleins d'imagination, qui s'amusent de leurs plans et s'enivrent de leurs paroles, mais à qui les plans et les paroles suffisent.
Il m’est bien revenu quelque chose de cette fameuse lettre de Thiers dont vous me parlez, et que Normanby a montrée à Rogier. Mais je n'en sais rien que d'incomplet et de vague. C’était, je crois une désapprobation de la lettre de Rogier. Si vous pouvez me donner, à ce sujet quelques détails un peu précis, soyez assez bonne pour me les donner.
Je vois qu’on me fait aller tous les jours à Champlâtreux et assister à toutes les réunions possibles. L’Assemblée nationale a bien fait de rappeler que je suis ici fort tranquille. Je suis très décidé, et très hautement contre la proposition Créton ; mais il ne me convient pas de paraître toujours présent, et actif dans les réunions purement légitimistes, où on la repousse. C’est une malice de Thiers ou de ses gens à l'adresse de Claremont.
Je vous ai dit que Montalembert m'écrit qu’il n’est pas prêt pour son discours qu’il devait m’apporter ici à la fin de septembre. " Je suis bien confus d'avoir à vous avouer aujourd’hui que je n'ai pas encore terminé ce travail. Pour me justifier, je dois dire que j’ai été indisposé au commencement de la prorogation puis distrait et absorbé par une foule de devoirs et d'ennuis électoraux. Cela ne diminue pas le remords que j'éprouve de ne pas vous tenir parole. Je viens donc vous demander humblement quelques jours de délai. "
Je parie qu'il ne sera pas prêt avant la fin d'octobre. Assez grand ennui pour moi, car je ne puis pas faire mon discours sans avoir vu le sien et il me faut bien autant de semaines qu'il lui a fallu de mois, et un peu de loisir. Ce discours sera fort écouté. Il faut qu’il soit bon.
Montalembert ajoute : " J’ai pris la liberté de faire remettre chez vous tout ce que j'ai jamais dit ou écrit. Il y a beaucoup de générosité de ma part à vous faire cette communication aussi complète, car vous pourrez y trouver plus d'une attaque contre vous et contre le Gouvernement que vous dirigiez. Mais la révolution de Février, si elle m'a donné raison sur quelques points, vous a si bien vengé sur tant d'autres qu'il ne saurait rester de ressentiment dans votre cœur contre ceux d'entre vos anciens adversaires qui étaient au fond vos alliés naturels. "
Il a bien raison. Je n’ai pas le moindre ressentiment contre lui. Je suis assez frappé du Firman de la Porte. au Pacha d’Egypte contre le chemin de fer d'Alexandrie à Suez. Je croyais à Sir Stratford Canning plus de crédit à Constantinople. C'est un gros désagrément pour Lord Palmerston qui met à ce chemin beaucoup d'importance. Vous verrez qu’il finira par prendre le parti d'Abbas Pacha contre le Sultan, comme nous avons pris en 1840, le parti de Méhémet Ali. Êtes-vous pour quelque chose dans cette résistance si décidée de la Porte, ou n’est-elle due qu’au travail de Paris et de Vienne ?
Onze heures
Merci de votre lettre très intéressante. Et j'en remercie aussi un peu Marion, excellent reporter. Le mot, si je ne me trompe est plus poli que celui de rapporteur. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Académies, Asssemblée nationale, Circulation épistolaire, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (Russie), Femme (politique), Politique (Analyse), Politique (France), Politique (Turquie), Posture politique, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Travail intellectuel
Val-Richer, Mercredi 16 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Mercredi 16 Juillet 1851
6 heures
Je me lève. Voilà une vie tranquille et saine. J’écrirai, des lettres ou autre chose jusqu'à 10 heures. La poste arrive. C'est mon événement. Je lis mes lettres. Je descends dans le jardin. Je remonte et je fais ma toilette. A 11 heures, je déjeune. Je me promène. Je remonte dans mon Cabinet, et je lis mes journaux. D'une heure à 7, je travaille et je me promène. A 7 heures je dîne. Après mon dîner, j'arrose mes fleurs une demi-heure. Je rentre et je lis jusqu'à 10 heures. Pas une âme, pas une voix, autre que mon valet de chambre et mon jardinier. On va commencer à savoir dans le pays que je suis arrivé, et on viendra un peu me voir. Nous parlerons de l'assemblée et du Président. Mais je resterai encore en grand repos.
Ma petite fille continue à aller mieux ; mais comme elle continue aussi à être fort délicate, je doute que le médecin d'Henriette lui permette de quitter Paris avant quinze jours. Je mettrai ce temps là à profit pour mon travail et pour mon repos.
Voilà donc la révolution Portugaise qui avorte comme les autres. Etrange temps où les révolutions sont si aisées à faire et si impossibles à poursuivre ! On ne les empêche jamais d’arriver ; mais dès qu'elles sont là, on les arrête. Je voudrais que le comte de Thomas vint à Paris l'hiver prochain. Je serais bien aise de le connaître. Que dites-vous de l'aplomb de Palmerston sur Pacifico ? et du bon sens anglais qui laisse tomber cette sottise sans mot dire, étant décidé à n'en pas renverser l’auteur ? Le vice originel du gouvernement représentatif, ce sont les paroles exagérées, et les paroles vaines tous les pays qui en essayent donnent à plein collier dans ce vice-là. L'Angleterre seule s’en défend ; elle sait parler bas, et même se taire.
10 heures
Je viens de lire mes lettres d'abord ; puis un coup d'œil sur les journaux. M. de Falloux me plaît, et le général Cavaignac m'amuse. Je lirai attentivement. J'en ai le temps. La campagne double la longueur de la vie. Vous allez mieux puisque vous ne m'en parlez pas. Vous ne me dites rien de Marion. Il me semble qu’elle doit être une grande ressource de conversation habituelle. A-t-elle autant d’esprit que de mouvement ? Ce n’est pas tout de remuer ; il faut avancer. Point de nouvelle de Paris. C’est vues qu’il faut dire. A qui se rapporte ce mot vu ? De qui parlez-vous ? De vous et de Marion. Vous êtes femmes, donc le mot qui vous regarde doit être au féminin. Vous êtes deux femmes. Donc il doit être au pluriel. Est-ce clair ?
Adieu. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je la fais pour moi seul comme si je devais passer ma journée à voir du monde. Adieu. G.
6 heures
Je me lève. Voilà une vie tranquille et saine. J’écrirai, des lettres ou autre chose jusqu'à 10 heures. La poste arrive. C'est mon événement. Je lis mes lettres. Je descends dans le jardin. Je remonte et je fais ma toilette. A 11 heures, je déjeune. Je me promène. Je remonte dans mon Cabinet, et je lis mes journaux. D'une heure à 7, je travaille et je me promène. A 7 heures je dîne. Après mon dîner, j'arrose mes fleurs une demi-heure. Je rentre et je lis jusqu'à 10 heures. Pas une âme, pas une voix, autre que mon valet de chambre et mon jardinier. On va commencer à savoir dans le pays que je suis arrivé, et on viendra un peu me voir. Nous parlerons de l'assemblée et du Président. Mais je resterai encore en grand repos.
Ma petite fille continue à aller mieux ; mais comme elle continue aussi à être fort délicate, je doute que le médecin d'Henriette lui permette de quitter Paris avant quinze jours. Je mettrai ce temps là à profit pour mon travail et pour mon repos.
Voilà donc la révolution Portugaise qui avorte comme les autres. Etrange temps où les révolutions sont si aisées à faire et si impossibles à poursuivre ! On ne les empêche jamais d’arriver ; mais dès qu'elles sont là, on les arrête. Je voudrais que le comte de Thomas vint à Paris l'hiver prochain. Je serais bien aise de le connaître. Que dites-vous de l'aplomb de Palmerston sur Pacifico ? et du bon sens anglais qui laisse tomber cette sottise sans mot dire, étant décidé à n'en pas renverser l’auteur ? Le vice originel du gouvernement représentatif, ce sont les paroles exagérées, et les paroles vaines tous les pays qui en essayent donnent à plein collier dans ce vice-là. L'Angleterre seule s’en défend ; elle sait parler bas, et même se taire.
10 heures
Je viens de lire mes lettres d'abord ; puis un coup d'œil sur les journaux. M. de Falloux me plaît, et le général Cavaignac m'amuse. Je lirai attentivement. J'en ai le temps. La campagne double la longueur de la vie. Vous allez mieux puisque vous ne m'en parlez pas. Vous ne me dites rien de Marion. Il me semble qu’elle doit être une grande ressource de conversation habituelle. A-t-elle autant d’esprit que de mouvement ? Ce n’est pas tout de remuer ; il faut avancer. Point de nouvelle de Paris. C’est vues qu’il faut dire. A qui se rapporte ce mot vu ? De qui parlez-vous ? De vous et de Marion. Vous êtes femmes, donc le mot qui vous regarde doit être au féminin. Vous êtes deux femmes. Donc il doit être au pluriel. Est-ce clair ?
Adieu. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je la fais pour moi seul comme si je devais passer ma journée à voir du monde. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 25 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 25 juillet 1849
8 heures
C’est évidemment à cause du Dimanche que je n'ai pas eu de lettre hier. Dans mon impatience, j’avais mal fait mon calcul. La poste n'est pas partie de Londres dimanche.
La petite scène du Havre a bien tourné. De bons juges m’écrivent de Paris : " Tout compté et bien compté, ce n'est point à regretter. Puisqu'il n’y a rien eu de grave autant vaut au risque de quelques embarras et de quelques inquiétudes, que vos éternels adversaires vos ennemis naturels aient fait la faute de provoquer ce qui a houleusement échoué. Il ne faut pas regretter l'éclat qu’ils ont donné à votre rentrée. Votre retour en France est un fait considérable. Il est considérable pour vos amis comme pour vous-même, en raison de votre passé et probablement aussi en raison de vôtre avenir. On l’a compris on le comprend, et l'on n'a pas su dissimuler sa mauvaise humeur. Encore une fois, tant mieux. "
Je n'ai encore lu Aberdeen et Brougham que dans le Journal des Débats. Mais ce que j'ai admiré, c’est Lord Palmerston sur l’Autriche. Quel aplomb, pour parler poliment ! Il a raison, puisqu'on l’écoute sans lui répondre. Il y a des gens qui lorsqu'ils ont fait des sottises en disant leur mea culpa, comme M. de Montalembert. Lord Palmerston se glorifie, en s’indignant qu'on l'ait cru capable de ce qu’il a fait. Vous voyez bien que le Pape rentrera à ses propres conditions. Pas plus à Paris qu'à Vienne, on ne lui demandera de partager sa souveraineté. J'étais bien violemment attaqué il y a dix-huit mois pour avoir écrit à M. Rossi qu’il ne devait ni ne pouvait le faire. Que de peine se donnent, et que de mal se font les hommes avant de revenir à l'idée juste qui leur aurait tout épargné. Adam Smith dit quelque part : " Telle est l’insolence naturelle de l'homme qu'il ne consent à employer les bons moyens qu'après avoir épuisé les mauvais. "
Je reçois toujours beaucoup de visites. Evidemment ; mes amis n’ont pas peur. Comme je ne mettrai pas leur courage à l'épreuve, il aura le temps de s'affermir. J’attends demain Armand Bertin. vous ne me donnez pas assez de détails sur votre santé. Je les demande à moins que vous ne me disiez que, moins vous en parlez mieux vous vous portez. Votre superstition peut seule me faire accepter votre silence.
Le beau temps a disparu. La pluie revient dix fois par jour. Je me promène pourtant. Les bons intervalles ne manquent pas. Je me lève de bonne heure. J’écris ; ma toilette, la prière. Nous déjeunerons à 11 heures. Promenade. Je fais mes affaires de maison et de jardin. Je remonte dans mon cabinet à une heure. J'y reste, sauf les visites. Nous dînons à 7 heures. Je me couche à 10. Quand le flot des visites se sera ralenti, j'aurai assez de temps pour travailler. Je veux faire beaucoup de choses. Adieu jusqu'à la poste.
Je suis bien aise que votre fils soit revenu. N'allez pourtant pas souvent à Londres si le choléra y persiste. Je crois que vous pouvez affranchir vos lettres. Mes filles en reçoivent souvent de leurs amies Boileau qui arrivent très exactement. Je vous le dis sans scrupule, car je suis écrasé de ports de lettres. Si nous apercevons la moindre inexactitude, nous cesserons.
Onze heures
Deux lettres. Le dimanche et le lundi viennent ensemble le Mercredi. Vous avez raison. Deux lettres et une seule enveloppe. Et deux lettres longues, charmantes. Adieu. Adieu. La poste m’apporte je ne sais combien de petites affaires qu’il faut faire tout de suite. Adieu. Adieu. G.
8 heures
C’est évidemment à cause du Dimanche que je n'ai pas eu de lettre hier. Dans mon impatience, j’avais mal fait mon calcul. La poste n'est pas partie de Londres dimanche.
La petite scène du Havre a bien tourné. De bons juges m’écrivent de Paris : " Tout compté et bien compté, ce n'est point à regretter. Puisqu'il n’y a rien eu de grave autant vaut au risque de quelques embarras et de quelques inquiétudes, que vos éternels adversaires vos ennemis naturels aient fait la faute de provoquer ce qui a houleusement échoué. Il ne faut pas regretter l'éclat qu’ils ont donné à votre rentrée. Votre retour en France est un fait considérable. Il est considérable pour vos amis comme pour vous-même, en raison de votre passé et probablement aussi en raison de vôtre avenir. On l’a compris on le comprend, et l'on n'a pas su dissimuler sa mauvaise humeur. Encore une fois, tant mieux. "
Je n'ai encore lu Aberdeen et Brougham que dans le Journal des Débats. Mais ce que j'ai admiré, c’est Lord Palmerston sur l’Autriche. Quel aplomb, pour parler poliment ! Il a raison, puisqu'on l’écoute sans lui répondre. Il y a des gens qui lorsqu'ils ont fait des sottises en disant leur mea culpa, comme M. de Montalembert. Lord Palmerston se glorifie, en s’indignant qu'on l'ait cru capable de ce qu’il a fait. Vous voyez bien que le Pape rentrera à ses propres conditions. Pas plus à Paris qu'à Vienne, on ne lui demandera de partager sa souveraineté. J'étais bien violemment attaqué il y a dix-huit mois pour avoir écrit à M. Rossi qu’il ne devait ni ne pouvait le faire. Que de peine se donnent, et que de mal se font les hommes avant de revenir à l'idée juste qui leur aurait tout épargné. Adam Smith dit quelque part : " Telle est l’insolence naturelle de l'homme qu'il ne consent à employer les bons moyens qu'après avoir épuisé les mauvais. "
Je reçois toujours beaucoup de visites. Evidemment ; mes amis n’ont pas peur. Comme je ne mettrai pas leur courage à l'épreuve, il aura le temps de s'affermir. J’attends demain Armand Bertin. vous ne me donnez pas assez de détails sur votre santé. Je les demande à moins que vous ne me disiez que, moins vous en parlez mieux vous vous portez. Votre superstition peut seule me faire accepter votre silence.
Le beau temps a disparu. La pluie revient dix fois par jour. Je me promène pourtant. Les bons intervalles ne manquent pas. Je me lève de bonne heure. J’écris ; ma toilette, la prière. Nous déjeunerons à 11 heures. Promenade. Je fais mes affaires de maison et de jardin. Je remonte dans mon cabinet à une heure. J'y reste, sauf les visites. Nous dînons à 7 heures. Je me couche à 10. Quand le flot des visites se sera ralenti, j'aurai assez de temps pour travailler. Je veux faire beaucoup de choses. Adieu jusqu'à la poste.
Je suis bien aise que votre fils soit revenu. N'allez pourtant pas souvent à Londres si le choléra y persiste. Je crois que vous pouvez affranchir vos lettres. Mes filles en reçoivent souvent de leurs amies Boileau qui arrivent très exactement. Je vous le dis sans scrupule, car je suis écrasé de ports de lettres. Si nous apercevons la moindre inexactitude, nous cesserons.
Onze heures
Deux lettres. Le dimanche et le lundi viennent ensemble le Mercredi. Vous avez raison. Deux lettres et une seule enveloppe. Et deux lettres longues, charmantes. Adieu. Adieu. La poste m’apporte je ne sais combien de petites affaires qu’il faut faire tout de suite. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 25 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 25 Juillet 1849
8 heures et demie du soir.
Nous venons de dîner. On fait de la musique dans le salon. Je remonte pour vous écrire. Bertin et Génie arrivent demain de très bonne heure et repartent le soir. Ils me prendront ma journée. C’est une affaire que cette visite de Bertin au Val Richer.
De sa personne, il est sauvage et se refuse aux avances. Il a refusé tout à l'heure d'aller à l’Elysée. A propos d'’Elysée, que dîtes-vous du discours du Président à Ham ? Montalembert n’est qu'un petit garçon en fait de mea culpa. Si cette mode prend. Dieu sait ce que nous entendrons. Mais je crois que le Président gardera la palme. J'ai enfin reçu mon Galignani et je viens de lire la séance des Communes. Je comprends les colères dont vous me parlez. Mais en vérité un parti conservateur, qui se laisse dire tout cela sans ouvrir la bouche, mérite bien qu’on le lui dise. Il était si aisé de concéder ce que la cause des Hongrois à de juste, et de frapper ensuite d’autant plus fort sur ce qu'elle a de révolutionnaire. L’esprit révolutionnaire est un poison qui infecte et déshonore, et perd de nos jours toutes les bonnes causes. Un rebelle (gardez m'en le secret) ; peut quelques fois avoir raison, un Jacobin jamais Tous les rebelles de notre temps deviennent en huit jours des Jacobins, s'ils ne l’étaient pas le premier jour.
Jeudi matin. 7 heures
Mad de Metternich et Madame de Flahaut m'amusent. Faites exprès pour se quereller. Mad de Mett serait battue. Il y a encore de la femme en elle et beaucoup d'enfant gâté. Ni de l'un ni de l'autre dans Mad. de Flah. Un vieux sergent de mauvais caractère, et toujours de mauvaise humeur. Je sais gré à Mad. Delmas de ses soins. Trouvez, je vous prie l'occasion de leur dire un mot de politesse de ma part. Malgré l'horreur de l'aveugle pour les constitutions.
Je ne me promène seul que dans mon jardin. Soyez tranquille ; je serai attentif. Je suis sûr, et tout me le prouve que la disposition générale du pays est bonne pour moi. Mais, dans la meilleure disposition générale, il y a toujours autant de coquins, et de fous qu’il en faut. Je suis décidé à me préserver pour vous et à me réserver pour je ne sais quoi. Mad. Lenormant m'écrit : " Au nom du ciel et au nom de la France, gardez votre situation hors de tout. Réservez-vous. Le duc de Noailles me charge expressément de vous le dire. " Et elle ajoute : " Je ne puis vous dire assez quel ami admirable, dévoué, courageux, s'est montré, pour la mémoire de ma pauvre tante et pour moi, cet excellent duc de Noailles dans la circonstance de mon triste procès. Il vient de nous quitter, et il était hier à Paris faisant son troisième voyage pour m'aider de ses conseils, de ses démarches et de son affection. Il a fait avec moi les visites aux magistrats. Il a voulu que se femme aussi témoignât dans l'affaire, et il y a une lettre d’elle dans le dossier de Chaix d'Estange. Dans ce temps de mollesse et d’indifférence de semblables témoignages de respects, de souvenir, et d’amitié sont bien rares. Il a bien envie de causer avec vous. Ce serait désirable et nécessaire. Comment cela se pourrait-il ? C’est ce que je ne sais guères, ni l’un ni l'autre de vous ne pouvant en ce moment aller l’un chez l'autre. »
Je suis bien décidé, quant à présent. à ne point sortir de chez moi. Onze heures Bertin est arrivé. Puis Salvandy. Voilà la poste. Je n’ai que le temps de fermer ma lettre. Mes hôtes repartent ce soir. Adieu. Adieu. Que j’aime votre lettre ! Bien moins que vous pourtant. Adieu. G.
8 heures et demie du soir.
Nous venons de dîner. On fait de la musique dans le salon. Je remonte pour vous écrire. Bertin et Génie arrivent demain de très bonne heure et repartent le soir. Ils me prendront ma journée. C’est une affaire que cette visite de Bertin au Val Richer.
De sa personne, il est sauvage et se refuse aux avances. Il a refusé tout à l'heure d'aller à l’Elysée. A propos d'’Elysée, que dîtes-vous du discours du Président à Ham ? Montalembert n’est qu'un petit garçon en fait de mea culpa. Si cette mode prend. Dieu sait ce que nous entendrons. Mais je crois que le Président gardera la palme. J'ai enfin reçu mon Galignani et je viens de lire la séance des Communes. Je comprends les colères dont vous me parlez. Mais en vérité un parti conservateur, qui se laisse dire tout cela sans ouvrir la bouche, mérite bien qu’on le lui dise. Il était si aisé de concéder ce que la cause des Hongrois à de juste, et de frapper ensuite d’autant plus fort sur ce qu'elle a de révolutionnaire. L’esprit révolutionnaire est un poison qui infecte et déshonore, et perd de nos jours toutes les bonnes causes. Un rebelle (gardez m'en le secret) ; peut quelques fois avoir raison, un Jacobin jamais Tous les rebelles de notre temps deviennent en huit jours des Jacobins, s'ils ne l’étaient pas le premier jour.
Jeudi matin. 7 heures
Mad de Metternich et Madame de Flahaut m'amusent. Faites exprès pour se quereller. Mad de Mett serait battue. Il y a encore de la femme en elle et beaucoup d'enfant gâté. Ni de l'un ni de l'autre dans Mad. de Flah. Un vieux sergent de mauvais caractère, et toujours de mauvaise humeur. Je sais gré à Mad. Delmas de ses soins. Trouvez, je vous prie l'occasion de leur dire un mot de politesse de ma part. Malgré l'horreur de l'aveugle pour les constitutions.
Je ne me promène seul que dans mon jardin. Soyez tranquille ; je serai attentif. Je suis sûr, et tout me le prouve que la disposition générale du pays est bonne pour moi. Mais, dans la meilleure disposition générale, il y a toujours autant de coquins, et de fous qu’il en faut. Je suis décidé à me préserver pour vous et à me réserver pour je ne sais quoi. Mad. Lenormant m'écrit : " Au nom du ciel et au nom de la France, gardez votre situation hors de tout. Réservez-vous. Le duc de Noailles me charge expressément de vous le dire. " Et elle ajoute : " Je ne puis vous dire assez quel ami admirable, dévoué, courageux, s'est montré, pour la mémoire de ma pauvre tante et pour moi, cet excellent duc de Noailles dans la circonstance de mon triste procès. Il vient de nous quitter, et il était hier à Paris faisant son troisième voyage pour m'aider de ses conseils, de ses démarches et de son affection. Il a fait avec moi les visites aux magistrats. Il a voulu que se femme aussi témoignât dans l'affaire, et il y a une lettre d’elle dans le dossier de Chaix d'Estange. Dans ce temps de mollesse et d’indifférence de semblables témoignages de respects, de souvenir, et d’amitié sont bien rares. Il a bien envie de causer avec vous. Ce serait désirable et nécessaire. Comment cela se pourrait-il ? C’est ce que je ne sais guères, ni l’un ni l'autre de vous ne pouvant en ce moment aller l’un chez l'autre. »
Je suis bien décidé, quant à présent. à ne point sortir de chez moi. Onze heures Bertin est arrivé. Puis Salvandy. Voilà la poste. Je n’ai que le temps de fermer ma lettre. Mes hôtes repartent ce soir. Adieu. Adieu. Que j’aime votre lettre ! Bien moins que vous pourtant. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 3 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 3 nov. 1849
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 8 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 8 nov. 1851
Vous me permettez du bien petit papier, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup à faire ces jours-ci. Je veux absolument avoir fini mon discours, et je l'aurai fini. Une visite de matinée à Lisieux, chez les gens qui m'ont donné à dîner. Une visite. dans mes champs, avec mon fermier et mon homme d'affaires, pour voir s’ils sont bien cultivés et en bon état. Riez si vous voulez, de ma science agricole ; elle me prend mon temps comme si elle était bien profonde.
Je lis tout ce que vous m'écrivez, vous et Marion, tout ce qui me vient d'ailleurs, tout ce que me disent mes dix ou douze journaux ; je ne vois pas de raison de changer mon impression et mon pronostic. Je crois la situation où je suis en ce moment très bonne pour juger sainement. Bien informé des faits et loin du bruit. J’y vais rentrer. Je tâcherai de ne pas m'en laisser étourdir au milieu du bruit, on oublie le plus grand des faits, l'état réel du pays lui-même, et on fait des sottises dont on est averti par des catastrophes.
Je sais bon gré à ce bon Alexandre de sa résignation. Je me préoccupe de la situation de votre fils Paul. Nous en causerons si vous voulez et si cette conversation ne vous agite pas trop.
A tout prendre, j’aime mieux que Lord John ne vienne pas à Paris. Dieu sait ce qu’il aurait dit ou conseillé au Président. Les Anglais n'entendent rien à nos affaires et pourtant leurs paroles ont toujours du poids. Vous êtes vous fait lire le discours de Louis Blanc à Londres dans l’une des fêtes de Kossuth ? C'est le vrai programme du parti au moins des émigrés du parti ; il feront ce qu’ils pourront en 1852 pour soulever une grande prise d’armes à moins que nous ne le fassions exprès de les faire réussir, ils échoueront ; mais ils ne pensent guère laisser passer cette époque sans protester contre les anciens échecs.
4 heures
Nous avons bien les mêmes instincts. J’ai été frappé et désolé des fautes qui commencent. Adieu, adieu. Je suis chaque jour plus pressé de vous retrouver. Adieu. G.
Vous me permettez du bien petit papier, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup à faire ces jours-ci. Je veux absolument avoir fini mon discours, et je l'aurai fini. Une visite de matinée à Lisieux, chez les gens qui m'ont donné à dîner. Une visite. dans mes champs, avec mon fermier et mon homme d'affaires, pour voir s’ils sont bien cultivés et en bon état. Riez si vous voulez, de ma science agricole ; elle me prend mon temps comme si elle était bien profonde.
Je lis tout ce que vous m'écrivez, vous et Marion, tout ce qui me vient d'ailleurs, tout ce que me disent mes dix ou douze journaux ; je ne vois pas de raison de changer mon impression et mon pronostic. Je crois la situation où je suis en ce moment très bonne pour juger sainement. Bien informé des faits et loin du bruit. J’y vais rentrer. Je tâcherai de ne pas m'en laisser étourdir au milieu du bruit, on oublie le plus grand des faits, l'état réel du pays lui-même, et on fait des sottises dont on est averti par des catastrophes.
Je sais bon gré à ce bon Alexandre de sa résignation. Je me préoccupe de la situation de votre fils Paul. Nous en causerons si vous voulez et si cette conversation ne vous agite pas trop.
A tout prendre, j’aime mieux que Lord John ne vienne pas à Paris. Dieu sait ce qu’il aurait dit ou conseillé au Président. Les Anglais n'entendent rien à nos affaires et pourtant leurs paroles ont toujours du poids. Vous êtes vous fait lire le discours de Louis Blanc à Londres dans l’une des fêtes de Kossuth ? C'est le vrai programme du parti au moins des émigrés du parti ; il feront ce qu’ils pourront en 1852 pour soulever une grande prise d’armes à moins que nous ne le fassions exprès de les faire réussir, ils échoueront ; mais ils ne pensent guère laisser passer cette époque sans protester contre les anciens échecs.
4 heures
Nous avons bien les mêmes instincts. J’ai été frappé et désolé des fautes qui commencent. Adieu, adieu. Je suis chaque jour plus pressé de vous retrouver. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 13 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer samedi 13 octobre 1849
8 heures
Vous arrivez aujourd'hui à Londres. Réglons notre avenir notre prochain avenir. Vous serez le 16 à Folkstone, le 17 à Boulogne, le 18 à Paris. Mad Austin m’arrive le 19 au Val Richer, pour traduire, mon ouvrage sous mes yeux. Il me faut 36 heures pour la mettre en train. Je ne puis partir que le dimanche 21 pour vous voir lundi 22. Je ne pourrai rester à Paris que deux jours. Il faudra que je revienne ici pour achever, mon travail et surveiller la traduction. Je comptais rester au Val Richer, jusqu'à la fin de Novembre, et quelques jours employés à une course à Paris me mettront en retard, par conséquent dans l'impossibilité d'y revenir plutôt. Si au contraire, je ne me détourne pas de mon travail, le 21 Octobre, je pourrai avancer mon retour définitif à Paris. J'y reviendrai alors décidément, le 15 ou le 16 novembre. Je prends le choix des deux jours à cause de l’incertitude des diligences où il me faut beaucoup de places. Il me semble que cela vaut mieux. Si vous étiez revenue à Paris vers le milieu de septembre, selon votre premier projet, il n’y avait pas à hésiter ; notre réunion définitive était trop loin ; j’allais vous voir sur le champ, ne fût-ce que pour deux jours. Vous ne revenez que le 18 octobre. Je puis, en ne m'interrompant pas dans mes affaires d’ici, travail et traduction, retourner définitivement à Paris, le 15 novembre. Ne vaut-il pas mieux faire cela que nous donner deux jours le 22 octobre pour retarder ensuite de quinze jours ou trois semaines notre réunion définitive ? Point de mauvais sentiment, point d'injuste méfiance, je vous en conjure. Le bonheur de vous retrouver de reprendre nos douces habitudes est ma première, ma constante pensée. Que vous y croyiez, ou que vous n'y croyiez pas absolument, que vous en jouissiez ou que vous n'en jouissiez pas parfaitement, il n’en sera pas moins vrai que vous êtes tout ce qui m'est le plus cher, et le plus nécessaire, qu'avec vous seule et auprès de vous seule je suis heureux. Je le sais, moi, je le sens ; et ni vos doutes, ni vos mauvais accès ne changeront rien ni à la réalité, ni à mon sentiment à moi. Laissez-les donc tout-à-fait, sans retour. Ayez confiance et jouissons ensemble de notre affection avec tout le bonheur que la confiance seule peut donner. Nous ne sommes que trop séparés ; trop de nécessités pèsent sur moi, et ne me laissent pas la pleine disposition de moi-même. N'y ajoutons rien dearest. Ne supposez pas que je renonce facilement à vous voir tout de suite après votre retour à Paris, que vous en êtes plus impatiente que moi. Je vous crie d’ici injustice ! Injustice ! Vous voyez ; je vais au devant des impressions qui, si j'étais près de vous me désoleraient et me charmeraient en même temps, car tout ce qui me montre votre affection me charme même votre injustice qui me désole. Mais point d'injustice ; pleine confiance. Cela est mille fois plus doux et il n’y a que cela qui ait raison. Je ne vous parle pas d’autre chose ce matin. Le beau temps est revenu, par un air presque froid. Je voudrais bien cela pour votre traversée. Et je vous voudrais bien Guéneau de Mussy. Je n’ai pas osé lui écrire pour le lui demander formellement. Il aurait été trop embarrassé à me le refuser, s'il ne l’avait pas pu. Mais je voudrais bien qu’il le pût.
Onze heures
Pas de lettre Pourquoi ? Je ne le saurai que demain. C'est bien déplaisant ; adieu, adieu. G.
8 heures
Vous arrivez aujourd'hui à Londres. Réglons notre avenir notre prochain avenir. Vous serez le 16 à Folkstone, le 17 à Boulogne, le 18 à Paris. Mad Austin m’arrive le 19 au Val Richer, pour traduire, mon ouvrage sous mes yeux. Il me faut 36 heures pour la mettre en train. Je ne puis partir que le dimanche 21 pour vous voir lundi 22. Je ne pourrai rester à Paris que deux jours. Il faudra que je revienne ici pour achever, mon travail et surveiller la traduction. Je comptais rester au Val Richer, jusqu'à la fin de Novembre, et quelques jours employés à une course à Paris me mettront en retard, par conséquent dans l'impossibilité d'y revenir plutôt. Si au contraire, je ne me détourne pas de mon travail, le 21 Octobre, je pourrai avancer mon retour définitif à Paris. J'y reviendrai alors décidément, le 15 ou le 16 novembre. Je prends le choix des deux jours à cause de l’incertitude des diligences où il me faut beaucoup de places. Il me semble que cela vaut mieux. Si vous étiez revenue à Paris vers le milieu de septembre, selon votre premier projet, il n’y avait pas à hésiter ; notre réunion définitive était trop loin ; j’allais vous voir sur le champ, ne fût-ce que pour deux jours. Vous ne revenez que le 18 octobre. Je puis, en ne m'interrompant pas dans mes affaires d’ici, travail et traduction, retourner définitivement à Paris, le 15 novembre. Ne vaut-il pas mieux faire cela que nous donner deux jours le 22 octobre pour retarder ensuite de quinze jours ou trois semaines notre réunion définitive ? Point de mauvais sentiment, point d'injuste méfiance, je vous en conjure. Le bonheur de vous retrouver de reprendre nos douces habitudes est ma première, ma constante pensée. Que vous y croyiez, ou que vous n'y croyiez pas absolument, que vous en jouissiez ou que vous n'en jouissiez pas parfaitement, il n’en sera pas moins vrai que vous êtes tout ce qui m'est le plus cher, et le plus nécessaire, qu'avec vous seule et auprès de vous seule je suis heureux. Je le sais, moi, je le sens ; et ni vos doutes, ni vos mauvais accès ne changeront rien ni à la réalité, ni à mon sentiment à moi. Laissez-les donc tout-à-fait, sans retour. Ayez confiance et jouissons ensemble de notre affection avec tout le bonheur que la confiance seule peut donner. Nous ne sommes que trop séparés ; trop de nécessités pèsent sur moi, et ne me laissent pas la pleine disposition de moi-même. N'y ajoutons rien dearest. Ne supposez pas que je renonce facilement à vous voir tout de suite après votre retour à Paris, que vous en êtes plus impatiente que moi. Je vous crie d’ici injustice ! Injustice ! Vous voyez ; je vais au devant des impressions qui, si j'étais près de vous me désoleraient et me charmeraient en même temps, car tout ce qui me montre votre affection me charme même votre injustice qui me désole. Mais point d'injustice ; pleine confiance. Cela est mille fois plus doux et il n’y a que cela qui ait raison. Je ne vous parle pas d’autre chose ce matin. Le beau temps est revenu, par un air presque froid. Je voudrais bien cela pour votre traversée. Et je vous voudrais bien Guéneau de Mussy. Je n’ai pas osé lui écrire pour le lui demander formellement. Il aurait été trop embarrassé à me le refuser, s'il ne l’avait pas pu. Mais je voudrais bien qu’il le pût.
Onze heures
Pas de lettre Pourquoi ? Je ne le saurai que demain. C'est bien déplaisant ; adieu, adieu. G.
Val-Richer, Samedi 25 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Samedi 25 octobre 1851
Vous n'aurez aujourd’hui que quelques lignes. Je pars après déjeuner pour Falaise où l’on me donne un dîner choisi ; et demain Guillaume le conquérant. Il faut que je me promène ce matin dans mon jardin pour arranger mon discours, car à Falaise je n'aurai pas un moment de loisir. Vous avez bien mal traité la statue du Roi ; on m'a dit qu'elle est belle. Je suis décidé à la trouver.
La Dauphine me revient toujours depuis hier. Deux choses me touchent également ; la grandeur vertueuse, et malheureuse ; la vertu et le malheur dans une condition pauvre et obscure. Dit-on si elle a regretté de mourir, et si elle espérait beaucoup revoir en France son neveu, et aller elle-même à Saint Denis ? Je ne puis pas ne pas être sûr qu'on fera à Claremont tout ce qui convient. Je suppose qu’à Paris toute la société monarchique prendra le deuil, indistinctement.
Voilà l’arrêt au Conseil de Guerre de Lyon confirmé par le Conseil de révision et la double fermeté du Président mise à l’épreuve. Enverra-t-il à Noukahiva, M. Genti et ses complices ? Adieu.
Je vais me promener. Onze heures Je suis bien impatient de la réponse de Pétersbourg. J’espère qu'elle sera bonne et qu'elle calmera un peu vos nerfs. Que devient la lettre que le duc de Noailles devait m'écrire le lendemain ? Soyez tranquille sur Falaise. Adieu, Adieu.
Je vous écrirai demain de Falaise. Je reviendrai ici lundi matin, de bonne heure. Adieu. G.
Vous n'aurez aujourd’hui que quelques lignes. Je pars après déjeuner pour Falaise où l’on me donne un dîner choisi ; et demain Guillaume le conquérant. Il faut que je me promène ce matin dans mon jardin pour arranger mon discours, car à Falaise je n'aurai pas un moment de loisir. Vous avez bien mal traité la statue du Roi ; on m'a dit qu'elle est belle. Je suis décidé à la trouver.
La Dauphine me revient toujours depuis hier. Deux choses me touchent également ; la grandeur vertueuse, et malheureuse ; la vertu et le malheur dans une condition pauvre et obscure. Dit-on si elle a regretté de mourir, et si elle espérait beaucoup revoir en France son neveu, et aller elle-même à Saint Denis ? Je ne puis pas ne pas être sûr qu'on fera à Claremont tout ce qui convient. Je suppose qu’à Paris toute la société monarchique prendra le deuil, indistinctement.
Voilà l’arrêt au Conseil de Guerre de Lyon confirmé par le Conseil de révision et la double fermeté du Président mise à l’épreuve. Enverra-t-il à Noukahiva, M. Genti et ses complices ? Adieu.
Je vais me promener. Onze heures Je suis bien impatient de la réponse de Pétersbourg. J’espère qu'elle sera bonne et qu'elle calmera un peu vos nerfs. Que devient la lettre que le duc de Noailles devait m'écrire le lendemain ? Soyez tranquille sur Falaise. Adieu, Adieu.
Je vous écrirai demain de Falaise. Je reviendrai ici lundi matin, de bonne heure. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 29 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 29 Juin 1850
6 heures
Je viens de me promener une heure seul. Après vous, ce que j'aime le mieux, c’est la solitude. Je crois bien que je finirais par m'en lasser. Mais ce serait long. Mon passé est très plein, et je lui porte de l'affection. J’ai encore assez de curiosité pour l'avenir. Je ne prouve point de vide.
Aujourd’hui, ni vous, ni les journaux ne m’avez rien apporté de Londres. En y regardant bien, ce que j'ai vraiment le plus à coeur dans cette affaire c'est de voir triompher la justice et la vérité. Elles veulent la ruine de Palmerston. J'estime l'Angleterre. Cela me déplaît qu'elle ne sache pas faire droit. Ce que j’ai de personnel contre Lord Palmerston est bien à la surface et j'y pense bien peu.
Je viens de relire et de mettre tout à fait en ordre, cette étude sur Monk qu’on me demande de réimprimer. Elle n’a jamais été publié que dans un recueil intitulé la Revue française, en 1837. Elle est enfouie là. C’est une scène de grande Comédie, un soldat, sensé, fin et taciturne, décidé à rétablir le Roi sans tirer un coup de fusil, et pendant plus de six mois trompant tous ceux qui n'en veulent pas et faisant taire tous ceux qui en veulent. C'est piquant à lire aujourd’hui, et amusant pour les gens d'esprit. Pas d'assez grosses couleurs pour le gros public. Aucune recherche d'allusions. D'ailleurs les temps et les pays sont très différents. On y cherchera des malices qu'on y trouvera pas ; et on ne verra pas toutes celles qui y sont.
Dimanche 30 Juin
J'ai des lettres de Londres d'une bonne source que vous connaissez et d'accord avec les vôtres. « C’est un débat sans exemple car il n'est dirigé par aucun esprit de parti, par aucun chef politique ; c'est le sentiment national du droit qui se fait jour avec une puissance irrésistible. Il a dicté le vote de la house of Lords ; il laissera le Ministère dans une bien faible majorité à l'autre chambre. On espérait hier 25 voix, aujourd'hui 15. Les discours de Gladstone et de Molesworth out surtout obtenu un grand succès. Le Gouvernement n'a le secours d’aucun membre indépendant. si ce n'est de gens comme Rocbuck et Bernal Osborne. Bref, on compte aujourd’hui sur une victoire morale complète sur l'ennemi, et sur un vote qui rendra à peu près impossible le maintien du Cabinet Rusell. Lord Stanley échouera s’il essaie de composer un Cabinet sans les free traders, et je crois qu’un remaniement Whig avec Graham & & aura plus de chances de succès. "
J’ai aussi de bonnes nouvelles, de St Léonard. Dumas m'écrit : " L'amélioration dans la santé du Roi s'est soutenue et progressivement développée. Le sommeil est revenu, la toux a disparu, les fonctions de l’estomac se font mieux ; les forces reviennent lentement mais elles reviennent surtout depuis trois jours. J'espère que le Roi reviendra sinon à un rétablissement complet, au moins à un état relativement bon et durable, avec les soins dont il est entouré. " Dumas était un des plus inquiets. C’est vraiment bien dommage que vous partiez dans ce moment. Mais vous avez raison de ne pas rester en l’air. Rien ne vous est plus contraire.
Les rois et les reines ont trop de malheur. Les coup de pistolet, encore passe ; mais des coups de canne ! Adieu, adieu. Je vous obéis ; j'écris toujours à Paris. J'en conclus que vous partirez au plutôt demain soir. Adieu.
6 heures
Je viens de me promener une heure seul. Après vous, ce que j'aime le mieux, c’est la solitude. Je crois bien que je finirais par m'en lasser. Mais ce serait long. Mon passé est très plein, et je lui porte de l'affection. J’ai encore assez de curiosité pour l'avenir. Je ne prouve point de vide.
Aujourd’hui, ni vous, ni les journaux ne m’avez rien apporté de Londres. En y regardant bien, ce que j'ai vraiment le plus à coeur dans cette affaire c'est de voir triompher la justice et la vérité. Elles veulent la ruine de Palmerston. J'estime l'Angleterre. Cela me déplaît qu'elle ne sache pas faire droit. Ce que j’ai de personnel contre Lord Palmerston est bien à la surface et j'y pense bien peu.
Je viens de relire et de mettre tout à fait en ordre, cette étude sur Monk qu’on me demande de réimprimer. Elle n’a jamais été publié que dans un recueil intitulé la Revue française, en 1837. Elle est enfouie là. C’est une scène de grande Comédie, un soldat, sensé, fin et taciturne, décidé à rétablir le Roi sans tirer un coup de fusil, et pendant plus de six mois trompant tous ceux qui n'en veulent pas et faisant taire tous ceux qui en veulent. C'est piquant à lire aujourd’hui, et amusant pour les gens d'esprit. Pas d'assez grosses couleurs pour le gros public. Aucune recherche d'allusions. D'ailleurs les temps et les pays sont très différents. On y cherchera des malices qu'on y trouvera pas ; et on ne verra pas toutes celles qui y sont.
Dimanche 30 Juin
J'ai des lettres de Londres d'une bonne source que vous connaissez et d'accord avec les vôtres. « C’est un débat sans exemple car il n'est dirigé par aucun esprit de parti, par aucun chef politique ; c'est le sentiment national du droit qui se fait jour avec une puissance irrésistible. Il a dicté le vote de la house of Lords ; il laissera le Ministère dans une bien faible majorité à l'autre chambre. On espérait hier 25 voix, aujourd'hui 15. Les discours de Gladstone et de Molesworth out surtout obtenu un grand succès. Le Gouvernement n'a le secours d’aucun membre indépendant. si ce n'est de gens comme Rocbuck et Bernal Osborne. Bref, on compte aujourd’hui sur une victoire morale complète sur l'ennemi, et sur un vote qui rendra à peu près impossible le maintien du Cabinet Rusell. Lord Stanley échouera s’il essaie de composer un Cabinet sans les free traders, et je crois qu’un remaniement Whig avec Graham & & aura plus de chances de succès. "
J’ai aussi de bonnes nouvelles, de St Léonard. Dumas m'écrit : " L'amélioration dans la santé du Roi s'est soutenue et progressivement développée. Le sommeil est revenu, la toux a disparu, les fonctions de l’estomac se font mieux ; les forces reviennent lentement mais elles reviennent surtout depuis trois jours. J'espère que le Roi reviendra sinon à un rétablissement complet, au moins à un état relativement bon et durable, avec les soins dont il est entouré. " Dumas était un des plus inquiets. C’est vraiment bien dommage que vous partiez dans ce moment. Mais vous avez raison de ne pas rester en l’air. Rien ne vous est plus contraire.
Les rois et les reines ont trop de malheur. Les coup de pistolet, encore passe ; mais des coups de canne ! Adieu, adieu. Je vous obéis ; j'écris toujours à Paris. J'en conclus que vous partirez au plutôt demain soir. Adieu.
Val-Richer, Vendredi 3 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 3 août 1849
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 7 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 7 nov. 1851
Le message est profondément médiocre. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un manque de dédain pour l'Assemblée. C’est tout bonnement de la médiocrité naturelle. Les articles du Dr Véron valaient mieux. Je ne trouve pas non plus que Berryer ait bien conduit sa première attaque. Il a été long, confus et hésitant. Mais si j'étais à Paris, je ne dirais pas cela. L’esprit de critique nous domine, et nous sacrifions tout au plaisir de tirer les uns sur les autres. Sur la physionomie de ce début, je crois moins que jamais à de grands coups, de l’une ou de l'autre part. On ne disserte pas si longuement et si froidement, au moment de telles révolutions. Elles sont précédées, ou par de grands signes de passion ou par de grands silences. La montagne épousant systématiquement le Président et sa mesure, cela est significatif et pourrait devenir important. Je doute que cela tienne. Le Président n'en fera pas assez pour eux et ils ne seront jamais pour lui ce qu’il veut, sa réélection. Chacun finira par rentrer dans son ornière.
J’ai mal dormi cette nuit, pas tout-à-fait par les mêmes raisons que vous. Je cherchais deux paragraphes de ma réponse à M. de Montalembert. Ils m'ont réveillé à 2 heures ; je les ai trouvés, je me suis levé, je les ai écrits, et je me suis recouché, pour mal dormir, mais pour dormir pourtant.
Le froid commence. Il gèle fort la nuit. Je vois fumer en ce moment le tuyau de ma serre. Il n’y a plus de fleurs que là. Il est bien temps d'aller retrouver ma petite maison chaude. Je ne vous écrirai plus que trois fois. Je voulais porter d’ici à Marion une belle rose en signe de ma reconnaissance. La gelée me les a flétries. Elle a bien raison d’ajouter à votre lettre des détails sur votre santé. C’est un arrangement excellent, et dont je la remercie encore.
J’ai fait ces jours-ci quelque chose d'extraordinaire dans mes moments de repos, et pour me délasser de mon travail. J’ai lu deux romans, David Copperfield de Dickens et Grantley Manor, de Lady Georgina Fullerton. Le premier est remarquablement spirituel, vrai varié et pathétique ; plein, seulement de trop d'observations et de moralités microscopiques. Le commun des hommes ne vaut pas qu'on en fasse de si minutieux portraits. Pour mon goût, j’aime bien mieux le roman de Lady Georgina, la société et la nature humaine élevée, élégante et un peu héroïque ; mais elle a l’esprit bien moins riche et bien moins vrai que Dickens. Qu'est-ce que cela vous fait à vous qui n’avez lu et ne lirez ni l'un, ni l’autre.
Onze heures et demie
Décidément mon facteur vient plus tard ; mais peu m'importe à présent. Adieu, Adieu. Je voudrais bien que vous ne violassiez pas trop les règles de Chomel. Adieu. G.
Le message est profondément médiocre. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un manque de dédain pour l'Assemblée. C’est tout bonnement de la médiocrité naturelle. Les articles du Dr Véron valaient mieux. Je ne trouve pas non plus que Berryer ait bien conduit sa première attaque. Il a été long, confus et hésitant. Mais si j'étais à Paris, je ne dirais pas cela. L’esprit de critique nous domine, et nous sacrifions tout au plaisir de tirer les uns sur les autres. Sur la physionomie de ce début, je crois moins que jamais à de grands coups, de l’une ou de l'autre part. On ne disserte pas si longuement et si froidement, au moment de telles révolutions. Elles sont précédées, ou par de grands signes de passion ou par de grands silences. La montagne épousant systématiquement le Président et sa mesure, cela est significatif et pourrait devenir important. Je doute que cela tienne. Le Président n'en fera pas assez pour eux et ils ne seront jamais pour lui ce qu’il veut, sa réélection. Chacun finira par rentrer dans son ornière.
J’ai mal dormi cette nuit, pas tout-à-fait par les mêmes raisons que vous. Je cherchais deux paragraphes de ma réponse à M. de Montalembert. Ils m'ont réveillé à 2 heures ; je les ai trouvés, je me suis levé, je les ai écrits, et je me suis recouché, pour mal dormir, mais pour dormir pourtant.
Le froid commence. Il gèle fort la nuit. Je vois fumer en ce moment le tuyau de ma serre. Il n’y a plus de fleurs que là. Il est bien temps d'aller retrouver ma petite maison chaude. Je ne vous écrirai plus que trois fois. Je voulais porter d’ici à Marion une belle rose en signe de ma reconnaissance. La gelée me les a flétries. Elle a bien raison d’ajouter à votre lettre des détails sur votre santé. C’est un arrangement excellent, et dont je la remercie encore.
J’ai fait ces jours-ci quelque chose d'extraordinaire dans mes moments de repos, et pour me délasser de mon travail. J’ai lu deux romans, David Copperfield de Dickens et Grantley Manor, de Lady Georgina Fullerton. Le premier est remarquablement spirituel, vrai varié et pathétique ; plein, seulement de trop d'observations et de moralités microscopiques. Le commun des hommes ne vaut pas qu'on en fasse de si minutieux portraits. Pour mon goût, j’aime bien mieux le roman de Lady Georgina, la société et la nature humaine élevée, élégante et un peu héroïque ; mais elle a l’esprit bien moins riche et bien moins vrai que Dickens. Qu'est-ce que cela vous fait à vous qui n’avez lu et ne lirez ni l'un, ni l’autre.
Onze heures et demie
Décidément mon facteur vient plus tard ; mais peu m'importe à présent. Adieu, Adieu. Je voudrais bien que vous ne violassiez pas trop les règles de Chomel. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 18 octobre octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Voici l'enveloppe de votre lettre venue ce matin. Le cachet m'étonne et je vous l'envoie. Peut-être avez-vous cacheté votre lettre hors de chez vous. Sinon, c’est trop tard. On n'aura pas eu grand profit à lire l'incluse. Dites-moi, si cette petite tête aisée vient de vous ou d'un étourdi.
Morny s'est évidemment beaucoup servi de mon billet. Tout ce petit bruit des journaux vient de là. Je vous prie toutes les fois que vous en trouverez l'occasion de mettre la vérité à la place du bruit. Je ne cache rien de ce que je pense ; mais je n'accepte que ce que j'ai dit. Le jour où la bonne solution sera possible, je serai contre toute prolongation de pouvoir de qui que ce soit. Jusques là, je suis pour le maintien des seuls pouvoirs possibles, le Président et l'Assemblée. Et quand ils seront au pied du mur, Orléanistes et Légitimistes ensemble où chacun à son tour, seront forcément de cet avis, Bien maintenir ce qui est dans l’état provisoire, provisoire à courte échéance et le maintenir comme provisoire, il n'y a que cela de sensé.
J'envoie à Génie quatre pages de Préface pour le Washington sur la République, qui valent, je crois les dix pages que vous avez lues de la préface à Monk sur la Monarchie. Adieu, adieu, adieu, et encore.
G.
Val Richer 18 0ct. 1850
3 heures
Morny s'est évidemment beaucoup servi de mon billet. Tout ce petit bruit des journaux vient de là. Je vous prie toutes les fois que vous en trouverez l'occasion de mettre la vérité à la place du bruit. Je ne cache rien de ce que je pense ; mais je n'accepte que ce que j'ai dit. Le jour où la bonne solution sera possible, je serai contre toute prolongation de pouvoir de qui que ce soit. Jusques là, je suis pour le maintien des seuls pouvoirs possibles, le Président et l'Assemblée. Et quand ils seront au pied du mur, Orléanistes et Légitimistes ensemble où chacun à son tour, seront forcément de cet avis, Bien maintenir ce qui est dans l’état provisoire, provisoire à courte échéance et le maintenir comme provisoire, il n'y a que cela de sensé.
J'envoie à Génie quatre pages de Préface pour le Washington sur la République, qui valent, je crois les dix pages que vous avez lues de la préface à Monk sur la Monarchie. Adieu, adieu, adieu, et encore.
G.
Val Richer 18 0ct. 1850
3 heures
Val-Richer, Vendredi 20 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 20 sept 1850
Je suis charmé que les Danois soient victorieux. Les premiers bruits m’avaient inquiété. Si j'étais à portée, je voudrais savoir le fond des causes de l'obstination des Holsteinois. D'ici elle paraît si absurde qu'on ne la comprend pas. Car ils ne se font certainement pas tuer pour le seul plaisir d’Arnds et de Grimm et de tous ces unitaires Allemands qui ne leur envoient que de très minces secours. Cet acharnement d'un petit pays à ne pas vouloir de la paix, que veulent pour lui tous les grands états, a quelque chose qui n’est pas de notre temps. Je sais assez de l'affaire pour savoir qu'européennement les Danois ont raison. Je voudrais être aussi sûr que localement et selon les traditions et les lois des duchés, ils ont aussi tout-à-fait raison. Quand on n’est que spectateur, on a besoin d'avoir tout-à-fait raison, quand on est acteur, la lutte entraîne. Je trouve ces pauvres paysans Holsteinois plus entraînés qu’ils ne devraient l'être s'ils n’étaient poussés que par les intrigues des Augustenbourg ou par les chimères germaniques. Vous ne lèverez pas pour moi ce doute là, vous n’avez pas assez de goût pour la science.
Si j'étais à Paris, je vous montrerais huit ou dix pages que je viens d'écrire comme préface à la réimpression de Monk. Pas l'ombre de science, mais un peu de politique actuelle, et assez nette. Vous verrez cela avant la publication.
C'est grand dommage que vous ne soyez pas à Bade, entre toutes ces Princesses et Thiers. Cela vaudrait la peine d'être vu et décrit par vous. A coup sûr comme amusement, et peut-être aussi comme utilité. Il a précisément la quantité et la qualité d’esprit qu’il faut pour plaire en quatre ou cinq endroits à la fois. Je doute qu’il fasse rien de bien important ; il est trop indécis pour cela ; mais je ne crois pas non plus qu’il se tienne tranquille. Il est en même temps mobile et obstiné, et il change sans cesse de chemin, mais pas beaucoup de but. Je parierais qu'on ne vous a pas dit vrai au pavillon Breteuil quand on vous a dit qu’il était venu et qu’on l’avait vu. On tient beaucoup là à faire croire que les menées contraires pour les deux branches sont très actives. On vit de la dissidence.
Onze heures
Je vois que j’ai raison de ne pas croire au dire du pavillon Breteuil. J’aurais été fort aise de voir Tolstoy au Val Richer ; mais j’aime bien mieux qu’il soit retourné plutôt à Paris. Il est affectueux pour vous, et il vous est commode. Je vous quitte pour deux visiteurs qui viennent me demander à déjeuner ; M. Elie de Beaumont et M. Emmanuel Dupaty, la géologie et le Vaudeville, l'Académie des sciences et l'Académie française. Ce sont deux hommes d’esprit et deux très honnêtes gens, qui m’aiment et que j’aime. Adieu, adieu, adieu. G.
Je suis charmé que les Danois soient victorieux. Les premiers bruits m’avaient inquiété. Si j'étais à portée, je voudrais savoir le fond des causes de l'obstination des Holsteinois. D'ici elle paraît si absurde qu'on ne la comprend pas. Car ils ne se font certainement pas tuer pour le seul plaisir d’Arnds et de Grimm et de tous ces unitaires Allemands qui ne leur envoient que de très minces secours. Cet acharnement d'un petit pays à ne pas vouloir de la paix, que veulent pour lui tous les grands états, a quelque chose qui n’est pas de notre temps. Je sais assez de l'affaire pour savoir qu'européennement les Danois ont raison. Je voudrais être aussi sûr que localement et selon les traditions et les lois des duchés, ils ont aussi tout-à-fait raison. Quand on n’est que spectateur, on a besoin d'avoir tout-à-fait raison, quand on est acteur, la lutte entraîne. Je trouve ces pauvres paysans Holsteinois plus entraînés qu’ils ne devraient l'être s'ils n’étaient poussés que par les intrigues des Augustenbourg ou par les chimères germaniques. Vous ne lèverez pas pour moi ce doute là, vous n’avez pas assez de goût pour la science.
Si j'étais à Paris, je vous montrerais huit ou dix pages que je viens d'écrire comme préface à la réimpression de Monk. Pas l'ombre de science, mais un peu de politique actuelle, et assez nette. Vous verrez cela avant la publication.
C'est grand dommage que vous ne soyez pas à Bade, entre toutes ces Princesses et Thiers. Cela vaudrait la peine d'être vu et décrit par vous. A coup sûr comme amusement, et peut-être aussi comme utilité. Il a précisément la quantité et la qualité d’esprit qu’il faut pour plaire en quatre ou cinq endroits à la fois. Je doute qu’il fasse rien de bien important ; il est trop indécis pour cela ; mais je ne crois pas non plus qu’il se tienne tranquille. Il est en même temps mobile et obstiné, et il change sans cesse de chemin, mais pas beaucoup de but. Je parierais qu'on ne vous a pas dit vrai au pavillon Breteuil quand on vous a dit qu’il était venu et qu’on l’avait vu. On tient beaucoup là à faire croire que les menées contraires pour les deux branches sont très actives. On vit de la dissidence.
Onze heures
Je vois que j’ai raison de ne pas croire au dire du pavillon Breteuil. J’aurais été fort aise de voir Tolstoy au Val Richer ; mais j’aime bien mieux qu’il soit retourné plutôt à Paris. Il est affectueux pour vous, et il vous est commode. Je vous quitte pour deux visiteurs qui viennent me demander à déjeuner ; M. Elie de Beaumont et M. Emmanuel Dupaty, la géologie et le Vaudeville, l'Académie des sciences et l'Académie française. Ce sont deux hommes d’esprit et deux très honnêtes gens, qui m’aiment et que j’aime. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 25 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Vendredi 25 oct. 1850
J’ai trouvé hier en arrivant, et je reçois ce matin une quantité d’épreuves à corriger. Monk, dont l’impression finit. Je veux que ce soit prêt à paraître à mon retour à Paris. De plus, je vais dans une heure, déjeuner à Lisieux. Préface pour dire que ma lettre sera courte. Je n'aime ni à écrire ni à recevoir des lettres courtes. Nous avons tant à nous dire et le temps s'en va si vite. Le courrier m'apporte une lettre de Morny qui m’écrit ce qu’il vous a dit. Il a senti la nécessité d’un peu d’excuse. Je m'attendais à ce qui est arrivé. Je n'en suis point dérangé ; mais je suis bien aise que l'abus soit constaté. Vous savez que je suis décidé à ne pas m'inquiéter des Affaires d'Allemagne.
Salvandy a parfaitement raison. Pour qu'une alliance avec la Prusse fût bonne à quelque chose à la France, il faudrait que la Prusse elle-même fût décidée à céder à la France les provinces du Rhin, en prenant à son tour en Allemagne son dédommagement. On n'en est pas là. Pour faire quelque chose aujourd’hui, il faudrait faire de grandes choses. On ne fera rien.
Je crois un peu à l'engourdissement de Lord Palmerston.Sa dernière lutte l’a laissé atteint. Il n'y a pas à s'y fier. Il est hardi et étourdi. Mais certainement il a envie de se reposer. Je me sais s’il y a quelque chose dans les journaux. Je n'ai pas le temps de les lire avant de partir pour Lisieux. Je crois que le Pape s’est trop pressé de faire un archevêque de Westminster. Il n’est pas assez bien assis chez lui pour s'attirer une forte bouffée de colère populaire anglaise. Palmerston en pourrait tirer grand parti. Je suis frappé de la décadence de l’esprit ecclésiastique Romain. Plus de foi fanatique et plus d'habileté politique ; c’est bien dangereux. On prétend pourtant que le Cardinal Antonelli est un homme d’esprit. Il n’y paraît pas. Adieu, adieu.
J’aurai, d’ici à mardi, je ne sais combien de petites affaires. La mort de mon pauvre juge de Lisieux m'oblige à me mêler de toutes. Adieu. G.
J’ai trouvé hier en arrivant, et je reçois ce matin une quantité d’épreuves à corriger. Monk, dont l’impression finit. Je veux que ce soit prêt à paraître à mon retour à Paris. De plus, je vais dans une heure, déjeuner à Lisieux. Préface pour dire que ma lettre sera courte. Je n'aime ni à écrire ni à recevoir des lettres courtes. Nous avons tant à nous dire et le temps s'en va si vite. Le courrier m'apporte une lettre de Morny qui m’écrit ce qu’il vous a dit. Il a senti la nécessité d’un peu d’excuse. Je m'attendais à ce qui est arrivé. Je n'en suis point dérangé ; mais je suis bien aise que l'abus soit constaté. Vous savez que je suis décidé à ne pas m'inquiéter des Affaires d'Allemagne.
Salvandy a parfaitement raison. Pour qu'une alliance avec la Prusse fût bonne à quelque chose à la France, il faudrait que la Prusse elle-même fût décidée à céder à la France les provinces du Rhin, en prenant à son tour en Allemagne son dédommagement. On n'en est pas là. Pour faire quelque chose aujourd’hui, il faudrait faire de grandes choses. On ne fera rien.
Je crois un peu à l'engourdissement de Lord Palmerston.Sa dernière lutte l’a laissé atteint. Il n'y a pas à s'y fier. Il est hardi et étourdi. Mais certainement il a envie de se reposer. Je me sais s’il y a quelque chose dans les journaux. Je n'ai pas le temps de les lire avant de partir pour Lisieux. Je crois que le Pape s’est trop pressé de faire un archevêque de Westminster. Il n’est pas assez bien assis chez lui pour s'attirer une forte bouffée de colère populaire anglaise. Palmerston en pourrait tirer grand parti. Je suis frappé de la décadence de l’esprit ecclésiastique Romain. Plus de foi fanatique et plus d'habileté politique ; c’est bien dangereux. On prétend pourtant que le Cardinal Antonelli est un homme d’esprit. Il n’y paraît pas. Adieu, adieu.
J’aurai, d’ici à mardi, je ne sais combien de petites affaires. La mort de mon pauvre juge de Lisieux m'oblige à me mêler de toutes. Adieu. G.
Val Richer, Jeudi 6 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 6 octobre 1853
J’y ai pensé et je crois que je n'écrirai pas. C’est toujours quelque chose de délicat que de donner des conseils surtout quand on ne vous les demande pas. Au moins faut-il bien savoir ce qu’on dit, et dire tout ce qu’on pense. Ces deux conditions me manqueraient. Ce qui se passe depuis vos dernières notes, ce que vous que dîtes de Lord Lansdowne, d'abord doux, puis irrité après avoir causé avec Lord Cowley, les quasi-velléités de guerre d'Aberdeen lui-même, tout cela me fait supposer qu’il y a des choses que je ne sais pas. Et quant aux choses générales, si le disais tout ce que je pense de la situation, j'en dirais trop ; si je ne disais pas tout, je dirais trop peu, et ce n’est pas la peine. J'attendrai, toujours décidé à n'être pas inquiet. Il faudra que je voie la guerre pour y croire.
Je trouve la Patrie, bien embrouillée dans sa réponse à l'Assemblée nationale. Je ne sais à qu’elle source, l'Assemblée avait puisé ses nouvelles ; mais la patrie à l’air de ne les démentir qu’à vous, et avec plus d'humeur que d'autorité.
Avez-vous remarqué la décision du petit conventicule italien qui s’est tenu à Londres autour de Mazzini et où sa politique violente n’a eu que trois voix ?
Marion serait bien aimable de me rendre un petit service. Les Durazzo, si je ne me trompe, sont à Paris. Je trouve, dans l’histoire du Piémont au 17e siècle, un nom que je ne suis pas sûr de savoir correctement ; c'est un marquis de Pianessa qui a joué un rôle dans les affaires des Vaudois et de Cromwell, à cette époque. Lui et sa femme étaient des gens considérables à la Cour de Turin. Quel est vraiment leur nom ? Est-ce Pianessa ou Pianezza ? Les Durazzo savent certainement cela. Marion aurait elle la bonté de le leur demander pour moi ? Je l'en remercie. d'avance.
Puisqu’il ne sait que de Noël, je serai à Paris bien avant le départ de Marion, et nous en causerons. Je ferai de mon mieux pour abréger l’absence.
Onze heures
C'est bien grave, et bien insensé. Il sera dit que les gouvernements n’ont pas plus de bon sens que les peuples. Voici ce que m'écrit M. Monod. Adieu, adieu. G.
J’y ai pensé et je crois que je n'écrirai pas. C’est toujours quelque chose de délicat que de donner des conseils surtout quand on ne vous les demande pas. Au moins faut-il bien savoir ce qu’on dit, et dire tout ce qu’on pense. Ces deux conditions me manqueraient. Ce qui se passe depuis vos dernières notes, ce que vous que dîtes de Lord Lansdowne, d'abord doux, puis irrité après avoir causé avec Lord Cowley, les quasi-velléités de guerre d'Aberdeen lui-même, tout cela me fait supposer qu’il y a des choses que je ne sais pas. Et quant aux choses générales, si le disais tout ce que je pense de la situation, j'en dirais trop ; si je ne disais pas tout, je dirais trop peu, et ce n’est pas la peine. J'attendrai, toujours décidé à n'être pas inquiet. Il faudra que je voie la guerre pour y croire.
Je trouve la Patrie, bien embrouillée dans sa réponse à l'Assemblée nationale. Je ne sais à qu’elle source, l'Assemblée avait puisé ses nouvelles ; mais la patrie à l’air de ne les démentir qu’à vous, et avec plus d'humeur que d'autorité.
Avez-vous remarqué la décision du petit conventicule italien qui s’est tenu à Londres autour de Mazzini et où sa politique violente n’a eu que trois voix ?
Marion serait bien aimable de me rendre un petit service. Les Durazzo, si je ne me trompe, sont à Paris. Je trouve, dans l’histoire du Piémont au 17e siècle, un nom que je ne suis pas sûr de savoir correctement ; c'est un marquis de Pianessa qui a joué un rôle dans les affaires des Vaudois et de Cromwell, à cette époque. Lui et sa femme étaient des gens considérables à la Cour de Turin. Quel est vraiment leur nom ? Est-ce Pianessa ou Pianezza ? Les Durazzo savent certainement cela. Marion aurait elle la bonté de le leur demander pour moi ? Je l'en remercie. d'avance.
Puisqu’il ne sait que de Noël, je serai à Paris bien avant le départ de Marion, et nous en causerons. Je ferai de mon mieux pour abréger l’absence.
Onze heures
C'est bien grave, et bien insensé. Il sera dit que les gouvernements n’ont pas plus de bon sens que les peuples. Voici ce que m'écrit M. Monod. Adieu, adieu. G.
Val Richer, Lundi 4 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer Lundi 4 octobre 1852
Puisque vous avez besoin des médecins. Je suis bien aise que vous ayez vu concurremment les deux meilleurs. Le départ de Chomel vous y a obligé. Vous ne pourrez pas les garder tous les deux à son retour ; mais vous comparerez leurs avis et leurs procédés et Olliffe se changera de prendre de l’un et de l'autre, ce qui vous sera bon. Andral est moins agréable de sa personne que Chomel ; mais je lui crois plus d’esprit, et il est extrêmement consciencieux.
Je n’ai absolument rien à vous dire. Rien n’est plus stérile que l’attente d’une chose prévue et regardée comme certaine.
Dans le sentiment public, l'Empire est déjà du passé. Pour moi, je ne vis plus qu’avec Cromwell. Si vos yeux vous le permettent quand il paraîtra, il vous amusera à connaître quoique aucun passé ne vous amuse guère.
C'est le bruit de la bourse, m’écrit-on que le Pape viendra sacrer le nouvel Empereur. Je n'y crois pas. Pourtant, il se fera sacrer. L'exemple de son oncle, et ses propres relations avec le Clergé lui en font une loi. Par qui ? L’archevêque de Paris sera bien petit Il n’ira pas le faire sacrer à Reims. Peut-être un sacre collectif ; tous les cardinaux Français réunis. Je suppose qu’on a pensé à cet embarras.
Onze heures
Adieu, adieu. Les paroles sont aussi vaines sur l'Empire que sur la santé. Il faut attendre. Adieu.
Puisque vous avez besoin des médecins. Je suis bien aise que vous ayez vu concurremment les deux meilleurs. Le départ de Chomel vous y a obligé. Vous ne pourrez pas les garder tous les deux à son retour ; mais vous comparerez leurs avis et leurs procédés et Olliffe se changera de prendre de l’un et de l'autre, ce qui vous sera bon. Andral est moins agréable de sa personne que Chomel ; mais je lui crois plus d’esprit, et il est extrêmement consciencieux.
Je n’ai absolument rien à vous dire. Rien n’est plus stérile que l’attente d’une chose prévue et regardée comme certaine.
Dans le sentiment public, l'Empire est déjà du passé. Pour moi, je ne vis plus qu’avec Cromwell. Si vos yeux vous le permettent quand il paraîtra, il vous amusera à connaître quoique aucun passé ne vous amuse guère.
C'est le bruit de la bourse, m’écrit-on que le Pape viendra sacrer le nouvel Empereur. Je n'y crois pas. Pourtant, il se fera sacrer. L'exemple de son oncle, et ses propres relations avec le Clergé lui en font une loi. Par qui ? L’archevêque de Paris sera bien petit Il n’ira pas le faire sacrer à Reims. Peut-être un sacre collectif ; tous les cardinaux Français réunis. Je suppose qu’on a pensé à cet embarras.
Onze heures
Adieu, adieu. Les paroles sont aussi vaines sur l'Empire que sur la santé. Il faut attendre. Adieu.
Val Richer, Mardi 21 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 21 sept. 1852
Je regrette cette idée de noviciat pour votre fils Paul ; d’autant plus que, dans l’apparence, il n’y a pas d'objection raisonnable. à y faire ; elle est naturelle. Mais évidemment, pour lui, cela n’est pas du tout nécessaire : c’est ou une pédanterie administrative, ou un mauvais vouloir détourné. Cependant, à moins que sa santé n’y mette tout-à-fait obstacle, si on insiste, il fera bien de se résigner. S'il a envie de rentrer dans les affaires, il ne peut pas espérer qu’il le fera sans ombre de désagrément ou d’ennui. Est-ce que M. de Meyendorff va à Pétersbourg ? Et y va-t-il, en même temps que M. de Nesselrode et Kisseleff ?
Votre calme de Paris n'est rien à côté de celui dans lequel je viens de rentrer ici. Je n’ai, à la lettre, point d'autre bruit que celui du vent, et point d'autres incidents que les alternatives du soleil et de la pluie. C'est bien vraiment le travail au sein du repos. Vie très saine, et au fond. très douce, sauf ce qui me manque.
Je pense avec plaisir qu’Aggy vous revient aujourd’hui. C’est une sécurité pour vous, et aussi pour moi. Marion est une sécurité et un plaisir. Croyez-vous qu’elle vous vienne avec son oncle, vers Noël, pour passer avec vous l’hiver prochain ? Je me figure que cet hiver, la fin surtout, sera très animé, pour les amateurs du mouvement de salon. L'Empire en répandra beaucoup à son début. Plus tard, il lui faudra un autre mouvement, qu’il aura peine à se procurer, du moins à un prix raisonnable.
Vous dit-on à quel moment Lord Palmerston passera à Paris, en conduisant sa femme à Nice ? Il sera bien reçu là. Le gouvernement actuel du Piémont l’a trouvé bienveillant, et le lui rend sans doute. Je trouve que ce gouvernement a un peu l’air de s'affermir. Quelques unes des querelles que le Clergé lui fait sont mauvaises et le servent.
Vos diplomates ont ils rencontré quelque part, M. de Cavour pendant son séjour à Paris ? Il doit avoir vu Thiers. Thiers a été bien venu à Turin.
Onze heures
Puisque Chomel vous voit souvent, je ne crains pas qu’il fasse de grosse faute ; il modifiera à temps le régime. J’attendrai impatiemment la nouvelle.
Je regrette cette idée de noviciat pour votre fils Paul ; d’autant plus que, dans l’apparence, il n’y a pas d'objection raisonnable. à y faire ; elle est naturelle. Mais évidemment, pour lui, cela n’est pas du tout nécessaire : c’est ou une pédanterie administrative, ou un mauvais vouloir détourné. Cependant, à moins que sa santé n’y mette tout-à-fait obstacle, si on insiste, il fera bien de se résigner. S'il a envie de rentrer dans les affaires, il ne peut pas espérer qu’il le fera sans ombre de désagrément ou d’ennui. Est-ce que M. de Meyendorff va à Pétersbourg ? Et y va-t-il, en même temps que M. de Nesselrode et Kisseleff ?
Votre calme de Paris n'est rien à côté de celui dans lequel je viens de rentrer ici. Je n’ai, à la lettre, point d'autre bruit que celui du vent, et point d'autres incidents que les alternatives du soleil et de la pluie. C'est bien vraiment le travail au sein du repos. Vie très saine, et au fond. très douce, sauf ce qui me manque.
Je pense avec plaisir qu’Aggy vous revient aujourd’hui. C’est une sécurité pour vous, et aussi pour moi. Marion est une sécurité et un plaisir. Croyez-vous qu’elle vous vienne avec son oncle, vers Noël, pour passer avec vous l’hiver prochain ? Je me figure que cet hiver, la fin surtout, sera très animé, pour les amateurs du mouvement de salon. L'Empire en répandra beaucoup à son début. Plus tard, il lui faudra un autre mouvement, qu’il aura peine à se procurer, du moins à un prix raisonnable.
Vous dit-on à quel moment Lord Palmerston passera à Paris, en conduisant sa femme à Nice ? Il sera bien reçu là. Le gouvernement actuel du Piémont l’a trouvé bienveillant, et le lui rend sans doute. Je trouve que ce gouvernement a un peu l’air de s'affermir. Quelques unes des querelles que le Clergé lui fait sont mauvaises et le servent.
Vos diplomates ont ils rencontré quelque part, M. de Cavour pendant son séjour à Paris ? Il doit avoir vu Thiers. Thiers a été bien venu à Turin.
Onze heures
Puisque Chomel vous voit souvent, je ne crains pas qu’il fasse de grosse faute ; il modifiera à temps le régime. J’attendrai impatiemment la nouvelle.
Val Richer, Mardi 24 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Mardi 24 août 1852
Il vous est plus facile de me faire de loin, la question que vous me faites à propos de Cromwell, qu'à moi d'y répondre. J'y répondrai pourtant très ouvertement. Au fait, je dirais volontiers tout haut, et devant tout le monde ce que j'ai à vous répondre. Je n’ai pas la prétention d'être insensible, au plaisir d’un petit succès. Mais je sais me le refuser pour peu que j'en aie une bonne raison. Ce n’est pas pour me le donner que j’ai publié ce fragment. Quand j’ai de l'humeur, quand je suis impatient, quand j'écoute mes souvenir de parti, je désire que le président suive sa fantaisie et se fasse Empereur. Certainement il s'attirera par là des complications et des difficultés, et des nécessités qui feront faire un pas à la situation. Quand je suis, ce qui est mon ordinaire, de parfait sang froid et détaché de tout sentiment de parti je trouve que le président a et aura grandement raison de ne rien changer à sa situation. Il y est plus fort, pour sa mission d’ordre social, qu’il ne le serait dans aucune autre, et plus sûr, pour lui-même, non seulement du présent, mais de l'avenir de son pouvoir.
J’écris, depuis longtemps, l’histoire de Cromwell. Je suis arrivé au moment où il a eu à décider s'il se ferait Roi. Il ne s’est pas fait Roi. A mon avis, il a très bien fait. C'est à cela qu’il a dû de mourir tranquille dans son lit, à Whitehall, et en pleine possession du pouvoir suprême. J’ai trouvé qu’il y avait là un grand exemple et un bon conseil. Je n’ai pas besoin de vous dire que je n’y ai pas mis ou changé un mot par malice. Il est tel qu’il aurait été publié il y a dix ans. Je suis en dehors de toutes choses, mais non en dehors de toute communication avec mon pays. Il veut bien mettre toujours quelque prix à savoir ce que je pense, et j'en mets à le lui dire. C'est par là que ma vie est encore publique. Je n’y veux pas renoncer. Je ne pense pas qu’il me vienne de là aucun désagrément. J'en serais surpris, et j'en prendrais mon parti. Je suis sûr qu’il n'en viendra aucun à aucune autre personne. Vous êtes la seule dont les désagréments, en ce genre pussent me toucher. Je suis tranquille de votre côté.
J’avais prévu ce qui est arrivé à Berlin. C’est en effet bien maladroit. Le neveu fait très bien d'honorer la mémoire de son oncle ; mais le roi de Prusse ne peut pas oublier sa mère.
La lettre d’Ellice est intéressante. Au fond, ce nouveau pas démocratique qu’il prévoit et qu’il craint ne lui déplait pas. Il est de ceux qui se résignent volontiers à ce mal. Je persiste à penser que l'Angleterre vaut mieux que ceux-là, et que si elle succombe au mal, ce ne sera pas sa faute, mais celle des hommes qui lui auront manqué.
10 heures et demie
Merci de me dire toujours tout. Ce que vous ne savez probablement pas, c’est que Villemain a publié, il y a longtemps, une histoire de Cromwell, qui n’a pas réussi, et que toute même histoire qui réussit un peu lui est un grand crève-cœur. Adieu, adieu.
Ma toux est à peu près partie.
Il vous est plus facile de me faire de loin, la question que vous me faites à propos de Cromwell, qu'à moi d'y répondre. J'y répondrai pourtant très ouvertement. Au fait, je dirais volontiers tout haut, et devant tout le monde ce que j'ai à vous répondre. Je n’ai pas la prétention d'être insensible, au plaisir d’un petit succès. Mais je sais me le refuser pour peu que j'en aie une bonne raison. Ce n’est pas pour me le donner que j’ai publié ce fragment. Quand j’ai de l'humeur, quand je suis impatient, quand j'écoute mes souvenir de parti, je désire que le président suive sa fantaisie et se fasse Empereur. Certainement il s'attirera par là des complications et des difficultés, et des nécessités qui feront faire un pas à la situation. Quand je suis, ce qui est mon ordinaire, de parfait sang froid et détaché de tout sentiment de parti je trouve que le président a et aura grandement raison de ne rien changer à sa situation. Il y est plus fort, pour sa mission d’ordre social, qu’il ne le serait dans aucune autre, et plus sûr, pour lui-même, non seulement du présent, mais de l'avenir de son pouvoir.
J’écris, depuis longtemps, l’histoire de Cromwell. Je suis arrivé au moment où il a eu à décider s'il se ferait Roi. Il ne s’est pas fait Roi. A mon avis, il a très bien fait. C'est à cela qu’il a dû de mourir tranquille dans son lit, à Whitehall, et en pleine possession du pouvoir suprême. J’ai trouvé qu’il y avait là un grand exemple et un bon conseil. Je n’ai pas besoin de vous dire que je n’y ai pas mis ou changé un mot par malice. Il est tel qu’il aurait été publié il y a dix ans. Je suis en dehors de toutes choses, mais non en dehors de toute communication avec mon pays. Il veut bien mettre toujours quelque prix à savoir ce que je pense, et j'en mets à le lui dire. C'est par là que ma vie est encore publique. Je n’y veux pas renoncer. Je ne pense pas qu’il me vienne de là aucun désagrément. J'en serais surpris, et j'en prendrais mon parti. Je suis sûr qu’il n'en viendra aucun à aucune autre personne. Vous êtes la seule dont les désagréments, en ce genre pussent me toucher. Je suis tranquille de votre côté.
J’avais prévu ce qui est arrivé à Berlin. C’est en effet bien maladroit. Le neveu fait très bien d'honorer la mémoire de son oncle ; mais le roi de Prusse ne peut pas oublier sa mère.
La lettre d’Ellice est intéressante. Au fond, ce nouveau pas démocratique qu’il prévoit et qu’il craint ne lui déplait pas. Il est de ceux qui se résignent volontiers à ce mal. Je persiste à penser que l'Angleterre vaut mieux que ceux-là, et que si elle succombe au mal, ce ne sera pas sa faute, mais celle des hommes qui lui auront manqué.
10 heures et demie
Merci de me dire toujours tout. Ce que vous ne savez probablement pas, c’est que Villemain a publié, il y a longtemps, une histoire de Cromwell, qui n’a pas réussi, et que toute même histoire qui réussit un peu lui est un grand crève-cœur. Adieu, adieu.
Ma toux est à peu près partie.
Val Richer, Mercredi 22 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer, Mercredi 22 sept. 1849
9 heures et demie
Je suis dans mon Cabinet depuis six heures. Je n'ai pas encore mis le pied dans le jardin quoiqu’il fasse un soleil superbe. Je suis plongé dans mon histoire de la révolution d'Angleterre. Notre temps me sert beaucoup plus pour la comprendre qu’elle ne m'éclaire sur notre temps. Personne, ne me croirait si je disais que je cherche bien plutôt dans le présent des lumières sur le passé que dans le passé des allusions au présent. C'est pourtant très vrai.
Savez-vous un effet qu’on n’a pas prévu ? Il est très probable que ces bruyantes et innombrables démonstrations dont les journaux sont remplis, feront l'Empire ; mais en le faisant, elles l’usent d'avance. On en aura trop entendu parler quand il sera proclamé. On attendra et on demandera autre chose.
Le Constitutionnel allait avant hier au devant des craintes qu'inspirent déjà ces autres choses ; il promettait un Empire qui ne serait pas l'Empire, qui ferait des sociétés de crédit foncier et des chemins de fer une monarchie pacifique et bourgeoise. C’est trop de bruit pour arriver là. Il fallait attendre plus patiemment la nécessité de la monarchie ; elle serait venue, et elle serait venue plus tranquillement, sans blaser d'avance et sans exciter outre mesure. J'en reviens toujours, au chancelier Oxenstiern, qu’il y a peu de sagesse, même dans ce qui réussit !
C'est probablement par mauvais vouloir pour Lord Douro que le Duc de Wellington n’a pas fait de testament ; il a voulu que son second fils, qu’il aime mieux, et qui a des enfants, ont la moitié de sa fortune. Peel et Wellington, jamais les fils n'ont moins ressemblé aux pères ; le contraste est choquant.
Je suis convaincu qu’il y a de la faute des pères en cela, et que des enfants vraiment bien élevés, et en intimité avec leur père, n'en sont jamais si loin, quelque différente que Dieu ait fait la pâte, de toutes les jalousies, celle de père à fils est la seule que je ne comprenne pas du tout. Je ne conçois pas de plus grande satisfaction que de se survivre, et de la perpétuer soi-même dans ses enfants. J’ai pourtant vu de grands exemples de cette jalousie là, et dans de bien frappantes occasions.
Je vous quitte pour faire ma toilette. Je suis impatient de savoir Aggy revenue.
Onze heures
Je remercie Aggy de ses quelques lignes, quoiqu’elles me chagrinent. J’espère qu’un peu de nourriture vous relèvera de votre abattement. Le temps mou et pluvieux paraît vouloir casser ; peut-être qu’un air plus sec et plus vif vous vaudra mieux. Adieu, Adieu, en attendant demain. G.
9 heures et demie
Je suis dans mon Cabinet depuis six heures. Je n'ai pas encore mis le pied dans le jardin quoiqu’il fasse un soleil superbe. Je suis plongé dans mon histoire de la révolution d'Angleterre. Notre temps me sert beaucoup plus pour la comprendre qu’elle ne m'éclaire sur notre temps. Personne, ne me croirait si je disais que je cherche bien plutôt dans le présent des lumières sur le passé que dans le passé des allusions au présent. C'est pourtant très vrai.
Savez-vous un effet qu’on n’a pas prévu ? Il est très probable que ces bruyantes et innombrables démonstrations dont les journaux sont remplis, feront l'Empire ; mais en le faisant, elles l’usent d'avance. On en aura trop entendu parler quand il sera proclamé. On attendra et on demandera autre chose.
Le Constitutionnel allait avant hier au devant des craintes qu'inspirent déjà ces autres choses ; il promettait un Empire qui ne serait pas l'Empire, qui ferait des sociétés de crédit foncier et des chemins de fer une monarchie pacifique et bourgeoise. C’est trop de bruit pour arriver là. Il fallait attendre plus patiemment la nécessité de la monarchie ; elle serait venue, et elle serait venue plus tranquillement, sans blaser d'avance et sans exciter outre mesure. J'en reviens toujours, au chancelier Oxenstiern, qu’il y a peu de sagesse, même dans ce qui réussit !
C'est probablement par mauvais vouloir pour Lord Douro que le Duc de Wellington n’a pas fait de testament ; il a voulu que son second fils, qu’il aime mieux, et qui a des enfants, ont la moitié de sa fortune. Peel et Wellington, jamais les fils n'ont moins ressemblé aux pères ; le contraste est choquant.
Je suis convaincu qu’il y a de la faute des pères en cela, et que des enfants vraiment bien élevés, et en intimité avec leur père, n'en sont jamais si loin, quelque différente que Dieu ait fait la pâte, de toutes les jalousies, celle de père à fils est la seule que je ne comprenne pas du tout. Je ne conçois pas de plus grande satisfaction que de se survivre, et de la perpétuer soi-même dans ses enfants. J’ai pourtant vu de grands exemples de cette jalousie là, et dans de bien frappantes occasions.
Je vous quitte pour faire ma toilette. Je suis impatient de savoir Aggy revenue.
Onze heures
Je remercie Aggy de ses quelques lignes, quoiqu’elles me chagrinent. J’espère qu’un peu de nourriture vous relèvera de votre abattement. Le temps mou et pluvieux paraît vouloir casser ; peut-être qu’un air plus sec et plus vif vous vaudra mieux. Adieu, Adieu, en attendant demain. G.
Mots-clés : Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Education, Empire (France), Famille royale (France), Fusion monarchique, Histoire (Angleterre), Parcs et Jardins, Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Presse, Régime politique, Santé (Dorothée), Travail intellectuel