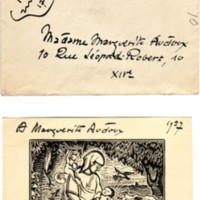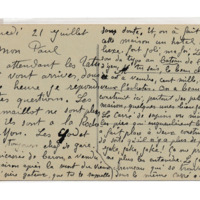Votre recherche dans le corpus : 630 résultats dans 630 notices du site.
Lettre de Marguerite Audoux à Marcel Raval
Lettre de Marguerite Audoux à Henri Meyer
La lettre 324 TER nous révèle qu'Henri Meyer écrit sous le pseudonyme de Jehan Le Povremoyne. Cette amitié épistolaire est peut‑être consécutive à la parution de De la ville au moulin. Henri Meyer et la romancière se verront par la suite, comme le laisse entendre l'avant‑dernier paragraphe de la lettre 344.
Lettre de Marcelle Vioux à Marguerite Audoux
« Marcelle Vioux
Deux ouvrages de Marcelle Viougeas, dite Marcelle Vioux (1895-après 1951), tous deux avec envois, prennent place dans la bibliothèque de la romancière, conservée au Musée Marguerite-Audoux de Sainte-Montaine : Fleur d'amour et Ma Route.
Carte de visite de Marguerite Audoux à Yvonne Arbogast
N. B. : Les propos exacts de l'article sont : « Quel être adorable ! Amer parce qu'il est si tendre. »
Lettre de Charles Chanvin à Marguerite Audoux
De la même génération que son ami Yell, avec qui il poursuit ses études au lycée de Troyes, le juriste Charles Chanvin (1877-1953) est vite attiré par les milieux littéraires, tout en étant le secrétaire de Me Fernand Labori, le défenseur de Dreyfus et de Zola. Chanvin publie au Mercure de France des poèmes remarqués. Il s'interposera d'ailleurs, avant que Mirbeau n'entre en scène, pour que cette maison d'édition ne prenne pas Marie‑Claire, dont elle ne voulait publier que des extraits.
N. B.. : Chanvin figure dans le tableau de Jacques‑Emile Blanche, André Gide et ses amis au Café maure de l'exposition universelle de 1900 (1901).
Lettre d'Edmond Rocher à Marguerite Audoux
Lettre de Blanche Febvre‑Longeray à Marguerite Audoux
Lettre de Marguerite Audoux à Antoine Lelièvre
L'article joint est le suivant :
« QUINZE ANS après
Lettre de Gabriel Belot à Marguerite Audoux
Peintre et graveur, Gabriel Belot (1882-1962) a illustré la très belle édition de Marie‑Claire dans les éclectiques du livre (janvier 1932). De bonne heure orphelin comme Marguerite Audoux, il vit une enfance triste. S'il est obligé d'être relieur pour gagner sa vie, c'est aussi en autodidacte qu'il peint (dès l'âge de six ans) puis grave (à partir de 1913). Entre 1910 et 1914 il se fait petit à petit reconnaître, notamment des Indépendants. Les lettres et les enveloppes qu'il envoie à la romancière sont magnifiquement illustrées (notamment par une aquarelle) et constituent un bon exemple de ce qu'est l'art postal.
Lettre de Lucien Descaves à Marguerite Audoux
Fils d'un graveur, Lucien Descaves (1961-949) passe une enfance modeste dans un quartier pauvre de Montrouge. En 1882, il publie son premier roman, Le Calvaire d'Héloïse Pajadou, dans lequel il s'affirme déjà comme un observateur amer de la société. Sa satire du milieu militaire, notamment avec Sous‑offs (1889), lui attire poursuites judiciaires (pour outrage aux bonnes mœurs et injures à l'armée) et acquittements. La position qu'il défend contre Zola dans le Manifeste des Cinq (Le Figaro du 18 août 1887) lui ferme les portes de la Société des Gens de Lettres. Le monde officiel des lettres, cependant, lui accorde un siège, en avril 1900, à la « Société littéraire des Goncourt », dont les statuts sont publiés au Journal officiel le 26 janvier 1902, le premier prix étant remis le 21 décembre 1903 au restaurant Champeaux. Là est bien la grande affaire, puisque, en novembre 1910, Marguerite Audoux est « goncourable », et Descaves toujours dans le jury… Si la romancière conçoit des craintes par rapport à ses concurrents, ses amis, eux, se méfient au plus haut point de Descaves (qui deviendra président de l'Académie Goncourt en 1944). Le 11 novembre 1910, Fargue écrit à Larbaud :
« Ah ! le bon accueil fait par Descaves à Marguerite ne m'inspire qu'une médiocre confiance. Je me rappelle les bonnes paroles et les promesses prodiguées à Philippe. Et j'ai bien peur que ce vaguemestre de L'A[cadémie] G[oncourt] ne lui ouvre les bras que pour l'étouffer. Timeo Danaos. »
[Léon‑Paul Fargue – Valery Larbaud, Correspondance (1910‑1946), texte établi, présenté et annoté par Th. Alajouanine, Gallimard, 1971, p. 35].
« Ce mauvais article eut pour conséquence une missive acerbe de Descaves, suivie de deux ou trois autres, dont je veux espérer que leur hargneux auteur eut bien vite honte de les avoir écrites. Je ne sais quelle obscure rancune lui faisant perdre toute mesure et tout sentiment des réalités, Descaves n'allait‑il pas jusqu'à accuser Philippe – à la fois bien trop timide et bien trop orgueilleux pour avoir jamais rien sollicité – d'avoir, vil arriviste, usé le paillasson et tiré la sonnette des Chers Maîtres ! Indigné d'une aussi scandaleuse injustice, Gide conserva ces lettres que Descaves, assurait‑il, n'emporterait pas en paradis – (Une perquisition en Enfer permettrait peut‑être la saisie de ce document). »
Lettre de Marguerite Audoux au Dr Augustin Dubois
Henri Dejoulx (dans Marie-Claire, Henri Deslois), dont s’éprend Marguerite Audoux lorsqu’elle est placée dans une ferme de Sologne, a une sœur aînée, Charlotte Dejoulx, qui épouse émile Dubois, notaire à Argent-sur-Sauldre puis à Saint-Viâtre. Leur fils aîné deviendra le docteur Augustin Dubois (23 août 1874, Argent-sur-Sauldre – 8 décembre 1948), qui exercera à Lamotte-Beuvron de 1906 à sa mort subite, et à qui est adressée la présente lettre. Singulièrement, la rencontre entre le médecin et la romancière vient davantage du succès de Marie-Claire que d’une recherche biographique qu’eût menée Augustin Dubois, qui « est un homme lettré ayant écrit quelques plaquettes historiques ou ethnologiques. S’intéressant aux auteurs qui chantent la Sologne, il est en relation avec quelques écrivains bien oubliés aujourd’hui, dont Roger sausset et Lucien Jullemier, mais aussi Marguerite Audoux, dont le renom n’est plus à affirmer. Augustin Dubois lui rend visite à Paris quand elle est au sommet de sa réputation, et de cette rencontre naît une lettre dans laquelle la romancière se dévoile avec une réelle sincérité dans son style littéraire à la simplicité inimitable. » [Heude (Bernard), Marguerite Audoux et la Sologne. Lettre autographe inédite au docteur Augustin Dubois. Lointains souvenirs et diverses dédicaces, in la Sologne et son passé (Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de SOLOGNE), n° 62, janvier-mars 2015, p. 13-26]
À cette lettre sont joints la reproduction d’un article de Marguerite Audoux extrait du journal Paris-Soir du jeudi 25 mars 1926, Lointains souvenirs (la romancière a ajouté au-dessus du titre : « Histoire vraie ») et Une Petite Histoire de Sologne dont nous reproduisons le texte :
« Comme récompense de la peine que vous allez prendre, voici une petite histoire de Sologne.
C’était fête à Pierrefitte ce dimanche-là, et votre mère, la bonne Charlotte aux beaux yeux francs, aux cheveux brillants et bouclés, avait eu la gentillesse de m’emmener à cette fête en même temps que sa mère, mais aussitôt arrivée elle s’aperçoit qu’elle a oublié un vêtement indispensable à l’un de ses enfants. J’offre de courir à Villeneuve le chercher, mais même en courant, à l’aller comme au retour, je ne serais pas revenue à temps. Charlotte, alors, a une idée. Prenez la voiture, me dit-elle. Je ne savais pas conduire, et Henriette assurait que je jetterais la jument dans le fossé si on me la confiait. Mais Charlotte, ses yeux dans les miens, me dit avec cette bonne humeur qui lui était coutumière : mais si, voyons, vous saurez bien conduire. Et puis la jument connaît bien le chemin, elle ira toute seule.
Oui, la jument connaissait le chemin, mais tout de suite elle prit la gauche, de sorte que les voitures rencontrées s’écartaient de mauvaise grâce, tandis que l’on me criait : ta droite, ta droite. J’ignorais qu’il y eût une droite et une gauche pour les voitures et je me creusai la tête pour savoir ce que voulaient dire ces gens. Au retour, lorsque je le demandais à Charlotte, elle eut un beau sourire avant de me répondre. »Carte postale de Marguerite Audoux à Antoine Lelièvre
Carte postale de Marguerite Audoux à Paul d’Aubuisson
- Paul d’Aubuisson (1906-1990) est l’aîné des trois petits‑neveux de Marguerite Audoux. C’est son fils adoptif préféré, celui qui jusqu’à sa mort veille sur la mémoire de la romancière, le flambeau ayant été repris par ses deux enfants, Geneviève et Philippe (à qui Bernard-Marie Garreau doit l’accès au fonds d’Aubuisson, qui se trouve chez lui), ainsi que par son neveu Roger. Une abondante correspondance entre Paul et sa mère adoptive s’inscrit dans le corpus des lettres familiales et familières (dont l’identifiant commence par le chiffre 0). B.-M. Garreau a rencontré paul d’Aubuisson en 1987, et réalisé plusieurs enregistrements de leurs entretiens.
Le contenu de la présente carte postale, dont la date est confirmée par le cachet de la poste, est surprenant (vœux d’anniversaire, alors que Paul est né un 5 décembre). Il est vrai que le 2 décembre précédent (1924), il écrivait à sa tante : « Je vais avoir 18 ans vendredi 5 décembre 1906 et non 6 décembre 1905 comme tu penses d’habitude. » Il n’empêche…
Lettre de Marguerite Audoux à Paul d’Aubuisson
- Paul d’Aubuisson (1906-1990) est l’aîné des trois petits‑neveux de Marguerite Audoux. C’est son fils adoptif préféré, celui qui jusqu’à sa mort veille sur la mémoire de la romancière, le flambeau ayant été repris par ses deux enfants, Geneviève et Philippe (à qui Bernard-Marie Garreau doit l’accès au fonds d’Aubuisson, qui se trouve chez lui), ainsi que par son neveu Roger. Une abondante correspondance entre Paul et sa mère adoptive s’inscrit dans le corpus des lettres familiales et familières (dont l’identifiant commence par le chiffre 0). B.-M. Garreau a rencontré paul d’Aubuisson en 1987, et réalisé plusieurs enregistrements de leurs entretiens.
- Stefan Esders (né le 6 juillet 1852 à Haren an der Ems, mort le 15 septembre 1920 à Vienne) et son frère Henri créent une grande usine de textiles à Bruxelles avec des succursales à Berlin, Paris, Saint-Pétersbourg, Rotterdam et Vienne.
- La mère de Paul est Yvonne d’Aubuisson (1882-1926)
- Vitali est une vieille voisine rue Léopold-Robert.
- Le petit Suédois travaille apparemment chez Fasquelle, où il s’occuperait des traductions en suédois. Le 2 décembre 1924, c’est-à-dire peu avant la présente lettre, Peul écrit à sa tante qu’il a vu cette personne, qui lui a emprunté Le Grand Meaulnes et Le Rêve de Zola. une carte postale que Marguerite Audoux envoie de L’Île-d’Yeu à Léon-Paul Fargue le 31 juillet 1922 (référencée lettre 294) nous donne d’autres précisions « Veux‑tu faire bon visage à Monsieur Rage Aurell, que j’appelle le petit Suédois, et qui voudrait te parler ? C’est un admirateur. De toi, bien sûr, animal ! De plus, il a réuni les œuvres de Philippe et il l’a fait connaître en Suède. » La relation entre Selma Lagerlöf et Marguerite Audoux peut être à la source de celle que cette dernière et son fils entretiennent avec le personnage en question.
- Roger est l’un des frères cadets de Paul.
- Maman Line est une voisine rue Léopold-Robert.
- Pierre Valin est un confrère, fidèle puisqu’il envoie régulièrement ses ouvrages dédicacés à la romancière (13 en tout).
- Les « Trott », désignés la plupart du temps par Paul et la romancière par ce diminutif, renvoient à madeleine et Lucien Trautmann (dit Tatu), ce dernier étant un vieil ami de Léon-Paul fargue et de Charles Chanvin, que l’on trouve dès 1912 à L’Île-d’Yeu avec ces quelques membres du Groupe de Carnetin. Voir la lettre 185 d’août 1912 de Marguerite Audoux à Antonin Dusserre et la lettre 247 adressée le 11 novembre à Antoine Lelièvre par la romancière.Lettre de Marguerite Audoux à Paul d’Aubuisson
Lettre de Marguerite Audoux à Paul d’Aubuisson
- Paul d’Aubuisson (1906-1990) est l’aîné des trois petits‑neveux de Marguerite Audoux. C’est son fils adoptif préféré, celui qui jusqu’à sa mort veille sur la mémoire de la romancière, le flambeau ayant été repris par ses deux enfants, Geneviève et Philippe (à qui Bernard-Marie Garreau doit l’accès au fonds d’Aubuisson, qui se trouve chez lui), ainsi que par son neveu Roger. Une abondante correspondance entre Paul et sa mère adoptive s’inscrit dans le corpus des lettres familiales et familières (dont l’identifiant commence par le chiffre 0). B.-M. Garreau a rencontré paul d’Aubuisson en 1987, et réalisé plusieurs enregistrements de leurs entretiens.
- Menette est une amie qui apparaît régulièrement dans la correspondance Paul-Audoux. Les renseignements les moins imprécis sur cette femme se trouvent dans le Journal de Romain Rolland en date du 22 mars 1921, jour où il mentionne sa première rencontre avec Marguerite Audoux, accompagnée d’une autre femme, Madame Menet, plus jeune, couturière elle aussi. Un exemplaire de La Fiancée qui se trouve au Musée Marguerite Audoux de Sainte-Montaine contient un envoi à émile et Henriette Menet. Il est donc plus que probable qu’il s’agisse de la même personne que celle mentionnée dans la présente lettre. ces transformations de patronymes sont monnaie courante rue Léopold‑Robert (la mère de Léon‑paul Fargue ne devient‑elle pas « Farguette » ?...).
- Vitali et Emma sont, rue Léopold-Robert, les vieilles voisines parisiennes de Marguerite Audoux ; Maman Line n’a pas été identifiée (autre voisine ?), pas plus que Jacques et Mme Walter.
Carte postale d'Albanie Fournier (Mme Fournier mère) à Marguerite Audoux
Cartes postales de Marguerite Audoux à Paul d'Aubuisson
- Les Courmaillot, Godet (lui chef de gare dans la région vendéenne) et Guillemin (logeurs) sont ou ont été des habitants de L'Île-d'Yeu.
- Menette est une amie qui apparaît régulièrement dans la correspondance Paul d'Aubuisson - Marguerite Audoux. Les renseignements les moins imprécis sur cette femme se trouvent dans le Journal de Romain Rolland en date du 22 mars 1921, jour où il mentionne sa première rencontre avec Marguerite Audoux, accompagnée d’une autre femme, Madame Menet, plus jeune, couturière elle aussi. Un exemplaire de La Fiancée qui se trouve au Musée Marguerite-Audoux de Sainte-Montaine contient un envoi à Émile et Henriette Menet. Il est donc plus que probable qu’il s’agisse de la même personne que celle mentionnée dans la présente lettre. Ces transformations de patronymes sont monnaie courante rue Léopold-Robert (la mère de Léon-Paul Fargue ne devient elle pas « Farguette » ou « Farguinette » ?...).
Mots-clés : Nouvelles de l''Île-d''Yeu (lieux et gens)
Lettre d'Alice Mirbeau à Marguerite Audoux
(Lettre due à l'aimable vigilance de Pierre Michel)
Carte postale de Marguerite Audoux à Léon‑Paul Fargue
Carte postale de Marguerite Audoux à Valery Larbaud
Billet de Bernard Naudin à Marguerite Audoux
Né le 11 novembre 1876 à Châteauroux, Bernard Naudin entre à dix-sept ans aux Beaux‑Arts de Paris dans l'atelier de Bonnat, puis est exposé aux Indépendants (l'un des tableaux, La Charge de Valmy, se trouve à la mairie de Châteauroux ; d'autres œuvres se trouvent au Musée Bertrand, dans la même ville). En 1904, Naudin abandonne la peinture pour se consacrer au dessin à la plume et à la gravure à l'eau‑forte. Il se plaît ainsi à illustrer livres et revues (Le Cri de Paris, L'Assiette au beurre), et, en particulier, le numéro spécial des Primaires d'août 1922, consacré à Marguerite Audoux, qui motive la présente lettre. Naudin, musicien lui‑même, a aussi essayé de rendre plastiquement des impressions musicales (par exemple, dans sa Sonata Appassionata). Il meurt le 7 mars 1946 à Noisy‑le‑Grand.
Lettre de Marguerite Audoux à Émile Guillaumin
Écrivain de la glèbe, comme Antonin Dusserre, Émile Guillaumin (1873-1951) évoque la vie rurale de façon réaliste, notamment avec La Vie d'un simple. Il dépasse cependant le régionalisme pour accéder à un véritable humanisme – ce en quoi il rejoint Marguerite Audoux. Les premiers contacts entre les deux écrivains sont épistolaires. Si l'on s'en tient à l'article de Guillaumin du 11 décembre 1937 écrit pour Les Nouvelles Littéraires (« Première et dernière visite à Marguerite Audoux »), il entendit d'abord parler d'elle en 1908 par Charles‑Louis Philippe ; puis il lui rendit visite en 1928, et enfin en mai 1936. Il admire la romancière, qu'il considère, bien au‑dessus de lui, comme un pur artiste. Nous reproduisons ici l'article laudatif qu'il écrit sur Le Chaland de la Reine :
« A propos du Chaland de la Reine
Émile GUILLAUMIN »