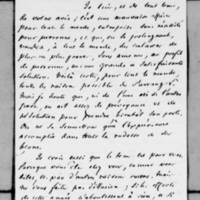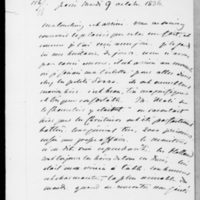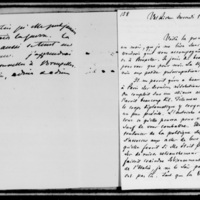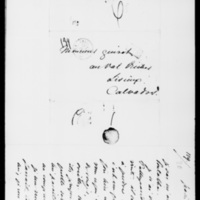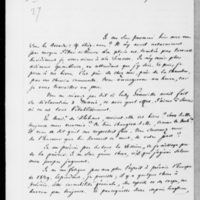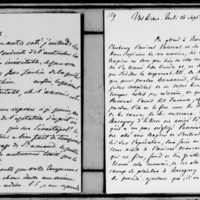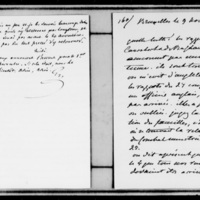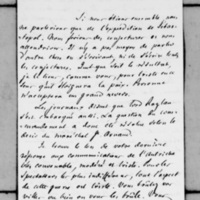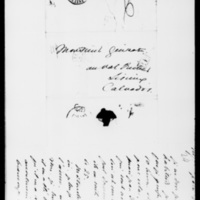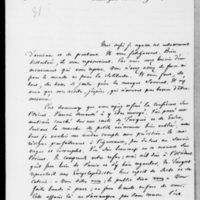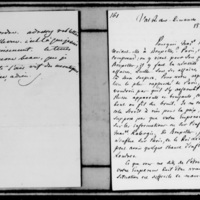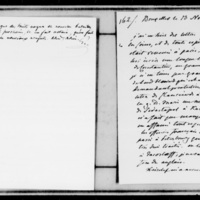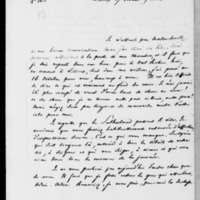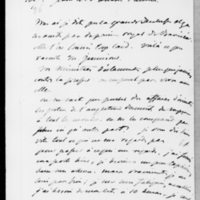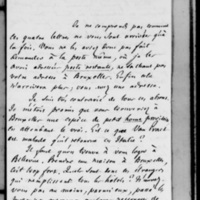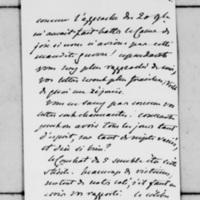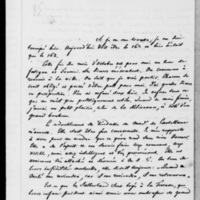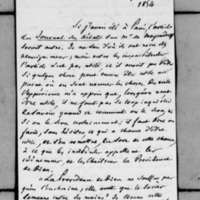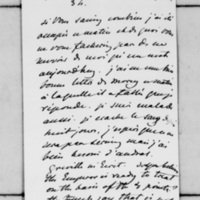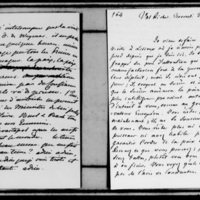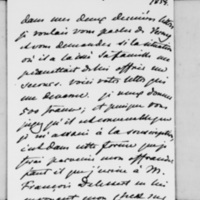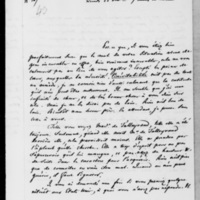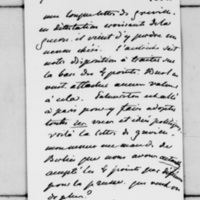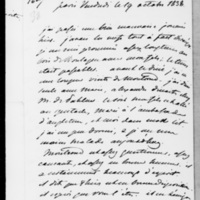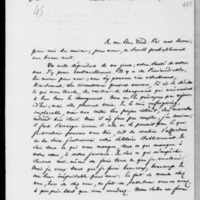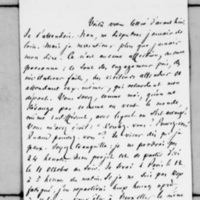Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
157. Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait comme vous. Je me suis couché hier à 9 heures et demie. J’avais beaucoup travaillé dans mon Cabinet et beaucoup couru dans mes champs ; deux choses que je puis très bien faire séparément mais pas bien ensemble. J’ai toujours éprouvé cela ; de l’activité d’esprit ou de corps, tant qu’on voudra ; mais l’une ou l’autre. Dans mes moments de grande préoccupation morale une course à pied d’une demi heure me fatiguait.
Vous verrez que Mad. de Talleyrand viendra chez vous cet hiver chercher des nouvelles. Je ne lui vois que M. Royer-Collard qui puisse lui en apporter un peu. Encore est-il lui-même fort en dehors de tout. Mais il vit à la Chambre et il voit quelque fois les Ministres. Je trouve ce que vous me dîtes à propos de sa visite fort naturel. Vous réagissez, et elle non. Elle a l’air embarrassé et vous non. Cela est dans l’ordre.
L’article des Débats d’hier sur l’Angleterre, l’Inde et la Russie est curieux. Est-ce qu’il y a vraiment chez vous quelque projet semblable ? Je ne dis pas projet lointain. général, politique d’ensemble; rien de plus simple, mais projet prochain, actuel. Ce serait étrange. Du reste cela s’est vu : beaucoup de prudence, de timidité même pour ce qu’on a sous la main à sa porte ; et des intentions, des combinaisons, même des préparatifs gigantesques pour ce qui est loin, bien loin. On satisfait ainsi, à la fois son imagination et sa raison. Et l’imagination se passe d’apparences et de paroles. à la bonne heure.
Lisez vous quelques fois le petit journal de Thiers, le Nouvelliste? Il est bien vif contre le Cabinet. Thiers n’a plus tout le Constitutionnel. M. Molé s’y est glissé ; non pas de manière à l’ôter à d’autres, mais pour y avoir; un petit coin à lui. C’est sa façon de procéder. Il n’en est pas d’un journal comme d’un cœur ; on n’est pas obligé à tout ou rien. Je vous quitte pour aller voir si on plante mes arbres. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que c’est que de surveiller des ouvriers. Mais pardonnez moi de vous trouver, quant à la température, un peu inconséquente. Vous me dites, page 1, Il fait très froid. et page 2, Comment, vous avez du feu dans votre chambre ! Cela me paraît incroyable. Quand Dieu fait très froid, moi, je fais du feu. Vous êtes à ce qu’il me semble, beaucoup plus résignée.
9 heures
Mes plantations se font bien. Je me prête, je crois, de très bonne grâce aux affaires et aux plaisirs de la Campagne. Et j’en jouirais très vivement si je les partageais. Mais je ne les partage pas. Aussi ne fais-je que m’y prêter. Voilà le facteur et une bonne lettre. N’oubliez rien, je vous prie de ce que vous avez eu une fois et un moment le projet de me dire. C’est là le mal cruel de l’absence entre tant d’autres ; on perd une infinité de choses, qui étaient bonnes, charmantes, mais qui passent avant qu’on se retrouve. Même quand je vous aurai retrouvée j’aurai beaucoup, beaucoup à regretter. N’oubliez donc pas. Je ne sais ce que feront mes amis, rien de déplacé j’espère. Pour moi, je n’irai certainement pas ailleurs que la où j’ai toujours été, depuis huit ans entr’autres. Je suis plus que jamais convaincu que c’est d’idées et de pratiques gouvernementales que la France a besoin. Et ce qui me fâche c’est qu’on l’en éloigne au lieu de l’y conduire. Si je me plains, ce sera de ce qu’on pousse ce pays-ci vers M. Odilon Barrot. Adieu. Adieu. Que c’est long ? G.
157. Val RIcher, Dimanche 10 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis, et de tout temps de votre avis, c’est une mauvaise affaire pour tout le monde, entreprise, sans nécessité pour personne, et qui en se prolongeant rendra, à tout le monde, des embarras de plus en plus graves, sans amener, au profit de personne, aucune grande et satisfaisante solution. Voilà certes, pour tout le monde toutes les raisons possibles de s’arranger. Mais je doute que, ni de l’une, ni de l'autre part, on ait assez de prévoyance, et de résolution pour prendre bientôt son parti. On ne se soumettra qu'à l'expérience accomplie dans toute la rudesse de ses leçons.
Je crois aussi que le temps est pour vous. Parce que vous êtes chez vous, comme vous dites, et par d'autres raisons encore. Mais ne vous faites pas d'illusion ; si les efforts de cette année n'aboutissent à rien, et si on ne s’arrange pas cet hiver, on fera l’année prochaine des efforts doubles, triples ce qu’il faudra pour compenser vos nouveaux préparatifs. Londres est essentiellement persévérant ; Paris ne se séparera pas de Londres et ni à Paris, ni à Londres, l'argent et les hommes ne manqueront. La proclamation du Maréchal St Arnaud n’a point l’air d’un général démoralisé à une armée démoralisée. C'est donc le Maréchal, qui commande en chef l'expédition, et Lord Raglan reste à la tête des troupes qui n’y vont pas. Probablement à l'heure qu’il est le canon gronde, autour de Sébastopol. Il est évident que vos victoires en Asie sont réelles, et que les Turcs s’y sont mal battus. C'est ce qui arrivera partout où ils ne seront pas sous les yeux des Européens, et mêler de beaucoup d’officiers Européens.
Savez-vous que le Duc de Noailles a été assez gravement malade d’une inflammation d'estomac avec toute sa famille ? Il a quitté Maintenon que le choléra ravageait, et ils sont allés chercher un abri au Marais, chez Mad. de la Ferté. Ils reviendront à Maintenon dés que le ravage aura cessé. Ils y sont peut-être revenus ces jours-ci, car le choléra est en grand déclin, partout.
Rainulphe d'Osmond, le neveu manchot de Mad. de Boigne, épouse, Mlle. de Maleyssie. C'est un mariage d'inclination née sur la plage de Trouville.
Onze heures
e vous adresse donc cette lettre à Bruxelles, poste restante. Moi aussi, je vous aime mieux là et je vous crois plus près. C'est plus près en effet et plus facile. Adieu, Adieu. Il n’y a certes, sujet à orgueil pour personne.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (mariage), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Mariage, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique
158. Bruxelles, Dimanche 5 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lord & lady Palmerston arriveront aujourd’hui à Paris. On peut tout conjecturer. Rothschild a passé ces deux jours. Il avait dîné à St Cloud dans la semaine. Il dit que l’Empereur était de très bonne humeur et l’Impératrice embellie et engraissée. Une nouvelle dépêche du P. Menchikoff dit que " depuis le 27 au 29 les positions respectives n’avaient point changé. Les travaux de siège continuaient, mais en général le feu de l' ennemi était devenu plus faible. que par le passé. " Personne à Paris ne doute que Sébastopol ne soit pris. Constantin me parait le croire aussi. Nous avons cependant maintenant 85 m h. Là, c’est lui qui me le mande, pourquoi ne pas livrer bataille ?
Je commence à souffrir du froid. Il y a beaucoup de courants d'air dans mon appartement. Les rhumatismes vont arriver par dessus les autres maux. Fine [?].
Je n’ai pas un mot du nouvelle à vous dire. Brokhausen n’est attendu qu'aujourd’hui. Je n’ai point eu votre lettre ce matin. Adieu. Adieu.
158. Paris, Mardi 9 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Matonhewitz est arrivé. Vous ne sauriez concevoir le plaisir que cela me fait et comme je l'ai reçue avec joie. Je le garde ici une huitaine de jours. Nous n’avons pas causé encore. Il est arrivé au moment où je faisais ma toilette pour aller dîner chez les petits Pozzo. Ils ont ouvert leur maison hier. C’est beau très magnifique, et très peu confortable. M. Mole & le chancelier y étaient. On racontait hier que les Christinos ont été parfaitement. battus. Leur général tué, 2000 prisonniers, enfin une grosse affaire. Le Moniteur n'en dit rien cependant. Les Holland sont toujours les héros de tous les dîners, lui était mon voisin à table. Son humeur est charmante, la plus aimable du monde. Quand on rencontre une gaieté naturelle avec beaucoup d’esprit, & beaucoup de connaissances, cela me parait la chose du monde la plus charmante. Et il me semble alors que moi aussi j'ai été gai, j’ai su rire et puis je ne sais plus rien. Ah, votre chancelier est un drôle d’homme. Il a voltigé hier pour arrivé au sommet du lit de Pozzo. C'est vraiment un tour de force que d'aller se coucher sur ce lit là aussi cela ne lui a-t-il pas réussi. Lord Holland a appelé cela un lit de justice. M. Molé a été parfaitement aimable.
Mon fils m’est revenu de Londres, l’Angleterre l’a engraissé. Il va rester huit jours avec moi. Il me dit que nos relations avec l'Angleterre prennent une tournure très grave. La Prusse, la Turquie, tout cela est bien embrouillé. savez-vous que les Anglais ont mis la main sur la flotte Turque. Il y a du mystère sous tout cela, je ne sais comment cela se débrouillera. La conférence ne va pas encore. Je vous écris en même temps que je parle a mon fils.
Je n’ai pas dormi de toute la nuit , tout cela fait que je ne sais ce que je vous dis. Pardonnez-moi mon mauvais h ce que vous me dites sur mon frère & mon mari est parfaitement vrai. Je crois aussi que c’est Médem, avec ses déclarations tranchantes qui aura fâché mon frère et que c'est là la cause de son silence. Adieu, je vous écris à tort & à travers aujourd’hui on reste autour de moi ce qui m’ôte toutes mes facultés. Adieu. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
158. Val-Richer, Samedi 13 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de me lever. C’est tard pour moi. J’ai mal dormi, je ne sais pourquoi. Passé mon premier sommeil, j’ai beaucoup de peine à en retrouver un second. Le temps change, les mœurs. Je voudrais bien changer les vôtres quand je serai là, et vous rendre un peu de force pour marcher, si on peut marcher à Paris, dans la saison où nous entrons. A la campagne, il n’y a pas de jour où il ne fasse beau une ou deux heures. Hier, il a plu à torrents ; je ne m’en suis pas moins promené deux ou trois fois, et j’ai eu cinq visites, dont deux venues de huit lieues. Il faut que je sois bien aimable. Je ne connais pas beaucoup de personnes pour qui j’eusse fait huit lieues hier. Il y en a une pour qui je ferais cent lieues, pour une demi-heure quand je l’aurais vue la veille. Je regrette que Matonchewitz, ne soit pas resté plus longtemps. Quand Lady Granville est malade vous êtes, en fait de conversation à un pauvre régime. Guère plus pauvre que le mien ; je suis très entouré, et bien entouré mais la conversation qui me plaît, pas seulement sur la politique, je n’en ai que bien peu, si j’en ai quelquefois. Je serais désolé que ma mère vit cela. Je ne crains rien tant que de laisser voir, aux personnes qui m’aiment et me donnent tout ce qu’elles ont, que cela ne me suffit pas. Aussi je cause beaucoup. Il faut que je fasse le métier de maîtresse de maison, que je m’occupe de tous et que je les amuse, car il faut cela, dans l’intérieur le plus uni. Bientôt Henriette m’y aidera un peu.
Si vous n’êtes pas mieux avec l’Angleterre que vous ne paraissez, Lady Clanricard aura une ambassade peu agréable. Elle a assez d’esprit et d’ambition pour se plaire aux situations difficiles, les seules où l’on fasse quelque chose. Mais il faut se sentir adossé à une politique qu’on soutienne volontiers, et avoir en perspective des résultats, des désagréments pour rien, pour passer le temps, c’est très ennuyeux. Lui avez-vous parlé de M. de Barante ? Ce sera sa réponse à Pétersbourg, et elle pour lui, qui a un goût extrême de conversatlon, plus que d’action. Que devient le Rois de Hanovre ? Vous raconte-t-il ses plans de gouvernement ? Charles Quint disait : [Sper suffil, ill un ynéuliugob, Eheree (Thierd) Pragt oellnt]. Charles Quint aurait-il raison ? J’espère pour lui qu’il écrivait l’Allemand mieux que moi. Je m’en acquittais assez bien autrefois. J’ai oublié. Je ne vois pas paraître non plus la grande victoire de D. Carlos sur les Christinos. Dieu est bien bon s’il donne à quelqu’un de ces gens-là une victoire ; c’est du bonheur perdu.
10 heures
Je suis charmé que vous gardiez Matonchewitz un peu plus longtemps. Je pense beaucoup à vos plaisirs. Je regretterai de ne pas voir les Holland. Je ne regretterai rien. Adieu. Le courrier m’apporte deux lettres auxquelles il faut que je réponde sur le champ. Adieu. Adieu G.
Mots-clés : Politique (Internationale), Vie domestique (François)
158. Val Richer, Mercredi 13 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà la première fois depuis un mois, que je me lève, sans le soleil. Je voudrais qu’il vous accompagnât à Ostende et à Bruxelles. Je jouis du beau temps autant pour vous que pour moi. La séparation n'ôte rien aux petites préoccupations de l'affection. Il me paraît qu’on a beaucoup d'humeur à Paris des dernières résolutions de l’Autriche. On comptait sur une alliance active, et on l’avait beaucoup dit. Tellement que presque tout le corps diplomatique y croyait. Confiance un peu puérile. L’Autriche a fait et fera tout ce qu’elle pourra pour vous diminuer, sauf de vous combattre. Elle appuiera les tendances de la politique des Alliés sans s'associer aux actes de leur guerre. Ce qu’elle ferait si elle était poussée dans ses derniers retranchements, si on lui faisait craindre sérieusement le soulèvement de l'Italie, je ne le sais pas ; mais elle n’en est pas là. Tant que la Révolution ne sera pas sur ses épaules, elle gardera son attitude de médiateur expectant. Elle en profitera pour gagner du terrain sur vous pendant la guerre, et vous en profiterez un jour, et l'Europe entière en profitera pour le rétablissement de la paix.
Je ne crois pas plus à une désunion sérieuse entre l’Autriche et la Prusse qu'à la guerre de l’Autriche contre vous. Le bruit a couru un moment à Paris que par suite des dernières résolutions de son Empereur, le comte de Bual se retirait. Le bruit a été démenti.
Tout le monde attend très impatiemment des nouvelles de l'expédition de Crimée. Le retour du Général Espinasse et ce qu’on dit de ce qu’il dit me déplaît. Je crains que l'imprévoyance, et la présomption ne soient pas d’un seul côté. C’est un sentiment très pénible que de n'avoir pas confiance dans la capacité du gouvernement de son pays.
Je crois que la visite du Roi Léopold n'aura pas été inutile à l'Empereur Napoléon. Il lui aura dit beaucoup de choses que celui-ci ne savait pas, et qui doivent le conduire à penser qu'autant au moins que personne, il a besoin de la paix.
Les nouvelles d’Espagne sont bonnes et mauvaises. Bonne en ce sens qu'à Madrid la réaction d’ordre a repris le dessus, et que, grâce au général O'donnel et à ses troupes, le gouvernement est le maître. Mauvaises dans la plupart des Provinces où l’anarchie est complète. C'est l'état normal de l’Espagne, et il peut durer longtemps, car il dure depuis longtemps.
La Reine Christine n’est point folle. Elle a au contraire, presque seule dans sa maison, conservé la sérénité de sa tête, et dans sa route, elle a parlé politique à ceux qu’elle rencontrait officiers ou Alcades, leur donnant à tous de bons conseils.
Midi
Adieu, adieu. Vous arrivez aujourd’hui à Bruxelles.
159. Bruxelles, Mardi 7 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lord Howard m’a fait une longue visite. Son langage me prouve que l’opinion de Lord Lansdowne aura prévalu dans le conseil anglais à savoir que Sébastopol finit tout, si, comme on le croit là, il tombe au pouvoir des alliés. Il m’a beaucoup parlé de la paix, mais avec de grands doutes que nous nous y prêtions. Lord Clarendon venait de lui écrire une lettre fort triste sur les pertes énormes essuyées par les Anglais dans la rencontre du 25. C. Gréville m'écrit aussi sur le même ton de désolation, et l’incertitude où l’on est encore sur le nom des victimes ajoute beau coup à l’inquiétude générale. En même temps on ne connait pas le chiffre de nos forces. Mais du côté des alliés il n'y avait pas 50 000 hommes (les Turcs non compris).
La Prusse vient de faire une dernière démarche à Peters bourg pour demander l'acceptation des quatre points et conjurant de le faire avant le dénouement de Sébastopol ce qu'en effet ôterait tout caractère d’humiliation à cette acceptation si la place tombait. La réponse peut arriver à Berlin aujourd’hui. Je doute que nous cédions. L'Autriche est dans une détestable position. On ne se fis pas encore tout à fait à elle de votre côté, et chez nous vous concevez aisément le sentiment qu'on lui porte. Si Sébastopol ne tombe. pas, Bual et Bach tomberont, & c’est le parti russe qui arrivera au pouvoir. On persiste à dire que tous les généraux sont de ce parti. L’Allemagne est dans un complet désarroi. C'est un grand moment que ce moment ici. Et Sébastopol un siège mémorable. A-t-il son analogue dans l’histoire ? Je ne crois pas. Je viens de voir le roi passer à cheval pour se rendre à la Chambre. Cerini a une fenêtre qui donne de ce côté. Brokhausen est revenu & intéressant. Il parait que mon Empereur est bien changé et dans un mauvais état de santé.
Moi j’ai un rhume de poitrine effroyable. Voilà deux nuits que je ne dors pas. Je ne bouge pas de chez moi. Mon fils est allé se promener en Hollande, Adieu. Adieu.
159. Paris,Mercredi 10 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vais m'occuper de suite de madame de Pontalba. Je n’ai vu hier que Madame de Talleyrand qui m’a fait une très longue visite. Il me parait qu’elle a du temps à perdre et des nouvelles à apprendre. C’est un grand changement. Deux fois hier elle vous a nommé, et savez- vous ce qui m’est arrivé. Il m’est arrivé de rougir comme on dit jusqu’aux oreilles, mais c’était si fort que ce disait être presque de l'embarras pour elle aussi. Quelle sotte habitude et comme je dois lui paraître étrange. Assurément elle ne comprend pas cela. Je me suis promenée avec mon fils, il faisait très froid. Le soir j’ai causé avec lui, je me suis couchée de bonne heure. encore une mauvaise nuit. J'aime le dernier mot de votre lettre. " je m’impatiente beaucoup." Soyez sûr que ce sont ces petits mots là que j’aime le mieux. Je vais vite les chercher. Vous me parlez de feu, comment vous en avez dans votre chambre ? Cela me parait incroyable.
2 heures
J’ai été interrompue par Matonchewitz, plus tard par Alava. Voici l'heure de ma promenade et de la poste. Je vous quitte et je vous dis adieu with all my heart. Adieu.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Réseau social et politique
159. Val-Richer, Dimanhe 14 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis promené hier avec vous sous les Arcades. Y étiez-vous ? Il n’y avait certainement pas moyen d’être ailleurs. La pluie est-tombée par torrents. Décidément je vous aime à La Terrasse. Je m’y crois plus aisément qu’ailleurs, en attendant que j’y sois. Et puis je pense à cet hiver. C’est près de chez moi, près de la Chambre par un chemin commode. Nous arrangerons, nos heures, car je veux travailler un peu.
Vous ne m’avez pas dit si Lady Granville avait fait sa déclaration à Marie, et avec quel effet. J’aime à savoir où en est tout l’établissement. Et Mad. de Flahaut revient-elle cet hiver ? Sera t-elle toujours mon ennemie ? Ou bien changera-t-elle comme M. Molé ? Il vous a dit qu’il me respectait fort. Vous souvenez-vous de l’humeur que lui donnait ce mot, de votre part ? Je ne prévois pas du tout la session et je n’essaie pas de la prévoir. Je ne sais qu’une chose, c’est que j’agirai selon mon propre jugement.
Je ne me fatigue pas non plus l’esprit à prévoir l’Europe de 1839. Cependant, je persiste ; il y a quelque chose à prévoir. Cette immobilité générale, des esprits et des corps, ne durera pas toujours. Et parce qu’elle dure depuis longtemps, c’est une raison pour qu’elle soit plus près de son terme, non pour qu’elle dure encore. Du reste tout cela est si vague qu’il n’y a pas à en parler. Lord Holland vous plaît donc beaucoup. J’en suis bien aise Il me plaisait fort aussi. J’aime les esprits cultivés et variés, qui s’intéressent à toutes choses, et reçoivent de toutes un mouvement facile. Il y a à cela de la liberté et de l’élégance, deux qualités charmantes. Quand je suis entré dans le monde les esprits là n’étaient pas rares ; il en restait quelques uns du siècle dernier ; temps de conversation et d’amusement s’il en fut jamais, où l’on pensait à tout pour s’en entretenir et avoir de quoi se plaire les uns aux autres. Lord Holland est fort lettré, grande ressource et grand agrément pour causer. On a eu beaucoup d’esprit dans le monde. il faut en hériter et en jouir encore, et en faire jouir les autres. Je n’aime pas les gens qui ne savent parler que de ce qui se voit et se fait de leur temps et autour d’eux. Pour tout le monde, le présent est une coterie. La meilleure est petite.
Savez-vous à quoi je m’amuse quelques fois ? à chercher, parmi les gens d’esprit que j’ai connu, lesquels vous auraient plu. Je n’en trouve pas beaucoup, quelques uns pourtant, trois ou quatre. Et quand j’ai trouvé ceux-là, je cherche s’ils vous auraient plu beaucoup. Il me semble que non. J’en suis charmé.
10 heures ¼
Je ne crois pas que vous me trouviez plus de jours que de coutume, mais moi, je voudrais bien ne pas vous trouver maigrie. Je borne là mon ambition. C’est bien de la vertu à moi. Du reste je ne sais pourquoi vous vous êtes persuadée que l’embonpoint me plaisait. Cela ne m’est pas arrivée une fois en ma vie. Je suis charmé que Marie soit de bonne humeur. Vous avez raison ; il ne faut pas prodiguer les remèdes héroïques Je serai comme vous dites, la pierre de touche, Adieu, adieu. Il fait très froid aujourd’hui. Je fais rentrer mes orangers. Il faut que tout rentre. Adieu. G.
159. Val Richer, Jeudi 14 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
On attend à Brest et à Cherbourg l’amiral Parseval et sa flotte. Dans l'opinion de nos marins, sur Charles Napier ne sort pas bien de cette campagne. On l'a trouvé bien timide et ne se préoccupant que d’éviter la responsabilité. On dit aussi que pour prendre Bomarsund, l'envoi d’un futur Maréchal, et de 10 000 hommes de troupes n'était pas nécessaire, et que l’amiral Parseval l’avait dit d'avance, offrant de prendre l'île et le fort avec les seuls marins et les canons de ses vaisseaux. Quand Baraguey d’Hilliers est arrivé là, il paraît qu’il a un peu négligé Parseval et qu’il est allé voir Napier et s'entendre avec lui sur l'opération, sans faire en même temps visite à l’amiral Français. Parseval qui est fier, froid et très gentleman, a trouvé cela mauvais, et est allé sur le champ se plaindre à Baraguey d’Hilliers du procédé, ajoutant que, si on ne lui faisait pas la place et la part auxquelles, il avait droit, il attaquerait, lui seul Bonarsund dans deux heures, et qu'avant la fin du jour il serait maître de la place. Tout s'est raccommodé. Voilà les bruits de nos ports. On dit aussi qu’au moment du départ de nos troupes pour la Baltique, quand Baraguey d’Hilliers a vu qu’on lui donnait pour chef du Génie, le général Nielle, officier très distingué et considérable dans son armée, il a craint de voir se renouveler à ses dépens, l’histoire du Général Oudinot et du général, aujourd’hui Maréchal Vaillant, au siège de Rome. Il s'en est expliqué nettement et est parti rassuré.
En Orient, le général Canrobert est très populaire dans l’armée. En apprenant le mauvais état de sa division mal engagée par le général Espinasse dans la Dobrutscha, il s’y est rendu sur le champ et a pris, ses mesures pour ramener la division malades et valides avec une promptitude, une intelligence, et une vigueur dont les troupes lui ont su beaucoup de gré.
Montebello m'est arrivé hier. Son fils lui revient ces jours-ci de la Baltique. Il est très impatient de le voir arriver. Il y a un peu de choléra sur son vaisseau, qui est celui de l’amiral, l'Inflexible. Ils ont perdu six hommes en deux jours. Son second fils va entrer à St Cyr. Il dit qu’il ira vous voir à Bruxelles. Il ne m’a apporté aucune nouvelle, des détails sur les succès de l'Impératrice à la cour et dans sa maison ; on la trouve bonne, généreuse attentive, spirituelle. Montebello dit que sa belle-sœur est tout-à-fait sous le charme. Pas la moindre disposition de l'Empereur à se mêler des affaires d’Espagne. L'Impératrice l'en détournerait au lieu de l’y pousser. Il ira la chercher à Bordeaux, et la ramènera au camp de Boulogne.
Onze heures
Le Morning Chronicle a bien raison de démentir, les toast attribués à l'Empereur et au Prince Albert. J’avais peine à y croire. Adieu, Adieu. G.
160. Bruxelles, Mercredi 9 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Quelle lettre ! Les rapports de Canrobert & de Raghan n'en annoncent pas encore le terme. Ils sont tristes plutôt. On m'écrit d'Angleterre que les rapports du 27 confiés à un officier anglais, ne sont pas arrivés. Il les a perdus ou oubliés. Jugez la désolation des familles, c'est là où se trouvait la relation du combat meurtrier du 25.
On dit à présent que c’est le 4 qui tous nos renforts devaient être arrivés. Le 2 La place n'était pas prise, ils arrivent peut être à temps pour livrer une bataille. Il faudra bien un avant ou après Sébastopol. N'êtes-vous pas épouvanté de ce sacrifice de vies humaines ?
On dit que nous n’avons pas voulu écouter les dernières dispositions de la Prusse. Cela décidera l’Allemagne. Elle ne joindra toute entière à l'Autriche si cela n’est pas fait déjà. L’Autriche a brûlé ses vaisseaux, il lui faut la guerre avec nous, car l’occasion ne lui sera jamais si belle. En attendant sur la demande de la Prusse nous avons arrêté la marche de la garde impériale & l’Autriche par représailles a retiré ses troupes de la frontière. Mais ce n’est qu’un sursis. Le Prince Gortchakoff à Vienne a demandé des explications sur les félicitations adressées à Paris & Londres à propos de la bataille de l’Alma. Bual a répondu qu’il n’avait pas d’explications à donner. Ce n’est que demain que Lord
Pal[merston arrive à Paris. On dit à Londres que c’est en décembre que l’Empereur ira en Angleterre mais l’affaire de la Crimée devrait être éclaircies avant. Or, elle peut être longue concevez-vous comme je grille en attendant. Ma santé va mal. Je reste au lit la moitié du jour, je ne suis plus sortie du tout depuis samedi ; rhume, rhumatisme, great despondancy. Adieu. Adieu.
160. Paris, Jeudi 11 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vraiment mon temps est tellement pris par mon fils, par Matonchewitz, par des visites, que je ne parviens pas à vous écrire comme je le voudrais comme j’en éprouve le besoin. Comprenez-vous que je vous aime, que je vous aime beaucoup, que je voudrais causer avec vous sans cesse, sur toute chose, que je m’impatiente contre tout le monde qui me prend mon temps. Matonchewitz repart je crois ce soir. Nous ne nous serons pas dit la vingtième partie de ce que nous avons à nous dire comme un homme d’esprit, & un galant homme est une affaire rare à rencontrer ! J’aime Matonchewitz extrêmement.
Quand je vous reverrai j'aurais bien des choses à vous dire, si le temps qui doit s'écouler encore d'ici là n’efface pas bien des choses de ma tête. Car c’est étonnant comme ce qui semble d'un si vif intérêt dans le moment est diminué au bout de huit jours. J’ai dit hier à un habitué que je les recevrais tous les soirs. Ils sont venus, la portière les a renvoyés, moi je les attendais. Enfin j’apprends qu'on a chassé tout le monde. Il n’est venu plus tard qu’Alava, qui s'avise de se trouver mal. Je l’ai livré à Marie et je suis allé me coucher.
Je ne me porte pas bien. Le sang à la tête, très froid aux genoux. Il faudrait marcher et je n’en ai pas la force. Venez me donner le bras. Pas de nouvelles de mon mari. pas de nouvelles en général, mais un horizon très bien partout. Ici cependant on est content. Votre lettre ce matin est fort bonne à lire. Que de fous dans le monde ! Mais il me semble qu'il n'y a des fous que dans les temps de paix et de calme. Je crois donc qu'ils sont un bon signe. On dit dans le monde que vos amis sont très enragés & qu'ils menacent de s’allier à Odillon Barrot s'ils ne trouvent pas meilleure compagnie.
Je suis fort aise que vous ne fassiez pas de dîner public, & de speech politique. Je trouve toujours qu'on doit ménager ces paroles pour le moment de l'action. les professions de foi, les prédictions, tout cela est du stuff quand ce n'est pas à propos, et je ne verrais aucun à propos à cela dans ce moment. Il me semble que j'aurai bien des belles choses à vous dire sur ce chapitre quand nous nous verrons. Adieu, car je crains encore les interruptions. Adieu. Adieu, toujours de même.
Mots-clés : Politique, Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
160. Val-Richer, Dimanhe 14 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
160 est un gros chiffre. Je l’écris avec un sentiment très partagé. Nous nous connaissons déjà depuis longtemps et nous avons été longtemps séparés. Où en serions nous si nous ne nous étions pas quittés un moment ? Bien plus avant que nous ne sommes si je ne me trompe. Le temps seul nous a manqué et nous manquera. Je suis convaincu que nous ne nous connaissons que très imparfaitement. C’est triste. Nous aurons souvent très souvent passé l’un à côté de l’autre, pas grand chose de plus. Nous valons l’un pour l’autre plus que cela beaucoup plus. Il y aura beaucoup à regretter entre nous. Faites-moi le plaisir de me dire, si mes lettres vous arrivent de meilleure heure à la Terrasse qu’aux Champs Elysées.
Si j’étais le Roi, je voudrais bien que le Prince royal de Bavière fût en effet trop laid. Du reste, je sais gré à votre grande Duchesse de l’avoir trouvé laid, s’il l’est réellement et de l’avoir dit. Il n’est pas besoin d’être une grande Duchesse pour se marier comme une sotte. Je serais charmée d’en savoir une qui s’y montrât plus difficile, et plus sensée. Cela ferait aussi honneur à son père.
Lundi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier soir par un petit accident arrivé à Henriette près de se coucher. Elle est tombée en courant dans la galerie et s’est fait mal au menton ; rien du tout, une simple écorchure. Mais le sang coulait ; mon bon Guillaume était au désespoir, et le désespoir le plus tendre, le plus caressant qui se puisse imaginer. J’ai là trois petites créatures qui auront grand besoin de force d’âme et de raison, car elles auront beaucoup d’émotion à porter. L’embarras est grand ; il faut tantôt développer, tantôt contenir ; aujourd’hui on désire, demain on craint la grande activité de l’esprit et du cœur. Je ne puis souffrir les natures obtuses, apathiques ; et les mérites contrariés coûtent si cher ou exigent tant ! C’est un effort bien difficile, et qu’il faut recommencer tous les jours, que d’accepter ce mélange si profond, si inséparable du bien et du mal, en nous-mêmes et dans notre destinée. Parlons de ce qui vous regarde.
Il faudra bien que nous trouvions moyen d’arranger votre soirée comme votre santé, même capricieuse, le voudra. Je regretterais que vous ne pussiez pas conserver l’habitude de rester chez vous tous les soirs, habituellement du moins. Rien ne convient mieux aux hommes et ne les attire davantage que la certitude de trouver toujours. Mais ne pourriez-vous, toutes les fois qu’à six heures, vous aurez envie d’aller vous coucher, le dire tout simplement et renvoyer ceux qui seront- là ? c’est un petit parti à prendre, je le sais et vous n’aimez pas à prendre un parti. Cependant cela vaudrait mieux je crois, que toute autre méthode. Si vous disposiez de vos heures de sommeil, je vous dirais de les placer le matin et de vous lever plus tard. Mais on ne dispose pas de soi, ni de nuit, ni de jour.
10 h.
Il est parfaitement sûr que si cela se pouvait, je vous écrirais plus d’une fois par jour. Je voudrais remplir votre temps, votre cœur, les remplir de moi, de moi seul. J’en dirais trop. Adieu. Adieu. G.
160. Val Richer, Vendredi 15 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si nous étions ensemble, nous ne parlerions que de l'expédition de Sébastopol. Nous ferions des conjectures, et nous attendrions. Il n’y a pas moyen de parler d'autre chose en s'écrivant, ni de s'écrire toutes les conjectures. Quel que soit le résultat, je le tiens, comme vous, pour triste en ce sens qu’il éloignera la paix. Personne n'acceptera un grand revers.
Les journaux disent que Lord Raglan s'est embarqué aussi. La question du commandement a donc été résolue selon le désir du Maréchal St Arnaud.
Je trouve le ton de votre dernière réponse aux communications de l’Autriche très convenable, modéré et triste. Pour les spectateurs les plus indifférents, tout l’aspect, de cette guerre est triste. Vous brûlez vos villes, ou bien en vous les brûle. Vous vous en allez des lieux qu’on vous prend et ceux qui vous les prennent n’y peuvent pas, rester et s'en vont aussi. Et succès ou revers rien n'avance à rien. Il y a, sous tout cela, un grand fonds d'absurdité et d'impossibilité.
Ce ne serait explicable que dans l'hypothèse d’une guerre à mort, comme celle de l'Europe en 1814 avec l'Empereur Napoléon. Mais l'hypothèse n’est pas admissible.
Samedi 10 heures
Votre lettre de Bruxelles m’arrive de bonne heure. Moi aussi, cela me plaît de vous savoir, j’ai presque dit de vous avoir plus près. Mais l'avenir ne me paraît pas meilleur qu'à vous. Vous levez de nouveau des soldats ; nous aussi. Si l'attaque sur Sébastopol ne décide rien, l’année prochaine sera terrible.
La liberté de la mer noire, toute seule ne signifie rien. Seulement une facilité pour la création d’un Sébastopol Anglais. C'est à mon sens, la pire chance pour vous.
Où êtes-vous logée à Bruxelles ? Bellevue, l’Europe, où enfin ? A part l’intérêt de l'adresse je tiens à le savoir. Je voudrais avoir vu le lieu où vous êtes. Adieu, Adieu. G.
Est-il vrai comme je le vois dans Galignani, que Kisseleff est revenu à Bruxelles ?
161. Bruxelles, Samedi 11 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Personne n’est plus impatient que moi du siège de Sévastopol. Je n’en comprends plus la fin. Si la place n’a pas été prise avant l’arrivée de nos renforts, le sera t-elle après ? Est-il vrai que Naples ne veuille pas de l’assaut ? Après avoir été très fanfarons je trouve le ton des Russes devenu très modeste. Ils n’affirment rien, ils espèrent dans tous les cas ils sont contents car la résistance est & sera bonne. C'est une grande lutte, un grand spectacle, qui fait honneur à tout le monde. Les savants seulement donnent tout aux combinaisons militaires des deux parts. Mais le courage est superbe. Le mien est fini. Je ne sais pas comment supporter les mille petits maux qui m’assiègent. C’est évidement & le mauvais climat et le mauvais gite. Il faut me tirer de là, et quand ? Je n’ai point de nouvelles à vous donner. J’ai lu les deux derniers bulletins de Menchikoff du 1er & du 3 au soir. Même situation. Attaques défenses. On répare tous les jours le mal fait la veille. Les renforts étaient attendus le 4.
Je ne sais pourquoi Crept. ne donne plus ces bulletins à l’indépendance, il a parfaitement tort. Les Allemands attendent Sébastopol. Jamais le roi de Prusse ne marchera contre nous. Il pourra être détrôné, il s’est fait cette religion-là. Voilà une lettre de la G. D. Marie du 5. On pensait que ce jour là l’assaut serait donné et qu'on le saurait à Pétersbourg le 10 ou le 11 aujourd’hui. Aucune certitude sur l’issue, mais quelqu’espérance. " nous sommes toujours en possession des redoutes prises. Elles sont postées sur les hauteurs dominantes de la principale ligne de retraite de l'ennemi (je copie.) C'est une position si importante qu'il est à supposer qu'il fera tous les efforts pour les reprendre. "
Des amitiés de père & mère pour moi. Le duc de Sutherland m’a écrit une très triste lettre sur la mort de son fils, 16 jours sans médecin sans secours. Quand il les a eus il était trop lard. Il est mort le lendemain.
Les Holland ne viendront que quand Sébastopol sera pris. Ils veulent jouir de mon humiliation et pas de mon triomphe. Vous savez bien qu’il n’y aurait pas de triomphe. Je suis toujours renfermée dans ma chambre toute la tête prise. Je me fais tapissier. Tous les jours quelque nouvelle invention pour me garer des courants d’air. Le M Port. dit que les Palmerston sont priés pour résider à St Cloud. Adieu. Adieu.
161. Paris, Vendredi 12 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne dors pas, c'est une mauvaise habitude. Pour que je dorme il faudrait que je puisse me coucher tous les jours à 10 heures et je ne sais comment m’arranger pour cela. Hier j’ai eu assez de monde. Mais pas de quoi accuser les Holland qui sont venus s’établir chez moi. Lui est un homme vraiment charmant quel dommage que vous ne les voyez peu ! Ils en sont très contrariés, ils partent. le 25. Matonchewitz passe encore huit jours ici. Plus je cause avec lui et plus je l’aime, nous parlons beaucoup de vous. Je lui ai fait lire votre lettre hier. Il en a été bien frappé. J’ai vu à l’impression qu’il en a reçue que moi je suis bien accoutumée à votre supériorité. Je jouis beaucoup de l’effet qu’elle produit sur les autres. C’est charmant d'être fière de ce qu'on aime.
2 heures
Je crois qu’il me faudra prendre le parti de vous écrire la nuit. Le matin. je suis interrompue, sans cesse. Matonchewitz est venu à 11 1/2 & ne me quitte que dans cet instant, et nous avons tant et tant à nous dire que je ne veux pas abréger ses visites. Vous me pardonnez n’est-ce pas ? On dit que l'Angleterre se joint à nous autres sur la question Belge. Ce serait drôle. Du reste point de nouvelles. Adieu. Adieu. bien vite & bien tendrement.
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
161. Val Richer, Dimanche 17 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi Mad. Kalergi revient-elle à Bruxelles. Paris, cela se comprend ; on y vient pour son plaisir. Mais Bruxelles, il y faut la nécessité, ou des affaires. Quelles sont ses affaires ? Ce séjour là sera suspect. Pour votre repos, dans le lieu le plus rapproché de Paris, je ne voudrais pas qu’il s'y reformat une coterie Russe apparente et bruyante, c’est-à-dire dont on fit du bruit. Je ne crois pas que cela servit à rien pour la paix, et je ne suppose pas que votre Empereur compte sur les informations ou sur l'influence de Mad. Kalergis. De Bruxelles, personne n'influe sur Paris, et le Roi Léopold seul peut avoir quelque chance d'influer sur Londres.
Ce que vous me dites de l'état d’esprit de votre Empereur doit être vrai. Sa situation est difficile et mauvaise. La défensive va mal au pouvoir absolu, et à l'orgueil. Certainement il n’a pas l'art de plaire et de se faire des amis. Vos deux derniers souverains Catherine et Alexandre l'avaient et s'en sont très efficacement servis. Quand on est un peu venu nouveau, dans une grande et vieille société comme l'Europe, il faut être très fort ou très aimable, et les deux ensemble encore mieux.
Vous aurez surement remarqué l’article de St Marc Girardin dans les Débats d’hier, sur la nouvelle brochure de M. de Figuemont. Les esprits sont en travail partout en Europe pour se faire, à votre égard, des idées, des systèmes qui vous rejettent d'Europe en Asie. Votre Empereur, prenant le contrepied de ses prédécesseurs, a voulu être plus Russe qu'Européen. Il y a réussi, et l'Europe est en train de le pousser dans la même voie.
On me dit qu’à Paris le public est très vivement préoccupé de Sébastopol. La préoccupation est toujours mêlée de quelque inquiétude. En province, on n’y pense guère. On y penserait beaucoup si l'expédition ne réussissait pas. La tranquillité est profonde et la sécurité très courte. Mais on s'attend au succès.
Les articles du Times et ceux d'Havas indiquent qu'à Londres et à Paris, on ne veut pas prendre trop d'humeur de l’inertie actuelle de l’Autriche. On explique, on montre quels services, son attitude a déjà rendus ; on espère mieux si le mieux devient nécessaire. J’ai cru longtemps qu’on ne pourrait pas faire la guerre, une vraie guerre, sans qu’elle devint générale. Ce qui se passe depuis un an m'en fait douter un peu. C'est le mérite de l'Empereur Napoléon d'avoir trompé, jusqu'ici, les espérances des révolutionnaires. S'il se laissait aller à la guerre générale, il perdrait nécessairement ce mérite, car la guerre générale, c’est la guerre révolutionnaire. Maintenant l’Autriche a cette grande force qu’on ne peut pas lui faire la guerre sans se jeter dans la révolution.
Montebello m'a quitté, excellent homme. Il dit toujours qu’il ira vous voir à Bruxelles. Il a sa femme malade, et comme il dit, toutes les infortunes du père de famille qui a des enfants de tous les âges, une fille à marier, un fils dans la Baltique, un autre à examiner pour l'école de St. Cyr, deux au collège, et un qui sort de nourrice. Il est absorbé.
Adieu. Adieu. G.
162. Bruxelles, Lundi 13 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu hier des lettres de tous les coins, et de toute espèce. Morny était revenu à Paris, je vais lui écrire une longue lettre de Constantin en grande espérance. Je n’en tiens pas grand compte de Lord Havard qui est à Paris demandant protections pour la lettre de Clauricarde à son fils. La G. D. Marie me mande que de Sébastopol à Kalonga il n’a fait que manger comme un affamé tout ce qu’il trouvait. Les officiers Français avaient passé à Pétersbourg quelques jours très bien traités. On les a entourés à Paroslaff, je ne sais ce qu'on fera des anglais.
Kisseleff m'a annoncé hier qu’il retournerait probablement à Pétersbourg. Il est très triste. Pas de perspective pour lui. Et on lui retire les deux tiers de ses traitements. Ditto pour Brunnow qui, lui, arrive à Pétersbourg dans quelques jours.
Chaque minute doit nous apporter une grande nouvelle. L'assaut devait être donné ; Menchikoff n’aurait donc pas attaqué avant, à quoi bon alors les renforts, car ma fois à Sébastopol il sera bien plus difficile de vous en déloger, et quel matériel immense vous allez y trouver ! Les jeunes grands ducs sont allés à Sébastopol dit-on. Pauvre impératrice comme elle va trembler ! J’apprends les combats du 5. De la tuerie sans résultat. C’est affreux. Pas de lettre de vous aujourd’hui. Il fait bien froid ; mon rhume dure. Adieu. Adieu. Je suis triste.
162. Lisieux, Mercredi 17 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’attends pas Matonchewitz, ni une bonne conversation. Mais j’ai dîné ici hier. Trois personnes attendent à la porte de ma chambre et il faut que je sois reparti dans une heure pour le Val Richer. Hier en venant à Lisieux seul dans ma voiture, j’ai pensé au 16 octobre pour vous, beaucoup à vous. Il est bien difficile de dire ce qui est vraiment au fond du cœur. Je n’ai jamais été plus occupé de vous. J’aime tant de choses en vous ! Et des choses que je ne trouve nulle part ailleurs nulle part mais n’ayez donc pas toujours de mauvaises nuits. Faites cela pour moi. Je regrette que les Sutherland passent si vite. Je voudrais que vous fussiez habituellement entourée d’affection d’impressions douces. C’est ce qui vous manque. Quelqu’un qui soit toujours là, associé à tous les détails de votre vie, à soigner et qui vous soigne, à aimer et qui vous aime dans tous les moments de la journée. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’autre chose que de vous. Il faut que je fasse entrer les gens qui attendent. Adieu. Adieu. Remerciez ; je vous prie, pour moi la Duchesse de Sutherland de son souvenir. J’espère que je serai plus heureux quand elle repassera par Paris pour retourner en Angleterre. Adieu. Adieu. Je voudrais couvrir d’adieux le papier blanc qui me déplaît. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
162. Paris, Samedi 13 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous ai-je dit que la grande Duchesse Olga ne veut pas du prince royal de Bavière. Elle l’a trouvée trop laid. Voilà ce que raconte M. Jennisson. Vos ministères déclament plus que jamais contre la presse. On ne peut pas croire avec elle. On ne sait que penser des affaires d’Orient. Les gestes de l'Angleterre donnent du soupçon à tout le monde. On ne les comprend pas plus ici qu’autre part. Je vous dis bien vite tout ce qui ne me regarde pas. Et pour passer à ce qui me regarde, j’ai fermé ma porte hier, je deviens un peu capricieuse dans mes allures. Mais vraiment je ne suis pas bien ; je me sens fatiguée, accablée. J'ai besoin de mon lit à 10 heures. Je ne sais comment m’arranger pour satisfaire cette fantaisie et en même temps celle de voir du monde. Au reste dans ce moment-ci encore le monde est peu amusant.
Savez-vous que le temps devient bien froid ; cela n’est pas naturel pour cette saison. Je compte sur l'été au mois de janvier. Marie est d'une douceur, d'une égalité d’humeur, & d'une bonne humeur charmante. Le speech de Lady Granville devient tout-à fait inutile. Nous l’avons ajourné à la première boutade au plus léger signe. Vous serez sans doute la pierre de touche. Elle est charmante pour mon fils. Je prétends qu’elle le soit pour vous, & tout le monde ; sans cela, bonjour.
Que je suis impatiente de voir finir ce mois ! Mais je m'en vais être horriblement envieuse. Vous allez revenir engraissé avec des joues, et moi, j'ai une très pauvre mine. Votre premier absence m'avait si bien servi. La seconde ne m'a rien valu du tout, au contraire. Palmella n'a jamais vu de sa vie Madame de Pontalba. Personne de ma connaissance ne la connait. Adieu. Adieu. Je compte les jours Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Internationale)
162. Val Richer, Lundi 18 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne comprends pas comment ces quatre lettres ne vous sont arrivées qu'à la fois. Vous ne les aviez donc pas fait demander à la poste même, où je les avais adressées poste restante, ne sachant pas votre adresse à Bruxelles. Enfin, cela n’arrivera plus ; vous avez une adresse Je suis très contrarié de tous ces absents. Je m'était promis que vous trouveriez à Bruxelles une espèce de petit homme provisoire, en attendant le vrai. Est-ce que Van Praet est malade qu’il retourne en Italie ?
Il faut qu’on trouve à vous loger à Bellevue. Prendre une maison à Bruxelles, c’est trop fort. Quels sont donc les étrangers qui remplissent tous les hôtels ? N'aurez- vous pas au moins, parmi eux, passé les premiers moments, quelques ressources de société ? Au moins faut-il qu’ils vous amusent un peu s'ils vous délogent. Voilà le général Espinasse défendu par le Moniteur et retournant en Orient. Vous souvenez-vous que c’est lui qui a fermé, l'Assemblée législative le 2 Décembre ? L’Assemblée législative me rappelle Montalembert. Il était à Bruxelles, il n’y a pas longtemps à ce que m’a dit quelqu’un qui en venait, et qui y avait dîné avec Mérode. Ce serait là deux ressources.
Mardi
Lisez l’un à côté de l'autre, si vous ne l'avez déjà fait, les derniers articles du Times sur le Prince Albert au camp de Boulogne et l'article du Moniteur de Dimanche. C'est à qui mieux mieux. Il faut que, pour les deux pays, cette alliance soit bien, aujourd’hui, dans la nécessité des choses pour qu’elle surmonte ainsi, tous les souvenirs, toutes les répugnances du passé, et survive à toutes les révolutions. Votre Empereur est dans une politique de routine. La France et l’Angleterre, en sont sorties.
Il me paraît que vous aurez affaire aux Turcs en Bessarabie, en même temps qu'aux Français et aux Anglais en Crimée. Les mouvements d’Omer Pacha indiquent une campagne dans la Dobroudja et au delà du Pruth. Je suis frappé aussi de l'envoi de tous les réfugiés Polonais, Hongrois, Italiens, qui servaient sous Omer Pacha, à l’armée Turque d’Asie. On se prépare de tous côtés pour cet automne et pour le printemps prochain, à une générale et rude campagne.
Autre campagne, moins bruyante. Voilà une vacance nouvelle à l'Académie Française. Il y en a deux à l'Académie des Inscriptions, et Fortoul sera nommé cette fois. A l'Académie Française, nos trois réceptions se feront en Janvier. J’ai reçu hier une lettre de l'évêque d'Orléans qui est pressé. Berryer est prêt. Salvandy prépare ses trois discours. On annonce un hiver littérairement assez animé. Les souvenirs des Cent-jours de Villemain s'impriment, et paraîtront en novembre. Albert de Broglie publiera les deux premiers volumes d’une Histoire du Christianisme au 4e siècle, quand il (le Christianisme) est monté sur le trône avec Constantin.
Onze heures
Comme de raison, les journaux ne m’apportent rien, et je n'ai à vous dire qu'adieu et adieu. G.
Mots-clés : Académie (élections), Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie française, Affaire d'Orient, Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), histoire, Littérature, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Réseau académique, Réseau social et politique, Salon
163. Bruxelles, Mercredi 15 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comme l’approche du 20 9bre m’aurait fait battre le cœur de joie si nous n’avions pas cette maudite guerre ! Cependant vous serez plus rapproché de moi, vos lettres seront plus fraîches ; voilà de quoi me réjouir. Vous ne savez pas comme vos lettres sont charmantes. Comment peut on avoir tous les jours tant d’esprit, sur tant de sujets variés et dire si bien.
Le combat du 3 semble être resté stérile. Beaucoup de victimes surtout de notre côté, s'il faut en croire vos rapports. Le célèbre capitaine Velde ici prétend qu’il ne s’agit plus de siège, mais de guerre. On se bat, on se battra, nous ne voulons à Balaklava et nous sommes en position de le menacer, c’est un point très fort par sa situation, par la nature, et par les travaux que vous y avez faits. Vous ne pouvez pas vous en passer.
Au bout de quelques batailles encore vous serez bien réduits, nous avons toujours les moyens de nous renforcer ! Quelle horreur ce sacrifices d’hommes ! Constantin me mande que L'Empereur renvoie à lady Clauricarde son fils. J’espère que la nouvelle est vraie. Il y a de la grandeur et de la malice dans cette vengeance. C’est accablant pour Clauricarde. Morny m’avait mandé il y a quelques jours l'insistance de l’Empereur pour lui faire accepter la présidence. Il l’a accepté, parce que dit-il les temps ne sont pas à l’eau de rose. Je trouve qu'il a très bien fait. Il se loue bien de l'amitié de son maître. Il n’est pas content encore de sa santé. Schlangenbad a été bien passager.
Quel chagrin. Je lis dans ce moment la mort de notre pauvre Ste Aulaire. J'en suis renversée. Quel aimable et charmant homme. Quelle tragédie, ces trois générations dans un si court espace de temps. Je perds un bon ami. Et vous plus que moi. Adieu. Adieu. Je tousse beaucoup, je ne sors pas Il fait très laid.
163. Paris, Dimanche 14 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai mal dormi ; je me suis levée très tard. J’attends Matonchewitz tout à l'heure, & je n’ai pas encore fait ma grande toilette. Voyez comme tout cela est enrageant. Et puis dimanche par dessus le marché ! Hier il a fait si froid que j'ai du prendre la voiture fermée. J'ai été à Auteuil où j’ai trouvé beaucoup trop de monde je n’y suis restée que cinq minutes. J'ai dîné chez la D. de Talleyrand avec Alava de là j’ai été de bonne heure chez Lady Holland. M. Molé y dînait. Mad. de Castellane y est venue après, et tout mon monde.
M. Molé a envoyé l’ordre que le corps d'observation reste sur la frontière, attendu que Louis Bonaparte n’a pas quitté encore son château. C’et décidément en Angleterre qu'il doit se rendre & de là aux Etats-Unis/ M. Molé n’avait pas l'air de bien bonne humeur. Il est parti aussi tôt que Mad. de Castellane est entrée.
Le Roi ne rentre en ville que mardi ce jour là aussi on attend Léopold. La conférence ira à ce qu’on croit & dans notre sens, parce que l'Angleterre se joint à nous. a propos Lord Palmerston a proposé d’établir à Londres une conférence pour régler les Affaires de l’Orient Nous avons décliné péremptoirement. Ce sont nos affaires. Demain sera vraiment la moitié du mois d'octobre !
Adieu. Cette semaine sera bien remplie pour moi. Mon fils, Matonchewitz, les Sutherland. Tout cela me quitte avant vendredi. Les derniers arrivent ce soir ! Ils me prendront beaucoup de mon temps aussi. Je voudrais partager toutes ces ressources, tous ces plaisirs, et tout cela vient à la fois ! Ecrivez-moi ; il est bien vrai que j'ai de vous une lettre tous les jours, mais cela ne me parait pas assez. Adieu. Adieu. Je suis bien casée & j'aime bien notre cabinet. Adieu encore.
163. Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je ne me trompe ; je me suis trompé hier. Aujourd’hui doit être le 163 et hier n’était que le 162. Cette fin du mois d’octobre est pour moi, un temps de fatigue et d’ennui. Les dîners m’écrasent. On commence à revenir à la ville. On sait que je vais partir. Chacun se croit obligé et pressé d’être poli pour moi. J’ai quatre dîners, en perspective. J’en ai refusé deux hier. Je refuse tout ce qui ne m’est pas politiquement utile. Quand ce mois finira j’aurai un petit plaisir, celui de la délivrance à côté d’un grand bonheur. Le redoublement de tendresse de Mad. de Castellane m’amuse. Elle sait être fort caressante. Je m’en rapporte à vous pour ne rendre que ce qu’on rend sans rien donner. Elle a de l’esprit et un savoir faire trop remuant, trop visible, mais assez intelligent et très persévérant. Elle est vraiment très attachée et dévouée à M. de L.
Au temps de leurs infidélités naturelles, elle disait toujours : " Quand M. Molé me reviendra, car il me reviendra, il me retrouvera. " Est-ce que les Sutherland sont logés à la Terrasse que leurs enfants puissent ainsi venir vous embrasser de grand matin ? Ce sont d’heureux enfants. On vous fait mal en vous montrant qu’on vous aime. C’est qu’on en vous le montre pas toujours, à tout instant. Il ne faut pas avoir du bonheur à longs intervalles et par accès. Il veut la continuité. Le soleil lève devant moi froid, mais dans un ciel pur, malgré les torrents de pluie d’hier. Je vous désire de tout mon cœur, ici, près de moi ; pour moi d’abord, pour vous ensuite. Je vous ferais du bien. Ce séjour est calme et doux. Une âme fatiguée y peut trouver du repos, et vous y trouveriez aussi de la tendresse. Il n’y a point de repos tout seul. Nous parlerions, nous ne parlerions pas, comme vous voudriez. Vous pleureriez si vous vouliez. Pas trop fort, n’est-ce pas ? Pas ces sanglots où tout votre être semble près de se briser, car je vous demanderais grâce, grâce pour moi-même. J’ai le cœur bien fatigué aussi, plus fatigué que je ne le montre, même à vous. Vous me seriez bonne, vous me feriez du bien aussi. Je veux que vous m’en fassiez. J’en ai besoin et j’y compte. Vous ne viendrez pas ici, mais j’irai vous retrouver.
8 heures
Je rentre. J’ai été me promener vingt minutes dans le jardin. J’y serais resté plus longtemps. Mais les ouvriers m’ont chassé. Quand on est vu, on n’est pas seul. Vous avez raison. Rien n’aide plus à rester ministre que de ne pas vouloir s’en aller. Rois ou Parlement ne chassent guère leurs ministres quand il faut absolument les chasser. Mais les révolutions sont plus brutales, et le Duc de Frias pourrait y être pris. A la vérité, la révolution d’Espagne est une si pâle copie qu’on peut se jouer d’elle sans y risquer comme sans y gagner grand chose. On m’a assuré quand la lettre, pendant je ne sais plus quelles Cortes, on allait voir tous les matins, dans le Moniteur, ce qui s’était fait en France à pareil jour pour savoir comment on remplirait sa journée. M. de Boislecomte est-il encore à Paris ? Si vous le rencontrez, faites-le causer sur le Pacha d’Egypte. Il doit être assez curieux à entendre sur l’état d’esprit où se trouve aujourd’hui cet homme là, et ce qu’on en peut conjecturer. J’admire beaucoup la netteté avec laquelle les Orientaux, quand une situation est une fois décidée en prennent leur parti et s’y accommodent sans cesser au fond, de travailler à la changer si elle leur déplaît. Il n’y a que cela de digne, et j’ajoute d’utile. Dans notre monde, on s’use, en petits efforts contre l’impossible. C’est dommage que Méhemet Ali ne soit pas sur un plus grand théâtre et avec plus d’avenir.
10 h.
Peu m’importe que vous griffonniez pourvu que ce ne soit pas un signe de lassitude. Je suis fort aise que votre fils vous reste quelques jours de plus. Je serais fort aise aussi de le trouver encore à Paris, et de le connaitre. Adieu Adieu. G.
163. Val Richer, Mardi 19 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si j’avais été à Paris l'article des Débats sur M. de Meyendorff, serait autre. Je ne sais d’où ils ont reçu des renseignements ; mais outre les inexactitudes, l'article n’est pas utile, et il aurait pu l'être. Si quelque chose peut être utile dans une situation si avancée et avec votre Empereur. Du reste j’ai appris depuis longtemps que lorsqu’on veut être utile, il ne faut pas se trop inquiéter de savoir quand et comment on le sera, ni si on le sera certainement ; il faut dire, ou faire sans hésiter, ce qui a chance d'être utile et s'en remettre du sort de cette chance à ce que les incrédules appellent, les événements et les Chrétiens la providence de Dieu. " La providence de Dieu ne souffre pas qu’on l'enchaine ; elle veut que le succès demeure entre ses mains. Je trouve cette belle phrase dans un discours inconnu d’un galant homme inconnu, membre du Long Parlement dans la révolution d’Angleterre. Il s’appelait Sir Henry Rudyard.
Nos journaux évaluent aujourd’hui vos forces en Crimée, l’armée de rase campagne, à 35 000 hommes seulement ! Si vous cachez bien là votre jeu, vous avez raison ; mais si loin de le cacher vous n'exagérez, comme vous avez fait ailleurs, c’est de là bien mauvaise politique aujourd’hui. Dans l'état actuel des sociétés et des affaires, les grands gouvernements ont plus d’intérêt à être crus en général qu’ils n'en peuvent avoir à mentir tel jour en particulier.
Les arrivants de Paris, y compris Montebello parlent très mal du nouvel arrangement de la place Louis XV. Précisément devant vos fenêtres, au-dessous, et tout le long des deux terrasses des Tuileries, on a fait un passage des voitures, une rue. On dit que C’est très laid. Heureusement, cela ne vous en dégoûtera pas. J’ai beau faire, j’ai beau être triste ; je ne puis pas croire sérieusement que vous serez bien longtemps sans revenir là. Et pourtant toutes les perspectives sont bien mauvaises. Aucun moraliste, ni Montaigne, ni Pascal lui-même n’a assez dit tout ce qu’il y a de contradictions dans notre cœur ; tantôt nous nous précipitons follement dans nos craintes ; tantôt nous les repoussons absolument. Faibles âmes et pauvre sort.
Midi
Voilà le N°134. Vous avez tort de croire qu’on est très craintif, en France sur le résultat de l'expédition de Crimée. On s'en préoccupe ; mais en général, on croit au succès. C'est aussi mon instinct. En grande partie parce que je ne crois guères, ni à ce que vous dites, ni à ce que vous faites. Nous aurons un de ces jours des nouvelles du débarquement. Adieu, Adieu. G.
163. Val Richer, Mardi 19 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
164. Bruxelles, Vendredi 17 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
3 h.
Si vous saviez combien j’ai été occupée ce matin et de quoi vous ne vous fâcheriez pas de ne recevoir de moi qu’un mot aujourd’hui. J’ai eu une bien bonne lettre de Morny ce matin à laquelle il a fallu que je réponde. Je suis malade. aussi. Je crache le sang depuis huit jours. J’espère que ce ne sera pas serein mais j’ai bien besoin d'Andral.
Greville m'écrit. Doyon believe the Emperor is ready to treat on the basis of the 4 points ? The french say that is not non enough. I think it would satisfy us, if we dare be satisfied.
On me dit de toutes parts que mon empereur accepte les 4 points comme base, je ne sais si c’est vrai, je suis assez portée à le croire. Nos renforts sont considérables. Vous serez obstinés, nous aussi. Ah mon dieu quand cela finira-t-il ? Adieu je n’en puis plus il me faut du repos. Adieu.
Je crois que je ne vous adresserai plus de lettre qu’à Paris. Adieu.
164. Paris, Lundi 15 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Trois heures de causerie avec Matonchewitz, et puis une promenade bien froide en calèche avec mon fils, ensuite le Prince Paul de W. et au moment de ma toilette Lady Granville Voilà ma matinée hier. J’ai dîné chez le duc de Palmella, où je me suis ennuyée ; je suis rentrée chez moi au sortir de table ; j’ai eu beaucoup de monde que j’ai chassé à onze heures. Ma journée a été remplie c'est à dire dissipée. Cependant les visites de Motonchewitz comptent. J'aimerais bien le garder ici, & il en a une grande envie, mais au bout du compte, il en sera encore plus profitable à Pétersbourg. Il part jeudi. Lady Clauricarde va demeurer dans ma maison, dans ce Palais si beau, si horrible pour moi. J’ai été saisie hier quand on me l’a annoncé.
Pozzo a une ample permission de venir à Paris et d’y rester jus qu’au mois de février. Il en est enchanté et moi aussi. Tcham est tout ahuri de ce que l’affaire suisse n’est pas finie tant que Louis Bonaparte y reste vous continuez votre attitude guerrière. Il a déposé cependant entre les mains du Gouvernement de Thurgovie une déclaration dans laquelle il se dit français. Mais ces gens sont un peu à sa dévotion, et ils ne donnent pas de publicité à cette déclaration.
Je vous remercie de me parler de nos habitudes d’hiver. J'y pense bien moi. J’arrange aussi, quel plaisir que tout cela ! J’ai fait la paix entre la Duchesse de Talleyrand et Lord Holland. Elle était désirée des deux partis. Ils se verront aujourd’hui. Je voudrais bien parvenir à montrer Berryer aux Holland, mais il n’est pas ici ; et ils partent le 25, encore une fois quel dommage que vous ne les voyez pas ! Ils en sont très contrariés. Ne me trouvez-vous pas bien égoïste dans ce que je vous dis sur Matonchewitz ? Un grand défaut est de ne jamais prendre le temps et la peine d’expliquer ma pensée. Ainsi ce que je vous dis à son égard qui me regarde, le regarde lui bien davantage encore. Il faut qu'il parte, car sa carrière est finie, s'il reste à Paris. Pour mon plaisir, pour le profit de ma curiosité, il me serait bien agréable ici. Il sait tout. Il est au courant de tout. Il est discret, prudent; sûr. C’est bien rare.
Voilà un temps doux & mou. Le même degré hier au thermomètre, et une sensation charmante au lieu de la plus désagréable. Madame de Castelane m'accable d’attention et de cadeaux. Il faut que je rende, les cadeaux s'entend. Je viens de m'arranger pour cela avec Fossin. Vous doutiez-vous en me faisant l’éloge de Lord Halland dans votre dernière lettre que vous faisiez un peu, non pas un peu, tout-à-fait ma critique ? Je vous en remercie, cela me fait toujours du bien, quoique je ne réponds pas que je me change. Je suis bien vieille pour changer. Il y a vingt ans de cela que je devais faire votre connaissance, comme je serais autre, comme je vaudrais mieux !
Adieu. Adieu. J'écris toujours à mon mari, mais vous verrez qu'il va reprendre son silence. Celui de mon frère me surprend. Adieu de tout mon cœur.
Mots-clés : Autoportrait, Politique (France), Vie familiale (Dorothée)
164. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis fâché que la duchesse de Sutherland soit engraissée. C’était déjà beaucoup. Quand elle ne sera plus du tout jeune ce sera beaucoup trop. Je m’intéresse à la durée de ce qui m’a plu un moment. Comptent-ils passer tout l’hiver en Italie ? Comment la Reine s’arrange-t-elle de cela ? Il me paraît qu’elle tient fort à garder ce qui lui plait, s’il est vrai qu’elle ait écrit au Roi de Naples pour garder Lablache. Cette jeune fille m’inspire assez de curiosité. Il me semble que personne ne la connait et ne dit ce qu’elle est. Y aura-t-il vraiment quelque chose en elle, ou sera-ce tout bonnement une reine amie sensée, facile, et uniquement occupée de s’amuser convenablement ? Ceci serait peut-être le meilleur pour l’Angleterre ; elle est, je crois dans l’une de ces crises, où ce qu’il y a de mieux pour le pays, c’est un gouvernement qui s’accommode au temps, en y faisant peu et lui demandant encore moins. Un pouvoir fier et exigeant, pour lui-même comme pour les autres, compromettrait là bien des choses. Vous avez raison sur l’Orient. C’était de ma part une pure fantaisie. Ce qui vaut le mieux à présent, c’est que la question en reste où elle est. Personne n’est prêt à lui donner la solution qui convient. L’Empereur à Potsdam était probablement désolé de ce que sa fille trouvait le Prince royal de Bavière, trop laid.
Est-ce Postdam ou Potsdam ? Vous écrivez Potsdam, et moi aussi. J’ai des cartes qui sont de notre avis ; mais la plupart disent Postdam, et il me semble que l’étymologie le voudrait. Décidez. Avez-vous jamais aimé la géographie ? Thiers prétend qu’il n’y a pas de grand homme qui n’ait aimé la géographie. Je l’ai fort bien sue, parce que je n’ai jamais lu une histoire, sans avoir les cartes sous les yeux, et sans suivre pas à pas les événements. Mais la géographie, pour elle- même me touche peu. L’Astronomie encore moins. Je n’ai jamais pu distinguer une étoile d’une autre. Ni le ciel, ni la terre ; c’est dédaigner beaucoup. Au fait, s’il n’y avait pas d’hommes dessus, et dessous, je prendrais du Ciel et à la terre peu d’intérêt.
Entendez-vous parler d’une jeune artiste, Mlle Rachel, qui a, dit-on de grands succès au théâtre français et ramène la foule à Racine et à Corneille ? Si elle fait cela, je lui veux beaucoup de bien, et c’est ce qui fait que je vous en parle. J’admire et j’aime extrêmement la vieille, la vraie littérature française. Et vous lui devez les mêmes sentiments. C’est votre nature qui le fait. Vous voyez que je vous traite là, comme je traiterais Lord Holland.
10 heures
J’avais un vrai remords, avant-hier de ma lettre si courte. J’aurais voulu la charger de toute autre chose, que de paroles. Il y a peu de variété dans ma manière de penser à vous. mais beaucoup de continuité. Je n’ai rien à apprendre sur votre frère et votre mari. Ils seront ce qu’ils sont. Quelque accoutumé que je sois aux incohérences, et aux contradictions de la nature humaine, pourtant il y a telle occasion, et dans cette occasion telle action, telle parole où l’homme se révèle tout entier, et d’après laquelle on peut hardiment le juger, et le prédire. J’ai vu votre mari et votre frère à cette épreuve-là. Adieu. Je vais donner quelques ordres pour des caisses qui doivent partir la semaine prochaine pour Paris. Adieu Bien, adieu. G.
164. Val Richer, Mercredi 20 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
165. Bruxelles, Dimanche 19 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Dans mes deux dernières lettres je voulais vous parler de Verny et vous demander si la situation où il a laissé sa famille, me permettait de lui offrir un secours. Voici votre lettre qui me devance. Je veux donner 500 Francs et puisque vous jugez qu'il est convenable que je m’associe à la souscription, c’est dans cette forme que je ferai parvenir mon offrande. Faut-il que j'écrive à M. François Delessert ne lui en voyant mon chek sur Rothschild ? Dites-moi son adresse. Ou bien voulez vous tout simplement inscrire mon nom pour cette somme ? et c'est à vous que j’enverrais la traite.
Je suis toujours malade et je crache le sang. Ah qu'il est temps de me tirer d'ici ! Je ne sors plus du tout, on me défend même la voiture. J’attendais quelque chose. aujourd’hui, une bonne chose. Cela n’est pas encore venue. C'est de moi que je parle. Crept. attend aussi, et il s’étonne fort de ne rien savoir de Sébastopol depuis le 8. Je trouve cela mauvais signe pour nous. Quant à vous, vous vous êtes arrangé de telle sorte que vous êtes toujours en retard des nouvelles. C'est une chose extraordinaire ! J’ai eu le plaisir de voir arriver Verner de Mérade ; il reste ici pour le moment. Montalembert viendra plus tard, je voudrais que ce fut trop tard. Adieu. Adieu.
165. Paris, Mardi 16 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a longtemps que je ne vous ai écrit de si bonne heure. Ma nuit a été. mauvaise. Le 16 octobre est une date qui me rappelle tant de bonheurs passés ! Ne me répondez pas à ceci ; ne m'en parlez pas. Je ne sais pas encore, je ne saurai jamais peut être parler de ces choses-là. Elles me sont trop avant dans le cœur. J'ai vu chez moi hier matin un petit ministre étranger à Londres. Je le traitais un peu comme une petite espèce lorsque j’y étais, et j’ai éte touchée de voir le bon souvenir qu'il conserve de ce temps. Cette diplomatie ne se console pas encore de nous avoir perdus. votre lettre m'arrive dans cet instant. C’est à peu près comme aux Champs- Elysées, peut-être un quart d’heure de différence, c.a.d. de ceci plutôt.
J’ai passé ma soirée chez Lady Granville avec les Sutherland. J’ai été fort émue en les revoyant. Le temps que j’ai passé chez eux il y a un an, un été si rempli de sensations douces & pénibles. La Duchesse est engraissée c’est trop. Le mari est comme il était. Je l'aime bien. Ils ne restent ici que trois jours. Les nouvelles de Madrid parlent d'une grande fermentation dans cette ville. On s’attend à un mouvement. Frias est brave & décidé à rester ministre. Il me semble que cette résolution aide assez à le demande. On est inquiet de Villers. Il pourrait bien tomber, entre les mains de Cabrera.
Vous avez des enfants charmants, vous êtes bien heureux, & vous le méritez. Je vous écris fort à bâtons rompus. Mon fils est dans ma chambre. La Duchesse de Sutherland m’a de suite demandé de vos nouvelles. Elle est fâchée de ne pas vous trouver ici. Je relis toutes vos lettres depuis le commencement. Il y en a quelques unes que je montre à Matonchewitz. Il en est extrêmement digne. Je m'occupe de vous beaucoup, à peu près toujours. Le temps approche, c'est de la joie pour mon triste cœur, car il est bien triste ! Adieu. Adieu.
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
165. Val Richer, Samedi 23 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je comptais aller vous voir à mon retour à Paris, du 15 au 20 novembre, j’irai plus tôt ; mais je ne puis y aller que dans trois semaines du 12 au 15 octobre. J’ai invité ici quelques personnes du 25 sept au 2 octobre, et du 3 au 12. Je ne puis pas ne pas les recevoir. Je vous sacrifierai, comme vous dites le Duc de Broglie, chez qui je devais aller dans la dernière quinzaine d'Octobre. J’aurais bien envie de vous gronder pour votre appel au Duc de Broglie, et au jardinier, mais vous êtes trop loin et trop triste. Je vous gronderai de près. Je cherche à deviner quelles bombes peuvent vous atteindre ; je m'en figure deux ou trois une surtout qui me paraît inadmissible. Nous verrons. Soignez votre santé. Je puis espérer de vous donner un bon conseil, et un peu de courage ; mais hélas, votre santé passe mon pouvoir.
Voilà le débarquement accompli, sans résistance, et l’armée alliée en marche sur Sébastopol. Le prince Mentchikoff a probablement concentré là toutes ses forces n'en ayant pas assez pour lutter sur plusieurs points. Probablement aussi, la lutte sera acharnée sur ce point-là. Peut-être aussi sur la route, car il y a bien cinq ou six jours de marche d’Eupatoria à Sébastopol, et je présume que vous n'avez pas laissé les routes, s'il y en a en bon état. Que de destructions ! Il semble qu’on attaque à la fois, Sébastopol, Odessa et Anapa. Si le Prince Mentchikoff ne se fait pas tuer, il a tort.
Je ne puis vous parler que de Sébastopol ou de vous-même. Et sur les deux, il faut attendre. J’aurai mes lettres de bonne heure le matin.
10 heures.
Les journaux ne m’apportent que la confirmation officielle de la nouvelle d’hier. Nous ne saurons rien, je présume, d’ici à huit jours. Adieu. G. Adieu.
J'étais déjà bien impatient d'aller vous voir dans deux mois. Je le suis bien plus à présent. Adieu. G.
166. Bruxelles, Lundi 20 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Puisque vous voilà si près il faut que je vous écrive encore aujourd’hui, quoique je n'ai rien à vous dire. S'il faut ne croire les journaux 3 généraux anglais auraient péri dans le combat du 5 outre les cinq blessés. 8 généraux c'est beaucoup, c’est énorme. Nous avons ici des nouvelles de Sébastopol du 12. Menchikoff dit qu’il ne s'était rien passé depuis le 5. Les Anglais se fortifient à Balaklava. Les travaux de siège n’avancent pas. Les dommages causés par le bombardement sont réparés chaque nuit. Voilà rien de plus.
Ces pauvres anglais qui couchent encore en plein air, et il neige ! Ils me font une pitié profonde. Je suis bien attristée de cette guerre pour tout le monde. Je suis chrétienne et je ne m’inquiète pas de ma nationalité. Pierre l’hermite s'en allait prêchant la guerre, pourquoi n'y a-t-il pas une peine l’hermite qui aille prêcher la paix ?
Ma vilaine toux continue, et ma réclusion aussi. Quand est-ce que la porte de ma prison sera ouverte ? Ne parlez de moi à personne. S'il en est besoin je vous donnerai avoir d'une promenade aux Champs Elysées. Jusque là laissez couler l’eau. Adieu. Adieu. Mon ami de Schlangenbad est excellent pour moi.
166. Paris, Mercredi 17 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez bien raison, et je suis très fatiguée, et je suis très maigrie, c’est trop pour moi, et je ne me résigne parce que cela va cesser. J’ai passé presque ma journée entière hier avec les Sutherland ; aujourd’hui encore. Après demain ils partent. Je vois même très peu mon fils, heureusement il reste quelque jours de plus. Le Roi de Hanovre me mande que l’Empereur était très triste et a battu à Postdam, on ne sait de quoi. Du reste, il est en santé parfaite.
Je ne m’accorde pas du tout avec vous sur l’Orient. Je ne vois pas à quelle bonne fin, nous perdrions l'Angleterre dans nos conseils sur cette question. Ce n’est pas avec elle qu’elle s’arrangera jamais, ce sera contre elle. Il y a d'autres puissances qui feraient meilleur ménage avec nous sur ce point & vous les connaissez. Mais en attendant que cette affaire arrive au point où il faudra la résoudre. Il est bon qu’elle reste comme elle est. Miraflores vient d'être nommé ambassadeur ici, ce qui le comble de joie. Il n'y avait rien de nouveau hier de Madrid.
Vous savez qu’on a reçu hier la nouvelle que Louis Bonaparte est parti le 14 & qu'il sera le 19 à Londres. C’est donc vraiment fini. Lord Granville a vu le Duc de Broglie hier. Il l’a trouvé extrêmement abattu & changé. Il lui a dit qu'il ne songeait pas à aller à Broglie. Il ne quittera pas Paris. J'ai dîné hier chez Lady Granville ; rien qu'Angleterre, 20 anglais. Je n’ai pas fermé l’œil cette nuit. C'est déplorable. Lady Jersey me mande qu'elle a vu mon mari à Munich, à Innsbruck, et que le grand Duc a parfaitement bonne mine. Adieu, je vous écris en me levant dans la crainte que plus tard je ne trouverai plus un moment. Voyez aussi comme je griffonne. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Deuil, Politique (France), Politique (Internationale)
166. Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.
166. Val Richer, Dimanche 24 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si Sébastopol est pris et détruit les puissances occidentales demanderont de nouveau et catégoriquement à l’Autriche de prendre parti. Parviendra-t-elle à tenir son attitude de médiateur armé jusqu'au jour où sa médiation amènera la paix ? Cela se peut si la paix est prochaine. Ce sera impossible si la guerre se prolonge. Il y a, dans l'avenir un point bien noir. Je plains l’Autriche si on marche jusqu'à ce point-là. Elle aura à choisir entre l’Alliance occidentale et la guerre révolutionnaire. L'article du Times d’hier est bien dur et menaçant.
Je remarque aussi un article du Morning Chronicle qui annonce pour le printemps prochain, si la paix ne se fait pas dans l’hiver, une expédition de débarquement dans la Baltique aussi formidable que celle qui agit maintenant dans la Mer Noire. Votre Empereur n'a évidemment pas cru, et ne croit probablement pas encore à l'étendue des moyens d'action qu’on peut déployer contre lui. Parmi les éléments de force, vous êtes trop accoutumés à ne penser qu'au nombre ; il y en a deux autres, très puissants aujourd’hui, et qui vous manquent. L'argent et la rapidité. Vous êtes moins riches, et vous n'avez, pour vous mouvoir, ni la vapeur sur mer, ni les chemins de fer sur terre. Ces deux forces là vous enlèvent, en grande partie le bénéfice du temps qui naturellement serait pour vous.
Que de choses à nous dire bientôt. Le champ des commentaires et des réflexions est infini. Que peut-on en mettre sur une petite feuille de papier.
Il m’arrive un déluge de lettres pour la place vacante à l'Académie française. Je suis au treizième candidat. Je ne crois pas que vous en connaissiez un seul, excepté, M. de Marcellus qui n’est pas sans quelque chance. Je ne crois, pourtant pas que ce soit lui. M. et Mad. Lenormant, qui doivent venir passer quelque jours ici le 5 octobre appuient vivement M. Legouvé. Ils ont quelque influence dans l'Institut. Je n'ai d’engagement avec personne et je garderai ma liberté jusqu'au dernier moment. L'élection ne se fera pas avant le mois de décembre.
Onze heures
Certainement vous avez tort de douter. Vous serez tranquille demain. J'y pense avec joie. Encore bien plus au milieu d'Octobre. Adieu, Adieu. G.
Pas malade, je ne me préoccupe que de cela. Adieu. G.
Mots-clés : Académie (candidature), Académie (élections), Académie française, Chemin de fer, Conversation, Femme (santé), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Marine, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Autriche), Politique (Russie), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau académique, Santé (Dorothée)
167. Bruxelles, Mercredi 22 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
La poste n’est pas venue. La neige empêche l’arrivage du train. Quelle fatalité ! Tous les jours j’attends ma délivrance, elle tarde quoique j’ai la promesse. Allez-voir Morny, quoique j’ai promis de ne pas parler de mon affaire, il est bien naturel que je vous l'ai dite. Il pourra vous dire où elle en est. Malgré les très mauvais auspices il ne m’est plus possible d’attendre. Je suis trop malade, plus tard je ne pourrais plus peut être, & vous voyez bien que Sébastopol est l’éternité. Je ne puis pas croire à des soupçons efficaces s'il y en avait à Londres ; l’Empereur est le maître et il est excellent pour moi. Je place toute ma confiance dans Morny. Parlez et redites-moi. Je me suis très malade et quel temps, & quels courants d'air chez moi !
J'ai été frappé de l’article de St Marc Girardin sur la Pologne. Il est bien fait. Quant au subside anglais je n’y ai pas cru un instant. Vous êtes plus fier que cela. " et la France est assez riche pour payer sa gloire. " Quelle lutte, quel carnage et quel courage. Les géants se sont atteints et comme ils se battent.
1 heure
Je vous prie allez chez Morny. Je le préviens de votre visite et je le prie de vous mettre au courant afin que vous puissiez me redire. Je suis pressée de savoir, & lui est peut-être ou malade ou trop occupé. L’Empereur est parfait pour moi, mais il peut craindre les soupçons anglais ; c’est ce qui fait le retard, demandez, apprenez et redites-moi sans perdre un moment. Je vous prie allez chez Morny tout de suite. Adieu. Adieu. Laissez là votre académie, je vous assure que je suis plus précise qu'elle.
167. Paris, Jeudi 18 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
C’est un bien petit mot que celui que vous m’avez écrit hier ; j'espère mieux pour demain, mais je vous remercie de tout ce que vous me dites. Matonchewitz part aujourd’hui. Je n'ai jamais tant causé avec lui de ma vie que dans ces huit jours, et suis bien contente de lui. J’aurai beau coup de choses à vous dire qui ne s’écrivent pas. Les Sutherland sont venus passer la soirée chez moi hier. Je n'ai reçu à leur donner pour les divertir ; il n’y a vraiment personne à Paris. Quel hasard que Humboldt. Mon ambassadeur se calme, il croit avoir trouvé l'hotel Beauny sur la place Vendôme mais il faut deux millions et il vient de les demander à l'Empereur.
Le discours d'ouverture des états à La Haye annonce comme je crois vous l’avoir dit que la Roi a fait une démocratie conciliante au mois de mars, et que jusqu’ici il n'y a pas obtenu réponse. Il espère cependant arriver à un arrangement définitif et honorable pour la Hollande au sujet des provinces insurgées. On dit maintenant que tout sera terminée cette semaine à Londres & dans une séance de la conférence. Léopold était hier dans le salon du roi, mon ambassadeur et lui ont beaucoup parlé batailles. C’est l’anniversaire de Leipzig, gigantesque combat.
Hier il a plu tout le jour, je n’ai pas pu marcher, aujourd’hui il me faut absolument trouver le moyen de faire de l'exercice. Mes nerfs vont mal. Voilà Matonchewitz qui m’a tenue deux grande heures, & dont je viens de me séparer avec un vrai chagrin. Alava sort d'ici aussi. L'arrivée en Espagne de la Princesse de Keira, aujourd’hui reine, car elle épouse Don Carlos est un grand événement. Votre police est complaisante.
Adieu. Adieu. Je suis plus nervous que jamais, plus triste que jamais. D’après tout ce qui s’est dit entre Matonchewitz et moi, je vois que mon avenir sera affreux, & que je ne puis compter sur rien et sur personne. Quel pays, quelles gens ! Il n’y a rien de plus, rien de nouveau, seulement qu'en y regardant de bien près, nous avons trouvé que mon mari et mon frère ne sont autre chose que des courtisans, & qu’ils le resteront. Adieu. Adieu.
167. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que si vous étiez bien parfaitement sûre que le mal de votre situation vient de gens incurables en effet, bien vraiment incurables cela ne vous calmerait pas au lieu de vous agiter ? Excepté les peines de cœur auxquelles la nécessité, l’inévitabilité n’est pas du tout un remède, je ne connais rien d’aussi calmant que la certitude qu’il n’en peut être autrement. Il me semble que j’ai une infinité de choses, et de très bonnes choses à vous dire sur cela. Mais je ne les dirai pas de loin. Rien n’est bon de loin. Bientôt nous serons près. En attendant, je pense sans cesse à vous. Telle vous voyez Mad. de Talleyrand, telle elle a été toujours. Seulement, quand elle avait M. de Talleyrand derrière elle, cela paraissait moins. Elle ne prendra pas l’aplomb qu’elle cherche. Elle a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir qu’il lui manque, et pas assez de hauteur, de de suite dans le caractère pour l’acquérir. Rien n’est pire que de connaitre en vain son mal. Quand on n’en peut guérir, il faut l’ignorer.
Je vous ai demandé une fois, si vous preniez quelque intérêt aux Etats-Unis, à quoi vous n’avez pas répondu. Il faut bien que j’y prenne intérêt puisque je m’en occupe. Mais Washington à part, il m’est arrivé, les jours derniers de Boston une nouvelle et grande quarterly review qui ma fort étonné, tant j’y ai trouvé d’esprit, de bon et presque de grand esprit quoique un peu enthusiantic and unexperienced. C’est très supérieur à tout ce que j’avais vu de là. L’auteur est un M. Greene, jusqu’ici inconnu, pour moi du moins. Je prends un vrai plaisir à découvrir dans le monde un homme de plus. un homme, c’est un monde.
On m’écrit qu’une affaire à laquelle vous n’avez certainement jamais pensé devient pour le Cabinet un assez gros embarras, l’affaire des sucres. Vous ne savez peut-être pas qu’il y a deux sucres, deux sucres en guerre, le sucre de canne et le sucre de betterave. Ils veulent absolument. ou qu’on leur sacrifie leur rival ou qu’on les mette d’accord. Malgré, son talent de conciliation, M. Molé n’en peut venir à bout. Il y a là quelque chose de plus à faire que de donner des paroles à droite et à gauche. Les intérêts sont en présence, très positifs et très animés. Ils exigent qu’on ait un avis, une volonté. M. Duchâtel m’écrit qu’on a trouvé cette exigence par trop forte, et qu’on n’aura, ni volonté, ni avis. Je vous mande tout ce qu’on me mande. A propos de M. Duchâtel, sa femme vient d’accoucher d’un garçon. Il est bien content.
Vous ne vous doutez pas du petit plaisir que j’ai à regarder ce matin par ma fenêtre. Il fait beau, s’il n’avait pas fait beau, j’aurais eu sur les bras, pendant quatre ou cinq heures, entre les quatre murs de mon salon, les vingt hôtes que j’attends de Lisieux à déjeuner. Grace au soleil, je pourrai les mettre dehors, je veux dire les promener.
10 heures
Je ne reçois pas une ligne de vous, je ne pense pas une fois à vous sans que mon désir de me retrouver auprès de vous redouble. Enfin, j’approche. Je vous aime bien tendrement. Je ne puis pas pour vous ce que je voudrais ce que je pourrais pas la millième partie, mais enfin, de près, je puis quelque chose, je fais quelque chose. Votre tristesse me pèse bien plus quand je ne la vois pas. Je serai triste avec vous. Je serai gai pour que vous ne soyez pas triste. Je veux vous faire un peu de bien. Je vous aime trop pour ne pas vous faire du bien. Adieu. Adieu. G.
168. Bruxelles, Jeudi 23 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Une longue lettre de Greville. En détestation croissante de la guerre. Il vient d'y perdre un neveu chéri. L’Autriche sait notre disposition à traiter sur la base des 4 points. Bual ne veut attacher aucune valeur à cela. Palmerston est allé à Paris pour y faire adopter toutes ses vues et idées politiques. Voilà la lettre de Greville. Mon neveu me mande de Berlin que nous avons actually accepté les 4 points par défiance pour la Prusse. Que veut-on de plus ? Je viens d'écrire à M. Delessert des nouvelles de votre causerie. et de lui envoyer mon chek avec Morny. Adieu.
Je reste prisonnière. Je n'ose pas sortir. Je recrache le sang aujourd’hui, j’avais eu deux jours de relâche. Le 15. Les travaux du siège n'avaient pas avancé. Le bombardement. continue. Le 14, huit bâtiments de transports ennemis ont été jetés sur la côte. Une frégate. & une corvette ont coulé bas. Voilà notre bulletin ce matin Je trouve bien charmant de pouvoir tous les jours avoir de mes nouvelles respectives. Il y aurait quelque chose de plus charmant encore.
Adieu. Adieu, pour aujourd’hui. J’attendrai avec impatience.
168. Paris, Vendredi 19 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une bien mauvaise journée hier. J’avais les nerfs tout à fait dérangés. Je me suis promenée assez longtemps au Bois de Boulogne avec mon fils ; le temps était passable. Avant le dîner, j’ai eu une longue visite de Montrond. J’ai dîné seule avec Marie, Alexandre dînait chez M. de Pahlen. Le soir, mon fils est allé au spectacle, Marie à l’Ambassade d'Angleterre, et moi dans mon lit. J'ai un peu dormi, & je me sens moins malade aujourd’hui.
Montrond est assez questionneur, assez causant, et assez en bonne humeur. Il a certainement beaucoup d'esprit. Il dit que Thiers est en bonne disposition. Il espère que vous l’êtes. Il ne dénigre personne, mais il exalte le roi. La Duchesse de Talleyrand a vu le Roi hier elle est bien traitée là. Elle essaye d’être bien un peu partout. M. Salvandy va beaucoup chez elle. Ma grande Duchesse Marie épouse vraiment le Lenchtemberg, les Russes jettent les haute cris avec raison, c'est égal, il sera notre gendre. On lui prépare un beau palais à Petersbourg, il doit y arriver dans huit jours. Nous aurons l'honneur d’être cousin de Louis Bonaparte. Il entre au service de Russie, (le gendre par Louis Bonaparte).
Le comte Woronzoff s’est démis de son gouvernement de la mer noire. Il était trop populaire. On a fait sa femme ce que je suis; ou espère par là calmer son mécontentement. Je suis ravie des dîner d'Adieux. Les Adieux de Normandie ne sont pas comme les nôtres.
On s'occupe beaucoup de l’Espagne. Je ne crois pas du tout que le dénoue ment soit prochain mais je crois sûrement au triomphe définitif de Don Carlos. Selon les propos de Montrond je croirais qu'on n’est pas tout-à-fait content du duc d’Orléans, ne savez-vous quelque chose. A propos, la cour désirerait le retour des Flahaut. On trouve qu’il n’y a plus un salon à Paris, & c’est vrai. M. de Talleyrand, Madame de Broglie, Madame de Flahaut de moins, c’est beaucoup. Quelle pauvre ville que votre grande ville, quand on en est réduit à avoir besoin de Marguerite. Adieu. Adieux.
Mots-clés : Politique (France), Politique (Internationale)
168. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève tard. J’ai mal dormi ; pour moi du moins ; pour vous, ce serait probablement une bonne nuit. Vos nuits dépendent de vos jours ; votre santé de votre âme. J’y pense continuellement. Il y a de l’irrémédiable. du moins pour nous ; nous n’y pouvons rien actuellement directement. Les circonstances peuvent amener, là où se décide ce qui vous touche, des raisons de changement qui amèneraient à leur tour le changement. Nous ne les prévoyons pas aujourd’hui ; mais elles peuvent venir. Je le crois unforgiving, implacable, mais non contre son propre intérêt, son moindre intérêt bien clair. Mais il n’y faut pas compter, j’en conviens ; il faut s’arranger comme si cela ne se pouvait pas. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c’est de combien d’affection et de soin j’entourerai, votre solitaire établissement. Je sais tout ce qui vous manque tout ce qui manque à votre cœur, à votre journée. Je sais ce qui m’empêche souvent moi-même de faire tout ce que je voudrais. Mais je veux tant que je ferai beaucoup beaucoup. Je me sens inépuisable pour vous. En fait de monde chez vous, hors de chez vous, en fait de passe-temps vous en aurez à peu près tant que vous voudrez. Votre salon est formé, à présent ; les habitudes sont prises ; la conversation, le petit mouvement social qui vous plaisent ne vous manqueront pas. Voilà pour la surface, au fond dearest, nous comblerons ensemble les vides, nous soignerons ensembles les plaies. Je vous aime tendrement. Le temps, l’absence, la connaissance plus complète de votre caractère, de votre esprit de vous toute entière, tout cela fait que je vous aime toujours autant, plutôt davantage. Vous savez que mes paroles n’exagèrent jamais mes sentiments. Vous savez que je suis doux à vivre. Je le serai pour vous, avec vous, plus que vous ne savez. Il y a bien du vide, bien de l’amertume dans votre situation ; j’y mettrai beaucoup de baume, beaucoup de tendresse. Vous vous souvenez de mon défi, dans nos premiers temps. Vous me direz un jour, si j’avais raison.
J’ai gardé hier mes hôtes jusqu’à cinq heures. Aujourd’hui, je vais dîner à Lisieux, demain aussi. Je mets les morceaux en quatre. Le retour de Lord Durham sera un avènement à Londres. Je ne sais qu’elle position il s’y refera ; mais je comprends que celle de Québec ne lui convienne pas. Revient-il cependant sans attendre son successeur, sans donner à son gouvernement le temps de pourvoir aux affaires du Canada ? Ce serait une boutade d’enfant gâté. Il y est sujet. Les Granville en sont-ils inquiets ? Je crois assez à leur jugement sur la situation, et les chances de leur cabinet. Ils sont éclairés, par une passion, leur désir de rester à Paris. Je la partage pour eux, quoique, non à cause d’eux.
10 heures
Je suis fâché que votre fils vous quitte avant que j’arrive. J’avais espéré qu’il vous resterait encore quelques jours ! Je suis charmé que vous en soyez contente. Ses qualités qu’il a valent mieux plus on en jouit. Je reçois une lettre de M. de Broglie qui me dit qu’en effet il ne vient pas à Broglie. Cela me met à l’aise. Je craignais toujours qu’il ne vint au moment où je veux partir. Il est bien triste, mais il reprend ses occupations intérieures. Il est très content de son fils. Adieu. Je serais en effet très bien aux Tuileries. J’y serai. Adieu. Adieu. Bien tendrement adieu. G.
168. Val Richer, Mercredi 27 septembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me promets aujourd’hui, une lettre de vous un peu moins agitée. Nous causerons de tous vos troubles. Depuis que je sais que Mad. Kalergis vient passer l’hiver à Paris, la situation me semble plus simple.
Je doute que vos renseignements sur l’Autriche soient bien exacts, sur la disposition du public, je veux dire. Si Bual et Bach étaient seuls contre vous, ils ne seraient pas de force à dominer tout le monde, Empereur et pays. Je vous crois un grand parti à la cour, dans la noblesse, dans l’armée, mais hors de là vous avez peu d’amis et même là, tous ne sont pas vos amis. Témoin feu Schwartzenberg. Il n'était certainement pas le seul de sa tonte dans sa classe. Et puis vous avez contre vous le danger qu’il y aurait à être avec vous. Le mauvais vouloir de l'Empereur Napoléon ferait aujourd’hui à l’Autriche plus de mal que le vôtre. Je persiste à croire qu’on fera tout ce qu’on pourra pour ne pas vous faire la guerre et que probablement, on n'y réussira ; mais si la guerre se prolonge, les dernières extrémités viendront, et alors je ne réponds de rien. Il me paraît impossible que nous n'apprenions pas bientôt ce qui s’est passé à Sébastopol. Puisque l’armée a débarqué à sept lieues, seulement et s'est mise aussitôt en marche, le siège doit avoir commencé du 18 au 20. Y aura-t-il autre chose qu’un siège ? Se battra-t-on en rase campagne tout cela est bien obscur et bien étrange. Je m'étonne de plus en plus que pas un de vos grands Ducs ne soit là, ni nulle part. On a joué un mauvais tour au grand Duc Constantin en annonçant, qu’il était parti. Notre public n’y pensait guère, à présent tout le monde parle de cette immobilité de la famille impériale.
Vous avez raison de dire qu’il faut regarder du côté des Etats-Unis. Je vois qu’ils viennent de se faire céder, par un traité avec le Roi Tamahéma (je ne sais quel chiffre), les îles Sandwich. C'est un petit commencement, mais un commencement. Leur ministre à Madrid, M. Soulé, était et est encore, quoique absent, dans les menées révolutionnaires les plus extrêmes. Il a été vraiment obligé de partir. Même Espartero ne pouvait plus le tolérer.
Onze heures
Pas de lettre. Cela m'étonne un peu. Vous devez avoir reçu avant hier ma lettre qui vous disait que j'irais vous voir du 12 au 15 octobre.
À demain donc. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Autriche), Politique (Etats-Unis), Politique (Russie), Salon
169. Bruxelles, Vendredi 24 novembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre est triste. Elle m’a rendue bien triste. Triste à pleurer je sais que je suis en bonnes mains. Vous, M. et plus haut aussi. Mais il parait que c'est peu de chose.
L’intimité serait donc bien frêle, si mon souffle pouvait l'endommager, mais c’est vraiment ridicule d’admettre ce motif, reste le mauvais caractère. Or, du côté puissant le cœur est bon et la disposition bonne. Je veux espérer, et cependant je pleure.
Je ne sais pas vous parler d’autre chose. Et cependant les quatre points acceptés par nous. Parlez de moi et de toute l’affaire à personne.
Les renseignements sur l’effet de notre réponse sont très variés. Vous saurez sans doute comment cela est pris à Paris, à juger sur le Times, on ne veut pas tenir compte à Londres de notre acceptation des quatre points. Alors je ne sais pas ce qu’on veut, sinon une guerre éternelle.
Persister à dire qu'on ne veut pas croire à la sincérité de l’Empereur Nicolas, c’est établir qu'on ne fera jamais la paix avec lui. Lui, veut la paix, je vous en réponds. On dit que notre Ministre à Vienne. dit : nous sommes las de faire la guerre pour des ingrats. (la race grecque).
Je vous ai dit que je vois Lord Howard souvent très intimement. Du reste van Praet & Brokhausen. Creptovitch est à la chasse. Sa femme à Stuttgart. Dites-moi toujours qui vous voyez et ce que vous faites de vos journées. Je suis inquiète de la soirée. Vous avez eu Broglie, mais vous ne l'avez plus.
Ma toux allait mieux hier mais les mauvaises nouvelles sur mon compte m'ont donné une attaque de bile. Vous savez comme tout agit sur moi. Il y a deux ans j’étais du du passeport de mon fils ! même cause même mal Adieu. Adieu.
Apprenez c’est pure curiosité de ma part, s'il est vrai qu'on paye le Moniteur juste le double de ce qu'il s'annonce. Ainsi 20 fr par trimestre au lieu de 10. Et moi on le fait encore payer 23. C’est drôle.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Discours du for intérieur, Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Russie), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée), Tristesse
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
169. Paris, Samedi 20 octobre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai pris beaucoup de bois de Boulogne hier, je me suis fatiguée dans l’espoir que cela me profiterait pour la nuit. J'ai été faire visite à la Duchesse de Talleyrand. Je ne puis pas vous dire combien elle & tout son établissement me paraissent unconfortable and unsatisfactory. Je ne sais à quoi cela tient. Elle a un air flottant, indécis, elle flatte tout le monde à droite, à gauche. Et par dessus toute cette incertitude, elle veut se donner de l'aplomb, & répète à tout instant qu’elle est une grande dame. Assurément elle devrait l’être, mais en vérité je ne trouve pas qu’elle en ait l'air, elle n’a pas assez de calme pour cela.
Le soir j’ai été dire adieu à la duchesse de Sutherland chez Lady Granville. J'y ai laissé Marie et je suis revenue me coucher à 10 heures ; cela m’a fait dormir un peu, pas beaucoup. Très décidément on dit Potsdam & je croirais, que cela dérive d’un juron. Il faut le demander à Humboldt. Je suis comme Thiers, j'aime la géographie. Le Duc de Noailles est ici, je ne l’ai pas vu encore. Son père était mourant, et il est mort en effet avant-hier. Ce sera pour lui un deuil et pas autre chose. M. de Barante est arrivé à Pétersbourg. Les affaires en Espagne sont au plus mal pour les Christinos, du moins c'est le ministre de Christine qui le dit !
Il fait doux et charmant aujourd’hui. je devrais me porter bien, & je me porte très mal. Il me semble que jamais mes nerfs n’ont été plus malades. Tout m’agite, tout m'irrite. Je sais bien qu’il n’y a pas de remède, car le mal me vient de gens incurables. Adieu. Adieu. Racontez-moi toujours que vous emballez, que vous envoyez. Il faudra bien finir par vous emballer vous même. Adieu.