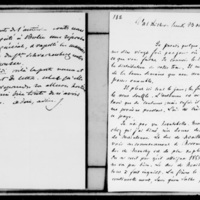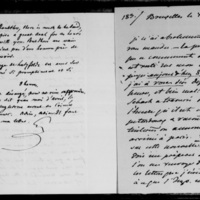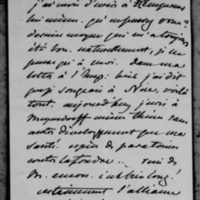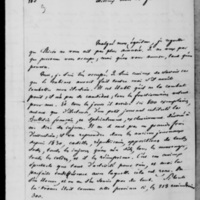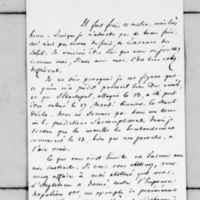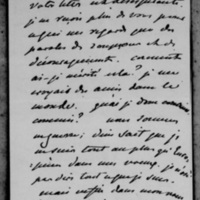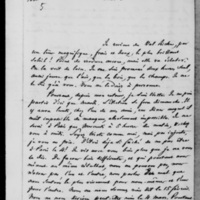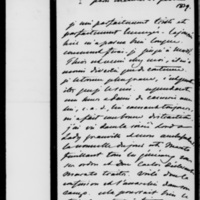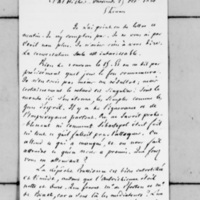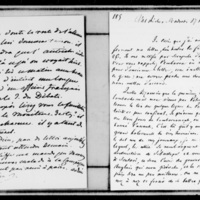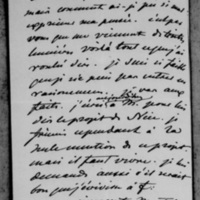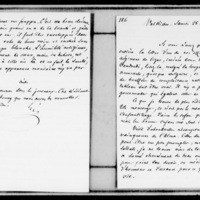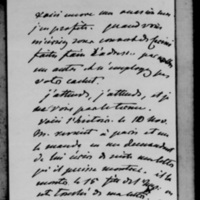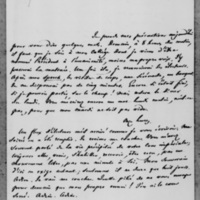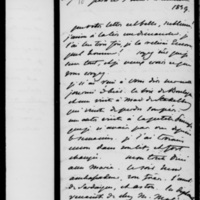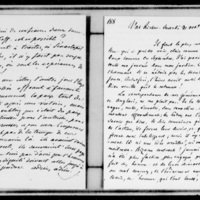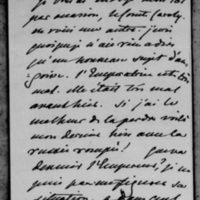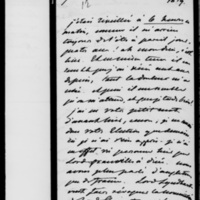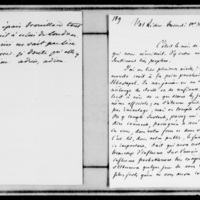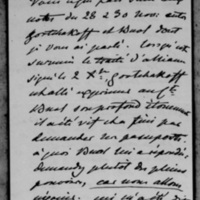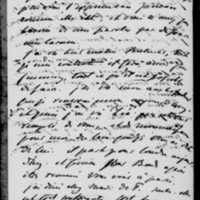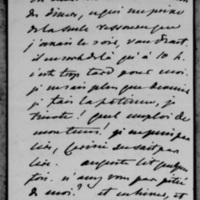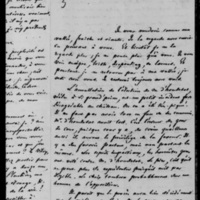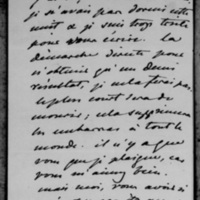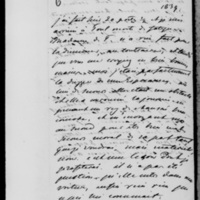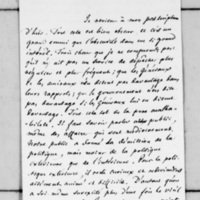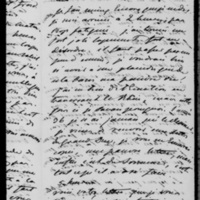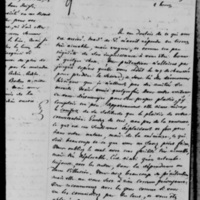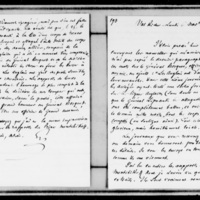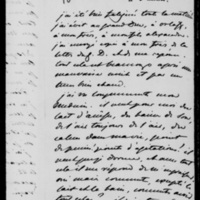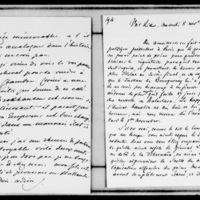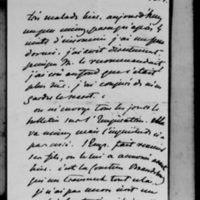Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
182. Val Richer, Lundi 23 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je prends quelque plaisir à me dire vingt fois par jour où vous êtes, ce que vous faites. Je connais les lieux, et la distribution de votre temps. Il me reste cela de la bonne semaine que nous venons de passer ensemble.
Il pleut ici tout le jour ; les feuilles tombent, le vent souffle. L’automne est venu plus tard que de coutume ; mais enfin il arrive. Je me promène pourtant. L’air est très sain dans ce pays.
Je n’ai pas vu Montebello. Mad. Lenormant chez qui j’ai dîné m'a donné des nouvelles de Maintenon. Le Duc de Noailles ira vous voir au commencement de Novembre. Le Duc de Mouchy est de plus en plus mal. On ne croit pas qu’il atteigne 1855. M. Molé ne va pas bien. Le Duc de Noailles en est tout-à-fait inquiet. La fièvre le reprend continuellement, sans qu’on sache pourquoi. Quand il s'est levé après avoir passé trois jours dans son lit, il était si faible qu’il ne pouvait marcher qu'avec deux bras. Le Chancelier a été enrhumé ; mais il s'est remis et va bien. Il se remettra toujours. Mad. de Boigne est très contente de sa nouvelle nièce. Mad. Duchâtel est venue à Paris voir sa mère Mad. Jacqueminot qui est très malade. Personne d'ailleurs à Paris. On y était occupé du procès de Mlle Rachel autant que de Sébastopol M. Legouvé, qui est venu me voir pour l'Académie lui a écrit, après l'avoir battue, un billet très galant pour la conjurer de le dispenser de la signification du jugement. On dit qu’elle jouera Médée, et qu’elle le jouera bien.
Voilà pour les coteries et les frivolités. Je n’ai rien à vous dire du monde sérieux. Je fais ici comme à Bruxelles, j’attends, mais j’attends sans vous. Il paraît que la réponse Prussienne a donné pas mal d'humeur à Vienne. J'oubliais de vous dire que j’ai passé chez Mad. de Seebach ; elle n’y était pas ; mais son mari y était. Nous avons causé un quart d'heure. Fort triste. Il croit que la Saxe adhérera toujours à la Prusse mais que la Prusse finira par adhérer à l’Autriche. Mad. Seebach voulait me parler de Mlle. de Cerini, de ses détresses de famille, comment vous la trouviez, si vous en étiez contente & & Je regrette votre pasteur luthérien, M. Verny. C’était un homme d’esprit et un excellent homme. Il est mort sur son champ de bataille, en deux minutes. Il s'est interrompu au milieu d’une phrase, s'est assis, a passé sa main sur son front. Deux médecins qui se trouvaient dans l’auditoire sont montés en hâte dans sa chaine ; il était mort, frappé d'apoplexie. Onze heures Votre lettre m’arrive sans numéro. J'y mettrai le 149. Adieu, adieu. Mille amitié de ma part, je vous prie, à M. Van Praet. C'est le vrai mot. Je suis charmé toutes les fois que je le retrouve. Adieu. G.
Mots-clés : Académie française, Diplomatie, Femme (politique), Femme (portrait), Femme (statut social), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Autriche), Politique (Prusse), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Salon, Santé, Théâtre, Vie domestique (Dorothée)
183. Bruxelles, Jeudi 7 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Dimanche
Je n'ai absolument rien à vous mander. La preuve est que ce commencement de lettre est restée sur mon bureau. jusqu’aujourd’hui 8. Mais j'ai à vous dire depuis une heure, et bien mal ! Mad. Sebach a traversé Berlin ; à l'heure qu’il est, elle est à Pétersbourg et raconte qu'aux Tuileries on annonce mon arrivée à Paris. Constantin sur cette nouvelle me dit que je dois me préparer à ce que l’on me renvoie de Péters. les lettres que j'écrirai de Paris à ce que l’Impératrice me redemande son portrait et à ce que je me brouille avec lui Constantin & mes fils, ce qui veut dire sans doute qu’ils me retireraient toute la pension qu’ils sont tenus à me faire. Voilà donc la préface de la bombe. J'avais bien raison de la craindre.
Maintenant où en suis-je ? Je n’en sais plus rien. Mon premier mouvement est la révolte. Est-ce le bon ? Ah, que n'êtes vous auprès de moi. Il y a des termes moyens. Mais il me faut des conseils, de l’esprit. Je ne sais prendre aucun parti. Je mourrai de cette angoisse, cela coupera court à tout. Il y a longtemps que je prévois cette fin là à mes misères.
C’est de la tranquillité, du repos qu'il me faut pour vivre au lieu de cela voyez-mon agitation. Ah, vous n'en avez aucune idée. Dans tous les cas tenez ce langage-ci : " Si Mad. de L. vient à Paris ce sera pour consulter son Médecin, et s'en aller à Nice s'il le lui prescrit et qu’elle en ait encore la force. Elle crache le sang, elle est bien malade. "
Le climat de Bruxelles doit être trop rude pour moi. & puis vous me conjurez de prendre mon parti vite & de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Soyez très inquiet et très pressant, j’ai besoin de cela & j’y compte. Du reste votre lettre ordinaire, seulement pas de sentences désobligeantes pour nous & je suis vraiment bien misérable et assez intéressante pour motiver que je l'envoie. Adieu. Adieu, je perds la tête.
Ah que le passeport est pressant. Il faudrait que Je l'eusse avant que l'écho de Mad. Sebach ne me revienne de Petersbourg. Ce sera au plus tard dans huit jours, peut être plutôt car la grande duchesse Olga savait cela à Stuttgart. Jusqu’à présent il n'y a que Constantin. J’ai le droit de n'y pas faire attention.
183. Bruxelles, Samedi 9 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai envie d'écrire à votre Empereur lui-même. Qu’en pensez-vous ? Dernier moyen qui m’a toujours été bon. Naturellement, je ne pense qu'à moi. Dans ma lettre à l’Impératrice hier j’ai dit que je songeais à Nice, voilà tout. Aujourd’hui j'écris à Meyendorff même thème sans autre développement que ma santé. Espèce de paratonnerre contre la foudre. Rien de M. encore. C'est bien long !
Certainement l’alliance avec l'Autriche c'est une énorme affaire traité de Vienne, Sainte Alliance tout détruit. La Prusse a été jouée. Elle est prise, elle ne peut pas se tirer de là. Il y a des gens qui craignent pour le roi. Evidemment nous n’accepterons pas la démarche de l’Autriche. En attendant et comme prévoyant on me dit que Brunnow est l’homme qui aurait à se mêler d’une négociation, mais il n’y a aucun moyen de croire qu’on en vienne là. Je ne vous redis pas l’état d’esprit, de corps où je suis. Dans toute ma vie je n’ai rien éprouvé de semblable. Adieu. Adieu.
Mon ami de Schlangenbad sera-t-il encore heureux ? Comme c’est long !
183. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Malgré mon égoïsme, je regrette que Thiers ne vous ait pas plus amusée. Je ne veux pas que personne vous occupe ; mais qu’on vous amuse, tant qu’on pourra. Moi, je suis très occupé. Je suis curieux de savoir ce que le cabinet aurait fait contre moi s’il avait combattu mon élection. Il est établi qu’il ne la combat point ; il n’a pas de candida t; tous les fonctionnaires votent pour moi. Et tous les jours il arrive ici 800 exemplaires autant que d’électeurs, d’un petit journal intitulé le Bulletin français, et spécialement, exclusivement dévoué à me dire des injures. Il ne se met pas en grands frais d'invention ; il va reprendre dans les anciens journaux depuis 1830, carlistes, républicains, oppositions de toutes sortes, toutes les injures qu’on m'a dites, tous les mensonges, toutes les colères, et il les réimprime. C’est un curieux spectacle que tant d'activité pour rien, et aussi la parfaite indifférence avec laquelle cela est reçu. On s’en étonne et on ne s’en soucie pas du tout. Si toute la France était comme cette province-ci, les 213 reviendraient 300.
Je vais ce matin au Val-Richer. J’y aurai le plaisir d’être seul quelques heures. Après vous, ce que je désire la plus en ce moment, c’est un peu de votre solitude. Depuis quelque temps, ma disposition est assez combattue. Je ne suis point las de la vie active et des affaires ; elles me plaisent toujours ; il me semble même que ce que j'y voudrais faire est à peine commencé. J’ai la tête de la volonté encore très pleines. Pourtant je suis un peu las des hommes ; j'en ai assez de leur conversation de leur figure. Je suis au milieu d'eux comme dans une foule qu’on est pressé de traverser pour rentrer chez soi. Rentrerais-je jamais chez moi ?
Maroto ne me rejoint ni ne m'afflige comme Granville ou Pahlen. Il me prouve que j'ai raison de ne rien attendre de personne en Espagne. On y fera ce qu’on y fait ; on y restera comme on est. Il n’y a là point de vainqueur. C’est parce que nous sommes des Européens que nous nous en étonnons. Il y a un pays dix fois grand comme l’Europe, où les choses se passent et demeurent ainsi depuis des siècles. Ce pays s’appelle l'Asie. Là par exemple, on a bien raison d'être las des hommes. Quoique vous ne sachiez pas le Latin, vous savez que Tacite a dit en parlant des statues de Brutus et de Cassius : « Elles brillaient d’autant plus qu’elles n’y étaient pas." C’est votre condition dans toutes ces conversations, ces correspondances, ces articles de journaux à propos de Prince de Lieven. Laissez- moi vous répéter ce que je vous ai dit. Vous êtes trop fière pour être faible. Et vous n'êtes pas plus fière qu’il ne convient.
On a tort en Belgique d'attendre l'issue de nos élections. Elles n'enverront pas cinq hommes et un caporal dans le Limbourg. Si j’avais eu besoin d'apprendre que ce pays-ci veut la paix, je l'apprendrais au milieu de toutes les oppositions, n'importe laquelle. Il a raison. La guerre pour de grandes raisons, à la bonne heure ; mais la guerre pour des querelles de journalistes ou pour des fantaisies, de gens d’esprit, c'est absurde. Adieu. De loin, je cause avec vous de ce qui ne me fait rien, ou pas grand chose. Voyez à quels scrupules d'exactitude vous m'avez accoutumé. Au fait, vous ne savez pas, personne ne saura jamais combien tout ce qui ne me tient pas au fond du cœur est peu pour moi, et quel abyme il y a en moi entre une chose et toutes les autres. Adieu. Vous ne me donnez pas des nouvelles de votre rhumatisme. A la vérité, il était passé quand je suis parti. Mais il me semble que de ce qui vous touche, rien ne passe. Adieu, Adieu.
183. Paris, Samedi 3 novembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez pas eu de lettre hier ? J'en suis désolée. J’ai bien questionné mon valet de chambre. Il dit que la lettre est partie, mais qu'il avait été trop tard pour l’affranchir. Vous en aurez eu deux ce matin. Mais je suis fâchée d’un petit mouvement de chagrin ; votre lettre était si joyeuse, si bonne jusqu'à ce dernier mot. Soyez sûr que moi aussi j'ai bien de la joie. Il vaut la peine de se réjouir quand on a huit mois devant soi, plus même n'est-ce pas ? Je voudrais me bien porter ou du moins en avoir l'air. Mais que faire !
J’ai fait visite hier à la Duchesse de Talleyrand. Cela ne m’amuse guère elle ne me parle que de ses affaires : il faut aimer beaucoup les gens pour s’intéresser à cela. Je crois que M. de Castellane a du charme. Lady Burghersh m'a fait une longue visite hier matin. Je vous prie de m’en demander des détails, car cela vous intéressera. Elle est full of valuable informations. Vous avez vos paquets à faire ; je ne vous les écris pas.
Le dîner des Granville était complètement anglais, ce qui me plaît. Mais quand le soir j’ai vu venir tous les natifs de Birmingham et de Manchester j’ai fui. J’ai été passer une demi-heure chez Mad. de Castellane et puis to my bed. Je ne rencontre jamais M. Molé chez elle, parce qu’il n’y vient que tard. Lady Granville a dîné avant-hier avec la Reine qui était en larmes en parlant de sa fille. Certainement elle est bien mal. Cette séparation à Fontainebleau sera bien triste !
La conférence ne marche pas. Je crois que les difficultés viennent principalement du côté de Léopold. Les troubles à Cologne lui semblent bons pour soutenir ses prétentions. Le Lenchtemberg a passé à Varsovie où il a été logé dans l’un des palais du Roi. Un aide de camps de l'Empereur l’attendait à la frontière. Cela ne peut se faire que pour un gendre quand on est aussi peu de chose que Lenchtemberg.
M. de Montalivet a causé l’autre jour avec Lord Granville qui l’a trouvé inquiet de la session. Adieu. L’avant dernier adieu. C’est charmant. Adieu.
Voilà les Débats, et voici ce que j’admire par dessus tout. " Et avec les points fixes.... Dieu s'est voilé." Et puis ce dernier paragraphe. " Regardez donc plus haut & &. " Tout cela est superbe. Je veux vous l’avoir dit tout de suite. Adieu.
Mots-clés : Politique (Internationale), Réseau social et politique
183. Val Richer, Mardi 24 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait frais ce matin, mais très beau. Quoique je n'admette pas de beau froid. Ceci n’est pas encore du froid, et c'est encore du soleil. Je voudrais être sûr que vous en jouissez comme moi, sinon avec moi. C'est bien assez différent.
Je ne sais pourquoi je me figure que ce qu’on m’a prédit pourrait bien être arrivé et que Sébastopol attaqué le 13 a été peut être enlevé le 17, mardi dernier. Ce serait drôle. Nous ne sommes pas dans un temps où les prédictions s'accomplissent. Mais je trouve que la nouvelle du bombardement commencé le 18, bien que non garantie, a l’air vraie.
Ce que vous écrit Greville est d'accord avec mes instincts. Si vous vous obstinez vous aurez affaire à aussi obstiné que vous. L'Angleterre a donné contre l'Empereur Napoléon 1er un exemple de persévérance que l'Europe toute entière de Lisbonne à Moscou était fort loin d'imiter. Elle le redonnera, contre vous, dans son intimité avec l'Empereur Napoléon 3 qui ne se séparera point d'elle. Les temps et les personnes sont bien changés, et en Angleterre même, bien des choses sont changées. Mais le fond du caractère et du gouvernement Anglais subsiste. Leur intérêt et leur honneur national sont engagés. L’intérêt, et l’honneur personnel de l'Empereur Napoléon, le sont aussi. Je suis profondément convaincu que cette guerre n'était point nécessaire, et pouvait être évitée ; mais on l’a faite, on la fait et tout pareil à celui de l'embarquement de on la fera jusqu'à ce que vous consentiez à une paix désagréable pour vous, mais qui vous sera pire, si vous ne la faites que plus tard, et qui, faite aujourd’hui, préviendrait le bouleversement de l'Europe, et vous laisserait vous-mêmes plus en mesure de reprendre avec le temps une partie de vos avantages naturels. Je ne sais ce que vont faire l’Autriche et la Prusse ; probablement prendre parti activement contre vous, l’Autriche au moins ; mais si avant cette résolution extrême, et Sébastopol étant pris, elles vous ouvrent quelque nouvelle porte de paix, vous ferez bien d'y passer. Si Sébastopol n'est pas pris, tout continuera, ou plutôt restera en suspens pour recommencer au printemps prochain. Et Dieu sait ce qui arrivera ou se préparera d’ici là, en Europe !
Midi
Je reçois tard le 150. Je suis bien aise, et que M. Lebeau ne vous ait pas endormie, et du pourquoi. Adieu, Adieu.
Vraiment, pardonnez moi, ma brutale franchise, la dernière dépêche du Prince Mentchikoff a l’air d’un mensonge tout pareil à celui de l'embarquement de l’armée Anglaise pour arriver à Balaklava. G
Mots-clés : Circulation épistolaire, France (1804-1814, Empire), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (Europe), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie)
184. Bruxelles, Dimanche 10 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre est désespérante. Je ne reçois plus de vous pour ce qui me regarde que des paroles de soupçons et de découragements. Comment ai-je mérité cela ? Je me croyais des amis dans le monde. Qu’ai-je donc commis ? Nous sommes en guerre ; Dieu sait que je ne suis tout au plus qu’Européenne dans mes vœux. Je n’ose pas dire tout ce que je sens. Mais enfin dans mon vœu d’aller à Paris, vous savez à quel point c’est le cœur, l’esprit, les besoins de ma santé qui m’en poussent. Je veux bien prendre le solennel engagement de ne plus écrire une ligne. Prescrivez-moi ce que je dois faire. Au fond je suis indigne d’avoir à me défendre. Qu'on vienne me parler je saurai répondre.
Et comment votre empereur se méfierait-il de moi ? Qui sait mieux que vous combien il se trompe ! A Pétersbourg on m’accuse de Napoléonisme ; chez vous, je prie encore qu'on m'explique de quoi on m'accuse, à Londres c'est la rancœur de Lord P. rancœur personnelle, car vous savez que j’y ai des amis et des amis puissants. Mon grand défaut est de compter sur ma parfaite innocence à voir tout ce qui m’arrive aujourd’hui. Je suis certainement bête.
Envoyez-moi Montebello ; je voudrais tant ouvrir mon cœur à quelqu’un. C'est un si honnête homme. Quel bonheur s'il venait. Je suis sûre qu'il pourrait ensuite. Mon ami de Sch. s'est-il refroidi dans son amitié, ou a-t-il perdu de sa puissance ? Ce n’est qu'à lui cependant que je puis me remettre et me fier. Je renonce à l’idée d'écrire plus haut. Il y aurait inconvenance. Comment n’ai-je pas un mot ? Vous m'avez dit de ne pas trop frapper à la porte. Fould est-il mon ami ? Je l'ai toujours pensé, y aurait-il inconvénient à me tourner vers lui aussi. Il a l’accès quotidien, il pourrait rappeler. M. trouverait-il cela mauvais ? Pourquoi ne pas chercher secours auprès de tous ceux qui pourraient me secourir. Je cherche à penser à nulle ressource mais je n'ose rien faire de si loin, sans avis.
Vais-je vous ennuyer aussi ? Ah mon Dieu, il me manquerait Plus que cela. Je ne vous parle que de moi. Quel grand moment dans l’histoire de l’Europe ! Tout est changé. Cela a été bien mené chez vous ; bien pitoyablement chez nous, ah mon Dieu ! Comme la presse a été mortifère. Que de réflexions curieuses à vous communiquer si nous étions ensemble & dans un moment pareil personne à qui dire mes impressions ou de qui en recevoir ! Je suis touchée du bon souvenir de Dumon. Il me semble que je l’entends trouvant sur tout ce qui se passe des réflexions et des mots si piquants & si vrais. Que vous êtes heureux de vivre. avec des gens d’esprit. J’ai toujours ici Mérode, mais ce n’est bon que pour rire avec, & je ne sais plus rire. Adieu. Adieu.
Savez-vous que Thiers est fort. consulté par Vaillant & par Thouvenel. Il a dîné avec celui-ci chez Hubner et il y a huit jours chez Rémopf. outre les autres rencontres.
184. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens du Val Richer, par un temps magnifique, frais et doux ; le plus brillant soleil ! Point de verdure encore, mais elle va éclater. On la voit de loin. Je me suis promené deux heures seul, aussi jeune que l’air, que les bois, que les champs. Je ne le dis qu'à vous. Vous ne le direz à personne. Pourtant depuis mon retour, je suis triste. Je ne puis partir d’ici que mardi. L’élection se fera dimanche. Il y aura lundi chez l’un de mes amis, un dîner auquel il m'est impossible de manquer absolument impossible. Je ne serai à Paris que Mercredi à 5 heures du matin, & chez vous à midi. Soyez triste comme moi, mais pas injuste, je vous en prie. J'étais déjà si fâché de ne pas être à Paris, le 4. Je vis avec vous bien plus que je ne vous le dis. De façons bien différentes et qui pourtant nous mènent au même résultat, nous ne pouvons pas, nous n'osons pas l’un et l'autre, nous parler du mal que nous sentons le plus vivement pour nous-mêmes et l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes rien dit le 15 février. Nous ne nous dirions peut-être rien le 4 mars. Pourtant je voudrais être là ; je voudrais vous voir. En vérité, il y a des tendresses, auxquelles Dieu devrait accorder de paraître telles qu’elles sont et de donner tout ce qu’elles ont, sans démonstration extérieure, sans parole. Dearest for ever dearest !
Vendredi 7 heures et demie
J’ai été réveillé cette nuit à une heure du matin, par un singulier message. Des électeurs de Rouen m’ont envoyé l'un d'entre eux pour me conjurer, c’est bien le mot d'aller passer quelques heures à Rouen et de prendre la parole dans un grand meeting où il s’agit d'assurer le succès des candidats de l'opposition entr'autres de M. Duvergier de Hauranne qu'on veut porter à Rouen. Il leur faut un virtuose pour porter le dernier coup. Avec un virtuose ils se tiennent pour vainqueurs. Je me suis excusé, comme vous pensez bien. J’ai à faire ici. J’ai donné une belle lettre au lieu de ma personne. On la lira dans le meeting. Mais vous savez le peu qu’est une lettre. En voilà pourtant une qu’on m’apporte, et qui est beaucoup. Certainement, Lady William Bentinck est une bonne femme. Je le savais. A présent, je lui en sais gré. A-t-elle été jusqu'à vous offrir son perroquet, ce perroquet favori qui va se promener avec elle ? Je suis bien aise que le Duc de Wellington, n'ait pas notre rhumatisme. Je dis notre, car décidément j'ai les épaules un peu entreprises. Je n’ai pas même le temps de lire les journaux. J'ai laissé les miens à Paris. Il faudrait ici aller Ies chercher au Club. On me les raconte. Et je n’ai pas besoin qu’on me les raconte. Je les fais bien tout seul, amis ou ennemis. Le rabâchage règne et gouverne dans le monde. J’ai bien remarqué l'âpreté anglaise dans cette affaire du Pilote. Il y a quelque chose de plus que l'humeur de l'affaire même. C’est une humeur générale, et qui prend plaisir à se faire sentir, les plus simples en sont frappés, et frappés aussi de la chose même, de l'étourderie de ce jeune Prince, et de l’inconvénient des étourderies princières. On va de là aux faiblesses royales. Et de là on vient à moi, pour me donner raison. Le Duc d'Orléans a passé ici, cette nuit. Il va sans doute au devant du Prince de Joinville. Nous sommes sur la route de Brest.
Adieu. A mercredi. J’ai ces 24 heures là bien lourdes, sur le cœur. Il n'y a pas moyen. Adieu.
184. Paris, Mercredi 27 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis parfaitement triste et parfaitement ennuyée. La journée hier m’a paru bien longue. Comment ferai-je jusqu'à mardi. Thiers est venu chez moi ; il m’a moins divertie que de coutume. Je le trouve plus grave, c’est peut- être que je le suis. Cependant une heure et demie de causerie avec lui, c-à-d lui causant toujours, m'a fait une bonne distraction. J’ai vu dans la soirée Lord & Lady Granville et mon ambassadeur ; la nouvelle du jour est Marato fusillant tous les généraux sous ses ordres et Don Carlos déclarant Marato traître. Voilà donc la confusion et l’anarchie dans son camp. Cela pourrait bien le faire lever tout-à-fait. Granville avait l’air fort réjoui de ces nouvelles. Pahlen l’était moins. Il m’avait porté notre journal officiel renfermant un long article sur mon mari assez bien fait ! Ce qui y est le plus remarquable est ce qui n'y est pas. Ainsi pas mention de sa femme. Du reste une biographie très exacte, il est même question de ses enfants. Lady Jersey m’écrit une fort bonne lettre plus du grand dîner, mais rien de sa part qui me regarde. Il est excellent pour mon fils pour un fils, c’est tout ce qu'il me faut.
On traîne en Belgique, cela a l'air d'un parti pris ; on ne veut pas finir avant de connaître le résultat de vos élections. Voici du beau temps, j’ai été l’essayer aux Tuileries, plus tard J’irai au bois de Boulogne à 5 h. chez Lady Granville, je dîne chez Mad. de Talleyrand ; vous savez maintenant mes faits et gestes. Apprenez moi les vôtres. Adieu. Adieu. C’est bien dur de devoir se dire adieu de si loin en février. Nos beaux jours ne sont plus que les plus mauvais de l’année.
184. Val Richer, Mercredi 25 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai point eu de lettre ce matin. Je n'y comptais pas. Je ne vous ai pas écrit non plus. Je n’avais rien à vous dire. La conversation seule est intarissable. Rien de nouveau le 15. Et on ne dit pas précisément quel jour le feu commencera. Je n'en crois pas moins au résultat ; mais certainement le retard est singulier. Tout le monde ici s'en étonne, les simples comme les gens d’esprit. Il y a de l’ignorance et de l'imprévoyance partout. On ne savait probablement, ni comment Sébastopol était fait ni tout ce qu’il fallait pour l'attaquer. On attend ce qui a manqué, et on nous fait attendre ce qu’on nous a promis. Que ferez vous en attendant ?
La dépêche Prussienne est bien entortillée et timide, autant que l’Autrichienne était nette et dure. Que feront, M. de Pforten et M. de Bensk, car ce sont là les médiateurs ? L’un et l'autre vous sont favorables, d’intention ; mais je doute fort que l'action suive. M. de Seebach m’a eu l’air d'admettre la chance que l'Allemagne se coupe en deux, et qu’une partie de la confédération adhère à la Prusse et à vous par la Prusse, tandis que l'autre suivrait l’Autriche dans l'alliance occidentale. Je ne crois pas du tout à cette chance-là. Les Allemands ne se battront pas entre eux à cette occasion-ci. L'Allemagne entière restera neutre, ou deviendra Anglo-française. dans l'hypothèse de l'Allemagne coupée en deux, Seebach regarde la Saxe, comme liée à la Prusse, par cette raison et " Dans un remaniement de l'Europe, la Prusse seule peut nous manger et en a envie ; il faut que nous soyons ses amis pour lui ôter tout prétexte. Pauvre garantie que l’amitié de qui veut vous dévorer.
La querelle semble l'échauffer beaucoup entre le Roi de Danemark et ses Chambres. Trois dissolutions en vingt mois, c’est beaucoup. J’ai bien peur que les libéraux danois ne soient pas plus sensés, ni plus patients que d'autres. Ce serait dommage, au milieu des folies Européennes, les Etats scandinaves s'étaient jusqu'ici bien tenus.
Midi
Je suis désolé des retard de mes lettres. Je me suis plaint bien vivement à Lisieux. La première tournée du bombardement a été bien chaude. Il est impossible qu’on tue 500 hommes par jour pendant longtemps. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Marine, Politique (Allemagne), Politique (Analyse), Politique (Autriche), Politique (Europe), Politique (Prusse), Politique (Russie), Relation François-Dorothée
185. Bruxelles, Lundi 11 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre est excellente. Je vous remercie. Je reste toujours sans réponse d’autre part. Vos conseils sont très sensés. J’ai besoin qu’on m’en donne car je me livre à des amis de désespoir et je ne comprends pas que je vive encore.
Lord Howard vient plus souvent et nous causons beaucoup et à fond. Il croit que nous pouvons accepter de commencer à parler, admettre la discussion. Dans ce cas, il y aurait suspension d’hostilités. Il a été charmé d’apprendre que Brunnow serait employé dans cas qu’on se parle mais comment espérer, avec les exigences anglaises, ce que dit le Times au moins & qui est surement la vérité. Je suis de votre avis l’adhésion de la Prusse faciliterait.
2 heures.
J’apprends que Barrot a reçu tout rement avis qu'on ne permette plus à aucun Russe d’entrer en France. Jusqu'ici il y avait tolérance après examen. C'est une mesure toute nouvelle. On me parle vaguement du renvoi de Mad. Kalergis. Je saurais tantôt si c’est vrai. Mad. Creptovitch est revenu hier de Paris.
Imaginez que je ne dors pas du tout c.a.d. Trois ou tout au plus
4 heures dans la nuit & point de tout le jour. Quelle chose, étonnante que je continue à exister. Je n’ai pas parlé à M. de mon projet de Nice. parce que je ne lui ai pas écrit depuis que j’y songe. Adieu. Adieu et encore merci.
185. Paris, Jeudi 28 février 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre m’a réjoui le cœur ce matin, je vous en remercie. Vous saurez que le duc de Wellington a eu une paralysie à ma façon, un rhumatisme dans les épaules, pas autre chose. Il se porte bien. J’ai vu chez moi hier matin, mon ambassadeur, M. de Montrond, et Lady William Bentinck. La bonne femme ! Je pleurais. lorsqu'elle est entrée, car je pleure souvent. Cela l’a fort touchée. Elle m’a fait toutes les propositions imaginables. Elle voulait m’envoyer un espagnol un homme qu’elle aime beaucoup, un excellent homme à ce qu’elle dit qui viendrait chez moi tous les jours pour me distraire ! Et puis elle m’a demandé si elle pourrait m’envoyer des oiseaux, elle dit que les oiseaux distraient. Enfin elle m’a envoyé des gravures, et puis elle veut que j'aille dîner demain seule avec elle et son mari. Comprenez-vous qu’on puisse rire et s’attendrir tout à la fois ? Il y avait tant de bon cœur et tant de bêtise dans tout cela que je ne savais comment m'arranger entre mes larmes et un peu d’envie de me moquer d’elle la reconnaissance l’a emportée, et je range Lady Wlliam dans la catégorie des plus excellentes femmes, que j'aie jamais rencontrée.
Je n’ai trouvé chez Mad. de Talleyrand à dîner que M. de Montrond. Elle est inquiète de ce que le consentement de son mari au mariage de Pauline tarde tant. Palhen en est maigrie.
Le soir j'ai vu chez moi Messieurs d’Armin, de Pahlen, et de Noailles et M. Molé ; qui est fort bien touché. Il avait sa plus douce mine, et de la bonne humeur. Il attend, comme tout le monde attend. Mercredi si le temps est clair, il saura tout. Il m’a confirmé ce que je vous disais d’Espagne. Maroto est mis hors de la loi déclaré traître. Vous voyez dans les journaux à quel point on s'émeut en Angleterre pour l’affaire du pilote. Lisez la discussion à la Chambre basse. Adieu votre lettre est charmante et bonne. Mais je n’aime pas les lettres. Adieu. Adieu.
185. Val Richer, Vendredi 27 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je crois que j’ai oublié hier en fermant ma lettre, de dater la fin du Jeudi 26. Je me rectifie par scrupule d’exactitude. Vous vous rappelez l’embarras où nous a jetés, pour d’anciennes lettres, une inattention de ce genre ; nous avons perdu une demi heure à nous mettre d'accord.
Quelle bizarrerie que la première nouvelle du bombardement nous vienne par Pétersbourg ! Je trouve le ton des quelques lignes du Prince Mentch. triste et peu confiant. Je présume qu'après deux ou trois jours de bombardement, on aura donné l'assaut. C'est là qu’il y aura eu un grand Holocauste de vies humaines. Si, comme le dit un de mes journaux, je ne sais plus lequel, les alliés se rembarquent après la destruction de Sébastopol et vont hiverner à Scutari, ce sera l’avis du gouvernement Anglais qui aura prévalu, et la chance de paix sera un peu meilleure. On ne sera pas nez à nez et forcés de se battre pendant. l'hiver. L'enivrement et l'irritation se calmeront plus aisément à distance. Pour tout le monde, et pour toutes choses, il y a avantage, après un grand coup à une suspension des coups. C’était le grand art de l'Empereur Napoléon d’offrir et de faire brusquement la paix après quelque éclatante victoire. Son successeur, saura-t-il en faire autant, et vous y prêterez-vous ? Vous êtes fiers et obstinés. Vous seriez pourtant un peu embarrassés, si, Sébastopol détruit, on vous offrait la paix aux mêmes quatre conditions de M. Drouyn de Lhuys et de Lord John Russell, ni plus, ni moins et parce qu’on admettrait implicitement sans vous le dire impoliment, que la destruction de Sébastopol est une limitation suffisante de votre puissance dans la mer Noire.
En attendant qu’on dit cette sagesse, on fait en France et en Angleterre de bien françaises ; elle leur demanda à venir un l’année prochaine. Je ne sais à quoi il faut le plus croire dans ce qu’on en dit, à la dissimulation où à l'exagération. Chez nous il y a peut-être de l’une et de l'autre ; mais, en Angleterre, l’une et l'autre sont à peu près impossibles. Vous aurez vu l'énumération de la flotte qu’on équipe pour la Baltique. Vous aurez là, si la paix ne se fait pas le pendant de l'expédition de Crimée.
La bénédiction de votre Empereur à genoux, à ses fils à genoux, en présence d’une armée à genoux, m'a touché. J’ai oublié qu’ils n'étaient pas encore partis. Ils font bien de partir enfin. Dieu veuille ménager le cœur de leur mère. Ils vont à l’armée du Prince Gortchakoff ; on ne se bat guère là, cette année du moins.
Je connais beaucoup Florence Nightingale, qui va en Orient à la tête d’une compagnie de sœurs de la charité laïques. C'est une belle, spirituelle vive, et noble personne, de 30 à 35 ans. Elle venait assez souvent voir mes filles à Brompton. Elle entendit dire que je leur lisais quelquefois des tragédies, ou des comédies françaises ; elle leur demanda à venir un jour. Je lus Polyeucte. L'expression passionnément pieuse et romanesque de sa figure en m'écoutant me frappa. C'est un beau dévouement. Mais quand on a de la beauté et guère plus de 30 ans, il faut être enveloppée dans une longue robe de bure noire et cachée sous une guimpe blanche. L'humilité religieuse non seulement de cœur, mais du dehors, est nécessaire à cette vie-là, et en fait la sureté ; la moindre apparence mondaine n’y va pas du tout.
Midi
Rien de nouveau dans les journaux. C'est décidément par Pétersbourg que nous avons les nouvelles. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (portrait), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Marine, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (France), Politique (Russie)
186. Bruxelles, Mardi 12 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mon Dieu, moi vous accuser ! Mais comment ai-je pu si mal exprimé ma pensée. C’est par vous que me viennent de tristes lumières voilà tout ce que j’ai voulu dire. Je suis si faible que je ne puis pas entrer en raisonnements. Je vais aux aujourd’hui faits. J'écris à M. pour lui dire le projet de Nice. Je frémis cependant à la seule mention de ce projet mais il faut vivre. Je lui demande aussi s'il serait bon que j'écrivisse à F. Pauvre innocent Montebello qui me conjure de venir à Paris où je serais reçue par tous à bras ouverts. Parlez lui dites lui. Il est excellent, il peut-être utile, très utile. Ne négligez pas cela et tout de suite. Hélas il n’y a plus d'amitiés. Cependant ce que vous lui direz à lui ne doit pas être dit à d'autres. Molé est parfait, mais sans doute impuissant. Mes protecteurs sont des puissances morales qui devraient compter.
Les jeunes grands ducs sont toujours à Sébastopol, & y restent. L’Impératrice a été très mal, en grand danger. Elle allait mieux. Que va-t-elle devenir quand elle verra la Prusse se joindre à l’alliance. tournez.
Mon empereur doit être dans un état d’esprit terrible je ne me le figure pas réduit à cette extrémité. Hélas il ne se rendra pas. Et on a bien soin en Angleterre de lui dire. Si vous cédez - vous êtes déshonoré.
Je suis curieuse du diner de la Reine aujourd’hui. Ah cent fois le jour, je voudrais vous avoir auprès de moi, pour moi, pour tout ce qui se passe. Adieu. Adieu. J’ai écrit Je suis lasse. Ma faiblesse est grande. Adieu. Adieu.
Que votre affection ne se fatigue pas. Adieu. tournez. Je crains les susceptibilités. Voilà pourquoi je vous envoie la feuille volante. A remettre si vous le jugez bon, si non à bruler.
Mots-clés : Conversation, Correspondance, Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Prusse), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
186. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le soleil a beau briller la rivière, a beau couler gaiement devant ma fenêtre ; tout ce qui m'entoure a beau prendre soin de m'animer et de me plaire. Je pense tristement à vous, si triste ! Je me sens seul loin de vous, si seul !
Je vous l'ai dit bien souvent; je puis me répandre au dehors ; je puis paraître, je puis être très occupé, très actif, et que tout cela soit point un mensonge, point un effort, mais très superficiel, très indifférent pour moi, pour ce qui est vraiment moi. Moi, c’est ce qui m’aime et ce que j'aime. Moi, c’est vous, vous de loin vu de près, triste ou gaie, pleurant ou souriant, juste ou injuste même. Mais ne soyez pas injuste ; ne le soyez jamais !
J'ai bien raison d'être triste avec vous. Voilà votre pauvre lettre. C’est bien assez du mal des jours ; les mots devraient être un repos. Je regrette quelque fois que vous ne soyez pas en état et aussi en nécessité absolue de vous fatiguer physiquement. Je l’ai éprouvé ; l'extrême fatigue endort la douleur ; quand le corps s'affaisse, l’âme s’apaise. Paix stérile, paix sans joie, mais qui donne quelque relâche et rend quelque force. Et puis, quand de cruelles images vous assiègent, quand vous n'êtes entourée que de morts, faites un effort, prenez votre élan ; sortez de ces tombeaux. Ils en sont sortis ; ils sont ailleurs. Nous serons où ils sont. Je me suis longtemps épuisé à chercher où ils sont et comment ils y sont. Je ne recueillais de mon travail que ténèbres et anxiété. C’est qu’il ne nous est pas donné, il ne nous est pas permis de voir clair d’une rive à l'autre. Si nous y voyions clair, s'ils étaient là devant nos yeux, nous appelant, nous attendant, supporterions-nous de rester où nous sommes aussi longtemps que Dieu l’ordonne ? Ferions-nous jusqu'au bout notre tâche ? Nous nous refuserions à tout, nous abandonnerions tout ; nous jetterions là notre fardeau, notre devoir, et nous nous précipiterions vers cette rive où nous les verrions clairement. Dieu ne le veut pas, mon amie. Dieu veut que nous restions où il nous a mis, tant qu’il nous y laisse. C'est pourquoi, il nous refuse cette lumière certaine, vive qui nous attirerait invinciblement ailleurs ; c'est pourquoi il couvre d'obscurité ce séjour inconnu où ceux qui nous sont chers emporteraient toute notre âme. Mais l’obscurité ne détruit pas ce qu’elle cache ; mais cette autre rêve où ils nous ont devancés, n'en existe pas moins parce qu'un nuage s'étend sur le fleuve qui nous en sépare. Il faut renoncer à voir dearest, il faut renoncer à comprendre. Il faut croire en Dieu. Depuis que je me suis renfermé dans la foi en Dieu, depuis que j’ai jeté à ses pieds toutes les prétentions de mon intelligence, et même les ambitions prématurées de mon âme, j'avance en paix quoique dans la nuit, et j'ai atteint la certitude, en acceptant mon ignorance. Que je voudrais vous donner la même sécurité la même paix ! Je ne renonce pas, je ne veux pas renoncer à l’espérer.
Midi
Je vais aller voter pour la formation du bureau. Demain, je serai retenu toute la journée, car on veut me nommer Président du Collège. Je ne pourrai probablement vous écrire que quelques lignes. Je les retarderai jusqu’au dernier moment ; il est possible que le scrutin soit dépouillé avant le départ du courrier. Je vous en dirais le résultat. Moi aussi, j’attends. Je viens de recevoir une lettre de M. Jaubert qui me rassure tout à fait sur l’élection de M. Duvergier. D'autant que Jaubert est disposé à voir en noir. Je suis préoccupé de celle de M. Joseph Poirier. J'y tiens et j'en ai toujours été un peu inquiet. Nous verrons. Je ne crains pas grand chose du résultat définitif, quel qu’il soit. Si la victoire ne nous est pas donnée du premier coup, nous aurons certainement de quoi la prendre. Peut-être cela vaudrait-il mieux. En tous cas, je suis résigné et prêt. Adieu. Ne soyez pas trop souffrante, je vous en prie. Mon ambition est bien modeste. Adieu. G.
186. Paris, Vendredi 1er Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé une nuit affreuse. de l’insomnie, & des rêves l'un plus hideux que l’autre. Des meurtres et rien que des morts autour de moi. Des morts chéris, d'autres indifférents, mais enfin je n'étais pas de ce monde. Et je me suis tout-à-fait brisée ce matin. Votre lettre m’a remise un peu, je vous en remercie. Je vous vois content et je le suis.
Les journaux disent que M. Duvergier de Hauranne n’est pas aussi content que vous et qu'il va perdre son élection, ah cela par exemple fera un grand plaisir dans le camp ministériel. M. Appony m'a fait une longue visite hier matin. Il n’est pas tranquille. L'avènement possible de M. Thiers le trouble à un degré un peu excessif. Il y a là quelque mystère, quelque personnalité dont je n’ai pas la clé. La discussion à Bruxelles est remise à la semaine prochaine. Les troupes prussiennes sont en force sur la frontière. Partout on s’émeut fort de la situation des affaires en France. Vous êtes de grands perturbateurs.
J'ai vu longtemps hier matin Lady Granville et son mari. J'ai fait une longue promenade au bois de Boulogne par un temps. charmant. Le soir j’ai reçu mon ambassadeur, la Sardaigne, Naples, la Suisse, et le Duc de Richelieu. Le faubourg St Germain a une grande admiration pour le duc de Joinville. Messieurs ses frères sont partis hier pour aller à sa rencontre. Ils le ramènent aujourd’hui à Paris. Voilà toutes mes nouvelles.
J'écris aujourd’hui à mes deux fils, et à la Duchesse de Sutherland. Elle prolongera son séjour en Italie, ce dont je suis fâchée. M. Ellice sera ici le 20, il est dans une fort grande admiration de la coalition ! Adieu vous ne concevez pas comme je me sens souffrante. C’est peut être le temps. Je n’en sais rien, mais je ne vaux rien. Adieu. Adieu.
186. Val Richer, Samedi 28 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous n'avez pas lu tout entière la lettre d’un de nos officiers, du 39e régiment de ligne, insérée dans les Débats d’hier Vendredi, lisez-la malgré la longueur. Elle est amusante, quoique vulgaire, et à travers bien des bouffés de complaisance nationale, le tableau doit être vrai. Il n’y a point de garçonnades qui égalent, celles de Pétersbourg. Ce que je trouve de plus ridicule, dans de tels mensonges, ce n’est pas le mensonge ; c’est l'enfantillage. J’aime les enfants plus que personne. mais les hommes enfants me sont insupportables. Voilà d'abondantes récompenses pour les vainqueurs de l'Alma. Celles des généraux sont peut-être un peu promptes ; mais pour les soldats, je ne trouve rien de trop. Quand on a donné obscurément ses bras, ou ses jambes pour faire son devoir, on mérite bien un peu d’honneur et d'aisance pour ce qui reste de vie.
Les petits Etats Allemands me paraissent bien vivement préoccupés de la chance d’une rupture entre l’Autriche et la Prusse. Ils ont raison. Autrefois, les Allemands pouvaient se faire la guerre entre eux en conservant leur indépendance. Aujourd’hui s'ils se divisaient, ils ne seraient plus que les instruments des uns et des autres. Entre les grandes puissances de l'Est et de l'ouest l'Allemagne n’a pas trop de tout son poids pour rester aussi une grande puissance. Nous nous sommes moqués des puérilités de la patrie Allemande ; il y a au fond de cela une idée juste. Du reste, je ne crois pas à la rupture. L’Autriche fera des politesses et la Prusse des concessions. L'orgueil Prussien a subi bien des désagréments depuis 1848 ; je doute qu’il les repousse maintenant à coups de canon ; surtout quand les coups de canon seraient très contre la pente nationale.
Ce que vous me dites des dispositions expectantes de l’Autriche jusqu'au printemps avec ce qu'on rapporte, n’est pas d'accord de l'avis du baron de Hess qui a demandé, au dernier conseil de guerre tenu à Vienne que l’Autriche ne demeurât plus sur la défensive. Onze heures Le facteur ne m’apporte rien, et je vous dis Adieu. Est-ce que le retour du Roi Léopold ne vous enlèvera pas quelquefois Van Praet ? Adieu. G. Adieu. G.
187. Bruxelles, Mardi 12 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici encore une occasion sure j’en profite. Quand vous m'écrirez sous couvert de Cerini faites faire l'adresse par un autre et n'employez pas votre cachet. J’attends, et j’attends. Je ne vois pas le terme. Voici l’histoire. Le 10 Nov. M. revient à Paris et me le mande, en me demandant de lui écrire de suite une lettre qu'il puisse montrer. Il la montre le 15 fête de l’Imp. On est touchée de ma lettre. On veut que je revienne. On me fait la promesse seulement comme j’ai affaire à un allié ombrageux. Laissez-moi la lettre pour que je la montre à Lord Cowley." Morny me dit l'Emp. va de suite m'envoyer le passeport. Dites-moi le jour, j'irai vous chercher au chemin de fer. Je ferai préparer votre dîner. & &. Vous savez mieux que moi le reste. La seule lettre que j’ai eu depuis de Morny est du 28. " hier 27 l’Impératrice m’a dit diabolique effet en Angleterre, mes affaires d’état, mais c’est égal je ne changerai pas, je l’ai promis. Si sur cela M. heureux & moi plus que lui. Il me dit au revoir ici. Seulement il ajoute "attendez patiemment". C’est ce petit mot qui me jette dans le désespoir. Y a-t-il un terme. Le [?] me tue.
J’ai écrit le 6 ce que vous m'avez dit d'écrire. Pas un mot. Est-ce que je com promets M. ? Je me tâte je voudrais bien savoir si je suis moi. L'objet aujourd’hui des soupçons de tout le monde ! Ah que j'espère cruellement l'importance que j’ai pu avoir, ou plutôt qu'on m’a cru.
Je demande mon repos ma santé, mes amis ; je dis volontiers adieu à toutes les correspondances à tout, pourvu qu'on me rende Paris.
Depuis le 20 Nov., le jour où vous y êtes rentré, je ne tiens plus d'impatience jusque là ma résignation était douce.
Il y a eu quelque chose de mal heureux l’arrivée de Palmerston va était prévenu cependant qu'il n'était pas de mes amis. Enfin je ne veux pas chercher les toutes. Je suis touchée de l’amitié, mais je crains qu’elle ne se fatigue ou qu’elle perde sa puissance. Je vous ai demandé si Fould était bien pour moi. Je le crois. M. se fâcherait-il si jefFrappais à cette porte.
Voici votre lettre d’hier sur ce & j’y ai répondu sujet entre autres & par ma lettre ce matin.
Je crois que chez nous on veut décidément la paix, mais il n’y aura pas moyen si on nous la rend trop dure. Nous sommes extrêmement forts du côté de l’occident. Que je voudrais que Sébastopol tombât (ne répétez pas cet horrible propos) tout serait plus facile. Mais on dit que ce sera imprenable. N'oubliez pas que le 16 Hatzfeld envoie son courrier.
Ah que je voudrais que Montebello veut me voir. Qu'il m’amène son fils. Un jour de causerie avec lui. Des paroles de vous intimes quelque direction. Ou bien le duc de Noailles ou Dumon ferait-il cela ? Mon Dieu quelqu’un à qui parler, me confier. Je suis bien malheureuse. Adieu. Adieu. Adieu. Que cette semaine en octobre a été charmante. Quel inépuisable bavardage. Quel impensable plaisir. Adieu. Vous connaissez le mot de Thiers pour chez vous. J’aime la cuisine. Je n’aime pas le cuisinier. Je ne conçois pas que ma lettre du 6 à Morny soit resté sans réponse.
6 heures
Il est peu utile, il est même dangereux de se plaindre. mais comment ne pas me plaindre au fond du cœur de la publicité donnée à tout cela lorsque M. savait à quel point je tenais au secret. Cela devait rester entre lui l’Empereur et moi. Au lieu de cela, voyez ? Quand on m'en parle, je nie que j'ai fait une démarche. Bavardage provenu de ce que je parle de mon ardent désir d’aller à Paris et que je l'écris à tout le monde. Je vous écris à toutes les heures. J’ai la fièvre. Ah si vous étiez au Val Richer comme je me soucierais que de Paris. Adieu. Adieu.
Il me semble entrevoir dans vos lettres que vous avez peu d'espoir. Au fond je ne comprends pas l’Empereur. C’est montrer trop sa subs[?] à l'Angleterre. Je lui croyais plus d'orgueil que cela. Moi à Paris qu’est-ce que je puis faire. Ne suis je pas en son pouvoir ? Enfin je ne comprends pas. Encore et toujours Adieu.
8 heures Encore un mot. Je vous ai parlé ce matin de Montebello. Il est excellent et peut être très utile. Il voit souvent Fould, ils ont souvent parlé de moi depuis mon départ. Son amitié & son témoignage ont une grande valeur parce qu'il est plein d'innocence et de sincérité. On l’aime là. Il pourrait dire bien des choses qui me seraient très utiles car j’ai toujours causé bien librement avec lui. Mettez-le au fait et je parie qu’il trouvera moyen de me servir.
Mots-clés : Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Correspondance, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Enfants (Guizot), Femme (diplomatie), Femme (maternité), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (Russie), Réseau social et politique
187. Lisieux, Samedi 2 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je prends mes précautions aujourd’hui pour vous dire quelques mots. Demain à 8 heures du matin, il faut que je sois à mon collège dont je viens d'être nommé Président à l'unanimité, moins ma propre voix. J’y passerai la matinée. Une fois élu je remercierai les électeurs. Après mon speech, les visites de corps, une sérénade, un banquet. Je ne disposerai pas de cinq minutes. Encore si c'était fini, si je pouvais partir sur le champ ! Mais restera le dîner du lundi. Vous m'écrirez encore un mot lundi matin, n’est-ce pas, pour que mon mardi ne soit pas vide. Onze heures Un flux d’électeurs m'est arrivé comme je vous écrivais. Ma soirée en a été remplie. Je reviens me coucher. Vous m’avez souvent parlé de la vie précipitée de votre cour impériale ; toujours aller, venir, s'habiller, recevoir, être reçu, pas un mouvement libre, pas une minute à soi. Mon souverain d'ici en exige autant ; seulement il ne dure que huit jours. Adieu. Je vais me coucher. Quelle pitié de ne vous envoyer pour demain que mon propre ennui ! J'en ai le cœur serré. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Mandat local
187. Paris, Samedi 2 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mercredi seulement. Que c’est long ! je m'afflige, mais je ne me plains pas. Je ne suis pas inquiète comme vous le dites. Mais cela me fait beaucoup de peine. Cela vous ne vous en plaindrez pas ? Oui le 4 ! C’est horrible, mais je ne puis ni en parler ni en écrire.
J’ai eu une lettre de Paul hier. L’Empereur a envoyé de suite à Londres le comte Strogonnoff pour remplacer mon fils pendant le voyage qu'il va faire en Russie. Il lui enjoint de venir de suite attendu qu’'il désire le voir. Paul ne veut pas aller dans ce moment, sa santé ne va pas à un voyage rapide dans la rude saison. Il ira dans quatre semaines on trouvera cela étrange, il fallait courir ventre à terre dès le lendemain ! Voilà comme on est chez nous. J’ai eu ma lettre de mon frère ce matin ; il avait reçu mes deux lettres. Celle de reproche et l’autre écrite après la mort de mon mari. La sienne contient que des hélas et des reproches sur ce que je ne veux pas vivre en Russie. Voici le lieu de lui dire une fois pour toutes pourquoi je n’y veux pas vivre et que je n’y retournerai jamais. Je vous montrerai cette lettre, je ne l’enverrai qu'après vous l’avoir lue.
J’ai vu hier matin chez moi la comtesse Appony. J’ai fait le plus agréable dîner possible chez Lady William Bentinck, elle, son mari et Lord Harry Vane, voilà tout. Très anglais, très confortable, j’ai eu presque de la gaieté. Le soir chez moi, mon ambassadeur, celui d’Autriche, Fagel, M. de Stackelberg & le Prince Waisensky. Don Carlos a retiré sa proclamation contre Maroto. Après l’avoir déclaré traître, il approuve tous ses actes, lui rend le commandement. Enfin, c’est une confusion plus grande que jamais, et mes ambassadeurs disent que ce qu'il y a de mieux à faire est d’abandonner complètement Don Carlos et le principe. Les princes gâtent le principe.
Lord Everington vient d'être nommé vice roi d’Irlande, c'est un très grand radical, un homme d’esprit, membre distingué de la chambre basse, et très grand seigneur quand son père Lord Forteseme mourra. Je vous conterai comment un jour il est resté caché pendant deux heures dans les rideaux de mon lit ! J’ajoute, puisque vous êtes si loin ; que c’est mon mari qui l'y avait caché. Vous feriez d’étranges spéculations si je ne vous disais pas cela. Et ce n’était pas cache cache.
Le petit copiste est venu. Il a commencé aujourd’hui. Cela va très bien. Les ambassadeurs avaient vu M. Molé hier. Les nouvelles sur les élections sont d’heure en heure meilleures pour les ministres. Vous avez bien fait de n'être pas allé à Rouen, mais vous faites très mal d'avoir du rhumatisme. Je vous le disais lorsque vous êtes parti, j’étais sure que vous alliez prendre froid. Faites-vous bien frotter au moins Adieu. Adieu, il faut donc encore écrire demain et lundi. What a bore ! Adieu. Adieu.
187. Val Richer, Dimanche 29 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
L'ordre du jour de Lord Raglan sur les médecins de son armée est bien rude, et certainement bien mérité. On ne donne pas de telles leçons à son propre monde sans une nécessité absolue. Mais il est beau de les donner. Evidemment l’armée anglaise a souffert et souffre encore beaucoup. Quant au siège même le rapport de Canrobert du 13 suffit pour prouver qu’il est difficile, et qu’il sera long. Rien n’est sûr et tout est possible. Mais je ne me lasse pas de redire que vous êtes en présence d’une obstination au moins égale à la vôtre.
Je suis bien aise que l’amiral Bruat se fasse honneur. C’est un homme d’une intelligence et d’un courage rares. Il m’a très bien secondé dans l'affaire la plus difficile, et la plus ennuyeuse que j’ai eue, celle de Taïti. C'est à lui, militairement, comme à moi politiquement, que la France doit d'avoir conservé cette possession à laquelle la Californie, l’Australie, la Chine et le Japon ouverts donnent chaque jour plus de valeur.
J'admire la promptitude de vos nouvelles, mais je ne m'accoutume pas à la lenteur des nôtres ; je ne comprends pas qu’on n'ait pas organisé un service de bateaux et d'estafettes pour faire arriver les rapports de Balaklava à Vienne aussi vite que vos courriers vont de Sébastopol à Moscou. Il est assez naturel que nos généraux en Crimée n’y pensent pas toujours ; leur action est plus importante que notre information ; mais le gouvernement aurait dû régler cela dès le début et très régulièrement. Il est très intéressé à savoir et beaucoup aussi à parler. Quand la presse n’est pas libre, c’est au pouvoir à l'alimenter. Je suis très contrarié que Morny ne soit pas encore revenu à Paris.
Midi
Je trouve les dépêches du Moniteur obscures ; elles en disent plus en un sens que le Prince Mentchikoff n’en a avoué moins dans un autre sens ; elles détruisent plus de fortifications et moins d'hommes. Du reste, je vois qu’on vient d'organiser un service pour que nous ayons des nouvelles directes tous les deux jours. Il est bien ridicule qu’on ait attendu jusqu'à aujourd’hui. Adieu, Adieu. G.
188. Bruxelles, Mercredi 13 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Comment n'avez-vous pas eu ma lettre du 11. J'écris tous les jours. J'écris aujourd’hui à Montebello et je le prie d’aller vous voir. Dites-lui de montrer ma lettre à F. Il va chez lui souvent, il pourrait bien y aller à mon intention. Il y a là tout ce qu'il faut. Je passe régulièrement deux nuits de suite sans sommeil c.a. d. Trois heures tout au plus. La troisième nuit 6 h. de sommeil, c’est réglé. Imaginez ce qu'on devient à un pareil régime.
J’attends la poste. Votre lettre y est toujours, que Dieu vous en récompense. Mais M. pas un mot. Mon Dieu, on est donc sans pitié et sans souvenir. Lord Howard dit que l'Angleterre va voir en Crimée 55 m hommes, qu’elle en mettra plus s'il le faut. Il faut Sébastopol, à Londres, à Paris, c’est résolu. Si j’étais l’Emp. Nicolas, je laisserais prendre pour que cela finisse. On devient féroce à Londres, la poste n’accepte plus de lettre à l’adresse de St Pétersbourg. Ce que je vous ai dit de Mme Kalerdgi me parait vrai, quoique les Crept. nient. La source des informations est bonne. En tous cas samedi elle quitte Paris.
Adieu bien vite, on m'interrompt.
188. Lisieux, Lundi 4 mars 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est aujourd’hui que je ne puis vous écrire qu’un mot au milieu de trente visites. Ma Chambre ne désemplit pas. J’ai eu un succès complet, comme il me convenait. Les Républicains et les Carlistes se sont abstenus. Et j’ai eu presque l'unanimité, 477 voix sur 525, c'est-à-dire 156 voix de plus qu’à ma dernière élection, et 67 voix de plus que dans l’élection où j'en avais le plus obtenu. Le pays est charmé de moi, & moi de lui. Vous verrez dans les journaux ce que je leur ai dit après l'élection. Toute la population m’a suivi dans les rues jusqu'à ma porte. On ne me dira plus que je ne suis pas populaire du moins jusqu’à ce que j’y aie mis ordre moi-même. Tout va assez bien autour de moi. Je ne connais encore que 8 élections. Le Ministère y a déjà perdu 2 voix, et nous point. J’en saurai davantage mercredi matin, car je pars demain bien décidément, & je vous verrai mercredi.
J’espère que le retard de Paul n'aura pas pour lui de suite fâcheuse. Mais à sa place je serais parti sur le champ. J'estime trop l'indépendance pour la mettre à toute sauce. Nous causerons de tout cela Mercredi. Farewell, farewell fom the deepest of my heart !
Mots-clés : Elections (France), Enfants (Benckendorff), Mandat local
188. Paris, Dimanche 3 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Que votre lettre est belle, sublime ! J'aime à la lire un dimanche. Je l'ai lue trois fois, je la relirai encore. Quel homme ! Soyez sûr que je sens tout, et je veux croire ce que vous croyez.
Je n'ai rien à vous dire sur ma journée d’hier. Le bois de Boulogne et une visite à Mad. de Stackelberg qui vient de perdre son père. uns autre visite à la petite Princesse que je n’avais pas vu depuis 6 semaines. Je l’ai trouvée encore dans son lit et fort changée. Mon triste dîner avec Marie. Le soir mon ambassadeur, son frère. L’ambassadeur de Sardaigne, et Aston. Les diplomates venaient de chez M. Molé. Il était en fort grande assurance pour les élections de Paris. Du reste point de nouvelles. Vous ai je dit que M. Ellice va arriver ?
J'ai beaucoup à écrire aujourd’hui Pahlen me fait peur au sujet de la résolution de Paul de ne pas obéir de suite. Je lui en écris, & je lui envoie deux lettres pour mon frère, il choisira celle qui conviendra le mieux à la résolution qu’il aura prise, et aux motifs qu’il aura donnés, voilà un nouveau sujet d’inquiétude. On sera très fâché à Pétersbourg quoi que je puisse dire. Je vais dîner chez Lady Granville, aujourd’hui. Je repasse dans ce moment toutes les lettres de mon mari ; j'ai besoin d’y retrouver quelques indications sur les affaires de mon fils, et en les relisant je m’arrête avec joie, avec peine, sur chaque mot presque. Il y avait encore alors tant de bons sentiments entre nous ! Ah mon Dieu ! Adieu. Adieu.
Je ne vous dirai plus adieu que demain. J’espère que vous m'annoncerez ce soir votre élection. Adieu. God bless you.
188. Val Richer, Mardi 31 octobre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait le plus magnifique temps qui se puisse voir clair comme en Août doux comme en septembre. J’ai passé presque toute ma journée dans mon jardin. Ce serait charmant, si ce n'était pas les derniers beaux jours. Autrefois, l'hiver avait aussi son charme. Dieu veuille qu’il le retrouve !
La correspondance de nos généraux, Français et Anglais, ne me plaît pas. Je la trouve vague, molle, écourtée, sans caractère. Les vôtres mentent effrontément ; les nôtres ont l’air de ne savoir que dire. Je suis convaincu qu’au jour de l'action, ils feront leur devoir, et qu’ils le feront avec intelligence ; mais il n’y a évidemment là, ni une idée arrêtée, ni une volonté maîtresse. Bizarre contraste jamais guerre n'a été plus factice, plus engagée par le seul fait des hommes et de leurs démarches, bien ou mal conçues ; et l'événement une fois en train, ces hommes, qui l’ont lancé, se trainent à sa suite, languissamment, à tâtons, comme s’ils n'avaient rien prévu et préparé dans ce que seuls, ils ont décidé. On peut être mal informé et point prêt quand on est pris au dépourvu par quelque brusque et impérieuse nécessité mais il faut mieux savoir et diriger d'avantage, ce qu’on a soi-même amené ! Avez-vous quelque idée sur ce qu’il y a de vrai dans ce qu’on dit de l'activité de votre travail aux Etats-Unis et de ses effets ? On prétend que l'opinion américaine, qui vous était très hostile au commencement de cette guerre, tourne en votre faveur, grâce à vos efforts diplomatiques, financiers, commerciaux. Je ne vois pas ce changement dans le peu qui me revient des journaux américains. Mais certainement, si la guerre se prolonge, elle amènera des transformations, et des complications inattendues. La plus grave de toutes serait celle qui amènerait l’Amérique à prendre parti dans des questions purement Européennes, comme celle-ci.
En fait d’Amérique, je ne lisais pas reste ; mais vous me le ferez lire. Mes filles qui ont lu l'original disent comme vous que c’est plein d’intérêt, et charmant par le naturel, mais bien long. Lisez vous vous-même, ou Mlle de Cerini commence-t-elle à vous lire ? Je le voudrais bien. J’ai beaucoup dit à Mme de Seebach qu’elle devait s'y appliquer, car c'était là sa principale utilité.
Midi et demie
Mon facteur est pressé. J’ai à peine jeté un coup d’œil sur mes journaux. Ils ne disent pas grand chose ; mais mon impression, en les lisant, est d'accord avec ce que vous me mandez ; il n’y a pas de grands renforts et Sébastopol sera pris. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Correspondance, Femme (éducation), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Lecture, Littérature, Parcs et Jardins, Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Etats-Unis), Politique (France), Politique (Russie), Presse
189. Bruxelles, Mercredi 13 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ai envoyé mon 187 par occasion, le comte Caroly. En voici une autre. J'écris quoique je n'ai rien à dire qu’un nouveau sujet d'angoisse. L’Impératrice est très mal. Elle était très mal avant hier. Si j’ai le malheur de la perdre voilà mon dernier lien avec la Russie rompu ?
Que va devenir l’Empereur, je ne puis pas me figurer sa situation, & dans quel moment !
Le ministre d’Autriche qui est venu me voir ce matin est encore plein d'espérance de la paix. Le 28 Nov.; nous avons adhéré par note aux quatre points simplement formellement. Le 30 Bual exprime par note au Prince Gortchakoff la vive satisfaction de son maître. Le 2 on signe le fameux. traité exige dit-on très rudement par Bourqueney & Westemorland. Bual nous déclare que c’est dans le but de rendre la paix plus facile. Trouverons-nous cela ? Dans les préliminaires qui ont dû nous être envoyé, Sébastopol ne sera pas mentionné. L'Angleterre dit-on est fort désireuse de la paix. Je ne crois pas trop. La Prusse va être forcée de se décider. Adieu. Je n’ai rien de nouveau sur mon compte. Mon découragement s’arcroit tous les jours. God bless you. Adieu. 8 heures du soir.
189. Paris, Lundi 4 Mars 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’étais réveillée à 6 heures ce matin, comme il m'arrive toujours de l’être à pareil jour. Quatre ans ! Ah mon Dieu, c’est hier. Et en même temps il me semble que j’ai vécu cent ans depuis, tant la douleur m'a usée. Et puis il me semble qu'on m’attend, et que je tarde bien !
J’ai eu votre petit mot d'avant hier, encore ; je ne saurai donc votre élection que demain. lci je n’ai rien appris. Je n’ai en effet vu personne hier que Lord Granvillle à dîner. Nous avons plus parlé d'Angleterre que de France. Lord Lyndhurst veut faire révoquer la nomination de Lord Erington. Si la motion passe. Ce sera bien embarrassant. Le duc de Wellington a été mal décidément. Il est mieux, mais on ne veut pas qu’il aille à la Chambre ; il en résultera que Lord Lyndhurst sera le véritable chef de parti, et il y mettra plus de vigueur. Lord Brougham l’excite et le soutient.
Voici un petit billet de Henriette et un plus long billet de Madame. de Meulan pour m'annoncer votre élection. dont je me réjouis fort. Il me parait que cela a été triomphant. Je vous en félicite. Je viens de répondre aux deux billets. J’ai écrit huit pages à Paul et quatre énormes pages à Alexandre, à celui-ci pour m'opposer au mariage, car on en parle à Paul pour lui envoyer des extraits de vieilles lettres qui jettent quelque jour sur ses affaires. Adieu. Adieu. Dieu merci le dernier adieu. Mercredi midi n’est-ce pas ? Ever your's.
189. Val Richer, Mercredi 1er novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’était le mois de Novembre qui nous réunissait. J’y entre avec un sentiment très perplexe.
J’ai eu hier plusieurs visites. Tout le monde croit à la prise prochaine de Sébastopol. Je n’ai jamais vu un si singulier. mélange de doute et de confiance. On ne croit à rien de ce que disent les journaux, même officiels on s'étonne qu’ils n’en disent pas davantage, mais on compte sur le succès. On y compte surtout, passez-moi de vous le dire crument, parce qu’on a cessé de croire en vous dans votre force et dans votre habileté. C'est là, dans notre public, le fait nouveau et important. Fait qui aura certainement beaucoup d'influence sur l'avenir, une influence probablement très exagérée. On s'étonnera quelque jour de vous trouver plus forts qu’on ne vous aura crus, comme On s'étonne aujourd’hui de vous trouver plus faibles qu’on ne croyait.
Le Journal des Débats donnait hier deux dépêches de Pétersbourg et de Berlin (26 Août et 5 sept) que je n’avais pas encore lues. Je suis accoutumé au Style allemand, de dépêches ou de livres ; mais que dites-vous de cette phrase Prussienne : " Nous ne revendiquons pas aux quatre points que la Russie vient de refuser comme base de négociation le monopole d'être exclusivement propres à remplir ce but ; mais nous contenons, en en détachant, l'écorce d’une susceptibilité à laquelle nous ne contestons pas d'être naturelle à y trouver un noyau appelé à reparaître, tôt ou tard, avec telle ou telle modification, comme base de l’arrangement qui assurera à l'Europe les bienfaits de la paix. Le traducteur français est sans doute pour beaucoup dans cette phrase ; mais ce n’est certainement pas lui qui a inventé l'écorce, et le noyau.
Les élections Espagnoles ont à ce qu’on assure, trompé l’attente des révolutionnaires, et pour peu que le ministère veuille résister, il trouvera, dans les Cortés qui s’approchent, un point d’appui. Cela calmera peut-être les désirs d'abdication de la Reine Isabelle. Autrefois, il n’y avait que les grands hommes qui abdiquassent aujourd’hui, c’est une fantaisie qui prend aux plus médiocres. La lassitude et la peur dominent. Notre temps est un temps de mécomptes, mécomptes pour les honnêtes gens, mécomptes pour les coquins. Est-ce un pas vers la décadence ou vers la sagesse ?
Onze heures
Je dis comme ce pauvre de mousseaux de Givré qui ne dit plus rien, car il est mort du choléra : " rien, rien, rien ! " ; mais toujours Adieu, adieu, et adieu. G. G.
190. Bruxelles, Vendredi 15 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici ce qui fait suite aux notes du 28 & 30 Nov. Autre Gortchakoff et Bual dont je vous ai parlé. Lorsqu’est survenu le traité d’alliance signé le 2 Xbre Gortchakoff est allé exprimer au Cte Bual son profond étonnement.
Il a été vif et a fini par demander ses passeports. A quoi Bual, lui a répondu : demandez plutôt des pleins pouvoirs, car nous allons négocier. Ceci m’a été dit en confidence mais vous pouvez tenir pour certain d’autres côtés tout en confiance dans l’idée que la paix ne dépend que de l’Empereur et qu'on ne la lui rendra pas trop dure.
10 heures. Voilà votre lettre avant tout, que je vous félicite du petit garçon. Félicitez votre fille de ma part. Je m’associe bien à toutes les joies de famille. Vous n'oubliez pas que Hatzfeld à demain une occasion de me faire passer des livres.
Lord Howard vient me voir souvent. Il connait les heures de tête à tête. Je suis très contente de lui. Vraiment l’idée de la paix possible. Toute l’apparence belliqueuse est nécessaire pour inspirer confiance & flatter. La passion populaire. On en sera plus libre d'aboutir à la paix. Je crois donc moi à la sincérité du [gouvernement] Anglais dans ce but. Mais là on doute de la nôtre. On a tort. L'Empereur désire la paix ardemment, et la maladie mortelle de sa femme doit bien augmenter le désir. Il y avait quelque mieux avant hier. C’est toujours ses inquiétudes pour ses fils, mais comment les rappeler tant qu'on se bat ?
Pas un mot de M. Mes souffrances & mon chagrin augmentent. Adieu. Adieu.
190. Paris, Dimanche 2 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne veux pas vous dire ma tristesse, je ne vous l’exprimerai jamais comme elle est et vous n'avez pas besoin de mes paroles pas dessus mes larmes. J’ai vu hier matin Bulwer, dont Je suis contente. Il fera ainsi que Cumming tout ce qu’il est possible de faire. J’ai vu mon ambassadeur que je verrai encore aujourd'hui et puis j’ai vu Zéa qui est tout rempli de vous et de reconnaissance pour moi du bien que je vous ai dit de lui. Il part pour Londres aujourd'hui et finira par Bade après être revenu vous voir à Paris. J’ai dîné chez Mad. de Talleyrand seule. Elle est fort souffrante, fort bonne pour moi. Elle m’a parlé de vous sans me parler de votre lettre comme de raison. Elle part à onze heures et moi à 9. Je l'attendrai à Sézanne et puis nous verrons. J'ai passé le soir chez Lady Granville. Son mari est malade, j'y dîne aujourd'hui. Je me suis couché à 10 heures. J’ai peu et mal dormi. Vous savez ce qui m'a occupé - ce qui m'occupera toute ma vie mais ce qui devrait me laisser dormir. J'espère que vous ne vous trompez pas pour ma nuit dernière. Je suis excédée de fatigue, je voudrais être partie. Adieu. Adieu. Je pense à vous sans cesse plus que je n’y ai jamais pensé. Dites moi que nous nous reverrons. Adieu.
190. Val-Richer, Lundi 3 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Du Val-Richer, lundi 3 Juin 1839 7 heures
Je me lève excédé. J’étais dans mon lit hier à 9 heures Je suis arrivé ici par une pluie noire, par une route point terminée, pleine de pierres et d'eau où ma calèche s’est brisée. Il a fallu mettre ma mère et mes enfants dans la cariole des gens. Personne n’a eu de mal. Cette nuit, j’ai été mahométan, muphti même, chargé de marier Thiers. Je me suis fait attendre à la mosquée. J'étais occupé à chercher quelqu’un je ne sais qui ; mais je ne trouvais pas, et je cherchais toujours. Ma nuit a été presque aussi fatigante que ma journée.
Je n’ai jamais été plus triste de vous quitter. Certainement nous nous reverrons. Mais nous n'avons jamais été trois mois sans nous voir. Je suis pourtant bien d'avis de ce voyage. Vous en avez besoin. Revenez fraîche et forte. Je ne vous aimerai pas mieux ; vous ne me plairez pas davantage ; mais je serai plus content.
Pour aujourd’hui, je n’ai point de nouvelles. Je ne pourrais vous en donner que de mes arbres, qui vont bien, sauf un oranger mort. C'est dommage que je n'aie pas beaucoup d’argent à dépenser ici. J’en ferais un lieu charmant, en dedans et en dehors de la maison. Mais décidément l'argent me manque. Ma consolation c'est de pouvoir me dire que je l’ai voulu. Cela ne consolait pas George Dandin. Je suis plus heureux que lui.
Le petit manuscrit de Sir Hudson Lowe est très intéressant. Si vous vous le rappelez, il va singulièrement à la situation de ce moment-ci, entre la Russie, la France et l'Angleterre en face de l'Empire Ottoman, seulement les conclusions, je dis les bonnes conclusions ne sont pas les mêmes.
Du reste, en général, dans les évènements comme dans les personnes, les ressemblances sont à la surface et les différences au fond. Il n'y a point de vraies ressemblances. Chaque chose a sa nature, et son moment, qui n’est la nature ni le moment d’aucune autre. Quel dommage que la question révolutionnaire complique et embarrasse toutes les politiques ?
Comme nous arrangerions bien les affaires d'Orient, vous et moi, si nous n'avions pas moi la manie et vous l’horreur des révolutions ! Essayons, madame, de nous corriger un peu, l'un et l'autre.
9 heures 1/4 Voilà votre lettre. Je l'espérais sans y compter Et je la trouve charmante, toute triste qu'elle est, ou mieux parce que triste. Décidément, je suis voué au parce que. Oui, soyez triste, mais triste d’une seule chose. Qu’il ne vous vienne plus de tristesse d'ailleurs. Que tout vous soit doux, sauf notre séparation. Portez-vous mieux, engraissez et nous nous reverrons. Adieu, adieu. G.
190. Val Richer, Jeudi 2 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne comptais pas vous écrire aujourd’hui ; mais je veux vous dire qu’on a reçu à Paris, du 25, des nouvelles contradictoires, l’une celle des lignes anglaises, forcées et de leur cavalerie abîmée par le général Liprandi arrivé tout récemment avec son corps d’armée ; l'autre que ce même jour, 25 oct. les alliés ont fait, sur Sébastopol une grosse attaque qui a mis la place à bout de résistance. On m'écrit les deux choses ; mais je ne trouve rien du tout dans le Moniteur, et les feuilles d’Havas ne donnent que la première nouvelle la mauvaise pour nous, ce qui me fait craindre qu’elle ne soit la seule vraie. Entre le mensonge et le silence, la vérité est difficile à reconnaître. Il faut attendre. On commence évidemment à être très préoccupé des lenteurs du siège. L'alimentation des armées alliées est une grosse affaire. Il arrive tous les jours à Balaklava, 31 navires chargés, uniquement à cette intention. Il ne faudrait pas que le temps devint trop mauvais.
L’Evêque d'Orléans, sera reçu à l’Académie d’aujourd’hui, en huit jours, le 9. Il l'a demandé afin de pouvoir partir pour Rome, où il est appelé pour décréter l'immaculée conception de la Vierge.
Mlle Rachel (quel nom à mettre après ce que je viens de dire !) ne veut pas jouer Médée. Elle va en appeler du jugement du tribunal. Elle compte beaucoup, sur la protection de M. Fould.
Il y a du malheur sur les familles de mes amis. Ce pauvre Villemain à sa fille aînée, 19 ans, mourante de la poitrine. Il y a de quoi lui rendre la folie. Adieu, Adieu.
Ne soyez pas malade. Vos indispositions sont en général assez simples ; mais votre force n’est pas grande. Il vous faut un bon climat, une vie monotone. du repos d’esprit et Andral. Adieu. G. Ce que vous me dites de l’Autriche et de M. Bach est d'accord avec toutes mes conjectures. Les souverains absolus sont absolument imprévoyants ; pour se débarrasser de l’aristocratie qui les gène, ils grandissent à ses dépens, la démocratie qui les renversera après les avoir servis. S'ils avaient de l’esprit et du courage, ils feraient, à l’aristocratie comme à la démocratie, leur part dans le gouvernement, et les garderaient soigneusement toutes deux pour les limiter et les contenir l’une par l'autre. Mais qui est ce qui a la sagesse de demain ? Adieu encore.
191. Bruxelles, Samedi 16 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
On entre ici dans la saison des dîners, ce qui me prive. de la seule ressource que j'avais le soir, van Praet Il ne sort de là qu'à 10 h. C’est trop tard pour moi. Je ne sais plus que devenir.
Je fais la patience, je tricote ! Quel emploi de mon temps ! Je ne peux pas Cerini ne sait pas lire. Auguste lit quelques lire. fois. N'avez-vous pas pitié de moi ?
Et en hiver, et à l’auberge, et dans cette époque si abondante en événements dont le plus petit aurait défrayé la conversation de mon salon pendant la semaine, n’avoir personne quel exil pour mon esprit.
L’Impératrice va décidement mieux. Je le sais par le télégraphe de Berlin que j'ai fait interroger ce Comme je n’ai matin. pas répondu un mot à la lettre menaçante de mon neveu, il a cessé de m'écrire. Je ne saurai des détails de l’Impératrice que par Meyendorff. On me dit que la Prusse ne se pressera pas d’adhérer au traité du 2 Xbre. Elle a tort, d'autant plus qu'il faudra bien qu’elle y passe. Je trouve les remarques des Débats sur le discours de Lord John très juste. Adieu, toujours avec tristesse, plus que jamais avec tendresse. Adieu.
Tous mes N° sont ils exactement rentrés ?
191. Sézanne, Lundi 3 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous voulez savoir de mes nouvelles. J’ai cheminé tristement, bien tristement. Mais me voici. Je vais dîner, je fais comme à Boulogne je vous prends avant mon dîné et j'ai bien faim. J'ai beaucoup de choses à vous dire ; je ne vous les dirai que de Baden, de très mauvaises nouvelles de mes affaires. C'est de mal en pire en Courlande rien rien du tout. Il me semble que lorsque on saura cela, il est difficile qu'on en fasse pas quelque chose. Comment vont se conduire mes fils ? Voulez- vous que je vous le dise ? Mon inquiétude porte sur l’opinion qu’ils vont donner d’eux ! Adieu. Adieu que ce sera long, long, triste. Je pense à vous sans cesse. Oubliez la calèche. Je reviendrai riche ou pauvre. Mon orgueil s'abaisse devant mon amour. Adieu. Je suis morte de fatigue mais adieu mille fois.
191. Val-Richer, Mardi 4 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous voudrais comme ma vallée, fraiche et riante. Je la regarde avec envie en pensant à vous. Et bientôt je ne la regarde plus ; je ne pense plus qu'à vous. Je vous vois maigre, triste, desponding, en larmes. Et pourtant je ne retourne pas à ma vallée ; je reste avec vous. Je resterai toujours avec vous.
L’annulation de l'élection de M. d’Houdetot, réélu à si grand'peine, est un petit incident fort désagréable au château. On en a été très piqué. Il ne faut pas avoir tort en face de ses ennemis Mr d’Houdetot avait tort. C’est l'erreur des gens de cour, puisque cour y a, de croire qu'ailleurs aussi, ils auront le privilège de la faveur. Il y a des favoris partout, mais non partout les mêmes. Les esprits impartiaux, les honnêtes gens ont voté contre M. d’Houderot. Le pire, c’est qu’il ne peut plus se représenter puisqu’il n’est pas éligible. Le choix tombera probablement sur un homme de l'opposition.
Il paraît que le procès aura lieu décidément vers le milieu de Juin. On le presse ; on ne veut pas que, s’il doit y avoir des exécutions, elles soient trop voisines des fêtes de Juillet ; et très probablement il y en aura. L'assassinat est prouvé, dit-on, contre deux des accusés, et des principaux. L’un, le nommé Barbès a tué de sa main l'officier qui commandait le poste du Palais de justice, l'autre Milon, Miron, je ne sais pas bien, a fait fusiller trois soldats, après avoir enlevé un corps de garde. Plusieurs témoins les reconnaissent.
Après les fêtes de Juillet, le Roi veut aller à Bordeaux. Il a formé plusieurs fois ce projet. Je doute qu'il l'exécute encore. Cependant il le promet. Bordeaux le demande beaucoup, et comme une réparation. Ils disent que jamais Roi ou Empereur ne les a laissés neuf ans sans aller les voir. Le Maréchal Vallée avait demandé plusieurs fois à être rappelé. On s'est montré disposé à le lui accorder. On lui aurait donné le Général Cubieres pour successeur. Il ne s'en est plus soucié, et il reste. J’en suis bien aise. A travers toutes les manies d’un esprit systématique et d’un caractère insociable, c’est un homme honnête, capable et prudent. Qualités dont notre établissement d'Afrique à grand besoin. Je m'intéresse à cet établissement. Je m’en suis beaucoup mêlé.
Mon sac est vidé, madame. Bien petit sac cette fois, et probablement souvent jusqu'à ce que je retourne à Paris. On ne m'écrit guères les petites choses, et il n’y en a pas de grandes. Vous n’avez probablement jamais ouvert un livre intitulé : Historiettes de Tallemant des Réaux. C'était un abbé du 17e siècle qui écrivait tous les soirs tout ce qu’il avait entendu dire sur toutes les personnes dont tout le monde parlait. Il a écrit ainsi six gros volumes curieux et amusants, quoique pleins d'énormes sottises. Quelqu'un de votre connaissance, mon Génie, se donne le même plaisir sur notre temps. Il laissera des volumes beaucoup plus convenables, j’en suis sûr que ceux de l'abbé Tallemant, et peut-être assez piquants. On oublie beaucoup trop en ce monde. En attendant de vraies nouvelles d'Orient, j’ai apporté ici et je lisais tout à l'heure l'ouvrage de M. Urquhart de la Turquie et de ses ressources. Savez-vous au juste quel cas on fait à Londres de l'auteur ? Le livre me semble bien vide, avec de grandes prétentions.
Adieu pour aujourd'hui. Je vous quitte pour aller assister à des plantations de fleurs ; je devrais dire coopérer. Je transporte le jardin du Roi au Val-Richer. Je mentirais si je disais que cela ne m'amuse pas du tout ; et je mentirais bien davantage si je disais que cela m'intéresse vraiment. On peut vivre superficiellement ; mais il n'y a pas moyen de s’y tromper. Pour moi, je n'y prétends pas.
Mercredi 7 heures Depuis que je ne vous vois plus, ma perplexité est extrême. Je suis bien plus inquiet ; j'ai besoin que vous me rassuriez, et j'hésite à vous le demander, à vous occuper de votre santé. Convenons d'une chose ; c’est que vous me direz tout, absolument tout ; je n'ignorerai aucun détail, ni aucune de vos inquiétudes. Ce sera comme si je vous voyais, sauf le plaisir de vous voir. A cette condition, je ne vous agiterai pas, de mon tourment. J’attends presque avec humeur le moment où j’attendrai vos lettres à jour fixe. En aurai-je ? N'en aurai-je pas ? Cette ignorance m'est insupportable. J’en ai encore pour huit jours avant que vous vous soyiez posée, que je le sache du moins et que jen éprouve l'effet. Où êtes-vous en ce moment ? à Vitry, je pense. Vous vous levez. Vous allez partir pour Nancy. J’ai fait cette route-là, il y a douze ans, le cœur bien déchiré. Je conduisais à Plombières ma femme mourante.
Que notre âme est étrange, & tout ce qui s’y passe dans le cours de la vie ! Quels contrastes, quels désaccords, impossibles à concevoir ensemble, et qui coexistent pourtant & s'effacent et disparaissent dans cette mer du temps qui couvre de son uniformité tout ce qu'elle engloutit Adieu. Adieu.
9 heures. Voilà le facteur, et deux lettres de Paris qui ne m’apportent rien à vous envoyer. Adieu encore.
191. Val Richer, Samedi 4 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il paraît que vous dites vous mêmes à Pétersbourg, que les nouvelles du 25 du Prince Mentchikoff, annonçant un grand succès contre les Anglais, étaient fausses. Le Moniteur donne sous la même date des nouvelles très contraires, et bien cruelles pour l’intérieur de Sébastopol. Je suppose que l’amiral Hachimoff, que nous tuons aujourd’hui, n'est autre que l’amiral Kormiloff que vous avez tué, il y a quelques jours. Vos deux amiraux à la fois, ce serait trop. Quand viendra la fin de cette boucherie ?
Il serait curieux que la mission de M. de Beust et von der Pforten à Berlin aboutît à une dépêche Prussienne dure pour vous à force d’insistance pour vous rendre plus traitables. Je trouve cela dans mes journaux d’hier, et je n'en serais pas étonné. Les petits Allemands vous demandent de les tirer d’embarras par la complaisance, comme vous les en tiriez jadis par la force. Si vous ne les en tirez, ni d’une façon, ni de l'autre, ils s'en prendront à vous de leurs embarras.
Je suis porté à croire que cette concession des chemins de fer autrichiens à une compagnie Française est comme on le dit, une grosse affaire qui influera beaucoup sur les relations des deux Etats. Regardez-y bien ; quoiqu’on en ait souvent et sottement abusé, le mot civilisation n’est pas un mot vague, ni vain ; il y a, sous ce mot, une foule d’intérêts puissants qui deviennent aisément des liens puissants entre les peuples. Puissants par le bien être et par l'orgueil qu’ils satisfont également. Le goût commun et l'état semblable de la civilisation jouent, dans l'alliance Anglo-française, un plus grand rôle qu’on ne pense.
Jusqu’où les Etats-Unis feront-ils du bruit pour l'affront fait à M. Soulé ? J'en suis assez curieux. Je ne pense pas que cela aille bien loin. Au fait le gouvernement ici a eu raison ; les origines et l’ancienne vie de M. Soulé, et son affaire à Madrid, avec M. Turgot, et toutes ses allures méritaient cela. Les gouvernements ne doivent être ni susceptibles, ni insensibles aux injures.
Autre petite curiosité ; la Reine Isabelle, ouvrira-t-elle elle-même les Cortés ? Si elle ne le fait pas, cela donnera un grand élan au parti révolutionnaire dans cette assemblée ; l'absence sera une demi abdication. Si elle paraît en personne il n’y aura plus d'abdication du tout. J’ai peine à croire que l’Espagne tente la république.
Midi
Tout cela me paraît très obscur. Rien de plus ennuyeux que le mensonge. Ma conclusion est que les Anglais ont reçu un assez grave échec et que le siège continue avec les mêmes chances. Adieu, Adieu. G.
192. Bruxelles, Dimanche 17 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai reçu votre lettre d’hier. Je n’avais pas dormi cette nuit, & je suis trop triste, pour vous écrire. La démarche directe pour n’obtenir qu'un demi. résultat, je ne la ferai pas. Le plus court sera de mourir cela supprimera les embarras à tout le monde. Il n'y a que vous que je plaigne, car vous m'aimez bien.
Mais moi, vous avoir si prés, et ne pas être avec vous ? Voyez-vous cela me déchire le cœur, et ma santé n’y tiendra pas. Il m’en reste si peu de santé. Pardonnez-moi de ne vous dire que cela aujourd’hui. mais ma pauvre tête n'y tient pas. Et mon coeur brise. Adieu. Adieu.
Pourquoi Montebello ne montre-t-il pas ma lettre à F. ? Cela ne peut faire aucun mal, et cela pourrait faire du bien.
192. Safnern, Mercredi 5 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai fait hier 20 postes 1/2 et je suis arrivée à Soul morte de fatigue. Madame de T. n'a rien fait pour la diminuer, au contraire, attendu que vous me croyiez en bien bonnes mains. Moi j’étais parfaitement la dupe de mes espérances. Au lieu de secours elle était un obstacle et elle a couronnée la journée en prenant un rez-de-chaussée bien commode, et m’envoyant moi 35 au second pour être bien mal. Secours moral de sa part tant que je voudrais, mais matériel non. C'est une leçon dont je profiterai. Il n’a pas été question qu’elle entre dans ma voiture, enfin rien rien que ce qui lui convenait. Vous voyez que j'ai de la rancune.
En voilà une page toute éclairée. Ici je suis seule heureusement, est bien, je vais manger et me reposer demain je serai à Baden vers les quatre heures, sauf accident. Il pleut des torrents, les routes sont gâtées. Aujourd’hui je me sens mieux et j'ai hâte de vous le dire, et de vous dire aussi que j’ai passé ma journée au Val-Richer et que j’y resterai certainement jusqu’à dimanche. Il me tarde bien d’avoir une lettre J'espère la trouver demain. Adieu, adieux et encore adieu.
192. Val-Richer, Jeudi 6 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
A mon grand étonnement, la poste n'est pas encore arrivée. Que je serais impatient si j’attendais une lettre ! Mais je n'y compte pas aujourd’hui. Je n'attends que des nouvelles. Je serais pourtant bien aise de savoir qu’il n’y en a pas de trop grosses. Le Ministre de l'intérieur m’a écrit hier. Qui sait si aujourd’hui il n’est pas aux prises avec une insurrection ? Hier, il n’était occupé que de l'humeur des 200 qui ne peuvent pardonner à M. Passy d'avoir ôté M. Bresson de l'administration des forêts pour y remettre M. Legrand, que M. Molé en avait ôté pour y mettre M. Bresson. « M. Molé, me dit-on, souffle le feu et la discorde, mais ce feu s'éteindra bientôt. Je n'en doute pas : petit souffle sur petit feu.
On me dit aussi que les lettres d'Orient sont à la paix. Je m’y attends malgré le fracas des journaux. Si le Sultan et le Pacha, l’un des deux au moins, n’ont pas le diable au corps, on leur imposera la paix. Moi aussi, je suis pour la paix. Cependant, si la guerre était supprimée de ce monde, quelques unes des plus belles vertus des hommes s'en iraient avec elle. Il leur faut, de temps en temps, de grandes choses à faire, avec de grands dangers et de grands sacrifices. La guerre seule fait les héros par milliers ; et que deviendrait le genre humain sans les héros ?
Voilà le facteur. Il n’apporte rien, ni lettres ni évènements. Tout simplement la malle poste s’est brisée en route. Elle arrivera dans quelques heures ; une estafette vient de l’annoncer. J’en suis pour mes frais d'imagination depuis ce matin. Encore une fois, si j’attendais une lettre, je ne pardonnerais pas à la malle poste de s'être brisée.
4 heures On ne sait ce qu’on dit. On a tort de ne pas espérer toujours. La malle poste est arrivée. Un de mes amis, a eu la bonne grâce de monter à cheval et de m’apporter mes lettres. En voilà une de vous, et qui en vaut cent, même de vous. Vous êtes charmante, et vous serez charmante, riche ou pauvre. J’espère bien que vous ne serez pas pauvre. Plus j’y pense, plus je tiens pour impossible que tous vos barbares, fils ou Empereur ; pardonnez-moi, s’entendent pour ne faire rien, absolument rien de ce qu’ils vous doivent. Votre orgueil n'aura pas à s'abaisser. Et puis, croyez-moi, vous n'auriez point à l'abaisser, mais tout simplement, à le déplacer, à changer vos habitudes d'orgueil. Et puis, pour dernier mot, j'accepterais l'abaissement de votre orgueil devant ce que j’aime encore mieux. Mais je ne vous veux pas à cette épreuve ; je ne veux pas des ennuis, des contrariétés qu’elle vous causerait. Vous souffrez des coups d'épingle presque autant que des coups de massue. Il faut que vos affaires s’arrangent. J'attendrai vos détails, avec une désagréable impatience. D'où vous sont donc venues tout à coup ces nouvelles mauvaises nouvelles ? J’ai vu tant varier les dires et les rapports à ce sujet que je n’en crois plus rien. Ma vraie crainte, c’est qu’il n’y ait là personne qui prenne vos intérêts à cœur et les fasse bien valoir. Cependant je compte un peu sur votre frère. Au fond, c’est un honnête homme, et il a de l’amitié pour vous.
Vendredi, 8 heures
J’ai mal aux dents. Je suis enrhumé du cerveau ; j'éternue comme une bête. Mais n'importe, j'ai le cœur content. Je retournerai à Paris, mercredi ou jeudi. Sans plaisir ; je n’y ai plus rien. J’aimerais mieux rester ici. J’y vis doucement. Je retourne à Paris par décence plutôt que par nécessité. Il ne paraît pas que le débat sur l'Orient doive venir de sitôt. Mais je ne veux pas qu’on s'étonne de mon absence. Le procès commence le 10, et remplira tout le mois. Donc écrivez-moi chez le Duc de Broglie, rue de l'Université, 90. Je le crois bien contrarié d'être obligé de rester à Paris. Il avait grande hâte d'aller en Suisse. C'est le premier indice que j'observe, de son côté, à l'appui de votre conjecture. Si elle se réalise, ce sera par l'empire de l’habitude plutôt que par un sentiment plus tendre. Adieu. Quand notre correspondance rentrera- t-elle dans son cours régulier ? Vous arrivez aujourd’hui à Baden. Je vous souhaite un aussi beau soleil que celui qui brille sur ma vallée. Adieu. Adieu. Le meilleur des adieux. G.
192. Val Richer, Dimanche 5 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens à mon post scriptum d’hier. Tout cela est bien obscur, et c’est un grand ennui que l'obscurité dans un si grand intérêt. Trois choses que je ne comprends pas qu’il n’y ait pas un service de dépêches plus régulier et plus fréquent ; que les généraux et les amiraux n'en disent pas davantage dans leurs rapports que le gouvernement n'en dise pas davantage, si les généraux lui en disent davantage. Tout cela est de la pure malhabileté. Il faut savoir parler au public, même des affaires qui vont médiocrement. Notre public a donné la démission de la politique, mais moins de la politique extérieure que de l’intérieure. Pour la politique extérieure, il reste curieux et redeviendrait aisément animé et difficile. D’autant qu’on a soi-même surexcité plus d’une fois le vieil esprit national. Point de rapport, ou point de publication des rapports de l’amiral Hamelin sur l'affaire du 17 où les flottes, et la flotte Française en particulier, et le vaisseau amiral Français, la ville de Paris entr'autres, ont évidemment jouer le grand rôle et beaucoup souffert ! C’est inconcevable. Je dirai du silence comme du mensonge ; c’est une si bonne chose qu’il ne faut pas en abuser, car on l’use et on le décrie.
Par dessus le marché, mon journal des Débats et mon Moniteur d’hier m'ont manqué. Il n’y avait certainement rien que ne m'aient dit l'assemblée nationale et les feuilles d’Havas ; mais c’est impatientant.
Albert de Broglie, qui arrive de Paris m'écrit : " J’ai laissé Paris un peu inquiet des longueurs du siège auxquelles, on aurait du être préparé. Il n’y a point d’incertitude sur l’issue, mais un sentiment, je crois assez juste, que plus la défense des Russes sera longue, moins le coup sera décisif. pour la paix."
Albert me donne des nouvelles des St Aulaire. " Cette pauvre famille, après trois mois de tortures héroïquement supportées est, je crois à bout de forces. Elle n’a voulu voir personne encore J’ai eu un mot de Mad. d'Harcourt, et vu une lettre de Langsdorff à M. Doudan ; l’un et l'autre paisibles et désolés. " Il ne me dit pas que St Aulaire soit malade.
Serez-vous assez bonne pour remercier de ma part, le capitaine Van de Velde de sa brochure sur la guerre de Crimée qu’il a bien voulu m'envoyer à Paris et qu’on m’a renvoyée ici ? Je l’ai trouvée très claire, très intéressante et très vraisemblable pour les ignorants, comme moi.
A en juger par les extraits qu’on en a donnés à Londres et à Paris, les rapports du Prince Mentchikoff sur la bataille de l'Alma sont écrits avec dignité et convenance.
Midi
Avec les journaux, j’ai des nouvelles de Paris, de très bonne source. Je copie : " La version russe relative à l'échec éprouvé par les troupes anglaises était singulièrement exagérée ; mais peu s'en est fallu qu’elle ne fût exacte. La vérité est que le 25, le général Liprandi, à la tête d’un corps de 30 000 hommes a surpris et attaqué l'aile droite du corps d'observation des armées alliées, composée de la division Anglaise qui a été un moment très compromise. Mais l’arrivée du général Bosquet et de la division française a rétabli les choses et forcé les Russes à la retraite. Les Anglais ont fait des pertes sensibles surtout leur cavalerie. Les rapports de leurs généraux rendent l'hommage le plus complet à la valeur et à la décision de nos troupes qui ont dans cette occasion, sauvé la partie. Cette affaire fait le plus grand honneur au général Bosquet. qui paraît être un officier de grand avenir. Vous voyez que j’ai eu la même impression que vous sur les rapports du Prince Mentchikoff.
Adieu, Adieu. G. G.
193. Baden, Jeudi 6 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je fais mieux encore que je ne dis. Je suis arrivée à 2 heures, pas. trop fatiguée. J ai trouvé un fort joli logement fort en désordre, il faut passer par un peu d'ennui, je voudrais bien n’avoir à me plaindre que de cela dans ma pauvre vie ! J’ai eu bien de l'émotion en traversant le Rhin, mais cette fois-ci je savais pourquoi ; l'année 36 je n'ai jamais pu le deviner. Je viens de recevoir une lettre du grand Duc, je vous en écrirai copie, une pauvre lettre ; mais enfin c'est du souvenir, c'est tout ce qu'il a à se faire.
5 heures
Voici votre lettre, que je vous remercie ! Je suis triste mais j'essaierai de l'être le moins possible avez-vous eu ma lettre de Sezanne. & de Saverne ? Voyez bien à m'accuser réception de tous mes N°. Voici la lettre du grand duc orthographe & tout.
Londres 19/31 mai 1839
Madame,
Avant de quitter ce pays où vous avez passé tant d’années et où tout ceux que vous ont connu, vous aiment et vous conservent un attachement bien sincères, permettez-moi de vous adresser ce peu de mots pour vous dire, chère Princesse, la peine que j'éprouve de ce que les circonstances ne nous aient pas permis de nous rencontrer. Le séjour que j’ai fait en Angleterre et l'accueil vraiment amical que j’y ai reçu de la part de la Reine, de ses ministres, et je puis le dire avec vérité de le part de tous les partis, me laisseront un souvenir bien agréable pour toute ma vie. Soyez persuadée, Madame que je serais éternellement reconnaissant à la veuve du Prince de Lieven pour l'amitié que son défunt mari n'a jamais cessé de me témoigner et que j'ai su apprécier.
Recevez Madame les assurances des sentiments que je vous ai voués.
Alexandre
Je vais répondre, et vous en aurez copie aussi. Vous ai-je dit qu'Orloff était inquiet de n'avoir rien eu de moi depuis sa lettre. C'est Lady Cowper qui me mande. Je ne sais encore qui est à Baden. Je crois, personne. Au reste je n’ai pas regardé par la fenêtre. Il pleut et fait froid. Bonsoir mais surtout adieu.
Vendredi 7 à 7 heures du matin.
Je me suis coucher à 9 heures levée à 6. J'ai fait une longue promenade pas un beau soleil dans un pays ravissant, j’ai déjeuné et me voici à vous, à vous toujours. Il me semble que je m'arrangerai de ceci très bien pourvu qu'il ne pleuve pas. Vraiment mon logement est charmant, gai, environné de rosiers, d’orangers. Je vous enverrai le dessin, le plan. 2 heures J’ai vu du monde des Russes, que vous ne connaissez pas. M. de Bacourt qui me dit que ma lettre doit être porté de suite à la poste. Adieu donc, adieu, il fait beau, il fait chaud, si vous étiez ici ! God bless you.
193. Bruxelles, Mardi 19 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai pas été en état hier de traiter une ligne votre lettre de Samedi m’avait bouleversée. Elle m’a donné mes attaques de bile des plus violentes. J’ai passé hier tout le jour dans mon lit. J'y suis encore aujourd’hui. mais mieux que hier. Ces secousses ne me vont plus. Que puis-je vous dire ? Mon esprit et mon courage m’abandonnent. Tout ce que je perds de ce côté-là, je le gagne en tendresse de cœur, et mon cœur déborde, et mess yeux pleurent. J'écrirai peut-être à l'Empereur. Ce sera mes résolution soudaine, car par réflexion je ne le ferais pas.
Je me suis fait lire votre discours, très beau, mais la fin n’a pas été de mon goût Nous avons sur certaines choses des gouts différents, et j’ai trouvé le moment mal[ ?]. La Prusse ne se joindra pas encore à l’alliance. C’est le plaisir de trainer, car il faudra bien qu’elle y arrive. Je ne puis pas continuer. Je suis trop faible. Adieu.
193. Val-Richer, Samedi 8 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me doutais de ce qui vous est arrivé. Mad de Talleyrand m’avait répondu en termes très aimables, mais vagues, et comme un peu inquiète de son impuissance à vous être bonne à quelque chose. Mes prétentions n'allaient pas jusqu'à espérer qu’elle vous cédât le rez-de-chaussée pour prendre le second ; ce sont là des dévouements héroïques que je n'attends pas des amitiés du monde. Mais venir quelque fois dans votre voiture, et vous désennuyer pour son propre plaisir, j’y comptais un peu. Apparemment elle aime mieux le confort de sa solitude que le plaisir de votre conversation. Gardez de ceci non pas de la rancune, ce qui est un sentiment déplaisant et fort peu dans votre nature, mais de la mémoire, ce qui sera beaucoup et ce que vous ne savez point faire. Vous oubliez le mal avec une facilité très aimable, mais très déplorable. C’est ainsi qu’on retombe toujours avec les autres dans la dépendance ou dans l’illusion. Vous avez beaucoup de pénétration mais elle ne vous sert à rien, comme prévoyance. vous recommencez avec les gens comme si vous ne les connaissiez pas du tout , et vous êtes obligée de rapprendre à chaque occasion, ce que vous aviez parfaitement vu ou deviné à la première. Vous avez bien raison d'être au Val-Richer. Vous ne serez nulle part en aussi tendre compagnie. Restez-y un peu plus que vous ne comptiez. Je n’en partirai que samedi prochain 15.
On m’écrit que le rapport de l'affaire d'Orient n'aura lieu que le 19 et le débat le 20. Le Maréchal est allé à la commission ; inculte, ignorant, mais rusé et se conformant assez habilement à ses instructions. Il a annoncé très confidentiellement et en demandant le secret, que le gouvernement voulait maintenir en Orient le statu quo, mais un statu quo durable, en assurant au Pacha l'hérédité de l’Egypte et de la Syrie. Du reste rien de plus ; des communications de pièces parfaitement insignifiantes, ou déjà imprimées ; rien qui mette la commission au courant de l'état de l'Empire Turc et des relations des diverses Puissances avec lui ou entre elles. La commission a, dit-on, assez d'humeur; et cela paraîtra.
Le Cabinet n'est pas en bonne veine. Il a vivement combattu, aux Pairs, la proposition de M. Mounier sur la légion d’honneur et elle a passé malgré lui. Aux Députés, une autre proposition, fort absurde, pour retirer aux fonctionnaires députés leur traitement pendant la durée de le session, et qui avait toujours été rejetée jusqu'ici, a été adoptée, au grand étonnement des Ministres qui n'avaient pas même ouvert la bouche, tant ils se croyaient sûrs du rejet. Un crédit de cinq millions, demandé pour achever le chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche, a été fort mal reçu. En tout il y a du décousu, de l’inertie dans le pouvoir, et de la débandade dans son armée. Thiers ne va plus à la Chambre, et annonce son très prochain départ. Plusieurs de ses amis. craignent qu’il n'attende même pas la discussion des Affaires d'Orient. Vous voilà au courant, comme si nous avions causé, au plaisir près. Mais le plaisir vaut mieux que tout le reste, n’est-ce pas ?
Dimanche 7 heures
Hier, il a plu sans relâche ; aujourd’hui le plus beau soleil brille. Hier vous me manquiez pour rester dans la maison et oublier la pluie ; aujourd’hui, vous me manquerez pour me promener et jouir du soleil. J’attends quelques personnes cette semaine, M et Mad. de Gasparin, Mlle Chabaud. Celle-ci m’est très précieuse pour mes filles et ma mère. Je suis très touché de l'amitié infatigable avec laquelle elle s’en occupe. C’est une excellente personne, très isolée en ce monde, et qui avec un cœur vif, n’a jamais connu aucun bonheur vif. Elle reporte sur les affections collatérales la vivacité, et le dévouement qu'elle n'a pas trouvé à dépenser en ligne directe. Mes filles l'aiment beaucoup. Henriette fait vraiment, avec elle, des progrès sur le piano. Elle a de très bons doigts. Adieu.
Vous me tenez dans l'anxiété en me disant que vous avez de mauvaises nouvelles pour vos affaires, sans me dire ce qu’elles sont, ni d’où elles viennent. J’en suis très impatient, car nous sommes impatiens de savoir le mal comme le bien. Mais je ne puis me résoudre à croire que, sur les terres de Courlande, tout le monde se soit jusqu'ici si grossièrement trompé. Encore une preuve de plus de votre barbarie. Les plus éclairés n'ont pas la moindre connaissance sûre des lois du pays. Adieu. Adieu. Enfin, votre prochaine lettre sera de Baden, & notre correspondance régulière sera établie. Mais vous avez été bien aimable, vous avez mis de la régularité en courant la poste adieu encore. G.
193. Val Richer, Lundi 6 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'étais pressé hier en vous envoyant les nouvelles qui m’arrivaient ; je n’ai pas copié le dernier paragraphe. Après les mots sur le général Bosquet, officier de grand avenir, on ajoute : " Les Anglais ont d'ailleurs pris leur revanche. Dans cette même journée du 27, les assiégés ayant tenté une sortie formidable sur les lignes anglaises, (sans doute en même temps que le général Liprandi les attaquait du dehors) ont été complètement battus, et ont laissé sur le terrain mille morts, dont les corps ont été comptés (on souligne ainsi). Tout cela est glorieux, mais horriblement triste.
Les journaux que vous recevrez aujourd’hui ou demain vous donneront probablement les détails. Je vous les envoie en tous cas comme ils me viennent.
J’ai lu en entier, les rapports du Prince Mentchikoff dont je n’avais vu que de extraits. Ils sont vraiment remarquables par l'absence de forfanterie et pas l’équité. Les journaux Anglais nient que le fils de Lord Clanricard ait été pris. Le sait-on positivement de Pétersbourg ?
Avez-vous lu le discours de Lord John à Mansion house pour provoquer les souscriptions au patriotic fund en faveur des familles des tués et des blessés ? Au milieu des éloges à la bravoure et au dévouement des soldats anglais, il les félicite et il félicite le pays de ce que leurs lettres, publiées dans les journaux, ont prouvé " that our rank and file can express themselves with a degree of intelligence and property which, while it marks their good feeling, indicates how much progress has been made in education, since the last war. " Voilà la passion de la civilisation, et cela a été couvert d’applaudissements.
J’ai une longue lettre de Macaulay. Purement littéraire ; des compliments sur Cromwell. Il me dit qu’il publiera dans quelques mois son Histoire de Guillaume 3. Toute préoccupation politique personnelle du moins l'a évidemment quitté : " My health is not very good. But I do not complain. I have numerous sources off happiness, independance, liberty, leisure, book, kind friends and relations."
Il viendra à Paris, le printemps prochain, pour l'exposition. Il nous faut la paix alors, pour que tout le monde y vienne. Midi Je vais lire les rapports détaillés, sur les affaires du 15. Je commence à comprendre celles du 25 et du 26, et j'en conclus que rien n'est fini. Adieu, Adieu. G.
194. Baden, Samedi 8 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai été bien fatiguée toute la matinée j’ai écrit au grand Duc, à Orloff, à mon frère, à mon fils Alexandre. J'ai envoyé copie à mon frère de la lettre du grand Duc et de ma réponse. Tout cela est beaucoup après une mauvaise nuit et par un temps bien chaud. J’ai vu longuement mon médecin. Il veut pour moi du lait d'ânesse, des bains de son, de l’air toujours de l'air, du calme dans ma vie, point de peines ! Point d'agitations ! Il veut que je dorme et avec tout cela il me répond de m'engraisser. Oui mais comment, excepté le lait et le bain, comment avoir tout cela ? Il m’a trouvé extrêmement changée et maigrie il y a longtemps que cela me frappe.
Je ne vois Mad. de Talleyrand qu’une demi-heure par jour, voilà tout, et puis je ne vois personne que Marie qui vient se promener avec moi le soir. Voilà mes dissipations de Baden. Mais le lieu est charmant, le temps superbe. Je ne me plaindrai pas, mais je suis bien seule.
Dimanche 9. à 8 heures du matin.
J'ai reçu hier au soir votre N°191. Je suis avide et heureuse de vos lettres, mettez-vous bien en tête qu’il ne se passe pas de minute où je ne pense à vous. J'ai des nouvelles de mon fils Alexandre. Il est arrivé à Pétersbourg le 22. Mon frère est tout de suite accouru chez mon fils, et les à reçus avec la plus grande tendresse. Alexandre a l’air fort content. Je n’ai rien de mon frère.
Une longue lettre d’Ellice qui ne pense pas que le ministère anglais tienne longtemps. Il croit que Lord Howick fera la brèche. Il est question de dissolution. J'ai presque bien dormi cette nuit.
J’ai commencé ce matin le lait d’ânesse. Je reviens de mon bain qui m’a plu. J'ai marché, j'ai déjeuné et il n’est que huit heures. Hier au soir je me suis fait miner au vieux château. On monte pendant une heure. C’est beau, c’est superbe. Des points de vue admirables des ombrages charmants, venez donc voir cela. Je défie que vous ayez rien vu de comparable. J’étais seule, toujours seule, ah ! que c’est triste ! midi. Je reviens de l'église. J'ai entendu mon excellent sermon, qui m’a bien émue. Vous ne savez pas comme j'ai l’âme tendre et triste. Je vous envoie copie de ma lettre au grand Duc. Dites-moi si elle est bien. Adieu, Adieu, que d'adieux à 120 lieux de distance. Ah que j'aimerai à repasser le Rhin ! Si on s’avisait de me le défendre, qu’est-ce que je ferais ? Adieu. Adieu.
194. Bruxelles, Mercredi 20 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le Prince Gortchakoff a reçu des pleins pouvoirs pour traiter. sur les trois premiers points pas d'objections, sur le quatrième, révision du traité. Si l'on élève les prétentions de la dépêche de M. Drouin de Luys. Il se retire de la conférence. Décidément nous ne céderons pas sur ce point. Nous tenons Sébastopol, qu'on nous le prenne. Meyendorff est très péremptoire sur ce point, aussi, pas de commission de cette nature-là.
La vive opposition au Foreign unlistement bill provient. de ce qu’on croit que le Prince Albert y a le doit dans l’intérêt des Allemands. C’est très impopulaire. Jeudi 21. Je n’ai pas pu continuer hier, je me suis trouvé mal. L'heure de la poste a passé. Je n’ai pas encore écrit. Je flotte entre le direct & l’indirect dirait, ce sera sans doute celui-ci.
Avez-vous lu le Times du 18 ? La correspondance de l’armée. Quel était pitoyable, quel tableau il en fait. Cholera, dénuement, dans l’armée anglaise. misères de tout sortes ! C’est très curieux à lire tâchez de l’avoir. Cela vaut la peine que vous y prendrez. Kisseleff est très malade. comme moi. Cet atroce climat.
Le général Osten Sacken est mort en Crimée à la tête de 36 m grenadiers, corps d’élite après la garde impériale. Je ne vois pas que les opérations avancent. Le Times dit que le Choléra enlève tous les jours 80 hommes dans l’armée anglaise. Adieu, je suis très faible depuis 3 jours dans mon lit. La[ ?] m’y a laissé hier. Adieu. Adieu. Flahaut arrive à Paris demain. Voyez-le et parlez lui de moi. Et puis parlez moi de lui. Tous vos numéros m’arrivent régulièrement.
194. Val-Richer, Lundi 10 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que vous avez à Baden un climat moins variable que le mien. Je ne puis garder le soleil deux jours de suite. Je n’aime pas cela. J’aime l’égalité et la durée. Plus ce qui me plaît dure, et dure toujours le même, plus j'en jouis. Je n’ai jamais compris ce que c'était que de se blaser. Il m'est arrivé (et même bien rarement) de reconnaitre que je m'étais trompé, que j’avais eu tort de prendre plaisir à quelque chose ou à quelqu'un ; mais m'en lasser à cause du temps seul, non. Bien loin d'user pour moi ce que j'aime, le temps m’est trop court pour en jouir, selon mon cœur. L’éternité seule y suffirait. Vous êtes-vous jamais figurée ce que serait le bonheur avec la perspective de l'éternité ? Il n'y a d'éternel que mon rhume de cerveau. Ceci, par exemple, je m'en ennuie. Depuis quelques jours, je ne vois rien qu’à travers un nuage, ma vallée, mes enfants, mes idées, sauf une qui est toujours claire et vive. A force d'éternuements de brouillards, de larmes, je me suis endormi hier sur mon canapé en lisant l'Orient. Car décidément je regarde beaucoup à l'Orient. J’en saurai très long sur ces affaires-là. C’est bien dommage que nous ne puissions pas en causer encore avant que j'en parle. Evidemment les évènements ne marchent pas vite, là, et les efforts de l’Europe pour les ajourner arriveront à temps. D'après ce qui me revient, pour peu que l'affaire fût bien conduite, l’hérédité de Méhémet-Ali sortirait de cette crise, et le statu quo, dont on parle toujours après un changement, recommencerait pour un temps.
8 heures et demie
Je viens de faire placer mes orangers. On peut prendre beaucoup d’intérêt à ce qu’on fait par cela seul qu'on le fait. Mais, c’est seulement pendant. qu'on le fait. J’ai planté un monde de fleurs. Dans six semaines le Val Richer sera un bouquet. Que vous revient-il de Londres? Le Cabinet me semble dans une situation de plus en plus précaire Lord Melbourne et Lord John ont l’air d’honnêtes gens à bout de voie, qui ont de l'humeur contre tout le monde, contre qui tout le monde a de l'humeur, et qui ne voulant par aller plus loin, ne peuvent plus aller du tout. On ne me mande rien de Paris, sinon que les grands projets historiques de Thiers, ne sont pas si sérieux qu’on l'affiche, et que tout cet étalage de 500 000 fr. a surtout pour but de rassurer des créanciers, et de les engager à prendre patience. A défaut du Ministère, on leur montre en perspective l'histoire de l'Empire. La Chambre des Pairs s’est bien échauffée sur la Légion d’honneur. Le Ministère y a repris ses avantages. Décidément M. Villemain est l'homme résolu et agissant aussi bien qu'éloquent du Cabinet. Il est toujours question du voyage du Roi à Bordeaux. M. Dufaure l'accompagnerait. Le Roi prend tout à fait possession de M. Dufaure. Il ( je veux dire M. Dufaure) avait aussi votre faveur, Madame ; mais je doute qu'il la conservât de près. Il n’a d’esprit et de talent qu'à la tribune.
Mardi 9 h. J’attends le courrier ce matin avec un surcroit d'impatience. Je n’ai pas eu de lettre depuis deux jours. Enfin celle-ci ouvrira une ère régulière. C’est bien le moins qu’elle soit régulière. Vote embonpoint et vos lettres, je veux ces deux choses-là de votre absence.
1 heure Voilà enfin votre N°193. Encore un nouveau retard de la malle poste. Je suis désolé d'avoir dit qu'il ne fallait pas destituer M. Conte. A demain ma réponse. Il faut que je donne tout de suite ceci. Je suis charmé de vous savoir arrivée bien logée. Adieu. Adieu. Mille et un.
194. Val Richer, Mercredi 8 novembre 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Des connaisseurs en fait de tactique politique prétendent à Paris que le gouvernement ne prend point de peine pour prévenir ou dissiper les inquiétudes parce qu’il veut qu’on soit inquiet, se promettant de donner par là plus d'éclat au succès final, et de regagner ce que le Tartare de Bourqueney lui a fait perdre. Je ne crois pas beaucoup à ces finesses, et je m'étonne de plus qu’il faille 17 jours pour avoir des nouvelles de Balaklava. Le Rapport de l’amiral Hamelin est très bien et lui fait honneur ; mais nous aurions de l'avoir au plus tard le 1er Novembre.
S'il est vrai, comme le dit le Constitutionnel, que nos troupes, vous aient repris le 26, les redoutes dont vous vous étiez emparées le 27 et qu'elles aient rejeté le général Liprandi au-delà de la Tchernaia, en même temps, qu'elles repoussaient la sortie des assiégés, l'opération offensive du prince Mentchikoff. aurait complètement échoué, et il lui resterait peu de chances de faire lever le siège par une bataille. Restent toujours deux questions vos renforts arriveront-ils plus vite et en plus grand nombre que les nôtres ? Combien de temps encore avec l’hiver qui approche des assiégeants, nourris par mer, peuvent-ils continuer le siège ? Je suis tout-à-fait de ceux qui croient que Sébastopol sera pris ; mais il faut qu’on se dépêche, car il ne reste plus beaucoup de temps pour le prendre.
Parlons d'autre chose. Faites mettre des bourrelets dans votre appartement pour peu que vous y restiez encore à toutes les portes et à toutes les fenêtres. Faites calfeutrer une fenêtre, s’il y a encore des courants d’air ; c’est assez d’une fenêtre à ouvrir. Avec du charbon et des bourrelets, on peut toujours se défendre du froid, et des vents coulis.
On m'écrit que le Chancelier a repris ses dîners du lundi, et que dans l'avant-dernier il a donné une marque de verdeur qui a diverti ses convives. C'étaient tous des jeunes gens de l'Académie, âge moyen, 60 ans. Le Chancelier a voulu prendre un papier dans son secrétaire, et a laissé tomber un trousseau de chefs, de toutes petites chefs, chefs de portefeuille à papiers qu’on serre, clefs de cassette à lettre qu’on garde. Les jeunes gens ont cherché par terre et n'ont pas trouvé. Le chancelier, tout en leur disant de ne pas se donner la peine, " et très content de nous humilier un peu nous autres sveltes et fringants ", dit le narrateur qui en était à continuer à causer en se promenant dans la pièce, et avec une adresse d’ancien préfet de police, sans faire semblant de rien, il tâtait le tapis du pied droit puis tout à coup, il s'est baissé, et s'est relevé tout aussi vite, le petit trousseau de clefs à la main. Ayez 89 ans à ce prix là. On attend avec assez de curiosité les deux discours de demain à l’Académie. On ne connait pas du tout celui de M. Dupanloup ; mais M. de Salvandy a lu le sien à plusieurs personnes, entr'autres de très longs fragments chez Mad. de Talleyrand. On dit qu’il y aura des hardiesses.
Cela m'amuserait assez d'être à Paris pendant que Lord et Lady Palmerston y sont. Je les verrais un peu et je les aurais beaucoup. Mais je présume qu’ils n'y resteront pas longtemps et moi, je n’y serai pas avant le 20 novembre. Je ne suis pas du tout pressé d'y retourner.
Midi.
Mes journaux annoncent l'assaut pour le 15 ou le 2 Novembre. Si cela était, nous le saurions bientôt. Adieu, Adieu. G.
195. Baden, Lundi 10 juin 1839, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai dormi que deux heures cette nuit la lettre de mon banquier m’avait de nouveau renversée. Vous savez comme je le suis aisément. Je m’en vais écrire à moi frère et Matonchewitz. Et j'ai bien peu de forces. Si vous étiez là vous m'en donneriez, et un peu de courage. Mais mes seules ressources ! C’est pitoyable.
Mardi 8 h. du matin
J’ai écrit, je vous enverrai copie si cela ne me coûte pas trop de peine. J’ai reçu votre n° 192. Je serai bien aise de vous écrire à Paris nous serons plus près. J’ai vu Mad. de Talleyrand. Ah que nous sommes loin. Hier un peu plus que de coutume, elle redevient très bonne ; je vous ai dit ; le secours moral, j’y puis compter, l’autre non. Elle me prendra mes chevaux et mes chambres, mais elle me donnera de bons conseils. Voici ma vie à 6 heures hors de mon lit et un verre de lait d’ânesse. Une heure de promenade à pied. Une demi-heure de repos à 7 1/2 un bain de son et de lait à 27 degrés. Dix minutes de bain, à 8 h mon déjeuner, et puis mes lettres à 9 1/2 ma toilette, à 11 heures seconde promenade à pied. à Midi le lunchon. Après de la lecture de 2 à 3 promenade en calèche ; de 3 à 4 je me repose dans le jardin. à 4 heures mon Dieu ! à 5 h., on m'apporte mes lettres et mes journaux, à 6 heures en calèche jusqu'après 8 heures. Ensuite une demi-heure de mon jardin, et à 9 heures mon lit. Voilà exactement mes faits et gestes. Ensuite, Marie vient me voir un quart d’heure dans la matinée pas davantage. Mad. de Talleyrand se promène en calèche avec moi ou le matin ou le soir. Et voilà toutes mes ressources. A propos elle me charge de la rappeler à vous. Dans quelques temps elle vous écrira pour vous dire de mes nouvelles.
1 heure
Je vois par votre lettre que j’ai négligé de vous dire d'où m'étaient venu les mauvaises nouvelles sur mes affaires en Courlande. C'est de copies des textes de la loi en Courlande très volumineux, très embrouillés, mais d'où il appert, que j'aurai une année du revenu entier de la terre de Courlande une fois payé ce qui fait je crois 60 m. francs. Rien du tout d’une autre terre en Lituanie achetée par mon mari, et rien non plus d'une belle arende en Lituanie. La 7ème partie de l’arende en Courlande qui sera peut être 2 mille francs par an. Vous voyez que cela me réduit au 7ème de la terre de Russie & à la quatrième part du capital en Angleterre. Mes fils auront chacun entre 80 à 90 mille roubles de rentes. Voilà mes notions pour le moment. Ces papiers Courlandais dont je vous parle m'ont été remis par la princesse Mescherscky. C'est un cousin à elle qui les lui a envoyés de Mittan. Je vous envoie les copies promises, dites-moi si j'ai bien fait sans ma lettre à Matonchevitz, j’ai été un peu plus claire. Il n’y a personne encore à Baden que je connaisse beaucoup de russes petites gens. Quelques Anglais ditto Le lieu est fort embellie. L'entrepreneur des jeux à Paris est venu ici, il y a déjà dépensé un million 300 m. francs pour embellir le salon et les promenades. Je suis la voisine immédiate. C’est même lui qui me nourrit. Le temps est charmant pas trop chaud, les promenades les plus belles du monde. Que ce serait joli se vous étiez ici ! Je n’ai pas une nouvelle à vous mander je ne sais absolument rien. Je ne saurai rien que par vous.
5 heures
Je reçois dans ce moment, une lettre de mon frère, fort bonne et amicale. Il me parle avec tendresse de mes fils, dont il parait fort content. Il me dit que Pahlen accepte, et que lui mon frère se réserve le rôle de super arbitre. Il fait faire un recueil des lois en Russie et en Courlande, qui m’indiquera ce qui me revient, et il ajoute. " Le reste sera une négociation j'espère aisée avec deux fils qui paraissent si comme il faut. " A présent j'attendrais avec plus de patience et de confiance, car je crois que vraiment mes affaires sont dans les meilleurs mains possibles. Je transcrirai demain ce qu'il me dit de vos affaires qui est assez drôle. Adieu. Adieu. Adieu. Ecrivez-moi tout. J’attends vos lettres avec tant d’impatience ! Adieu.
195. Bruxelles, Samedi 23 décembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Très malade hier. Aujourd’hui. un peu mieux, parce qu’après 3 nuits d'insomnie j’ai un peu dormi, j’ai écrit directement. puisque M. le recommandait. J’ai cru au fond que c’était plus sûr. J’ai conjuré de n'en garder le secret.
" On m’envoie tous les jours le bulletin sur l’Impératrice. Elle va mieux mais l’inquiétude n’a pas cessé. L'Emp. fait revenir ses fils, on le lui a annoncé avant-hier. C’est la comtesse Brandsburg qui me transmet tout cela. Je n’ai pas encore écrit un mot à Constantin. J’ai eu hier de lui une lettre où il emplore son pardon. A la bonne heure. Les nouvelles diplomatiques sont mauvaises. Cette affaire n’ira pas. Comment voulez-vous que nous souffrions qu'on nous parle de Sébastopol ? Qu'on le prenne d’abord, mais on ne peut pas nous demander de nous reconnaitre vaincus quand nous ne le sommes pas. Je doute qu'il y ait même le semblant d'une conférence. La démarche de la Prusse à Londres et à Paris restera parfaitement stérile. Cela ne mène à rien. Je vous prie continuez vos lettres, elles sont ma seule consolation. Je suis bien malade mais je serais encore en état d’aller trouver Andral. Adieu. Adieu.