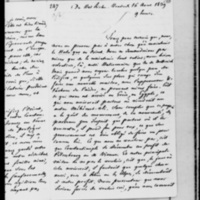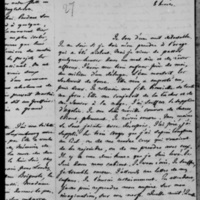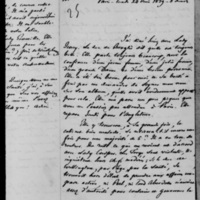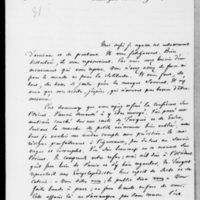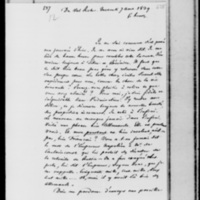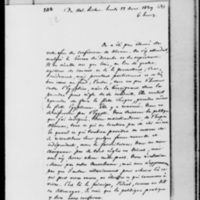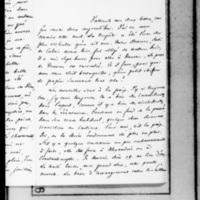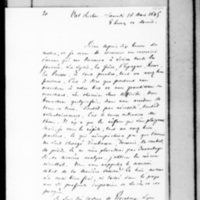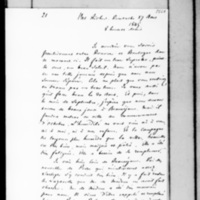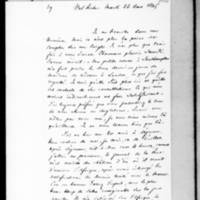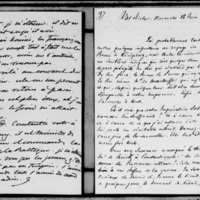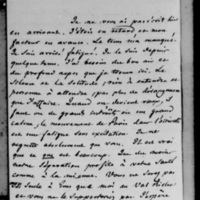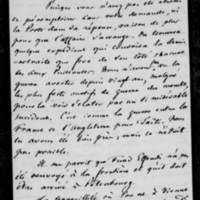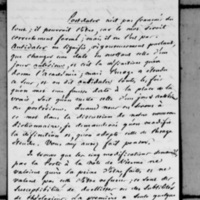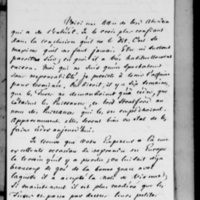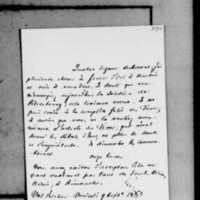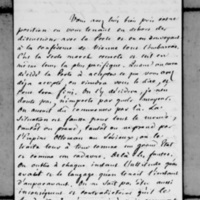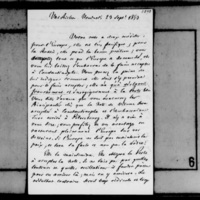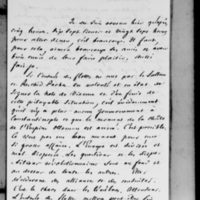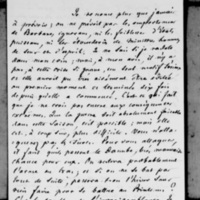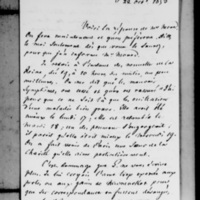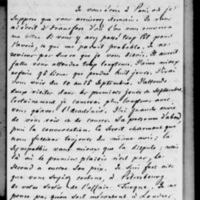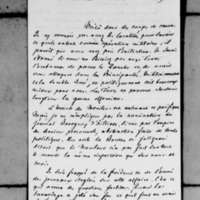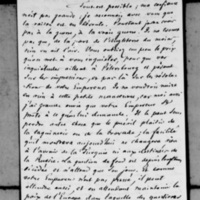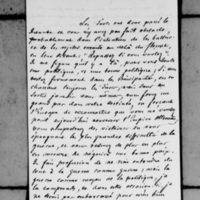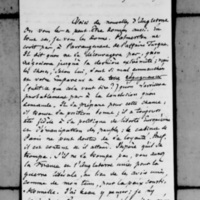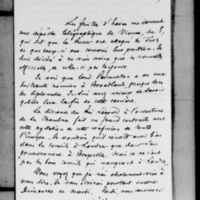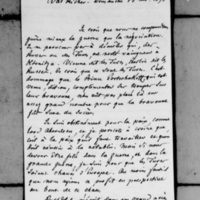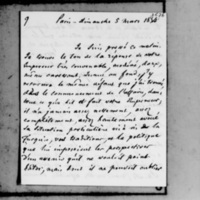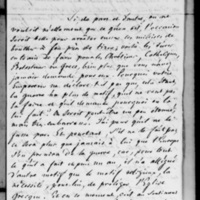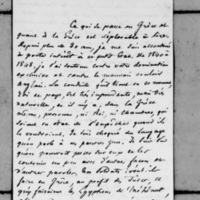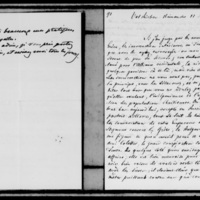Votre recherche dans le corpus : 177 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 3 Oct. 1849 9 heures
Je comprends que l’Autriche et la Russie insistent pour se faire rendre les fugitifs hongrois et polonais. Je comprends que la Turquie, refuse de les rendre. Certainement aucun des grands gouvernements Européens ne les rendrait. Être la seule nation en Europe capable de cela, c’est beaucoup. Les Turcs ne sont plus assez barbares. Sont-ils assez faibles ? Si j’avais à parier, je parierais que les fugitifs s’évaderont et iront en Angleterre. Vous ne ferez pas la guerre à la Turquie pour les reprendre. La France et l’Angleterre ne vous feront pas la guerre, avec la Turquie pour l'aider à ne pas vous les rendre. Tout le monde sera dans une impasse dont tout le monde voudra sortir. Ils s’évaderont. On criera d’un côté, on se taira de l'autre. Et bientôt on n’en parlera plus. Resteront dans le monde Kossuth, Bem, et Mazzini, trois hommes qui se seront fait un nom dans les événements de 48 et 49. La seule chose qui en reste. En apparence du moins et pour quelque temps car si les évènements ont été impuissants et ridicules, leurs causes subsistent, toujours redoutables, à ces trois hommes correspondent trois questions dont deux, l’Italienne et la Polonaise sont insolubles mais très vivaces et dont la troisième la Hongroise ne peut être résolue que par un bon gouvernement Autrichien, ce qui n’est par sûr. Et le vent de folie révolutionnaire, et socialiste soufflant toujours sur ces trois places de l’Europe, il y a à parier que l’accès de fièvre chaude qu'elles viennent de lui donner n’est pas le dernier. Si vous lisiez les journaux légitimistes, vous verriez que le parti catholique lui-même, les politiques du moins, M. de Falloux en tête ne songent qu’à profiter du Motu proprio du Pape pour sortir de Rome sauf à négocier encore après pour obtenir de lui quelque chose de plus, un peu plus d’amnistie ou un peu plus de constitution. On n'insistera pas sur le dernier point. Qui gardera le Pape et Rome après cela ? Peu importe. On aimera mieux les Espagnols que les Autrichiens. On se résignerait aux Autrichiens. L’armée française aura rétabli le Pape dans Rome, et protégé la politique modéré. C’est assez pour s'en aller. Que la politique modérée, et le Pape deviennent ensuite ce qu’ils voudront. La République française ne songe qu'à se laver les mains des révolutions et des restaurations qu'elle a faites. Ni pour les unes, ni pour les autres, elle ne se charge du succès.
Je suis frappé de la rentrée en scène, à Paris de Proudhon et de Louis Blanc par leurs nouveaux journaux la Voix du Peuple et le Nouveau monde. Le parti modéré a beau vouloir dormir ; ces gens-là, ne le lui permettront pas. Ou des batailles au moins annuelles dans les rues, ou un gouvernement assez fortement constitué pour que ceux-là, même qui ont envie de la bataille la croient impossible ; il n’y a pas moyen d'échapper à cette alternative. Il faut que la société mette le socialisme sous ses pieds, ou qu’elle meure de sa main. Et pour mettre le socialisme sous ses pieds, il faut ou cent mille hommes et le général Changarnier en permanence dans Paris, ou un vrai gouvernement. Combien de temps maintiendra-t-on le premier moyen pour s’épargner la peine de prendre le second ? C’est la question.
Onze heures
Nous ne pouvons nous répondre que le lendemain. Je vois que vous craignez plus que moi que la rupture entre la Russie et la Porte ne devienne sérieuse. Si elle devenait sérieuse, vous auriez le dernier. Adieu. Adieu. G.
Je comprends que l’Autriche et la Russie insistent pour se faire rendre les fugitifs hongrois et polonais. Je comprends que la Turquie, refuse de les rendre. Certainement aucun des grands gouvernements Européens ne les rendrait. Être la seule nation en Europe capable de cela, c’est beaucoup. Les Turcs ne sont plus assez barbares. Sont-ils assez faibles ? Si j’avais à parier, je parierais que les fugitifs s’évaderont et iront en Angleterre. Vous ne ferez pas la guerre à la Turquie pour les reprendre. La France et l’Angleterre ne vous feront pas la guerre, avec la Turquie pour l'aider à ne pas vous les rendre. Tout le monde sera dans une impasse dont tout le monde voudra sortir. Ils s’évaderont. On criera d’un côté, on se taira de l'autre. Et bientôt on n’en parlera plus. Resteront dans le monde Kossuth, Bem, et Mazzini, trois hommes qui se seront fait un nom dans les événements de 48 et 49. La seule chose qui en reste. En apparence du moins et pour quelque temps car si les évènements ont été impuissants et ridicules, leurs causes subsistent, toujours redoutables, à ces trois hommes correspondent trois questions dont deux, l’Italienne et la Polonaise sont insolubles mais très vivaces et dont la troisième la Hongroise ne peut être résolue que par un bon gouvernement Autrichien, ce qui n’est par sûr. Et le vent de folie révolutionnaire, et socialiste soufflant toujours sur ces trois places de l’Europe, il y a à parier que l’accès de fièvre chaude qu'elles viennent de lui donner n’est pas le dernier. Si vous lisiez les journaux légitimistes, vous verriez que le parti catholique lui-même, les politiques du moins, M. de Falloux en tête ne songent qu’à profiter du Motu proprio du Pape pour sortir de Rome sauf à négocier encore après pour obtenir de lui quelque chose de plus, un peu plus d’amnistie ou un peu plus de constitution. On n'insistera pas sur le dernier point. Qui gardera le Pape et Rome après cela ? Peu importe. On aimera mieux les Espagnols que les Autrichiens. On se résignerait aux Autrichiens. L’armée française aura rétabli le Pape dans Rome, et protégé la politique modéré. C’est assez pour s'en aller. Que la politique modérée, et le Pape deviennent ensuite ce qu’ils voudront. La République française ne songe qu'à se laver les mains des révolutions et des restaurations qu'elle a faites. Ni pour les unes, ni pour les autres, elle ne se charge du succès.
Je suis frappé de la rentrée en scène, à Paris de Proudhon et de Louis Blanc par leurs nouveaux journaux la Voix du Peuple et le Nouveau monde. Le parti modéré a beau vouloir dormir ; ces gens-là, ne le lui permettront pas. Ou des batailles au moins annuelles dans les rues, ou un gouvernement assez fortement constitué pour que ceux-là, même qui ont envie de la bataille la croient impossible ; il n’y a pas moyen d'échapper à cette alternative. Il faut que la société mette le socialisme sous ses pieds, ou qu’elle meure de sa main. Et pour mettre le socialisme sous ses pieds, il faut ou cent mille hommes et le général Changarnier en permanence dans Paris, ou un vrai gouvernement. Combien de temps maintiendra-t-on le premier moyen pour s’épargner la peine de prendre le second ? C’est la question.
Onze heures
Nous ne pouvons nous répondre que le lendemain. Je vois que vous craignez plus que moi que la rupture entre la Russie et la Porte ne devienne sérieuse. Si elle devenait sérieuse, vous auriez le dernier. Adieu. Adieu. G.
247. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
247 Du Val Richer Vendredi 16 août 1839 9 heures
Tenez pour certain que nous nous ne pensons pas à autre chose, qu’à maintenir le statu quo en Orient. Nous ne demanderions pas mieux que de le maintenir tout entier : nous serions volontiers, là, aussi stationnaires que M. de Metternich. Mais quand nous voyons tomber quelque part de l’édifice, et quelqu'un sur place qui essaye d’en faire une nouvelle maison, nous l'approuvons, et tâchons de l’aider, ne pouvant mieux faire. C’est ce qui nous est arrivé en Grèce, en Egypte ; ce qui nous arriverait partout où viendrait un autre Méhémet Ali. Sans compter que ce pays-ci a le goût du mouvement de la nouveauté des parvenus gens d’esprit que partout où il les rencontre, il prend feu pour eux, et que son Gouvernement est bien obligé de faire un peu comme lui. Ce que nous ne voulons pas, c’est que Constantinople se démembre au profit de Pétersbourg ou de Vienne. Et notre principale raison de ne pas le vouloir, c’est que le jour où cela arriverait, il faudrait que quelque chose aussi, vers le Rhin ou les Alpes se démembrât à notre profit. Nous pressentons que nous sérions forcés de vouloir ceci, qu'on nous casserait aux oreilles qu’il faut le vouloir, et nous n'avons nulle envie d'être mis au défi de courir cette grande aventure ou de passer pour des poltrons si nous ne la courons pas. Nous sommes pacifiques, très pacifiques, et nous ne voulons pas être poltrons.
Je dis nous, le pays. Voilà toute notre politique sur l'Orient. Et pour soutenir cette politique là, on pourrait nous faire faire beaucoup de choses. Nous regarderions comme un acte de prudence des combats sur mer, au loin, pour éviter une guerre continentale et à nos portes. Nous souhaitons, le statu quo en Orient parce qu'il nous convient en Occident. Le démembrement de l'Empire turc, c'est pour nous le remaniement de l’Europe. Le remaniement de l’Europe personne ne sait ce que c’est. Et nous sommes un pays prudent, très prudent, quoiqu'il ne soit pas impossible de nous rendre fous encore une fois, nous le sentons, et n'en voulons pas d'occasion. En tout ceci l'Angleterre pense comme nous et nous nous entendons très bien. Mais elle a une autre pensée qui n’est qu'à elle, et qui nous gêne dans notre concert. Elle ne veut. pas qu’il se forme dans la Méditerranée aucune Puissance nouvelle ; ayant des chances de force maritime et d'importance commerciale Elle ne le veut pas, et pour la Méditerranée elle-même, et pour l'Inde. De là son inimitié contre la Grèce et contre l’Egypte ; inimitié qu'elle voudrait nous faire partager, ce dont nous ne voulons pas n'ayant point d'Inde à garder, et ne craignant rien pour notre commerce dans la Méditerranée. L'Angleterre voudrait s’enchaîner, et nous enchaîner avec elle au statu quo entier, absolu, de l'Empire Ottoman. Nous ne voulons pas. parce que nous ne le croyons pas possible, parce que nous n'y avons pas un intérêt aussi grand, aussi vital que l’Angleterre ; parce que l'entreprise si nous nous en chargions ensemble pèserait bientôt sur nos épaules plus que sur les siennes et nous compromettrait, bien davantage en Europe. Voilà par où nous nous tenons et par où nous ne nous tenons pas l'Angleterre et nous. En ce moment l'Angleterre nous cède ; elle renonce à poursuivre son mauvais vouloir contre l’Egypte. Elle y renoncerait, je crois très complètement, si elle était bien convaincue que de notre côté nous tiendrons bon avec elle pour protéger contre vous soit le vieux tronc, soit les membres détachés et rajeunis de l'empire Ottoman. Elle doute ; elle nous observe. Il dépend de nous de la rassurer tout-à-fait, et en la rassurant de lui faire adopter à peu près toute notre politique.
Vous savez l’Autriche. Jamais je crois, nous n'avons été si bien avec elle. Elle est bien timide ; elle est si peu libre de ses mouvements que la perspective de la moindre collision, même dans l'Orient et pour l'Orient seul, l’épouvante presque autant que celle du remaniement de l’Europe. Cela se ressemble en effet un peu pour elle car elle tient à l'Orient et à l’Occident ; ses racines s'étendent des sources du Pô, bouches du Danube, et l’ébranlement va vite de l’une à l'autre extrémité. Cependant je crois que si elle y était forcée, si les habilités dilatoires perdaient toute leur vertu, elle agirait avec nous, et qu'elle l’a à peu près dit. Si c’est vous-même qui pacifiez l'Orient, qui présidez à la transaction entre Constantinople et Alexandrie, qui donnez un trône au Pacha pour ne pas cesser de protéger vous-même le Sultan sur le sien, il n’y a rien à dire. Vous aurez bien fait, et nous n'en serons pas très fâchés. Vous aurez gardé votre influence ; nous aurons obtenu notre résultat.
N'est-il pas très possible que tout finisse ainsi du moins en ce moment, et que sous les mensonges des journaux, sous les fanfaronnades des Gouvernements, au fond nous agissions tous à peu près dans le même sens, n'ayant pas plus d'envie les uns que les autres de rengager les grands combats ? Je suis bien tenté de le croire. Samedi 9 heures Pas de lettre ce matin. Cela me déplaît toujours beaucoup et m'inquiète un peu. Adieu. Adieu à demain. G.
Tenez pour certain que nous nous ne pensons pas à autre chose, qu’à maintenir le statu quo en Orient. Nous ne demanderions pas mieux que de le maintenir tout entier : nous serions volontiers, là, aussi stationnaires que M. de Metternich. Mais quand nous voyons tomber quelque part de l’édifice, et quelqu'un sur place qui essaye d’en faire une nouvelle maison, nous l'approuvons, et tâchons de l’aider, ne pouvant mieux faire. C’est ce qui nous est arrivé en Grèce, en Egypte ; ce qui nous arriverait partout où viendrait un autre Méhémet Ali. Sans compter que ce pays-ci a le goût du mouvement de la nouveauté des parvenus gens d’esprit que partout où il les rencontre, il prend feu pour eux, et que son Gouvernement est bien obligé de faire un peu comme lui. Ce que nous ne voulons pas, c’est que Constantinople se démembre au profit de Pétersbourg ou de Vienne. Et notre principale raison de ne pas le vouloir, c’est que le jour où cela arriverait, il faudrait que quelque chose aussi, vers le Rhin ou les Alpes se démembrât à notre profit. Nous pressentons que nous sérions forcés de vouloir ceci, qu'on nous casserait aux oreilles qu’il faut le vouloir, et nous n'avons nulle envie d'être mis au défi de courir cette grande aventure ou de passer pour des poltrons si nous ne la courons pas. Nous sommes pacifiques, très pacifiques, et nous ne voulons pas être poltrons.
Je dis nous, le pays. Voilà toute notre politique sur l'Orient. Et pour soutenir cette politique là, on pourrait nous faire faire beaucoup de choses. Nous regarderions comme un acte de prudence des combats sur mer, au loin, pour éviter une guerre continentale et à nos portes. Nous souhaitons, le statu quo en Orient parce qu'il nous convient en Occident. Le démembrement de l'Empire turc, c'est pour nous le remaniement de l’Europe. Le remaniement de l’Europe personne ne sait ce que c’est. Et nous sommes un pays prudent, très prudent, quoiqu'il ne soit pas impossible de nous rendre fous encore une fois, nous le sentons, et n'en voulons pas d'occasion. En tout ceci l'Angleterre pense comme nous et nous nous entendons très bien. Mais elle a une autre pensée qui n’est qu'à elle, et qui nous gêne dans notre concert. Elle ne veut. pas qu’il se forme dans la Méditerranée aucune Puissance nouvelle ; ayant des chances de force maritime et d'importance commerciale Elle ne le veut pas, et pour la Méditerranée elle-même, et pour l'Inde. De là son inimitié contre la Grèce et contre l’Egypte ; inimitié qu'elle voudrait nous faire partager, ce dont nous ne voulons pas n'ayant point d'Inde à garder, et ne craignant rien pour notre commerce dans la Méditerranée. L'Angleterre voudrait s’enchaîner, et nous enchaîner avec elle au statu quo entier, absolu, de l'Empire Ottoman. Nous ne voulons pas. parce que nous ne le croyons pas possible, parce que nous n'y avons pas un intérêt aussi grand, aussi vital que l’Angleterre ; parce que l'entreprise si nous nous en chargions ensemble pèserait bientôt sur nos épaules plus que sur les siennes et nous compromettrait, bien davantage en Europe. Voilà par où nous nous tenons et par où nous ne nous tenons pas l'Angleterre et nous. En ce moment l'Angleterre nous cède ; elle renonce à poursuivre son mauvais vouloir contre l’Egypte. Elle y renoncerait, je crois très complètement, si elle était bien convaincue que de notre côté nous tiendrons bon avec elle pour protéger contre vous soit le vieux tronc, soit les membres détachés et rajeunis de l'empire Ottoman. Elle doute ; elle nous observe. Il dépend de nous de la rassurer tout-à-fait, et en la rassurant de lui faire adopter à peu près toute notre politique.
Vous savez l’Autriche. Jamais je crois, nous n'avons été si bien avec elle. Elle est bien timide ; elle est si peu libre de ses mouvements que la perspective de la moindre collision, même dans l'Orient et pour l'Orient seul, l’épouvante presque autant que celle du remaniement de l’Europe. Cela se ressemble en effet un peu pour elle car elle tient à l'Orient et à l’Occident ; ses racines s'étendent des sources du Pô, bouches du Danube, et l’ébranlement va vite de l’une à l'autre extrémité. Cependant je crois que si elle y était forcée, si les habilités dilatoires perdaient toute leur vertu, elle agirait avec nous, et qu'elle l’a à peu près dit. Si c’est vous-même qui pacifiez l'Orient, qui présidez à la transaction entre Constantinople et Alexandrie, qui donnez un trône au Pacha pour ne pas cesser de protéger vous-même le Sultan sur le sien, il n’y a rien à dire. Vous aurez bien fait, et nous n'en serons pas très fâchés. Vous aurez gardé votre influence ; nous aurons obtenu notre résultat.
N'est-il pas très possible que tout finisse ainsi du moins en ce moment, et que sous les mensonges des journaux, sous les fanfaronnades des Gouvernements, au fond nous agissions tous à peu près dans le même sens, n'ayant pas plus d'envie les uns que les autres de rengager les grands combats ? Je suis bien tenté de le croire. Samedi 9 heures Pas de lettre ce matin. Cela me déplaît toujours beaucoup et m'inquiète un peu. Adieu. Adieu à demain. G.
224. Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
224 Du Val-Richer, Dimanche 21 Juillet 1839 5 heures
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
202. Paris, Mercredi 26 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
202 Paris. Mercredi 26 Juin 1839 8 heures
Je sors d’une nuit détestable. Je ne sais si je dois m'en prendre à l'orage qui a été violent. Mais je viens de passer quelques heures dans un mal aise et des rêves affreux. J’avais mes trois enfants près de moi, au milieu d'un déluge. L'eau montait, les soulevait de terre. Elle m'en a emporté un, puis deux. Je retenais ma fille Henriette de toute ma force. Elle me conjurait de la lâcher et de me sauver à la nage. J’ai souffert le supplice d'Ugolin. Je me suis réveillé couvert de sueur, criant, pleurant. Je revois encore. Mes mains se sont jointes avec désespoir. J’ai prié, j’ai supplié les trois Anges que j’ai depuis longtemps au Ciel, ou de me rendre ceux qui venaient de les rejoindre, ou de me prendre avec eux. Il y a une des heure que je suis levé. Je suis dans mon cabinet. Je vous écris. Je souffre, je tremble encore. J’attends une lettre de mes enfants. Je l’aurai certainement. En attendant, je ne puis reprendre mon empire sur mon imagination sur mes nerfs. Quelle nuit ! Quelle horreur que la douleur dont le rêve est une telle torture ! Pardon de vous parler de la mienne. Mais vraiment, je souffre encore beaucoup. Je suis très ébranlé. J’attends mes lettres avec angoisse. Il me semble que je me rassure en vous parlant.
10 heures
Voilà une lettre de Pauline et de ma mère. Dieu soit loué ! Il n’y en a point de noyé. J’étais vraiment fou il y a deux heures, je ne voyais rien que ma pièce d'eau. Mes enfants tombés dans ma pièce d’eau. Il faut que je parle d'autre chose, car je retomberais. Que nous sommes de faibles créatures ! Et avec une telle faiblesse, toujours à la porte de tels dangers, de telles douleurs ! Une étourderie, un faux pas, une minute de négligence d’une bonne, rien, vraiment rien, entre nous et le supplice ! Et nous marchons, nous vivons nous dormons au bord de ces abymes ! Ah, nous sommes aussi légers que faibles. Nous oublions tout, les maux passés, les maux possibles, les maux qui sont là peut-être là tout près ! Que nous sommes dignes de pitié ! Et quelle pitié que ce que nous sommes ! Il faut que je vous quitte encore. Je ne puis m’arracher à mon impression de cette nuit. J’aime pourtant bien votre grand papier, car j'ai aussi votre N°201.
Jeudi 27 7 h et demie
Les débats de la Chambre s’animent un peu. Le Cabinet avait eu avant-hier sur l'affaire du Mexique, une pitoyable séance. Les hésitations et les contradictions du Maréchal et de son avocat le Garde de sceaux, avaient soulevé le cœur. Hier sur l’Espagne, M. Passy et M. Dufaure est assez bien parlé. Je doute que le Roi soit content de ce qu’ils ont dit surtout M. Dufaure ; mais ils ont réussi. Pour qui les deux séances ont été bien mauvaises, c’est M. Molé. Défendre dans l'une par M. de Salvandy, sans le moindre effet, et dans l'autre, attaquant le cabinet actuel par M. de Chasseloup qui est resté seul, absolument seul. Tout le monde en a été frappé ! Demain ou après-demain, le débat sur l'Orient. Vous voyez les nouvelles. Les gens qui connaissent le pays ne croient pas que le Pacha dirige son effort sur Constantinople ; ce qui mettrait ses amis d'Europe dans l’embarras et les empêcherait de lui donner l'appui dont il a besoin. La guerre une fois engagée et s’il bat les Turcs, il marchera plutôt de l'Ossoff à l'Elbe que du Sud au Nord et vers Bagdad que vers Constantinople. Conquérir l'hérédité, c’est son grand but. Il y subordonnera toute sa conduite. Nos instructions partent pour notre flotte en Orient, analogues à celles de l'Angleterre.
Le procès commence aujourd’hui. Pendant son cours, le gouvernement s'attend à quelque nouvelle attaque. Ces gens-là l’annoncent très haut. Ce sont des sectaires de plus en plus isolés, et qui redoublent de rage à mesure que leur nombre diminue. Dans leurs réunions du matin et du soir ils mettent en avant les projets les plus frénétiques, l'incendie, l'assassinat. On est fort sur ses gardes. On a fait venir deux régiments de plus. Je doute fort d’un nouveau coup. Les Chefs des accusés refusent absolument de parler. Avant-hier le Chancelier pressait Martin. Bernard de questions. Celui-ci a dit au greffier : " Ne pourriez-vous pas faire taire ce grand Monsieur qui m’ennuie ? " Il faut que je vous quitte. J'ai ma toilette à faire Je vais déjeuner au Luxembourg avec Lady Jersey. Nous ne nous quittons pas. Elle a voulu entendre la lecture du Chapitre des Mémoires de Mad. de Rémusat qui raconte la mort du Duc d'Enghien. M. de Rémusat l'a lu hier au soir chez Mad. Anisson. Elle part demain pour Londres. L'autre jour à dîner chez Madame Brignole, la Princesse de Ligne était là aussi. Madame Brignole ne savait trop à qui donner le pas. Elle a imaginé d'aller confier son embarras à Lady Jersey elle-même qui lui a répondu. " Il n'y a rien de plus simple. Je suis femme d’un lord d’Angleterre. Vous ne pouvez pas hésiter. " Je suis de son avis. L’aristocratie passe avant la noblesse. Adieu. Adieu. Votre grand papier a son mérite mais il est traitre comme le petit du reste. Vous n’écrivez pas sur le verso. On n'a que la moitié de ce qu’on attend. Adieu encore.
Je sors d’une nuit détestable. Je ne sais si je dois m'en prendre à l'orage qui a été violent. Mais je viens de passer quelques heures dans un mal aise et des rêves affreux. J’avais mes trois enfants près de moi, au milieu d'un déluge. L'eau montait, les soulevait de terre. Elle m'en a emporté un, puis deux. Je retenais ma fille Henriette de toute ma force. Elle me conjurait de la lâcher et de me sauver à la nage. J’ai souffert le supplice d'Ugolin. Je me suis réveillé couvert de sueur, criant, pleurant. Je revois encore. Mes mains se sont jointes avec désespoir. J’ai prié, j’ai supplié les trois Anges que j’ai depuis longtemps au Ciel, ou de me rendre ceux qui venaient de les rejoindre, ou de me prendre avec eux. Il y a une des heure que je suis levé. Je suis dans mon cabinet. Je vous écris. Je souffre, je tremble encore. J’attends une lettre de mes enfants. Je l’aurai certainement. En attendant, je ne puis reprendre mon empire sur mon imagination sur mes nerfs. Quelle nuit ! Quelle horreur que la douleur dont le rêve est une telle torture ! Pardon de vous parler de la mienne. Mais vraiment, je souffre encore beaucoup. Je suis très ébranlé. J’attends mes lettres avec angoisse. Il me semble que je me rassure en vous parlant.
10 heures
Voilà une lettre de Pauline et de ma mère. Dieu soit loué ! Il n’y en a point de noyé. J’étais vraiment fou il y a deux heures, je ne voyais rien que ma pièce d'eau. Mes enfants tombés dans ma pièce d’eau. Il faut que je parle d'autre chose, car je retomberais. Que nous sommes de faibles créatures ! Et avec une telle faiblesse, toujours à la porte de tels dangers, de telles douleurs ! Une étourderie, un faux pas, une minute de négligence d’une bonne, rien, vraiment rien, entre nous et le supplice ! Et nous marchons, nous vivons nous dormons au bord de ces abymes ! Ah, nous sommes aussi légers que faibles. Nous oublions tout, les maux passés, les maux possibles, les maux qui sont là peut-être là tout près ! Que nous sommes dignes de pitié ! Et quelle pitié que ce que nous sommes ! Il faut que je vous quitte encore. Je ne puis m’arracher à mon impression de cette nuit. J’aime pourtant bien votre grand papier, car j'ai aussi votre N°201.
Jeudi 27 7 h et demie
Les débats de la Chambre s’animent un peu. Le Cabinet avait eu avant-hier sur l'affaire du Mexique, une pitoyable séance. Les hésitations et les contradictions du Maréchal et de son avocat le Garde de sceaux, avaient soulevé le cœur. Hier sur l’Espagne, M. Passy et M. Dufaure est assez bien parlé. Je doute que le Roi soit content de ce qu’ils ont dit surtout M. Dufaure ; mais ils ont réussi. Pour qui les deux séances ont été bien mauvaises, c’est M. Molé. Défendre dans l'une par M. de Salvandy, sans le moindre effet, et dans l'autre, attaquant le cabinet actuel par M. de Chasseloup qui est resté seul, absolument seul. Tout le monde en a été frappé ! Demain ou après-demain, le débat sur l'Orient. Vous voyez les nouvelles. Les gens qui connaissent le pays ne croient pas que le Pacha dirige son effort sur Constantinople ; ce qui mettrait ses amis d'Europe dans l’embarras et les empêcherait de lui donner l'appui dont il a besoin. La guerre une fois engagée et s’il bat les Turcs, il marchera plutôt de l'Ossoff à l'Elbe que du Sud au Nord et vers Bagdad que vers Constantinople. Conquérir l'hérédité, c’est son grand but. Il y subordonnera toute sa conduite. Nos instructions partent pour notre flotte en Orient, analogues à celles de l'Angleterre.
Le procès commence aujourd’hui. Pendant son cours, le gouvernement s'attend à quelque nouvelle attaque. Ces gens-là l’annoncent très haut. Ce sont des sectaires de plus en plus isolés, et qui redoublent de rage à mesure que leur nombre diminue. Dans leurs réunions du matin et du soir ils mettent en avant les projets les plus frénétiques, l'incendie, l'assassinat. On est fort sur ses gardes. On a fait venir deux régiments de plus. Je doute fort d’un nouveau coup. Les Chefs des accusés refusent absolument de parler. Avant-hier le Chancelier pressait Martin. Bernard de questions. Celui-ci a dit au greffier : " Ne pourriez-vous pas faire taire ce grand Monsieur qui m’ennuie ? " Il faut que je vous quitte. J'ai ma toilette à faire Je vais déjeuner au Luxembourg avec Lady Jersey. Nous ne nous quittons pas. Elle a voulu entendre la lecture du Chapitre des Mémoires de Mad. de Rémusat qui raconte la mort du Duc d'Enghien. M. de Rémusat l'a lu hier au soir chez Mad. Anisson. Elle part demain pour Londres. L'autre jour à dîner chez Madame Brignole, la Princesse de Ligne était là aussi. Madame Brignole ne savait trop à qui donner le pas. Elle a imaginé d'aller confier son embarras à Lady Jersey elle-même qui lui a répondu. " Il n'y a rien de plus simple. Je suis femme d’un lord d’Angleterre. Vous ne pouvez pas hésiter. " Je suis de son avis. L’aristocratie passe avant la noblesse. Adieu. Adieu. Votre grand papier a son mérite mais il est traitre comme le petit du reste. Vous n’écrivez pas sur le verso. On n'a que la moitié de ce qu’on attend. Adieu encore.
201. Paris, Lundi 24 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
201 Paris lundi 24 Juin 1839 8 heures
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
J’ai dîné hier avec Lady Jersey. Le Duc de Broglie dit qu'elle est toujours belle. Elle parle toujours beaucoup avec la confiance d’une jeune femme, d’une jolie femme, d’une grande dame et d’une bonne personne. Elle a été très bonne pour moi et sa bonté a fini par me demander de signer mon nom sur son album, qu’elle avait évidemment apporté pour cela. Elle m’a paru un peu piquée que vous ne l’eussiez pas attendue à Paris. Elle repart jeudi pour l'Angleterre. Elle y trouvera à sa grande joie, le Cabinet, bien malade. Se retirera-t-il encore une fois pour une majorité de 5 ? Il a eu tort de rentrer. Du reste ce qui me revient est d'accord avec Lady Cowper. Les Tories sont violents, & inquiètent leurs chefs modérés ; si le duc de Wellington, par l’âge, par la santé, se trouvait hors d'état de prendre aux affaires une part active, ni Peel, ni Lord Aberdeen n'auraient assez d'autorité pour contenir et gouverner le parti. Et ses fautes rendraient bientôt le pouvoir à ses adversaires. Si vous étiez ici, vous verriez un Cabinet bien aussi chancelant en apparence, quoi qu’il le soit bien moins au fond. Vous entendriez dire tout le jour que M. Molé se rapproche de M. Thiers, et aussi de moi, et moi de M. Thiers que M. Cousin part pour Plombières avec M. Molé ; que l'autre jour, de la voix et du geste, j'ai approuvé M. de Salvandy à la tribune. Je n’ai jamais vu tant de commérages. Il n’y a rien, rien du tout, et le Cabinet tiendra jusqu'à des événements.
5 heures
Je reviens de la Chambre et j'en rapporte peut-être des évènements. Deux dépêches télégraphiques disent que les Turcs ont envahis quinze villages égyptiens qu’Ibrahim s'est mis en mouvement avec 25 000 hommes pour les reprendre ; que la flotte Turque est dans le Bosphore, occupée à embarquer 7000 hommes de débarquement ; que le Sultan est très malade &. On attend cette nuit les dépêches écrites qui donneront des détails. En tout cas, lisez attentivement le rapport que M. Jouffroy vient de lire à la Chambre. C’est un morceau remarquable par la netteté et la mesure, au fond et dans la forme. Le langage est excellent. Il a été accueilli avec grande faveur. Il est très douteux qu’il y ait un débat.
Votre N°200 vaut mieux à la fin qu'au commencement. Quand je vois, pour tout un jour, quelques lignes, écrites comme on se traine quand on ne peut plus marcher, mon cœur se serre pour vous. Du reste, j'ai la même impression que Madame de Talleyrand. Je pressens un meilleur tour de vos affaires. A la vérité il faut bien qu'à force de descendre le moment de rencontre arrive. J'emploierai mon loisir à vous chercher une maison. Et si je trouvais de l'autre côté de l'eau quelque chose qui vous convient vraiment je n'hésiterais pas ; au risque d’y perdre, et par conséquent de vous y faire perdre quelque chose. Mais n’arrêtez aucun projet donc aucune maison avant les arrangements de Pétersbourg. Il faut savoir ce que vous aurez.
Mardi 8 heures
J’ai été hier soir faire ma cour à Neuilly. J’ai trouvé le Roi en bonne humeur, et comptant que les affaires d'Orient s’arrangeront de concert entre vous nous, et tout le monde. Il m'a gardé longtemps, et m’a paru penser qu’il avait aujourd’hui du pouvoir presque ultra petita. Il me semble que cela ne va pas au delà de votre latin. De Neuilly, j’ai été chez Lady Granville. Elle part, dans une quinzaine de jours pour les eaux de Kitsingen (dis-je bien ? ) près de Würtsbourg, où elle ne trouvera personne et c’est ce qu’elle cherche. Je suis allé hier chez votre Ambassadeur. Il était parti. Adieu. Voilà des visites. Quoique vous ne me disiez rien de bon sur votre santé, j'ai à son sujet, le même pressentiment que sur vos affaires. Et je crois entrevoir que vous même l’avez un peu. Ainsi soit-il ! God bless you ! Adieu Adieu.
233. Val-Richer,Vendredi 2 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
233. Du Val Richer Vendredi soir 2 Août 1839
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Je suis de mauvaise humeur. Je mène demain mes filles à Caen. Il faut que je parte de bonne heure avant l’arrivée de la poste. Je n’ai pas eu de lettre aujourd'hui ; je n'en aurai pas demain, et après-demain à 2 heures seulement à mon retour ici. Je vous répète que je suis de mauvaise humeur si vous ne m’avez pas écrit, pourquoi me disiez- vous la veille que vous ne m'imiteriez pas ? Et si vous m’avez écrit, pourquoi ce matin n’ai-je pas eu votre lettre ?
Voici mes nouvelles de ce matin. La flotte Turque est arrivée le 14 et s'est mise absolument à la disposition de Méhémet. L'amiral Stopford ne l’a pas plus arrêtée que n'avait fait l'amiral Lalande. Ainsi, on ne peut nous imputer un prétendu concert, Méhémet a déclaré qu’il ne rendrait la flotte que lorsque Khosrer Pacha ne serait plus à la tête des affaires et qu'on lui aurait accordé l’hérédité des pays qu'il gouverne. Mais en même temps l’armée égyptienne a reçu ordre de se retirer derrière, l’Euphrate. Ceci est la grande nouvelle, car ceci prouve que l'affaire se dénouera par la Diplomatie, Méhémet ne voulant donner prétexte à personne pour la dénouer autrement. C'est ce qu’on m’écrit avec une vive satisfaction. Vous le savez peut-être déjà.
Avec cette dépêche d'Alexandrie, ce que le courrier m’a apporté ce matin de plus piquant, c’est un petit livre intitulé : L'Almanach des Chasseurs, pour l’année de chasse 1839-1840 et qui débute ainsi : " Les profanes comptent quatre saisons dans l'année ; les chasseurs n'en comptent que deux : 1° Celle où l'on chasse. 2° Celle où l'on ne chasse pas. " Puis viennent toutes sortes de préceptes et de conseils, comme celui-ci : Tuez les geais, les pies, les buses, les oiseaux sont remplis de ruses. "
Rien de tout cela n’est à mon usage, car je ne chasse pas. Vous voyez bien que la poste aurait beaucoup mieux fait de m'apporter votre lettre. Adieu jusqu'à demain matin. Plût à Dieu !
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°161 Lundi soir, 15 oct, 9 heures et demie
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
237. Val-Richer, Mercredi 7 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
237 Du Val-Richer. Mercredi 7 août 1839 6 heures
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
145. Val-Richer, Dimanche 30 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1838 (4 août - 4 novembre)
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
N°145 Dimanche 30 septembre 7 heures
Je reviens à M. de Pahlen. Ce qu’il vous à dit me paraît singulier à force d’être absurde. Que de tels propos fussent tenus en hiver, quand il m’arrive de rencontrer quelques fois chez vous Thiers le matin ; Berryer le soir, je le concevrais ; il ne faut pas aux commérages un meilleur prétexte. Mais à présent en l’absence de tout prétexte une correspondance quand vous n’avez pas écrit du tout, cela ne peut venir que de très loin, comme vous dîtes ou de très bas. Ce ne peut être qu’un retentissement des rencontres de l’hiver dernier, qui revient du bout du monde, ou un propos d’antichambre. Il est impossible que le Ministère quelque susceptible, quelque ombrageux que je le sache, quelque goût que je lui connaisse pour les rapports et les tracasseries de polices soit pour quelque chose là dedans. M. Molé vous aura, je n’en doute pas, édifiée de ce côté. Reste la supposition lointaine. Nous verrons. Il n’y a pas moyen de la vérifier sur le champ. Cependant elle me paraît bien invraisemblable. Je persiste à croire à des bavardages subalternes qui auront étouffé votre Ambassadeur. En tout cas, je lui sais gré de vous avoir avertie.
Je vous renvoie la lettre de Lord Aberdeen. Celle de Lady Clanricard est intéressante. J’en ai reçu une qui l’est assez ; de M. de Barante, d’Odessas, pleine de la Grèce et de la Turquie. Athènes et Constantinople. Deux choses surtout l’ont frappé. Colocotroni et Nicitas, les noms qui ont retenti héroïquement en Europe s’épuisant en intrigues et en humilités pour un traitement de 1500 fr. ; les Turcs qui ne sont plus Turcs ne disent plus Chiens de Chrétiens, confessent à tout propos leur infériorité et s’efforcent de nous imiter sans espérer d’y réussir. Il me dit en finissant : " Si les grandes puissances le veulent, s’il s’établissait quelque concert dans le patronage qu’elles exercent, le rajeunissement d’Eson ne serait pas impossible. La Turquie se transformerait peu à peu en un état subalterne qui prospérerait plus ou moins. Il se placerait au même rang que la Moldavie le Valachie ou la Grêce. Mais si la bonne volonté de chaque Cabinet demeure isolée et méfiante, le cadavre de l’Empire Ottoman tout en demeurant debout avancera chaque jour dans sa dissolution, et au premier incident il tombera en poudre. Le premier soin à prendre serait de faire cesser cet état provisoire et menaçant d’hostilité entre l’Egypte et Constantinople. Autrement nulle sécurité, nul progrès dans l’Orient. Je ne réponds pas qu’une telle résolution, soit possible à décider et à exécuter ; mais il m’a paru quelle était nécessaire. "
Je vous enverrais la lettre même, si elle n’était pas très longue et écrite si fin que vos pauvres yeux se perdraient à la lire. Vous avez la substance. Lord Aberdeen attache trop d’importance au Mexique et à la côte d’Afrique. C’est un reste de la vieille politique Torry, que cette disposition hargneuse à notre égard sur les petites choses, ne pouvant et ne voulant rien autre que les Whigs sur les grandes. Grandes et petites choses se tiennent. On se fait petit soi-même à retenir les secondes quand on abandonne les premières. Lord Aberdeen devrait porter dans sa politique extérieure, sa nouvelle disposition dont il vous parle pour ses relations privées. Party violence convient encore, moins aujourd’hui au dehors qu’au dedans, et national animosity doit être entirely subdued aussi bien que personal animosity. Du reste la simplicité tranquille et haute de son ton et de son caractère me plaît toujours beaucoup.
10 h.
Non je ne veux pas vous refaire ; n’on, je ne vous reproche pas votre franchise ; bien au contraire, je vous en aime. Et vous voyez bien que votre impression ne peut me déplaire puisque je l’ai eue avant vous, puisque c’est moi qui l’ai suscitée en vous. Mais vous ne connaissez pas ce pays-ci. Vous ne savez pas ce que c’est qu’un village tout catholique, et les habitudes qui en résultent dans la famille Protestante la plus pieuse. A demain les détails, car je veux vous répondre avec détail. Je ne veux pas qu’il vous reste sur le cœur autre chose, qu’un regret. Adieu Adieu. Je suis fort aise de votre conversation avec M. Molé. Cela empêchera toujours quelque chose. Adieu. Calmez-vous au moins sur les loups. Un long adieu. G.
Je reviens à M. de Pahlen. Ce qu’il vous à dit me paraît singulier à force d’être absurde. Que de tels propos fussent tenus en hiver, quand il m’arrive de rencontrer quelques fois chez vous Thiers le matin ; Berryer le soir, je le concevrais ; il ne faut pas aux commérages un meilleur prétexte. Mais à présent en l’absence de tout prétexte une correspondance quand vous n’avez pas écrit du tout, cela ne peut venir que de très loin, comme vous dîtes ou de très bas. Ce ne peut être qu’un retentissement des rencontres de l’hiver dernier, qui revient du bout du monde, ou un propos d’antichambre. Il est impossible que le Ministère quelque susceptible, quelque ombrageux que je le sache, quelque goût que je lui connaisse pour les rapports et les tracasseries de polices soit pour quelque chose là dedans. M. Molé vous aura, je n’en doute pas, édifiée de ce côté. Reste la supposition lointaine. Nous verrons. Il n’y a pas moyen de la vérifier sur le champ. Cependant elle me paraît bien invraisemblable. Je persiste à croire à des bavardages subalternes qui auront étouffé votre Ambassadeur. En tout cas, je lui sais gré de vous avoir avertie.
Je vous renvoie la lettre de Lord Aberdeen. Celle de Lady Clanricard est intéressante. J’en ai reçu une qui l’est assez ; de M. de Barante, d’Odessas, pleine de la Grèce et de la Turquie. Athènes et Constantinople. Deux choses surtout l’ont frappé. Colocotroni et Nicitas, les noms qui ont retenti héroïquement en Europe s’épuisant en intrigues et en humilités pour un traitement de 1500 fr. ; les Turcs qui ne sont plus Turcs ne disent plus Chiens de Chrétiens, confessent à tout propos leur infériorité et s’efforcent de nous imiter sans espérer d’y réussir. Il me dit en finissant : " Si les grandes puissances le veulent, s’il s’établissait quelque concert dans le patronage qu’elles exercent, le rajeunissement d’Eson ne serait pas impossible. La Turquie se transformerait peu à peu en un état subalterne qui prospérerait plus ou moins. Il se placerait au même rang que la Moldavie le Valachie ou la Grêce. Mais si la bonne volonté de chaque Cabinet demeure isolée et méfiante, le cadavre de l’Empire Ottoman tout en demeurant debout avancera chaque jour dans sa dissolution, et au premier incident il tombera en poudre. Le premier soin à prendre serait de faire cesser cet état provisoire et menaçant d’hostilité entre l’Egypte et Constantinople. Autrement nulle sécurité, nul progrès dans l’Orient. Je ne réponds pas qu’une telle résolution, soit possible à décider et à exécuter ; mais il m’a paru quelle était nécessaire. "
Je vous enverrais la lettre même, si elle n’était pas très longue et écrite si fin que vos pauvres yeux se perdraient à la lire. Vous avez la substance. Lord Aberdeen attache trop d’importance au Mexique et à la côte d’Afrique. C’est un reste de la vieille politique Torry, que cette disposition hargneuse à notre égard sur les petites choses, ne pouvant et ne voulant rien autre que les Whigs sur les grandes. Grandes et petites choses se tiennent. On se fait petit soi-même à retenir les secondes quand on abandonne les premières. Lord Aberdeen devrait porter dans sa politique extérieure, sa nouvelle disposition dont il vous parle pour ses relations privées. Party violence convient encore, moins aujourd’hui au dehors qu’au dedans, et national animosity doit être entirely subdued aussi bien que personal animosity. Du reste la simplicité tranquille et haute de son ton et de son caractère me plaît toujours beaucoup.
10 h.
Non je ne veux pas vous refaire ; n’on, je ne vous reproche pas votre franchise ; bien au contraire, je vous en aime. Et vous voyez bien que votre impression ne peut me déplaire puisque je l’ai eue avant vous, puisque c’est moi qui l’ai suscitée en vous. Mais vous ne connaissez pas ce pays-ci. Vous ne savez pas ce que c’est qu’un village tout catholique, et les habitudes qui en résultent dans la famille Protestante la plus pieuse. A demain les détails, car je veux vous répondre avec détail. Je ne veux pas qu’il vous reste sur le cœur autre chose, qu’un regret. Adieu Adieu. Je suis fort aise de votre conversation avec M. Molé. Cela empêchera toujours quelque chose. Adieu. Calmez-vous au moins sur les loups. Un long adieu. G.
242 . Val -Richer, Lundi 12 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
242 Du Val-Richer, lundi 12 août 1839 6 heures
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
On a été peu étonné de votre refus des conférences de Vienne. On s’y attendait malgré le Gascon du Danube et ses espérances. Il en résulte ceci que trois, au lieu de quatre agissent de concert, et se le promettent ; l’une, timidement, mais pourtant positivement et de très bon cœur au fond ; l'autre, avec un peu d'humeur contre l’égyptien, mais la témoignant sans la prendre pour règle de sa conduite. Elle voulait reprendre de force la flotte turque, prendre même la flotte égyptienne. Elle y a renoncé. Nous ne sacrifierons pas l’Egypte. Nous suivrons la politique que j'ai indiquée. Nous maintiendrons de l'Empire Ottoman tout ce qui ne tombera pas de soi-même. Et quand ce qui tombera paraîtra en mesure de se reconstituer sous quelque forme nouvelle et indépendante, nous le favoriserons. Nous ne nous chargerons pas de tout régler en Orient ; mais nous n’y serons absents nulle part. Nous n’interviendrons pas entre Musulmans; mais nous n'approuverons pas que d'autres interviennent pour achever là ce qui peut vivre encore, ou étouffer ce qui commence à vivre. C'est là le principe, l’idéal, comme on dit en Allemagne. Je crois que la politique pratique y sera assez conforme.
Thiers est encore à Paris tenant sur l'Orient un langage pacifique ; plus aigre que jamais contre MM. Passy et Dufaure qui le lui rendent bien. Je ne sais ce qui s’est passé récemment entre eux ; mais pendant quelque temps Thiers avait paru ménager Dufaure. Aujourd'hui il le traite fort mal, & chez lui devant tout le monde, le met au dessous de M. Martin du Nord Rien de nouveau du reste. Vous conviendrez qu'il y aurait du guignon si je me brouillais, avec le Duc de Broglie à propos de Mad. de Staël. Grace à la liberté de la presse il n’y a point de mensonge, si sot qu'il ne se trouve quelqu'un pour le dire. En attendant que nous soyons brouillés, j’ai eu hier des nouvelles du Duc de Broglie. Il va venir en Normandie pour le Conseil-général, et compte toujours passer l’automne, en Italie, avec sa fille et son fils, jusqu'à la session.
Dès que vous le pourrez, envoyez-moi la note des effets que vous voulez faire entrer en France et l’indication du bureau de douanes c’est-à-dire de la ville par où ils doivent entrer. Je l’enverrai au Directeur général des douanes en le priant de donner des ordres à ce bureau pour en autoriser l'entrée. Je crois que cela se pourra pour toutes choses puisque toutes sont des meubles anciens, et uniquement destinés à votre usage. Ne vous en embarrassez pas et laissez moi faire. Il faut seulement que je puisse désigner la nature des effets, et le point d'arrivée. Faites-vous adresser de Pétersbourg un état bien complet des caisses, de leurs numéros et de ce que chacune contient.
Je reviens aux dents des enfants français, c’est-à-dire des miens. Je ne réponds que de ceux-là. Si vous y aviez été vous auriez été content de leur petit courage, malgré le mouvement nerveux de Pauline. L'affaire a duré trois minutes, tragédie sans pathétique et sans longueur. Mais je tenais à y être moi-même. En tout, je tiens à témoigner, beaucoup de tendresse à mes enfants, et à ce qu’ils y comptent. La tendresse manque à ce lien-là, en Angleterre, et à presque toutes les relations de famille. C’est un grand mal. Toute la vie s'en ressent. Je vous disais l'autre jour qu'en fait d’éducation morale ou physique l’atmosphère, le régime et beaucoup de liberté, étaient tout à mon avis. J’ajoute beaucoup d'affection.
9 heures
Quand je suis triste pour vous, où par vous, je vous le dis. N'y voyez jamais que ce que je vous ai dit. Je veux savoir le mot qui vous a blessée. Quel qu’il soit j’ai eu tort de le dire & vous avez eu tort de vous en blesser. Je vous aime bien tendrement, et c'est mon plaisir de vous soutenir. Adieu. Adieu. J’ai beaucoup de choses à vous dire Demain.
415. Londres, Vendredi 18 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
415. Londres, Vendredi 18 septembre 1840
9 heures
J’attends mes deux lettres car j’en aurai deux aujourd’hui. J’ai eu mon courrier cette nuit. La tempète a été l’une des plus violentes qu’on ait vues. Notre steamer, sorti de Calais avant-hier fut obligé de rentrer. Hier il a mis sept heures pour aller à Douvres. Le port de Douvres est encombré. Et il faut, pour que mon cœur soit tranquille, qu’un petit chiffon de papier surmonté tout cela ! Les nouvelles sont à la paix. J’y ai toujours cru, j’y crois toujours. On a bien des incertitudes, dans l’esprit, comme il y a bien des vicissitudes, dans les événements. Pourtant au fond de la pensée, dans son cours habituel quelque chose domine conviction ou instinct. Pour moi, c’est la paix. Ici, on la désire évidemment de plus en plus. S’il y a quelque concession un peu embarrassante à faire, elle se fera à Alexandrie ou à Constantinople. Je devrais dire et au lieu d’ou. Le traité laisse avec grand soin, cette porte ouverte. Les bases d’arrangement entre le Sultan et le Pacha ne font point partie de la convention des quatre Puissances. C’est une annexe qui vient de la Porte seule et que la Porte peut modifier. Le Pacha de son côté ne me paraît point avoir jeté son bonnet par dessus les moulins. Il n’y a plus que des sages dans le monde. Je prends un singulier moment pour le dire. Pourtant je le crois.
En ma qualité de sage, je vais faire ma toilette pour occuper mon impatience. J’attends très dignement ce que je crains. Mais si on voyait avec quel tumulte intérieur j’attends ce que je désire, on ne me trouverait. pas si sage que je le dis. On aurait tort. La vraie sagesse consiste à ne s’émouvoir que selon l’importance des choses, et je suis bien sûr que j’ai raison dans l’importance que j’attache à celle qui m’émeut en ce moment. Décidément, je vais faire ma toilette.
Une heure
J’ai mes deux lettres, et il vous en a manqué une. Elle ne vous aura pas manqué. On vous l’aura remise plus tard. Je crois même qu’elle était longue, lundi. Je ne vous écris jamais aussi longuement que je le voudrais ! Ni vous non plus à moi. Certainement c’est absurde, absurde et intolérable. Je le sens mieux tous les jours. Mais vous avez tort dans votre égoïsme. Vous ne risquez, vous ne perdez jamais rien dans aucune situation. Partout, toujours mon regret, mon désir est le même. Ceux que j’aime le mieux, je les aime pour eux. Vous, je vous aime pour moi. Est-ce assez ?
Voilà donc la grande duchesse Marie cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue. J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie. Je n’étais pas sorti. J’avais joué au Whist. Je me fais pitié, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ! Bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue.
J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie Je n’étais pas sorti. J’avais joué au whist. Je me fais pitie, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ? bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir, sans y rien mettre qui me satisfasse et qui me plaise. Le temps, ce trésor si grand, qui s’écoule si vite, le dépenser pour rien, avec personne ! Cela me choque. Je rentre dans ma chambre honteux, petit. Quand au contraire mon temps a été bien rempli, rempli au gré de mon âme, quand le chêne a bien ouvert ses feuilles, et bien joui du soleil, je me retire, je me couché, je m’endors content et fier, animé et reposé. Je dis adieu non sans regret, mais sans amertume à ces belles heures passées. C’est toujours triste de belles heures qui ne sont plus. Mais elles ont été belles ; elles ont eu leur part des dons de Dieu, des biens de la vie. Ce quelles deviennent, où elles vont en s’enfuyant, je ne le sais pas ; le passé comme l’avenir est un mystère, un sanctuaire où notre vue ne pénètre point. Mais quand la portion de nous-mêmes qui disparaît dans ce sanctuaire a été charmante, il en reste une ombre charmante qui ne nous quitte plus. Je l’avais près de moi chaque soir cette ombre d’un jour plein, d’un jour heureux. En le regrettant, j’en jouissais encore. Je ne regrette plus rien, et mes journées tombent derrière moi, sans que j’y pense, sans que je tourne une seule fois la tête pour y regarder.
3 heures et demie
Je vous ai quittée. Je vous désirais trop. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu avant de sortir. Je vais faire deux ou trois visites. J’irai probablement voir lady Clanricard. Elle m’a dit qu’elle serait chez elle a cinq heures. Ce soir, j’aurai mes diplomates qui joueront au Whist. Lady Palmerston m’a dit que cela leur plaisait fort, mais que c’était bien dommage que je n’y eusse pas quelques femmes. Je ne trouve pas que ce soit dommage. Adieu. Adieu. Adieu, me plaît, mais ne me contente pas. Adieu.
9 heures
J’attends mes deux lettres car j’en aurai deux aujourd’hui. J’ai eu mon courrier cette nuit. La tempète a été l’une des plus violentes qu’on ait vues. Notre steamer, sorti de Calais avant-hier fut obligé de rentrer. Hier il a mis sept heures pour aller à Douvres. Le port de Douvres est encombré. Et il faut, pour que mon cœur soit tranquille, qu’un petit chiffon de papier surmonté tout cela ! Les nouvelles sont à la paix. J’y ai toujours cru, j’y crois toujours. On a bien des incertitudes, dans l’esprit, comme il y a bien des vicissitudes, dans les événements. Pourtant au fond de la pensée, dans son cours habituel quelque chose domine conviction ou instinct. Pour moi, c’est la paix. Ici, on la désire évidemment de plus en plus. S’il y a quelque concession un peu embarrassante à faire, elle se fera à Alexandrie ou à Constantinople. Je devrais dire et au lieu d’ou. Le traité laisse avec grand soin, cette porte ouverte. Les bases d’arrangement entre le Sultan et le Pacha ne font point partie de la convention des quatre Puissances. C’est une annexe qui vient de la Porte seule et que la Porte peut modifier. Le Pacha de son côté ne me paraît point avoir jeté son bonnet par dessus les moulins. Il n’y a plus que des sages dans le monde. Je prends un singulier moment pour le dire. Pourtant je le crois.
En ma qualité de sage, je vais faire ma toilette pour occuper mon impatience. J’attends très dignement ce que je crains. Mais si on voyait avec quel tumulte intérieur j’attends ce que je désire, on ne me trouverait. pas si sage que je le dis. On aurait tort. La vraie sagesse consiste à ne s’émouvoir que selon l’importance des choses, et je suis bien sûr que j’ai raison dans l’importance que j’attache à celle qui m’émeut en ce moment. Décidément, je vais faire ma toilette.
Une heure
J’ai mes deux lettres, et il vous en a manqué une. Elle ne vous aura pas manqué. On vous l’aura remise plus tard. Je crois même qu’elle était longue, lundi. Je ne vous écris jamais aussi longuement que je le voudrais ! Ni vous non plus à moi. Certainement c’est absurde, absurde et intolérable. Je le sens mieux tous les jours. Mais vous avez tort dans votre égoïsme. Vous ne risquez, vous ne perdez jamais rien dans aucune situation. Partout, toujours mon regret, mon désir est le même. Ceux que j’aime le mieux, je les aime pour eux. Vous, je vous aime pour moi. Est-ce assez ?
Voilà donc la grande duchesse Marie cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue. J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie. Je n’étais pas sorti. J’avais joué au Whist. Je me fais pitié, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ! Bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir cousine germaine de M. Demidoff. Cousine germaine par alliance. Les Bonaparte se remuent partout. Ici encore, pour tirer de prison leur Empereur Louis. C’est bien dommage que le sentiment du ridicule soit mort. Il aurait de quoi s’exercer. Mais de notre temps le ridicule s’est mêlé à la grandeur, à la tragédie, et cela le tue.
J’ai fait comme vous hier au soir ; je me suis couché de bonne heure, à 10 heures et demie Je n’étais pas sorti. J’avais joué au whist. Je me fais pitie, pitié comme tristesse, pitié comme décadence. Des soirées si charmantes ? bonheur à part, je ne puis souffrir de passer mon temps pour le passer, sans y rien recevoir, sans y rien mettre qui me satisfasse et qui me plaise. Le temps, ce trésor si grand, qui s’écoule si vite, le dépenser pour rien, avec personne ! Cela me choque. Je rentre dans ma chambre honteux, petit. Quand au contraire mon temps a été bien rempli, rempli au gré de mon âme, quand le chêne a bien ouvert ses feuilles, et bien joui du soleil, je me retire, je me couché, je m’endors content et fier, animé et reposé. Je dis adieu non sans regret, mais sans amertume à ces belles heures passées. C’est toujours triste de belles heures qui ne sont plus. Mais elles ont été belles ; elles ont eu leur part des dons de Dieu, des biens de la vie. Ce quelles deviennent, où elles vont en s’enfuyant, je ne le sais pas ; le passé comme l’avenir est un mystère, un sanctuaire où notre vue ne pénètre point. Mais quand la portion de nous-mêmes qui disparaît dans ce sanctuaire a été charmante, il en reste une ombre charmante qui ne nous quitte plus. Je l’avais près de moi chaque soir cette ombre d’un jour plein, d’un jour heureux. En le regrettant, j’en jouissais encore. Je ne regrette plus rien, et mes journées tombent derrière moi, sans que j’y pense, sans que je tourne une seule fois la tête pour y regarder.
3 heures et demie
Je vous ai quittée. Je vous désirais trop. Je ne vous reviens que pour vous dire adieu avant de sortir. Je vais faire deux ou trois visites. J’irai probablement voir lady Clanricard. Elle m’a dit qu’elle serait chez elle a cinq heures. Ce soir, j’aurai mes diplomates qui joueront au Whist. Lady Palmerston m’a dit que cela leur plaisait fort, mais que c’était bien dommage que je n’y eusse pas quelques femmes. Je ne trouve pas que ce soit dommage. Adieu. Adieu. Adieu, me plaît, mais ne me contente pas. Adieu.
410. Londres, Samedi 12 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
410. Londres, Samedi 12 septembre 1840
10 heures
Voilà deux lettres, Poix et Beauvais. Que j’ai le cœur léger ! Je l’avais bien gros en m’éveillant. Je n’ai pas voulu écrire. Vous êtes fatiguée. Mais vous avez faim et la France vous plaît. J’aime que la France vous plaise ; et je ne suis pas jaloux de la France. Ni de l’Angleterre non plus. L’Angleterre a été charmante. Tout est charmant ce matin. Dieu m’a donné son pouvoir ; je fais le monde à mon image, sombre ou brillant, triste ou gai selon l’état de mon cœur. Demain, j’aurai de vos nouvelles de Paris. Et tous les jours. Et de longues lettres. Demain, je ne vous écrirai pas à mon grand regret. Je suis forcé d’envoyer un courrier aujourd’hui. Il fait beau. J’espère que vous serez entrée à Paris sous un beau soleil, que les fontaines sont pleines d’eau, les Tuileries encore vertes, que vous aurez regardé avec plaisir par votre fenêtre. Regardez. Est-ce que je n’arrive pas ? Ah, j’y suis toujours, sauf le bonheur.
Je parle beaucoup de Napier moi. J’en parle à tout le monde. Quelques uns me répondent comme je parle. Les autres, essayent de ne pas me répondre du tout.Les plus hardis sont embarrassés. Je n’ai pas encore pu joindre lord Palmerston. Toujours à Broadlands pendant qu’on traduit et copie les ratifications turques. Ni Lady Clanricard qui est à la campagne aussi, on n’a pas su me dire où. Elle revient Lundi. Les Palmerstoniens attendent avec passion les insurgés de Syrie, un pauvre petit insurgé ; on n’en demande pas beaucoup. Ils tardent bien. J’ai peur que tôt ou tard, il n’en vienne assez pour faire égorger ceux qui ne seront pas venus. Quels jouets que les hommes ! Il y a là, au fond de je ne sais quelle vallée au sommet de je ne sais quelle montagne du Liban, des maris, des femmes, des enfants qui s’aiment, qui s’amusent, et qui seront massacrés demain parce que Lord Palmerston en roulant, sur le railway de Londres à Southampton, se sera dit : " Il faut que la Syrie, s’insurge; j’ai besoin de l’insurrection de Syrie ; si la série ne s’insurge pas, I’m fool ! "
3 heures
Il me tombe aujourd’hui je ne sais combien de petites affaires, de l’argent à envoyer à Paris pour le railway de Rouen, des quittances à donner, le bail de ma maison, Earthope, Charles Greville. On m’a pris tout mon temps, depuis le déjeuner. Je me loue beaucoup de Charles Greville. C’est dommage qu’il soit si sourd. Il arrive de Windsor où le Conseil privé s’est tenu hier. Il part demain matin pour Doncaster. Moi, j’écris ce matin à Glasgow et à Edimbourg que je nirai pas. Il faut qu’absolument que je sois à Londres pour recevoir l’insur rection de Syrie, si elle arrive. Voilà des grouses d’Ellice. J’aimais mieux les premières. dit-on, les premiers ou les premières ? Je le demanderai à lord Holland qui est mon dictionnaire anglais. Je reçois un billet de ce pauvre comte de Björmtjerna qui devait venir dîner aujourd’hui avec moi. Il est depuis hier matin dans une taverne, à côté de Customs house, attendant le bateau de Hambourg qui porte sa femme et ses enfants, et qui n’arrive pas. Il y a eu une violente tempête mercredi et jeudi. J’ai grande pitié de lui. J’ai eu hier ma première soirée. Dedel, Vans de Weyer, Hummelauer, Moncorvo, Alava Schleinitz, des secrétaires. Ils ont joué au Whist, à l’écarté, aux échecs. Les sandwich excellentes. Je les leur voyais manger avec humeur. Longchamps, Longchamps ! Pas de nouvelles. Neumann était à Broadlands. Il en revient aujourd’hui pour dîner chez moi. Quoiqu’il n’y ait personne ici, il y a des commérages. On dit que j’ai dit que si nous faisions la guerre, ce ne serait pas sur le Rhin, mais sur le Pô que nous la ferions. L’Autriche s’en est émue. Je dis que je ne l’ai pas dit, mais que je n’entends pas dire que nous ne ferions pas la guerre sur le Pô, si nous la faisions.
Adieu. Vous partez pour le bois de Boulogne. Adieu là comme partout, Adieu.
10 heures
Voilà deux lettres, Poix et Beauvais. Que j’ai le cœur léger ! Je l’avais bien gros en m’éveillant. Je n’ai pas voulu écrire. Vous êtes fatiguée. Mais vous avez faim et la France vous plaît. J’aime que la France vous plaise ; et je ne suis pas jaloux de la France. Ni de l’Angleterre non plus. L’Angleterre a été charmante. Tout est charmant ce matin. Dieu m’a donné son pouvoir ; je fais le monde à mon image, sombre ou brillant, triste ou gai selon l’état de mon cœur. Demain, j’aurai de vos nouvelles de Paris. Et tous les jours. Et de longues lettres. Demain, je ne vous écrirai pas à mon grand regret. Je suis forcé d’envoyer un courrier aujourd’hui. Il fait beau. J’espère que vous serez entrée à Paris sous un beau soleil, que les fontaines sont pleines d’eau, les Tuileries encore vertes, que vous aurez regardé avec plaisir par votre fenêtre. Regardez. Est-ce que je n’arrive pas ? Ah, j’y suis toujours, sauf le bonheur.
Je parle beaucoup de Napier moi. J’en parle à tout le monde. Quelques uns me répondent comme je parle. Les autres, essayent de ne pas me répondre du tout.Les plus hardis sont embarrassés. Je n’ai pas encore pu joindre lord Palmerston. Toujours à Broadlands pendant qu’on traduit et copie les ratifications turques. Ni Lady Clanricard qui est à la campagne aussi, on n’a pas su me dire où. Elle revient Lundi. Les Palmerstoniens attendent avec passion les insurgés de Syrie, un pauvre petit insurgé ; on n’en demande pas beaucoup. Ils tardent bien. J’ai peur que tôt ou tard, il n’en vienne assez pour faire égorger ceux qui ne seront pas venus. Quels jouets que les hommes ! Il y a là, au fond de je ne sais quelle vallée au sommet de je ne sais quelle montagne du Liban, des maris, des femmes, des enfants qui s’aiment, qui s’amusent, et qui seront massacrés demain parce que Lord Palmerston en roulant, sur le railway de Londres à Southampton, se sera dit : " Il faut que la Syrie, s’insurge; j’ai besoin de l’insurrection de Syrie ; si la série ne s’insurge pas, I’m fool ! "
3 heures
Il me tombe aujourd’hui je ne sais combien de petites affaires, de l’argent à envoyer à Paris pour le railway de Rouen, des quittances à donner, le bail de ma maison, Earthope, Charles Greville. On m’a pris tout mon temps, depuis le déjeuner. Je me loue beaucoup de Charles Greville. C’est dommage qu’il soit si sourd. Il arrive de Windsor où le Conseil privé s’est tenu hier. Il part demain matin pour Doncaster. Moi, j’écris ce matin à Glasgow et à Edimbourg que je nirai pas. Il faut qu’absolument que je sois à Londres pour recevoir l’insur rection de Syrie, si elle arrive. Voilà des grouses d’Ellice. J’aimais mieux les premières. dit-on, les premiers ou les premières ? Je le demanderai à lord Holland qui est mon dictionnaire anglais. Je reçois un billet de ce pauvre comte de Björmtjerna qui devait venir dîner aujourd’hui avec moi. Il est depuis hier matin dans une taverne, à côté de Customs house, attendant le bateau de Hambourg qui porte sa femme et ses enfants, et qui n’arrive pas. Il y a eu une violente tempête mercredi et jeudi. J’ai grande pitié de lui. J’ai eu hier ma première soirée. Dedel, Vans de Weyer, Hummelauer, Moncorvo, Alava Schleinitz, des secrétaires. Ils ont joué au Whist, à l’écarté, aux échecs. Les sandwich excellentes. Je les leur voyais manger avec humeur. Longchamps, Longchamps ! Pas de nouvelles. Neumann était à Broadlands. Il en revient aujourd’hui pour dîner chez moi. Quoiqu’il n’y ait personne ici, il y a des commérages. On dit que j’ai dit que si nous faisions la guerre, ce ne serait pas sur le Rhin, mais sur le Pô que nous la ferions. L’Autriche s’en est émue. Je dis que je ne l’ai pas dit, mais que je n’entends pas dire que nous ne ferions pas la guerre sur le Pô, si nous la faisions.
Adieu. Vous partez pour le bois de Boulogne. Adieu là comme partout, Adieu.
414. Londres, Jeudi 17 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1840 (février-octobre) : L’Ambassade à Londres
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
414. Londres, Jeudi 17 septembre 1840
sept heures et demie
Hier au soir à Holland house, Lord et lady Palmerston et lady Clanricard qui y avaient dîné. C’est un singulier spectacle que des gens d’esprit qui ne veulent pas parler de ce qui les occupe. Nous nous sommes extenués pendant deux heures à chercher des conversations. Nous en avons trouvé, beaucoup, de toutes sortes ; nous avons parcouru le monde et les siècles. Nous ne pouvions nous arrêter nulle part ; à peine un sujet abordé, nous le quittions. Evidemment notre pensée était ailleurs. Mais nous ne sommes jamais allés là où elle était. Je serais tenté de croire que Lord Palmerston n’est pas content. Je l’ai trouvé encore maigri, vieilli. J’espère que l’Orient ne lui donnera pas de gloire. Mais, à coup sûr, pas de jeunesse. Savez-vous qu’on dit que la Grèce pourrait bien faire la guerre à la Turquie? Elles sont très mal ; les relations des deux peuples ont presque cessé ; le ministre grec est sur le point de quitter Constantinople. Je serais charmé que cette Grèce, que vous avez faite, prit un rôle dans la question d’Orient. Pourvu que ce ne soit pas celui pour lequel vous l’aviez faite.
Lady Holland va mieux. Lady Clanricard part lundi, je ne sais pour où. J’irai la voir demain. Il me prend un scrupule. Lord Mahon à passé chez moi hier. Je recevrai peut-être une seconde invitation à aller passer vingt quatre heures chez eux à vingt milles de Londres. Je voudrais bien ne pas être impoli. Mais je ne veux être poli qu’avec votre permission. 24 heures. Voilà probablement un vif déplaisir. Les journaux anglais disent qu’ils n’ont par reçu leur exprès de Paris. La violence du vent aura empêché la traversée et pour les lettres, comme pour les journaux. On me dit qu’à cette époque vers l’équinoxe, on est quelquefois deux ou trois jours sans que rien puisse passer. Je ne me souviens pas que ce soit jamais arrivé. Il est vrai que je n’y regardais pas de si près. Pourtant j’ai déjà eu ici une équinoxe, en mars. Tout ce que je vous dis là n’avancera pas d’une heure l’arrivée du courrier et n’ôtera rien à mon impatience.
2 heures
La poste n’est pas venue en effet, et l’on doute qu’elle vienne aujourd’hui. Le nord-ouest qui soufflait hier fermait le port de Calais. Ce matin, tout est calme, excepté moi qui m’impatiente beaucoup plus que personne ne s’en doute. Vous récevrez, vous avez déjà reçu la visite, de mon joli médecin. Parlez-lui de votre santé. Permettez-lui d’y bien regarder de vous questionner. Il a de l’esprit, beaucoup de jugement et beaucoup de zèle. C’est quelque chose que le zèle passionné de la jeunesse. Cela vaut bien quelques fois, l’expérience indifférente de l’âge. Saviez-vous que lady Fanny vient d’écarter, le fils du duc de Richmond, lord March ? Elle le trouve trop enfant : " Je veux un mari qui me dise ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire, non pas un qui me le demande. " Ce n’est pas mal. Elle est toujours mal pour lord Palmerston toujours pressée d’aller chez sa soeur pour ne pas rester à Broadlands. Je vous dis tous les bavardages qu’on me dit. Je cherche à passer le temps.
4 heures
Je viens de faire deux visites, lady Palmerston et la princesse Auguste. Je vais souvent savoir des nouvelles de Stafford house, et de la Princesse Auguste. J’ai trouvé Lady Palmerston, très gracieuse. Elle sait plaire. Elle ne m’a point parlé de vous, mais vous êtes revenue deux ou trois fois dans la conversation d’anciennes petites histoires, une dame Russe qui, débarquant à Londres, vous avait priée de venir la voir at the black Bear, Custom’s house, je ne sais quoi encore ; rien, mais vous. Quel sentiment vous font éprouver les personnes qui savent plaire, et ne savent que plaire ? Dites-moi cela. Adieu. Je n’ai pas, le cœur à vous en dire davantage. Ou plutôt j’aurais le cœur à vous en dire trop. Adieu.
sept heures et demie
Hier au soir à Holland house, Lord et lady Palmerston et lady Clanricard qui y avaient dîné. C’est un singulier spectacle que des gens d’esprit qui ne veulent pas parler de ce qui les occupe. Nous nous sommes extenués pendant deux heures à chercher des conversations. Nous en avons trouvé, beaucoup, de toutes sortes ; nous avons parcouru le monde et les siècles. Nous ne pouvions nous arrêter nulle part ; à peine un sujet abordé, nous le quittions. Evidemment notre pensée était ailleurs. Mais nous ne sommes jamais allés là où elle était. Je serais tenté de croire que Lord Palmerston n’est pas content. Je l’ai trouvé encore maigri, vieilli. J’espère que l’Orient ne lui donnera pas de gloire. Mais, à coup sûr, pas de jeunesse. Savez-vous qu’on dit que la Grèce pourrait bien faire la guerre à la Turquie? Elles sont très mal ; les relations des deux peuples ont presque cessé ; le ministre grec est sur le point de quitter Constantinople. Je serais charmé que cette Grèce, que vous avez faite, prit un rôle dans la question d’Orient. Pourvu que ce ne soit pas celui pour lequel vous l’aviez faite.
Lady Holland va mieux. Lady Clanricard part lundi, je ne sais pour où. J’irai la voir demain. Il me prend un scrupule. Lord Mahon à passé chez moi hier. Je recevrai peut-être une seconde invitation à aller passer vingt quatre heures chez eux à vingt milles de Londres. Je voudrais bien ne pas être impoli. Mais je ne veux être poli qu’avec votre permission. 24 heures. Voilà probablement un vif déplaisir. Les journaux anglais disent qu’ils n’ont par reçu leur exprès de Paris. La violence du vent aura empêché la traversée et pour les lettres, comme pour les journaux. On me dit qu’à cette époque vers l’équinoxe, on est quelquefois deux ou trois jours sans que rien puisse passer. Je ne me souviens pas que ce soit jamais arrivé. Il est vrai que je n’y regardais pas de si près. Pourtant j’ai déjà eu ici une équinoxe, en mars. Tout ce que je vous dis là n’avancera pas d’une heure l’arrivée du courrier et n’ôtera rien à mon impatience.
2 heures
La poste n’est pas venue en effet, et l’on doute qu’elle vienne aujourd’hui. Le nord-ouest qui soufflait hier fermait le port de Calais. Ce matin, tout est calme, excepté moi qui m’impatiente beaucoup plus que personne ne s’en doute. Vous récevrez, vous avez déjà reçu la visite, de mon joli médecin. Parlez-lui de votre santé. Permettez-lui d’y bien regarder de vous questionner. Il a de l’esprit, beaucoup de jugement et beaucoup de zèle. C’est quelque chose que le zèle passionné de la jeunesse. Cela vaut bien quelques fois, l’expérience indifférente de l’âge. Saviez-vous que lady Fanny vient d’écarter, le fils du duc de Richmond, lord March ? Elle le trouve trop enfant : " Je veux un mari qui me dise ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire, non pas un qui me le demande. " Ce n’est pas mal. Elle est toujours mal pour lord Palmerston toujours pressée d’aller chez sa soeur pour ne pas rester à Broadlands. Je vous dis tous les bavardages qu’on me dit. Je cherche à passer le temps.
4 heures
Je viens de faire deux visites, lady Palmerston et la princesse Auguste. Je vais souvent savoir des nouvelles de Stafford house, et de la Princesse Auguste. J’ai trouvé Lady Palmerston, très gracieuse. Elle sait plaire. Elle ne m’a point parlé de vous, mais vous êtes revenue deux ou trois fois dans la conversation d’anciennes petites histoires, une dame Russe qui, débarquant à Londres, vous avait priée de venir la voir at the black Bear, Custom’s house, je ne sais quoi encore ; rien, mais vous. Quel sentiment vous font éprouver les personnes qui savent plaire, et ne savent que plaire ? Dites-moi cela. Adieu. Je n’ai pas, le cœur à vous en dire davantage. Ou plutôt j’aurais le cœur à vous en dire trop. Adieu.
259. Val -Richer,Vendredi 30 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
259 Du Val-Richer, vendredi 29 août 1839, 7 heures
Raisonnablement, j’aime mieux que vous restiez à Paris. Cela est plus commode. Je regretterai pourtant la solitude de Dieppe. Il n'y a pas moyen d'accorder tous ses désirs. Mon projet est d’aller dîner lundi à Evreux avec le Duc de Broglie. J'en repartirai dans la nuit et je serai à Paris mardi matin. J'espère que cela ne contrariera pas vos arrangements. Nous chercherons ensemble une maison. Génie m'en indique trois qu’il a visitées. Deux ne me paraissent rien valoir. L’une rue de Grenelle très près de Mad. de Talleyrand en face du passage Ste Marie, dans une maison de Mad. de La Rochejacquelein au rez-de-chaussée avec un jardin, 6000 fr. La vieille Duchesse de La Force demeure au premier. L'autre, rue de Varennes, près de la rue du Bac. C’est un hôtel [?], beaucoup trop loin. 11 000 francs. La troisième me semble meilleure, rue St Dominique entre la rue Belle-Chasse et l’hôtel du Consul d'Etat, presque en face des Brignole. Elle appartient au comte de Schulenbourg. 10 000 francs. Une belle cour des communs assez bien disposée. Un rez-de-chaussée seulement. Deux salons une salle à manger, une salle de billard, quatre chambres à coucher, des dépendances suffisantes. Un petit jardin de forme irrégulière et pas gracieuse resseré entre le Jardin du Conseit d'Etat et celui de Pozzo. Voici l'objection. C’est au Nord. Mais vous devriez le voir.
Le Pacha a bien raison de refuser. Vous voyez que déjà on n'avoue pas la proposition. Si j'étais de ses amis, je lui conseillerais ce qu’il a imaginé lui-même maintenir et attendre. L’Angleterre a une bien petite politique.
9 h. 1/2 Je vais décidément dîner à Evreux lundi. Si vous deviez être mardi à Rouen, ou à Dieppe, j’irais d’Evreux vous chercher là. Mais si vous êtes encore à Paris mardi j’y serai, moi, dans la journée de mardi et là nous verrons. Cela me paraît l’arrangement le moins compliqué. En tout cas je recevrai encore votre réponse à ceci, et même à ce que je vous écrivais demain car je ne passerai Lundi matin, à Lisieux qu’après l’arrivée de la poste. Adieu. Adieu. Il y a mille à parier contre un, contre la guerre.
Raisonnablement, j’aime mieux que vous restiez à Paris. Cela est plus commode. Je regretterai pourtant la solitude de Dieppe. Il n'y a pas moyen d'accorder tous ses désirs. Mon projet est d’aller dîner lundi à Evreux avec le Duc de Broglie. J'en repartirai dans la nuit et je serai à Paris mardi matin. J'espère que cela ne contrariera pas vos arrangements. Nous chercherons ensemble une maison. Génie m'en indique trois qu’il a visitées. Deux ne me paraissent rien valoir. L’une rue de Grenelle très près de Mad. de Talleyrand en face du passage Ste Marie, dans une maison de Mad. de La Rochejacquelein au rez-de-chaussée avec un jardin, 6000 fr. La vieille Duchesse de La Force demeure au premier. L'autre, rue de Varennes, près de la rue du Bac. C’est un hôtel [?], beaucoup trop loin. 11 000 francs. La troisième me semble meilleure, rue St Dominique entre la rue Belle-Chasse et l’hôtel du Consul d'Etat, presque en face des Brignole. Elle appartient au comte de Schulenbourg. 10 000 francs. Une belle cour des communs assez bien disposée. Un rez-de-chaussée seulement. Deux salons une salle à manger, une salle de billard, quatre chambres à coucher, des dépendances suffisantes. Un petit jardin de forme irrégulière et pas gracieuse resseré entre le Jardin du Conseit d'Etat et celui de Pozzo. Voici l'objection. C’est au Nord. Mais vous devriez le voir.
Le Pacha a bien raison de refuser. Vous voyez que déjà on n'avoue pas la proposition. Si j'étais de ses amis, je lui conseillerais ce qu’il a imaginé lui-même maintenir et attendre. L’Angleterre a une bien petite politique.
9 h. 1/2 Je vais décidément dîner à Evreux lundi. Si vous deviez être mardi à Rouen, ou à Dieppe, j’irais d’Evreux vous chercher là. Mais si vous êtes encore à Paris mardi j’y serai, moi, dans la journée de mardi et là nous verrons. Cela me paraît l’arrangement le moins compliqué. En tout cas je recevrai encore votre réponse à ceci, et même à ce que je vous écrivais demain car je ne passerai Lundi matin, à Lisieux qu’après l’arrivée de la poste. Adieu. Adieu. Il y a mille à parier contre un, contre la guerre.
273. Val-Richer, Dimanche 22 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
273 Du Val-Richer, Dimanche 22 Sept 1839 7 heures
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
Je viens à vous en me levant. Quand j'ai du monde, je ne dispose pas de ma soirée. Elle n'est pas amusante, savez-vous à quelle condition on supporte le commun des hommes ? à condition d'avoir quelque chose à en faire. Quand on les emploie, quand on va a un but à la bonne heure ; le but anime la route, l'utilité enfante l’intérêt. Mais le vulgaire pour rien, pour s’en amuser, et pour l'amuser ! C’est bien lourd.
J’ai là sous les yeux quelque chose de bien lourd aussi ; un jeune ménage, marié depuis deux mois, une jeune femme de 19 ans, ni laide, ni jolie, ni spirituelle, ni bête, ni glacée, ni animée, parfaitement insignifiante, ordinaire, une jeune femme, rien de moins, rien de plus. Comment se marie-t-on à cela ? Le vulgaire en passant dans un salon, c’est beaucoup ; mais le vulgaire dans l’intimité, pour toujours ! Je n'ai jamais compris qu’on s'y résignât. J’aurais été à ce compte, un bien mauvais mari.
Le Roi des Pays-Bas sera-t-il un bon mari pour Melle d’Outremont ? Il me semble qu’il était, pour la première, assez dur et peu fidèle. celle-ci aura, je pense, les infidélités de moins à subir. Je crois, comme vous, que dans la disposition de tout le monde, peu ou beaucoup de vaisseaux aux Dardanelles, c'est fort la même chose. Pourquoi ne se le dit-on pas, comme nous le disons ? Mais il faut être prêt les uns contre les autres, même quand on marche ensemble. Que sait-on ? Le hasard !
Voici ce que m'écrit hier un ministre. " Le Rois, m’a parlé hier de vous, fortement avec un vif désir de votre appui, et un sentiment très profond de tout ce que vous êtes. Pour moi, mon cher ami, qui n’ai qu'une petite responsabilité & un médiocre souci de moi-même, l’honneur sauf, je n’en attends pas moins la session avec une grave anxiété. L'affaire d’Espagne est un accident heureux et un mérite. Mais la Turquie nous reste avec tous ses hasards ; et il me semble cependant qu'avec cette intention de paix qui est générale et que doit partager un souverain prudent et conséquent, tout absolu qu’il est, une ambassade habile et active serait d’un poids immense, et pourrait prévenir ce qui deviendra peut-être inévitable, sans que personne le veuille, mais parce que personne ne saurait le détourner à temps. Je suis un faible politique, mais je n'ai pas une autre pensée que celle-là dans le temps actuel. "
Vous voyez qu’on a toujours bien envie, de m'avoir et de m'éloigner. On ne fera ni l’un ni l’autre. Lisez, dans le dernier cahier de la Revue des deux mondes (15 septembre) un long article sur le Duc de Wellington, à l'occasion de ses dépêches. Il vous intéressera. C’est un assez curieux spectacle que ce vent d’impartialité qui souffle sur nous et nous fait rendre justice contre le sentiment populaire si cela s'accorde jamais avec un fort esprit national, ce sera très beau.
C’est Pascal, je crois, qui dit : " je n'estime point un homme qui possède une vertu, s’il ne possède en même temps et au même degré, la vertu contraire. " Il a raison. Mais c’est bien de l’exigence. A la vérité on n'obtient rien de bon des hommes qu'à force d’exigence.
9 heures et demie
C’est bien vrai que vos soirées et les miennes, vous chez Armin, moi avec mon jeune ménage, c’est absurde ! Et nous serions si bien ! Il n’y a point de nouvelles. Je vous dis tout ce qu’on m’écrit. On est fort occupé des émeutes du Mans de la réforme du Conseil d'Etat & Tout cela ne vous fait rien. Vous avez raison de bien finir l’affaire de l'entresol. Il n'y a point de sûreté avec ce monde là. Adieu. Adieu. Le plus long adieu possible. Il n'y a de long que ce qui est éternel. G.
280. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1839 ( 1er juin - 5 octobre )
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
280 Du Val Richer, samedi 28 sept 1839 5 heures
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
20. Val-Richer, Samedi 16 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
20 Val Richer Samedi 16 août 1845
8 heures et demie
J’écris depuis six heures du matin, et je viens de recevoir, un courrier énorme qui me donnera à écrire toute la journée. La Syrie, la Grèce, l’Espagne, Rome la Prusse. A tout prendre tout va assez bien partout ! C’est à dire que partout, nous marchons à notre but, et nous grandissons en marchant. Les chemins sont difficiles. Nous bronchons quelques fois. Nous nous arrêtons de temps en temps, tantôt par nécessité, tantôt volontairement. C'est le cours ordinaire des choses. Il n’y a que les enfants qui s'en plaignent. Mais, je vous le répète tout va assez bien partout. Ce qui n'empêchera pas que l'avenir ne soit chargé d’embarras, d'ennemis, de combats, de périls. Je ne m'en plaindrai pas davantage, si, en dernière analyse, j’obtiens les mêmes résultats. Vous vous rappelez le mauvais début de la dernière session. Et bien aucune n’a aussi bien fini, ni laissé dans le pays une si profonde impression de succès et de progrès.
Je suis très content de Piscatory. Lyons travaille avec passion à faire ce qu’il lui reproche d'avoir fait, à allier M. Mavrocordato et M. Metaxa pour renverser. M. Colettis. L'alliance Anglo-Russe à la place de l'alliance Franco-Russe maintenant debout. Lyons a échoué. Et dans l'alliance Franco-Russe, Colettis a gagné beaucoup de terrain. Piscatory a vraiment beaucoup de savoir faire. Et je ne vois pas qu’il se soit écarté de l'épaisseur d'un cheveu, de la ligne que je lui ai tracée à Constantinople, on s'occupe sérieusement des affaires de Syrie. Le Ministre des Affaires étrangères, Chékib Etfendi, y est envoyé en mission pacificatrice, avec de grands pouvoirs. Nous verrons s'il en sortira quelque chose. Le public est exigeant. Il ne se contente pas d'être bien gouverné lui-même. Il veut que tous les gouvernements soient bons, même le Turc.
En Espagne, le duc de Séville a réellement, gagné un peu de terrain. Même ce me semble dans l’esprit de la Reine Christine. Vous savez que nous n'avons ni extérieurement ni au fond du cœur, pas la moindre objection à cette combinaison. J’ai averti à Naples qu’elle était en progrès. Le langage de M. le Duc de Nemours à Pampelune sera très bon. Il a été un peu indisposé à Bordeaux. Pure fatigue du voyage, qui est fatigant en effet, mais utile.
Thiers aussi va voyager en Espagne. Pour voir les champs de bataille. Et aussi en Portugal. Il y emploiera, le mois de septembre. Il va en compagnie. peut-être MM. de Rémusat, Mérimée (votre bon député), &... Bülow de plus en plus mal. D'après le langage, de ses amis mêmes, on croit sa situation désespérée. Les émeutes religieuses se multiplient en Prusse. Halberstadt a eu la sienne pour Ronge comme Posen pour Cgerski. Je ne crois pas au succès des nouvelles religions. Mais elles feront du mal aux anciennes, et j’en suis fâché. Adieu.
C'est mardi seulement que je vous saurai arrivée à Boulogne, car je compte que vous n'aurez quitté Londres qu'aujourd'hui. Ce que vous me dîtes de vos yeux me charme. Adieu. Adieu
8 heures et demie
J’écris depuis six heures du matin, et je viens de recevoir, un courrier énorme qui me donnera à écrire toute la journée. La Syrie, la Grèce, l’Espagne, Rome la Prusse. A tout prendre tout va assez bien partout ! C’est à dire que partout, nous marchons à notre but, et nous grandissons en marchant. Les chemins sont difficiles. Nous bronchons quelques fois. Nous nous arrêtons de temps en temps, tantôt par nécessité, tantôt volontairement. C'est le cours ordinaire des choses. Il n’y a que les enfants qui s'en plaignent. Mais, je vous le répète tout va assez bien partout. Ce qui n'empêchera pas que l'avenir ne soit chargé d’embarras, d'ennemis, de combats, de périls. Je ne m'en plaindrai pas davantage, si, en dernière analyse, j’obtiens les mêmes résultats. Vous vous rappelez le mauvais début de la dernière session. Et bien aucune n’a aussi bien fini, ni laissé dans le pays une si profonde impression de succès et de progrès.
Je suis très content de Piscatory. Lyons travaille avec passion à faire ce qu’il lui reproche d'avoir fait, à allier M. Mavrocordato et M. Metaxa pour renverser. M. Colettis. L'alliance Anglo-Russe à la place de l'alliance Franco-Russe maintenant debout. Lyons a échoué. Et dans l'alliance Franco-Russe, Colettis a gagné beaucoup de terrain. Piscatory a vraiment beaucoup de savoir faire. Et je ne vois pas qu’il se soit écarté de l'épaisseur d'un cheveu, de la ligne que je lui ai tracée à Constantinople, on s'occupe sérieusement des affaires de Syrie. Le Ministre des Affaires étrangères, Chékib Etfendi, y est envoyé en mission pacificatrice, avec de grands pouvoirs. Nous verrons s'il en sortira quelque chose. Le public est exigeant. Il ne se contente pas d'être bien gouverné lui-même. Il veut que tous les gouvernements soient bons, même le Turc.
En Espagne, le duc de Séville a réellement, gagné un peu de terrain. Même ce me semble dans l’esprit de la Reine Christine. Vous savez que nous n'avons ni extérieurement ni au fond du cœur, pas la moindre objection à cette combinaison. J’ai averti à Naples qu’elle était en progrès. Le langage de M. le Duc de Nemours à Pampelune sera très bon. Il a été un peu indisposé à Bordeaux. Pure fatigue du voyage, qui est fatigant en effet, mais utile.
Thiers aussi va voyager en Espagne. Pour voir les champs de bataille. Et aussi en Portugal. Il y emploiera, le mois de septembre. Il va en compagnie. peut-être MM. de Rémusat, Mérimée (votre bon député), &... Bülow de plus en plus mal. D'après le langage, de ses amis mêmes, on croit sa situation désespérée. Les émeutes religieuses se multiplient en Prusse. Halberstadt a eu la sienne pour Ronge comme Posen pour Cgerski. Je ne crois pas au succès des nouvelles religions. Mais elles feront du mal aux anciennes, et j’en suis fâché. Adieu.
C'est mardi seulement que je vous saurai arrivée à Boulogne, car je compte que vous n'aurez quitté Londres qu'aujourd'hui. Ce que vous me dîtes de vos yeux me charme. Adieu. Adieu
21. Val-Richer, Dimanche 17 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
21 Val Richer, Dimanche 17 août 1845
8 heures et demie
Je voudrais vous savoir positivement entre Douvres et Boulogne dans ce moment-ci. Il fait un temps superbe, point de vent, un beau soleil. Nous n'avons pas eu une telle journée depuis que nous nous sommes séparés. Cela me plaît que vous rentriez en France par un beau temps. Je veux aussi qu’il fasse beau le 30 août. Et puis dans le mois de septembre, j’espère que nous aurons encore de beaux jours, à Beauséjour. Mais il faudra rentrer en ville, au commencement d’octobre. L’humidité ne vaut rien ni à vous ni à moi, ni à mes enfants. Et la campagne est toujours plus humide que la ville.
Henriette est très bien, mais maigrie et pâle. Elle a été très fatiguée. Elle a besoin de se remplumer.
Je vais bien loin de Beauséjour. J'ai des nouvelles de Perse qui m’intéressent assez. Sartiger s'y conduit très bien. Il y a fait rentrer les Lazaristes que M. de Médem en avait fait chasser. M. de Médem a été très mauvais pour nous. Il vient d’être rappelé et remplacé par un Prince Dolgorouki qui était à votre Ambassade à Constantinople. On dit qu’il sera plus modéré que Médem. On m'en parle bien. Un petit incident à Constantinople dont je suis bien aise. Le duc de Montpensier doit y être arrivé ces jours-ci. Bourqueney a communiqué d'avance à Chekib Effendi la liste des officiers qui l'accompagnaient, & devaient être présentés au Sultan. Dans le nombre, se trouvait un Abd el-At, Algérien, Arabe, Musulman, sous lieuteuant de Spahir à notre service. Vive émotion parmi les Turcs ; Comment présenter un tel homme au Sultan ? Insinuations, supplications à Bourqueney d’épargner ce calice. Il a très bien senti la gravité du cas et répondu très convenablement mais très vertement. On s'est confondu en protestations ; Abd el-Al sera reçu comme les autres officiers du Prince. Tout le régiment des Spahir serait reçu s’il accompagnait le Prince. Et de bonnes paroles sur notre possession d’Alger qu’on sait bien irrévocable, ceci fera faire un pas à la reconnaissance par la Porte. Adieu. Adieu.
J’ai des hôtes ce matin. Puis, dans la semaine où nous entrons & les premiers jours de la suivante, trois grands déjeuners de 25 personnes chacun. Mes politesses électorales à la campagne, le déjeuner est plus commode que le dîner.
Je regrette Bulwer pour votre route. Comme agrément, car comme utilité, si vous aviez besoin de quelque chose, je doute qu’il fût bon à grand chose. Quand vous reviendrez de Boulogne vous savez que Génie a, si vous voulez, quelqu'un à votre disposition. Adieu. Adieu.
Je me porte très bien. J’ai le sentiment que marcher beaucoup me fait beaucoup de bien. Seulement il n’y a pas moyen de réunir les deux choses, le mouvement physique et l'activité intellectuelle. Il faut choisir. Adieu. Adieu. G.
8 heures et demie
Je voudrais vous savoir positivement entre Douvres et Boulogne dans ce moment-ci. Il fait un temps superbe, point de vent, un beau soleil. Nous n'avons pas eu une telle journée depuis que nous nous sommes séparés. Cela me plaît que vous rentriez en France par un beau temps. Je veux aussi qu’il fasse beau le 30 août. Et puis dans le mois de septembre, j’espère que nous aurons encore de beaux jours, à Beauséjour. Mais il faudra rentrer en ville, au commencement d’octobre. L’humidité ne vaut rien ni à vous ni à moi, ni à mes enfants. Et la campagne est toujours plus humide que la ville.
Henriette est très bien, mais maigrie et pâle. Elle a été très fatiguée. Elle a besoin de se remplumer.
Je vais bien loin de Beauséjour. J'ai des nouvelles de Perse qui m’intéressent assez. Sartiger s'y conduit très bien. Il y a fait rentrer les Lazaristes que M. de Médem en avait fait chasser. M. de Médem a été très mauvais pour nous. Il vient d’être rappelé et remplacé par un Prince Dolgorouki qui était à votre Ambassade à Constantinople. On dit qu’il sera plus modéré que Médem. On m'en parle bien. Un petit incident à Constantinople dont je suis bien aise. Le duc de Montpensier doit y être arrivé ces jours-ci. Bourqueney a communiqué d'avance à Chekib Effendi la liste des officiers qui l'accompagnaient, & devaient être présentés au Sultan. Dans le nombre, se trouvait un Abd el-At, Algérien, Arabe, Musulman, sous lieuteuant de Spahir à notre service. Vive émotion parmi les Turcs ; Comment présenter un tel homme au Sultan ? Insinuations, supplications à Bourqueney d’épargner ce calice. Il a très bien senti la gravité du cas et répondu très convenablement mais très vertement. On s'est confondu en protestations ; Abd el-Al sera reçu comme les autres officiers du Prince. Tout le régiment des Spahir serait reçu s’il accompagnait le Prince. Et de bonnes paroles sur notre possession d’Alger qu’on sait bien irrévocable, ceci fera faire un pas à la reconnaissance par la Porte. Adieu. Adieu.
J’ai des hôtes ce matin. Puis, dans la semaine où nous entrons & les premiers jours de la suivante, trois grands déjeuners de 25 personnes chacun. Mes politesses électorales à la campagne, le déjeuner est plus commode que le dîner.
Je regrette Bulwer pour votre route. Comme agrément, car comme utilité, si vous aviez besoin de quelque chose, je doute qu’il fût bon à grand chose. Quand vous reviendrez de Boulogne vous savez que Génie a, si vous voulez, quelqu'un à votre disposition. Adieu. Adieu.
Je me porte très bien. J’ai le sentiment que marcher beaucoup me fait beaucoup de bien. Seulement il n’y a pas moyen de réunir les deux choses, le mouvement physique et l'activité intellectuelle. Il faut choisir. Adieu. Adieu. G.
27. Val-Richer, Samedi 23 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
27. Val-Richer, Samedi 23 août 1845
Il me survient ce matin une nécessité absolue d'écrire une longue lettre au maréchal Bugeaud. Des difficultés, des tracasseries, des étourderies, sans intérêt pour vous, mais dont il faut que je m'occupe et qui me prennent le temps que je vous destinais. A Beauséjour, le mal n'est pas grand. Si quelque incident nous ôte un quart d’heure, nous le retrouvons bientôt. De loin, on ne répare rien. Je suis bien impatient du 30. Je voudrais qu’il fit aussi beau qu’aujourd’hui. Mais les soirées commencent à devenir longues, fraîches et longues. On ne peut plus guère sortir le soir. Comment vous arrangez-vous des lumières ? En tous cas, nous resterons, dans l’obscurité.
Je serai bien aise de causer avec Bulwer. J’en serais encore plus aise, si j’avais confiance. Mais enfin il a de l’esprit et point de mauvais vouloir. J'ai commencé à parcourir la Correspondance de Sir Stratford Canning sur les affaires de Syrie. Je la trouve bonne, sensée, nette, ferme. Je traiterais volontiers avec cet homme-là malgré son difficile caractère. Deux in folio de Parliamentary Papers sur la Syrie. Et j'ai beau chercher : je ne vois aucun moyen efficace d’arranger vraiment ces affaires-là. Il y faudrait la très bonne foi et le très actif concours de la Porte. Et la Porte est apathique, & nous trompe. Mes nouvelles d'Allemagne sont de plus en plus graves. Les populations très animées ; les gouvernements très inquiets et abattus. Le Roi de Prusse, toujours gai et confiant. M. de Metternich espérait un peu après Stolzenfel. Une visite de lui au Johannisberg. Le Roi retourne sans s'arrêter à Berlin. Le pauvre Roi de saxe est désolé. Il a dit, les larmes aux yeux, à la députation de Leipzig que c’était le jour le plus triste de sa vie. " Et comment les choses là m’arrivent-elles à moi qui n’ai jamais souhaité que le plus grand bonheur de mes sujets ? "
C'est singulier que dans les temps difficiles, il y ait toujours à côté des Rois, un frère compromettant. Adieu. Adieu.
Je vois qu’il n’y aura point de Mouchy. Si vous parlez demain Dimanche, vous serez donc à Beauséjour, après-demain lundi. Vous ai-je dit que Génie qui y est allé, l’a trouvé charmant plus fleuri que jamais ? Moi, j’ai du monde à déjeuner lundi. Salvandy mardi. Du monde à déjeuner Mercredi. Une visite à Lisieux Jeudi. Mes paquets vendredi. Samedi, à 5 heures du matin je serai en voiture. Je crois que vous me trouverez tres bonne mine. Adieu. Adieu. G.
Je pense en ce moment que cette lettre-ci n’ira plus vous chercher à Boulogne et vous sera portée Lundi à Beauséjour. Heureuse lettre !
Il me survient ce matin une nécessité absolue d'écrire une longue lettre au maréchal Bugeaud. Des difficultés, des tracasseries, des étourderies, sans intérêt pour vous, mais dont il faut que je m'occupe et qui me prennent le temps que je vous destinais. A Beauséjour, le mal n'est pas grand. Si quelque incident nous ôte un quart d’heure, nous le retrouvons bientôt. De loin, on ne répare rien. Je suis bien impatient du 30. Je voudrais qu’il fit aussi beau qu’aujourd’hui. Mais les soirées commencent à devenir longues, fraîches et longues. On ne peut plus guère sortir le soir. Comment vous arrangez-vous des lumières ? En tous cas, nous resterons, dans l’obscurité.
Je serai bien aise de causer avec Bulwer. J’en serais encore plus aise, si j’avais confiance. Mais enfin il a de l’esprit et point de mauvais vouloir. J'ai commencé à parcourir la Correspondance de Sir Stratford Canning sur les affaires de Syrie. Je la trouve bonne, sensée, nette, ferme. Je traiterais volontiers avec cet homme-là malgré son difficile caractère. Deux in folio de Parliamentary Papers sur la Syrie. Et j'ai beau chercher : je ne vois aucun moyen efficace d’arranger vraiment ces affaires-là. Il y faudrait la très bonne foi et le très actif concours de la Porte. Et la Porte est apathique, & nous trompe. Mes nouvelles d'Allemagne sont de plus en plus graves. Les populations très animées ; les gouvernements très inquiets et abattus. Le Roi de Prusse, toujours gai et confiant. M. de Metternich espérait un peu après Stolzenfel. Une visite de lui au Johannisberg. Le Roi retourne sans s'arrêter à Berlin. Le pauvre Roi de saxe est désolé. Il a dit, les larmes aux yeux, à la députation de Leipzig que c’était le jour le plus triste de sa vie. " Et comment les choses là m’arrivent-elles à moi qui n’ai jamais souhaité que le plus grand bonheur de mes sujets ? "
C'est singulier que dans les temps difficiles, il y ait toujours à côté des Rois, un frère compromettant. Adieu. Adieu.
Je vois qu’il n’y aura point de Mouchy. Si vous parlez demain Dimanche, vous serez donc à Beauséjour, après-demain lundi. Vous ai-je dit que Génie qui y est allé, l’a trouvé charmant plus fleuri que jamais ? Moi, j’ai du monde à déjeuner lundi. Salvandy mardi. Du monde à déjeuner Mercredi. Une visite à Lisieux Jeudi. Mes paquets vendredi. Samedi, à 5 heures du matin je serai en voiture. Je crois que vous me trouverez tres bonne mine. Adieu. Adieu. G.
Je pense en ce moment que cette lettre-ci n’ira plus vous chercher à Boulogne et vous sera portée Lundi à Beauséjour. Heureuse lettre !
29. Val-Richer, Mardi 26 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
29 Val Richer Mardi 26 août 1845
Je me brouille dans mes Numéros. Mais ce n'est plus la peine de compter sur mes doigts. Je n’ai plus que trois fois à vous écrire. Charmant plaisir samedi. Jarnac m'écrit : " Ma petite course à Southampton m’a fait perdre les deux derniers jours de Madame de Lieven à Londres ce que j’ai fort regretté. Je crois qu’elle s’est plu ici, et qu’elle est contente de ses consultations. Ce qui m'en revient indirectement est fort satisfaisant. " J'ai toujours préféré que vous passassiez le temps de mon absence, en Angleterre. Quand vous n'êtes pas avec moi, je vous aime mieux là qu'ailleurs. Je ne vous trouve bien que là.
J’ai eu hier mes 20 amis à déjeuner, bien contents de moi, je crois, et de Guillet. Après déjeuner, c’est-à-dire vers 4 heures comme j’allais me promener, le général de la Rue m'est arrivée du château d’Eu où il venait d'arriver d'Afrique après avoir échangé les tarifications du dernier traité avec le Maroc. C’est un homme d'assez d’esprit avec le plus beau coup de sabre imaginable sur la joue gauche. Il m’a intéressé sur l’Afrique, le maréchal Bugeaud, l’Empereur de Maroc, Sir Robert Wilson, Sidi Bousalam &. Sir Robert malgré la verte réprimande de Lord Stanley, continue toujours à se mêler beaucoup du Maroc et à y faire ce qu’il peut contre notre influence. Il agit par le consul Marocain à Gibraltar et par le Pacha de Sétuan, jeune grand seigneur marocain avec qui il est lié et qu’il va voir souvent. Notre campagne de l’année dernière contre le Maroc a fait là un effet immense et qui subsiste, à ce qu’il parait.
Le pauvre Consul Général d'Angleterre, M. Drummond Hay excellent et très loyal homme, est mort de chagrin de n'avoir pas réussi à prévenir l’évènement et d’avoir vu la prépondérance, à peu près exclusive de son pays périr là, entre ses mains. Le nom du Prince de Joinville reste là fort grand. Il a laissé chez les Marocains une vive impression de courage, de savoir-faire, de sagesse, et de politesse. Le Général de la Rue m'a quitté à 9 heures. Le Maréchal Bugeaud vient passer trois mois en France, chez lui, et va faire, en arrivant une visite de quelques jours au Maréchal Soult à Soultberg-(Le Maréchal ne dit et n'écrit jamais autrement. Par tendresse pour la Maréchale Allemande.) La conversation entre les deux Maréchaux sera fort tendue, fort diplomatique, & par moments fort orageuse. Je vais faire ma toilette. J’attends tout-à-l ’heure Salvandy et Broglie.
9 heures
Voici un courrier qui m’apporte de grosses nouvelles, la destitution de Riga Pacha à Constantinople la retraite de Métaxa à Athènes. Je m’attendais à celle-ci et elle me déplaît quoique tout ce qui me revient de Grèce me porte à croire que Colettis n’en sera pas ébranlé. Mais rien absolument n’annonçait la première, et elle a été imprévue pour tout le corps diplomatique européen. Bourqueney ne se l’explique pas bien encore. Cependant, au premier aspect, il la considère comme une victoire du parti réformateur en Turquie.
Je vais lire tout cela, attentivement. Raisonnablement, le moment vient de retourner à Paris. C’est bien heureux que la raison me fasse tant de plaisir. Je reçois une lettre du Duc de Noailles. Il a eu son fils malade, mais le rétablissement est complet. Il me demande beaucoup de vos nouvelles. et finit en me disant : " Madame de Lieven aurait bien mérité, par son aimable intérêt, d'être invitée à la cérémonie qui aura lieu ici. Dimanche prochain, la pose de la première pierre du viaduc à Maintenon du chemin de fer de Chartres. " Adieu. Adieu. G.
Je me brouille dans mes Numéros. Mais ce n'est plus la peine de compter sur mes doigts. Je n’ai plus que trois fois à vous écrire. Charmant plaisir samedi. Jarnac m'écrit : " Ma petite course à Southampton m’a fait perdre les deux derniers jours de Madame de Lieven à Londres ce que j’ai fort regretté. Je crois qu’elle s’est plu ici, et qu’elle est contente de ses consultations. Ce qui m'en revient indirectement est fort satisfaisant. " J'ai toujours préféré que vous passassiez le temps de mon absence, en Angleterre. Quand vous n'êtes pas avec moi, je vous aime mieux là qu'ailleurs. Je ne vous trouve bien que là.
J’ai eu hier mes 20 amis à déjeuner, bien contents de moi, je crois, et de Guillet. Après déjeuner, c’est-à-dire vers 4 heures comme j’allais me promener, le général de la Rue m'est arrivée du château d’Eu où il venait d'arriver d'Afrique après avoir échangé les tarifications du dernier traité avec le Maroc. C’est un homme d'assez d’esprit avec le plus beau coup de sabre imaginable sur la joue gauche. Il m’a intéressé sur l’Afrique, le maréchal Bugeaud, l’Empereur de Maroc, Sir Robert Wilson, Sidi Bousalam &. Sir Robert malgré la verte réprimande de Lord Stanley, continue toujours à se mêler beaucoup du Maroc et à y faire ce qu’il peut contre notre influence. Il agit par le consul Marocain à Gibraltar et par le Pacha de Sétuan, jeune grand seigneur marocain avec qui il est lié et qu’il va voir souvent. Notre campagne de l’année dernière contre le Maroc a fait là un effet immense et qui subsiste, à ce qu’il parait.
Le pauvre Consul Général d'Angleterre, M. Drummond Hay excellent et très loyal homme, est mort de chagrin de n'avoir pas réussi à prévenir l’évènement et d’avoir vu la prépondérance, à peu près exclusive de son pays périr là, entre ses mains. Le nom du Prince de Joinville reste là fort grand. Il a laissé chez les Marocains une vive impression de courage, de savoir-faire, de sagesse, et de politesse. Le Général de la Rue m'a quitté à 9 heures. Le Maréchal Bugeaud vient passer trois mois en France, chez lui, et va faire, en arrivant une visite de quelques jours au Maréchal Soult à Soultberg-(Le Maréchal ne dit et n'écrit jamais autrement. Par tendresse pour la Maréchale Allemande.) La conversation entre les deux Maréchaux sera fort tendue, fort diplomatique, & par moments fort orageuse. Je vais faire ma toilette. J’attends tout-à-l ’heure Salvandy et Broglie.
9 heures
Voici un courrier qui m’apporte de grosses nouvelles, la destitution de Riga Pacha à Constantinople la retraite de Métaxa à Athènes. Je m’attendais à celle-ci et elle me déplaît quoique tout ce qui me revient de Grèce me porte à croire que Colettis n’en sera pas ébranlé. Mais rien absolument n’annonçait la première, et elle a été imprévue pour tout le corps diplomatique européen. Bourqueney ne se l’explique pas bien encore. Cependant, au premier aspect, il la considère comme une victoire du parti réformateur en Turquie.
Je vais lire tout cela, attentivement. Raisonnablement, le moment vient de retourner à Paris. C’est bien heureux que la raison me fasse tant de plaisir. Je reçois une lettre du Duc de Noailles. Il a eu son fils malade, mais le rétablissement est complet. Il me demande beaucoup de vos nouvelles. et finit en me disant : " Madame de Lieven aurait bien mérité, par son aimable intérêt, d'être invitée à la cérémonie qui aura lieu ici. Dimanche prochain, la pose de la première pierre du viaduc à Maintenon du chemin de fer de Chartres. " Adieu. Adieu. G.
97. Val Richer, Dimanche 18 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
97 Val Richer, Dimanche 18 juin 1854
J’ai probablement tort de mettre quelque importance au voyage du Roi de Prusse à Kenigsberg ; mais toutes les circonstances me semblent indiquer que c’est quelque chose, le départ précipité du roi qui n’attend pas la fête du son frère, le Prince de Prusse qui va rejoindre le Roi, même, M. de Manteuffel qui n’y va pas et qui, depuis quelque temps, doit être devenu assez désagréable à votre Empereur. Enfin, on s'accroche à tout.
Est-il vrai que votre impératrice soit de nouveau très souffrante ? Et à cause de vous et à cause de ce que j’ai entrevu d'elle, je lui porte un véritable intérêt. Donnez-moi, je vous prie de ses nouvelles. Elle doit être au moins fort triste.
Vous avez surement remarqué le trait de M. de Brück à Constantinople : " Au succès des armées des puissances alliées. ! " Cela ressemble bien à une préface de la guerre. Je serai curieux de savoir si, comme le disait, il y a quelques jours le journal des Débats, c'est encore le Prince de Metternich qui, du fond de sa vieillesse et de sa surdité, dirige cette politique. Je penche à le croire.
Midi
J’ai été dérangé par deux visites matinales. Je n'ai que le temps de lire votre n°81 et de vous dire, adieu, Adieu. C'est bien court. Adieu. G.
J’ai probablement tort de mettre quelque importance au voyage du Roi de Prusse à Kenigsberg ; mais toutes les circonstances me semblent indiquer que c’est quelque chose, le départ précipité du roi qui n’attend pas la fête du son frère, le Prince de Prusse qui va rejoindre le Roi, même, M. de Manteuffel qui n’y va pas et qui, depuis quelque temps, doit être devenu assez désagréable à votre Empereur. Enfin, on s'accroche à tout.
Est-il vrai que votre impératrice soit de nouveau très souffrante ? Et à cause de vous et à cause de ce que j’ai entrevu d'elle, je lui porte un véritable intérêt. Donnez-moi, je vous prie de ses nouvelles. Elle doit être au moins fort triste.
Vous avez surement remarqué le trait de M. de Brück à Constantinople : " Au succès des armées des puissances alliées. ! " Cela ressemble bien à une préface de la guerre. Je serai curieux de savoir si, comme le disait, il y a quelques jours le journal des Débats, c'est encore le Prince de Metternich qui, du fond de sa vieillesse et de sa surdité, dirige cette politique. Je penche à le croire.
Midi
J’ai été dérangé par deux visites matinales. Je n'ai que le temps de lire votre n°81 et de vous dire, adieu, Adieu. C'est bien court. Adieu. G.
Val Richer, Samedi 28 mai 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 28 Mai 1853
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier en arrivant. J'étais en retard et mon facteur, en avance. Le temps m'a manqué. Je suis arrivé fatigué. Je le suis depuis quelque temps. J’ai besoin du bon air et du profond repos que je trouve ici. Le silence et la solitude ; rien à entendre et personne à attendre, pas plus de dérangement que d'affaire. Quand on devient vieux, il faut ou de grands intérêts ou un grand calme ; le mouvement de Paris dans l'oisiveté est une fatigue sans excitation. Je ne regrette absolument que vous. Il est vrai que ce qui est beaucoup.
Que du moins notre séparation profite à votre santé comme à la mienne. Vous ne serez pas aussi seule à Ems que moi au Val Richer et vous ne le supporteriez pas. J’espère pourtant que vous vous reposerez, et que vous reviendrez mieux portante que l’an dernier.
Prés, bois, champs, feuille, fleurs, tout est resplendissant de fraîcheur, et de jeunesse. Le soleil brille surtout cela. Quelques ondées de pluie coupent de temps en temps les rayons du soleil. C'est charmant à voir. Outre le plaisir du moment dans ce spectacle, j’aime à penser qu’il se renouvelle et se renouvellera chaque année depuis et pendant je ne sais combien de siècles, apportant à je ne sais combien de millions du créatures le même plaisir.
J’attends les nouvelles de Constantinople, avec curiosité, mais sans vraie inquiétude. Plus j’y pense, plus je me persuade que rien de grave n’en peut sortir, même quand vous vous brouilleriez tout-à-fait avec la Turquie, même quand vous lui feriez un peu de guerre. Il n’y a de grave aujourd’hui que ce qui engage la question révolutionnaire et tout l’Europe. On n'en viendra pas là.
Je suis frappé de la tranquillité de la bourse de Londres à côté de la vivacité des journaux anglais. Adieu. J’attendrai le facteur pour fermer ma lettre. Adieu, Adieu.
Onze heures
Je crois encore moins à la chute de Lord Aberdeen qu'à la guerre. Les Anglais ont encore plus de bon sens pour la dedans que pour le dehors. Je ne m’agite pas de tous ces bruits ; je n’aime pas, ensuite, à m'être agité pour rien. Merci de vous trouver triste et misérable. sans moi. Adieu, adieu.
Il ne fallait rien moins à Lord Cowley qu’une grosse fusion. G.
8 heures
Je ne vous ai pas écrit hier en arrivant. J'étais en retard et mon facteur, en avance. Le temps m'a manqué. Je suis arrivé fatigué. Je le suis depuis quelque temps. J’ai besoin du bon air et du profond repos que je trouve ici. Le silence et la solitude ; rien à entendre et personne à attendre, pas plus de dérangement que d'affaire. Quand on devient vieux, il faut ou de grands intérêts ou un grand calme ; le mouvement de Paris dans l'oisiveté est une fatigue sans excitation. Je ne regrette absolument que vous. Il est vrai que ce qui est beaucoup.
Que du moins notre séparation profite à votre santé comme à la mienne. Vous ne serez pas aussi seule à Ems que moi au Val Richer et vous ne le supporteriez pas. J’espère pourtant que vous vous reposerez, et que vous reviendrez mieux portante que l’an dernier.
Prés, bois, champs, feuille, fleurs, tout est resplendissant de fraîcheur, et de jeunesse. Le soleil brille surtout cela. Quelques ondées de pluie coupent de temps en temps les rayons du soleil. C'est charmant à voir. Outre le plaisir du moment dans ce spectacle, j’aime à penser qu’il se renouvelle et se renouvellera chaque année depuis et pendant je ne sais combien de siècles, apportant à je ne sais combien de millions du créatures le même plaisir.
J’attends les nouvelles de Constantinople, avec curiosité, mais sans vraie inquiétude. Plus j’y pense, plus je me persuade que rien de grave n’en peut sortir, même quand vous vous brouilleriez tout-à-fait avec la Turquie, même quand vous lui feriez un peu de guerre. Il n’y a de grave aujourd’hui que ce qui engage la question révolutionnaire et tout l’Europe. On n'en viendra pas là.
Je suis frappé de la tranquillité de la bourse de Londres à côté de la vivacité des journaux anglais. Adieu. J’attendrai le facteur pour fermer ma lettre. Adieu, Adieu.
Onze heures
Je crois encore moins à la chute de Lord Aberdeen qu'à la guerre. Les Anglais ont encore plus de bon sens pour la dedans que pour le dehors. Je ne m’agite pas de tous ces bruits ; je n’aime pas, ensuite, à m'être agité pour rien. Merci de vous trouver triste et misérable. sans moi. Adieu, adieu.
Il ne fallait rien moins à Lord Cowley qu’une grosse fusion. G.
Val-Richer, Jeudi 11 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer 11 oct. 1849
8 heures
Puisque vous n'avez pas été absolus et péremptoires dans votre demande, ni la Porte dans sa réponse, raison de plus pour que l'affaire s’arrange. On trouvera quelque expédient qui couvrira la demie-retraite que fera de son côté chacune des deux puissances. Nous n'avons vu la guerre avorter depuis vingt ans malgré les plus forts motifs de guerre du monde pour la voir éclater par un si misérable incident. C'est comme la guerre entre la France et l'Angleterre pour Tahiti. Nous en avons été bien près ; mais ce n'était point possible. Il me parait que Fuad Efendi n'a pas été renvoyé à la frontière et qu’il doit être arrivé à Pétersbourg. La tranquillité où l'on est à Vienne sur cette question me parait concluante. S'il y avait la moindre raison de craindre, les esprits Autrichiens seraient renversés. Jamais l’Autriche n'aurait été à la veille d'un plus grand danger. Je vous répète qu’à Paris personne ne s’inquiète sérieusement de cette affaire. M. de Tocqueville a été, jusqu'ici, un homme d’esprit dans son Cabinet et dans ses livres. Il est possible qu’il ait de quoi être un homme d’esprit dans l'action et gouvernement. Nous verrons. Je le souhaite. C’est un honnête homme et un gentleman.
Je savais bien que ma petite lettre au Roi pour son anniversaire lui ferait, plaisir. J'ai reçu hier la plus tendre réponse. Après toutes sortes de compliments pour moi, dans le passé : « vous me donnez la plus douce consolation que je puisse recevoir, non pas à mes propres malheurs, (ce n’est pas de cela dont je m’occupe); mais à la douleur que me causent les souffrances de notre malheureuse patrie, en me disant que vous anticipez pour moi une justice à laquelle j'ai été peu accoutumé pendant ma vie. Cette justice, je l'espère et surtout je la désire pour vous comme pour moi. Mais j’ai trop peu de temps devant moi pour me flatter d'en être témoin avant que Dieu m’appelle à lui. La maladie du corps politique est bien grave. Ses médecins n’en connaissent guères la véritable nature, et je n’ai pas de confiance dans l’homéopathie qui me parait caractériser leur système de traitement. J’aurais bien envie de laisser couler ma plume mais je craindrais qu'elle n'allât top loin. Ma bonne compagne, qui se porte très bien, et qui a lu votre lettre, me charge de vous dire qu'elle en a été bien touchée.» J’ai été touché moi de cette phrase : une justice à laquelle j’ai été peu accoutumé, pendant ma vie. Il parle de lui-même comme d’un mort. Lord Beauvale a en effet bien de l’esprit, et du meilleur. Merci de m'avoir envoyé sa lettre. Je regrette bien de ne l'avoir pas vu plus souvent pendant mon séjour en Angleterre. Recevez-vous toujours la Presse ? Je ne la reçois pas, mais, M. de Girardin m'en envoie quelques numéros, ceux qu’il croit remarquables. J'en reçois un ce matin. Tout le journal, plus un supplément, remplis par un seul article le socialisme et l'impôt. Vous feriez je ne sais pas quoi plutôt que de lire cela. Je viens de le lire. Une heure de lecture. Tenez pour certain que cela fera beaucoup de mal. C'est le plan de budget, de gouvernement et de civilisation de M. de Girardin. Parfaitement fou, frivole, menteur, ignorant, pervers. Tout cela d’un ton ferme convaincu, modéré, positif, pratique. Des chimères, puériles et détestables présentées de façon à donner à tous les sots, à tous les rêveurs, à tous les badauds du monde l'illusion et le plaisir de se croire de l'esprit et du grand esprit et de l'utile esprit. Quelle perte que cet homme-là ! Il a des qualités très réelles qui ne servent qu’à ses folies et à ses vices. Personne ne lira ce numéro en Angleterre, et on aura bien raison. Et j’espère que même en France, on ne le lira pas beaucoup. C’est trop long. Mais rien ne répond mieux à l’état déréglé et chimérique des esprits. Je vous en parle bien longtemps, à vous qui n'y regarderez pas. C'est que je viens d'en être irrité.
Onze heures J’aime Clarendon Hôtel. C’est un premier pas. Je vous écrirai là demain. Vos yeux me chagrinent. Adieu, adieu. G.
8 heures
Puisque vous n'avez pas été absolus et péremptoires dans votre demande, ni la Porte dans sa réponse, raison de plus pour que l'affaire s’arrange. On trouvera quelque expédient qui couvrira la demie-retraite que fera de son côté chacune des deux puissances. Nous n'avons vu la guerre avorter depuis vingt ans malgré les plus forts motifs de guerre du monde pour la voir éclater par un si misérable incident. C'est comme la guerre entre la France et l'Angleterre pour Tahiti. Nous en avons été bien près ; mais ce n'était point possible. Il me parait que Fuad Efendi n'a pas été renvoyé à la frontière et qu’il doit être arrivé à Pétersbourg. La tranquillité où l'on est à Vienne sur cette question me parait concluante. S'il y avait la moindre raison de craindre, les esprits Autrichiens seraient renversés. Jamais l’Autriche n'aurait été à la veille d'un plus grand danger. Je vous répète qu’à Paris personne ne s’inquiète sérieusement de cette affaire. M. de Tocqueville a été, jusqu'ici, un homme d’esprit dans son Cabinet et dans ses livres. Il est possible qu’il ait de quoi être un homme d’esprit dans l'action et gouvernement. Nous verrons. Je le souhaite. C’est un honnête homme et un gentleman.
Je savais bien que ma petite lettre au Roi pour son anniversaire lui ferait, plaisir. J'ai reçu hier la plus tendre réponse. Après toutes sortes de compliments pour moi, dans le passé : « vous me donnez la plus douce consolation que je puisse recevoir, non pas à mes propres malheurs, (ce n’est pas de cela dont je m’occupe); mais à la douleur que me causent les souffrances de notre malheureuse patrie, en me disant que vous anticipez pour moi une justice à laquelle j'ai été peu accoutumé pendant ma vie. Cette justice, je l'espère et surtout je la désire pour vous comme pour moi. Mais j’ai trop peu de temps devant moi pour me flatter d'en être témoin avant que Dieu m’appelle à lui. La maladie du corps politique est bien grave. Ses médecins n’en connaissent guères la véritable nature, et je n’ai pas de confiance dans l’homéopathie qui me parait caractériser leur système de traitement. J’aurais bien envie de laisser couler ma plume mais je craindrais qu'elle n'allât top loin. Ma bonne compagne, qui se porte très bien, et qui a lu votre lettre, me charge de vous dire qu'elle en a été bien touchée.» J’ai été touché moi de cette phrase : une justice à laquelle j’ai été peu accoutumé, pendant ma vie. Il parle de lui-même comme d’un mort. Lord Beauvale a en effet bien de l’esprit, et du meilleur. Merci de m'avoir envoyé sa lettre. Je regrette bien de ne l'avoir pas vu plus souvent pendant mon séjour en Angleterre. Recevez-vous toujours la Presse ? Je ne la reçois pas, mais, M. de Girardin m'en envoie quelques numéros, ceux qu’il croit remarquables. J'en reçois un ce matin. Tout le journal, plus un supplément, remplis par un seul article le socialisme et l'impôt. Vous feriez je ne sais pas quoi plutôt que de lire cela. Je viens de le lire. Une heure de lecture. Tenez pour certain que cela fera beaucoup de mal. C'est le plan de budget, de gouvernement et de civilisation de M. de Girardin. Parfaitement fou, frivole, menteur, ignorant, pervers. Tout cela d’un ton ferme convaincu, modéré, positif, pratique. Des chimères, puériles et détestables présentées de façon à donner à tous les sots, à tous les rêveurs, à tous les badauds du monde l'illusion et le plaisir de se croire de l'esprit et du grand esprit et de l'utile esprit. Quelle perte que cet homme-là ! Il a des qualités très réelles qui ne servent qu’à ses folies et à ses vices. Personne ne lira ce numéro en Angleterre, et on aura bien raison. Et j’espère que même en France, on ne le lira pas beaucoup. C’est trop long. Mais rien ne répond mieux à l’état déréglé et chimérique des esprits. Je vous en parle bien longtemps, à vous qui n'y regarderez pas. C'est que je viens d'en être irrité.
Onze heures J’aime Clarendon Hôtel. C’est un premier pas. Je vous écrirai là demain. Vos yeux me chagrinent. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 24 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Lundi 24 octobre 1853
Quand Xérès fit dire à Léonidas " rends-moi tes armes " c’est, je pense, qu’il était un peu embarrassé de passer les Thermopyles ; et Léonidas fit acte de bon sens comme d’héroïsme en lui répondant " Viens les prendre."Il me paraît qu’Omer Pacha, est dans le même embarras que Paris, et qu’il somme le Prince Gortschakoff de passer le Danube et de venir l'attaquer, le menaçant de le passer lui-même et d'aller l’attaquer, en cas de refus. Je ne sais si c’est sérieusement qu’on écrit cela de Bucarest ; il n’y a pas eu beaucoup de situations plus ridicules que celle de ces deux armées qui vont passer l'hiver à se montrer le poing d’un bord du Danube à l'autre. Entendez-vous parler de l’Asie et la guerre peut-elle vraiment commencer là, à défaut de l'Europe ?
Je n'ai pas eu hier de nouvelles de la Reine Marie Amélie. Quand même elle continuerait d'aller mieux, elle serait hors d'état de faire son voyage d’Espagne. Les Princes ont écrit à leur frère Montpensier de venir sur le champ à Genève. On préparait, à Lisbonne, une très belle et très affectueuse réception pour la Reine. La Reine de Portugal mettait du prix à la traiter avec éclat. Le Duc de Nemours est accouru en hâte, laissant sa femme à Vienne où il retournera probablement. Je dis comme vous, je n'ai rien à dire. Je vous quitte pour aller profiter, dans mon jardin d’un temps admirable. Nous avons eu hier le plus beau jour de l’année, chaud et clair. comme dans un bel été. Aujourd’hui sera aussi beau.
Un journal dit que sir Edmund Lyons reprend du service comme marin, et va rejoindre comme contre amiral, la flotte de l’amiral Dundas. Lord Palmerston ne peut pas renvoyer en Orient un agent plus dévoué, plus remuant, plus impérieux, et plus anti-russe.
Midi
Je ne m'étonne pas de toutes ces mollesses. Il n’y a vraiment pas un motif sérieux de guerre, à moins qu’on ne s'échauffe par taquinerie, et ce n'est pas la peine. Adieu. Adieu. Ma fille vous remercie de vos bons souhaits. Elle part ce soir, en assez bonne disposition. Adieu. G.
Quand Xérès fit dire à Léonidas " rends-moi tes armes " c’est, je pense, qu’il était un peu embarrassé de passer les Thermopyles ; et Léonidas fit acte de bon sens comme d’héroïsme en lui répondant " Viens les prendre."Il me paraît qu’Omer Pacha, est dans le même embarras que Paris, et qu’il somme le Prince Gortschakoff de passer le Danube et de venir l'attaquer, le menaçant de le passer lui-même et d'aller l’attaquer, en cas de refus. Je ne sais si c’est sérieusement qu’on écrit cela de Bucarest ; il n’y a pas eu beaucoup de situations plus ridicules que celle de ces deux armées qui vont passer l'hiver à se montrer le poing d’un bord du Danube à l'autre. Entendez-vous parler de l’Asie et la guerre peut-elle vraiment commencer là, à défaut de l'Europe ?
Je n'ai pas eu hier de nouvelles de la Reine Marie Amélie. Quand même elle continuerait d'aller mieux, elle serait hors d'état de faire son voyage d’Espagne. Les Princes ont écrit à leur frère Montpensier de venir sur le champ à Genève. On préparait, à Lisbonne, une très belle et très affectueuse réception pour la Reine. La Reine de Portugal mettait du prix à la traiter avec éclat. Le Duc de Nemours est accouru en hâte, laissant sa femme à Vienne où il retournera probablement. Je dis comme vous, je n'ai rien à dire. Je vous quitte pour aller profiter, dans mon jardin d’un temps admirable. Nous avons eu hier le plus beau jour de l’année, chaud et clair. comme dans un bel été. Aujourd’hui sera aussi beau.
Un journal dit que sir Edmund Lyons reprend du service comme marin, et va rejoindre comme contre amiral, la flotte de l’amiral Dundas. Lord Palmerston ne peut pas renvoyer en Orient un agent plus dévoué, plus remuant, plus impérieux, et plus anti-russe.
Midi
Je ne m'étonne pas de toutes ces mollesses. Il n’y a vraiment pas un motif sérieux de guerre, à moins qu’on ne s'échauffe par taquinerie, et ce n'est pas la peine. Adieu. Adieu. Ma fille vous remercie de vos bons souhaits. Elle part ce soir, en assez bonne disposition. Adieu. G.
55. Val Richer, Samedi 2 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
55 Val Richer, samedi 2 Sept 1853
Postdater n’est pas français du tout ; il pourrait l'être, car le mot serait correctement formé ; mais il ne l'est pas. Antidater ne signifie, rigoureusement parlant, que changer une date en mettant celle d’un jour antérieur, et c’est la définition qu’en donne l'Académie ; mais l’usage a étendu ce sens, et on dit antidater toutes les fois qu’on met une fausse date à la place de la vraie, soit qu'on mette celle d’un jour antérieur ou postérieur. Quand nous en serons à ce mot dans la discussion de notre nouveau dictionnaire, je demanderai qu’on modifie la définition et qu’on adopte celle de l'usage étendu. Vous m’y aurez fait penser.
Je trouve que les cinq modifications demandées par la Porte à la note de Vienne ne valaient guère la peine d'être faites, et ne valent pas celle d'être refusées ; ce sont des susceptibilités de Duellistes ou des subtilités de théologiens. La première a seule quelque intérêt pour vous ; il peut convenir à votre Empereur, pour la Russie, que le Sultan lui-même reconnaisse la vive sollicitude que les Empereurs de Russie ont de tout temps témoigné pour l'Eglise grecque, et le Sultan à mon avis, peut très bien reconnaître ce fait sans déroger. J’aurais été plus difficile que le sultan pour la troisième modification, j’aurais demandé le changement de ces mots : restera fidèle à la lettre et à l’esprit &, car ils impliquent un peu qu’il ne l’a pas toujours été, et il peut moins convenir de cela que de votre vive sollicitude pour l'Eglise grecque. Mais en vérité, il n’y a pas là de quoi fournir à une demi heure de conversation sérieuse entre hommes sensés ; et que ces modifications soient acceptées ou refusées, la situation des parties, comme on dit, restera en droit et en fait, absolument la même. Acceptez-les donc et n’en parlons plus.
Je suis très touché de l’intérêt que M. de Meyendorff veut bien porter au succès de mon fils, et je l'en remercie. Ma part dans l’éducation de mes enfants a été de m’arranger pour les faire vivre avec moi et pour causer avec eux. Je les ai eus tous les jours, de très bonne heure, à déjeuner et à dîner avec moi, heure d’intimité et de conversation. L'affection et le développement intellectuel y ont également gagné. Mon fils, a du reste suivi les classes et mené la vie de collège ; mais sans se détacher de la famille. Je suis un grand partisan de la famille, en pratique quotidienne comme un principe politique. En fait d’arrangements de famille, je vois avec une vive contrariété qu’on se décide au prolongement du boulevard de la Madeleine et qu’on va se mettre à l'œuvre. On me prendra donc ma maison. Grand déplaisir, outre l'ennui d’un déménagement. J’avais bien compté mourir dans ce nid-là.
Onze heures
Votre lettre de Bar m'était arrivée tard, et je voulais faire une petite recherche sur postdater, avant de vous répondre. Voilà la cause de mon retard, volontaire et non étourdi. Adieu, Adieu. Je répondrai à Marion. Adieu. G.
Postdater n’est pas français du tout ; il pourrait l'être, car le mot serait correctement formé ; mais il ne l'est pas. Antidater ne signifie, rigoureusement parlant, que changer une date en mettant celle d’un jour antérieur, et c’est la définition qu’en donne l'Académie ; mais l’usage a étendu ce sens, et on dit antidater toutes les fois qu’on met une fausse date à la place de la vraie, soit qu'on mette celle d’un jour antérieur ou postérieur. Quand nous en serons à ce mot dans la discussion de notre nouveau dictionnaire, je demanderai qu’on modifie la définition et qu’on adopte celle de l'usage étendu. Vous m’y aurez fait penser.
Je trouve que les cinq modifications demandées par la Porte à la note de Vienne ne valaient guère la peine d'être faites, et ne valent pas celle d'être refusées ; ce sont des susceptibilités de Duellistes ou des subtilités de théologiens. La première a seule quelque intérêt pour vous ; il peut convenir à votre Empereur, pour la Russie, que le Sultan lui-même reconnaisse la vive sollicitude que les Empereurs de Russie ont de tout temps témoigné pour l'Eglise grecque, et le Sultan à mon avis, peut très bien reconnaître ce fait sans déroger. J’aurais été plus difficile que le sultan pour la troisième modification, j’aurais demandé le changement de ces mots : restera fidèle à la lettre et à l’esprit &, car ils impliquent un peu qu’il ne l’a pas toujours été, et il peut moins convenir de cela que de votre vive sollicitude pour l'Eglise grecque. Mais en vérité, il n’y a pas là de quoi fournir à une demi heure de conversation sérieuse entre hommes sensés ; et que ces modifications soient acceptées ou refusées, la situation des parties, comme on dit, restera en droit et en fait, absolument la même. Acceptez-les donc et n’en parlons plus.
Je suis très touché de l’intérêt que M. de Meyendorff veut bien porter au succès de mon fils, et je l'en remercie. Ma part dans l’éducation de mes enfants a été de m’arranger pour les faire vivre avec moi et pour causer avec eux. Je les ai eus tous les jours, de très bonne heure, à déjeuner et à dîner avec moi, heure d’intimité et de conversation. L'affection et le développement intellectuel y ont également gagné. Mon fils, a du reste suivi les classes et mené la vie de collège ; mais sans se détacher de la famille. Je suis un grand partisan de la famille, en pratique quotidienne comme un principe politique. En fait d’arrangements de famille, je vois avec une vive contrariété qu’on se décide au prolongement du boulevard de la Madeleine et qu’on va se mettre à l'œuvre. On me prendra donc ma maison. Grand déplaisir, outre l'ennui d’un déménagement. J’avais bien compté mourir dans ce nid-là.
Onze heures
Votre lettre de Bar m'était arrivée tard, et je voulais faire une petite recherche sur postdater, avant de vous répondre. Voilà la cause de mon retard, volontaire et non étourdi. Adieu, Adieu. Je répondrai à Marion. Adieu. G.
57. Val Richer,Mercredi 7 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
57 Val Richer. Mercredi 7 sept. 1853
Voici une lettre de Lord Aberdeen qui a de l'intérêt. Je le crois plus confiant dans la conclusion qu’il ne le dit. C'est sa maxime qu’il ne faut jamais être ni surtout paraîtra sûr ; en quoi il a très habituellement raison. Moi qui ne suis qu’un spectateur sans responsabilité, je persiste à tenir l'affaire pour terminée. On disait, il y a six semaines, que les Turcs ne demandaient qu'à céder, que c’étaient les puissances, et Lord Stratford, ou non des puissances qui les en empêchaient. Apparement elles seront bien en état de les faire céder aujourd’hui.
Je trouve que votre Empereur a là une excellente occasion de reprendre en Europe le terrain qu’il y a perdu ; on lui sait déjà beaucoup de gré de la bonne grâce avec laquelle il a accepté la note de Vienne ; si maintenant, il est plus modéré que les Turcs et passe par dessus leurs petites exigences pour mettre fin à la crise au lieu de s'en servir pour la prolonger, on sera frappé de sa magnanimité russe, de sa sagesse Européenne ; on regardera presque la paix comme un don de lui, et la question sera close à son honneur comme à son profit.
Le Duc de Broglie et Mad. d’Haussonville, sont venus me voir avant hier. Nous avons causé tout le jour. Broglie triste et sensé, trouvant, comme vous le dites, et comme cela est évident, que l'Empereur Napoléon, a gagné que l'affaire d'Orient a bien tourné pour lui, qu’il s’y est conduit habilement & & Cela vaut mieux que la popularité au Dieppe. Un souverain est toujours populaire aux eaux où il amène du monde.
J’ai vu ce pauvre Molé quand j’ai été à Paris pour l'Académie. C'est fort triste, un peu moins pour lui que pour d’autres, parce qu’il a toujours plus vécu de la conversation que de la réflexion ou de l'étude. Il paraissait croire que c’était une cataracte, déjà formée, sur un oeil et en train de se former sur l'autre. On peut opérer cela. Triste ressource, mais ressource. On n’a pas besoin d'être un héros mutilé pour finir comme le maréchal de Rantzau ; Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur, heureux ceux à qui le coeur reste entier ! Après tout, c’est par là qu’on vit. Adieu, je vais faire ma toilette. J’aurai de vos nouvelles ce matin. Je vous écrirai encore vendredi. Puis, je vous verrai dimanche. Vrai jour de fête. Adieu.
Onze heures
Voilà votre lettre. Ce serait bien du bruit. Mais si Constantinople est sens dessus dessous, tout suivra. Adieu. Vous savez bien que je ne m'ennuierai pas.
Voici une lettre de Lord Aberdeen qui a de l'intérêt. Je le crois plus confiant dans la conclusion qu’il ne le dit. C'est sa maxime qu’il ne faut jamais être ni surtout paraîtra sûr ; en quoi il a très habituellement raison. Moi qui ne suis qu’un spectateur sans responsabilité, je persiste à tenir l'affaire pour terminée. On disait, il y a six semaines, que les Turcs ne demandaient qu'à céder, que c’étaient les puissances, et Lord Stratford, ou non des puissances qui les en empêchaient. Apparement elles seront bien en état de les faire céder aujourd’hui.
Je trouve que votre Empereur a là une excellente occasion de reprendre en Europe le terrain qu’il y a perdu ; on lui sait déjà beaucoup de gré de la bonne grâce avec laquelle il a accepté la note de Vienne ; si maintenant, il est plus modéré que les Turcs et passe par dessus leurs petites exigences pour mettre fin à la crise au lieu de s'en servir pour la prolonger, on sera frappé de sa magnanimité russe, de sa sagesse Européenne ; on regardera presque la paix comme un don de lui, et la question sera close à son honneur comme à son profit.
Le Duc de Broglie et Mad. d’Haussonville, sont venus me voir avant hier. Nous avons causé tout le jour. Broglie triste et sensé, trouvant, comme vous le dites, et comme cela est évident, que l'Empereur Napoléon, a gagné que l'affaire d'Orient a bien tourné pour lui, qu’il s’y est conduit habilement & & Cela vaut mieux que la popularité au Dieppe. Un souverain est toujours populaire aux eaux où il amène du monde.
J’ai vu ce pauvre Molé quand j’ai été à Paris pour l'Académie. C'est fort triste, un peu moins pour lui que pour d’autres, parce qu’il a toujours plus vécu de la conversation que de la réflexion ou de l'étude. Il paraissait croire que c’était une cataracte, déjà formée, sur un oeil et en train de se former sur l'autre. On peut opérer cela. Triste ressource, mais ressource. On n’a pas besoin d'être un héros mutilé pour finir comme le maréchal de Rantzau ; Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur, heureux ceux à qui le coeur reste entier ! Après tout, c’est par là qu’on vit. Adieu, je vais faire ma toilette. J’aurai de vos nouvelles ce matin. Je vous écrirai encore vendredi. Puis, je vous verrai dimanche. Vrai jour de fête. Adieu.
Onze heures
Voilà votre lettre. Ce serait bien du bruit. Mais si Constantinople est sens dessus dessous, tout suivra. Adieu. Vous savez bien que je ne m'ennuierai pas.
Val Richer, Vendredi 9 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Quatre lignes seulement j’ai plusieurs choses à finir d’ici à demain et rien à vous dire. Je doute que vous m'envoyez aujourd’hui la solution de Pétersbourg ; cela traînera encore. Je ne puis croire à la complète folie des Turcs ; à moins que vous ne la vouliez vous- mêmes. L’article du Times, que m'ont donné les Débats d’hier est plein de doute et d’inquiétude. A dimanche, les commentaires.
Onze heures
Vous aurez raison d'accepter. Cela ne vaut vraiment pas tant de bruit. Adieu. Adieu, à Dimanche.
Val Richer, Vendredi 9 Sept 1853
Onze heures
Vous aurez raison d'accepter. Cela ne vaut vraiment pas tant de bruit. Adieu. Adieu, à Dimanche.
Val Richer, Vendredi 9 Sept 1853
Mots-clés : Affaire d'Orient, Politique (Turquie), Presse
Val Richer, Lundi 19 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, lundi 19 Sept 1853
Vous avez très bien pris votre position, en vous tenant en dehors des discussions avec la Porte, et on en renvoyant à la conférence de Vienne tout l'embarras. C'est la seule marche correcte et, c’est en même temps la plus pacifique. Quand on aura décidé la Porte à accepter ce que vous avez déjà accepté, on viendra vous le dire, et tout sera fini. On l’y décidera, je n'en doute pas, n'importe par quels moyens. On aurait dû commencer par là. La situation est fausse pour tout le monde ; tantôt on prend, tantôt on ne prend pas l'Empire Ottoman au sérieux, on le traite tour à tour comme un grand état et comme un cadavre. De là, les fautes. On oublie à chaque instant l'attitude qu’on avait et le langage qu’on tenait l’instant d'auparavant. On ne sait pas être aussi inconséquent et contradictoire qu’il le faudrait. Je m'amuserai à voir comment on s'y prendra pour se donner à soi-même. Tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, tant de démentis. J’ai beau faire ; je ne peux m'attendre à rien de plus grave dans cette question.
Votre Empereur devrait bien interdire au prince Gortschakoff les proclamations. Si Omer Pacha en faisait de son côté, la guerre serait difficile à éviter.
Je vois que Lord Palmerston a quitté Londres. D'autres aussi sans doute. On sera convenu de l'action commune. Je suis fort aise que Molé ait de l’espoir pour ses yeux ; s'il y a un commencement de mieux, c’est la preuve qu’il n’y a point de paralysie, du nerf optique. Si vous le revoyez, soyez assez bonne pour lui dire que je regrette aussi beaucoup de ne l’avoir pas vu avant mon départ. Je n’ai trouvé jeudi dernier à l’Académie que Vitet et Cousin avec qui causer, Ste Aulaire n’y était pas, ni aucun autre de mes amis. La Reine Christine abuse de la platitude. C'est un mal très commun, et qu’on pourrait s’épargner sans le moindre inconvénient. Elle aura eu de l'humeur de n'être pas reçue à Claremont. Le Duc de Montpensier s'en ressentira peut être. A la vérité, quand on a de l’esprit et de la bassesse, on n'a guère d'humeur. Adieu.
Je n'ai plus à vous parler que du beau temps. Vous en jouissez au bois de Boulogne. Mes bois sont plus jolis, mais vous n'y êtes pas. Adieu.
Mes amitiés à Marion. G. Lisez dans le dernier numéro de la Revue des deux Mondes, une bouffonnerie intitulée : la mission trop secrète. Trop longue, mais drôle.
Vous avez très bien pris votre position, en vous tenant en dehors des discussions avec la Porte, et on en renvoyant à la conférence de Vienne tout l'embarras. C'est la seule marche correcte et, c’est en même temps la plus pacifique. Quand on aura décidé la Porte à accepter ce que vous avez déjà accepté, on viendra vous le dire, et tout sera fini. On l’y décidera, je n'en doute pas, n'importe par quels moyens. On aurait dû commencer par là. La situation est fausse pour tout le monde ; tantôt on prend, tantôt on ne prend pas l'Empire Ottoman au sérieux, on le traite tour à tour comme un grand état et comme un cadavre. De là, les fautes. On oublie à chaque instant l'attitude qu’on avait et le langage qu’on tenait l’instant d'auparavant. On ne sait pas être aussi inconséquent et contradictoire qu’il le faudrait. Je m'amuserai à voir comment on s'y prendra pour se donner à soi-même. Tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, tant de démentis. J’ai beau faire ; je ne peux m'attendre à rien de plus grave dans cette question.
Votre Empereur devrait bien interdire au prince Gortschakoff les proclamations. Si Omer Pacha en faisait de son côté, la guerre serait difficile à éviter.
Je vois que Lord Palmerston a quitté Londres. D'autres aussi sans doute. On sera convenu de l'action commune. Je suis fort aise que Molé ait de l’espoir pour ses yeux ; s'il y a un commencement de mieux, c’est la preuve qu’il n’y a point de paralysie, du nerf optique. Si vous le revoyez, soyez assez bonne pour lui dire que je regrette aussi beaucoup de ne l’avoir pas vu avant mon départ. Je n’ai trouvé jeudi dernier à l’Académie que Vitet et Cousin avec qui causer, Ste Aulaire n’y était pas, ni aucun autre de mes amis. La Reine Christine abuse de la platitude. C'est un mal très commun, et qu’on pourrait s’épargner sans le moindre inconvénient. Elle aura eu de l'humeur de n'être pas reçue à Claremont. Le Duc de Montpensier s'en ressentira peut être. A la vérité, quand on a de l’esprit et de la bassesse, on n'a guère d'humeur. Adieu.
Je n'ai plus à vous parler que du beau temps. Vous en jouissez au bois de Boulogne. Mes bois sont plus jolis, mais vous n'y êtes pas. Adieu.
Mes amitiés à Marion. G. Lisez dans le dernier numéro de la Revue des deux Mondes, une bouffonnerie intitulée : la mission trop secrète. Trop longue, mais drôle.
Val Richer, Vendredi 23 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 23 sept 1853
Votre note a deux mérites pour l'Europe, elle est très pacifique ; pour la Russie, elle prend la bonne position ; vous acceptez tout ce que l'Europe a demandé, et vous lui laissez l’embarras de le faire accepter à Constantinople. Vous prenez la peine de lui indiquer comment elle doit s’y prendre pour le faire accepter ; elle n'a qu'à déclarer franchement et énergiquement à la Porte & & Vous dites d'avance que vous évacuerez les Principautés dès que la note de Vienne sera acceptée à Constantinople et l’ambassadeur Turc arrive à Pétersbourg. Il n’y a rien à vous dire, vous profitez de vos avantages, en rassurant pleinement l’Europe sur vos desseins. Si l'Europe ne sait pas maintenir la paix, ce sera sa faute et non pas la vôtre. Elle la maintiendra. Elle obligera la Porte à accepter la note. Je ne sais pas par quelles lenteurs et qu’elles oscillations, il faudra passer pour en arriver là ; mais on y arrivera. Le résultat contraire serait trop ridicule et trop périlleux. En attendant le discours de Lord John ne me plaît pas du tout ; il admet beaucoup trop la chance de la guerre. Si c'est de la part de cette fraction du Cabinet une disposition à céder à l'opinion belliqueuse anglaise, c’est grave ; si ce n'est que ménagement pour cette opinion, avec l’intention au fond, de lui résister, je crois les ménagements plus dangereux qu'utile. Le cabinet anglais me paraît avoir deux peurs ; pour de la guerre, et peur d’un débat, en faveur de la paix dans le Parlement. Il voudrait la paix, sans débat. C’est une utopie. Il faut toujours se battre quelque part, et il vaut mieux se battre au dedans pour faire triompher la bonne politique qu'en dehors en l'abandonnant.
Je vois que votre grande Duchesse Marie, quitte l’Angleterre, malgré le goût qu’elle y a pris. Elle a raison de la quitter ; mais son goût me donne bonne opinion d'elle. Je dis de l’Angleterre ce qu’on a dit des ouvrages des grands maîtres.
C'est avoir profité que de savoir s'y plaire. Je suis de votre avis sur les paroles de l'Empereur au camp de Satory ; elles sont bonnes et bien dîtes à la fois militaires et pacifiques, agréables pour le dedans et pour le dehors ; et d’une flatterie noble, de celle qui relève ceux à qui elle s'adresse au lieu de les corrompre.
Avez-vous vu le maréchal Narvaez ? Ce sont ses amis qui rentrent au pouvoir à Madrid. Ils ne se suffiront pas longtemps à eux seuls. Ils auront besoin de lui. Dit-on que la Reine Christine retourne en Espagne ? Je suis en train de questions. Barante est-il à Paris ? Sa fille devait accoucher dans le cours de ce mois. S'il y est, vous seriez bien bonne de me dire son adresse. J’ai à lui répondre et je ne sais où le prendre. Il doit venir me voir au commencement d'Octobre. J’ai reçu hier une lettre de Piscatory qui veut aussi venir vers cette époque. Mes enfants remplissent presque ma maison, et j’ai besoin d’espacer mes hôtes pour ne pas les faire coucher à la belle étoile.
Adieu, Adieu. Le beau temps continue. J'en jouis autant au bois de Boulogne qu’au Val Richer. Adieu. G.
Votre note a deux mérites pour l'Europe, elle est très pacifique ; pour la Russie, elle prend la bonne position ; vous acceptez tout ce que l'Europe a demandé, et vous lui laissez l’embarras de le faire accepter à Constantinople. Vous prenez la peine de lui indiquer comment elle doit s’y prendre pour le faire accepter ; elle n'a qu'à déclarer franchement et énergiquement à la Porte & & Vous dites d'avance que vous évacuerez les Principautés dès que la note de Vienne sera acceptée à Constantinople et l’ambassadeur Turc arrive à Pétersbourg. Il n’y a rien à vous dire, vous profitez de vos avantages, en rassurant pleinement l’Europe sur vos desseins. Si l'Europe ne sait pas maintenir la paix, ce sera sa faute et non pas la vôtre. Elle la maintiendra. Elle obligera la Porte à accepter la note. Je ne sais pas par quelles lenteurs et qu’elles oscillations, il faudra passer pour en arriver là ; mais on y arrivera. Le résultat contraire serait trop ridicule et trop périlleux. En attendant le discours de Lord John ne me plaît pas du tout ; il admet beaucoup trop la chance de la guerre. Si c'est de la part de cette fraction du Cabinet une disposition à céder à l'opinion belliqueuse anglaise, c’est grave ; si ce n'est que ménagement pour cette opinion, avec l’intention au fond, de lui résister, je crois les ménagements plus dangereux qu'utile. Le cabinet anglais me paraît avoir deux peurs ; pour de la guerre, et peur d’un débat, en faveur de la paix dans le Parlement. Il voudrait la paix, sans débat. C’est une utopie. Il faut toujours se battre quelque part, et il vaut mieux se battre au dedans pour faire triompher la bonne politique qu'en dehors en l'abandonnant.
Je vois que votre grande Duchesse Marie, quitte l’Angleterre, malgré le goût qu’elle y a pris. Elle a raison de la quitter ; mais son goût me donne bonne opinion d'elle. Je dis de l’Angleterre ce qu’on a dit des ouvrages des grands maîtres.
C'est avoir profité que de savoir s'y plaire. Je suis de votre avis sur les paroles de l'Empereur au camp de Satory ; elles sont bonnes et bien dîtes à la fois militaires et pacifiques, agréables pour le dedans et pour le dehors ; et d’une flatterie noble, de celle qui relève ceux à qui elle s'adresse au lieu de les corrompre.
Avez-vous vu le maréchal Narvaez ? Ce sont ses amis qui rentrent au pouvoir à Madrid. Ils ne se suffiront pas longtemps à eux seuls. Ils auront besoin de lui. Dit-on que la Reine Christine retourne en Espagne ? Je suis en train de questions. Barante est-il à Paris ? Sa fille devait accoucher dans le cours de ce mois. S'il y est, vous seriez bien bonne de me dire son adresse. J’ai à lui répondre et je ne sais où le prendre. Il doit venir me voir au commencement d'Octobre. J’ai reçu hier une lettre de Piscatory qui veut aussi venir vers cette époque. Mes enfants remplissent presque ma maison, et j’ai besoin d’espacer mes hôtes pour ne pas les faire coucher à la belle étoile.
Adieu, Adieu. Le beau temps continue. J'en jouis autant au bois de Boulogne qu’au Val Richer. Adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Europe, Politique (Analyse), Politique (Russie), Politique (Turquie)
Val Richer, Mercredi 28 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 28 sept 1853
Je ne suis revenu hier qu'après une heure. Dix sept lieues et vingt sept heures pour aller dîner, c’est beaucoup. Il faut pour cela, aimer beaucoup ses amis et avoir bien envie de leur faire plaisir. Aussi fais-je.
Si l’entrée des flottes ne met pas le Sultan et Reschid Pacha en volonté et en état de signer la note de Vienne et d'en finir de cette pitoyable situation, c’est évidemment qu’il n’y a plus aucun gouvernement à Constantinople et que le moment de la chute de l'Empire Ottoman est arrivé. C'est possible. Ce n'est pas un bon moment pour une si grosse affaire. L’Europe est divisée, et mal disposée. Les questions, et les dispositions révolutionnaires sont au fond, et au-dessus de toutes les autres. Elles décideront des alliances et des conduites. C'est le chaos dans les ténèbres. Attendons l’entrée des flottes mettra peut-être fin, pour quelque temps, à la crise. C’est toujours mon pressentiment.
L’Angleterre me paraît entrer sans motif sérieux, dans une de ces ébullitions populaires qui lui ont quelquefois fait faire de grosses fautes, mais dont pourtant, elle est presque toujours sensément sortie. Et sortira-t-elle cette fois, ou y succombera-t-elle ? Cela dépend de ses chefs. Il y a, j'en suis convaincu, dans le pays, des points d’appuis assez forts pour résister aux meetings et faire prévaloir la bonne politique. Le bon jugement, et le bon vouloir ne manquent pas à lord Aberdeen. Aura-t-il assez d'énergie ? Je le désire vivement pour lui, pour son pays et pour l'Europe.
Onze heures
Voilà une longue lettre et intéressante, quoique toute cette agitation soit vraiment assez ridicule pour une question qu’il serait si aisé de finir. Adieu, adieu. G.
Je ne suis revenu hier qu'après une heure. Dix sept lieues et vingt sept heures pour aller dîner, c’est beaucoup. Il faut pour cela, aimer beaucoup ses amis et avoir bien envie de leur faire plaisir. Aussi fais-je.
Si l’entrée des flottes ne met pas le Sultan et Reschid Pacha en volonté et en état de signer la note de Vienne et d'en finir de cette pitoyable situation, c’est évidemment qu’il n’y a plus aucun gouvernement à Constantinople et que le moment de la chute de l'Empire Ottoman est arrivé. C'est possible. Ce n'est pas un bon moment pour une si grosse affaire. L’Europe est divisée, et mal disposée. Les questions, et les dispositions révolutionnaires sont au fond, et au-dessus de toutes les autres. Elles décideront des alliances et des conduites. C'est le chaos dans les ténèbres. Attendons l’entrée des flottes mettra peut-être fin, pour quelque temps, à la crise. C’est toujours mon pressentiment.
L’Angleterre me paraît entrer sans motif sérieux, dans une de ces ébullitions populaires qui lui ont quelquefois fait faire de grosses fautes, mais dont pourtant, elle est presque toujours sensément sortie. Et sortira-t-elle cette fois, ou y succombera-t-elle ? Cela dépend de ses chefs. Il y a, j'en suis convaincu, dans le pays, des points d’appuis assez forts pour résister aux meetings et faire prévaloir la bonne politique. Le bon jugement, et le bon vouloir ne manquent pas à lord Aberdeen. Aura-t-il assez d'énergie ? Je le désire vivement pour lui, pour son pays et pour l'Europe.
Onze heures
Voilà une longue lettre et intéressante, quoique toute cette agitation soit vraiment assez ridicule pour une question qu’il serait si aisé de finir. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Europe, Politique (Angleterre), Politique (Turquie), Voyage
Val Richer, Vendredi 30 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 30 sept. 1853
Au point où en sont venues les choses, il n’y a plus de marge, ni de choix pour la conduite, à tenir ; il faut faire aujourd’hui ce qu’on eût dû faire au moment où l’on a rédigé à Vienne la note de transaction, insister péremptoirement auprès du sultan pour qu’il accepte de la main de Puissances amies, ce que votre Empereur a eu le bon esprit d'accepter, sans débat, de la main de Puissances méfiantes et jalouses. Et quels dangers réels la retraite, ainsi imposée au sultan l’expose- t-elle chez lui, et que peut-on faire pour la couvrir ? Je ne connais pas assez l'état des faits à Constantinople, ni le détail des négo ciations à Vienne pour avoir, à cet égard, des idées précises et pratiques. On a fait entrer des vaisseaux dans les Dardanelles ; on est donc en mesure de protéger le sultan contre le parti de la guerre, et de lui assurer la liberté de faire ce qu’on lui demande. On voudrait, ce me semble, rédiger à Vienne, au nom des trois puissances, une nouvelle note explicative de la première, et qui en donnant au sultan, sur ses objections, une certaine satis faction, elle ou apparente, lui permit de signer. sans embarras. Je comprends la possibilité d’une telle note, quoique je sois hors d'état s'en indiquer les normes ; mais elle n’est possible qu’en s'en entendant avec votre Empereur et en s’assurant qu’elle ne dérangera rien à son acceptation. Il ne faudrait pas que le commentaire lui fit repousser le texte qu’il a consenti. Comme je suppose toujours que votre Empereur veut la paix et ne joue pas un double jeu, je ne vois pas pourquoi il ferait objection à une telle note convenable ment rédigée, et qui sauverait un peu l’honneur du Sultan obligé de signer la première après l'avoir repoussée. C’est une affaire de procédés et de langage. Si on veut s'entraider et si on sait s'exprimer, on doit en venir à bout. Seulement, il faut que cette nouvelle note soit faite en commun par les trois puissances qui ont rédigé et proposé la première, son efficacité à Constantinople dépend du concert à Vienne. Encore ici, l’entente avec votre Empereur est nécessaire ; s'il travaille à détruire l'action commune et à séparer immédiatement l’Autriche de la France et de l'Angleterre, il rendra la note explicative impossible, et tous les embarras de la situation renaîtront d’autant plus que la note explicative me paraît aussi nécessaire à Londres qu'à Constantinople, et qu’il y a des ménagements à avoir pour la passion Anglaise aussi bien que pour la barbarie Turque.
Loin des incidents de Constantinople et des conversations de Vienne et d'Olmütz, tout ceci. n'est probablement que du bavardage. Je vous le donne comme il me vient à l’esprit. M. Monod voyage depuis plusieurs semaines, en Allemagne ; il était, depuis huit jours à Berlin. Voilà pourquoi je n'ai pas de réponse. Il sera dimanche à Paris.
Onze heures
Ne connaissant pas votre seconde dépêche explicative, je ne puis en tenir compte, ni savoir quelle part lui faire. Je suis de l’avis de Fould. Cela s’arrangera. Adieu, adieu. G.
Au point où en sont venues les choses, il n’y a plus de marge, ni de choix pour la conduite, à tenir ; il faut faire aujourd’hui ce qu’on eût dû faire au moment où l’on a rédigé à Vienne la note de transaction, insister péremptoirement auprès du sultan pour qu’il accepte de la main de Puissances amies, ce que votre Empereur a eu le bon esprit d'accepter, sans débat, de la main de Puissances méfiantes et jalouses. Et quels dangers réels la retraite, ainsi imposée au sultan l’expose- t-elle chez lui, et que peut-on faire pour la couvrir ? Je ne connais pas assez l'état des faits à Constantinople, ni le détail des négo ciations à Vienne pour avoir, à cet égard, des idées précises et pratiques. On a fait entrer des vaisseaux dans les Dardanelles ; on est donc en mesure de protéger le sultan contre le parti de la guerre, et de lui assurer la liberté de faire ce qu’on lui demande. On voudrait, ce me semble, rédiger à Vienne, au nom des trois puissances, une nouvelle note explicative de la première, et qui en donnant au sultan, sur ses objections, une certaine satis faction, elle ou apparente, lui permit de signer. sans embarras. Je comprends la possibilité d’une telle note, quoique je sois hors d'état s'en indiquer les normes ; mais elle n’est possible qu’en s'en entendant avec votre Empereur et en s’assurant qu’elle ne dérangera rien à son acceptation. Il ne faudrait pas que le commentaire lui fit repousser le texte qu’il a consenti. Comme je suppose toujours que votre Empereur veut la paix et ne joue pas un double jeu, je ne vois pas pourquoi il ferait objection à une telle note convenable ment rédigée, et qui sauverait un peu l’honneur du Sultan obligé de signer la première après l'avoir repoussée. C’est une affaire de procédés et de langage. Si on veut s'entraider et si on sait s'exprimer, on doit en venir à bout. Seulement, il faut que cette nouvelle note soit faite en commun par les trois puissances qui ont rédigé et proposé la première, son efficacité à Constantinople dépend du concert à Vienne. Encore ici, l’entente avec votre Empereur est nécessaire ; s'il travaille à détruire l'action commune et à séparer immédiatement l’Autriche de la France et de l'Angleterre, il rendra la note explicative impossible, et tous les embarras de la situation renaîtront d’autant plus que la note explicative me paraît aussi nécessaire à Londres qu'à Constantinople, et qu’il y a des ménagements à avoir pour la passion Anglaise aussi bien que pour la barbarie Turque.
Loin des incidents de Constantinople et des conversations de Vienne et d'Olmütz, tout ceci. n'est probablement que du bavardage. Je vous le donne comme il me vient à l’esprit. M. Monod voyage depuis plusieurs semaines, en Allemagne ; il était, depuis huit jours à Berlin. Voilà pourquoi je n'ai pas de réponse. Il sera dimanche à Paris.
Onze heures
Ne connaissant pas votre seconde dépêche explicative, je ne puis en tenir compte, ni savoir quelle part lui faire. Je suis de l’avis de Fould. Cela s’arrangera. Adieu, adieu. G.
Val Richer, Dimanche 2 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 2 octobre 1853
J’aime bien le discours de Gladstone à Inverness. Voilà, comment il faut parler de la politique de la paix. Ceux qui ne la recommandent qu'au nom du repos et des intérêts matériels ne savent pas qu’ils sont les mobiles les plus puissants sur l'esprit des peuples. Et puis, je trouve le ton de Gladstone décidé et ferme. Palmerston aussi a bien parlé. Si l'Angleterre persiste dans cette voie, je persisterai aussi dans ma confiance. J’ai lu dans l’Assemblée nationale d’hier. Le texte original de vos deux notes. La première est en effet très bonne au fond et dans la forme, pacifique avec la dignité tranquille d’un grand gouvernement. Mais je suis tout à fait de l’avis de ceux qui désapprouvent la seconde. Je n'entre pas dans la débat des phrases et des mots. A quoi bon le débat même, y eussiez-vous cent fois raison ? La première nole établissait très bien votre position générale, et en haut ; pourquoi descendre à des questions très particulières, et très petites dans leur aspect, quel que soit le lien qui les rattache à la grande ? Pourquoi vous faire avocats et théologiens, et fournir aussi aux cabinets et aux journaux l'occasion de se faire avocats et théologiens à leur tour ? Ils abusent de l'occasion, et par là, ils entretiennent la prévention populaire qui vous soupçonne de vouloir tout autre chose que ce que vous dites. Et c’est cette prévention qui embarrasse et affaiblit les gouvernements amis de la paix. Votre situation et votre politique envers la Turquie sont si complexes que vous ne pouvez entrer dans les détails sans prêter le flanc par quelque côté ; vous voulez aujourd’hui la paix, le statu quo, et en même temps vous saisissez, vous ne pouvez pas ne pas saisir, quand ils se présentent, les moyens de faire des pas vers un avenir qui n’est, ni le statu quo, ni la paix. Vous êtes donc incessamment exposés à ce que vos intentions présentes et vos vues d'avenir se mêlent et se donnent des démentis mutuels et dans cette confusion, le public, qui n’y regarde. pas de près, confond à son tour toutes choses, et prête à vos démarches, à vos paroles d'aujourd’hui un sens qu'elles n’ont pas aujourd’hui, mais qu’on y peut mettre quand on se transporte dans l'avenir. C’est là l'écueil dont vous avez à vous garder, et votre note explicative nous y pousse au lieu de vous en éloigner. Je ne connais pas de plus grand danger, dans les grandes affaires, que la fantaisie de prouver en détail qu’on a et qu’on a toujours eu raison.
J’ai des nouvelles de Claremont. La Reine est en effet revenue malade de la mer ; mais elle repart, et elle est, je crois, déjà repartie par Douvres et Ostende pour aller par terre s'embarquer à Gênes d’où la traversée, en Espagne est beaucoup plus courte et par une mer plus douce.
J’espère que l’indisposition de Marion n'est rien. Avez-vous eu, avec elle, votre conversation et va-t-elle passer quelques jours en Angleterre ?
Onze heures
Certainement, si la guerre éclate, tout le monde sera fou et aura été bien maladroit. Adieu, Adieu. G.
J’aime bien le discours de Gladstone à Inverness. Voilà, comment il faut parler de la politique de la paix. Ceux qui ne la recommandent qu'au nom du repos et des intérêts matériels ne savent pas qu’ils sont les mobiles les plus puissants sur l'esprit des peuples. Et puis, je trouve le ton de Gladstone décidé et ferme. Palmerston aussi a bien parlé. Si l'Angleterre persiste dans cette voie, je persisterai aussi dans ma confiance. J’ai lu dans l’Assemblée nationale d’hier. Le texte original de vos deux notes. La première est en effet très bonne au fond et dans la forme, pacifique avec la dignité tranquille d’un grand gouvernement. Mais je suis tout à fait de l’avis de ceux qui désapprouvent la seconde. Je n'entre pas dans la débat des phrases et des mots. A quoi bon le débat même, y eussiez-vous cent fois raison ? La première nole établissait très bien votre position générale, et en haut ; pourquoi descendre à des questions très particulières, et très petites dans leur aspect, quel que soit le lien qui les rattache à la grande ? Pourquoi vous faire avocats et théologiens, et fournir aussi aux cabinets et aux journaux l'occasion de se faire avocats et théologiens à leur tour ? Ils abusent de l'occasion, et par là, ils entretiennent la prévention populaire qui vous soupçonne de vouloir tout autre chose que ce que vous dites. Et c’est cette prévention qui embarrasse et affaiblit les gouvernements amis de la paix. Votre situation et votre politique envers la Turquie sont si complexes que vous ne pouvez entrer dans les détails sans prêter le flanc par quelque côté ; vous voulez aujourd’hui la paix, le statu quo, et en même temps vous saisissez, vous ne pouvez pas ne pas saisir, quand ils se présentent, les moyens de faire des pas vers un avenir qui n’est, ni le statu quo, ni la paix. Vous êtes donc incessamment exposés à ce que vos intentions présentes et vos vues d'avenir se mêlent et se donnent des démentis mutuels et dans cette confusion, le public, qui n’y regarde. pas de près, confond à son tour toutes choses, et prête à vos démarches, à vos paroles d'aujourd’hui un sens qu'elles n’ont pas aujourd’hui, mais qu’on y peut mettre quand on se transporte dans l'avenir. C’est là l'écueil dont vous avez à vous garder, et votre note explicative nous y pousse au lieu de vous en éloigner. Je ne connais pas de plus grand danger, dans les grandes affaires, que la fantaisie de prouver en détail qu’on a et qu’on a toujours eu raison.
J’ai des nouvelles de Claremont. La Reine est en effet revenue malade de la mer ; mais elle repart, et elle est, je crois, déjà repartie par Douvres et Ostende pour aller par terre s'embarquer à Gênes d’où la traversée, en Espagne est beaucoup plus courte et par une mer plus douce.
J’espère que l’indisposition de Marion n'est rien. Avez-vous eu, avec elle, votre conversation et va-t-elle passer quelques jours en Angleterre ?
Onze heures
Certainement, si la guerre éclate, tout le monde sera fou et aura été bien maladroit. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Samedi 8 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 8 octobre 1853
Je renonce plus que jamais à prévoir ; on ne prévoit pas les emportements de Barbares ignorants, ni les faiblesses d'Etats puissants, ni les étourderies de Ministres hommes de sens et d’esprit. Je ne sais si je radote dans mon coin ; mais, à mon avis, il n’y a pas, à cette crise si grave, un seul motif sérieux et elle aurait pu très aisément être évitée au premier moment et termine dix fois depuis qu’elle a commencé. C’est ce qui fait que je ne crois pas encore aux conséquences extrêmes. Que la guerre soit absolument faisable dans cette saison, c’est possible ; mais elle est à coup sûr, plus difficile. Vous n'attaquerez pas les Turcs. Pour vous attaquer, il faut qu’ils passent le Danube, très mauvaise chance pour eux. On restera probablement l’arme au bras ; et si on ne se bat pas tout de suite, passera-t-on l’hiver sans rien faire pour se battre au Printemps ? C'est le comble de l’invraisemblance. Je retombe toujours dans ma raison. Pourtant je suis inquiet. Je crois que je ne le serais pas du tout, si je ne l'étais pas pour vous. Mais vous êtes dans la question. Je persiste à croire qu’il s'est passé à Olmütz quelque chose que nous ne savons pas et qui laisse une poste entrouverte pour la paix.
Parlons d'autre chose. Avez-vous lu la vie du Marquis de Bouillé par son petit-fils René de Bouillé ? Cela vous intéresserait. Vous passeriez la partie militaire. M. de Brouillé a été l’un des rares hommes de sens et du caractère du parti émigré dans notre grande révolution, et il a été, en rapport avec tous les hommes considérables de son temps.
Onze heures
Bonne lettre dans notre péril. J’ai toujours confiance à la dernière extrémité. S'il y a quelque nouvelle chance de négociation, Aberdeen ne se retirera pas. Très probable ment d'ailleurs, il ne se retirerait pas seul, et vous savez qu’un cabinet nécessaire à l'intérieur, ne se dissout pas pour des raisons de politique extérieure. J’ai trouvé, pour la Princesse Koutschoubey, non pas tout ce qu’elle cherche, mais quelque chose qui, je crois, peut lui suffire quant à présent et vaut peut-être mieux pour commencer. Je le lui écrirai demain à elle-même, puisque vous le désirez. Je n'ai pas le temps ce matin. Adieu. Adieu. G.
Je renonce plus que jamais à prévoir ; on ne prévoit pas les emportements de Barbares ignorants, ni les faiblesses d'Etats puissants, ni les étourderies de Ministres hommes de sens et d’esprit. Je ne sais si je radote dans mon coin ; mais, à mon avis, il n’y a pas, à cette crise si grave, un seul motif sérieux et elle aurait pu très aisément être évitée au premier moment et termine dix fois depuis qu’elle a commencé. C’est ce qui fait que je ne crois pas encore aux conséquences extrêmes. Que la guerre soit absolument faisable dans cette saison, c’est possible ; mais elle est à coup sûr, plus difficile. Vous n'attaquerez pas les Turcs. Pour vous attaquer, il faut qu’ils passent le Danube, très mauvaise chance pour eux. On restera probablement l’arme au bras ; et si on ne se bat pas tout de suite, passera-t-on l’hiver sans rien faire pour se battre au Printemps ? C'est le comble de l’invraisemblance. Je retombe toujours dans ma raison. Pourtant je suis inquiet. Je crois que je ne le serais pas du tout, si je ne l'étais pas pour vous. Mais vous êtes dans la question. Je persiste à croire qu’il s'est passé à Olmütz quelque chose que nous ne savons pas et qui laisse une poste entrouverte pour la paix.
Parlons d'autre chose. Avez-vous lu la vie du Marquis de Bouillé par son petit-fils René de Bouillé ? Cela vous intéresserait. Vous passeriez la partie militaire. M. de Brouillé a été l’un des rares hommes de sens et du caractère du parti émigré dans notre grande révolution, et il a été, en rapport avec tous les hommes considérables de son temps.
Onze heures
Bonne lettre dans notre péril. J’ai toujours confiance à la dernière extrémité. S'il y a quelque nouvelle chance de négociation, Aberdeen ne se retirera pas. Très probable ment d'ailleurs, il ne se retirerait pas seul, et vous savez qu’un cabinet nécessaire à l'intérieur, ne se dissout pas pour des raisons de politique extérieure. J’ai trouvé, pour la Princesse Koutschoubey, non pas tout ce qu’elle cherche, mais quelque chose qui, je crois, peut lui suffire quant à présent et vaut peut-être mieux pour commencer. Je le lui écrirai demain à elle-même, puisque vous le désirez. Je n'ai pas le temps ce matin. Adieu. Adieu. G.
Val Richer, Mercredi 12 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 12 oct. 1853
J’ai Barante ici depuis avant hier ; il ne m’a rien appris, mais nous causons beaucoup. Il est aimable, bon, et de mon avis presque sur toutes choses. Il ne croit pas plus que moi, et que M. de Meyendorff qu’on se batte sérieusement, ni que la France et l'Angleterre s'en mêlent réellement. L’attitude et l’unanimité du cabinet anglais disent aussi cela. Piscatory m'écrit que nous ne tenons pas assez de compte des Barbares, des Turcs eux-mêmes, et que leur ignorance et leurs passions déjoueront, toute la modération Européenne. Je ne le crois pas pourtant ce qui se passe depuis un mois lui donne quelque apparence de raison. Voyez-vous les Holland ? Barante dit qu’ils sont très animés, et que, ces jours derniers. Thiers, chez eux, était fort à la guerre. Il a eu là, à ce sujet, une dispute très vive avec Cousin, grand partisan de la paix. " Voilà comme vous êtes toujours, vous voulez recommencer 1840 & & " Cousin développe très bien un bon thème.
Avez-vous lu la lettre de Montalembert à Dupin qui lui avait envoyé son discours au comice agricole de Corbigny ? C'est vieux, mais c’est vif et bien tourné.
La correspondance d’Havas ferait mieux de ne pas trahir si clairement, dans son petit bulletin politique, son désir de la chute de Lord Aberdeen. J'y trouve aujourd’hui cette phrase : " Au jour où le gouvernement anglais se déciderait à entrer en lutte avec la Russie, il est possible que les précédents de l'illustre diplomate deviennent gênants et qu’il soit utile de remettre la conduite de la guerre en des mains plus vigoureuses et moins engagées ; mais tant qu’il reste quelque espoir de conserver la paix, tant qu’il y a des négociations à suivre, des concessions à solliciter, l'influence pacifique du nom de Lord Aberdeen est bonne, ce nom semble à conserver ? C’est une maladresse d'être à la fois timide et malveillant. On me dit que Naples est assez agité surtout la Sicile ; les correspondances de Malte recommencent. Le Roi de Naples est convaincu que, si la guerre éclatait, la Sicile serait la vraie indemnité anglaise. Les perspectives de cet avenir là commencent à agiter beaucoup aussi Rome et Turin.
Vous devriez lire les nouvelles lettres de la Palatine, Madame mère du Régent. M. de Sainte Beuve en donne dans le Moniteur, un extrait piquant. Je ne connais pas un exemple pareil de grossièreté unique dans le langage ; mais le fond est sensé, spirituel et honnête. Cela vous amuserait. Je ne connais pas du reste encore les nouvelles Lettres. Je n'en parle que d'après le Moniteur.
Onze heures
Adieu, adieu. Je n'ai rien de plus à vous dire. G.
J’ai Barante ici depuis avant hier ; il ne m’a rien appris, mais nous causons beaucoup. Il est aimable, bon, et de mon avis presque sur toutes choses. Il ne croit pas plus que moi, et que M. de Meyendorff qu’on se batte sérieusement, ni que la France et l'Angleterre s'en mêlent réellement. L’attitude et l’unanimité du cabinet anglais disent aussi cela. Piscatory m'écrit que nous ne tenons pas assez de compte des Barbares, des Turcs eux-mêmes, et que leur ignorance et leurs passions déjoueront, toute la modération Européenne. Je ne le crois pas pourtant ce qui se passe depuis un mois lui donne quelque apparence de raison. Voyez-vous les Holland ? Barante dit qu’ils sont très animés, et que, ces jours derniers. Thiers, chez eux, était fort à la guerre. Il a eu là, à ce sujet, une dispute très vive avec Cousin, grand partisan de la paix. " Voilà comme vous êtes toujours, vous voulez recommencer 1840 & & " Cousin développe très bien un bon thème.
Avez-vous lu la lettre de Montalembert à Dupin qui lui avait envoyé son discours au comice agricole de Corbigny ? C'est vieux, mais c’est vif et bien tourné.
La correspondance d’Havas ferait mieux de ne pas trahir si clairement, dans son petit bulletin politique, son désir de la chute de Lord Aberdeen. J'y trouve aujourd’hui cette phrase : " Au jour où le gouvernement anglais se déciderait à entrer en lutte avec la Russie, il est possible que les précédents de l'illustre diplomate deviennent gênants et qu’il soit utile de remettre la conduite de la guerre en des mains plus vigoureuses et moins engagées ; mais tant qu’il reste quelque espoir de conserver la paix, tant qu’il y a des négociations à suivre, des concessions à solliciter, l'influence pacifique du nom de Lord Aberdeen est bonne, ce nom semble à conserver ? C’est une maladresse d'être à la fois timide et malveillant. On me dit que Naples est assez agité surtout la Sicile ; les correspondances de Malte recommencent. Le Roi de Naples est convaincu que, si la guerre éclatait, la Sicile serait la vraie indemnité anglaise. Les perspectives de cet avenir là commencent à agiter beaucoup aussi Rome et Turin.
Vous devriez lire les nouvelles lettres de la Palatine, Madame mère du Régent. M. de Sainte Beuve en donne dans le Moniteur, un extrait piquant. Je ne connais pas un exemple pareil de grossièreté unique dans le langage ; mais le fond est sensé, spirituel et honnête. Cela vous amuserait. Je ne connais pas du reste encore les nouvelles Lettres. Je n'en parle que d'après le Moniteur.
Onze heures
Adieu, adieu. Je n'ai rien de plus à vous dire. G.
Au château de Broglie, Samedi 22 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Au château de Broglie, Samedi 22 oct. 1853
Voici la réponse de M. Monod. On fera maintenant ce qu'on préférera. Dites le moi seulement dès que vous le saurez pour que j'en informe, M. Monod.
Je reçois à l’instant des nouvelles de la Reine du 19 à 10 heures du matin, un peu meilleures. On me dit que les mauvais symptômes ont cessé et qu'on est rassuré. J’ai pour que ce ne soit là que les oscillations d’une maladie bien grave. Elle avait été mieux le lundi 17 ; elle est retombée le mardi 18 ; un des poumons s’engorgeait ; il paraît qu’elle était mieux le Mercredi 19. On a fait venir de Paris, une soeur de la Charité qu'elle aime particulièrement.
C'est dommage que G. ne vous écrive plus. Je lui croyais l’âme trop exercée aux pertes ou aux gains de Newmarket pour que ses correspondances en fussent dérangées. Si l'Europe ressemble à la France, M. de Persigny aura raison.
Avez-vous lu l’article des Débats d’hier sur la race Slave, et le théâtre en Russie, et savez-vous qui est M. Pierre Douhaina l’article m’a intéressé, quoique bien long. Les Russes et les Turcs vont remplir les journaux. Je trouve le dernier langage du Times très sensé. On fera évidemment partout tout ce qu’on pourra pour rétablir la paix, et probablement on y réussira. Mais, on a en même temps partout le sentiment qu’il y a beaucoup d'inconnu, dans cette situation, et on se prépare à n'être pas surpris, ni pris au dépourvu par l'inconnu.
Voilà, toutes mes nouvelles. Je pars dans deux heures pour aller passer deux jours au Val Richer. J’ai eu ici un temps affreux. Il fait un peu moins laid aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Voici la réponse de M. Monod. On fera maintenant ce qu'on préférera. Dites le moi seulement dès que vous le saurez pour que j'en informe, M. Monod.
Je reçois à l’instant des nouvelles de la Reine du 19 à 10 heures du matin, un peu meilleures. On me dit que les mauvais symptômes ont cessé et qu'on est rassuré. J’ai pour que ce ne soit là que les oscillations d’une maladie bien grave. Elle avait été mieux le lundi 17 ; elle est retombée le mardi 18 ; un des poumons s’engorgeait ; il paraît qu’elle était mieux le Mercredi 19. On a fait venir de Paris, une soeur de la Charité qu'elle aime particulièrement.
C'est dommage que G. ne vous écrive plus. Je lui croyais l’âme trop exercée aux pertes ou aux gains de Newmarket pour que ses correspondances en fussent dérangées. Si l'Europe ressemble à la France, M. de Persigny aura raison.
Avez-vous lu l’article des Débats d’hier sur la race Slave, et le théâtre en Russie, et savez-vous qui est M. Pierre Douhaina l’article m’a intéressé, quoique bien long. Les Russes et les Turcs vont remplir les journaux. Je trouve le dernier langage du Times très sensé. On fera évidemment partout tout ce qu’on pourra pour rétablir la paix, et probablement on y réussira. Mais, on a en même temps partout le sentiment qu’il y a beaucoup d'inconnu, dans cette situation, et on se prépare à n'être pas surpris, ni pris au dépourvu par l'inconnu.
Voilà, toutes mes nouvelles. Je pars dans deux heures pour aller passer deux jours au Val Richer. J’ai eu ici un temps affreux. Il fait un peu moins laid aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Au château de Broglie, Mercredi 26 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Au château de Broglie, Mercredi 26 oct. 1853
Certainement si la Grèce prenait parti contre les Turcs et soulevait partout les Grecs, la complication serait grosse et l’Europe Chrétienne bien embarrassée. Mais cela n’arrivera que si vous le voulez, et vous ne le voudrez pas. Il y avait un homme qui est mort, et qui s’il vivait n'y manquerait pas ; c'était Colettis. Il aurait cru trahir, la Grèce et les Grecs s’il avait laissé échapper une telle chance que l'Europe le voulût ou non. Mais ces hommes-là sont rares, et je ne pense qu’il y ait en Grèce un autre Colettis.
Le Duc de Broglie reçoit à l’instant une lettre du Dr Chomel qui est arrivé de Genève le 22. Il avait quitté la Reine le 24, la laissant mieux, mais pas encore tout-à-fait en convalescence. Encore de la fièvre. Il craint l’âge, la saison, la fatigue. Cependant il est plutôt rassurant qu'inquiétant.
On a eu grand tort à Londres de n'être pas parfaitement poli envers votre grande Duchesse. D’autant plus poli qu’on semblait plus près de se battre. La guerre n’est pas une brouillerie entre les personnes. Je trouve misérables ces impolitesses préméditées, par raison d'Etat. Il n’y a à cela ni dignité, ni habilité. C’est une humeur subalterne ou une maladroite, imprévoyance. Reine d’Angleterre, j’aurais rendu extérieurement à votre grande Duchesse tout ce qui lui appartient, sans me préoccuper de la paix ou de la guerre. Empereur des Français j'aurais invité Kisseleff et Hübner à Compiègne comme les autres, sauf à ne pas leur dire là un mot de politique. C’eût été de meilleur goût dans le présent, et de meilleure politique pour l'avenir.
Je suis revenu hier ici, par un temps magnifique qui dure. Il y a chasse aujourd’hui dans la forêt. On court un chevreuil. Mon fils, est parti ce matin avec Albert et Paul de Broglie. Il y aura certainement moins de confusion qu'à Compiègne, et j’espère pas d'accident. J'écrirai à M. Monod pour qu’il n’attende rien. Je crois qu’on a raison. Ce serait bien solitaire. Ecrivez-moi encore et demain Jeudi, je vous prie. Je n'en partirai que samedi matin de bonne heure. Le Duc de Broglie partira aussi samedi pour Paris où Mad. de Staël arrive. Il va conduire son fils Paul à l'Ecole polytechnique où ce jeune homme entre brillamment. Il est spirituel, original, sauvage, et doué, à ce qu’il paraît de dispositions rares pour les Mathématiques.
Adieu, adieu. Où donc est allé Dumon ? Je ne pense pas qu’il doive être absent longtemps. G.
Certainement si la Grèce prenait parti contre les Turcs et soulevait partout les Grecs, la complication serait grosse et l’Europe Chrétienne bien embarrassée. Mais cela n’arrivera que si vous le voulez, et vous ne le voudrez pas. Il y avait un homme qui est mort, et qui s’il vivait n'y manquerait pas ; c'était Colettis. Il aurait cru trahir, la Grèce et les Grecs s’il avait laissé échapper une telle chance que l'Europe le voulût ou non. Mais ces hommes-là sont rares, et je ne pense qu’il y ait en Grèce un autre Colettis.
Le Duc de Broglie reçoit à l’instant une lettre du Dr Chomel qui est arrivé de Genève le 22. Il avait quitté la Reine le 24, la laissant mieux, mais pas encore tout-à-fait en convalescence. Encore de la fièvre. Il craint l’âge, la saison, la fatigue. Cependant il est plutôt rassurant qu'inquiétant.
On a eu grand tort à Londres de n'être pas parfaitement poli envers votre grande Duchesse. D’autant plus poli qu’on semblait plus près de se battre. La guerre n’est pas une brouillerie entre les personnes. Je trouve misérables ces impolitesses préméditées, par raison d'Etat. Il n’y a à cela ni dignité, ni habilité. C’est une humeur subalterne ou une maladroite, imprévoyance. Reine d’Angleterre, j’aurais rendu extérieurement à votre grande Duchesse tout ce qui lui appartient, sans me préoccuper de la paix ou de la guerre. Empereur des Français j'aurais invité Kisseleff et Hübner à Compiègne comme les autres, sauf à ne pas leur dire là un mot de politique. C’eût été de meilleur goût dans le présent, et de meilleure politique pour l'avenir.
Je suis revenu hier ici, par un temps magnifique qui dure. Il y a chasse aujourd’hui dans la forêt. On court un chevreuil. Mon fils, est parti ce matin avec Albert et Paul de Broglie. Il y aura certainement moins de confusion qu'à Compiègne, et j’espère pas d'accident. J'écrirai à M. Monod pour qu’il n’attende rien. Je crois qu’on a raison. Ce serait bien solitaire. Ecrivez-moi encore et demain Jeudi, je vous prie. Je n'en partirai que samedi matin de bonne heure. Le Duc de Broglie partira aussi samedi pour Paris où Mad. de Staël arrive. Il va conduire son fils Paul à l'Ecole polytechnique où ce jeune homme entre brillamment. Il est spirituel, original, sauvage, et doué, à ce qu’il paraît de dispositions rares pour les Mathématiques.
Adieu, adieu. Où donc est allé Dumon ? Je ne pense pas qu’il doive être absent longtemps. G.
52. Val Richer , Vendredi 26 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
52 Val Richer, Vendredi 26 Août 1853
Je vous écris à Paris où je suppose que vous arriverez demain. Je vous ai écrit à Francfort d’où l’on vous renverra ma lettre si vous y avez passé trop tôt pour l'avoir, ce qui me paraît probable. Je ne reviens pas sur ce que je vous disais. Il aurait fallu vous attendre trop longtemps. J’aime mieux refaire 95 lieues que perdre huit jours. J’irai vous voir du 10 au 15 septembre. J’attends deux visites dans les premiers jours de septembre. Certainement je causerai plus longtemps avec vous qu’avec l'Académie. J’ai grande envie de vous voir et de causer. La personne d'abord, puis la conversation. Ce serait charmant que nous fussions toujours du même avis ; la sympathie vaut mieux que la dispute ; mais là, où le premier plaisir n'est pas, le second à encore son prix. Je suis fort aise que vous soyiez content, à Pétersbourg de votre sortie de l'affaire Turque. Je ne pense pas qu’on soit mécontent à Londres et je crois que, s’il n’y avait point eu d'Angleterre, ou si elle ne s'en était pas mêlée, vous seriez encore plus contents. C'est elle qui vous a empêchés de faire toute votre volonté. Là est son succès, quelles qu'aient été ses fautes. La politique extérieure Anglaise fait beaucoup de fautes de détail, car elle ignore beaucoup, tant le continent lui est étranger, et elle est pleine de transformations brusques, et de soubresauts, comme il arrive dans les pays libres ; mais en gros et dans l’ensemble des choses, le bon sens et la vigueur y sont toujours et la mènent au but. Quant à l'affaire elle-même, comme je ne m'en suis jamais inquiété, j'en attends très patiemment à la dernière fin. J’ai reçu hier des nouvelles de Barante qui ne me paraît pas s'être inquiété non plus.
Le mariage de l'Empereur d’Autriche était très inattendu. En Normandie du moins. Je ne suppose pas qu’il y ait là aucun goût personnel. C’est un lien de plus avec la Bavière que l’Autriche tient toujours beaucoup à se bien assurer, comme son plus gros satellite en Allemagne. Les Belges me paraissent ravis de leur Duchesse de Brabant. L’Autriche aura toujours bien à faire avec les deux boulets rouges qu’elle traine ; mais elle se relève bien tout en les traînant. Je voudrais connaître un peu au juste son état intérieur. J’entends là dessus bien des choses contradictoires.
On m’a dit à Paris que le travail pour faire venir le Pape avait sérieusement recommencé. On vous le dira sans doute aussi. En France, dans les masses, certainement l'Impératrice est populaire ; on aime mieux la beauté, et le roman que la politique, on s'y connaît mieux. Je suis venu, samedi de Paris à Rouen par un train qui précédait d’un quart d'heure celui qui devait mener le ménage impérial à Dieppe. Toute, la population était en l’air pour les voir passer ; et ce n'était pas de la pure curiosité ; il s'y mêlait de l’intérêt.
Onze heures 1/2
Voilà mon facteur et n'en à ajouter. Adieu, adieu.G.
Je vous écris à Paris où je suppose que vous arriverez demain. Je vous ai écrit à Francfort d’où l’on vous renverra ma lettre si vous y avez passé trop tôt pour l'avoir, ce qui me paraît probable. Je ne reviens pas sur ce que je vous disais. Il aurait fallu vous attendre trop longtemps. J’aime mieux refaire 95 lieues que perdre huit jours. J’irai vous voir du 10 au 15 septembre. J’attends deux visites dans les premiers jours de septembre. Certainement je causerai plus longtemps avec vous qu’avec l'Académie. J’ai grande envie de vous voir et de causer. La personne d'abord, puis la conversation. Ce serait charmant que nous fussions toujours du même avis ; la sympathie vaut mieux que la dispute ; mais là, où le premier plaisir n'est pas, le second à encore son prix. Je suis fort aise que vous soyiez content, à Pétersbourg de votre sortie de l'affaire Turque. Je ne pense pas qu’on soit mécontent à Londres et je crois que, s’il n’y avait point eu d'Angleterre, ou si elle ne s'en était pas mêlée, vous seriez encore plus contents. C'est elle qui vous a empêchés de faire toute votre volonté. Là est son succès, quelles qu'aient été ses fautes. La politique extérieure Anglaise fait beaucoup de fautes de détail, car elle ignore beaucoup, tant le continent lui est étranger, et elle est pleine de transformations brusques, et de soubresauts, comme il arrive dans les pays libres ; mais en gros et dans l’ensemble des choses, le bon sens et la vigueur y sont toujours et la mènent au but. Quant à l'affaire elle-même, comme je ne m'en suis jamais inquiété, j'en attends très patiemment à la dernière fin. J’ai reçu hier des nouvelles de Barante qui ne me paraît pas s'être inquiété non plus.
Le mariage de l'Empereur d’Autriche était très inattendu. En Normandie du moins. Je ne suppose pas qu’il y ait là aucun goût personnel. C’est un lien de plus avec la Bavière que l’Autriche tient toujours beaucoup à se bien assurer, comme son plus gros satellite en Allemagne. Les Belges me paraissent ravis de leur Duchesse de Brabant. L’Autriche aura toujours bien à faire avec les deux boulets rouges qu’elle traine ; mais elle se relève bien tout en les traînant. Je voudrais connaître un peu au juste son état intérieur. J’entends là dessus bien des choses contradictoires.
On m’a dit à Paris que le travail pour faire venir le Pape avait sérieusement recommencé. On vous le dira sans doute aussi. En France, dans les masses, certainement l'Impératrice est populaire ; on aime mieux la beauté, et le roman que la politique, on s'y connaît mieux. Je suis venu, samedi de Paris à Rouen par un train qui précédait d’un quart d'heure celui qui devait mener le ménage impérial à Dieppe. Toute, la population était en l’air pour les voir passer ; et ce n'était pas de la pure curiosité ; il s'y mêlait de l’intérêt.
Onze heures 1/2
Voilà mon facteur et n'en à ajouter. Adieu, adieu.G.
Val-Richer, Dimanche 30 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 30 oct. 1853
Voilà donc des coups de canon. Je ne connais pas assez les localités pour savoir ce qu’ils valent comme opération militaire ; il paraît que vous avez pris l’initiative. Je serais étonné si vous ne laissiez pas aux Turcs l’embarras de passer le Danube, et de venir vous attaquer dans les Principautés. Militairement cela semble sensé, et politiquement, c’est beaucoup mieux pour vous. Les Turcs ne peuvent soutenir longtemps la guerre offensive. L’article du Moniteur est calmant et pacifique. Mais je ne m'explique pas la nomination du général Baraguey d’Hilliers, sinon par l'Empire des services personnels, abstraction faite de toute politique. Du reste la Bourse et Galignani disent que le Moniteur n’a pas fait sur tout le monde la même impression que sur vous et moi.
Je suis frappé de la froideur et de l’ennui des journaux Anglais sur cette affaire. C'est ce qui arrive des questions factices. Quand le bavardage a jeté son feu, et qu’il faut en venir à l'action sérieuse, il n’y a plus rien, et en voudrait bien n’y plus penser.
J’ai quelque peine à écrire ce matin. Je suis pris, dans l’épaule, d’une douleur rhumatismale assez vive quand je fais un mouvement. Je connais cela. J'en ai été atteint un jour où j’avais à parler à la Chambre des Paires, et j’ai parlé quand même, l’épaule et le cou de travers. Je n'ai plus besoin de si maltraiter mon mal. Cela passera avec quelques frictions et deux ou trois jours.
Onze heures
Voilà une lettre qui me déplait beaucoup. Mais vos impressions sont bien en contradiction avec cette suspension momentanée des hostilités dont les journaux m’apportent le bruit. Je ne crois pas à l'attaque dans la mer Noire. Que tout cela est fou et triste ! Adieu, adieu. G.
Voilà donc des coups de canon. Je ne connais pas assez les localités pour savoir ce qu’ils valent comme opération militaire ; il paraît que vous avez pris l’initiative. Je serais étonné si vous ne laissiez pas aux Turcs l’embarras de passer le Danube, et de venir vous attaquer dans les Principautés. Militairement cela semble sensé, et politiquement, c’est beaucoup mieux pour vous. Les Turcs ne peuvent soutenir longtemps la guerre offensive. L’article du Moniteur est calmant et pacifique. Mais je ne m'explique pas la nomination du général Baraguey d’Hilliers, sinon par l'Empire des services personnels, abstraction faite de toute politique. Du reste la Bourse et Galignani disent que le Moniteur n’a pas fait sur tout le monde la même impression que sur vous et moi.
Je suis frappé de la froideur et de l’ennui des journaux Anglais sur cette affaire. C'est ce qui arrive des questions factices. Quand le bavardage a jeté son feu, et qu’il faut en venir à l'action sérieuse, il n’y a plus rien, et en voudrait bien n’y plus penser.
J’ai quelque peine à écrire ce matin. Je suis pris, dans l’épaule, d’une douleur rhumatismale assez vive quand je fais un mouvement. Je connais cela. J'en ai été atteint un jour où j’avais à parler à la Chambre des Paires, et j’ai parlé quand même, l’épaule et le cou de travers. Je n'ai plus besoin de si maltraiter mon mal. Cela passera avec quelques frictions et deux ou trois jours.
Onze heures
Voilà une lettre qui me déplait beaucoup. Mais vos impressions sont bien en contradiction avec cette suspension momentanée des hostilités dont les journaux m’apportent le bruit. Je ne crois pas à l'attaque dans la mer Noire. Que tout cela est fou et triste ! Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mardi 1er novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 1er Nov. 1853
Tout est possible ; ma confiance n’est pas grande ; je reconnais avec vous que la raison est en déroute. Pourtant je ne crois pas à la guerre, à la vraie guerre. Je ne trouve pas que de la part de l'Angleterre du moins, rien en ait l’air. Vous oubliez un peu le prix qu’on met à vous inquiéter, pour que vos inquiétudes aillent à Pétersbourg et pèsent sur les impressions, et par là, sur les résolutions de votre Empereur. Je ne voudrais nuire en rien à cette petite manoeuvre, car moi aussi j’ai grande envie que votre Empereur se prête à ce qu’on lui demande. Il le peut sans perdre autre chose que le puéril plaisir de la taquinerie ou de la bravade ; la facilité qu’il montrera aujourd’hui ne changera rien à l'avenir de la Turquie ni aux destinés de la Russie. La question du fond est depuis longtemps décidée, et n'attend que son jour. Et comme votre Empereur n'est pas pressé, il peut attendre aussi, et en attendant maintenir la paix de l'Europe dans laquelle des questions bien plus grandes que la Turquie sont engagées. Si, pour le porter à cela vos inquiétudes sont bonnes à quelque chose, gardez-les. Mais quand je vous en vois réellement tourmentée, je laisse là ma diplomatie, et je les combats comme si elles ne servaient à rien.
Si j’en crois le Moniteur, vous n'êtes pas oisifs en Chine, et vous voir préparez à profiter là de la chute des Tartares. Encore un point sur lequel vous vous trouverez en présence des Anglais et des Américains. Dans un siècle d’ici, il ne restera plus sur ce globe un pays dont la race Européenne ne soit maîtresse. C'est juste.
J’ai bien fait de n'avoir pas à vous écrire hier ; vous m'auriez trouvé une bien mauvaise écriture ; j’avais les épaules tout-à-fait prises de rhumatismes. Les frictions ont fait leur effet. J’ai très bien dormi cette nuit, et je suis dégagé.
Avez-vous lu les Mémoires du comte Mollien et les extraits du Moniteur ne vous en donnent-ils pas quelque envie ? Vous passeriez les dissertations de finances ; il y aurait encore, dans les conversations avec l'Empereur, et les embarras intérieurs de son gouvernement, de quoi vous intéresser. Si vous vouliez les volumes, il sont dans ma bibliothèque à Paris ; mon fils, qui y retourne samedi, vous les ferait remettre.
Onze heures
Le facteur m’arrive au milieu de la toilette. Je suis bien aise que les diplomates ne fassent des notes, et très fâché que vous passiez des nuits blanches. Vraiment, si la guerre devait sortir de tout ceci il y a longtemps qu'elle aurait commencé, tant on a mal conduit les affaires de la paix. Adieu, adieu. G.
Tout est possible ; ma confiance n’est pas grande ; je reconnais avec vous que la raison est en déroute. Pourtant je ne crois pas à la guerre, à la vraie guerre. Je ne trouve pas que de la part de l'Angleterre du moins, rien en ait l’air. Vous oubliez un peu le prix qu’on met à vous inquiéter, pour que vos inquiétudes aillent à Pétersbourg et pèsent sur les impressions, et par là, sur les résolutions de votre Empereur. Je ne voudrais nuire en rien à cette petite manoeuvre, car moi aussi j’ai grande envie que votre Empereur se prête à ce qu’on lui demande. Il le peut sans perdre autre chose que le puéril plaisir de la taquinerie ou de la bravade ; la facilité qu’il montrera aujourd’hui ne changera rien à l'avenir de la Turquie ni aux destinés de la Russie. La question du fond est depuis longtemps décidée, et n'attend que son jour. Et comme votre Empereur n'est pas pressé, il peut attendre aussi, et en attendant maintenir la paix de l'Europe dans laquelle des questions bien plus grandes que la Turquie sont engagées. Si, pour le porter à cela vos inquiétudes sont bonnes à quelque chose, gardez-les. Mais quand je vous en vois réellement tourmentée, je laisse là ma diplomatie, et je les combats comme si elles ne servaient à rien.
Si j’en crois le Moniteur, vous n'êtes pas oisifs en Chine, et vous voir préparez à profiter là de la chute des Tartares. Encore un point sur lequel vous vous trouverez en présence des Anglais et des Américains. Dans un siècle d’ici, il ne restera plus sur ce globe un pays dont la race Européenne ne soit maîtresse. C'est juste.
J’ai bien fait de n'avoir pas à vous écrire hier ; vous m'auriez trouvé une bien mauvaise écriture ; j’avais les épaules tout-à-fait prises de rhumatismes. Les frictions ont fait leur effet. J’ai très bien dormi cette nuit, et je suis dégagé.
Avez-vous lu les Mémoires du comte Mollien et les extraits du Moniteur ne vous en donnent-ils pas quelque envie ? Vous passeriez les dissertations de finances ; il y aurait encore, dans les conversations avec l'Empereur, et les embarras intérieurs de son gouvernement, de quoi vous intéresser. Si vous vouliez les volumes, il sont dans ma bibliothèque à Paris ; mon fils, qui y retourne samedi, vous les ferait remettre.
Onze heures
Le facteur m’arrive au milieu de la toilette. Je suis bien aise que les diplomates ne fassent des notes, et très fâché que vous passiez des nuits blanches. Vraiment, si la guerre devait sortir de tout ceci il y a longtemps qu'elle aurait commencé, tant on a mal conduit les affaires de la paix. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer 3 Novembre 1853
Je suis décidé à croire que votre Empereur ne veut pas la guerre, et par conséquent à croire qu’il saisira la première occasion de sortir d’un mauvais pas qui mène à la guerre à la guerre révolutionnaire générale, au chaos Européen.
Si malgré cette perspective, vous aviez votre parti pris de pousser la botte à fond et de jeter bas l'Empire Ottoman pour mettre la main sur les gros morceaux, je comprendrais l'obstination et je n'aurais rien à dire, sinon que le moment est mal choisi pour un si grand coup. Mais je suis convaincu que vous ne voulez pas porter ce coup et alors je ne comprendrais pas que vous ne missiez pas fin, le plutôt possible, à la situation actuelle. Vous n’avez qu'à y perdre. Vous y avez déjà pas mal perdu ; vous y avez perdu votre grand caractère de pacificateur général, de conservateur suprême de l'ordre Européen ; vous avez reveillé les méfiances des autres puissances ; vous vous êtes séparés de l'Angleterre ; vous l’avez unie à la France ; vous avez placé votre plus sûr allié, l'Autriche, dans la situation la plus périlleuse. Vous avez fait autre chose encore ; vous avez fourni à la Turquie une nouvelle occasion de s'établir dans le droit public Européen.
Taxez moi de rancune si vous voulez ; mais ce fût là, en 1840, votre faute capitale, pour isoler, pour affaiblir le gouvernement du Roi Louis Philippe, vous avez alors mis de côté votre politique traditionnelle qui était de traiter les affaires de Turquie pour votre propre compte, à vous seuls sans concert avec personne, vous avez vous-mêmes porté ces affaires à Londres par le traité du 15 Juillet 1840 vous en avez fait de vos propres mains, l'affaire commune de l’Europe. Vous avez été obligés l’année suivante, de faire encore un pas dans cette voie, et la convention des détroits du 13 Juillet 1841, et, de votre aveu, confirmée, pour la Turquie, l’intervention et le concert de l'Europe. Ce n’est pas là, je pense, ce qui vous convient toujours et au fond, et vous deviez être pressés de rentrer avec la Turquie dans vos habitudes de tête à tête. L'affaire des Lieux Saints vous en fournissait, il y a quelques mois une bonne occasion ; après y avoir essuyé, par surprise, à ce qu’il paraît un petit échec, vous y aviez repris vos avantages ; vous l'aviez réglée comme il vous convenait, sans vous brouiller avec la France, et de façon à être fort approuver de l'Angleterre. Pourquoi n'en êtes vous pas restés là ? Tout ce que vous avez fait depuis vous a mal réussi, vous avez eu l’air de vouloir plus que vous ne disiez ; vous n'avez pas fait ce que vous vouliez ; vous vous êtes bientôt trouvés engagés plus avant que vous ne vouliez ; vous avez rallié l'Europe contre vous et jeté la Turquie dans les bras de l’Europe. Pourquoi ? Encore un coup, je ne le comprends pas. Je ne le comprendrais que si je vous croyais décidés à jouer, en ce moment, la grande et dernière partie de cette question, et à mettre, à tout risque, la main sur Constantinople. Et comme je ne crois pas cela, je persiste à penser qu’une seule chose vous importe ; c’est de mettre fin promptement à une situation qui a le triple effet de vous isoler en Europe, d’unir l'Europe contre vous et de placer de plus en plus la Turquie sous la sauvegarde du concert Européen. Vous pouvez sortir de ce mauvais pas, sinon sans quelque déplaisir momentané, du moins sans aucun inconvénient sérieux pour votre politique nationale, et son avenir ; la géographie et le cours naturel des choses vous donnent, dans la question Turque, des forces et des avantages que rien ne peut vous enlever. Pourquoi susciter contre soi un orage quand il suffit de laisser couler l'eau ? Adieu.
J'en dirais bien plus si nous causions. G.
Je suis décidé à croire que votre Empereur ne veut pas la guerre, et par conséquent à croire qu’il saisira la première occasion de sortir d’un mauvais pas qui mène à la guerre à la guerre révolutionnaire générale, au chaos Européen.
Si malgré cette perspective, vous aviez votre parti pris de pousser la botte à fond et de jeter bas l'Empire Ottoman pour mettre la main sur les gros morceaux, je comprendrais l'obstination et je n'aurais rien à dire, sinon que le moment est mal choisi pour un si grand coup. Mais je suis convaincu que vous ne voulez pas porter ce coup et alors je ne comprendrais pas que vous ne missiez pas fin, le plutôt possible, à la situation actuelle. Vous n’avez qu'à y perdre. Vous y avez déjà pas mal perdu ; vous y avez perdu votre grand caractère de pacificateur général, de conservateur suprême de l'ordre Européen ; vous avez reveillé les méfiances des autres puissances ; vous vous êtes séparés de l'Angleterre ; vous l’avez unie à la France ; vous avez placé votre plus sûr allié, l'Autriche, dans la situation la plus périlleuse. Vous avez fait autre chose encore ; vous avez fourni à la Turquie une nouvelle occasion de s'établir dans le droit public Européen.
Taxez moi de rancune si vous voulez ; mais ce fût là, en 1840, votre faute capitale, pour isoler, pour affaiblir le gouvernement du Roi Louis Philippe, vous avez alors mis de côté votre politique traditionnelle qui était de traiter les affaires de Turquie pour votre propre compte, à vous seuls sans concert avec personne, vous avez vous-mêmes porté ces affaires à Londres par le traité du 15 Juillet 1840 vous en avez fait de vos propres mains, l'affaire commune de l’Europe. Vous avez été obligés l’année suivante, de faire encore un pas dans cette voie, et la convention des détroits du 13 Juillet 1841, et, de votre aveu, confirmée, pour la Turquie, l’intervention et le concert de l'Europe. Ce n’est pas là, je pense, ce qui vous convient toujours et au fond, et vous deviez être pressés de rentrer avec la Turquie dans vos habitudes de tête à tête. L'affaire des Lieux Saints vous en fournissait, il y a quelques mois une bonne occasion ; après y avoir essuyé, par surprise, à ce qu’il paraît un petit échec, vous y aviez repris vos avantages ; vous l'aviez réglée comme il vous convenait, sans vous brouiller avec la France, et de façon à être fort approuver de l'Angleterre. Pourquoi n'en êtes vous pas restés là ? Tout ce que vous avez fait depuis vous a mal réussi, vous avez eu l’air de vouloir plus que vous ne disiez ; vous n'avez pas fait ce que vous vouliez ; vous vous êtes bientôt trouvés engagés plus avant que vous ne vouliez ; vous avez rallié l'Europe contre vous et jeté la Turquie dans les bras de l’Europe. Pourquoi ? Encore un coup, je ne le comprends pas. Je ne le comprendrais que si je vous croyais décidés à jouer, en ce moment, la grande et dernière partie de cette question, et à mettre, à tout risque, la main sur Constantinople. Et comme je ne crois pas cela, je persiste à penser qu’une seule chose vous importe ; c’est de mettre fin promptement à une situation qui a le triple effet de vous isoler en Europe, d’unir l'Europe contre vous et de placer de plus en plus la Turquie sous la sauvegarde du concert Européen. Vous pouvez sortir de ce mauvais pas, sinon sans quelque déplaisir momentané, du moins sans aucun inconvénient sérieux pour votre politique nationale, et son avenir ; la géographie et le cours naturel des choses vous donnent, dans la question Turque, des forces et des avantages que rien ne peut vous enlever. Pourquoi susciter contre soi un orage quand il suffit de laisser couler l'eau ? Adieu.
J'en dirais bien plus si nous causions. G.
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 3 Nov. 1853
Les Turcs ont donc passé le Danube, et vous n’y avez pas fait obstacle, probablement dans l’intention de les battre et de les rejeter ensuite au delà du fleuve, en leur disant : " Repassez si vous voulez. " Je me figure qu’il y a là, pour vous toute une politique, et une bonne politique ; si vous restez fermement dans les principautés, en en chassant toujours les Turcs, mais sans en sortir jamais vous-mêmes, vous ferez un grand pas dans votre destinée, en forçant l’Europe de reconnaître que vous ne voulez point aujourd’hui renverser l'Empire Ottoman ; vous remporterez des victoires en vous épargnant les plus grandes difficultés de la guerre, et vous resterez de plus en plus en mesure de négocier, une bonne paix. Je fais profession de ne rien entendre du tout à la guerre comme guerre ; mais la guerre comme moyen de la politique, je la comprends, et dans cette occasion-ci, je ne serais pas embarrassé pour m'en bien servir.
Onze heures et demie
Vos nouvelles valent mieux que mes plans de politique. Comme vous dites, il faut encore tout que ce soit fini ; mais quand ce sera fini, je ne serai guère plus sûr de la paix que je ne l’ai toujours été. Adieu, adieu. On sonne le déjeuner, et ma toilette n’est pas encore achevée. G.
Les Turcs ont donc passé le Danube, et vous n’y avez pas fait obstacle, probablement dans l’intention de les battre et de les rejeter ensuite au delà du fleuve, en leur disant : " Repassez si vous voulez. " Je me figure qu’il y a là, pour vous toute une politique, et une bonne politique ; si vous restez fermement dans les principautés, en en chassant toujours les Turcs, mais sans en sortir jamais vous-mêmes, vous ferez un grand pas dans votre destinée, en forçant l’Europe de reconnaître que vous ne voulez point aujourd’hui renverser l'Empire Ottoman ; vous remporterez des victoires en vous épargnant les plus grandes difficultés de la guerre, et vous resterez de plus en plus en mesure de négocier, une bonne paix. Je fais profession de ne rien entendre du tout à la guerre comme guerre ; mais la guerre comme moyen de la politique, je la comprends, et dans cette occasion-ci, je ne serais pas embarrassé pour m'en bien servir.
Onze heures et demie
Vos nouvelles valent mieux que mes plans de politique. Comme vous dites, il faut encore tout que ce soit fini ; mais quand ce sera fini, je ne serai guère plus sûr de la paix que je ne l’ai toujours été. Adieu, adieu. On sonne le déjeuner, et ma toilette n’est pas encore achevée. G.
Val-Richer, Lundi 7 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 7 Nov. 1853
Voici des nouvelles d’Angleterre. On vous les a peut-être données aussi. En tout cas, je vous les donne. Palmerston ne croit pas à l’arrangement de l'affaire Turque. Il dit qu’on ne se découragera pas, qu’on négociera jusqu'à la dernière extrémité ; mais les choses, selon lui, sont si mal emmanchées et votre Empereur a de telles répugnances (qu’est-ce que cela veut dire ?) qu’on n’arrivera probablement pas à la conclusion qu’on demande. Il se prépare pour cette chance ; il trouve sa position bonne ; il a toujours été fidèle à sa politique de liberté Européenne et d'émancipation des peuples ; le cabinet de Paris ne peut douter de sa loyauté. Bref, il est content, et il attend. J’espère qu’il se trompe. S'il ne se trompe pas, vous aurez la France et l'Angleterre unies pour la guerre libérale, au lieu de les avoir une comme de mon temps, pour la paix constitutionnelle. J’ai beau y penser ; je n'y crois pas. Pouvez-vous vérifier si ce qu’on me dit de Palmerston est vrai ?
En tout cas, les coups de canon qui le tirent en ce moment en Valachie amèneront, ou la paix prompte, ou une guerre de trente ans. On m'écrit que le marquis de Viluma quitte Paris pour aller être président du Sénat à Madrid. Si Narvaez ne devient pas bientôt président du Conseil il reviendra comme ambassadeur à Paris. La nomination du frère de M. de Viluma, du général Pezuela comme gouverneur de Cuba n'indique pas que l’Espagne soit près de s'entendre, à ce sujet, avec les Etats-Unis. C'est un militaire espagnol, très brave, très fier et très vif.
Encore une lettre d’Angleterre, de mon ami Hallam. En voici deux phrases, très sensés : - The worst that could now happen would be a decisive advantage in the fields obtained by the Turks. - There is an apparent spirit in this country very much opposed to the temporizing policy of our friend Lord Aberdeen ; but I do not believe, it lies deep, through the press is almost universally in that tone. A good deal of this swing to the refugee and revolutionary party throughout Europe, and I am most anxious for a pacific settlement, in order to defeat their objects.
Midi
Je ne suis plus curieux que des nouvelles de la bataille. Si vous ne passez pas le Danube, je suis tranquille. Adieu, Adieu. G.
Voici des nouvelles d’Angleterre. On vous les a peut-être données aussi. En tout cas, je vous les donne. Palmerston ne croit pas à l’arrangement de l'affaire Turque. Il dit qu’on ne se découragera pas, qu’on négociera jusqu'à la dernière extrémité ; mais les choses, selon lui, sont si mal emmanchées et votre Empereur a de telles répugnances (qu’est-ce que cela veut dire ?) qu’on n’arrivera probablement pas à la conclusion qu’on demande. Il se prépare pour cette chance ; il trouve sa position bonne ; il a toujours été fidèle à sa politique de liberté Européenne et d'émancipation des peuples ; le cabinet de Paris ne peut douter de sa loyauté. Bref, il est content, et il attend. J’espère qu’il se trompe. S'il ne se trompe pas, vous aurez la France et l'Angleterre unies pour la guerre libérale, au lieu de les avoir une comme de mon temps, pour la paix constitutionnelle. J’ai beau y penser ; je n'y crois pas. Pouvez-vous vérifier si ce qu’on me dit de Palmerston est vrai ?
En tout cas, les coups de canon qui le tirent en ce moment en Valachie amèneront, ou la paix prompte, ou une guerre de trente ans. On m'écrit que le marquis de Viluma quitte Paris pour aller être président du Sénat à Madrid. Si Narvaez ne devient pas bientôt président du Conseil il reviendra comme ambassadeur à Paris. La nomination du frère de M. de Viluma, du général Pezuela comme gouverneur de Cuba n'indique pas que l’Espagne soit près de s'entendre, à ce sujet, avec les Etats-Unis. C'est un militaire espagnol, très brave, très fier et très vif.
Encore une lettre d’Angleterre, de mon ami Hallam. En voici deux phrases, très sensés : - The worst that could now happen would be a decisive advantage in the fields obtained by the Turks. - There is an apparent spirit in this country very much opposed to the temporizing policy of our friend Lord Aberdeen ; but I do not believe, it lies deep, through the press is almost universally in that tone. A good deal of this swing to the refugee and revolutionary party throughout Europe, and I am most anxious for a pacific settlement, in order to defeat their objects.
Midi
Je ne suis plus curieux que des nouvelles de la bataille. Si vous ne passez pas le Danube, je suis tranquille. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 11 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 11 Nov. 1853
Les feuilles d'havas me donnent une dépêche télégraphique de Vienne, du 8, qui dit que les Russes ont attaqué les Turcs et que ceux-ci ont conservé leur position. Je suis décidé à ne rien croire que les nouvelles officielles, et celles-ci pas toujours.
Je vois que Lord Palmerston a eu une brillante réunion à Broadlands, presque tous les diplomates. Je suis assez curieux de savoir quelle sera la fin de cette carrière.
Le discours au Roi Léopold à l'ouverture de ses Chambres fait un grand contraste avec cette agitation et cette confusion de toute l’Europe. Je voudrais qu’il réussit aussi bien dans les conseils à Londres que dans son gouvernement à Bruxelles. Mais ce ne sont pas les bons conseils qui manquent à Londres. Vous voyez que je n'ai absolument rien à vous dire. Je vous écrirai pourtant encore dimanche et mardi. Jeudi, nous causerons.
Midi.
Triste lettre et triste début d’hier. Je ne vois guères maintenant d’autre chance de salut que celle sur laquelle vous comptez, la bêtise générale. Adieu, adieu. G.
Les feuilles d'havas me donnent une dépêche télégraphique de Vienne, du 8, qui dit que les Russes ont attaqué les Turcs et que ceux-ci ont conservé leur position. Je suis décidé à ne rien croire que les nouvelles officielles, et celles-ci pas toujours.
Je vois que Lord Palmerston a eu une brillante réunion à Broadlands, presque tous les diplomates. Je suis assez curieux de savoir quelle sera la fin de cette carrière.
Le discours au Roi Léopold à l'ouverture de ses Chambres fait un grand contraste avec cette agitation et cette confusion de toute l’Europe. Je voudrais qu’il réussit aussi bien dans les conseils à Londres que dans son gouvernement à Bruxelles. Mais ce ne sont pas les bons conseils qui manquent à Londres. Vous voyez que je n'ai absolument rien à vous dire. Je vous écrirai pourtant encore dimanche et mardi. Jeudi, nous causerons.
Midi.
Triste lettre et triste début d’hier. Je ne vois guères maintenant d’autre chance de salut que celle sur laquelle vous comptez, la bêtise générale. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 13 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 13 Nov. 1853
Je crois que nous ne comprendrons guère mieux la guerre que la négociation. Je ne parviens pas à démêler qui, des Russes ou des Turcs est resté vainqueur à Oltenita. Vienne dit les Turcs, Berlin dit les Russes. Je crois que ce sont les Turcs. C’est dommage que le Prince Gortschakoff, qui est venu, dit-on, complimenter ses troupes sur leur bravoure, n'en eût pas placé là un assez grand nombre pour que la bravoure fût sûre du succès.
Je suis obstinément pour la paix, comme Lord Aberdeen, et je persiste à croire que c’est à la paix qu’il faut travailler, et qu’on doit réussir à la rétablir. Mais si nous devons être jetés dans la guerre, et dans la grande guerre, je suis pour que les Turcs soient chassés d’Europe. Au moins faut-il que nous avons ce profit en perspective au bout de ce chaos.
Duchâtel m’écrit dans un grand accès d'indignation contre la façon dont " cette misérable affaire a été conduite ; il n’y a pas deux jugements à rendre." Il est du reste plus préoccupé du dedans que du dehors : " L’hiver, dit-il, sera difficile à passer ; il n’arrive que peu de grains étrangers ; le commerce prétend manquer de la sécurité nécessaire. Les denrées autres que le blé, ont manqué comme le blé et même quelques unes dans une plus forte proportion. Le vin est arrivé à un prix que l'ouvrier ne peut pas payer. Il y a un sujet grave d’inquiétude. Les dispositions du peuple, même dans nos campagnes ordinairement si tranquilles, prennent un caractère menaçant ; le socialisme chemine sous terre sans qu’on s'en aperçoive. Il ne suffit pas, pour le détruire, de la comprimer d’une main en l'encourageant de l'autre ; la force est nécessaire contre les idées mauvaises, mais à elle seule, elle est insuffisante ; il y faut le concours énergique des idées vraies, fortement soutenues. "
Il a raison. Il ne reviendra à Paris qu'à la fin de l’année.
Je ne trouve rien à redire à votre manifeste. Il ne dit que l'indispensable, y compris, la phrase sur la foi orthodoxe. Les catholiques ardents ne peuvent pas vous pardonner ce mot orthodoxe. C'est pour cette raison qu’ils aiment mieux les Turcs qui n’ont pas la prétention de l'orthodoxie. Il me semble que la circulaire de M. de Nesselrode en dit plus que le manifeste, et qu’elle laisse entrevoir la chance d’une guerre offensive de votre part, bien au delà du Danube. En général, les commentaires par circulaires ne vous ont pas réussi.
Onze heures
Je reçois à la fois plusieurs lettres. La situation me paraît grossir et gronder. Que c’est absurde ! Mais ce n'en est que plus grave. Adieu, adieu.
Voici la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Je vous écrirai encore deux mots mardi. G.
Je crois que nous ne comprendrons guère mieux la guerre que la négociation. Je ne parviens pas à démêler qui, des Russes ou des Turcs est resté vainqueur à Oltenita. Vienne dit les Turcs, Berlin dit les Russes. Je crois que ce sont les Turcs. C’est dommage que le Prince Gortschakoff, qui est venu, dit-on, complimenter ses troupes sur leur bravoure, n'en eût pas placé là un assez grand nombre pour que la bravoure fût sûre du succès.
Je suis obstinément pour la paix, comme Lord Aberdeen, et je persiste à croire que c’est à la paix qu’il faut travailler, et qu’on doit réussir à la rétablir. Mais si nous devons être jetés dans la guerre, et dans la grande guerre, je suis pour que les Turcs soient chassés d’Europe. Au moins faut-il que nous avons ce profit en perspective au bout de ce chaos.
Duchâtel m’écrit dans un grand accès d'indignation contre la façon dont " cette misérable affaire a été conduite ; il n’y a pas deux jugements à rendre." Il est du reste plus préoccupé du dedans que du dehors : " L’hiver, dit-il, sera difficile à passer ; il n’arrive que peu de grains étrangers ; le commerce prétend manquer de la sécurité nécessaire. Les denrées autres que le blé, ont manqué comme le blé et même quelques unes dans une plus forte proportion. Le vin est arrivé à un prix que l'ouvrier ne peut pas payer. Il y a un sujet grave d’inquiétude. Les dispositions du peuple, même dans nos campagnes ordinairement si tranquilles, prennent un caractère menaçant ; le socialisme chemine sous terre sans qu’on s'en aperçoive. Il ne suffit pas, pour le détruire, de la comprimer d’une main en l'encourageant de l'autre ; la force est nécessaire contre les idées mauvaises, mais à elle seule, elle est insuffisante ; il y faut le concours énergique des idées vraies, fortement soutenues. "
Il a raison. Il ne reviendra à Paris qu'à la fin de l’année.
Je ne trouve rien à redire à votre manifeste. Il ne dit que l'indispensable, y compris, la phrase sur la foi orthodoxe. Les catholiques ardents ne peuvent pas vous pardonner ce mot orthodoxe. C'est pour cette raison qu’ils aiment mieux les Turcs qui n’ont pas la prétention de l'orthodoxie. Il me semble que la circulaire de M. de Nesselrode en dit plus que le manifeste, et qu’elle laisse entrevoir la chance d’une guerre offensive de votre part, bien au delà du Danube. En général, les commentaires par circulaires ne vous ont pas réussi.
Onze heures
Je reçois à la fois plusieurs lettres. La situation me paraît grossir et gronder. Que c’est absurde ! Mais ce n'en est que plus grave. Adieu, adieu.
Voici la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Je vous écrirai encore deux mots mardi. G.
9. Paris, Dimanche 5 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
9 Paris, Dimanche 5 mars 1854
Je suis pressé ce matin. Je trouve le ton de la réponse de votre Empereur très convenable, modéré, doux, même caressant. Quant au fond, j’y retrouve le même défaut que j’ai trouvé, dans le commencement de l'affaire, dans tout ce qu'a dit et fait votre Empereur ; il n’a jamais assez nettement, assez complètement, assez hautement avoué, sa situation particulière vis-à-vis de la Turquie, vos traditions, et la politique que lui imposaient les perspectives d’un avenir qu’il ne voulait point hâter, mais dont il ne pouvait oublier les nécessités et les chances. Il s’est toujours présenté comme aussi attaché que la France et l'Angleterre à l’intégrité et à l'indépendance de l'Empire Ottoman. Cela n'est pas ; cela ne se peut pas ; vous êtes voisins et grecs. Si vous aviez pris ouvertement, votre position, on vous aurait su gré de votre modération. Au lieu de cela, on s’est méfié de votre langage officiel que démentaient les tendances plus ou moins cachées, plus, ou moins lointaines de vos actes. Il y a, dans la lettre actuelle, le même défaut et vérité générale. Vous êtes trop de petits saints, vous en êtes affaiblis comme politiques. Je ne dis rien des questions de détail comme droit public, vous avez souvent raison.
Voilà l'Assemblée nationale suspendue, c’est-à-dire supprimée. Quoique inattendue en ce moment et pour l’article inculpé, la mesure ne m’a pas surpris. Je lui ferais volontiers le même reproche qu'à la lettre de votre Empereur ; il y a trop de réticence.
Dîner littéraire hier chez Mad. Mollien ; pas ennuyeux. Le soir, Mad. de Boigne malade. Mad. Rothschild ne recevait pas, par exception. Je suis rentré chez moi de bonne heure.
Il vaut mieux que le Ministre de France soit allé vous voir, et que vous soyez avec lui, en bons rapports. C’était autrefois un conservateur décrié. Adieu, adieu. G.
Je suis pressé ce matin. Je trouve le ton de la réponse de votre Empereur très convenable, modéré, doux, même caressant. Quant au fond, j’y retrouve le même défaut que j’ai trouvé, dans le commencement de l'affaire, dans tout ce qu'a dit et fait votre Empereur ; il n’a jamais assez nettement, assez complètement, assez hautement avoué, sa situation particulière vis-à-vis de la Turquie, vos traditions, et la politique que lui imposaient les perspectives d’un avenir qu’il ne voulait point hâter, mais dont il ne pouvait oublier les nécessités et les chances. Il s’est toujours présenté comme aussi attaché que la France et l'Angleterre à l’intégrité et à l'indépendance de l'Empire Ottoman. Cela n'est pas ; cela ne se peut pas ; vous êtes voisins et grecs. Si vous aviez pris ouvertement, votre position, on vous aurait su gré de votre modération. Au lieu de cela, on s’est méfié de votre langage officiel que démentaient les tendances plus ou moins cachées, plus, ou moins lointaines de vos actes. Il y a, dans la lettre actuelle, le même défaut et vérité générale. Vous êtes trop de petits saints, vous en êtes affaiblis comme politiques. Je ne dis rien des questions de détail comme droit public, vous avez souvent raison.
Voilà l'Assemblée nationale suspendue, c’est-à-dire supprimée. Quoique inattendue en ce moment et pour l’article inculpé, la mesure ne m’a pas surpris. Je lui ferais volontiers le même reproche qu'à la lettre de votre Empereur ; il y a trop de réticence.
Dîner littéraire hier chez Mad. Mollien ; pas ennuyeux. Le soir, Mad. de Boigne malade. Mad. Rothschild ne recevait pas, par exception. Je suis rentré chez moi de bonne heure.
Il vaut mieux que le Ministre de France soit allé vous voir, et que vous soyez avec lui, en bons rapports. C’était autrefois un conservateur décrié. Adieu, adieu. G.
19. Paris, Jeudi 16 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
19 Paris. Jeudi 16 Mars 1854
Si de part et d'autre, on ne voulait réellement que ce qu’on dit, l'occasion serait belle pour arrêter encore, les milliers de bouches à feu près de tirer, voilà les Turcs en train de faire pour les Chrétiens, Catholiques, Protestants ou Grecs, bien plus que vous n'avez jamais demandé, pour eux. Pourquoi votre Empereur ne déclare-t-il pas que cela étant, la guerre n'a plus le motif, qu’il ne veut pas la faire et qu’il demande pourquoi, on l’a lui fait ? On serait peut-être un peu étonné, mais très embarrassé. J’ai peur qu’il ne le fasse pas. Et pourtant, s'il ne le fait pas, ce sera plus que jamais à lui que l'Europe s'en prendra de la guerre, car, pour tout ce qu’il a fait depuis un an, il n’a allégué d’autre motif que le motif religieux, la nécessité, pour lui, de protéger l'Eglise grecque. Et en ce moment, c’est au sentiment religieux de son peuple qu’il fait appel pour populariser la guerre. Voici ce qui arrivera probablement. La Russie fera la guerre, à l'Europe pour garantir aux Chrétiens grecs, de Turquie des privilèges très inférieurs à ceux que la Turquie leur accorde. L’Europe fera la guerre aux Chrétiens grecs pour les forcer à accepter ce que la Turquie leur accorde. En soi, cela est absurde, et bientôt, aux yeux des hommes religieux, cela sera odieux. Et si, comme cela encore est probable, l’Europe est elle-même bouleversée, de nouveau par cette guerre, devenue révolution, un jour ne tardera pas à venir, où il n’y aura ni assez de malédictions, ni assez de sifflets pour les auteurs d’une telle situation.
On n'aura, pour échapper aux malédictions. et aux sifflets, d’autre ressource que de dire qu’on voulait autre chose que ce qu’on disait. Triste apologie quand le jour du jugement est arrivé.
On disait hier, de bonne source, que tout était arrangé avec l’Autriche, qu’elle ne vous déclarerait et ne vous ferait point la guerre, mais qu’elle déclarerait son adhésion morale à la politique qui maintient l’intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman, et qu'elle se chargerait de maintenir l’ordre, dans la Servie, la Bosnie et le Monténégro. On paraissait espérer que la Prusse en gardant sa neutralité, donnerait, à cette quasi-neutralité de l’Autriche, une approbation explicite. " Si on était sage, disait avant hier Morny, on se contenterait de cela, on le dirait tout haut, et on resterait en intimité avec l’Autriche, à ces termes. " Il a raison ; mais il disait Si. Et si on n’est pas sage, qu’arrivera-t-il ?
Voilà votre numéro 13. Vous avez un peu troublé Molé il y a quelques jours, en lui écrivant, par la poste, que vous aviez chargé M. de Mirepoix de lui remettre une lettre. Cela n’est pas de votre prudence ordinaire, et je ne dirai pas à Hatzfeld que vous m'avez écrit, par la poste aussi, de me servir de son courrier. Je lui ferai demander ce matin si son courrier peut se charger aussi des deux volumes, de Cromwell. Je pense que oui. Sinon, je vous les enverrai par une autre voie. Adieu.
Je vous ai dit, je crois, que je vais au Val Richer lundi, pour trois jours. J'en reviendrai Vendredi matin. Mon projet. est ensuite de partir le 21 mars et d'aller passer cinq jours avec vous, jusqu’au 5 avril au soir, d’un jeudi à un jeudi. On vient assez me voir le jeudi soir, et je ne veux pas y manquer souvent. J'espère que rien ne dérangera mon projet, et qu’il vous conviendra comme à moi. Adieu, adieu. G.
P.S. On m'assure que les nouvelles de Constantinople disent que la négociation en faveur les Chrétiens est loin d’être aussi avancée qu’on le disait. Au bal qu'a donné ces jours derniers le Roi Jérôme, on affirme que son fils Napoléon n’a pas paru, déclarant à son père que dans ces fonctionnaires Impériaux, il y avait tant d'ennemis de leur droit héréditaire qu’il ne voulait pas se mêler à eux. Le Roi de Naples se prêtera à tout ce qu’on voudra de lui ; mais il a demandé à être débarrassé de M. de Maupas qui intriguait trop ouvertement pour les Murat. De là le remplacement de Maupas par de la cour.
Si de part et d'autre, on ne voulait réellement que ce qu’on dit, l'occasion serait belle pour arrêter encore, les milliers de bouches à feu près de tirer, voilà les Turcs en train de faire pour les Chrétiens, Catholiques, Protestants ou Grecs, bien plus que vous n'avez jamais demandé, pour eux. Pourquoi votre Empereur ne déclare-t-il pas que cela étant, la guerre n'a plus le motif, qu’il ne veut pas la faire et qu’il demande pourquoi, on l’a lui fait ? On serait peut-être un peu étonné, mais très embarrassé. J’ai peur qu’il ne le fasse pas. Et pourtant, s'il ne le fait pas, ce sera plus que jamais à lui que l'Europe s'en prendra de la guerre, car, pour tout ce qu’il a fait depuis un an, il n’a allégué d’autre motif que le motif religieux, la nécessité, pour lui, de protéger l'Eglise grecque. Et en ce moment, c’est au sentiment religieux de son peuple qu’il fait appel pour populariser la guerre. Voici ce qui arrivera probablement. La Russie fera la guerre, à l'Europe pour garantir aux Chrétiens grecs, de Turquie des privilèges très inférieurs à ceux que la Turquie leur accorde. L’Europe fera la guerre aux Chrétiens grecs pour les forcer à accepter ce que la Turquie leur accorde. En soi, cela est absurde, et bientôt, aux yeux des hommes religieux, cela sera odieux. Et si, comme cela encore est probable, l’Europe est elle-même bouleversée, de nouveau par cette guerre, devenue révolution, un jour ne tardera pas à venir, où il n’y aura ni assez de malédictions, ni assez de sifflets pour les auteurs d’une telle situation.
On n'aura, pour échapper aux malédictions. et aux sifflets, d’autre ressource que de dire qu’on voulait autre chose que ce qu’on disait. Triste apologie quand le jour du jugement est arrivé.
On disait hier, de bonne source, que tout était arrangé avec l’Autriche, qu’elle ne vous déclarerait et ne vous ferait point la guerre, mais qu’elle déclarerait son adhésion morale à la politique qui maintient l’intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman, et qu'elle se chargerait de maintenir l’ordre, dans la Servie, la Bosnie et le Monténégro. On paraissait espérer que la Prusse en gardant sa neutralité, donnerait, à cette quasi-neutralité de l’Autriche, une approbation explicite. " Si on était sage, disait avant hier Morny, on se contenterait de cela, on le dirait tout haut, et on resterait en intimité avec l’Autriche, à ces termes. " Il a raison ; mais il disait Si. Et si on n’est pas sage, qu’arrivera-t-il ?
Voilà votre numéro 13. Vous avez un peu troublé Molé il y a quelques jours, en lui écrivant, par la poste, que vous aviez chargé M. de Mirepoix de lui remettre une lettre. Cela n’est pas de votre prudence ordinaire, et je ne dirai pas à Hatzfeld que vous m'avez écrit, par la poste aussi, de me servir de son courrier. Je lui ferai demander ce matin si son courrier peut se charger aussi des deux volumes, de Cromwell. Je pense que oui. Sinon, je vous les enverrai par une autre voie. Adieu.
Je vous ai dit, je crois, que je vais au Val Richer lundi, pour trois jours. J'en reviendrai Vendredi matin. Mon projet. est ensuite de partir le 21 mars et d'aller passer cinq jours avec vous, jusqu’au 5 avril au soir, d’un jeudi à un jeudi. On vient assez me voir le jeudi soir, et je ne veux pas y manquer souvent. J'espère que rien ne dérangera mon projet, et qu’il vous conviendra comme à moi. Adieu, adieu. G.
P.S. On m'assure que les nouvelles de Constantinople disent que la négociation en faveur les Chrétiens est loin d’être aussi avancée qu’on le disait. Au bal qu'a donné ces jours derniers le Roi Jérôme, on affirme que son fils Napoléon n’a pas paru, déclarant à son père que dans ces fonctionnaires Impériaux, il y avait tant d'ennemis de leur droit héréditaire qu’il ne voulait pas se mêler à eux. Le Roi de Naples se prêtera à tout ce qu’on voudra de lui ; mais il a demandé à être débarrassé de M. de Maupas qui intriguait trop ouvertement pour les Murat. De là le remplacement de Maupas par de la cour.
65. Val-Richer, Vendredi 12 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
65 Val Richer Vendredi 12 Mai 1854
Ce qui se passe en Grèce et quant à la Grèce est déplorable à lire. Depuis plus de 30 ans, je me suis accoutumé à porter intérêt à ce petit état. De 1840 à 1848, je l’ai soutenue contre votre domination exclusive et contre le mauvais vouloir anglais. La conduite qu’il tient en ce moment, roi et pays, est très imprudente, mais très naturelle, et il n’y a dans la Grèce même, personne, ni Roi, ni chambres qui soient en état de l'empêcher quand ils le voudraient. Je suis choqué du langage qu’on parle à ses pauvres gens. Je suis sur qu’on pourrait peser sur eux et les contenir un peu avec d'autres façons et d'autres paroles. Nos soldats iront-ils faire en Grèce, au profit des Turcs, ce qu'y faisaient les Égyptiens de Méhémet Ali quand nous y avons envoyé une armée pour les en chasser, et ferons-nous, contre la marine grecque, un second Navarrin ?
Détruire successivement, dans la Méditerranée, les marines Turque, Russe et Grecque c’est beaucoup. Cette affaire d'Orient tournera mal pour l'Europe ; la politique ne peut pas se mettre à ce point en contradiction avec la religion, avec les instincts populaires, avec les actes, tout reçus, des gouvernements eux-mêmes. Plus j'y regarde, plus je me persuade que, si on n'en finit pas promptement, on tombera dans un odieux Chaos. Que signifie ce qu’on écrit de Vienne sur de nouvelles propositions que l’Autriche, après avoir occupé la Bosnie, adresserait à la Russie, et que M. de Meyendorff aurait trouvées acceptables ?
Le bruit se répand ici, parmi le peuple, que le recrutement de l'armée prochaine sera avancée, et qu’on prendra six mois plutôt 80 000 hommes. On s'en attriste ; mais on s'y résigne. La guerre et ses conséquences n'étonnent et ne choquent jamais beaucoup ce pays-ci même quand elles lui déplaisent Du reste, il ne me revient rien qui me donne lieu de croire que ce bruit soit fondé.
Onze heures et demie
Je serais bien fâché qu’il arrivât malheur à ce pauvre M. de Meyendorff. Il me semble que je le connais. Adieu, Adieu.
Voilà enfin le rapporte détaillé de l'amiral Hamelin. Adieu.
Ce qui se passe en Grèce et quant à la Grèce est déplorable à lire. Depuis plus de 30 ans, je me suis accoutumé à porter intérêt à ce petit état. De 1840 à 1848, je l’ai soutenue contre votre domination exclusive et contre le mauvais vouloir anglais. La conduite qu’il tient en ce moment, roi et pays, est très imprudente, mais très naturelle, et il n’y a dans la Grèce même, personne, ni Roi, ni chambres qui soient en état de l'empêcher quand ils le voudraient. Je suis choqué du langage qu’on parle à ses pauvres gens. Je suis sur qu’on pourrait peser sur eux et les contenir un peu avec d'autres façons et d'autres paroles. Nos soldats iront-ils faire en Grèce, au profit des Turcs, ce qu'y faisaient les Égyptiens de Méhémet Ali quand nous y avons envoyé une armée pour les en chasser, et ferons-nous, contre la marine grecque, un second Navarrin ?
Détruire successivement, dans la Méditerranée, les marines Turque, Russe et Grecque c’est beaucoup. Cette affaire d'Orient tournera mal pour l'Europe ; la politique ne peut pas se mettre à ce point en contradiction avec la religion, avec les instincts populaires, avec les actes, tout reçus, des gouvernements eux-mêmes. Plus j'y regarde, plus je me persuade que, si on n'en finit pas promptement, on tombera dans un odieux Chaos. Que signifie ce qu’on écrit de Vienne sur de nouvelles propositions que l’Autriche, après avoir occupé la Bosnie, adresserait à la Russie, et que M. de Meyendorff aurait trouvées acceptables ?
Le bruit se répand ici, parmi le peuple, que le recrutement de l'armée prochaine sera avancée, et qu’on prendra six mois plutôt 80 000 hommes. On s'en attriste ; mais on s'y résigne. La guerre et ses conséquences n'étonnent et ne choquent jamais beaucoup ce pays-ci même quand elles lui déplaisent Du reste, il ne me revient rien qui me donne lieu de croire que ce bruit soit fondé.
Onze heures et demie
Je serais bien fâché qu’il arrivât malheur à ce pauvre M. de Meyendorff. Il me semble que je le connais. Adieu, Adieu.
Voilà enfin le rapporte détaillé de l'amiral Hamelin. Adieu.
91. Val Richer, Dimanche 11 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1854 (1er janvier-21 décembre) : Dorothée, une princesse russe, persona non grata à Paris
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
91 Val Richer, Dimanche 11 Juin 1854
Si l’on juge par les nouvelles de Grèce, les insurrections intérieures, en Turquie, soit que vous les ayez encouragées ou non, vous seront de peu de secours ; un embarras momen tané pour l'Alliance occidentale, la nécessité de quelques garnisons là et là, mais rien de plus. Les insurrections ne vous vont pas, pas même là. En principe, vous les désavouez, et en fait vous dites tout bas que vous ne voulez point ce qu'elles veulent, l'indépendance et l’aggloméra tion des populations Chrétiennes. On ne dit rien tout bas aujourd’hui, excepté en Russie même partout ailleurs, tout se sait. Je suis sûr que les conversations de votre Empereur, avec Seymour courent la Grèce, la Bulgarie & Je me figure ce qu’on aurait pensé et dit mon ami Colettis, le grand conspirateur contre les Turcs. De quelque côté qu'on envisage cette Affaire, elle est bien mauvaise pour vous. Vous aviez bien raison de vouloir rester tête-à-tête avec les Turcs il devient clair que vous n'êtes puissants contre eux qu'à condition du tête à tête, et que dés que l'Europe s'en mêle votre force d’agression en Orient, force révolutionnaire et force militaire se trouve très insuffisante. Il vous faut absolument deux choses, le tête à tête avec la Porte et l'Europe divisée. L’une et l'autre vous manquent. Vous pouvez croire que la seconde ne vous manquera pas toujours, mais quoiqu’il arrive, la révélation qui se fait en ce moment sur votre compte restera, et vous en souffrirez longtemps. Je ne pense pas que de l’entrevue du Roi de Prusse et de l'Empereur d’Autriche à Teschen, il sorte autre chose que l’attitude actuelle des deux puissances, sauf quelques paroles un peu plus précises sur les développements que cette attitude pourra prendre. Et si vous n'avez pas de grands succès, ces développements, quelle que soit la bonne volonté des Princes, seront de plus en plus contre vous. L'Allemagne ne peut supporter longtemps cette expectative de guerre et de révolution, il faut que de gré ou de force. elle vous fasse faire la paix.
Certainement l'Angleterre est contente de l’Autriche sans cela, Kossuth ne serait pas traité comme il l'est aujourd’hui par le Times, le Morning Chronicle &. Il serait plaisant que la guerre ne détronât que Mazzini et Kossuth.
Midi.
Je n'attendais pas de lettre aujourd’hui. Je suis impatient de vous savoir arrivée et établie. Adieu, Adieu. G.
Si l’on juge par les nouvelles de Grèce, les insurrections intérieures, en Turquie, soit que vous les ayez encouragées ou non, vous seront de peu de secours ; un embarras momen tané pour l'Alliance occidentale, la nécessité de quelques garnisons là et là, mais rien de plus. Les insurrections ne vous vont pas, pas même là. En principe, vous les désavouez, et en fait vous dites tout bas que vous ne voulez point ce qu'elles veulent, l'indépendance et l’aggloméra tion des populations Chrétiennes. On ne dit rien tout bas aujourd’hui, excepté en Russie même partout ailleurs, tout se sait. Je suis sûr que les conversations de votre Empereur, avec Seymour courent la Grèce, la Bulgarie & Je me figure ce qu’on aurait pensé et dit mon ami Colettis, le grand conspirateur contre les Turcs. De quelque côté qu'on envisage cette Affaire, elle est bien mauvaise pour vous. Vous aviez bien raison de vouloir rester tête-à-tête avec les Turcs il devient clair que vous n'êtes puissants contre eux qu'à condition du tête à tête, et que dés que l'Europe s'en mêle votre force d’agression en Orient, force révolutionnaire et force militaire se trouve très insuffisante. Il vous faut absolument deux choses, le tête à tête avec la Porte et l'Europe divisée. L’une et l'autre vous manquent. Vous pouvez croire que la seconde ne vous manquera pas toujours, mais quoiqu’il arrive, la révélation qui se fait en ce moment sur votre compte restera, et vous en souffrirez longtemps. Je ne pense pas que de l’entrevue du Roi de Prusse et de l'Empereur d’Autriche à Teschen, il sorte autre chose que l’attitude actuelle des deux puissances, sauf quelques paroles un peu plus précises sur les développements que cette attitude pourra prendre. Et si vous n'avez pas de grands succès, ces développements, quelle que soit la bonne volonté des Princes, seront de plus en plus contre vous. L'Allemagne ne peut supporter longtemps cette expectative de guerre et de révolution, il faut que de gré ou de force. elle vous fasse faire la paix.
Certainement l'Angleterre est contente de l’Autriche sans cela, Kossuth ne serait pas traité comme il l'est aujourd’hui par le Times, le Morning Chronicle &. Il serait plaisant que la guerre ne détronât que Mazzini et Kossuth.
Midi.
Je n'attendais pas de lettre aujourd’hui. Je suis impatient de vous savoir arrivée et établie. Adieu, Adieu. G.
54. Val Richer, Jeudi 1er Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
54 Val Richer, Jeudi 1er septembre 1853
Merci de vos quelques lignes de Strasbourg. J’espère en avoir quelques unes ce matin de Paris. Vous devez y être arrivée avant hier soir. Vous n'y trouverez pas plus de soleil qu’à Schlangenbad je n’ai jamais vu un plus affreux été. Mais vous vous reposerez chez vous. A mon avis on n'est bien que là où on doit rester. Grand signe de vieillesse.
Je n’aime pas ces petites modifications demandées à Constantinople. J’espère qu’elle sont aussi insignifiantes qu’on le dit. Les reproches du Times à la Porte, m'en font un peu douter. Du reste, j'en reviens toujours à mon dire ; si vous ne désirez pas, en secret, que la question dure, elle finira. Bien des gens à Londres, et à Paris, croient que vous ne voulez pas qu'elle finisse, et que vous comptez sur les objections de la Porte. Si cela est, petites ou non, elles sont graves.
Faites-vous attention aux actes et au langage des agents des Etats-Unis, chez eux et en Europe, le Président Pierce, le ministre Soulé, le chargé d'affaires Brown ? Il y a là du nouveau. Tenez pour certain que le nouveau monde se mêlera bientôt, et bien activement, des affaires de l'ancien, et avec toute l’arrogance et l'hypocrisie démocratiques.
Onze heures
Je suis charmé de vous savoir arrivée et hors des auberges. Merci de deux copies. La vivacité de Constantin m'amuse. La paix ne s'en fera pas moins. Adieu, adieu. G.
Merci de vos quelques lignes de Strasbourg. J’espère en avoir quelques unes ce matin de Paris. Vous devez y être arrivée avant hier soir. Vous n'y trouverez pas plus de soleil qu’à Schlangenbad je n’ai jamais vu un plus affreux été. Mais vous vous reposerez chez vous. A mon avis on n'est bien que là où on doit rester. Grand signe de vieillesse.
Je n’aime pas ces petites modifications demandées à Constantinople. J’espère qu’elle sont aussi insignifiantes qu’on le dit. Les reproches du Times à la Porte, m'en font un peu douter. Du reste, j'en reviens toujours à mon dire ; si vous ne désirez pas, en secret, que la question dure, elle finira. Bien des gens à Londres, et à Paris, croient que vous ne voulez pas qu'elle finisse, et que vous comptez sur les objections de la Porte. Si cela est, petites ou non, elles sont graves.
Faites-vous attention aux actes et au langage des agents des Etats-Unis, chez eux et en Europe, le Président Pierce, le ministre Soulé, le chargé d'affaires Brown ? Il y a là du nouveau. Tenez pour certain que le nouveau monde se mêlera bientôt, et bien activement, des affaires de l'ancien, et avec toute l’arrogance et l'hypocrisie démocratiques.
Onze heures
Je suis charmé de vous savoir arrivée et hors des auberges. Merci de deux copies. La vivacité de Constantin m'amuse. La paix ne s'en fera pas moins. Adieu, adieu. G.
50. Paris , Vendredi 19 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
50 Paris, Vendredi 19 Août 1853
La séance de l'Académie. Française a eu lieu huit jours plutôt que je ne pensais. Je suis arrivé hier matin pour y assister. Je repars demain. Il n’y a absolument personne ici. De mes amis ; Dumon seul.
Je trouve le public très rassuré ; et pourtant il court de mauvais bruits sur les Principautés ; on doute de la prompte évacuation. Je me soucie peu des bruits ; mais je suis frappé du débat du Parlement surtout, du discours de Palmerston. Il n’a jamais été si Turc, jamais si décidé à la guerre pour l'indépendance de la Turquie, jamais si confiant dans les moyens de résistance de la Porte et dans l'efficacité de l'alliance Anglo-française pour la soutenir. Ici, le langage et toutes les démonstrations du gouvernement sont archi pacifiques, et font regarder l'affaire comme terminée. Je sais qu’au ministère de la guerre, on n’a pas douté un moment de la paix et qu’on n’a fait aucun préparatif pour une autre chance. Mais je persiste à croire qu’on aurait accepté et qu’on accepterait volontiers cette autre chance, et que la sympathie est toujours grande pour Palmerston.
Mad. de Hatzfeld est la seule ressource du petit nombre d’âmes politiques en peine qui errent encore à Paris. Elle reçoit les jeudi et lundi. Je passerai à sa porte ce matin. Je ne la trouverai probablement pas. Il fait très beau. Tout le monde se promène. La fête du 15 a été très brillante. Paris était plein d'étrangers. Il se vide. J’ai vu Mad. de Boigne en passant à Trouville. La mort de sa belle-soeur a été pour elle un vrai chagrin, autant qu'elle peut avoir un chagrin. Mad. d'Osmond est morte tout à coup, par une pression du cœur sur les poumons ; elle a été asphyxiée. Sa fille, la Duchesse de Maillé, venait de la quitter ; on a couru après elle, sur le Boulevard. Elle est revenue en courant ; sa mère était morte. Mad. de Boigne attend ces jours-ci à Trouville toute sa famille.
On s'amuse beaucoup à la cour. La Reine Christine y est en grande faveur et fait ce qu’il faut pour être en faveur. On parle du mariage d’une de ses filles avec le Prince Napoléon. On reparle aussi du sacre et du Pape. En attendant l'Impératrice a de grands succès au jeu du ballon, en plein air. Adieu. Ce n’est pas la peine de venir à Paris pour n'y apprendre que cela. Aussi n’y suis-je pas venue pour rien apprendre. Adieu. G.
La séance de l'Académie. Française a eu lieu huit jours plutôt que je ne pensais. Je suis arrivé hier matin pour y assister. Je repars demain. Il n’y a absolument personne ici. De mes amis ; Dumon seul.
Je trouve le public très rassuré ; et pourtant il court de mauvais bruits sur les Principautés ; on doute de la prompte évacuation. Je me soucie peu des bruits ; mais je suis frappé du débat du Parlement surtout, du discours de Palmerston. Il n’a jamais été si Turc, jamais si décidé à la guerre pour l'indépendance de la Turquie, jamais si confiant dans les moyens de résistance de la Porte et dans l'efficacité de l'alliance Anglo-française pour la soutenir. Ici, le langage et toutes les démonstrations du gouvernement sont archi pacifiques, et font regarder l'affaire comme terminée. Je sais qu’au ministère de la guerre, on n’a pas douté un moment de la paix et qu’on n’a fait aucun préparatif pour une autre chance. Mais je persiste à croire qu’on aurait accepté et qu’on accepterait volontiers cette autre chance, et que la sympathie est toujours grande pour Palmerston.
Mad. de Hatzfeld est la seule ressource du petit nombre d’âmes politiques en peine qui errent encore à Paris. Elle reçoit les jeudi et lundi. Je passerai à sa porte ce matin. Je ne la trouverai probablement pas. Il fait très beau. Tout le monde se promène. La fête du 15 a été très brillante. Paris était plein d'étrangers. Il se vide. J’ai vu Mad. de Boigne en passant à Trouville. La mort de sa belle-soeur a été pour elle un vrai chagrin, autant qu'elle peut avoir un chagrin. Mad. d'Osmond est morte tout à coup, par une pression du cœur sur les poumons ; elle a été asphyxiée. Sa fille, la Duchesse de Maillé, venait de la quitter ; on a couru après elle, sur le Boulevard. Elle est revenue en courant ; sa mère était morte. Mad. de Boigne attend ces jours-ci à Trouville toute sa famille.
On s'amuse beaucoup à la cour. La Reine Christine y est en grande faveur et fait ce qu’il faut pour être en faveur. On parle du mariage d’une de ses filles avec le Prince Napoléon. On reparle aussi du sacre et du Pape. En attendant l'Impératrice a de grands succès au jeu du ballon, en plein air. Adieu. Ce n’est pas la peine de venir à Paris pour n'y apprendre que cela. Aussi n’y suis-je pas venue pour rien apprendre. Adieu. G.