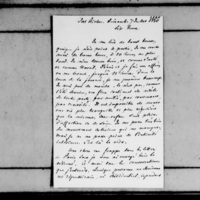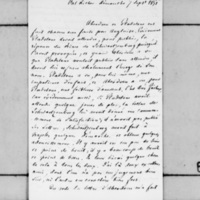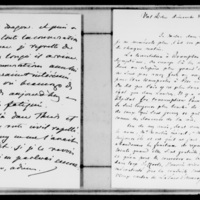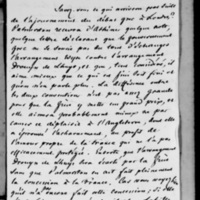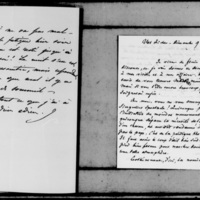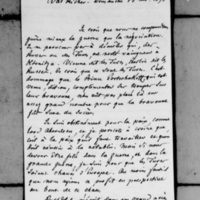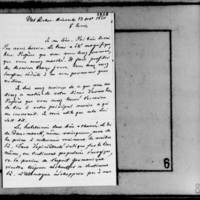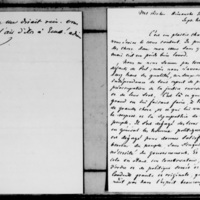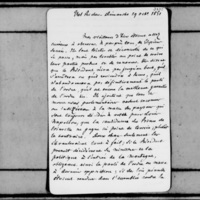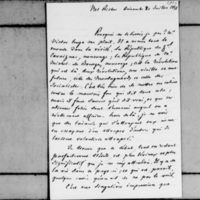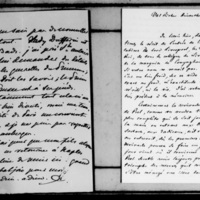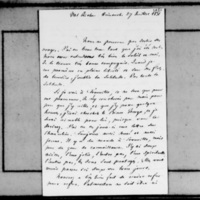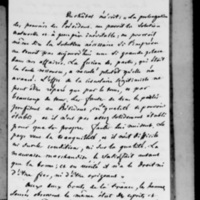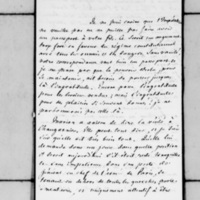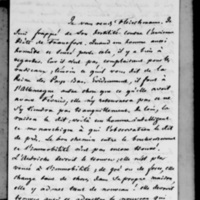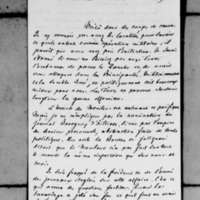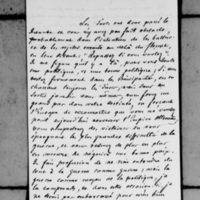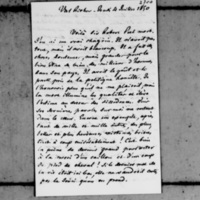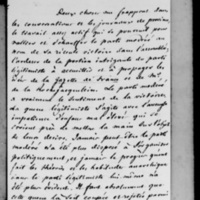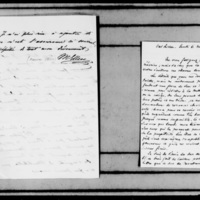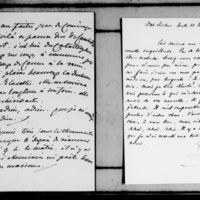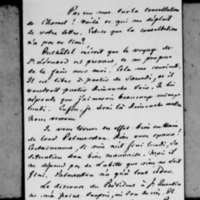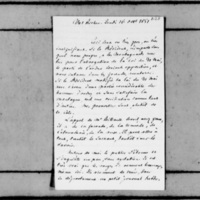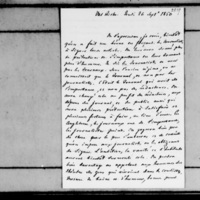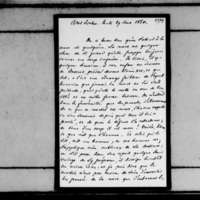Votre recherche dans le corpus : 1140 résultats dans 5493 notices du site.Collection : 1850-1857 : Une nouvelle posture publique établie, académies et salons (La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856)
Val-Richer, Dimanche 7 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Six heures
Je me lève de bonne heure quoique je n'aie point à partir. Je me couche aussi de bonne heure, à 10 heures au plus tard. Je m’en trouve bien et comme santé et comme travail. J'écris et je fais mes affaires en me levant jusqu'à 11 heures. Dans le cours de la journée, je me promène beaucoup. Je vois peu de monde. Ce n'est pas, comme l'été dernier, un flux continu de visites de toutes parts, par amitié, par convenance, par curiosité. Il est impossible de mener une vie plus tranquille et plus régulière que la mienne. Mes enfants sont pleins d'affection et de soin. Je me passe très bien du mouvement extérieur qui me manque. Mais je ne me passe point de l’intimité intérieure. C'est là le vide.
Une chose me frappe dans les lettres de Paris dont je vous ai envoyé hier le résumé, et aussi dans les conversations que j'entends. Quoique personne ne devienne ni républicain, ni présidentiel, cependant la République et le président gagnent. Les légitimistes déplaisent de plus en plus. La monarchie sans les légitimistes paraît de plus en plus impossible. Point d'avenir donc hors de ce qui est; et qui n’a pas d'avenir non plus, mais qui est et que personne n'entreprend sérieusement de renverser n'étant pas sûr de le renverser à son profit. C’est un arbre qui ne grandit pas, qui ne s'enracine pas, qui ne pousse ni sur terre ni sous terre, mais qui reste debout. A quel point la nécessité, et l'habitude sont-elles suffisantes pour fonder un gouvernement ; voilà la question qui est en train de se résoudre. Je ne crois pas qu'elles soient suffisantes pour fonder, mais elles le sont, à coup sûr, pour faire durer longtemps. J’ai écrit cela hier à S Léonard avec détail, à la Reine. Mes nouvelles du Roi continuent d’être bonnes.
10 heures
Pas de lettre aujourd'hui. Cela ne m'étonne pas. Vous serez arrivée avant hier à Ems trop tard pour la poste. Je vois dans les journaux une crue subite du Rhin qui me déplaît. Vous avez dû aller de Cologne à Ems par le Rhin. J'espère que vous n'aurez eu ni sujet, ni seulement prétexte d'avoir peur. II ne me vient rien du tout de Paris ce matin. Je trouve que le ministère à l’air bien étourdi et bien impuissant. La loi sur la presse que tout le monde repousse, sa loi sur les maires qu’il voudrait et n'ose remettre à flot. Il semble que les esprits soient à bout comme les forces, et qu’on ne sache plus rien inventer qu'on puisse mener à bien. Adieu, Adieu. Vous me direz comment vous êtes établie à Ems. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 7 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Aberdeen et Gladstone ont fait chacun une faute peu anglaise. Evidemment Gladstone devait attendre pour publier, la réponse du Prince de Schwartzemberg puisqu'il l’avait provoquée ; et quand Aberdeen a vu que Gladstone voulait publier sans attendre, il devait lui refuser absolument l’usage de son nom. Gladstone a eu, pour lui-même, une impatience d'enfant, et Aberdeen a eu pour Gladstone une faiblesse d’amant. C’est très fâcheux, car évidemment aussi, si Gladstone avait attendu quelques jours de plus, la lettre de Schwartzemberg lui aurait donné, un commencement de satisfaction ; il n'aurait pas publié ses lettres ; Schwartzemberg aurait fait à Naples quelque démarche et obtenu quelques adoucissements. Il y aurait eu un peu de bien et point de bruit ; il y a beaucoup de bruit et point de bien. Je leur dirai quelque chose de cela à tous les deux. J’ai là deux excellents amis dont l’un n'a pas un jugement bien sûr, ni l’autre un caractère bien fort. Du reste la lettre d'Aberdeen m’a fait plaisir en ce sens qu'elle m'a prouvé qu’il avait sérieusement agi pour empêcher la publication, et que le Prince de Schwartzenberg l'avait sérieusement écouté. C'est bien dommage que la chose ait mal tourné ; Aberdeen y perdra de son crédit à Vienne et Schwarzenberg de sa bonne disposition.
Vous avez certainement répondu à Beauvale que le récit du Times était vrai. Il y a bien des méprises et des omissions ; mais peu importe l'effet est produit. Et à en juger par l'effet produit à Paris et sur les journaux, je ne serais pas étonné qu'à Claremont, il y eût aussi quelque effet par réaction, et que nous vissions faire là un mouvement de retraite analogue à celui des Débats. Celui-ci est excellent ; je connais les personnes ; elles hésiteront et tarderont beaucoup à se rengager si même elles se rengagent, ce dont je doute. Je craignais qu’il n’y ait là plus de parti pris d'Orléaniste, et plus de pique de journaliste. Pourvu que le Constitutionnel et autres ne les taquinent pas trop sur leur retraite. Beauvale est plus puritain que je ne croyais. C'eût été, de la part du Roi Louis Philippe, une vertue sublime de ne pas se tenir en mesure de profiter des fautes prévoyables de la branche aînée, et d'en accepter au contraire la solidarité, ainsi que celle de ses destinées. Car il n’y avait pas de milieu pour lui ; il fallait ou se distinguer nettement afin de pouvoir rester en France après les ordonnances de Juillet, ou se confondre absolument avec Charles X et émigrer de nouveau avec lui. L’alternative était dure ; et des Anglais qui trouvent très bon que Guillaume 3 se soit tenu si à part du Roi Jacques son beau-père et ait fini par le chasser lui-même n'ont pas le droit d'être si exigeants envers le roi Louis-Philippe. Ceci soit dit sans rien retrancher de ce que je pense et viens de dire à Claremont sur la conduite actuelle.
Je remercie Marion, après vous des deux copies. J'ai aussi de loin mes petits profits dans son séjour auprès de vous. Le langage de Changarnier à la Commission de permanence sur les réfugiés de Londres et le gouvernement anglais m'a frappé. Ce n'était pas à lui à mettre des bâtons, dans ces roues là, que les bâtons soient légitimes au non. [...]
Val-Richer, Dimanche 8 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre dans nos habitudes ; je ne numérote plus. C’est un petit travail de chaque matin.
La translation à Brompton est un triste symptôme. On envoie là les [?] dont on n'espère plus grand chose, et qui ne sont pas assez forts ou assez riches pour être transportés à Pise où à Madère. On dit que l’air y est plus doux, et plus égal que dans Londres. Il y a un bal hôpital for consumption.
Pauvre Fanny ! Je suis toujours plus touché de la mort de ceux qui sont jeunes, et qui n’ont pas connu les douceurs de la vie.
Un de mes amis dont vous connaissez le nom, M. Moulin m'écrit : " Mon avis a toujours été et est qu’il ne faut pas abandonner les fonctions de représentation locale quand elles sont gratuites, électives et qu’on peut les conserver ou les obtenir sans trop d'effort."
J'aurais vivement mécontenté par la conduite contraire mon vieux canton de La Tour d'Auvergne que je retrouve fidèle à toutes mes fortunes aujourd’hui comme après 1848, et qui va probablement me réduire à la presque unanimité. J’ai compris d'abord les instructions de Venise comme moyen de modérer l'ardeur du parti légitimiste à se porter vers les fonctions publiques dont il a été si longtemps privé, mais je ne m'explique pas l’insistance avec laquelle, on vient de les reproduire à la veille des élections des conseils généraux. En Auvergne, elles n'ont reçu, elles ne reçoivent aucune exécution ; pas un légitimiste ne s’est retiré ; tous les légitimistes de nos conseils électifs vont y rentrer. Comme nous ne sommes pas un pays de grande propriété, le parti ne peut avoir influencé que par le patronage des intérêts locaux ; il perd toute autorité, toute importance s'il se retire sous sa tente, et sa retraite inspire plus de sarcasmes que de regrets.
Je suis bien aise que Cromwell vous amuse. Je vous en envoie sous bande un exemplaire. Cela a été inséré dans la Revue contemporaine, et ne se vend point séparément. On m'écrit que cela fait quelque bruit à Paris, et j'en juge par la fureur avec laquelle Emile Girardin l’attaque dans la Presse. Les amis du Président, ont tort de s'en fâcher. Cela n'a été écrit, ni pour lui, ni contre lui. J’ai pensé à son oncle en l'écrivant, à lui pas du tout. Il est vrai que l'allusion subsiste à la seconde génération, et que la conclusion est que Cromwell fit bien de ne pas se faire Roi. Si j'étais l’un des conseillers du Président, je lui conseillerais de faire comme Cromwell, qui mourut dans son lit, à Whitehall tranquille, et puissant. Mon conseil déplairait probablement, ce qui n'empêcherait pas qu’il ne fût bon.
Adieu. Je passe mon temps à me promener et à causer avec mes Anglais qui ont l’air de se plaire ici. Ils me quittent, le 15, et je pars le même jour pour aller près de Caen marier M. de Blagny. Je rentrerai chez moi le 13 pour n'en plus bouger. Adieu, adieu.
J’espère que la lettre de ce matin me dira que vous avez marché.
11 heures
Malgré votre lettre, j'adresse encore à Dieppe, Pour vous, je crois que vous serez mieux à Paris d’autant que les chaleurs de l'été me semblent passées. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 9 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Savez-vous ce qui arrivera par suite de l'ajournement du débat grec à Londres ? Palmerston recevra d'Athènes quelque note, quelque lettre déclarant que le gouvernement grec ne se soucie pas du tout d'échanger l’arrangement Wyse contre l’arrangement Drouyn de Lhuys, et que, tout considéré, il aime mieux que ce qui est fini soit fini et qu'on n’en parle plus. La différence entre les deux conventions n'est pas assez grande pour que la Grèce y mette un grand prix, et elle aimera probablement mieux ne pas causer ce déplaisir à l'Angleterre dont elle a éprouvé l'acharnement, au profit de l'amour propre de la France qui ne l'a pas efficacement protégé. En sorte que l’arrangement Drouyn de Lhuys sera écarté par la grève sans que Palmerston en ait fait pleinement la concession à la France. Car vous voyez bien qu’il n’a pas encore fait cette concession ; si elle était faite, on ne négocierait plus. Lahitte n’a demandé et ne peut demander que cela. S'il l’avait obtenu, il se serait déjà déclaré satisfait et lord Lansdowne n'aurait pas éludé la discussion. Palmerston discute, marchande. A Paris, il a l’air pressé, mais il ne cède pas davantage. A Londres, il demande du temps, et on lui en donne. Athènes le tirera d’embarras en repoussant cet échange entre les deux conventions qui devient plus insignifiant et plus impraticable à mesure que le temps s’écoule. Et à la fin comme au commencement de l'affaire, par ruse, comme par force, Lord Palmerston aura fait sa volonté. Que dira alors Lord Stanley ? Les honnêtes gens sont obligés d'avoir plus d’esprit et d'être plus fermes que les brouillons. Avoir raison ne les en dispense pas.
Le général Trézel revient de S Léonard et m'écrit : " J’ai trouvé le Roi, fort maigri, fort affaibli, confiné dans sa chambre et fatigué de surcroît par un troisième rhume. Il a consacré plus de force et de vie que cet état n’en devrait faire espérer ; la parole est toujours nette et facile ; l’esprit aussi prompt, aussi lucide que de coutume d'ailleurs quelques symptômes favorables se manisfestaient depuis plusieurs jours dans les fonctions de l'estomac, et donnaient l’espoir que ce dépérissement graduel pourrait s'arrêter. J’ose à peine me livrer à cet espoir. La reine des Belges est fort affaiblie aussi par une fièvre lente assez inquiétante. » Absolument rien de nouveau sur la grande question. Je savais bien qu’on ne dirait rien de plus à Trézel. Toujours le langage de la politique d’attente et d'abstention. Il a paru au général que dans le cas où la famille royale perdrait son chef, le duc et la Duchesse de Nemours seraient assez disposés à prolonger leur séjour en Angleterre, à cause de leurs très bons rapports avec la Reine Victoria, mais que la Reine et ses autres enfants quitteraient bientôt un pays qui ne leur plaît pas.
Vous avez bien raison de consulter Chomel avant de partir. Je vous ai dit qu’Aix la Chapelle m'étonnait. Je ne vous crois point la poitrine malade ; mais c’est un climat rude, et le froid ou l’humidité par dessus l’ennui, c’est trop pour vous.
10 heures
Je suis charmé que Montebello parte. Je me déciderai d'après ce qu’il m’écrira. Je n’ai pas encore la réponse définitive du Duc de Broglie. Je ne me préoccupe guère des trois millions. On les votera. Ou bien on marchandera et on finira par s’arranger. Adieu, Adieu. Je vais déjeuner à Lisieux. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 9 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de finir mon discours, et je vais donner ces deux jours à mes visites et à mes affaires. Que j’ai envie de vous trouver mercredi moins fatiguée ! Mais si vous l'êtes encore beaucoup je vous soignerai enfin. Au moins vous ne vous ennuyez pas.
Singulier spectacle. Quiconque prend l’initiative du moindre mouvement inutile, quiconque dépasse la nécessité de l'épaisseur d’un cheveu est aussitôt condamné et délaissé par le pays. C’est de la politique thermométrique. Il faut avoir le coup d’oeil bien sûr et le pied bien ferme pour marcher droit dans une telle atmosphère. Certainement d’ici la nomination de Vitet et la proposition des questeurs me paraissent deux fautes graves et si j’avais été là, je les aurais déconseillées. Je verrai ce qu’on me dira pour les justifier. Je suis du reste, bien décidé à n'en croire moi-même plutôt que ce qu’on me dira. Ecouter tous les avis et agir toujours selon son propre avis, c’est la bonne règle quand on a du bon sens C'est facile quand on n'est que donneur d'avis, et point acteur. Je ne puis croire que la majorité se laisse mener longtemps par Thiers, et Changarnier ; elle reconnaîtra bientôt qu’ils la mènerait perdre. Les montagnards ont voté pour Vitet évidemment pour brouiller la majorité. Je ne crois pas du tout à M. de Hackereen.
Thiers a-t-il, ou n'a-t-il pas été au service de la Madeleine pour la Dauphine. Je puis encore vous faire une question. Mais mardi, Marion n'aura plus à vous remplacer. pour m'écrire.
4 heures
Je suis charmé que vous recommenciez à manger pourvu que vous digériez. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 13 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je crois que nous ne comprendrons guère mieux la guerre que la négociation. Je ne parviens pas à démêler qui, des Russes ou des Turcs est resté vainqueur à Oltenita. Vienne dit les Turcs, Berlin dit les Russes. Je crois que ce sont les Turcs. C’est dommage que le Prince Gortschakoff, qui est venu, dit-on, complimenter ses troupes sur leur bravoure, n'en eût pas placé là un assez grand nombre pour que la bravoure fût sûre du succès.
Je suis obstinément pour la paix, comme Lord Aberdeen, et je persiste à croire que c’est à la paix qu’il faut travailler, et qu’on doit réussir à la rétablir. Mais si nous devons être jetés dans la guerre, et dans la grande guerre, je suis pour que les Turcs soient chassés d’Europe. Au moins faut-il que nous avons ce profit en perspective au bout de ce chaos.
Duchâtel m’écrit dans un grand accès d'indignation contre la façon dont " cette misérable affaire a été conduite ; il n’y a pas deux jugements à rendre." Il est du reste plus préoccupé du dedans que du dehors : " L’hiver, dit-il, sera difficile à passer ; il n’arrive que peu de grains étrangers ; le commerce prétend manquer de la sécurité nécessaire. Les denrées autres que le blé, ont manqué comme le blé et même quelques unes dans une plus forte proportion. Le vin est arrivé à un prix que l'ouvrier ne peut pas payer. Il y a un sujet grave d’inquiétude. Les dispositions du peuple, même dans nos campagnes ordinairement si tranquilles, prennent un caractère menaçant ; le socialisme chemine sous terre sans qu’on s'en aperçoive. Il ne suffit pas, pour le détruire, de la comprimer d’une main en l'encourageant de l'autre ; la force est nécessaire contre les idées mauvaises, mais à elle seule, elle est insuffisante ; il y faut le concours énergique des idées vraies, fortement soutenues. "
Il a raison. Il ne reviendra à Paris qu'à la fin de l’année.
Je ne trouve rien à redire à votre manifeste. Il ne dit que l'indispensable, y compris, la phrase sur la foi orthodoxe. Les catholiques ardents ne peuvent pas vous pardonner ce mot orthodoxe. C'est pour cette raison qu’ils aiment mieux les Turcs qui n’ont pas la prétention de l'orthodoxie. Il me semble que la circulaire de M. de Nesselrode en dit plus que le manifeste, et qu’elle laisse entrevoir la chance d’une guerre offensive de votre part, bien au delà du Danube. En général, les commentaires par circulaires ne vous ont pas réussi.
Onze heures
Je reçois à la fois plusieurs lettres. La situation me paraît grossir et gronder. Que c’est absurde ! Mais ce n'en est que plus grave. Adieu, adieu.
Voici la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Je vous écrirai encore deux mots mardi. G.
Val-Richer, Dimanche 13 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je me lève. J'ai bien dormi. J'en avais besoin. Le temps a été magnifique hier. J'espère que vous vous serez promenée, que vous aurez marché. Il faut profiter des derniers beaux jours. Vous serez assez longtemps réduite à ne vous promener qu'en voiture. Je suis assez curieux de ce que vous me direz ce matin de votre dîner d'avant-hier. J'espère que vous aurez trouvé l'occasion de dire à votre principal convive ce qui me concernait. Je crois utile que cela lui soit dit.
Les Holsteinois sont bien acharnés. Le roi de Danemark même vainqueur aura de la peine à redevenir vraiment le maître là. Tant d'opiniâtreté indique sur le lieu même, un sentiment populaire énergique et la passion de l’esprit germanique viendra toujours réchauffer ce sentiment là. L'Allemagne n'échappera pas à une grande transformation. Je ne sais laquelle ni comment ni au profit de qui ; mais l'Allemagne ne restera pas comme elle est. Je ne vois en Europe que l’Angleterre et la Russie qui aient chance de rester longtemps comme elles sont.
Midi
Pauvre Reine ! A moi, comme à vous, ce sont les seuls mots qui viennent. Avez-vous remarqué son petit dialogue avec le curé d'Ostende à l'entrée et à la sortie de l’église ? " Priez beaucoup pour mon enfant. " Je ne connais rien de plus touchant que ces simples mots.
Merci de vos détails, très intéressants sur votre dîner. Si vous trouvez quelque occasion naturelle de dire ce que je vous rappelais tout-à-l'heure, soyez assez bonne pour la saisir. Le petit article des Débats sur la séance de la commission permanente me frappe un peu. C’est certainement Dupin qui l’a dicté. Il prouve que si la commission ne veut pas pousser les choses à bout; elle veut les avoir prises au sérieux. Il faut que le Général d'Hautpoul soit congédié avant l’ouverture de l'Assemblée.
Je suis fort aise que Marion ait pris son parti. Faites lui en, je vous prie, mon compli ment en lui disant combien je regrette de ne l'avoir pas vue. Je lui aurais conseillé ce qu’elle fait. J’ajoute seulement que s'il est bien convenu qu’elle restera à Paris avec sa soeur Fanny, il faut qu’elle y reste en effet quand ses parents partiront. Si elle retourne en Angleterre avec eux, elle ne reviendra pas. Adieu, Adieu. G.
Le Duc de Broglie ira certainement à Claremont car la Reine et la famille Royale y retourneront, je pense, aussitôt après les obsèques. Je crois que j'irai à Broglie lundi 21, pour 48 heures. Adieu, encore.
Mots-clés : Deuil, Europe, Famille royale (France), Femme (maternité), Femme (politique), Femme (statut social), Politique (Allemagne), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Posture politique, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (François)
Val-Richer, Dimanche 14 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
C’est un plaisir charmant de vous écrire le cœur content. Je puis enfouir bien des choses dans mon cœur sans qu’il y paraisse mais c'est un poids bien lourd.
Nous ne nous sommes pas trompés sur les défauts de Peel ; mais nous n'avons pas prisé assez haut ses qualités, ces deux-ci surtout, son indépendance de tout esprit de parti, et sa préoccupation de la justice envers le masses et de leur sort. C'est là ce que l’a fait grand en lui faisant faire à tout risque, de grandes choses, et ce qui lui vaut aujourd’hui le respect et la sympathie de tout un peuple. Il s'est dégagé des liens qui enchaînent en général les hommes politiques, et il s’en est dégagé pour donner satisfaction aux besoins du peuple, sans s'inquiéter des nécessité du gouvernement. Et il a fait cela en étant un conservateur, un homme d’ordre et de politique sensée et régulière Conduite grande et originale, quoi qu’il n’eût pas dans l’esprit beaucoup d'originalité ni de grandeur.
10 heures
Votre lettre du 9 m’a interrompu. Je ne m’en plains pas. J’ai beaucoup à vous dire encore sur Peel. J'y reviendrai. Je reçois une longue lettre de Lord Aberdeen revenant de Drayton. « It was a sad ceremony ; and to witness the change in that happy résidence, in which I had experienced so much friendship, and had seen so much wisdom, prudence, and integrity of character, required more philosophy than I possessed. " Des détails sur le sentiment public envers Peel. Puis ceci : " His last speech was most important. It was made reluctanly and he greatly dreaded the defeat of tre Govern. ment. From his previous silence, had it not been delivered, the government could have maintained and the public would have believed that he approved of their foreign, as well as of their domestic policy. His manifest reluctance and the moderation of hir manner rendered his censure most effective. " Discussion toujours profonde, quoiqu'avec moins d’aigreur, dans le parti conservateur ; pas de conciliation sur les questions de free trade. Conclusion : " Radicalism is here in the ascendant ; but I am inclined to think that there will be more prudence than we have lately witnessed, abroad. "
Autre lettre intéressante de Mistriss Austin " Lord John's speech was far worse than Lord Palmerston's, and calcutated to do great mischief. Every body speaks of Lord Palmerston's as the most wonderful effort of oratory, considering his age, the heat, and all there was to [?] his difficulties. During five hours, he never faultered, never recalled a word never drank a drop of water, and left off with the very same intonation of voice as he began with. How lamentable that such powers are se employed ! People seem to think that in spite of the " triumph " of tne government, the system of foreign policy has received a severe and salutary, check and that even he will not risk another such struggle. If there were any bounds to human credulity, one might be amazed at hearing sensible men (as I did) talk of " all this being the result of a conspiracy. " I asked in vain what means you, and M. de Metternich, and Princess Lieven, possessed of influencing the mind and opinion of the English - for I maintain that the public was against the government. Nobody can answer. Yet they continue to assert it. We are very much ashamed of the vulgar blustering tone of the speacher en that side." Elle est liée avec Cobden, Sir W. Molesworth, tous ces chefs radicaux qui ont parlé et voté contre Lord Palmerston, malgré leur peuple. Voilà l'Angleterre. Demain, je vous enverrai de la France.
J’ai, ce matin, de Paris, de bonnes nouvelles de vous, par Kisseleff. Votre fils Alexandre était arrivé. Adieu, Adieu, Adieu. Vos lettres arrivent affranchies. G.
Val-Richer, Dimanche 14 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.
Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.
Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance
Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.
11 heures
Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 15 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis frappé de ce que vous me dîtes de l’intimité de Changarnier et de Lamoricière. Cela coïncide avec ce qui m'est revenu d'ailleurs, ces jours-ci. Lamoricière dans des conversations intimes, s’est déclaré inconciliable, absolument inconciliable avec les rouges et l'Empire, ou toute combinaison bonapartiste analogue à l'Empire ; du reste prêt à accepter toute autre solution, l'une ou l'autre des deux branches, n'importe laquelle, ou mieux encore toutes deux ensemble ceci dans l’hypothèse où la république régulière ne pourrait pas durer, ce qu’il ne regarde point comme sûr, mais comme très possible. Je vous donne ces ouï dire pour ce qu'ils valent ; ils viennent de bon lieu. Ils peuvent être vrais aujourd’hui et point demain ; Lamoricière est si mobile ?
Les nouvelles de Bruxelles m'affligent beaucoup. La Reine, toute cette famille royale quittant le cercueil du Roi et traversant la mer pour venir s'asseoir auprès du lit de mort de leur fille, de leur sœur ! Quelle épreuve ! quel spectacle ! Les douleurs s’appellent et s'attirent. Je ne sais rien que par les journaux ; mais j’ai le cœur serré à l'idée de ce deuil sur deuil pour la Reine dont la personne, et le cœur, semblaient ne laisser plus de place à un deuil nouveau. Je voulais écrire ces jours-ci à la Reine et à M. le Duc de Nemours. Je n'ose pas. J’attends.
J'espère que vous me donnerez aujourd’hui d'un peu meilleures nouvelles de votre rhume. Décidément enrhumée ou non, et encore plus enrhumée, je vous aime mieux à Paris qu'ailleurs. Vous y avez à la fois plus de repos et plus de mouvement. Je compare ce que vous voyez là, avec votre solitude de Schlangenbad. Et pour avoir cela vous n'avez d'autre peine à prendre que de ne pas sortir de chez vous.
Je suis curieux de ce que vous me direz sur M. de Meyendorff. La nouvelle de Berlin est répétée dans tous les journaux. Je ne puis croire à cette retraite, et encore moins au motif. Mad. Swebach (est-ce bien son nom ? ) doit savoir le vrai. Midi Je regrette de n'avoir pas vu l'article du Times, sur Salvandy. Je suis frappé de la réserve des journaux de toute opinion sur ce sujet. Ils sentent tous que c’est sérieux, et ne veulent ni s’engager ni se compromettre. Je vois ce matin un article du Siècle qui pose, entre la Monarchie et la République, je ne sais combien de questions pleines d'embarras et qui admettent les réponses contraires.
Je suis bien aise d'avoir valu à Constantin les remerciements qu’il a reçus. Vous savez que je lui ai trouvé, sous sa tranquillité modeste et un peu stérile, l’esprit plus ouvert et plus sérieux que je ne supposais. Adieu, adieu. Vous aurez reçu ce matin une réponse sur Fleischmann. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 17 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.
Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.
J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !
11 heures
Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 19 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes visiteurs d'hier étaient assez curieux à observer. A peu près tous des Elyséens sensés. Il sont tristes et déconcertés de ce qui se passe, mais pas troublés au point de croire leur partie perdue, et de renoncer. Ils disent que le Président n'ira pas jusqu'au bout, qu’il s’arrêtera ou qu’il reviendra à temps, qu'il n'abandonnera pas définitivement le parti de l’ordre, qu'il est encore la meilleure garantie de l’ordre, &. Ils ajoutent que tous des mouvements parlementaires restent inconnus ou indifférents à la masse des paysans qui sont toujours décidés à voter pour Louis Napoléon que la candidature du Prince de Joinville ne gagne ici point de terrain, plutôt le contraire, deux choses seulement les ébranleraient tout-à-fait ; si le président. prenait décidément ses ministres et la politique à l'entrée de la Montagne, obligeant ainsi le parti de l’ordre en masse à devenir opposition ; si des lois pénales étaient rendues dans l'Assemblée contre la réélection du Président. Ceci pénétrerait jusqu'aux paysans et arrêterait beaucoup de votes. Dans cette hypothèse, à laquelle ils ne croient pas, quelques uns vont au Prince de Joinville. D'autres, les plus intelligents pensent à Changamier, beaucoup disent que le Président des rouges l'emporterait et ont peur.
Sur la loi du 31 mai, à peu près tous désirent les modifications dont il était question avant la crise et blâment beaucoup le Président de ne s'en être pas contenté. Voilà mes observations. Décidément ce pays-ci est sensé. Si toute la France, lui ressemblait, il n’y aurait pas grand chose à craindre. On dit cependant que le département de La Manche se gâte un peu. Toujours, dans la masse des paysans même méfiance et même antipathie envers les légitimistes.
Je regrette que Kisseleff n'ait pas dîné à St. Cloud avec les dames Russes. Il est bon observateur. Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point le Président est confiant ou troublé.
Pendant que nous remettons ici tout en question, l'Europe est tranquille et se reconstitue. Je suis frappé du contraste. Quand l’Assemblée sera réunie, on devrait bien faire ressortir ce fait pour faire sentir à la France sa jolie et poser sur les honnêtes gens. Si le Président. changeait réellement de politique, l’armée Française quitterait Rome, et ce serait un petit ébranlement. Mais l’Autrichienne y entrevoit tout de suite. Je ne crois pas aux Italiens. Pourtant il y a encore là des volcans et des tremblements de terre.
A propos d'Italiens, avez-vous été à leur rentrée ? Je n'ai pas regardé dans les journaux si elle avait été brillante. Cela ne vous fera-t-il pas coucher trop tard le samedi, veille du Dimanche ?
Onze heures
Mes impressions d’ici ne sont pas en désaccord avec ce que dit M. Fould de la confiance du Président. Quand l'Assemblée sera là, ce sera autre chose. On a beau en mal parler. Sa présence réelle agit et sur le public, et sur le président lui-même. Nous verrons. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 20 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourquoi ne le dirais-je pas ? M. Victor Hugo me plaît. Il a remis tout le monde dans la vérité. La République du Gal Cavaignac, mensonge ; la République de M. Michel de Bourge, mensonge ; c’est la révolution qui est là, deux révolutions, une vieille et une future, celle des Montagnards et celle des Socialistes. C'est très bien de se mettre en colère contre le mauvais fou qui dit tout cela ; mais il faut savoir qu’il dit vrai, et que ces odieuses folies sont l'ennemi auquel on a réellement affaire. Hors de là, je ne vois que des badauds qui s’attrapent eux-mêmes en essayant d'en attraper d'autres qui se laissent volontiers attraper. Je trouve que ce débat, tout en restant parfaitement stérile est plus sérieux et plus significatif que je ne m’y attendais. Il y a de la vie dans ce pays-ci ; ce qui est, paraît, quelque envie qu'on ait de ne pas le voir. C'est une singulière impression que de recevoir l’écho de ce bruit dans le silence de ma solitude.
Mon gendre Conrad m’arrive demain pour passer ici quatre jours. Ils ne veulent pas me laisser plus longtemps seul. Pauline qui est à merveille ainsi que son enfant, vient s'établir avec son mari samedi prochain 26. Henriette est obligée de rester encore trois ou quatre semaines à Paris ; sa fille va mieux et on espère qu’elle ira décidément bien ; mais il n'y a pas moyen de la séparer en ce moment de son médecin. Le Val Richer aura revu un moine pendant huit jours. Vous savez que moine veut dire solitaire.
Je suis bien aise de ce que vous dit Lady Allice sur le ballot. Je ne me fie pourtant pas beaucoup à ces indifférences superbes des Ministres. Je compte plus sûr le bon sens anglais que sur la fermeté de Lord John. Croker, dans sa dernière lettre caractérise le genre et le degré d'habileté des Whigs, et le mal qu'ils laissent faire grâce à celui qu'ils ont l’air d'empêcher, avec beaucoup de vérité et de finesse. Je suis frappé de ce que vous me dites que la réaction va trop vite à Berlin. C'est mon impression aussi, sans bien savoir. Et j'ai peur que cette réaction, qui va si vite, ne soit, au fond, pas plus courageuse qu'habile. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article Alexandre Thomas dans les Débats à ce sujet ? Il était plus précis et plus topique que ne l'est ordinairement cette signature.
Je trouve le Constitutionnel bien faible depuis quelque temps. Rabâcheur, sans confiance en lui-même. Est-ce que le Président serait déjà un vieux gouvernement ? Le plus grand des défauts dans ce pays-ci.
Onze heures
Le facteur ne m’apporte pas grand'chose. Petit effet de Dufaure. Pas plus grand de Barrot, M. Moulin m'écrit pendant que Barrot parle. Le discours de Berryer reste entier, et jusqu'ici seul, du bon côté du moins. Mon gendre Cornélis m’écrit : " Ce discours a fait dans Paris une grande sensation, plus grande qu'on ne pouvait l'espérer. Tout le monde en parle, et ce qui est singulier, tout le monde l'a lu. Les journaux anti légitimistes y ont beaucoup contribué ; ils ont cherché à entourer la fusion sous les couronnes décernées à M. Berryer, et pour éviter d'apprecier l'acte politique, ils ont adressé à l'orateur des louanges excessives, en affectant de ne voir là qu’un beau discours. Mais le public n'est pas de leur avis " Adieu. Adieu. Je suis charmé qu’il vous arrive du renfort. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 20 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de lire, dans Peel and his times, toute l'histoire du Reform- bill. Certainement il eût été possible de faire un Reform-bill plus conservateur, et qui n’entrainât pas dans le pays un si grand déplacement des influences, dans le Parlement un si complet changement des partis et des hommes en pouvoir. Il a manqué à Peel dans cette occasion, le courage qu’il a eu, envers son propre parti, dans l'affaire des Corn-laws il a manqué à Lord Grey le courage de s'entendre avec Peel au lieu de se livrer à l'emportement de la réforme. J’ai tort de dire de s'y livrer ; on a excité cet emportement ; on a porté de l’eau, non pas à la rivière, mais au torrent ; il y a eu visiblement, dans le mouvement populaire de cette époque, quelque chose de factice ne croyez-vous pas ? Et croyez-vous qu’il eût été possible à Lord Grey de se concerter avec Peel pour une réforme plus modérée ? Vous me répondrez probablement. Pas plus qu'il ne m'eût été possible à moi, avant Février de m'entendre avec Tiers sur la question de réforme. Les antécédents des hommes, des chefs sont des chaînes qu'ils ne brisent plus. Il n’y a que les soldats qui puissent changer de drapeau. Peel n'en a réellement pas changé en 1846. Il a fait alors ce qu’il avait fait toute sa vie. La consistency dans l’inconsistency, c'était son caractère et son système. Il ne savait résister invinciblement qu’au parti de qui il ne craignait rien. Vous voyez bien que je n'ai rien à vous dire du présent.
Onze heures
Je pardonne volontiers au Constitutionnel sa morale au général Changarnier. Il faut bien se donner une petite satisfaction quand on fait un sacrifice, et Changarnier a plus d’esprit qu’il n'en faut pour accepter sans humeur le sermon, d'ailleurs sensé, et poli que lui adresse M. Véron. Vous savez que j'ai toujours crue à cette fin. Mais je suis bien aise de la voir officiellement annoncée. Je compte avoir également raison en Allemagne. Et j'incline à croire que ce sera Ladowitz lui-même qui me donnera raison.
Je reçois une lettre de Van Praet à qui j’avais envoyé ma lettre au Roi Léopold. Il m’annonce une réponse du Roi et s'étend beaucoup sur la sympathie de la Belgique pour une Reine venue de France. Il me paraît clair qu'on recueille avec soin dans le Palais, toutes les raisons de se rassurer, et tous les points d’appui. Adieu.
Je vous écrirai un mot demain avant de partir pour Broglie. Je pars d'assez bonne heure parce que je m’arrête pour déjeuner à Lisieux. Il est bien convenu que lundi, mardi et mercredi, vous m'écrirez à Broglie. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous dites que votre cure finit le 5 août. Je ne croyais pas que ce fût si tôt. C’était en août et plutôt vers le milieu que dans les premiers jours que je me promettais d’aller vous voir. J’ai besoin d’être ici le 6 août, pour affaires, affaires de la localité et affaires à moi qui doivent réunir quelques personnes. J’attends deux ou trois visites d’ici à la fin de Juillet. J’aimerais donc mieux la dernière quinzaine d’août que la première. Voici quel était mon désir et mon plan. Guillaume aura, je l'espère, des prix au grand concours de l'université, le 17 août. Je n’ai jamais manqué d'aller le voir couronner. Je n’y voudrais pas manquer à présent qu’il est grand et que mons influence sur lui est de plus en plus nécessaire. J’irais à Paris le 12 août, et j'en repartirais, le 13 au soir pour aller vous trouver, en passant par Bruxelles, là où vous seriez sur les bords du Rhin, Ems, Bade, ou ailleurs.
Je serai charmé de voir Aberdeen, mais je doute qu’il vienne et en tous cas, ce n’est pas lui que je vais chercher. Quel ennui que cette distance qui empêche de rien concerter. Je n'aurai réponse à ceci que dans six jours. Je vais tâcher de m’arranger pour ne pas l'attendre et pour aller vous voir à Ems dans les derniers jours de Juillet de les premiers d'août toujours obligé d'être ici de retour le 6, au moment où vous quitterez Ems. Je voudrais bien savoir où vous serez après. Je comprends que vous n'ayez nulle envie de passer le mois d'août à Paris. Il n’y aura personne; pas un de vos amis Français, et bien peu du corps diplomatique. La dispersion sera encore plus grande cette année que de coutume. Tout le monde est excédé.
Va-t-on de Paris à Ems en deux jours quand on ne s'arrête pas? Je suppose qu'on n’arrive à Ems que le troisième jour. Je vais faire demander cela à Paris. Les jeunes Broglie et les d’Harcourt sont venus hier de Trouville, passer la journée ici. Ils sont aimables et en train. J’ai une lettre de Madame de Ste-Aulaire qui me presse d'aller la voir à Etiolles. A la bonne heure l’automne prochain, quand nous serons tous rentrés à Paris.
Un M. Alexander Wood m'a apporté hier une lettre de Gladstone très amicale et qui contient ceci : « Through Lord Aberdeen, I have had the high gratification of learning that you approved of the sentiments which I made bold to express on the occasion of our late debate respecting foreign affairs. They were spoken with great, sincerity. They were confortable, I believe, not only to the declared opinion of one of our houses of Legislature but to the real, though undeclared and latent opinion of the other. The majority of the house ef Commons was with us in heart and conviction ; but fear of inconveniences attending the removal of a Ministry which there is no regularly organized opposition ready to succeed, carried the day, beyond all substantial doubt against, the merits of the particular question. " Après tout, je crois que c’est bien là le vrai, et que la victoire de Lord Palmerston n'est ni de bien bon aloi, ni bien définitive s’il recommence. Et je suis persuadé qu’il recommencera.
La poste est en retard ce matin. Non pas vous, mais toute la poste. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a point de sûreté ; on peut tous les jours apprendre de Paris je ne sais quoi. Je vais faire ma toilette en attendant, et avant de vous dire adieu.
Onze heures
Voilà le facteur qui a été retardé. Il faut qu'il reparte tout de suite. Je n'ai que le temps de fermer ma lettre. Adieu, adieu. Le mercredi 17 ou au plus tard le 18, vous aurez été délivré de mon inquiétude. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 22 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je lisais hier dans Peel and his times, le récit de l’entrée de Canning dans le Cabinet de Lord Liverpool, les répugnances du Roi de tous les collègues de Liverpool, le travail de la marquise de Conyngham. Je regardais si votre nom ne venait pas. Il n'est pas venu. C’est un bien froid, sec et vide récit, quoique exact au fond. L’exactitude n’est pas la vérité, ni la vie. J’ai votre récit à vous très présent à la mémoire.
Certainement la revirade ou la conversion de Peel, comme on voudra l'appeler, est la plus complète qui se soit jamais vue. Tendre la main, en entrant aux Orangistes et en sortant, aux radicaux, c'est énorme. Pourtant on entrevoit dès les premiers temps que la revirade pourra se faire un jour, si un jour vient où il convienne qu’elle se fasse. Peel semble avoir toujours pressenti le triomphe des mesures qu’il combattait, et s'être ménagé une issue dans leur sens. Son père l'avait prédestiné et il se croyait lui- même prédestiné à être le successeur de M. Pitt. Ils ont tenu, M. Pitt et lui, les conduites précisément contraires. M. Pitt voulait certaines grandes mesures libérales, l'abolition de la traite l'émancipation des catholiques ; il les a toujours sontenues et avouées, et jamais faites. M. Peel les a toujours combattues, jusqu'au jour où il les a faites. L’un, élevé whig, devenu Tory ; l’autre élevé Tory, devenu plus que Whig. Voilà le facteur et votre lettre qui m’arrêtent au milieu de ma comparaison.
Onze heures
J’allais vous demander ce que signifie le voyage de la Gazette de France (M. Lourdoneix) à Frohsdorff. Je trouve à peu près la réponse dans mes journaux de ce matin. La circulaire du Conseil de M. le comte de Chambord met à l'index, l’appel au peuple. Elle a raison mais par par d'assez bonnes et grandes raisons. Je n’ai pas en idée que cette circulaire ait beaucoup de succès. C’était une excellente occasion de parler à tout le monde en parlant à son parti. L’occasion me semble un peu manquée. Napoléon avait coutume de dire: " L'exécution est tout." Il avait ses raisons pour le dire ; il était fou dans la conception et admirable dans l'exécution. Mais il est très vrai que l'exécution est beaucoup. La meilleure idée, mal exécutée devient une sottise. Moi aussi je n'ai rien de plus à vous dire. Je vous quitte pour me promener, un peu après déjeuner. Il fait encore beau mais d’un beau temps en train de se gâter. Adieu, Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 27 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 27 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Duchâtel m’écrit : " La prolongation des pouvoirs du Président me paraît la solution naturelle et à peu près inévitable ; on pourrait même dire la solution nécessaire si l’imprévu ne tenait pas aujourd'hui une si grande place dans nos affaires. La fusion des partis, qui était la seule ressource, a reculé plutôt qu’elle n’a avancé. L’effet de la circulaire légitimiste ne peut être réparé que par le temps, et par beaucoup de temps. Les fautes de tous les partis profitent au président en sa qualité de pouvoir établir, et il n'est pas assez solidement établi pour que ses propres fautes lui nuisent. Le pays veut la tranquillité et il n’est difficile ni sur les conditions, ni sur la qualité. La mauvaise marchandise, le satisfait autant que la bonne ; et en vérité, il n'a le droit ni d'être fier, ni d'être exigeant. "
Aux deux bouts de la France, les hommes sensés observent le même état des esprits et ont la même impression. Les Normands et les Gascons se ressemblent peu ; et pourtant leur politique est la même. Duchâtel me dit qu'il ne compte pas revenir à Paris avant le mois de décembre. Il paraît qu'il prend plaisir à l'agriculture.
10 heures
Malgré le Times et les Débats, je ne crois pas une telle folie. Ce serait mettre le feu au monde pour éteindre un fagot qui brûle dans un coin. Vous en Silésie et nous dans les provinces du Rhin ! Quand en sortirons-nous, nous y entrons ? Je ne vois là qu’un fait certain ; c’est que nous sommes tous décidés à faire finir l'affaire du Danemark. Nous avons raison et l'affaire finira sans un gros effort. Dans ceci comme dans tout, la Prusse fait plus de bruit qu'elle ne veut et ne peut faire d'effet. Politique toute d'étalage et de ruse. D'étalage par complaisance pour l’esprit révolutionnaire dont elle a peur et dont elle voudrait se servir. De ruse, parce qu’elle se dit : " Essayons toujours ; que sait-on ? Nous finirons peut- être par y gagner quelque chose le jour où la France, l'Angleterre et la Russie voudront dire sérieusement : " Finissez. " On finira. Je suis convaincu qu'on dira cela de Varsovie. Le régiment du Maréchal Paskuditch n’y fera [?]
Votre Empereur sait mieux que moi, ce qui lui convient. Mais je trouve ses démonstrations en l’honneur du Maréchal énormes. Cela semble indiquer, ou une importance du maréchal ou une pression de l'opinion publique Russe que je ne supposais pas.
Soyez sûre que le duc de Noailles a tort, lui spécialement de tant regretter ma lettre à Morny. Je serais bien étonné si, quand nous en aurons causé, il n’était pas tout à fait de mon avis. Je n’y ai pas mis tant de préméditation, et je fais mon système après coup, mais plus j'y pense, plus je crois le système bon. Il ne fait que confirmer mon instinct.
Si j'étais là, je vous lirais l'oraison funèbre de la Reine des Belges que le père Dechamps vient de prononcer à Bruxelles. Vraiment bon et beau morceau. Senti et sensé de la lumière religieuse et de l'intelligence humaine Tout ce qui se passe là fait honneur aux acteurs, et aux spectateurs. Adieu. Adieu.
Je vous écrirai encore demain. Et vous aussi à moi. Puis plus de lettres pour longtemps. Adieu. G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Décès, Diplomatie (Russie), Famille royale (France), Politique (Allemagne), Politique (Danemark), Politique (France), Politique (Normandie), Politique (Prusse), Posture politique, Réception (Guizot), Réseau social et politique
Val-Richer, Dimanche 28 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis croire que l'Impératrice ne veuille pas ou ne puisse pas faire avoir un passeport à votre fils. Ce serait un argument trop fort en faveur du régime constitutionnel avec tous ses ennuis et ses dangers. Sans vanité, votre correspondance vaut bien un passeport, et je ne pense pas que le pouvoir absolu, pour se maintenir, ait besoin de pousser jusque là l’ingratitude. Encore passe l’ingratitude pour les services rendus ; mais l’ingratitude pour des plaisirs si souvent donnés ! Je ne pardonnerais pas celle-là.
Marion a raison de dire la vérité à Changarnier. Elle peut tout dire, et je suis sûr qu’elle dit très bien tout. Qu'elle lui demande donc un jour dans quelle position il serait aujourd’hui, s’il était resté tranquille et sans impatience, dans son poste de Général en Chef de l’armée de Paris, se tenant en dehors de toutes les querelles parlementaires, et uniquement attentif à être toujours le représentant et le défenseur de l’ordre, soit à l'Elysée, soit à l'Assemblée. Il serait. aujourd’hui, entre Louis Napoléon et le Prince de Joinville le candidat naturel et obligé du parti de l’ordre à la présidence, la seule et assurée ressource de la majorité et du public dans leur perplexité. Pour moi je ne me console pas qu'il ne se soit pas ménagé cette chance simple infaillible, et je n'espère pas qu'en glanant de tous côtes des débris de partis, il s'en refasse une qui en approche, de bien loin. Personne n'est plus noir que moi, dans ce moment-ci.
La déclaration du Général Magnan au Président ne m'étonne pas. La peur gagnera tout le monde. Mais le lendemain du jour où tout le monde a eu peur ne vaut pas mieux que la veille, et nous ne serons pas tirés d'embarras parce que le président y sera tombé.
La Duchesse de Marmier n'a pas le moindre crédit à Claremont, et ses paroles ne signifient absolument rien. Mais elle remplacera là Mad. Mollien qui en dit quelques fois de bonnes. Pas beaucoup plus efficaces, il est vrai. Cependant, je persiste à croire que les bonnes paroles valent mieux que les mauvaises. Je regrette donc Mad. Mollien à Claremont.
Ma fille est assez bien. Elle a un peu dormi. Il iront son mari et elle, passer l'hiver à Rome. La santé de son mari a besoin du midi, et les raisons qui venaient de l'enfant ne subsistant plus. Rome vaut mieux qu' Hyères. Ils partiront vers le milieu d'octobre.
10 heures et demie
Henriette vous remercie de vos paroles qui lui ont été au cœur. Et moi aussi. Elle supportera comme il faut les épreuves et j'espère que Dieu lui enverra encore des joies. Adieu, Adieu. Je reçois ce matin beaucoup de lettres et on m'attend pour la prière. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 29 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous vends Fleischmann. Je suis frappé de son hostilité contre l'ancienne diète de Francfort. Quand un homme aussi honnête et sensé pense cela, il y a bien à regarder. Car il n'est pas complaisant pour les radicaux ; témoin ce qu’il vous dit de la Reine des Pays-Bas. Evidemment, il faut à l'Allemagne, autre chose que ce qu'elle avait avant février ; elle n'y retournera pas et ne s'y tiendra pas tranquillement. De loin, la raison le dit ; voilà un homme intelligent et monarchique à qui l’observation le dit de près. Le bon chemin entre le bouleversement et l'immobilité n'est pas encore trouvé. L’Autriche devrait le trouver ; elle n’est plus vouée à l'immobilité ; de gré ou de force elle change tant de choses dans sa propre maison, elle y admet tant de nouveau; elle devrait trouver aussi et admettre le nouveau qui convient au grand corps allemand. C’est la seule manière de déjouer l'ambition de la Prusse. Tout ce qu’il faut à l’Autriche, c’est que la confédération germanique subsiste tran quille et point asservie à la Prusse. Il ne se peut pas que l'ancienne organisation soit la seule qui atteigne à ce but. " Cherchez et vous trouverez. “, dit l'évangile qui a toujours raison. Je suis convaincu que, si l’Autriche, cherche sérieusement et sincèrement, elle trouvera.
Le Roi de Wurtemberg me fait dire qu’il espère que je retournerai sur le Rhin l'été prochain et qu’il me priera alors de pousser jusqu'à Stuttgart. Avez-vous vraiment quelque idée d’y aller voir, votre grande Duchesse ?
Peel and his times m'amuse toujours beaucoup. Je viens de lire 1827, l'apparition et la disparition de Canning. Vous n'êtes pas nommée du tout ; mais les menées autour de George IV, pour la formation de ce Cabinet brillant et éphémère sont assez vivement racontées, par un libéral modéré et de peu d’esprit, qui déteste les cours et les femmes dans les cours. Il parle du travail caché que faisait ou laissait faire le Duc de Wellington pour remplacer lui-même, Lord Liverpool et il dit : " The king was disposed to favour this tortuous course ef proceeding ; he had et this time become a kind of English Sardana palus, and was anxious, to have a government sufficiently strong to relieve him from all anxieties about affairs of state, and to leave him free to enjoy the imitation of a Mohammedan Paradise which he had established at Windsor, perfect in all respects save the prohibition of wine." Il raconte assez bien l'effet que fit sur le Roi la démission, simultanée des six anciens collègues Tories de Canning : " This, which certainly looked like an attempt to intimidate, fired the pride of George IV ; he immediately confirmed the appointment of M. Canning, and gave him full power to supply the places which had been vocated. " Cela vous amuserait.
10 heures
Votre lettre est intéressante. J'y répondrai demain. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 30 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc des coups de canon. Je ne connais pas assez les localités pour savoir ce qu’ils valent comme opération militaire ; il paraît que vous avez pris l’initiative. Je serais étonné si vous ne laissiez pas aux Turcs l’embarras de passer le Danube, et de venir vous attaquer dans les Principautés. Militairement cela semble sensé, et politiquement, c’est beaucoup mieux pour vous. Les Turcs ne peuvent soutenir longtemps la guerre offensive. L’article du Moniteur est calmant et pacifique. Mais je ne m'explique pas la nomination du général Baraguey d’Hilliers, sinon par l'Empire des services personnels, abstraction faite de toute politique. Du reste la Bourse et Galignani disent que le Moniteur n’a pas fait sur tout le monde la même impression que sur vous et moi.
Je suis frappé de la froideur et de l’ennui des journaux Anglais sur cette affaire. C'est ce qui arrive des questions factices. Quand le bavardage a jeté son feu, et qu’il faut en venir à l'action sérieuse, il n’y a plus rien, et en voudrait bien n’y plus penser.
J’ai quelque peine à écrire ce matin. Je suis pris, dans l’épaule, d’une douleur rhumatismale assez vive quand je fais un mouvement. Je connais cela. J'en ai été atteint un jour où j’avais à parler à la Chambre des Paires, et j’ai parlé quand même, l’épaule et le cou de travers. Je n'ai plus besoin de si maltraiter mon mal. Cela passera avec quelques frictions et deux ou trois jours.
Onze heures
Voilà une lettre qui me déplait beaucoup. Mais vos impressions sont bien en contradiction avec cette suspension momentanée des hostilités dont les journaux m’apportent le bruit. Je ne crois pas à l'attaque dans la mer Noire. Que tout cela est fou et triste ! Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 2 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai jamais voulu aller revoir Neuilly. J’y aurais éprouvé le plus désagréable des sentiments, celui de la colère impuissante. Je ne connais rien de plus hideux que cette fureur destructive de la canaille contre les demeures d’un pauvre roi qui n’avait jamais fait de mal à personne, et qui parmi ses défauts n’avait certainement pas celui d'être dur et hautain envers le petit peuple.
Vous ai-je jamais dit que, pendant que j'étais encore en Angleterre du printemps de 1849, si je ne me trompe des habitants de Neuilly avaient fait une souscription pour contribuer à la reconstruction du château, et que l’un d'entre eux me l'avait envoyée en me priant d’en parler au Roi ? Je lui en parlai, et il me répondait avec le sentiment le plus amer que je lui aie peut-être jamais vu : " Non, tant que je vivrai et que Neuilly sera à moi, il restera détruit. Je trouvai qu’il avait raison.
Thiers est ce qu’il était. Il veut que Henri V et la fusion soient impossibles. La difficulté est assez grande pour qu'un peu de bon vouloir en fasse une impossibilité. Mais il serait bien fâché qu'elle fût moins grande ; et si elle l’était moins en effet, il travaillerait à l’aggraver. Toutes les fois qu’il faudra se classer définitivement, Thiers rentrera dans le camp révolutionnaire. Il n'y a en pareille conversation, qu'une réponse à lui faire, c'est d'opposer impossibilité à impossibilité, impossibilité de durée à impossibilité d'arrivée, et de lui bien mettre sur les épaules la responsabilité de celle dont il se fera le champion. Il n'y a pas moyen de ramener Thiers ; mais on peut aisément le troubler. Il faut avoir son indécision à défaut de sa conversion.
J’ai enfin des nouvelles de Piscatory, à propos de la mort de ma petite-fille. Il me dit en finissant : " Encore un mois de repos avant la lutte où il m'est impossible d’être avec qui que ce soit ; et cependant je prendrai parti. Quoi que je fasse conservez-moi votre amitié ; la quantité de la mienne compense un peu la qualité." Je n’entrevois pas quelle est la monstruosité qu’il médite de faire, et qui peut compromettre mon amitié. Il sera tout bonnement Joinvilliste.
J’ai reçu hier une longue lettre de Dumon. Noire en effet, et très spirituelle. Je ne vous en redis rien. Il vous a sûrement dit tout cela. Que dit-on du résultat définitif des élections belges ? Si le ministère n'a gagné en effet qu'une voix dans le nouveau sénat cela me suffirait pas pour faire passer sa loi, et le ministre des finances, M. Frère, qui est le révolutionnaire par excellence, pourrait bien être forcé de se retirer. Ce ne serait pas mauvais, comme exemple.
Les quatre tableaux qui terminent le manifeste napolitain sont concluants et utiles. Vous intéressez-vous au télégraphe sous-marin ? Vous ne vous doutez pas à quel point le public provincial en est occupé ; il attendait la nouvelle du succès comme celle d’une victoire. L'imagination des hommes est tournée vers ces choses là.
11 heures
Merci de votre lettre de ce matin très bonne, et qui sera utile. Je vous en parlerai demain. Merci et adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis décidé à croire que votre Empereur ne veut pas la guerre, et par conséquent à croire qu’il saisira la première occasion de sortir d’un mauvais pas qui mène à la guerre à la guerre révolutionnaire générale, au chaos Européen.
Si malgré cette perspective, vous aviez votre parti pris de pousser la botte à fond et de jeter bas l'Empire Ottoman pour mettre la main sur les gros morceaux, je comprendrais l'obstination et je n'aurais rien à dire, sinon que le moment est mal choisi pour un si grand coup. Mais je suis convaincu que vous ne voulez pas porter ce coup et alors je ne comprendrais pas que vous ne missiez pas fin, le plutôt possible, à la situation actuelle. Vous n’avez qu'à y perdre. Vous y avez déjà pas mal perdu ; vous y avez perdu votre grand caractère de pacificateur général, de conservateur suprême de l'ordre Européen ; vous avez reveillé les méfiances des autres puissances ; vous vous êtes séparés de l'Angleterre ; vous l’avez unie à la France ; vous avez placé votre plus sûr allié, l'Autriche, dans la situation la plus périlleuse. Vous avez fait autre chose encore ; vous avez fourni à la Turquie une nouvelle occasion de s'établir dans le droit public Européen.
Taxez moi de rancune si vous voulez ; mais ce fût là, en 1840, votre faute capitale, pour isoler, pour affaiblir le gouvernement du Roi Louis Philippe, vous avez alors mis de côté votre politique traditionnelle qui était de traiter les affaires de Turquie pour votre propre compte, à vous seuls sans concert avec personne, vous avez vous-mêmes porté ces affaires à Londres par le traité du 15 Juillet 1840 vous en avez fait de vos propres mains, l'affaire commune de l’Europe. Vous avez été obligés l’année suivante, de faire encore un pas dans cette voie, et la convention des détroits du 13 Juillet 1841, et, de votre aveu, confirmée, pour la Turquie, l’intervention et le concert de l'Europe. Ce n’est pas là, je pense, ce qui vous convient toujours et au fond, et vous deviez être pressés de rentrer avec la Turquie dans vos habitudes de tête à tête. L'affaire des Lieux Saints vous en fournissait, il y a quelques mois une bonne occasion ; après y avoir essuyé, par surprise, à ce qu’il paraît un petit échec, vous y aviez repris vos avantages ; vous l'aviez réglée comme il vous convenait, sans vous brouiller avec la France, et de façon à être fort approuver de l'Angleterre. Pourquoi n'en êtes vous pas restés là ? Tout ce que vous avez fait depuis vous a mal réussi, vous avez eu l’air de vouloir plus que vous ne disiez ; vous n'avez pas fait ce que vous vouliez ; vous vous êtes bientôt trouvés engagés plus avant que vous ne vouliez ; vous avez rallié l'Europe contre vous et jeté la Turquie dans les bras de l’Europe. Pourquoi ? Encore un coup, je ne le comprends pas. Je ne le comprendrais que si je vous croyais décidés à jouer, en ce moment, la grande et dernière partie de cette question, et à mettre, à tout risque, la main sur Constantinople. Et comme je ne crois pas cela, je persiste à penser qu’une seule chose vous importe ; c’est de mettre fin promptement à une situation qui a le triple effet de vous isoler en Europe, d’unir l'Europe contre vous et de placer de plus en plus la Turquie sous la sauvegarde du concert Européen. Vous pouvez sortir de ce mauvais pas, sinon sans quelque déplaisir momentané, du moins sans aucun inconvénient sérieux pour votre politique nationale, et son avenir ; la géographie et le cours naturel des choses vous donnent, dans la question Turque, des forces et des avantages que rien ne peut vous enlever. Pourquoi susciter contre soi un orage quand il suffit de laisser couler l'eau ? Adieu.
J'en dirais bien plus si nous causions. G.
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les Turcs ont donc passé le Danube, et vous n’y avez pas fait obstacle, probablement dans l’intention de les battre et de les rejeter ensuite au delà du fleuve, en leur disant : " Repassez si vous voulez. " Je me figure qu’il y a là, pour vous toute une politique, et une bonne politique ; si vous restez fermement dans les principautés, en en chassant toujours les Turcs, mais sans en sortir jamais vous-mêmes, vous ferez un grand pas dans votre destinée, en forçant l’Europe de reconnaître que vous ne voulez point aujourd’hui renverser l'Empire Ottoman ; vous remporterez des victoires en vous épargnant les plus grandes difficultés de la guerre, et vous resterez de plus en plus en mesure de négocier, une bonne paix. Je fais profession de ne rien entendre du tout à la guerre comme guerre ; mais la guerre comme moyen de la politique, je la comprends, et dans cette occasion-ci, je ne serais pas embarrassé pour m'en bien servir.
Onze heures et demie
Vos nouvelles valent mieux que mes plans de politique. Comme vous dites, il faut encore tout que ce soit fini ; mais quand ce sera fini, je ne serai guère plus sûr de la paix que je ne l’ai toujours été. Adieu, adieu. On sonne le déjeuner, et ma toilette n’est pas encore achevée. G.
Val-Richer, Jeudi 3 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Duchâtel m'écrit : " Je trouve l'esprit encore abaissé depuis un an dans ce pays. On ne sait ni ce qu’on veut, ni même ce que l'on désire. On demande l’ordre matériel sans savoir à quelles conditions, ni par quels moyens il peut être procuré. On dérive constamment sur la pente de l’imprévoyance et de la platitude. Aussi la fusion est-elle très peu populaire à Bordeaux. On y aime peu les légitimistes auxquels les conservateurs reprochent, non seulement leurs péchés d'ancien régime, mais leurs alliances des dernières années avec la Montagne. Il est impossible, d’un autre côté, de rien voir de plus maladroit, de plus déplaisant de plus dénué d’esprit politique, que les légitimistes de province. Ils auraient pour but de sa faire détester qu'ils ne s’y prendraient pas autrement.
Le Président, de son côté, a beaucoup perdu. L’idée de l'Empire n'entre plus dans la tête de personne. Les plus chauds partisans du statu quo ne vont pas au delà, d’un nouveau bail de quatre ans. Mais ce que les légitimistes et le président perdent, personne ne le gagne. La France avec ses folies, était destinée à donner le spectacle, digne d’une maison d'aliénés, d’un jeu où il n’y a que des perdants, sans gagnants. Si le bon Dieu ne vient pas à notre aide, nous n'avons guère de chance de nous en tirer. "
Vous voyez qu’il n’est pas gai. Cependant il ne change nullement d’avis et ne renonce point.
Je viens de lire l'article de [?] Marc Girardin dans les Débats. La première partie mauvaise. La Seconde sauf un mot, bonne et utile. Ce qui domine dans les journalistes, c’est la polémique. Ils ont besoin de porter des bottes. On se pique aisément à ce jeu là. Il y a, dans tout cet article, plus de polémique que de politique. Je fais dire ce que j'en pense, sur le ton de l’observation amicale, et dans l’intérêt du Journal lui-même. Son importance subsiste et il en gagne dans le parti conservateur plutôt qu’il n'en perd. Précisément parce qu'il est à la fois fidèle au parti et point étranger à ses passions. Mais on peut agir sur lui, à condition de ne jamais se lasser. C’est la condition de tout succès en ce monde.
Onze heures
L’infamie est grande. Mais je ne crois pas qu’il y ait à hésiter. Il faut vous épargner le désagrément de cette publication. Pur désagrément de journaux et de bavardages, mais qui vous ennuierait fort. Il faut seulement avoir de cette femme une déclaration bon et dûment signée, que le manuscrit qui serait remis est unique, qu’il n’en existe aucune copie, et que toute publication qui en serait faite ultérieurement ne serait qu'une fabrication mensongère. Je sais ce que cela peut valoir avec de telles gens. Pourtant c’est une arme, et un moyen de discréditer s’il y avait lieu. Je suis comme de raison, prêt à aller causer de cela avec vous, s'il le faut. Mais je ne vois guère ce que j'aurais de plus à vous dire et je crois qu’il faut prendre garde de ne pas grossir cette petite indignité. Je ne puis agir d'aucune façon, car je ne pourrais agir sans paraître ce qui aurait de l'inconvénient. Parlez de cela à mon visiteur d’hier, que vous aurez vu ce matin. Il est plus propre que personne à donner un bon conseil, en telle occasion, et à faire ce qu’il peut y avoir à faire pour en finir. Et comme si vous aviez, comme je le présume besoin d’une entremise, il faut mieux que ce ne soit pas la sienne, je joins ici un mot pour lui où je lui indique un homme très propre à s'en charger, très sûr ; et qui le ferait, je n'en doute pas, de très bonne grâce, car il m'est fort dévoué. Remettez ce billet à mon visiteur ; quand vous en aurez causé avec lui, je crois que vous serez de mon avis. Je vous renvoie la lettre. Je suis vivement contrariée, pour vous de l'agitation que cela vous donne. Certainement il est difficile de voir une plus indigne action. Adieu, adieu.
Soyez sûre que les deux personnes que je vous indique sont très intelligentes, et très dévouées. Adieu.
Val-Richer, Jeudi 4 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà Sir Robert Peel mort. J'en ai un vrai chagrin. Il n’avait pas tout, mais il avait beaucoup. Il a fait des choses douteuses mais grandes pour le bien être de bien des millions d'hommes dans son pays. Il avait le goût et le parti pris de la politique honnête. Je l’honorais plus qu'il ne me plaisait ; mais la mort illumine les qualités et élève l'estime au-dessus des dissidences. Puis ses dernières paroles sur moi me restent dans le cœur, encore un exemple, après tant de mille et mille autres, des plus belles et plus heureuses, existences brisées tout à coup misérablement ! C’est bien la peine de devenir grand pour rester à la merci d'un caillou et d'un coup de pied de cheval ! Si le dernier mot de la vie était ici bas, elle ne vaudrait certes pas le souci qu'on en prend.
Quelle sera l'influence de cette mort sur la situation du cabinet Whig et l'état des partis en Angleterre ? Cela me paraît assez obscur. L'opposition en sera plus libre ; les Peelistes s’y incorporeront plus intimement. Les Protectionnistes seront peut-être plus modérés, en matière de free trade, n'ayant plus devant eux leur vainqueur. C'est en même temps, sinon un Chef, du moins un grand patron de moins pour une combinaison nouvelle. Dites-moi vos informations, et voir conjectures.
Le Duc de Broglie m'écrit : " Les affaires sont toujours dans le même état. L'assemblée est fort décousue, et a grand besoin de se séparer pour ne pas se quereller. Nous espérons une prorogation de trois mois dans les premiers jours d'août. " - Un autre correspondant : " Les tiraillements dans la majorité et entre la majorité et le Président deviennent tous les jours plus sensibles. Tout le monde est mécontent de tout le monde. Les légitimistes sont les plus aigres, comme toujours. De son côté, la presse va de l'avant, et on demande hautement la révision de la Constitution. On dit que cette question et celle de la prorogation des pouvoirs du Président seront posés sans faute au retour de l'Assemblée. "
Adieu. Je n'attendais pas de lettre ce matin ; elle ne me manque pas moins. Il me tarde bien de vous savoir arrivée, et un peu reposée. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 4 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes incomparable pour faire succéder, presque sans intervalle, la plus complète impartialité à la plus vive passion. Vous ne savez que dire à l'article des Débats sur la candidature du Prince de Joinville. Je vous assure qu’il ne détruit rien de ce que vous avez jusqu'ici pensé et dit contre cette candidature. Les Débats ne se sont pas le moins du monde inquiétés de la discuter, d'examiner si elle était bonne ou mauvaise ; ils ont saisi une occasion de faire un hymne, en l’honneur du Prince de Joinville pour couvrir leur embarras sur la question même. Ils repoussent une injure pour se dispenser d'avoir un avis. Que l'effet de leur article puisse être mauvais, je ne le conteste pas, et j’aimerais infiniment mieux qu’ils n'eussent rien dit ; mais je l'ai relu attentivement j’y avais à peine regardé hier matin, en fermant ma lettre ; c'est de la politique purement personnelle dans une situation équivoque, et pour se réserver la faculté de dire plus tard oui ou non selon le besoin de cette situation. Il y a des attaques contre les patrons de la candidature du président et des insinuations contre les patrons de celle du Prince de Joinville. On prépare et on élude. Et on finit par donner au Prince de Joinville des conseils pour son bonheur. Je ne sais ce que fera le Journal plus tard ; mais ceci n’est pas sérieux. Je n'ai encore vu que bien peu de personnes de ce pays-ci ; mais personne ne s'attend à un coup d'Etat ; et s’il arrive sans quelque fait nouveau qui le motive. On n'y comprendra rien.
La disposition des esprits est vraiment singulière et leur fait bien peu d’honneur comme esprit ; on n'a pas du tout le sentiment du danger de la situation ; on est sans confiance, mais aussi presque sans inquiétude. On semble se dire : " Nous nous en tirerons toujours ; après tout, cela ira toujours bien aussi bien que cela va à présent, et cela nous suffit. " Il n'y a point de milieu entre le désespoir de Jérémie et ce stupide aveuglement. Je suis fort triste et encore plus humilié.
Montebello m'écrit, fort triste aussi, mais je vais entrevoir de plus, dans sa tristesse un peu de perplexité. Je n'ai point de perplexité du tout ; nous avons bien plus raison que nous ne croyons. Et il faut nous établir chaque jour plus nettement dans notre avis. Je répondrai bientôt à Montebello. Je voudrais bien qu’il fût tranquille sur sa femme.
Je regarde, et je regarderai attentivement à ce qui se passe en Autriche. Ce sera curieux. Il n’arrivera, à la révolution et aux révolutionnaires, rien qu’ils n'aient mérité ; mais je voudrais bien que la réaction fût conduite habilement, et qu’il en résultât une vraie réorganisation. Je suis un peu pour les gouvernements, comme vous pour les diplomates ; je m’y intéresse, quelque soit leur nom comme à mon métier, et il me semble toujours que je suis pour quelque chose dans leurs revers ou dans ceurs succès.
10 heures
Votre lettre confirme, un peu mes conjectures instinctives. Je croirai au coup d'Etat quand je l’aurai vu. Mais ce qui me plaît le plus de votre lettre, c’est que vous vous sentez mieux. Paris vous reposera et le bon effet des eaux viendra peut-être. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 6 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Deux choses me frappent dans les conversations et les journaux de province : le travail assez actif qui se poursuit pour rallier et échauffer le parti modéré au nom de sa récente victoire dans l'assemblée ; l'ardeur de la portion intrigante du parti légitimiste à accueillir et à propager les idées de la gazette de France et de M. de la Rochejacquelein. Le parti modéré a vraiment le sentiment de la victoire. La guerre légitimiste s'agite avec l’aveugle impatience d’enfants mal élevés qui se croient près de mettre la main sur l'objet de leurs désirs. Jamais peut-être le parti modéré n'a été plus disposé à s'organiser politiquement, et jamais le progrès qu’ont fait les théories et les habitudes anarchiques dans le parti légitimiste lui-même n’a été plus évident. Il faut absolument que cette queue là soit coupée et rejetée parmi ces débris de toutes nos révolutions qui feront longtemps encore une opposition absolue et absurde à tout gouvernement. Le vrai et complet parti modéré, ne s'organisera qu'à cette condition, et en luttant contre cette queue là comme contre toutes les autres.
9 heures
Voilà les journaux et votre lettre. Je comprends l'émotion ; mais convenez qu'elle est bien ridicule. Il faut choisir ; veut-on, avoir un président de la république comme on en a un aux Etats-Unis, ne voyant personne, ne donnant un verre d'eau à personne, faisant tout simplement les affaires du pays sans aucun lien ni rapport avec la société du pays ? Cela se peut ; cela ne va pas mal aux Etats- Unis. Mais si cela convient à la France et à l'Assemblée nationale, il faut le dire tout haut, et non seulement permettre, mais prescrire au Président cette façon de vivre. Je dis prescrire car il y a en France, sur ce point des habitudes, des traditions des siècles d’habitudes et de traditions à abolir. Ce n'est pas trop d’une loi formelle pour les abolir et introduire un régime nouveau. Si on ne veut pas de cette abolition, si on ne la croit pas possible, si le président. doit être un personnage non seulement politique, mais sociable, si la République française entend conserver un peu la physionomie de la France, France de l'ancien régime, France de l'Empire, France de la Restauration, France de la Monarchie de Juillet, il faut absolument donner au président ce qu’il lui faut absolument pour jouer ce rôle-là. Je ne connais rien de plus honteux et de plus odieux que cette double prétention d'avoir un Président qui dépense, et de ne pas payer ce qu’il dépense, ce double parti pris des fêtes, et de la banqueroute, des charités et de la banqueroute. Et quand cette situation éclate, on se récrie ou s'indigne : on dit : " Ne nous parlez pas de cela. ". Si j'étais le président, je n’en parlerais peut-être pas ; mais je publierais toutes les semaines, dans le Moniteur, les comptes de ma maison, de toutes les dépenses de ma maison, et je laisserais au public à juger, si c'est moi qui suis le banqueroutier. Sur cette misérable question domestique comme sur les grandes questions politiques le pays-ci ne sera pas gouvernable tant qu'on ne l'obligera pas à voir les choses comme elles sont, et à entendre toute la vérité.
Si l'affaire grecque n'est pas tout-à-fait arrangée et conclue, Normanby en familiarité publique avec le président est quelque chose de plus que du mauvais gout ; c'est de l’insolence. Adieu. Adieu.
Je suis bien impatient des réponses que j’attends sur le véritable état de St Léonard. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 6 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ne vous fatiguez pas à m'écrire ; mais sachez que la vue de votre écriture me charme tout le jour.
Les détails que vous me donnez sont tristes, mais ne m'étonnent pas. Il faudrait une force de sens et d’âme supérieure pour résister à la tentation dont on les assiège. On leur promet de leur rendre leur patrie et un trône et nous leur demandons de renoncer absolument à cette chance pour en courir une autre qu’ils regardent comme très douteuse presque comme impossible. Ce n’est pas sur eux que tombe mon blâme mais sur ceux qui les prennent pour instrument de la perpétuité d'un état de révolution qu’ils sont eux-mêmes incapables de gouverner, et qu’ils ne veulent pas laisser finir.
Je suis de l’avis du Duc de Noailles. Il a bien fait de laisser partir la lettre que le duc de Montmorency avait reçue. Votre paragraphe dans le portrait du comte de Chambord de M. de la Guéronnière m’a amusé, malgré la délayage et la lourdeur prétentieuse. Mallac m'écrit avec assez de trouble. Nous touchons, selon lui, à de gros événements peut-être à une crise définitive, le Président est résolu à tout risquer pour vaincre la résistance de l'Assemblée ; les Régentistes se donnent beaucoup de mouvement et sont plein d’espérance ; Changarnier pousse les Légitimistes à des mesures extrêmes, et pourrait bien n'être que l’instrument de Thiers & & Tout cela se peut ; mais je persiste à douter que tout cela aboutisse à une solution prochaine. La partie est plus compliquée, et plus grande que ne se le figurent les joueurs assis autour de la table. Personne n'est près de la gagner.
Je ne vous dis rien de Pétersbourg. Il n'en faut plus parler, et il y faut penser le moins possible. C'est bien difficile. Je le sais.
J’avais hier chez moi un des principaux et des plus intelligents manufacturiers de Lisieux. Il m’a dit que depuis trois ou quatre semaines, les affaires étaient aussi complètement suspendues qu'elles l’avaient été en 1848.
Onze heures et demie
Mon facteur arrive très tard. Je craignais qu’il n’y est quelque chose à Paris. Ce que vous me dites ne change rien à mon impression. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 7 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Duchâtel m'écrit : " Je trouve l'aspect des choses triste ; la situation de Changarnier à peu près détruite ; la fusion rendue presque ridicule par la correspondance du Prince de Joinville ; tout le monde en découragement ; le mouvement dans le sens du Président ; l'assemblée a été raisonnable pour la révision et le choix de la commission de permanence ; mais cette raison, si elle persiste, la conduira plus loin que jusqu'à présent ne le veulent les Légitimistes. Il est clair que la prolongation doit en sortir. "
Vous voyez ; c’est la même impression que j'ai d’ici ; sauf l'exubérance de l’esprit de critique, qui est le plaisir et la faiblesse de Duchâtel. Il ne résiste pas à se moquer de ce dont le monde se moque. Si l'idée de la fusion est juste, comme je le crois, il n’est pas au pouvoir du Prince de Joinville de la rendre ridicule par ses sottises. Elle en surmontera bien d’autres. Mais en attendant, et sur la situation en général, certainement Duchâtel dit vrai. J'y regarderai dimanche. Il voudrait aller chasser quelques grosses en [?] avant notre visite à Claremont le 26. Mais son fils, et la distribution des prix le retiendront trop tard à Paris. Je doute pourtant que nous partions ensemble. Il veut arriver à Londres 8 ou 10 jours avant le 26, pour les donner à l'exposition. Je n’en donnerai pas tant ; un ou deux jours de Londres me suffiront très bien, et je ne veux arriver en Angleterre que tout juste pour la visite qui m’y fait aller.
D'autres lettres de sources diverses, me transmettent la même impression que Duchâtel. Je vois seulement que, dans beaucoup de département on commence à se préoccuper sérieusement de l'élection de la future assemblée, et à se concerter entre conservateurs et légitimistes, pour qu’elle soit bonne. C’est aujourd’hui le but essentiel, et le seul possible, à attendre.
Un autre mouvement électoral m’arrive celui de l'Académie. Tous les concurrents m'écrivent, M. Liadières, M. Philarète Chasles, M. Poujoulat & Vous ne connaissez guères plus les noms que les personnes. Tous aussi légers les uns que les autres. Il n’y aurait que Berryer qui eût du poids et de l'éclat. Mais notre dernier choix a été M. de Montalembert ; l'Académie ne voudra pas faire coup sur coup deux choix politiques, l'un pris à Rome, l'autre à Frohsdorf. Je n’ai pas idée du résultat. Ce dont vous n'avez pas d’idée, c'est de mon état d'enchiffrenement et d'éternuement ce matin. Je vous écris à travers des torrents de larmes. Il fait pourtant bien beau et bien sec hors de mes yeux. Je suspends pour attendre un intervalle lucide.
10 heures
Merci de la lettre qui m’arrive. Je n'y comptais pas aujourd’hui. J’y vois un peu plus clair, mais guères. Je n'ai rien de Paris. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 9 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les deux visiteurs qui me sont arrivés hier au moment où je vous écrivais étaient MM. de Bourmont et d'Osseville. Si les bonnes intentions suffisaient pour bien faire les affaires d’une cause, les légitimistes pourraient réussir ; mais il faut encore autre chose ; il faut surtout comprendre la langue qu'on parle et l’air qu’on respire. J'en désespère souvent. La perplexité de ces hommes-là au milieu des querelles de leur parti est grande ; ils ne veulent pas se brouiller avec M. Berryer et Falloux ; ils soupçonnent même que ceux là ont raison ; mais leur cœur est avec MM. Nettement et La Rochejaquelein ; ils ne peuvent se résoudre à s'en séparer. Quant au Général Changarnier, ils ne demanderaient pas mieux que de l'adopter pour candidat ; ils feraient même, à cette chance, le sacrifice de beaucoup de doutes et de méfiances. Mais, s'il vote pour la proposition Creton, c’est trop fort ; ils l'abandonneront tous. En dernière analyse, pressés entre le Prince de Joinville et Louis Napoléon, ils ne s'abstiendront pas ; ils voteront pour le dernier. Ils le savent déjà, mais ils ne le disent pas encore tout haut, et ils souffrent quand on leur dit. Pardonnez moi l’insulte ; on dirait un parti de femmes ; ce qui leur plaît ou leur déplait, voilà la considération décisive.
Vous avez bien raison, l'article de l'Assemblée nationale à propos d'Abdel Kader ne vaut rien ; il fallait être beaucoup plus moqueur, sur Lord Londonderry et beaucoup plus solide et arrêté sur le fond de la question. Ni moi non plus, je ne sais où ils ont pris la mission de Lord Londonderry à St Pétersbourg ; il faut pourtant qu’il y ait quelque prétexte ; est-ce qu'il n’a pas été au sacre de l'Empereur Nicolas ? pour Kossuth me surprend un peu. Est-ce pure badauderie populaire ? Le gouvernement sans s'y mêler, n'y pousse-t-il pas, n'y connive-t-il pas du moins ? Palmerston en est bien capable, et l'hostilité contre l’Autriche est son grand moyen d'influence en Italie, à quoi il tient beaucoup dans ce moment-ci. Être puissant en Piémont et en Suisse, couper l'herbe sous le pied à la France pas ; ils voteront pour le dernier. Ils le savent révolutionnaire et à ses portes c'est une bonne fortune qu’il cultive avec soin. Je soupçonne et ils souffrent quand on leur dit. Pardonnez aussi qu’à Constantinople et dans la question d’Egypte il n’est pas content de l’Autriche, et qu’il s'en venge. Mais qu’est donc devenu l’ancien sentiment national anglais ? Raynaud et Kossuth, c’est beaucoup.
Cette question hongroise a fait dans le monde plus d'effet que nous n'avons supposé. Voyez les Etats-Unis. On a vu là des aristocrates et une ancienne constitution ; on n'a pas voulu y voir des révolutionnaires. Que viendra faire Lord John à Paris ?
Onze heures
Le refus à Alexandre me passe. Je ne croyais pas cela possible. Je n’avais pas besoin de cela pour être sûr que mes préférences ont raison. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 11 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci devient une véritable et cruelle inquiétude. Pas de lettre. Vous êtes malade. Seriez-vous assez malade pour n'avoir pas même pu penser à me faire écrire un mot par votre médecin, par Auguste? Je n'y comprends rien. Mais je suis désolé. Et je ne vois personne à qui m'adresser pour avoir de vos nouvelles. Il faut que j’attende. Il m'est impossible de vous parler d'autre chose. J’aurais bien des choses à vous dire. Mais c'est impossible. Adieu, adieu, adieu. Il y a bien longtemps, que je n'ai ressenti une telle anxiété. Adieu.
G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Inquiétude
Val-Richer, Jeudi 11 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai passé hier ma matinée à Lisieux. 26 visites ! à la vérité, je n'en ai trouvé que six. Dans les villes de province comme à Paris la société est dispersée et court les champs. Ce n'est pas la peine de vous redire mes observations sur l'état des esprits. Je n’ai rien entendu de nouveau. J'arrive toujours à la même conclusion ; s'il ne survient point d'événement qui dérange la pente des choses, on élira une assemblée plus présidentielle que celle-ci, et puis on réélira le Président, dans la confiance que l'Assemblée couvrira l’inconstitutionnalité de sa ratification. Toutes les autres combinaisons, toutes les autres. prétentions sont en dehors du sentiment national. Il est vrai que, dans mon pauvre pays le sentiment national est bien souvent bafoué et foulé aux pieds. Il se venge ; mais cela ne le sauve pas.
Je travaille beaucoup. J'écris ma politique personnelle ; ce que j’ai cherché pour mon pays ; fragment de Mémoires personnels. Je veux avoir cela tout prêt, pour le publier au moment qui me conviendra. C’est un grand amusement et ce peut être un grand intérêt pour moi. Je crois que cela vous intéressera aussi. On peut très bien trouver la garantie qu’on cherche pour Changarnier. Je suis moins sûr, qu'elle lui convienne quand on l’aura trouvée.
Si Thiers va à Londres, c'est pour faire cesser les hésitations qui existent encore là, qui ont même augmenté, je crois, dans ces derniers temps, et qui empêchent toute conduite positive et publique. Or il n’y a que les conduites positives et publiques qui réussissent. Thiers ira quand le Duc d’Aumale y sera arrivé, pour être de la délibération de famille. Je ne crois pas qu'on lui résiste. Il fera adopter le plan de campagne qu’il proposera. Quel sera ce plan. C'est ce qu’il faudra savoir le plus tôt possible. Il y en avait eu un premier qui a été fort dérangé. Nous verrons ce qui adviendra du second.
Est-ce que personne à votre connaissance, ne parle d'aller aussi voir Madame la Duchesse d'Orléans à Eisenach ? Je n’entends plus parler du tout de Piscatory. Il ne m’a pas écrit depuis que je suis ici. J'en saurai peut-être quelque chose à Broglie. En tout cas je romprais moi-même le silence. Je ne veux, ni me brouiller avec un ami, ni me laisser boucher une fenêtre sur le camp ennemi. Avez-vous quelque certitude qu’il est en correspondance avec la Duchesse de Talleyrand ? Cela vaut la peine de le savoir sûrement. Je m'étonnerais que de la part de Palmerston, cette correspondance eût recommencé sans quelque intention. Il a à la fois beaucoup de premier mouvement et beaucoup de calcul. Et il peut avoir envie de s’entrouvrir, en tous sens des portes.
11 heures
Merci de votre longue lettre. Je vous remercierai bien plus encore quand vous me direz que vous vous sentez mieux. Voilà des visiteurs de Trouville qui viennent me demander à déjeuner. Hippolyte de La Rochefoucauld et cinq ou six Mallet, Labouchère & Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 12 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'espère que ce beau temps guérira promptement votre mal de gorge. L’air était plus doux hier qu'il ne l'a été depuis longtemps. Je ne veux pas avoir le plus petit remords à votre sujet. C’est un grand contraste que le profond repos de ce lieu-ci, après la vie de courrier que j'ai menée deux ou trois fois cet été. J’ai besoin de repos. Moins que vous, mais comme vous, je m'aperçois que ma bonne santé est au prix d’une vie tranquille. Retrouverons nous une vie tranquille ? J’en doute. Le succès même sera plein de difficultés, et de luttes.
Je suis assez frappé des progrès de l’esprit républicain, non pas pour lui-même mais contre autrui. Il a fallu un grand courage dans les temps que nous avons traversés il n'en faudra pas moins dans ceux qui se préparent. Le Président sera demain à Paris, son voyage ne me paraît laisser, dans ce pays-ci à peu près aucune trace. Impression très superficielle ; ni bonne, ni mauvaise. Bizarre destinée ! Ce sont les masses qui l’ont porté au pouvoir, et il plait peu aux masses quand elles le voient, peuple ou armée. Il n’a, sur elles, ni l'autorité impériale, ni l'entraînement révolutionnaire. C'est auprès des classes moyennes sensées et honnêtes qu’il réussit le mieux ; elles lui trouvent de la tenue et lui savent gré de sa persévérance dans la politique d’ordre. Il fera bien de continuer à prendre là son point d'appui. C’est là que le sentiment général est décidément favorable à la prolongation de ses pouvoirs.
10 heures
Votre rhume me désole. Pour quelques minutes dans mon cabinet ? Je vous en prie soignez-vous comme je vous soignerais. Il est impossible qu'avec du soin et ce soleil, le rhume soit long. Je ne trouve rien, dans mes journaux et je n’ai que des lettres insignifiantes. Partout l'impression de la mort du Roi est vive et bonne. Si les débats de l'Assemblée ne gâtent pas cela, on fera un grand pas vers le salut. Adieu, Adieu.
Je suis bien aise que vous ayez eu une bonne lettre de la grande Duchesse Olga. Vous n'aviez pas le moindre tort ; mais l’innocence ne suffit pas toujours. Adieu. G.
Mots-clés : Âge, Famille royale (France), Politique (France), Santé (Dorothée), Santé (François)
Val-Richer, Jeudi 13 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Neuf heures
Pas un mot sur la consultation de Chomel ! Voilà ce qui me déplaît de votre lettre. Est-ce que la consultation n’a pas eu lieu ? Duchâtel m'écrit que le voyage de St Léonard est pressant, et me propose de le faire avec moi. Cela me convient. Il est libre à partir de samedi, et il voudrait partir dimanche soir. Je lui réponds que j'aimerais beaucoup mieux lundi. Enfin, je serai là dimanche matin. Nous verrons. Je vous trouve en effet bien en train de lord Palmerston. Dieu vous exauce ! Certainement, si rien n’est fini lundi sa situation sera bien mauvaise. Mais il ne dépend pas de Lahitte que rien ne soit fini. Palmerston n'a qu'à tout céder.
Le discours du Président à St Quentin ne m’a point surpris, ni son succès. Il ressemble à tous ses autres discours. Bonnes intentions vagues et contradictoires. Le vrai et le faux, le pour et le contre le gentleman et le philanthrope, un peu socialiste, l’ordre et la porte entrouverte au désordre. Et c'est à cause de cela que le Président réussit souvent en parlant. L’état général des esprits lui ressemble eux aussi, ils voudraient tout cela à la fois. Changarnier a raison de ne pas faire de bruit. Voilà Emile de Girardin enfin élu. Ce sera dans l’assemblée, un ennui pour le gouvernement et quelques fois un embarras. Il prêtera souvent à la Montagne de l’esprit et de l'audace. Ce n'est nullepart ni jamais un homme indifférent.
Vous ne vous intéressez surement pas à Cuba. Moi, je suis charmé que la piraterie américaine ait échoué honteusement. Je souhaite toutes sortes de bien à l’Espagne et au général Narvaez. Adieu. J’ai tant de choses à vous dire dimanche que je ne vois rien à vous dire aujourd’hui. Je vous écrirai encore demain. Je suis seul absolument seul aujourd’hui dans le Val Richer. Pauline est partie ce matin pour Trouville avec son mari. Henriette arrive ce soir ici avec le sien. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 14 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je serai donc à Paris le 24, à Londres le 27 ; à Weybridge pour le service le 26, et probablement à Claremont le 27, pour la conversation. Si je resterai à Londres un ou deux jours, c’est ce que je ne sais pas. Je me refuse absolument aux invitations Lord Aberdeen, Sir John Boileau, Croker & & mais peut-être Croker et Sir John Boileau viendront à Londres pour me voir. En tout cas je compte partir de Londres le 29 ou le 30, et être par conséquent à Paris, le 30 ou le 31. Vous voyez que mes plans cadrent avec les vôtres. Je vous prie seulement d'être à Paris le 31 août ou le 1er septembre au plus tard, car j'aurai bien peu de jours à y rester et je n'en veux rien perdre. Je suis entré très activement, dans plusieurs travaux qui ont quelque importance que je veux avoir terminé avant de rentrer à Paris cet automne et qui me laissent peu de liberté.
Je n'ai trouvé les choses, ni si changées, ni si aggravées que vous l’avait écrit Duchâtel. L’intrigue Joinville avance peu, quoique fort active. Les pauvres étourderies du Prince lui-même tombent à terre presque aussitôt que commises. Sauf à recommencer. Les questions qui s’agitent et les événements qui se préparent sont trop gros pour que tout ce petit mouvement y fasse ou y change grand chose. Ce qu’on a gagné, par le progrès de l'union désireuse et réelle entre les deux partis conservateurs est à mon avis bien plus important que les incidents dont on se préoccupe ne sont fâcheux. Voilà la part de mon optimisme. Deux sortes de gens ont raison d'être tristes, des gens difficiles et les gens pressés ; rien de grandement bon ne se fera, ou du moins ne se fera bientôt. Nous avons encore je ne sais combien de sottises à traverser et de sots à user. Ce sera probablement contre ce qui existe aujourd’hui qu’ils s’useront. Quand la France, sera sortie de cet abominable bourbier on trouvera qu'après le malheur d’y être tombée, et tombée par sa faute elle y a eu du bonheur et qu’elle s'en est tiré à bon marché. La candidature Joinville, et la proposition Creton, voilà les embarras réels du moment. Le second fournira peut-être un moyen de sortir du premier.
J’ai été parfaitement content de Berryer. Il n’a qu’une idée fixe, l’élection de l'Assemblée future. C’est à ce but que tout doit être subordonné. Et heureusement, le gros du parti le comprend. Les dissidents même, très peu nombreux commencent à s'inquiéter de l'explosion de leur dissidence et à chercher quelque moyen de boucher le petit trou qu’ils ont fait. M. de Falloux, très sensé et très ferme, mais de nouveau souffrant, est parti pour aller rejoindre sa femme à Nice. Le Président a causé avec Kisseleff, le jour de sa fête à St Cloud, et lui a tenu un langage fort raisonnable. Décidé à se croiser les bras et à attendre que le pays agisse. Il y a toujours des impatients amateurs de Coup d'Etat. Il est peu probable, très peu, qu’ils prévalent quoiqu’on ne soit peut-être pas fâché que le public en ait toujours un peu peur. Cela le rend plus modeste, et plus, empressé à faire lui-même ce qui dispense des coups d'État. Le public s’inquiète d'une circonstance. Un commandement donné, à Paris, au général St Arnauld, le vainqueur de la Kabylie, le plus entreprenant et le plus dévoué des nouveaux généraux africains bien plus capable d’un coup que le Général Magnan de Paris à Londres.
Un de mes amis anglais whig sensé et fort au courant m’écrit : " Lord John has made a promise, a very rash one, it seems to me of a new reform-bill ; and whether, it succeeds or fails, it will not leave us where it founds. I breakfasted this morning with Lord Lansdowne, and tried to find out whether the government had any fixed plan. But I could learn nothing, and I suspect that they have not yet, even seriously considered what they mean to propose. My suspicion is that what they ultimately do propose will be too strong for the Tories and too weak for the radicals ; that they will be defeated by a Tory-radical opposition, and go out ; that a Tory government will come in and reign for 4 or 5 years, and that then the whigs will come back, with a larger or at least a more,(deux mots que je n’ai jamais pu lire).... bill. " Cela me paraît de l'English good sense. Adieu.
J'adresse toujours à Francfort Vous ne m'avez rien dit contre. Votre tête me déplait bien. J’ai peine à croire que vous ne sauviez pas votre fils Alexandre. Ce ne serait pas la peine de prendre tant de peine pour avoir si peu de crédit. Adieu, adieu G
Val-Richer, Jeudi 16 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci sera ou très gros, ou très insignifiant. Si le Président, n'importe sous quel nom propre, a les Montagnards avec lui pour l'abrogation de la loi du 31 mai, le parti de l’ordre devient opposition, et nous entrons dans les grandes aventures. Si le Président modifie la loi du 31 mai avec l'aveu d’une partie considérable des hommes d’ordre et sans satisfaire la Montagne, c’est une oscillation comme tant d'autres. Mes pronostics sont plutôt de ce côté.
L’appel de M. Billault serait assez grave ; il a de la faconde, de la témérité, de l'étourderie, de la ruse. Il peut aller à tout, tantôt le sachant, tantôt sans le savoir. Autour de moi le public s'étonne et s’inquiète un peu, sans agitation. Il est très vrai que les rouges se remuent beaucoup, même ici. Ils viennent de créer, dans le département, un petit journal hebdomadaire. Ce suffrage universel, qu’ils font colporter et répandre par paquets, même au fond des campagnes. Cela n'est pas sans action sur la multitude, même honnête, qui prend plaisir à se voir rechercher et à se croire importante.
Le parti de l'ordre prend beaucoup moins de peine, et se croit peut-être trop sûr de son fait. Certainement, les partis conservateurs de l’Assemblée se sont misérablement conduits n’osant jamais faire ni seulement dire ce qu'ils croyaient non seulement bon, mais nécessaire, et ayant peur de toucher, au seul instrument dont ils pussent se servir, le Président. Ils se sont annulés eux-mêmes pour ne pas le grandir. Par défaut de résolution ; surtout par complaisance pour leur propre fantaisie et leur humeur. Personne en a voulu se contrarier soi-même, ni contrarier ses amis. Aujourd'hui ma crainte est double ; et le parti de l’ordre et le président courent grand risque au jeu qui se joue. Les joueurs enragés peuvent espérer quelque coup heureux ; mais les anarchistes seuls ont de quoi être vraiment contents.
Je vais aujourd'hui à Lisieux pour un grand déjeuner. Je verrai là l'effet de tout ceci sur le gros public. Mon petit journal jaune me dit qu'on dit que Cartier reste. Si cela arrive, vous vous souviendrez que j'y avais pensé. Je ne sais pas si ce serait bon pour M. Carlier lui-même ; ce serait certainement bon pour nous. Il ne nous livrera pas à la Montagne. C’est un homme intelligent et résolu. Il peut avoir envie de tenter, à tout risque, une grande fortune politique, à la fois au service du suffrage universel et contre la Montagne. Dans des temps comme celui-ci, ce sont ces hommes-là qui font avancer quelque fois dénouent les situations.
M. Véron m'étonne un peu. Il était très prudent. Se mettre dans la barque d'Emile Girardin et de M. de Lamartine ! Il ne peut pas se flatter que ce sera lui qui la conduira. Quand la prudence, et la vanité sont aux prises, on ne sait jamais. Je vais faire ma toilette en attendant la poste.
Onze heures
Quel ennui que votre bile ! Je voudrais être à demain pour vous savoir mieux. Adieu, Adieu. Je pars pour Lisieux. G.
Val-Richer, Jeudi 17 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Le temps est splendide. J'ouvre mes fenêtres sous le plus pur ciel, et le plus brillant soleil que j’aie jamais vus en Normandie. N'étaient les vapeurs qui roulent en fuyant à l’horizon, je croirais un col et un soleil du midi. Mais je n'y crois pas. L’impression chaude et transparente de l’air du midi est restée trop vive dans ma mémoire. Je viens d'allumer mon feu.
Après la nature, l'histoire. Celle-ci est bien ancienne. Pourquoi êtes-vous si loin ? Le discours de M. de Falloux est excellent, spirituel, sensé, honnête, élevé, élégant. Je comprends que l’assemblée soit restée froide. Ni l’éloquence n'est puissante, ni la politique pratique. Rien qui satisfasse les intérêts, ni qui remue les armes. C'est, pour moitié, la faute de la situation quand il n’y a rien à faire, il n’y a rien à dire. Pourtant on pouvait certainement exciter plus fortement l’inquiétude et faire entrevoir plus distinctement l'avenir. Le Général Cavaignac m'a intéressé et ennuyé. Tout ce qu’il dit est nouveau pour lui et vieux pour moi. Il découvre des théories usées. Mais on sent un homme sous les guenilles un homme fortement convaincu et qui se battra pour la République. Plus l'avenir s'éloigne, plus il m'inquiète. La République ne peut pas vivre, et ne se laissera pas mourir. Je suis dans un état d’esprit très désagréable. Je crois fermement à un certain avenir et je ne vois pas du tout comment il sortira du présent. Comme un homme sûr d'arriver, mais qui marcherait à travers des précipices sans voir du tout son chemin. C’est la foi absolument dénuée de science. M. de Maistre serait content de celle-là.
Je n'ai point oublié les Delmas. Je suis allé chez eux et, ne les trouvant pas j'ai laissé deux cartes p.p.c., pour qu’ils sussent bien que, s'ils ne me croyaient pas, c’est que je n'étais plus à Paris. Quand j'aurais un mauvais procédé, pour vous, vous ou moi, nous irons le dire à Rome. Je vous laisserai le choix. Je n’ai pas dîné le Jeudi 10, chez les Hatzfeldt parce que j’avais un engagement antérieur chez Mad. Lenormant, engagement auquel j'ai manqué parce que j'étais encore souffrant. J’ai passé moi-même et mis des cartes, la veille de mon départ, chez Hatzfeldt, Hübner, Kisseleff et Antonini. On m'a dit que ce dernier était malade.
10 heures
Voilà des visites qui m'arrivent avec la poste. Je n'ai que le temps de fermer mes lettres. Mon bulletin de l'assemblée porte : “ Berryer est depuis quelques minutes à la tribune. Il signale le double danger de l’anarchie, et du Bonapartisme. Il devient magnifique, admirable. Il n’a jamais été plus beau, aussi beau. Mais il faut que je ferme ma lettre. La nomination du Général Magnan est très mal accueillie.” Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 17 octobre octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le temps est étrangement beau et doux. Un soleil d’été sur une nature, d’automne. Je me suis promené hier deux heures. J’avais trop chaud. Vous auriez beaucoup joui de cet avis-là. Il vaut mieux que celui du bois de Boulogne. Mais dans quinze jours nous serons en hiver. Il ne faut pas s’attacher à ce soleil. Je n’y penserai pas quand je serai avec vous. Mais, hors ce qui me plaît par dessus tout, la liberté, le repos et les spectacles de la campagne, me plaisent maintenant plus que le reste. La nature a du bon sens et de la grandeur.
10 heures
Kisselef a tort d'être si troublé. Certainement, s’il y a guerre en Allemagne (ce que je ne crois toujours pas), il y aura en France à l'Elysée et dans les journaux, des velléités de s'en mêler. Des velléités sincères, et des velléités hypocrites. Le public, le vrai public n'en voudra pas. L'assemblée sera comme le public ; le ministère comme l’assemblée ; et on ne s'en mêlera pas. Et l'Elysée sera fort aise qu’on ne veuille pas s'en mêler, et qu’on ait l’air de croire qu’il voulait s'en mêler. L'ancienne politique subsistera. Il n’y a plus en France, de gouvernement capable de la changer, ni de l'avouer. On en voudra le profit, en en éludant la responsabilité. Ce sera le Général Lahitte qui en aura l'honneur.
A propos du Général Lahitte, je vois dans tous les journaux qu'on veut le nommer à l’assemblée pour le département du Nord, et dans la Gazette de France qu'il y a, dans ce département, des gens, conservateurs, et légitimistes, qui pensent aussi à moi. Je n'en ai point entendu parler, et je n’ai pas besoin de vous dire que je n'en veux pas entendre parler. Le Moment n’est pas venu, et on a grande raison de porter le Général Lahitte. Je lui donne ma voix.
L'Indépendance Belge m'amuse. Vous savez mon billet à Morny. Je prévoyais bien qu’on en ferait un peu de bruit. A la bonne heure. Je ne l’ai pas écrit parce que le bruit, mais quoique. Un avis très décidé, et dit très haut, et une entière liberté d’attitude et de langage quotidien, c'est mon parti pris. Je suis plus indépendant que l'Indépendance Belge. La fusion de l'autre côté du fossé ; le Président tant qu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu’on ne sait pas sauter le fossé; voilà mon avis, et je ne m’en gênerai pas de le dire, et de le pratiquer.
Ecrivez-moi à Broglie, (au château de Broglie, par Broglie. Eure) lundi, mardi et mercredi. Je n'en partirai que jeudi après le déjeuner. Le courrier y arrive à 9 heures du matin. J'y vais seul. Le médecin de Pauline ne veut pas qu'elle remue au delà du strict nécessaire. Entre nous, mes deux filles. sont grosses. Elles ne le disent pas encore. Je persiste à croire que Mad. Rothschild a raison, et que le Général d'Hautpoul s'en ira. Adieu, Adieu G.
Val-Richer, Jeudi 18 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
C'est aussi l’heure où vous vous levez, me dites-vous. Que faites-vous à cette heure-ci, aujourd’hui ? Quand vous vous le rappellerez, au moment où vous recevrez ma lettre, la vôtre ne me le dirait que dans huit jours. On aura beau inventer les chemins de fer, les ballons ; on ne supprimera pas l'absence. Je n'ai guère plus de nouveau à vous envoyer d’ici que vous d'Ems à moi.
J’ai fait hier mes visites à Lisieux, par la pluie. Je suis frappé de ce qu’il y a de tranquillité et de ce qui revient de prospérité matérielle dans le pays. Cette société est aussi habile à se défendre du mal qu’inhabile à conserver le bien. Il est vrai qu'en fait de prospérité comme de sécurité, elle se contente à bon marché. Toutes ces existences sont très petites pour la richesse comme pour l’esprit, et elles se soucient peu de devenir grandes, sous l'un ou sous l'autre rapport. Quand on a gagné assez d’argent pour vivre sans rien faire dans sa petite maison de ville ou de campagne, on se trouve assez riche. Quand on sait faire ses comptes et lire son journal, on se trouve assez spirituel. Jamais l’ambition n'a été si courte et si basse. Les proverbes ont toujours raison : on est punis par où l'on a pêché.
Voici où ce mot puni me mène tout à coup à M. de Lamartine. Bien des gens le trouvent bien puni. Je trouve qu’il ne le sera jamais assez. Vous vous rappelez l’article de Croker dans le Quarterly review sur l’évasion du Roi après Février, et la réponse qu’y a faite M. de Lamartine et dans laquelle il a raconté qu’il avait voulu, comme gouvernement provisoire, faire sortir le Roi en sûreté, qu’il était allé trouver M. de Montalivet, qu’il lui avait demandé où était le Roi, et lui avait offert, sur son honneur, de le faire conduire hors de France par quatre commissaires qu’il lui avait nommés, M. Ferdinand de Lasteyrie, M. Oscar de Lafayette, et deux de ses amis personnels, M. de Champeaux ancien officier dans la garde royale, et M. d'Argaud, attaché aux Affaires étrangères. Croker ne lâche pas prise aisément ; il est allé au fond de tous ces dire ; il a questionné le Roi, et par le Roi, M. de Montalivet. Il publie dans le nouveau n° du Quarterly review une réponse à la réponse de M. de Lamartine, et, il affirme que les quatre commissaires proposés par M. de Lamartine à M. de Montativet étaient, Lasteyrie et Lafayette, oui, mais au lieu des deux derniers nommés dans la réponse, MM. Flocon et Albert, [ouvriers] ! Peut-on concevoir un tel mensonge ? Car entre les deux assertions, je crois à celle de Montalivet. M. de Lamartine s’en tirera par l'absence. Il est à Smyrne. Le Quaterly review ne va pas là.
Voilà un petit désagrément pour Palmerston. C'est encore la Duchesse de Montpensier qui hérite du trône d’Espagne. Si la Reine d'Espagne mourait demain, il aurait de la peine, malgré ses 46 voix de majorité, à faire faire la guerre par son pays pour empêcher l'Infante de succéder. Car elle succéderait en Espagne sans difficulté ; les progressistes seraient les premiers à la reconnaître et Narvaez est toujours là.
9 heures.
Voilà votre lettre. Je n’en ai absolument aucune autre. Quand j’ai celle-là, j’attends les autres patiemment. Comment ne savez-vous pas encore que j’ai été cinq jours sans lettre ? Nous sommes bien loin. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 19 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait vingt lieues hier pour ne trouver qu'une seule des personnes que j’allais chercher. Peu m'importe ; ma visite est faite. C’était une visite, non seulement de convenance mais de conscience. Les Banneville ont été très bien pour moi dans les plus mauvais jours quand beaucoup d'autres étaient mal, ou tremblaient d'avoir l’air d'être bien. Je suis très fidèle à ces souvenirs. J’ai rencontré dans ma vie beaucoup d’ingrats et de lâches, mois toujours aussi quelques cœurs reconnaissants et courageux ; et quelques uns de ceux-là suffisent pour faire oublier beaucoup des autres et sauver l'honneur de l'humanité.
Je comprends qu’on s'inquiète à Berlin de Cassel et de Darmstadt ; mais j'ai quelque penchant à croire qu’on fait autre chose que de s'en inquiéter. Ces désordres des petits états Allemands, cette incurable impuissance ou sottise des petits Princes, servent au fond les vues de la Prusse et poussent vers elle les populations. L’ambition prussienne est craintive, mais obstinée. Le Gouvernement de Berlin a peur pour lui-même, mais sans cesser de convoiter le bien d'autrui. Je ne crois pas qu’il excite les insurrections badoises, hessoises ou autres, mais je doute qu'il s'en afflige à tout prendre, il en espère plus qu’il n’en craint.
Il m’est venu ces jours-ci assez du monde de mes environs ; mais je n'ai rien à vous en dire. Grande stagnation des esprits comme des faits. Grande prospérité de l’industrie et du commerce qui ne demandent que le statu quo. Grande détresse de l'agriculture qui voudrait bien un changement, mais qui n'ira point au devant. Les légitimistes voient cela ; ils ont le sentiment que eux seuls ils ne peuvent rien ; je ne dis pas seulement rien faire mais rien tenter ; quand on le leur dit, ils en conviennent sur le champ. Et pourtant ils parlent, ils s'agitent comme s'ils pouvaient et faisaient quelque chose. Cela leur fait grand mal dans le pays ; leur agitation incommode ; leurs paroles déplaisent. C’est un grand art que de savoir se tenir tranquille et se taire. Les partis n’ont jamais cet art là ; surtout les partis qui sont à la fois nobles et faibles. Ils se remuent et bavardent pour oublier un peu leur impuissance.
Soyez tranquille ; je n'oublierai point que c'est moi qui ai au la première idée de René de Fleischmann, et qui ai pris l'initiative. J’ai envie qu’en fin de compte la chose réussisse. Mais je ne puis ni ne veux forcer la main aux intéressés. Quant à la dot, je vous ai dit au premier moment, mais à vous seule, ce qu’il en pourrait être dans l'avenir avec quelques bonnes chances de famille ; mais quand il a été question d'en parler à d'autres, j'ai été très précis ; 10,000 liv. de rente en se mariant, et 5 ou 6000 de plus assurées. Cela est très exact.
10 heures
Merci de votre soin à recueillir pour moi toutes les nouvelles, grandes ou petites, tristes ou gaies. Je serais bien curieux de savoir si Thiers à réellement passé par Paris pour aller à Richmond. Je n’y crois pas. Ce serait, de la part de Richmond le symptôme d'une politique plus à part et plus hardie, que je ne le suppose. Je crois au travail constant, mais hésitant, embarrassé, timide et ménageant tous les avenirs. Adieu, adieu., adieu.
Ma fille Pauline ne sera à Paris qu'après-demain matin samedi. Elle en partira dimanche soir. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 21 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai sur le cœur votre chagrin, je ne veux pas dire votre injustice de Vendredi dernier 15. Ne croyez donc jamais qu'aucune dissipation comme vous dîtes, ni aucune affaire puissent me détourner de penser à vous. Je ne serai content que lorsque je saurai que vous avez eu ma lettre. J'espère bien le savoir demain.
Duchâtel m'écrit qu’il part pour Londres, hier soir. J’irai probablement le retrouver chez Grillon, où il va se loger. Il me dit : " Paris est désert. Les renseignements de tous les points de l’horizon s'accordent à dire que la candidature du Prince de Joinville prend assez vivement. On assure que le président et ses ministres en sont inquiets. Il se pourrait que ce coup d'éperon déterminât le président à agir. Le mouvement que les Montagnards se donnent peut lui faire beau jeu. "
Je ne crois pas beaucoup aux inquiétudes du Président sur la candidature du Prince de Joinville, ni à ses velléités d’agir. A en juger par ce qui m'entoure et ce qui me revient le travail pour cette candidature est plus vif qu’efficace ; il créera une petite scission dans le grand parti conservateur ; pas grand chose de plus. Sur les côtes seulement, la faveur est réelle pour le prince de Joinville. Dans les terres, les campagnes restent pour Louis Napoléon. Si, l’intrigue pour créer, au Prince de Joinville, un parti dans la Montagne réussissait, c’est alors que commencerait le danger. Il ne paraît pas que jusqu'ici, l’intrigue réussisse. Les Montagnards hésitent toujours entre Ledru Rollin et Carnot.
Autre sorte de nouvelles que me donne Duchâtel. " Les Régentistes vont à Londres pour le 26. Rémusat est parti hier. A propos de Rémusat, saviez-vous qu’il vivait intimement avec une Mad. Fagnères l'ancienne maîtresse de Martin du Nord ? Je devais aller aujourd'hui à Champlâtreux. M. Molé me fait écrire qu'il est au lit avec la fièvre. " Vous avez tout ce que j'ai.
J’ai un mot du duc de Noailles, de Maintenon. Il regrette fort de ne m'avoir pas trouvé à Paris. Je lui ai écrit que j'y passerais le 24 ; mais il n’avait pas encore reçu ma lettre. Il attend impatiemment votre retour. Il y a, dans votre lettre du 13, une parole qui me plaît, parmi d'autres. Vous me dites que vous aurez fini dans dix jours, c’est-à-dire le 23 ou le 24. Vous partiriez donc le 25 ou le 26, et vous seriez à Paris le 28 ou le 29. Ce serait à merveille. Je me crois sûr que je partirai de Londres le 29 pour être à Paris le 30.
Je suis fâché que vous ne receviez pas la feuille jaune, le courrier de Paris. Vous y trouveriez sur les auteurs des Correspondances de l’Indépendance Belge et sur les dessous de cartes de ces correspondances, des détails qui vous amuseraient. La coterie Régentiste se donne beaucoup de mouvement de ce côté là. Je ne vois toujours pas clair sans Changarnier. Il a bien de l'humeur de la candidature du Prince de Joinville ; mais je le trouve bien timide à la témoigner.
11 heures
Enfin vous avez ma lettre. Je maudis comme vous les postes allemandes, quoique j'en aie moins souffert que vous. Ce ne sont pas elles qui reçoivent vos lettres. Ce mauvais effet d'Ems me contrarie beaucoup.
Val-Richer, Jeudi 23 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voulais rentrer à Paris du 2 au 5 novembre. Ma réponse à M. de Montalembert exige, absolument huit jours de plus. Je veux l'apporter à peu près terminée, et il n'y a pas moyen pour moi de travailler un peu de suite à Paris surtout quand j’y arrive. Je ne rentrerais donc que du 10 au 12. Et Falaise me fait perdre deux jours. Ce retard me déplaît beaucoup, et à vous, j'espère autant qu'à moi. Bien à cause de vous seule, et de mon plaisir à me retrouver auprès de vous, car je ne me sens aucun empressement à rentrer dans cette atmosphère d'activité bavarde et vaine. La solitude rend sérieux et difficile. Je le deviens tous les jours davantage. D'autant plus que je vois clairement, pour le bon parti, une bonne conduite à tenir, je ne dis pas qui le conduirait promptement à son but mais qui certainement, l’y ferait marcher et qui en attendant, le lierait intimement au pays de l'aveu et de l’appui duquel il ne peut se passer. Mais cette bonne conduite, on ne la tiendra pas ; elle exige trop de bon sens de patience, et de sacrifice des fantaisies personnelles. Connaissez-vous un pire ennui que de voir faire et défaire soi-même de compagnie, des fautes qui déplaisent autant qu'elles nuiront, et de se donner beaucoup de mouvement pour aboutir, le sachant, à beaucoup d'impuissance ?
Le discours de M. de Montalembert est un ouvrage, un long ouvrage beaucoup trop bong, excellent au fond, très hardi, et souvent très beau dans la forme. Ni l'Académie ni son public n’ont jamais rien entendu de si hautement et brutalement anti-révolutionnaire. La vérité y abonde ; la mesure et le tact y manquent. Ceci entre nous. C’est toujours l'homme qui, selon le dire de M. Doudan, commence toujours par les paroles : " Soit dit pour vous offenser " Certainement, ni la Commission de l'Académie, ni l'Académie elle-même, si on est obligé de recourir à elle avant la séance, ne laisseront passer ce discours tel qu'il est. Je m'attends à une vive, controverse intérieure et antérieure. On demandera à M. de Montalembert beaucoup de changements, et le changement d'abrègement sont indispensables, pour son propre succès J'appuierai auprès de lui ces changements-là car je désire son succès autant que lui-même ; d'abord parce qu'il le mérite et aussi parce que son succès sera bon pour la bonne cause Quant au fond des choses, je défendrai son discours contre les gens à qui il déplaira et contre ceux qui en auront peur, sans qu’il leur déplaise. Ne parlez de ceci, je vous prie qu'à des amis de M. de Montalembert ; je ne veux pas qu’il puisse me reprocher d'avoir ébruité d'avant son discours. Mais si vous voyez son beau frère Menode, il n’y à pas de mal qu’il sache un peu mon impression et ma prévoyance.
Berryer a raison de se présenter pour l'Académie. Je crois pleinement à son succès. Cependant il faudra en prendre soin. Bien des gens croiront faire par là de la politique et en auront peur. Le Gouvernement qui, à la vérité, n'a à peu près aucune influence dans l’Académie, lui sera certainement fort contraire. S'est-il assuré de ce que fera Thiers ?
Si vous voyez Vitet soyez assez bonne pour lui demander de ma part des nouvelles de Duchâtel. Il m’a écrit. Je lui ai répondu au moment de la mort de ma petite-fille, depuis, je n'ai rien reçu de lui. Je pense pourtant que ma lettre lui est arrivée.
Onze heures
Il ne faut pas de défaillance et je suppose que Chomel n'a pas compté pour longtemps sur l'artichaut strict. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 25 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
La poste me traite ici cette année avec une grande courtoisie ; elle envoie un facteur au Val Richer exprès pour moi. Il vient directement, chargé de mes seules lettres et attend quatre heures avant de repartir. Comme au temps de ma puissance. Cette faveur a été sans doute l'objet de quelque hésitation, car deux ou trois fois, elle a été suspendue. Je suis rentré dans la foule ; le facteur faisait une tournée de canton, arrivait ici tard et repartait presque aussitôt. Il paraît qu’on s'est enfin tout à fait décidé pour la bonne grâce. Le facteur me le dit. J’en suis fort aise, et je témoignerai de quelque façon au directeur général que j’y suis sensible.
On annonce la convocation des Conseils généraux pour la fin d’août, quinze jours ou trois semaines après le départ de l'Assemblée. Ils se préparent fort tranquillement. C’est évidem ment une institution plus enracinée dans le pays que beaucoup d'autres, les propriétaires y ont goût et confiance, sans distinction de partis. Si les Conseils généraux exprimaient vivement et généralement quelque voeu, faisaient quelque démarche cela aurait assez d'autorité. Mais ils ne feront, cette année, rien de semblable ; point d'impulsion forte ni générale, point de but précis. Ils resteront à peu près, dans la même ornière que l’assemblée et le gouvernement. Il n'en résultera rien.
Je suis frappé de l’ignorance où vous êtes, vivant en Allemagne, sur les affaires d'Allemagne. On y pense donc bien peu en Allemagne. Car enfin, quoique vous n'ayez à Ems personne de bien amusant, vous y avez du monde. Si vous étiez à Plombières ou à Vichy, vous entendriez bien autrement parler des affaires de France et de Paris. Les plus froids et les plus sots en seraient sans cesse occupés. Il faut qu’il y ait au delà du Rhin bien peu de public et de publicité politique. Ce qui se passe à Vienne et à Berlin mérite fort à coup sûr qu’on y regarde. Pour moi, je suis avec un vif intérêt la réorganisation de la Monarchie autrichienne et les soubresauts rusés et vains de l'ambition prussienne. Vous avez raison ; petit pays, excepté pour les savants et pour les Chambellans. Vous me ferez voir le Rhin. Je ne le verrai probablement jamais sans vous.
9 heures
Précisément aujourd’hui vous me donnez sur l'Allemagne, des renseignements intéressants. Ce que vous me dites a l’air vrai. Vous voyez que la nomination de la commission permanente est devenue tout-à-fait une affaire. Sans conséquence, comme tout aujourd'hui, mais qui excite vivement les passions ce qui se croit des passions. L’Elysée y est battu ; ce qui ne servira de rien à l'Assemblée.
Je trouve le discours de Lord Palmerston au reform Club meilleur que son discours à la Chambre des communes. Plus vif, et plus original. Je suis assez frappé qu’aucun de ses collègues ne soit allé à ce dîner. C’est probablement d'accord avec lui.
On me dit que le Vice Président des Etats-Unis, M. Fillmore est un homme très distingué, beaucoup plus distingué que le Général Taylor. Le choléra en veut aux Présidents américains. Deux en quelques années. Les rois d’Europe ont été plus ménagés.
Le petit article du Constitutionnel sur la première communion du Comte de Paris est intéressant. Mais évidemment le Roi est toujours bien faible. J’aurai un de ces jours de ses nouvelles avec détail. Adieu, adieu.
Je crois un peu que les eaux d’Ems sont un humbug. Je l’ai entendu dire. On envoie là les personnes à qui on ne veut ni bien ni mal. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 25 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma petite fille est bien malade. J’ai cru hier qu’elle ne passerait pas la journée, et je la trouve plus mal ce matin qu'hier. Elle a passé une mauvaise nuit. Je m'étonne toujours de ce qu’il y a de force dans la créature la plus faible. Pauvre petite enfant ! Entrevoir à peine le jour de la vie ! Dieu sait ce qu’elle y trouverait, si elle y restait. Sa mère a beaucoup de piété et de courage.
10 heures
Val-Richer, Jeudi 25 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Ma petite fille est morte ce matin, deux heures après que je vous avais écrit. Sans souffrance ; elle s'est éteinte, plutôt par impossibilité de vivre que par maladie, à force de soins, on lui a donné quelques mois de vie ; mais les soins n'ont pas pu davantage. Sa mère est résignée, par soumission à Dieu et par courage naturel, mais très triste ; elle soignait son enfant avec une vigilance passionnée. Je ne crois pas que cela change rien à leur projet de passer l’hiver dans le midi. C’est surtout son mari qui en a besoin.
J’ai eu ce matin vos deux lettres. Certainement tout cela est de la pitoyable conduite. Les légitimistes n'avaient pas et n'ont pas autre chose à faire que de soutenir le président tant qu'ils ne peuvent pas avoir la Monarchie par la fusion, et non seulement de le faire, mais de dire tout haut pourquoi ils le font. Mais ils veulent suivre leurs fantaisies comme s'ils étaient assez forts pour les faire réussir. Tous les partis en France sont à la fois impuissants et intraitables. C’est un spectacle ridicule. Quelque grosse sottise passera à travers tout cela, et elle aura son temps même son temps de triomphe comme toutes les sottises. Puis elle tombera, en ayant aggravé le mal général.
Je suis très triste et très décidé à ne mettre la main dans aucune sottise. Je suis tombé. Si je ne puis pas me relever à ma satisfaction, je resterai à la place où je suis tombé.
Vous ne lisez pas le Messager. Celui qui m'est arrivé ce matin contient un grand article évidemment inspiré par Thiers sur les conférences de Champlâtreux. J'en suis toujours. L'article a l’air fait pour la présidence de Changarnier. Au fond, il laisse le choix entre le Prince de Joinville et Changarnier. Et ce choix restera ouvert jusqu'au dernier moment. Changarnier a son parti pris de n'en prendre aucun et d'être, soit en premier, soit en second, le restaurateur de n'importe laquelle des deux monarchies.
Le propos de M. Carlier, sur de nouvelles élections m'étonne. Ils ont, ce me semble plus à redouter la proposition Créton, et le vote des lois pénales contre la réélection que des élections nouvelles. Mais ils savent sans doute mieux que moi où ils en sont.
Vendredi 26 7 heures
Je me lève. La plus petite et la plus obscure mort est solennelle. Tant que cette pauvre enfant est là, toute la maison lui appartient, et n'est que son tombeau. J’ai écrit à Caen pour faire venir le Pasteur Prostestant qui réside là. Nous n'en avons pas de plus rapproché. Il arrivera ce soir ou demain matin. L’enterrement se fera demain. C’est un grand isolement, et quelques fois un grand embarras, que de n'être pas de la religion générale du pays qu'on habite. Je n’ai nul embarras ; tout mon village, y compris le Curé, est très bienveillant pour moi et se prête avec coeur à tout. Mais l'isolement subsiste toujours.
Onze heures
Votre lettre est intéressante. Et le trio a dû l'être. Vous avez bien raison de dire tout haut votre sentiment. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amis et relations, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Femme (maternité), Femme (politique), Mort, Pensée politique et sociale, Politique (Analyse), Politique (France), Portrait, Posture politique, Presse, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Religion, Réseau social et politique, Santé (enfants Guizot)
Val-Richer, Jeudi 26 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
On s’apercevra, je crois bientôt qu’on a fait une bévue en forçant les Journalistes, à signer leurs articles. On leur aura donné plus de prétentions et d’importance en leur donnant plus d'humeur. Je dis les journalistes, et non pas les journaux. Sous l’Ancien régime, on ne connaissait que le journal, et non pas les journalistes. C'était le journal qui avait de l'importance, et non pas ses rédacteurs. On aura changé cela au profit des rédacteurs, aux dépens du journal et du public aussi qui aura plusieurs prétentions à satisfaire et plusieurs fortunes à faire au lieu d’une. En Angleterre, les journaux ont de l'importance les journalistes point. On gagnera bien peu de chose par le peu d’embarras, et de crainte qu'on impose aux journalistes, en les obligeant de signer. L’ambition, la vanité et l'habitude auront bientôt surmonté cela. On perdra bien davantage en appelant aux honneurs du théâtre des gens qui vivaient dans les coulisses. Mesure de haine et d'humeur, bonne pour satisfaire la haine et l’humeur inintelligente et imprévoyante hors de là. C'est l’impression qui m’a frappé hier, en lisant mes journaux signés pour la première fois.
Autre raison. Quand les rédacteurs ne signent pas, l'autorité appartient au propriétaire qui a la responsabilité morale du journal. Quand les rédacteurs signent, une partie de l'autorité va à eux avec la responsabilité, c’est-à-dire que l'influence passe de l’esprit de propriété à l’esprit de vanité.
Il me revient que le président est décidé à fondre la cloche l’hiver prochain, c’est-à-dire sa cloche. Il demandera formellement à l'Assemblée la prorogation de ses pouvoirs avec la révision, de la Constitution. Si l’assemblée la lui refuse il ira seul devant le suffrage universel, vraiment universel. Il est décidé à durer, à durer tant qu’il pourra à faire tout pour durer. Je le comprends ; mais je crois qu’il se tromperait si pour durer il lançait lui-même le pays dans une secousse. Il pourrait se tromper beaucoup sur le résultat. Le pays s'en prendra de la secousse dont il ne veut pas à celui qui en aura pris l’initiative, et il la lui fera payer. La force du président est précisément de mettre le pays à l'abri d’une secousse nouvelle, et des maux et ce qui est pire des incertitudes dont l'idée seule fait trembler le pays. S'il est bien conseillé, il gardera à tout prix cette position qui lui donnera au dernier moment, quand il faudra absolument fondre la cloche, plus de chances de durée qu’il n’en trouverait dans un appel prématuré, et non indispensable, au suffrage universel.
10 heures
Votre récit de la revue de Versailles est curieux. Mistriss Howard et Lady Normanby ! Rien de plus, rien de moins. C’est un peu fort.
Vous voyez bien que j’ai raison de dire que Lady Allice me plait. Je vois qu’on a pris aussi le deuil à Berlin pour le Roi Louis Philippe. A ma connaissance, il n’y a pas eu plus de notification là qu'à Vienne. Il n’y en avait point il y a trois semaines. C’est donc spontané. Ils ont raison. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 27 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà du bien petit papier. Je n'en ai pas d'autre sous la main. Vous partez donc samedi ou lundi. Paris vous manquera beaucoup. Vous venez d'avoir un mois très animé. Paris, et Londres à la fois. Et quelque chose de plus que la pure curiosité. Quoique les deux questions aient l’air réglées, au moment de votre départ, elles renaîtront bientôt. Et vous ne serez pas là pour voir et pour me dire, ni moi non plus pour vous tenir au courant. Nous nous enverrons quelques extraits, de lettres et nos réflexions.
A Paris, il va y avoir un temps d'arrêt. On votera les lois qui sont sur le tapis et le budget de 1851, puis on se prorogera. Et personne ne fera de coup d'état pendant la prorogation. Voilà ce que dit la prévoyance humaine. Londres devrait, ce semble, rester plus animé. Si le cabinet était vaincu la confusion serait grande; s'il est vainqueur, que deviendra le conflit entre les deux Chambres ? Mon pronostic est qu’il commencera par s’apaiser. Lord Stanley a été bien plus modéré que Lord John ; il n'a point jeté le gant aux Communes et à la révolution ; il a strictement limité son coup ; et peut s’arrêter sans se démentir. Mais quel effet aura produit sur la Chambre des Lord l’attaque révolutionnaire de Lord John ? Peut-elle ne pas la ressentir, et ne pas en marquer son déplaisir ? Les Anglais ont beaucoup de retenue ; ils savent faire un pas, et puis attendre. Pourtant la question d'honneur est bien engagée ; honneur de Chambre, honneur d'histoire ; le vieux parti Tory peut-il laisser ainsi traiter ses anciens triomphes ? Est-il assez transformé pour ne plus s'en soucier ? Je vous envoie mes questions et mes spéculations. Le facteur va m’apporter le résultat de Londres. Cela aura probablement duré plus d'un jour.
Dix heures
Ce sera long à Londres. Je vois que j’ai fait les frais du discours de Sir James Graham. Je consens volontiers à être de plus en plus déclaré l'adversaire et le but des coups de Lord Palmerston. Je n'y perdrai pas. Je vous voudrais cette chaleur là quand vous serez à Aix la Chapelle. Je suis convaincu que là, et quand vous prendrez des bains, elle vous serait bonne. Nous avons eu ici hier soir un violent orage. Adieu, adieu. G.
Je reçois ce matin une lettre avec l'adresse de la main de Marion. Je l'ouvre croyant qu'elle m'écrit pour me parler de vous et m'indiquer quelque chose à fair pour l'aider à aller avec vous. Pas du tout ; c’est son père qui m'écrit pour me parler du free trade, de Mad. de Staël, de Cicéron et de St Paul.
Val-Richer, Jeudi 29 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.
Je lisais, il y a quelques semaines à mes enfants un sermon de Bossuet, prêché devant Louis XIV, et qui dit : " C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui à parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort ! Voilà dit-on ce que c’est que l'homme. Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée ; ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt les noires idées ; et je puis dire que les mortels n’ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. " Ce sont de bien belles paroles et bien vraies.
Que feront la Reine et ses enfants ? Je persiste à penser que le parti digne est de laisser le corps du Roi à Claremont, toujours le centre et le lieu de la famille royale, jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à Dreux, comme il y doit être ramené, sans désordre et sans indifférence. Aujourd’hui, il y aurait l'un ou l'autre spectacle. Et toujours quelques uns des Princes à Claremont pendant que les autres voyageraient à leur gré. C’est la conduite que nous avons indiquée à St Léonard le Duc de Broglie et moi. Je viens de lui écrire pour lui demander, s’il est toujours du même avis. Que de sottises seront dites d’ici à huit jours sur ce grand mort ! Sottises de haine et sottises de bêtise.
En France et aussi en Angleterre. J'espère qu’il y aura aussi des paroles convenables. Il y a droit, et il peut supporter la vérité. J’espère aussi avoir enfin des lettres de vous. Le silence dans l'absence est insupportable.
Dix heures
Voilà vos deux lettres. J'ai vraiment envie, pour vous, que vous puissiez aller à Bade. Vous y passeriez huit jours agréablement. Qu'avez-vous besoin du Duc de Noailles ? Plaisir, je comprends, mais besoin, non. Kolb suffit pour la sureté.. Les Débats sont très convenables sur le Roi. Les paroles sont justes et le sentiment vrai. Le Constitutionnel très inconvenant. Sec et petit. On dirait qu’il parle pour sa propre justification. Quand viendra le moment où la vérité pourra être dite ? Jamais peut-être de mon vivant. Adieu, adieu.
Vous ne me dites pas de ne plus vous écrire à Schlangenbad. Je continue donc. Je serai bien aise quand je vous en saurai dehors. Votre ennui me déplaît et le froid m'inquiète. Adieu, adieu.
Prendra-t-on à Wiesbaden le deuil du Roi ? Ce serait de bien bonne paroles convenables. Il y a droit, et il peut politique comme de bien bon goût.