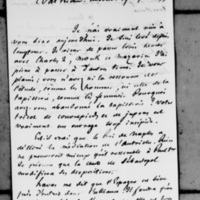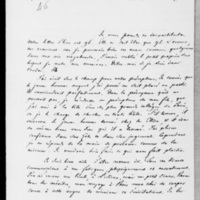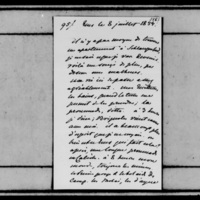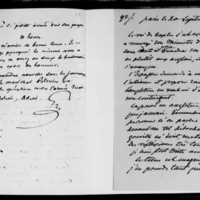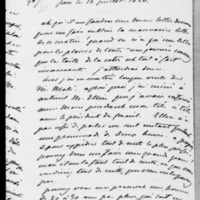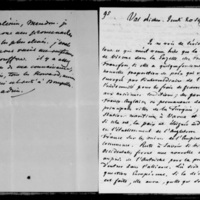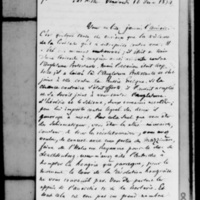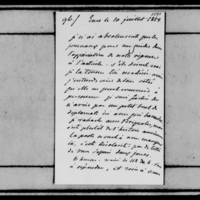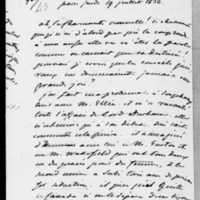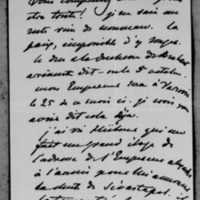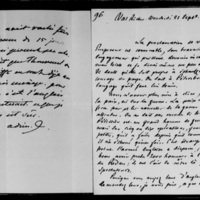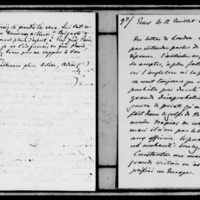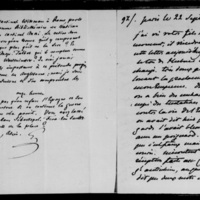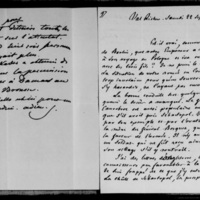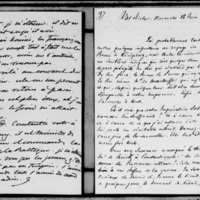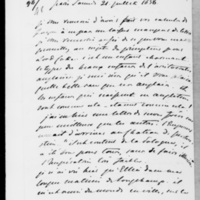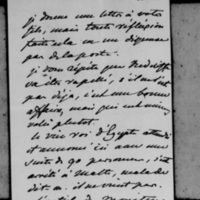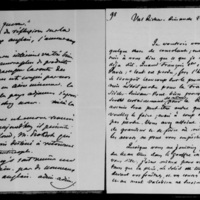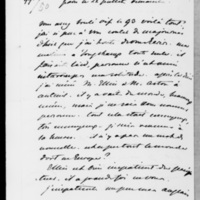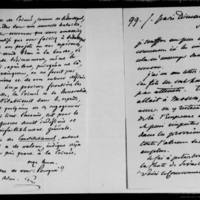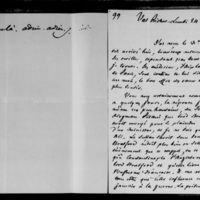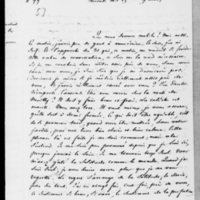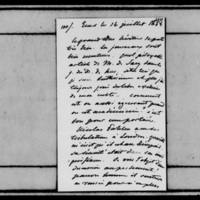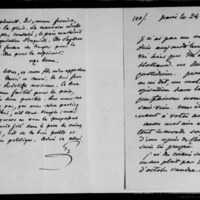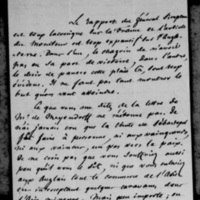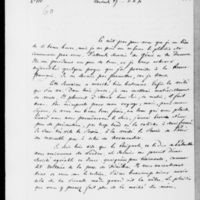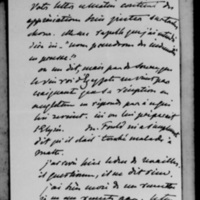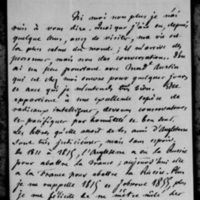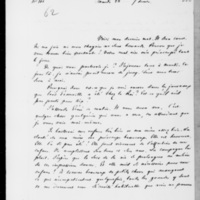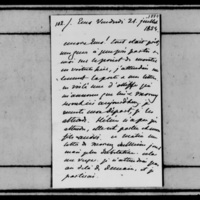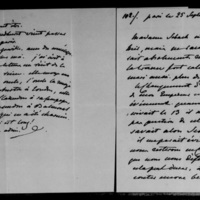Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
94. Val-Richer, Mercredi 19 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai vraiment rien à vous dire aujourd’hui. Je suis levé depuis longtemps. Je viens de passer trois heures avec Charles 2, Monk et Mazarin. J’ai peine à passer à d'autres temps. Je vous plains ; vous n'avez ni la ressource de l'étude, comme les hommes, ni celle de la tapisserie, comme les femmes. Pourquoi avez-vous abandonné la tapisserie ? Votre tricot de couvrepieds et de jupons est vraiment un ouvrage, trop insipide ?
Est-il vrai que le Roi de Naples a décliné la médiation de l’Autriche ? Rien ne prouverait mieux qu’il ressemble à Paulser Je présume que la chute de Sébastopol modifiera ses dispositions.
Havas me dit que l’Espagne est bien près d’entrer dans l'alliance. Il faudra qu’on lui donne bien de l'argent, car elle est hors d'état de payer sa petit armée sur son propre territoire.
10 heures
Votre lettre m’arrive de bonne heure. Je ne comprends pas pourquoi la mienne vous a manqué. Vous en aurez eu deux le lendemain. Je suis le plus exact des hommes. Pas la moindre nouvelle dans les journaux. Selon Havas, le maréchal Pélissier va recommencer les opérations contre l’armée russe. Adieu, Adieu. G.
94. Val Richer, Jeudi 15 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne vous ai pas écrit hier ; j’avais besoin d'avoir de vos nouvelles. Votre N°77, le premier d'Ems, m'est arrivé le cinquième jour. L’Espace et le temps, tout s’aggrave. Enfin nous voilà rentrés dans l’ordre. Quel ordre ! J’espère que le soleil quand il viendra, vous amènera à Ems un peu de société ; mais quand viendra le soleil ? Ici le temps est affreux. Depuis deux jours il tombe des torrents. Grand mal pour les récoltes et pour mes allées. Le pain a renchéri encore au dernier marché de Lisieux, et plus de la moitié des ouvriers sont sans ouvrage.
On a beau dire que la guerre n'est pas sentie, quand je regarde dans mon petit cercle, je trouve qu’elle se fait très bien sentir ; les affaires sont fort ralenties et la confiance ne reprend pas. Je vous ai dit il y a quatre jours, ce qu’on me disait du Prince Napoléon, et de ses amis à Constantinople. Le journal de Francfort n’a donc pas tort. Lord Stratford aura raison de celui-là comme des autres. S'il est orgueilleux, il doit être content. On ne parle plus, ce me semble, de sa santé. Je suis de mon mieux, sur ma carte, les opérations de la guerre, mais je ne les comprends guère plus qu'elles n'avancent. Je vois seulement que vous n’avez pas pris Kalafat, ni Silistrie, pas plus que les alliés n’ont détruit Sébastopol et Cronstadt. On dit que nous avons tort de trouver qu’on va lentement et que si nous y regardions bien, nous verrions qu’on n’a jamais été si vite. Confirmez-vous ou démentez-vous l’explication qu’on donne des derniers mouvements du Maréchal Paskévitch, et de son quartier général transporté à Yossi ? Est-ce vraiment pour se mettre en garde contre l’Autriche dont on prévoit la prochaine hostilité ?
Maurocordato refuse de faire partie du Cabinet imposé au Roi Othon. Il faudra se contenter d’un plus petit personnage grec. Quelle que soit leur opinion, ceux qui sont un peu gros ne se soucient pas d'être ministres à ce prix. Peu importe aux événements.
Montalembert part cette semaine pour Vichy. Son affaire est donc abandonnée, ou à peu près. On m'écrit que M. Molé a été appelé et M. Villemain rappelé devant le juge d’instruction. Cela a dû contrarier Molé. J’ai des nouvelles de Barante. Complètement seul, avec sa femme, au fond de son Auvergne. " J’y suis témoin de l’apathique indifférence qui d’année en année, s'assoupit davantage. On ne s’intéresse à rien ; on n'est ni content, ni mécontent ; on ne regrette point le passé ; on ne forme pas de désir pour l'avenir ; cette guerre qui commence, l'Europe qui peut la mettre en branle n'éveillent pas même la curiosité. Ces gens-là se contentent de la vue à meilleur marché que vous. Pourtant, c’est vous qui avez raison. Mais je voudrais que vous ne souffrissiez pas de votre ambition non satisfaite."
Adieu jusqu'au facteur. Où loge la Princesse Kotschoubey, car vous ne pouvez pas l'avoir à Bauernhof ? Midi Voilà votre N°78. Je me porte bien quoique j'éternue encore. Adieu, Adieu. G.
94. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous prends en inexactitude. Votre lettre d’hier est 96. Elle ne doit être que 95. L’erreur me convient car je pourrais bien en avoir commis quelqu’une dans ma vie vagabonde. J’avais oublié le petit papier sur lequel je note mes numéros. Dites-moi si je suis dans l’ordre 96. J’ai écrit sur le champ pour votre précepteur. Je crains que le jeune homme auquel j’ai pensé ne soit placé ou parti. Ill conviendrait parfaitement. Dans la prévoyance qu’il ne pourrait pas, je m’adresse au précepteur de mon fils, que j’ai mis à la tête d’un des plus grands collèges de Paris, et je le charge de chercher en toute hâte. S’il trouve, il enverra, le jeune homme trouvé chez M. Ellice, & il ira en même temps vous dire qui il a trouvé. J’ai pleine confiance dans son zèle et dans son jugement. Cependant je ne réponds de la main de personne comme de la mienne. Je voudrais bien faire ce qui vous fait plaisir.
Je suis bien aise d’être revenu ici. Tous ces dîners commençaient à me fatiguer, physiquement et moralement. J’en ai encore un lundi à Lisieux mais un petit dîner. Parmi tous ses mérites, mon voyage à Paris aura celui de couper cours à cette vogue de réunions et d’invitations. Je les voyais pleuvoir. On sera forcé de s’interrompre, & après on n’y pensera plus. La modification Tory du Cabinet anglais, me paraît toujours bien. Le renversement complet me semble pas possible, et pour la transaction, je ne la comprends guère avant que les questions d’Irlande soient vidées. Du reste, M. Ellice en sait plus que moi. Je ne crois pas tout ce que disent les gens qui savent ; mais je n’ai pas la prétention de savoir mieux qu’eux. M. de Stackelberg ne m’étonne pas du tout. Il y a certainement un tel intermédiaire, & je lui ai trouvé deux ou trois fois le ton d’un homme, qui n’est pas étranger à toute importance pratique. Si cela est, il n’a pas encore fait une bonne campagne cette année. Je ne sais si les affaires d’Isabelle avancent ; mais celles de Don Carlos reculent évidemment.
Faites votre course à Versailles, la semaine prochaine. Je ne pourrais probablement pas la faire avec vous. Le jury me retiendra souvent toute la matinée. Mais nous aurons toujours la soirée. Je suis bien aise que M. Molé soit venu vous voir. Je m’en fie à vous pour le faire revenir. Vous êtes habile pour plaire. Il me semble que voilà votre Grand Duc guéri. Les journaux le remettent en voyage. Je le plains d’avoir peur de son père. Ce qu’on vous dit de l’Empereur m’est revenu encore de plusieurs côtés. La prédiction du duc de Mortemart se vérifiera. Si votre Impératrice mourrait l’agitation serait grande parmi les Princesses à marier. L’Empereur chercherait-il bientôt.
10 heures
Voilà le vrai n° 96. Vous vous êtes corrigée, vous-même. Il est charmant ce N° là, charmant par votre joie. C’est le sort qui m’a mis du jury. Je suis sur la liste générale comme tous les électeurs. On en tire au sort un certain nombre. Le sort vient de me désigner. Il est plein d’intelligence. Soyez tranquille ; une fois à Paris, je ne vous parlerai pas de constitution. Adieu. Adieu. G.
95. Ems, Samedi 8 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il n’y a pas moyen de trouver un appartement à Schlangenbad, je ne sais ce que je vais devenir. Voilà un souci de plus, par dessus mes malheurs. Ma vie ici se passe assez agréablement. Mes écritures, les bains, quand le temps me permet de les prendre ; la promenade, ditto. A 3 heures je dîne ; Brignoles vient causer avec moi. Il a beaucoup plus d'esprit que je ne croyais. Ou bien est-ce Ems qui fait cela ? Après une longue promenade en calèche. à 8 heures mon monde, toujours les mêmes. Le Prince George & le bel aide de Camps. Les Melas, les d’Ayne Hélène et Olga. Musique superbe. Le public s’assemble sous les fenêtres pour entendre ces belles voix. De la conversation pas trop. à 10 heures tout le monde est rentré chez soi. A propos du Pce George. Je lui montre de vos lettres. Grande fête pour lui. Il a de l’esprit, il comprend, & il admire avec fureur.
Si j'en crois l’Indépendance il y aurait dans notre réponse de quoi s’arranger. Mais ni vous ni les Anglais ne le voudrez. Il me semble que l’Espagne donne de l’inquiétude à Paris. Je ne crois pas comme vous que la Reine s’en tire maintenant. Et si elle tombe, quoi ? Restauration ? Règne ? L’infante Montpensier ? La réunion au Portugal ? La république ? Rien de tout cela ne peut vous convenir. Vous finirez par aller occuper Madrid, et de quatre. On peut tout croire, & surtout on peut tout rêver quand on s'ennuie à Ems. Adieu. Adieu.
Ma santé n'est ni mieux, ni pire. Dîtes moi que vous n’éternuez plus. Je compte que le soleil vous viendra un jour. Adieu.
95. Paris, Jeudi 20 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le roi de Naples s’est exécuté, il a renvoyé son ministre de la police. vous. Sans doute il viendra son macaron on plutôt aux Anglais, et l’affaire s’arrangera. L’Espagne demande à entrer dans l’alliance et propose son contingent. L'Angleterre ne veut ici d’elle ni de son continent. La presse en Angleterre plus enragée que jamais. Démembrer la Russie personne n'ose parler de Paix ; devant un tel débordement Greville m'écrit, sur tout cela des réflexions très tristes.
Je suis fort triste aussi. Le temps est magnifique. J’en prends tant que je puis mont Valérien, Meudon. Je cherche pour mes promenades. les points les plus élevés. J’avais de l’air pour venir me renfermer dans le gouffre. Il y a assez de malades de ma connaissance ; des Anglais, tous les Howard, moins le mari qui est resté à Bruxelles. Adieu. Adieu.
95. Paris, Mercredi 18 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah qu’il me faudra une bonne lettre demain pour me faire oublier la mauvaise lettre de ce matin ! Quand on n’a qu’une lettre pour le plaisir de toute une journée convenez que la taille de la vôtre est tout à fait J’attendrai donc. inconvenante Hier j’ai eu matin longue visite de M. Molé. Après quoi j’ai mené à Auteuil M. Ellice que j’avais enfermé avec Marie pendant mon tête à tête avec le président du conseil. Ellice n’a pas cessé de parler un seul instant pendant une promenade de deux heures. A propos & pour expédier tout de suite le plus pressé, pouvez-vous me faire une grande grâce ? Mais il me le faut tout de suite, ou que vous me disiez tout de suite que vous ne le pouvez pas. Pouvez-vous me procurer un homme de 20 à 30 ans pas plus, qui soit en même temps instituteur & même (tutor and companion) d’un garçon de 15 ans. Qui ne sache pas un mot d’Anglais, qui enseigne à cet enfant, la langue française à l’entretienne d’histoire, qui ne le quitte pas un instant, qui fasse au besoin avec lui quelques courses aux environs de Paris ? Enfin un homme actif, gai & sûr. Cette tutelle ne doit durer que quatre mois, peut être un peu plus. Le petit garçon Lord Coke fils du Earl of Leicester sera établie aux environs de Paris dans une famille française, tout cela est déjà réglé, il ne manque donc que ce précepteur. Nous ne le voulons pas pédant, pas trop doctrinaire. Le but du séjour de cet enfant ici est tout simplement d’apprendre bien le français et de savoir quelque chose de plus que faire des latin verses. Si M. l’instituteur peut par dessus le marché l’entretenir dans l’habitude du Latin il n’y aurait mais cela n’est pas essentiel pas de mal, l’essentiel est le français, la surveillance et l’entrain. Si vous connaissez une espèce qui répond à ces exigence. Ayez la bonté de lui écrire pour qu’il se rende de suite à l’hôtel Bristol place Vendôme chez M. Ellice de votre part. La question pécuniaire sera largement réglée, le jeune homme est héritier d’une fortune de 50 m £ de rente ! Vous savez ce que vent dire £ ? Des guinées. Vous me ferez un grand grand plaisir. Mandez-moi aussi l’adresse du précepteur. Je me suis chargée de cette affaire croyant que par vous tout se pouvait
Il m’est impossible de vous redire tout ce que m’a dit Ellice. C’est trop. Le plus important, est le remaniement positif, selon lui, du ministère, dans quel sens ? C’est ce qui restera à voir vraisemblablement plus Torry que Whig. Il déteste Palmerston et dit que Lord Melbourne le déteste aussi. M. Molé ne l’aime pas trop. M. Molé m’a conté bien des choses qui m’intéressent. Une conspiration avortée à Varsovie. Défaites de nos troupes dans l’Abazie. L’Empereur, d’une activité qu’ on qualifie étrangement. Et puis une drôle de chose, M. de Stackelberg intermetteur des secours aux Carlistes d’Espagne. Cela quoique il l’affirme, je ne puis pas le croire. Il a l’air d’en être bien sûr. Nous avons causé de tout. Il n’a pas d’inquiétude pour l’Orient du moins pas pour le moment. Il est content de l’Angleterre sur ce point. il me semble que je vous ai redit en gros, tout ce que je sais. Je m’en vais dîner aujourd’hui à Auteuil, je médite une fuite à Varsailles avec Ellice & Aston. Ce sera dans la semaine prochaine. pour y passer trois jours. Le Maréchal sera ici je crois le 25. Le duc de Nemours demain.
Adieu. Je voudrais bien vous faire comprendre combien vous me manquez. Combien j’ai des moments de tristesse de mélancolie affreuse, mais il ne faut pas trop vous le dire. Adieu. Adieu.
J’ai eu une lettre encore de la Duchesse de Talleyrand. Elle est insatiable. Elle veut des nouvelles et m’en donne de son côté de tout à fait saugrenues, sa meilleure source est M. Jennison. Imaginez. Quelle chute !
Mots-clés : Diplomatie, Pédagogie, Politique (Angleterre)
95. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne vois de sérieux dans tout ce qui m’est venu hier que la correspondance. de Vienne dans la Gazette des Postes de Francfort, si elle a quelque fondement ; une nouvelle proposition de paix qui vous serait envoyée par l’intermédiaire de l’Autriche, l'indemnité pour les frais de guerre ajoutée aux anciennes conditions ; des garnisons Franco-Anglaises, en permanence dans quatre principales villes de la Turquie des stations maritimes à Varna et à sinope. si cela est, la paix est éloignée indéfiniment, et l'établissement de l'Angleterre, et de la France sur les ruines de l'Empire Ottoman, commence. Reste à savoir si les puissances, occidentales feront une nouvelle démarche auprès de l’Autriche pour la presser d'entrer dans l'alliance. La sera la question Européenne. Si la démarche est faite, elle aura, qu’elle que soit la réponse autrichienne, les conséquences les plus graves. Si l’Autriche consent, c’est la grande guerre continentale contre vous et toute votre frontière à l'occident, la Pologne, entrant dans le jeu. Si l’Autriche refuse, c’est la guerre révolutionnaire s'allumant en Italie, et rallumant bientôt la guerre Européenne. Je ne sais si à Londres et à Paris, on a ces chances là, en vue et si on sait ce qu’on fait en leur ouvrant la porte ; je crois plutôt que non, et qu’on va devant soi sans savoir où l’on va. Mais qu’on sache, ou non ce qu’on fait, on ne le fera pas moins. Je n'ai jamais vu de plus grands évènements plus gratuitement, plus petitement et plus fatalement engagés.
En attendant, les embarquements de troupes, et de chevaux pour la Crimée continuent sur une grande échelle. Evidemment, il n’est pas du tout question de transformer la guerre de terre en blocus maritime, et cette occasion d’entrer dans la voie de la paix sera aussi manquée.
Vous ne lisez pas le Siècle. Faites vous apporté. le N°. du 18 et lisez son article sur l'insuffisance des quatre points proposés jusqu'ici comme base de la paix, et sur la nécessité de chercher, dans l'affranchissement des nationalités Polonaise, Finlandaise, Italienne, des garanties contre la Russie et des gages de la régénération de l'Europe.
Onze heures
Vous n'êtes pas gaie et je ne vous égayerai pas. Savez-vous pourquoi on ne vous dit rien ? Parce qu’on ne fait rien et ne sait rien faire. Adieu, adieu. G.
95. Val Richer, Vendredi 16 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne lisez jamais L'Univers. C'est quelque chose de curieux que la violence et la croisade qu’il a entreprise contre vous. Il a été un moment embarrassé ; il était, en train d’une croisade à peu près aussi violente contre l'Angleterre protestante. Mais l'occasion était trop belle ; il a laissé là l'Angleterre protestante et s'est joint à elle contre la Russie Grecque. Si la chance contraire s'était offerte, il l’aurait acceptée et se serait joint à vous contre l'Angleterre. L'hérésie et le schisme, deux ennemis mortels ; peu lui importe contre lequel des deux, il guerroie à mort. Par cela seul que vous êtes des schismatiques, vous êtes les alliés nécessaires, constants de tous les révolutionnaires ; vous avez voulu, de concert avec une partie des Mazziniens, faire de l'Italie un Royaume pour le duc de Leuchtemberg, vous n'avez aidé l’Autriche à dompter la Hongrie que parce que, pour le moment, le tour de la révolution hongroise ne vous convenait pas. Vous êtes partout les appuis de l'Anarchie et de la Barbarie. Et tout cela est cru par un grand nombre de Catholiques, de Prêtres, d'Évêques qui, avec l'Univers croiraient et disaient exactement les mêmes choses du Protestantisme et de l'Angleterre si c'était de ce côté qu’ils avaient affaire. Je n’ai jamais vu tant de passion dans tant de bêtise. C'est une grande pitié de voir une grande croyance, une grande église Chrétienne poussée, si bas par ses plus bruyants défenseurs. Quand je vois, d’un côté cet état d’esprit de l'Univers, de l'autre la Papauté ne pouvant vivre huit jours à Rome sans le secours d’une armée étrangère, il me prend de vives inquiétudes que le Catholicisme ne soit réellement bien malade, et j'en serais désolé, car, dans la moitié de l'Europe, où il a encore l’air de régner, il ne serait remplacé que par le socialisme et l'impiété.
Qu'est-ce que ce M. Ivan Tourgueniev dont le Journal des Débats raconte le livre qui paraît assez piquant ? J’ai connu deux Tourgueniev, man ils s'appelaient Alexandre et Nicolas ; l’un est mort, l'autre était un ancien conspi rateur, condamné à mort chez vous, homme d'esprit et honnête rêveur. Le livre des Débats a été écrit et circule librement en Russie ; c’est une satire nationale des mœurs nationales. J’ai entendu dire que l'Empereur Nicolas pratiquait assez ces satires là, Nicolas Gogol et autres, par espoir de réformer ses moeurs, la vénalité, l'ivrognerie, l'oisiveté. Il aurait mieux fait de pousser dans cette voie que d'envoyer le Prince Mentchikoff à Constantinople.
Je vois que Lord Palmerston a eu un petit échec dans la Chambre des Communes à propos des aumôniers catholiques, dans les prisons ; c'est le pendant de celui de Lord John à propos des Juifs. Le Parlement en donne la liberté d'être aussi Protestant qu’il lui plaît, bien sûr que cela ne renversera pas le Ministère. Je suis bien aise et un peu triste que vous soyez si contente de la Princesse Kotschoubey. Vous ne la garderez pas toujours. Est-elle donc bien décidée à retourner en Russie après Ems ? C’est certainement une très bonne, très sensée, très noble et très aimable personne.
Midi
Je suis très convaincu que mon esprit ne peut rien au mal dont nous souffrons. Adieu, Adieu. G.
95. Val Richer, Vendredi 20 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne commençais jamais à vous écrire qu’avec un sentiment triste. Il diminuait en vous écrivant ; mais au premier moment, je sentais si amèrement la séparation ! Aujourd’hui, j’ai le cœur joyeux. Et je l’aurai plus joyeux à chaque lettre. Je suis en voyage. Je marche vers vous. La malle poste a fait, dans son itinéraire, un changement qui me plaît fort. Elle partait de Lisieux à 2 heures et s’arrêtait une heure en route à Evreux. Cette heure là m’était insupportable. Maintenant elle part à 4 heures et ne s’arrête plus du tout. Une fois monté en voiture le 30, je n’en descendrai que le 31, dix minutes après avoir passé sous vos fenêtres, dans les Champs Elysées. J’aime que vous soyez toujours sur mon chemin. Il fait beau ; mais le chaud n’est pas revenu. Je ne veux pas qu’il revienne. Je ne veux pas que vous vous pâmiez de fatigue pendant que je serai à Paris. Vous est-il resté de cette chaleur encore un peu plus de faiblesse ? J’espère que non.
Avez-vous recommencé à manger ? Si vous saviez quels appétits je vois en Normandie ! C’est grand dommage que je ne dîne pas avec vous. Je suis sûr que je vous ferais manger le double. Le Ministère anglais a raison de ne pas vouloir que Lord Durham étale à Quebec ses bijoux. On est trop heureux d’avoir de pareils préjugés populaires à ménager. Mais convenez qu’il n’y a qu’heur et malheur. Je ne sais ce qu’a été le procès de ce M. Turton ; mais je doute qu’il ait pu être plus scandaleux que celui de Lord Melbourne contre M. Norton. Et Lord Melbourne chassera M. Turton à cause de son procès. A la vérité Lord Melbourne a gagné le sien. A propos, quel est le Hügel qui s’est battu à Stuttgart avec Mühlinen ? Est-ce le diplomate ou le voyageur ? Voici la filiation de mon à propos. Un procès scandaleux ; un scandale sans procès ; Lady Elizabeth Harcourt ; Hügel, le voyageur Adieu pour ce soir. Je vais me coucher. Je suis encore enrhumé du cerveau. C’est un grand ennui. Adieu pourtant.
Samedi 7 h. 1/2
Pourquoi M. Ellice vient-il à Paris en ce moment où il n’y a personne ? Je ne lui vois aucune raison d’amusement, de société. Y en a-t-il quelqu’une d’affaire ? Tient-il plutôt à telle ou telle partie du Cabinet qu’à telle autre ? Je ne sais pourquoi je vous fais ces questions. Je ne veux plus vous faire de questions ! Dans dix jours, vos réponses me viendront bien plus agréablement. Oui, dans dix jours. Que nous sommes de chétives créatures, à la merci de nos impressions. Ces dix jours ne me paraissent rien du tout. Et pourtant Dieu sait si je les vois s’écouler impatiemment. Mais il y a une impatience joyeuse qui abrège le temps. C’est la mienne aujourd’hui. En conscience, vous ne pouvez exiger d’Appony qu’il aime les Russes. L’Autriche me paraît dans cette désagréable position d’être essentiellement gouvernée dans sa politique par la crainte, crainte russe, crainte française, crainte pour l’Orient, crainte pour l’Italie ; en Allemagne même, un peu de crainte Prussienne. Le mouvement ascendant n’est pas de son côté. Mais que tout est lent pour les grandes choses ! Depuis le 17e siècle, l’Autriche décline. Elle en a pour longtemps à décliner de la sorte.
10 h.
J’ai tort. C’est vrai. Vous avez eu bien des représentants constitutionnels à faire danser. Et Léopold a tort aussi, et bien plus tort de ne pas revenir vous voir. Je suis charmé que M. Ellice reste jusqu’à mon arrivée. Il m’enseignera notre Ministère, comme M. Croker notre révolution. Adieu. Nous irons prendre de l’air ensemble à Longchamp.
96. Ems, Lundi 10 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai absolument que les journaux pour me guider dans l'appréciation de notre réponse à l’Autriche. S’ils disent vrai je la trouve très modérée, mais j’entend crier de tous côtés qu’elle ne peut convenir à personne. Je suis fâchée de n’avoir pas un petit bout de diplomate ici avec qui bavarder. Je rabâche avec Brignoles, mais c'est plutôt de l’histoire ancienne. La poste se met à nous manquer ici, c’est désolant. Pas de lettre de vous depuis deux jours.
6 heures.
Voici le 112 du 6. Rien a répondre, et rien à vous dire, car je n’ai de lettres de personne. Je vous envoie ceci afin que vous ne vous inquiétez pas de mon silence. Quelle triste situation, quelle sombres perspectives. Que deviendrons-nous vous et moi ? C'est à pleurer. Adieu. Adieu.
96. Paris, Jeudi 19 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah la Charmante nouvelle ! Si charmante que je n’ai d’abord pas pu la comprendre. à moi aussi elle va m’ôter la parole. Comme on connait peu sa destinée ! Pouvais-je croire que les conseils généraux me donneraient jamais une grande joie ? J’ai fait ma promenade à Longchamp hier avec M. Ellice. Il m’a raconté toute l’affaire de Lord Durham. Elle n’est encore qu’à son début. Dieu sait comment cela finira. Il a imaginé d’emmener avec lui ce M. Turton et un M. Wakefield qui ont tous deux eu des procès pour des femmes, & le second même à subi trois ans de prison for seduction. Il jure qu’il quitte le Canada si on le sépare de ces bijoux et les ministres sont résolus à ne pas permettre qu’ils y restent officiellement. Or Lord Durham n’a eu rien de plus pressé que de leur donner des emplois & de le publier dans les journaux de Quebec. Ce sont tous deux des hommes de beaucoup d’esprit et de mérite, mais le préjugé anglais ne permet pas qu’ils aient jamais d’emploi publié. C’est une difficile affaire entre le gouvernement & l’autocrate du Canada.
J’ai été dîner à Auteuil. Il n’y avait que M. Armin. Je me suis trouvé parfaitement at home. De l’Allemand, de la diplomatie, cela m’a convenu tout à fait. Je suis restée jusqu’à neuf heures & demi et je ne suis rentrée que pour me coucher. Appony est très peu avec des Russes, cela perce dans chaque parole M. de Metternich n’a vu dans le voyage à Stockholm qu’un caprice du moment. Il cherche à faire partager cette conviction. ici où l’on a été un peu effarouchée de la fantaisie impériale. Je relis votre lettre, cette jolie lettre. Ce n’est pas les conseils généraux ; c’est le jury qui vous amène. Comment êtes-vous de cela aussi ? Quelle drôle de chose. Vous m’expliquerez cela ; par lettre je vous prie, car depuis nous aurons mieux à nous dire. Je suis déjà jalouse de tous les moments pendant ces quinze jours et je ne veux pas me perdre à m’instruire en matière de constitution. Je voudrais vous dire quelque chose, et je ne pense qu’au 31 juillet. C’est si inattendu, si ravissant. Quel plaisir ! J’attends aujourd’hui des nouvelles anglaises. Quelques petits attachés des Ambassadeurs extraordinaires arrivés à Paris racontent que tous les ambassadeurs sont mécontents du peu de politesses qu’on leur témoigne à la cour. J’attends avec impatience le retour de Palmella & de Brignoles, je me trompe, je n’attends plus avec impatience que le juré.
Adieu. Adieu que ce sera charmant !
Mots-clés : Réseau social et politique
96. Paris, Vendredi 21 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
96. Val-Richer, Vendredi 21 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
La proclamation de votre Empereur est convenable, sans bravade, sans engagements qui puissent devenir in commode, mais triste, et je dirai même un peu abattue. Je doute qu’elle soit propre à échauffer le courage du pays. On sait à Pétersbourg, le langage qu’il faut lui tenir.
Nous n'avons plus rien à dire, ni sur la paix, ni sur la guerre. La paix ne se fera pas et les nouvelles de la guerre se font attendre. On ne sait pas encore si le maréchal Pélissier est un grand homme de guerre ; mais sur cinq ou six opérations, grandes, ou petites, qu’il a faites depuis qu’il commande il n’a échoué qu’une fois. C'est étrange à qu’il point l’armée Anglaise a disparu ; ils ont beau avoir perdu 2000 hommes à l'attaque du Redan ; ils ont l’air de n'être là qu’en spectateurs.
Puisque vous voyez tant d’Anglais, demandez leur, je vous prie, ce que signifie, le rappel du cardinal Wiseman à Rome par le Pape qui le nomme bibliothécaire du vasion à la place du cardinal Mai. Le retire-t-on d'Angleterre parce qu’on trouve qu’il y compromet l’Eglise catholique plus qu’il ne la sert ? Et qu’est-ce que Mgr. Talbat qui le remplace, comme archevêque de Westinster. Je n’ai jamais attaché grande importance à ce prétendu progrès du Catholicisme en Angleterre ; mais je suis curieux d'en suivre et d'en comprendre les incidents.
Onze heures
Je ne crois pas qu’on refuse l’Espagne et son contingent ; surtout si on continue la guerre de terre, comme cela paraît. Vous avez laissé bien des choses dans Sébastopol. Fera-t-on sauter tout ce qui reste de la place ? Adieu, Adieu. G.
96. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon rhume de cerveau s’en va. Je ne vous éternuerai pas au nez en arrivant. Le serein, dans ce pays-ci est une véritable pluie. Je le dédaignais trop. Depuis deux jours, j’y ai pris garde, je suis rentré de bonne heure et je m’en trouve très bien. Mes enfants y ont gagné une plus longue lecture, des Tales of the Crusaders de Walter Scott. C’est leur grand plaisir du soir. Plaisir d’une vivacité singulière. Les impressions vives, des hommes causent toujours un peu d’inquiétude. Elles auront des conséquences. Celles des enfants n’en ont point. Le plaisir passé, tout est fini. Aussi le spectacle en est très agréable. Hier soit le charme du sujet, soit vraiment le mérite du lecteur, ma petite Pauline s’est écriée tout à coup avec ravissement : " Mon père, que tu lis bien." Et je l’ai embrassée de tout mon cœur. C’est charmant d’être loué par ses enfants.
Je suis bien aise que M. Ellice reste à Paris jusqu’à mon arrivée. J’aurai peut-être aujourd’hui ou demain une réponse sur sa commission. Vous ai-je dit que j’avais dit à M. Lorain, proviseur du Collège St Louis et mon délégué pour cette affaire de passer chez vous, dès qu’il aurait trouvé quelqu’un pour vous donner l’adresse du précepteur et quelques renseignements à son sujet ? Savez-vous les détails de la conclusion ou à peu près du différend entre Berlin et Rome ? La Cour de Rome s’est conduite avec une Sagesse et une habileté consommée. Après avoir publiquement donné sur les doigts au Roi de Prusse, qu’elle prenait en flagrant délit de mensonge et de violence, elle a, sans la moindre humeur, engagé M. de Buntzen à aller un peu se promener un peu loin. Puis elle a vertement tancé l’archevêque de Posen, lui a demandé de quoi il le mêlait de vouloir imiter l’archevêque de Cologne, & lui a ordonné de se tenir tranquille et d’obéir au Roi, comme par le passé. Puis elle a reconnu l’administration provisoire du Diocèse de Cologne nécessaire à défaut de l’archevêque absent en voyage, n’importe où. Puis enfin, elle a dit au Roi qu’elle avait pourvu à tout, qu’il pouvait garder l’archevêque en prison tant qu’il voudrait, qu’elle n’en parlerait plus, que le jour où il ne se soucierait plus de garder l’archevêque, elle l’en débarrasserait en le faisant Cardinal. Voilà le bruit fini, la contagion arrêté, & le Roi de Prusse obligé d’être content, quoique déjoué dans ses petits arrangements secrets avec quelques uns de ses Évêques et fort embarrassé de son prisonnier. Rome n’eût pas mieux fait, il y a cinq cents ans. A la vérité, elle ne se se serait probablement pas contentée à si bon marché.
10 h. ¼
Le N°98 m’arrive entre une visite qui s’en va et une visite qui vient. Vous savez que le Dimanche est mon jour de corvée. J’aurai beaucoup de monde aujourd’hui, à cause de mon prochain départ. Car je pars le 30 et je serai rue de la Charte, le 31. Je devais en effet prendre le 5 août la société des Antiquaires, mais sa séance est remise à le fin d’août, toujours à cause de mon départ. Il a dérangé beaucoup de choses et de gens. Mais ce qu’il arrange, choses et gens, vaut mieux que ce qu’il dérange. Je vois à ma visite. Adieu. Here’s the place exactly. G.
96. Val Richer, Samedi 17 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
97. Ems, Jeudi 12 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Des lettres de Londres. On n'y veut pas entendre parler de nos réponses. L’Autriche ne peut pas les accepter, à plus forte raison ni l'Angleterre ni la France. On croit toujours que Sevastopol. peut-être pris du côté de terre. Grande désapprobation de la guerre de pirate qu’on nous fait dans le golfe de [Bothein] même Napier en est disgusted mais il n'ose pas le témoigner aux officiers. Le public en est enchanté. Brûlez, saccagez. Constantin me mande notre grande victoire en Asie. J'aurais préféré en Europe.
Les flottes se sont retirées. Il n’y a plus une voile devant Cronstadt. Le Maréchal Paskévitch est rétabli et reste à Yassy. Constantin me quitte qu’après la fête de l’Impératrice qui est demain.
Voilà toutes mes nouvelles Greville ajoute : " à moins de catastrophe à Pétersbourg jamais la paix ne se fera. " L’Empereur se porte bien. Ne trouvez-vous pas qu'on pouvait négocier sur nos réponses.
Montebello s’annonce à Schlangenbad. Je n’y crois pas. Je ne crois à rien d’agréable. jusqu'à nouvel avis adressez toujours à Ems. Adieu. Adieu.
Je suis jaune comme une orange. Le temps est affreux pas une belle journée. Le Connery de Vienne est un cousin de celui de Paris.
97. Paris, Samedi 22 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu votre fils hier un moment, il viendra me prendre cette lettre aujourd’hui. Le ton de Hubner me semble changé. Très doux pour nous, louant la proclamation de mon empereur, disant qu’ici on a bien des embarras. Préoccupé des tentatives répétées contre la vie de l’Empereur. On avait dit hier qu’un cent-gardes l’avait blessé au bras avec un poignard. On ajoute que c’est faux, mais cela a fort couru. Mécontent d'une réception faite au comte Clam général Autrichien, auquel on n’a dit que deux mots et dans la foule. Enfin que peu grognon, pour ici.
Fould s’étonne que les Brabant viennent. Le petit fils de la reine Amélie, grande indélicatesse on ne les a pas invités. C’est une bassesse gratuite. Cependant ils seront logés à St Cloud. Il m’a confirmé ce que m’a dit Hübner que Radcliffe va sauter. Il ne s’arrange pas avec Thouvenel. Toujours dédaigneux pour l’Allemagne, pour tous. Il nie que ce soit une grosse peine. Je dis la plus grosse, le ventre de l'Europe. Il est vrai qu’elle pouvait se ainsi conduire, si elle s'était entendu. Elle pouvait empêcher la guerre. Il me parle d’indémnités, vous concevez que je ris, allez les demander à d’autres. Et bien oui, à la Prusse. Il a répété cela deux fois. Je lui ai rappellé "la France est assez riche pour payer là gloire." Quant au prétendu attentat, il en rapporte l’invention à tous les mauvais drôles, qui ont commencé l’agitation à Angers. J’ai reconnu cependant plus de colère que de mépris dans la façon de crier le coup du cent-gardes.
Vous me direz que vous avez reçu ce N°97. Je me méfie toujours de la prudence de la jeunesse. Adieu. Adieu.
97. Paris, Vendredi 20 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne fais que penser à votre belle institution du jury. J’ai pour elle un grand respect. J’ai passé ma matinée hier à Longchamp. M. Ellice, M Granville et le petit Howard sont venus m’y trouver, j’ai ramené Ellice à Paris, il est revenu chez moi le soir ainsi que la petite princesse, les Durazzo & &. Lorsque j’ai dit à Ellice que vous serez ici le 31 il a décidé de remettre son départ pour vous attendre en vérité il est très curieux à écouter sur toute chose, et il bavarde comme je n’ai jamais entendu bavarder, on tire de lui tout ce qu’on veut. Ne croyez pas que le duc de Sussex sont ici comme le racontent vos journaux. Il ne bouge pas de Londres et il boude les ministres parcequ’ils ne veulent pas lui donner d’argent. Sir George Villers est arrivé hier de Madrid.
Pourquoi croyez-vous que je vous ai dit une bêtise en vous disant que je recevrais les représentants constitutionnels ? Vous oubliez que mon temps à été longtemps, et que je suis restée jusqu’en 34. En 34 donc j’ai fait dîner Miraflores, ambassadeur de Christine, & danser Van de Weyer, ministre de la révolution Belge. J’espère que c’est du libéralisme, nous avons cru que ce serait le pousser trop loin de faire manger le petit van de Weyer. Et puisque je parle de la Belgique, quand je me suis plaint que Léopold ne venait pas chez moi, c’est qu’il y est venu jus qu’à présent lorsqu’il était à Paris. Il cesse tout bonnement parce qu’il sait que j’ai perdu mon importance, jusqu’à l’année dernière il s’imaginait que je l’avais conservée. Pas de nouvelle de mon mari, rien du tout. Rien sur les mouvements du grand duc rien de nulle part le monde est fort ennuyeux. Je vous quitte pour Longchamp. J’y prends du bon air. Adieu. Adieu. dans onze jours !
Mots-clés : Diplomatie, Discours autobiographique
97. Val-Richer, Samedi 22 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-il vrai, comme on l'écrit de Berlin, que votre Empereur a renoncé à son voyage en Pologne et ira, en Crimée avec ses trois fils ? Je ne puis le croire. La situation de votre armée en Crimée est trop incertaine pour qu’un souverain aille s'y hasarder, ne l'ayant pas encore fait.
La bonne conduite sert quelquefois, même quand le succès manqué. Le général Canrobert est aussi populaire en France que s’il avait pris Sébastopol. Vous voyez par son exemple et par l'ovation à la mère du général Bosquet, qu’elle est la faveur de l’armée. Il n’y aurait pas un soldat qui ne fût reçu ainsi dans son village, s’il y rentrait.
J’ai des lettres d'Angleterre, lettres de connaisseurs peu favorables à la guerre. Je suis frappé de ce que j’y entrevois. La chute de Sebastopol, la perspective de votre retraite de Crimée, comme de Sébastopol après ou peut-être sans une nouvelle bataille, la grandeur des ressources que vous amassiez et des préparatifs que vous faisiez à Sébastopol et qui révèlent vos projets ou vos espérances tout cela fait venir l’eau à la bouche, et on se demande sérieusement, même les pacifiques, si après tout, puisqu’on est là, puisqu’on est vainqueur, on ne ferait pas bien de poursuivre et de vous enlever définitivement vos deux provinces frontières les plus menaçantes, la Crimée et la Bessarabie. Si ce projet s’établissait dans les esprits si on prenait quelqu’un de ces engagements de paroles qui lient l'avenir, c’est pour le coup que la guerre serait indéfinie et deviendrait infailliblement générale.
L'article du Constitutionnel, autant qu’un journal a de valeur indique déjà un parti bien pris quant à la Crimée.
Onze heures
Point de lettre de vous. Pourquoi ? Adieu, Adieu. G.
97. Val Richer, Dimanche 18 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai probablement tort de mettre quelque importance au voyage du Roi de Prusse à Kenigsberg ; mais toutes les circonstances me semblent indiquer que c’est quelque chose, le départ précipité du roi qui n’attend pas la fête du son frère, le Prince de Prusse qui va rejoindre le Roi, même, M. de Manteuffel qui n’y va pas et qui, depuis quelque temps, doit être devenu assez désagréable à votre Empereur. Enfin, on s'accroche à tout.
Est-il vrai que votre impératrice soit de nouveau très souffrante ? Et à cause de vous et à cause de ce que j’ai entrevu d'elle, je lui porte un véritable intérêt. Donnez-moi, je vous prie de ses nouvelles. Elle doit être au moins fort triste.
Vous avez surement remarqué le trait de M. de Brück à Constantinople : " Au succès des armées des puissances alliées. ! " Cela ressemble bien à une préface de la guerre. Je serai curieux de savoir si, comme le disait, il y a quelques jours le journal des Débats, c'est encore le Prince de Metternich qui, du fond de sa vieillesse et de sa surdité, dirige cette politique. Je penche à le croire.
Midi
J’ai été dérangé par deux visites matinales. Je n'ai que le temps de lire votre n°81 et de vous dire, adieu, Adieu. C'est bien court. Adieu. G.
97. Val Richer, Dimanche 22 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma corvée est finie. Ce n’est certes pas la solitude que je suis venu chercher ici. Je suis charmé de la vôtre. J’en profiterai. Je fais de charmants projets. Je fais des vœux pour que le temps se maintienne tel qu’il est aujourd’hui beau et pas chaud. Un de mes voisins de ce matin me l’a promis. " C’est, dit-il, le combat de la lune." Ce sera la lune de miel.
Je regrette que vous n’ayez pas vu M. Villers. Il aime à parler et il doit être curieux à entendre sur l’Espagne. Il a joué là un jeu bien brouillé. Quel triste sort que celui des pays faibles ! Le théâtre des intrigues rivales des grands pays quand ils ne sent pas celui de leurs guerres : jouet ou champ de bataille et toujours victime. Il ne faut pas être petit, et il faut être bon pour les petits. Je crois que c’est pour vous que M. Ellice est venu à Paris. Il me semble qu’il passe sa vie chez vous. Il a de l’esprit et il est très au courant. Comment un homme d’esprit comme lui ne s’aperçoit-il pas que tout en causant, & vous plaisant avec lui, vous ne lui portez pas grande considération ? Et s’il s’en aperçoit, comment s’en arrange-t-il ? Mais il est de ceux qui s’arrangent de tout ce qui les sert ou les amuse. Vous avez un grand talent pour traiter avec ces hommes-là. Vous les attirez sans les laisser tout à fait approcher. Vous leur plaisez et vous leur donnez le plaisir de vous plaire, mais toujours d’un peu loin. C’est votre histoire avec Thiers. En entendez-vous dire quelque chose? Ne trouvez-vous pas que le Maréchal Soult abuse de sa fortune ? Ces visites partout, ces acclamations de tous les jours, cette perpétuelle exhibition, combien de temps cela peut-il durer en Angleterre ? Chez nous, ce serait déjà fini usé. Et vous qui n’aimez pas les répétitions et les longues choses vous n’êtes donc pas Anglaise par là ? Il y a bien des côtés par où vous ne l’êtes pas. Vous avez le cœur plus anglais que l’esprit.
Du reste j’ai un de mes voisins qui arrivait d’Angleterre et qui vous charmerait à entendre, cinq minutes je veux dire car vous ne vous en accommoderiez pas plus longtemps. C’est le plus grand manufacturier du pays ; il est allé parcourir l’Angleterre pour ses affaires ; et malgré les rivalités d’argent, il en est dans un enthousiasme inépuisable ; il professe, il prêche la richesse, la propreté, l’élégance, la grandeur, l’esprit d’ordre, le bon jugement, les bonnes auberges. Je l’écoutais l’autre jour avec le plaisir de vous entendre donner raison. C’est lui qui m’a donné à dîner à Combrée avec 80 amis. Et son toast et son speech en mon honneur valaient son admiration pour l’Angleterre.
9 heures 1/2
93 méritait d’être brûlé vif. Je n’ai fait que mon devoir. Je trouve comme vous, que nous nous adressons de sottes lettres. Si elles pouvaient ressembler à nos conversations, elles seraient charmantes. Ah, nos conversations ? Nous les retrouverons de demain, en huit, pour quinze jours. Que ce sera court, & immense ! Vous y pensez, dites-vous, plus que moi. Je le veux bien, mais je le nie. J’y pense toujours. Ajoutez quelque chose à cela. Je vous en prie ; ayez des caprices ; ne vous laissez gouverner par personne en mon absence. Je ne vous le pardonnerais pas. C’est peut-être un des signes les plus assurés de l’affection que de se laisser gouverner. On ne remet sa liberté qu’à celui qu’on aime plus que soi-même, en qui on se confie plus qu’en soi-même. Redites-moi de vous gouverner.
Je n’ai pas encore de réponse pour le précepteur, vous l’aurez probablement avant moi. Vous ne savez pas combien je voudrais faire, à l’instant même ce que vous désirez. Si je pouvais le faire toujours moi-même, j’en serais sûr. Mais de loin, mais forcé de mettre un esprit au bout de mon esprit, des mains au bout de mes mains, tout est long, & je m’impatiente autant que vous. Adieu. Comment va Marie ? Dites-lui au moins une fois avant mon arrivée que je vous ai demandé de ses nouvelles. Adieu. Lundi prochain, je serai sur la route de Paris. Je vous porterai moi-même mon adieu. G.
98_1. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais vous envoyer de mon sommeil. Je suis sûr qu’il vous ferait grand bien. Pour moi, c’est ma vie, sauf les journées, vous devez avoir moins de bruit rue de la Charte que rue de Rivoli. A quelle époque comptez-vous retourner à la Terrasse ? Ne me répondez pas. Vous me direz tout le 31. Que de choses pour le 31 ! C’est un grand pouvoir Madame, que de répandre, sur un petit point du temps, tant d’espérance et de charme. Le monde entier se cotiserait en vain pour me donner, en bien des années, ce que j’attends, ce que j’aurai de vous ce jour-là. Et ce jour-là ne sera pas le seul. Le jury, qui nous vaut ces excellents moments nous en ôtera bien quelques uns. On tire au sort chaque matin les jurés qui doivent siéger dans la journée. Quand le sort me désignera, toute ma matinée pourra bien être prise. Mais, alors même, nous aurons la soirée ! Et le sort ne me désignera pas toujours. Et quelquefois, je me ferai récuser. Je vous parle là comme si vous étiez versée dans la procédure criminelle. Mon plaisir à part, je fais bien d’aller au Jury. L’amiral Duperré, qui avait été appelé il y a trois semaines, s’est excusé pour cause ou sous prétexte de santé, et comme Pair. Les Magistrats et les autres jurés ont trouvé cela mauvais, et je sais qu’on a dit : " Nous verrons si M. Guizot en fera autant." Je n’en ferai pas autant.
Je ne m’étonne pas que vous vous ennuyiez à Auteuil. Quels que soient les visiteurs, on s’ennuie partout où les maîtres de la maison sont ennuyeux. Ce qui fait l’agrément ou l’ennui d’une maison c’est bien moins ceux qui l’ont, que ceux qui l’habitent et y reçoivent. On m’écrit aussi que les Ministres ne savent comment tenir leur parole au comité Appony pour l’hôtel de la rue de Grenelle. Cela commence à se savoir et on en parle. Vous pourriez bien un de ces jours le trouver dans les petits journaux. Puisque, au pied du mur, vous n’avez pas plus d’envie de voir Versailles, je ne regrette pas que vous n’y alliez pas. Non que la chose ne soit belle et digne de vos yeux ; mais malgré les petites voitures, c’est très fatigant, & vous seriez bientôt excédée. Ma présomption est grande. Si j’y étais avec vous, je ne craindrais pas votre fatigue. Vous me direz si j’ai tort.
10 heures
Le N° 101 m’arrive par un grand orage. Il n’est pourtant pas orageux du tout. Quand votre nuit est mauvaise, vous faites fort bien de dormir tard. Cependant, je suis décidé à faire la part de la paresse très petite. Je ne suis point paresseux ; mais je m’écrie aussi, quel bonheur ! Il est sûr que la perspective du 31 fait aux lettres un peu de tort. Vous avez raison. Le Duc de Sussex a peu d’esprit, moins esprit que le Pape. Certainement l’esprit est rare en ce monde. Et il me semble qu’il s’en en va plus qu’il n’y en vient. J’en serais fâché. Je n’ai nulle envie de laisser le monde en déclin après moi. Adieu. Mercredi prochain, je serai établi dans mon bonheur. Adieu. G.
Mots-clés : Relation François-Dorothée, Réseau social et politique
98. Ems, Jeudi 13 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici jeudi, votre dernière lettre était de samedi, c’est bien long. J'ai reçu de bonne source hier les renseignements suivants sur notre réponse.
" Les [principautés] ne peuvent être totalement évacuées parce qu'il faut conserver un champs de bataille autre que la mer noire et la mer baltique. Jamais nous n’avons ni l’intention d’y rester & de les garder.
Nous sommes prêts à négocier sur trois points. 1. intégrité de l’Empire ottoman
2. égalité des Chrétiens et des Musulman
3. traité des détroits et de la navigation.
Le langage du Prince Gortchakoff est trés modéré, très pacifique. L'impression transmise à Paris et à Londres. est celle là."
Que pensez-vous de ceci ? Il me semble qu’on pourrait se parler. Voilà votre lettre de Dimanche comme c’est long, ce que dit Barante me paraît très sensé, à quoi sert-il d’être sensé ? Tout ce qui se passe est insensé. Je ne puis vous dire mon découragement profond, et puis c'est si triste de n’avoir avec qui discourir de mes peines. La semaine prochaine toute ma société s’éparpille. Cela m’est égal à moi, Schlangenbad, ou ceci, ou autre chose, c’est de la tristesse partout. Adieu. Adieu.
98. Lisieux, Mardi 24 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je persiste dans mon erreur. Je mets 98 comme si 93 avait été à sa place. Je suis encore venu dîner ici. C’est une singulière chose, qu’un pays démocratique. Tout le monde est shy avec un Ministre et shy avec humeur. Je ne suis plus ministre, mais je l’ai été et on croit que je le serai encore. Tout le monde veut être et avoir été bien pour moi, et avec moi, et croit pouvoir l’être sans embarras. Je n’ai jamais été plus entouré. Hier, à dîner, tout-à-coup, au milieu des 24 personnes qui étaient à table avec moi, comme je m’ennuyais fort l’idée m’est venu du plaisir que j’aurais si j’étais seul à table avec vous, à dîner je ne sais où. Le rouge m’a monté au visage. Ma voisine, la maîtresse de la maison l’a remarqué : " Est-ce que vous êtes souffrant ? Vous avez trop chaud. " J’ai eu beau dire que non. On a ouvert toutes les fenêtres. On m’a demandé dix fois, si j’étais encore incommodé, si j’allais mieux &, Dans huit jours, mon plaisir ne sera pas en idée. Je crois en vérité que le rouge me gagne encore en y pensant. M. Génie vient en effet passer avec moi Samedi et Dimanche. J’espère qu’il m’apportera quelque chose de vous. Je suis avide et toujours avide, en dépit du 31. Je serai très avide le 31 et tous les jours suivants. Je ne m’étonne pas que M. Villers ait mauvais ton. Il a mené à Madrid une vie fort légère, et les galanteries espagnoles n’ont bon ton, je crois, que dans les romances du Cid. Avez-vous jamais lu ces vieilles romances du Cid et de tous les héros Espagnols de son temps ? C’est très joli d’une élégance et d’une simplicité charmante. Il y a quelque chose de très agréable, de mon avis, dans une grande élégance d’esprit et de cœur une à une grande simplicité de vie matérielle. C’est souvent le mérite de l’antiquité grecque et de l’Europe du moyen-âge.
Je persiste à croire qu’Ellice est venu à Paris pour autre chose encore que pour vous et pour ne pas voter sur Lord Durham. Si vous avez quelque bon endroit où il vous plaise d’aller passer les trois journées, faites le, sauf cela, vous pouvez, ce me semble rester chez vous sans autre inconvénient que le bruit. A la vérité, il sera grand là où vous êtes. La poussière vous incommode-t-elle ? Je ne pensais pas qu’on arrose. Vous vous promenez donc toujours le soir sur la route de Neuilly.
J’y vais tous les soirs. Adieu. Je repars pour le Val-Richer, & ; je n’en sortirai plus que lundi prochain. Mon rhume n’est rien. Et je n’en aurai pas la moindre trace mardi. Adieu. G.
98. Paris, Samedi 21 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie d’avoir fait vos calculs de façon à ne pas me laisser manquer de lettre. Je vous remercie aussi de ce que vous me permettez au sujet du précepteur pour Lord Coke. C’est un enfant charmant. Le type des beaux enfants de l’aristocratie anglaise. Je suis sûre qu’il vous plaira. Quelle belle race que ces Anglais ! Et les enfants qui naissent en Angleterre sont comme cela, étaient comme cela ! J’ai eu hier une lettre de mon frère un peu meilleure que les autres. L’Empereur venait d’arriver au château de Furtustein " il est content de la Pologne, il a été bon pour tous sans se faire illusion." L’Impératrice très faible. Je n’ai vu hier qu’Ellice dans ma longue matinée de Longchamp. Il m’est venu du monde en ville, sur lequel je ne regrette que M. Villers. M. Molé me mande que le grand Duc est arrivé à Lubeck très souffrant et faible. Du reste, no new whatever.
Je mène une vie très solitaire depuis que je ne reçois plus le soir et que ma matinée se passe hors de Paris. Je me couche à 10 heures après une promenade en calèche et cette promenade je la fais invariablement sur la route de Neuilly, la seule praticable puisqu’elle est arrosée ! J’ai lu dans les journaux ce matin, que la réunion de savants à Caen est fixée au 8 août & que vous devez la présider. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous m’avez juré que vous étiez du jury. Je suis extrêmement refroidie sur la partie à Versailles. Vous ne sauriez croire comme je déteste de me déplacer, comme je crains l’inconnu, un mauvais lit. Je ne suis pas difficile, mais mes conforts me sont nécessaires. Je m’engage très lestement pour ce qui est dans l’avenir, mais quand le moment de l’exécution arrive cela me devient insupportable. Je crois que cela s’appelle de la vieillesse.
Adieu, je suis enchantée de vous savoir sorti de vos dîners, il m’en revenait de pauvres lettres. Au reste depuis que j’ai le 31 devant moi, je suis devenue fort accommodante ! Adieu. Adieu. Je ne pense qu’à mardi 31.
98. Paris, Samedi 22 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je donne une lettre à votre fils, mais toute réflexion faite cela ne me dispense pas de la poste. Je vous répéte que Redcliffe va être rapellé, s’il ne l’est pas déjà, c'est une bonne affaire mais qui eût même valu plutôt. Le vice roi d’Egypte attendu et annoncé ici avec une suite de 90 personnes, s’est arrêté à Malte malade dit-on. Il ne vient pas.
L’article du Moniteur pour est fait détruire toutes les craintes sur l’attentat. Au fond hier soir personne n’y croyait plus.
Abdel Kader à obtenu de l’Empereur la permission de résider à Damas au lieu de Brousse. Montebello est ici pour un jour. Adieu. Adieu.
98. Val-Richer, Dimanche 23 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais vous envoyer quelque chose de consolant ; mais je n’ai rien à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. Quand Français 1er écrivait de Pavie : " tout est perdu, fort l’honneur ", il se trompait beaucoup sur le premier point ; rien n'était perdu pour la France ; les siècles suivants l'ont bien prouvé. Il en de même sera certainement pour la Russie ; votre avenir sera peut-être autre que vous ne vouliez le faire ; mais à coup sûr, il n’est pas perdu. Vous avez atteint ce point de grandeur et de force où rien, pas même les revers ne peut vous empêcher de grandir.
Quoique vous ne jouissiez qu'à moitié du beau temps dans le gouffre de Paris, comme vous dites, j’aime mieux pour vous le beau temps que la pluie. Le soleil est toujours beau devant vos fenêtres, et vos courses à Meudon, et au mont Valèrien ne seraient pas possibles, s’il pleuvait. Ici, comme fermiers nous invoquons la pluie. La mauvaise récolte est de plus en plus constatée ; le pain renchérit toujours. La population s’inquiète. Elle s’agitera dans l’hiver. Il faudra des troupes pour la contenir, peut-être pour la réprimer.
Onze heures
Voilà deux lettres, et mon fils m'en apportera une troisième. Merci et merci. Je suis fort aise que Lord Redcliffe revienne. Ce sera certainement une facilité pour la paix quand la paix sera possible. Que vous ne la demandiez pas, que vous n'en parliez pas aujourd’hui, c’est tout simple ; mais que les vainqueurs ne vous la proposent pas, après avoir jeté dans le port les ruines de Sébastopol, c’est de la bien petite et bien mauvaise politique. Adieu, et adieu. G.
98. Val Richer, Lundi 19 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc le Maréchal Paskévitch hors de combat ; sa vieillesse ne vaut pas celle du Maréchal Radetzky. Que deviendra le traitement de Maréchal que votre Empereur donne à ce dernier, si l’Autriche se déclare contre vous ? Continuerez-vous de le lui donner ? Certainement, il y avait, dans votre patronage sur les officiers Autrichiens et Prussiens, quelque chose de bien régulier et de bien arrogant. Je comprends que l'Empereur d’Autriche saisisse l'occasion d'en finir avec votre Bolection. Il s’agit de savoir si l'occasion est sûre.
Si vous lisiez les Mémoires de Ste Aulaire en 1838 et 1839. Vous y verriez que le Prince de Metternich lui disait toujours à propos des affaires d'Orient : " Garantissez-moi que la France et l'Angleterre resteront unies, et je me mets sur le champ avec elles. " Apparemment il croit aujourd’hui à la solidité de l’union.
Si on vous prend Sébastopol, regarderez-vous la prise de Silistrie comme un dédommagement suffisant ? Evidemment, le rassemblement des troupes Franco-Anglaises à Varna a pour objet d'attaquer Sébastopol ou de vous faire lever le siège de Silistrie. Il est impossible que le mois de juillet n’amène pas là quelque gros événement.
La Reine Marie-Amélie est arrivée à Claremont en assez bon état. Elle a trouvé à Cologne Mad. la Duchesse d'Orléans qui l’attendait avec son fils, et qui l’a accompagnée jusqu'à Ostende. Le Roi Léopold lui a aussi amené ses petits-enfants. Il est vrai que les Aumale voient beaucoup de monde à Twickenham Le monde n'empêche pas le Duc de travailler à son histoire de la maison de Condé. Il a été question dernièrement d'en insérer un fragment, qu’on dit très intéressant, dans la Revue de Deux Mondes, mais la revue n’a pas osé. Je ne trouve pas l’offre à la Reine du passage par la France de bon goût ; on était trop sûr qu’elle ne serait pas acceptée. Il y a des offenses après lesquelles il ne faut pas avoir des prétentions de courtoisie. Du reste je n’ai pas entendu parler de celle-ci.
Je suis de l’avis du Times ; je trouve la conduite de Lord John dans les arrangements ministériels bien pauvre. C'est sans doute pour se faire pardonner qu’il a tonné si fort contre vous dans son élection à la Cité. Tout cela fait une série d'engagements qui rendent la paix de plus en plus difficile. Lord Palmerston avait-il envie de devenir ministre de la guerre, et regardait-il ce pas comme un acheminement vers le premier ?
Midi.
Point de lettre d'Ems et point de nouvelles d'ailleurs. Adieu, Adieu. G.
99. Ems, Samedi 15 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne crois pas un mot de la lettre que vous me citez de mon empereur au roi de Prusse. Si une telle lettre pourrait exister, elle ne serait pas connue. On reste très curieux de ce que sera la réponse de Vienne. Certainement il y a hésitation je n’en vois hélas aucun à Londres & à Paris si j’en juge sur les journaux.
Hier l’Indépendance annonçait une rencontre entre votre Empereur & la Reine d'Angleterre. Si cela se confirme ce serait un fait bien grand et bien brillant pour l’Empereur. Je suis curieuse de la confirmation. Dans ce moment une lettre de Greville. L’Autriche n’avance pas, nous restons, et on s’attend à une grande bataille sur le Danube. Les alliés pourrait bien y prendre part. La Prusse lie les mains à l’Autriche. Il est évident qu’elle fait tout pour se détacher de l’alliance et se joindre à nous. Mais osera-t-elle provoquer l’inimitié de l’Occident. [?] which are in a considerable fix.” Voilà la lettre de mon correspondant. Il n'accuse pas l’Autriche. Son traité avec la Prusse lui interdit de rien faire sans se concerter avec elle. J’attends avec beaucoup d’impatience ou des coups, ou le débrouillement de la situation des Allemands. Je pars décidément pour Schlangenbad jeudi le 20. C'est là duché de Nassau que vous m’adresserez vos lettres. Adieu. Adieu.
Paul est arrivé hier.
99. Paris, Dimanche 22 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous avez brûlé vif le 93 voilà tout. J’ai si peu à vous conter de ma journée d’hier que j’ai honte de vous écrire. Ma matinée à Longchamp toute seule. Il faisait laid personne n’est venu interrompre ma solitude. Après le dîner j’ai mené M. Ellce et M. Aston à Auteuil. Il y avait du monde, beaucoup même, mais je ne vais vous nommer personne. Tout cela était ennuyeux, très ennuyeux. Je suis revenue à 10 heures. Il n’y a pas un mot de nouvelle. Est-ce que tout le monde dort en Europe. Ellice est bien impatient du précepteur. Il a grande foi en vous. J’impatiente un peu mes Anglais de hier au soir. Je n’ai plus la plus petite envie de Versailles. Je me sens fort sotte d’en avoir jamais témoigné. Cela a l’air d’un caprice. Ah que j’aurais besoin d’être gouvernée. Pourquoi ne me gouvernez-vous pas ? Rien ne me plait que ce qui plait à un autre. Mais l’autre il faut que je l’aime ; que je l’aime bien, et je n’aime pas assez M. Ellice, ni M. Aston ; ici personne. Personne que la Normandie. Quelle belle manière d’échapper à la personnalité ! Monsieur, je deviens bête, je crois même que vous le trouvez un peu depuis le 27 juin.
Nous nous adressons de sottes lettres. Vous ne me dites rien, vous ne m’avez écrit que deux lettres charmantes même le n°87. " de douces paroles !", l’autre le jury. J’attends tout du jury. Dans 9 jours. J’y pense je crois plus que vous Adieu. Adieu.
99. Paris, Dimanche 23 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je souffre un peu de la maladie commune ici les entrailles, et cela m'ennuie sans m'inquiéter encore. J'ai eu une lettre de Meyendorff. ses fils ne sont heureusement pas atteints. Toute la cour allait à Moscou, l’Impératrice avec. On y restera huit jours de là l’Empereur va à Varsovie et puis inspecter son armée dans les provinces Baltique. Toute l'absence sera de 6 semaines au plus. Le cri à Pétersbourg en apprenant la chute de Sévastopol a été " Voici le commencement de la véritable guerre." Toujours des réflexions sur la haine aux Anglais, l’amour aux Français.
Le commerce intérieur va très bien l'Asie ne vendra plus de produits anglais parce que la route des caravanes est conquis par nos trouppes en Asie mineure. La perse et les pays adjanes s’approvi sionnent chez nous. Voilà la lettre. Hubner est encore revenu hier. Aujourd’hui il présente à St Cloud, M. Prokech qui est je crois destiné à retourner à Constantinople.
Les grey's sont venus me dire Adieu. Pas de nouveaux arrivés anglais. Adieu. Adieu.
99. Val-Richer, Lundi 24 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai reçu le N°97. Mon fils est arrivé hier, beaucoup mieux quant à ses oreilles, cependant pas tout-à-fait guéri, je trouve. Les médecins, d’Aix la Chapelle et de Paris, sont contents et lui disent que, dans un mois, le bon effet des eaux de fera encore plus sentir.
Vous avez certainement remarqué, il y a quelques jours, la réponse fort digne et même un peu hautaine, du sultan, au drogman disant que Lord Stratford lui avait envoyé pour se plaindre de la rentrée d’un ministre, de je ne sais quel Méhémet Ali. Le sultan savait sans doute que Lord Stratford n'était plus bien en selle. C’est un événement que ce rappel, en ce double sens qu'à Constantinople l'Angleterre n’est plus Lord Stratford, et qu’elle livre la place à l'influence Française. Il me revient de tous côtés que cette influence est plus que jamais à la guerre. La prétention de l’indemnité le prouve ; si vous la refusez, comme je le présume, il faudra la prendre autre part ; l’Autriche ne peut pas la laisser prendre en Italie ; vous ne pouvez pas la laisser prendre en Prusse. Ni l'Allemagne non plus. On aboutit toujours à la grande guerre européenne, si la guerre se prolonge et sort de Crimée, c’est presque infaillible. Je dis presque pour ne pas trop manquer à la modestie d’esprit que les événements m'ont apprise.
Entendez-vous dire, comme on me le dit qu’il y a un peu d'humeur contre le maréchal Vaillant qu’on ne trouve pas assez empressé à la guerre, et que le général Canrobert pourrait bien le remplacer ?
Le prétendu coup de poignard du cent garde n’a pas fait autant d'effet en province qu'à Paris ; on n’y a pas cru, même avant que le Moniteur l'eût nié. On est très porté. en province, à voir partout des manœuvres de Bourse ; on déteste la Bourse, par mépris des joueurs, et par jalousie de leurs gains.
Ce qui fait toujours grand effet, c’est la chute de Sébastopol et votre abandon précipité de tout ce qu’on y a trouvé. Cela ne rend pas la guerre plus populaire ; mais la confiance et l’orgueil publics montent rapidement. On ne croit plus à la force, ni des ennemis, ni des alliés, on sourit en parlant de l'Angleterre, comme de la Russie ; on croit notre armée capable de tout. Ce sentiment se répand dans toutes les classes, dans tous les partis. C'est par là que la politique de la guerre peut avoir prise sur le pays ; on n'aime pas la guerre mais on ne doute pas de la victoire.
Le Vice Roi d’Egypte est-il réellement tombé malade, au bien est-ce l'Angleterre qui l’a détourné de venir à Paris ? J’ai peine à le croine. Ce serait un mauvais procédé bien prompt.
Onze heures
e vous prie de féliciter de ma part, M. de Meyendorff de la santé de ses fils. Félicitations bien provisoires, hélas, puisque la guerre continue et continuera longtemps ; mais enfin il faut se féliciter chaque jour, à chaque danger passé. Je n’ai pas encore lu le Rapport du général Simpson. Adieu, Adieu. G.
99. Val Richer, Mercredi 25 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que nous sommes mobiles ! Moi aussi. Ce matin, j’avais peu de goût à vous écrire. Ce soir j’en ai soif. Et l’approche du 31 qui, ce matin me rendait si froide cette ombre de conversation, ce soir me la rend nécessaire. Si je me couchais sans m’être assis près de vous, sans avoir causé avec vous, je suis sûr que je ne dormirais pas. Dormirais-je mieux si je m’étais réellement assis près de vous. Si j’avais réellement causé avec vous ? J’en doute. N’importe. Causons. Êtes-vous encore sur la route de Neuilly ? Il doit y faire beau et frais. La calèche est ouverte. Vous avez tort. Il vaut mieux, je vous assure qu’elle soit à demi-fermée. Ce qui doit être agréable, c’est de se promener tard, quand vous êtes rentrés dans votre jardin, par une lune bien claire et bien calme. Cette phrase-là est faite je ne sais comment ; mais cela s’entend. Je me suis peu promené depuis que je suis ici, presque jamais le soir. Je me trouvais trop seul. Vous m’avez gâté la solitude comme le monde. Quand je suis seul, je vous désire encore plus que je ne vous regrette. Le regret s’arrange de la solitude, le désir, pas du tout. J’ai eu vingt fois, cent fois, près de vous, le sentiment si beau, si rare, le sentiment de la perfection d’un état auquel rien ne manque et qu’on accepterait avec ravissement comme sort éternel. Loin de vous, le souvenir de ces heures-là me revient sans cesse, tout à coup, au milieu d’une conversation ; et mon âme s’en va ; elle va vers vous. Vous me rendrez ces heures charmantes, n’est-ce pas ? Je les retrouverai près de vous. L’été à Paris est une très douce saison. On est bien plus libre. L’été, le monde n’a point de droits ; on ne lui donne que ce qu’on veut. Mes quinze jours seront à moi, bien à moi. Ils passeront si vite ! Que faites-vous de Marie, le soir. Mad. Durazzo s’en charge-t-elle quelques fois ?
Décidément ma mère et tous les miens vont passer à Broglie, le temps de mon absence. J’en suis charmé. Ils y seront bien et moins impatients. Ils n’iront que le 4 août. Mad. de Broglie m’écrit ce matin qu’elle ne sera libre que le 4 de quelques hôtes qu’elle a dans ce moment. Avez-vous eu des nouvelles d’Alexandre ? A-t-il bien abandonné ses idées de mariage ? Je ne puis me déshabituer des questions. Ne répondez qu’à celles dont vous voudrez débarrasser d’avance nos quinze jours. Le mois de Juillet, sur lequel vous aviez de si mauvais pressentiments, il ne se passera pas tout entier sans nous. A la vérité ce sera tout juste. L’année dernière, il a été tout à fait perdu. Vous le dirai-je cependant ? Il n’a pas été, il n’est pas encore en mon pouvoir d’y avoir tout le regret que je devrais. Votre voyage en Angleterre, votre impatience, votre chagrin, vos lettres si tendres, votre retour si soudain, c’est là ce qui m’a donné confiance. J’ai vu là une preuve, cette épreuve par laquelle tout nœud doit passer avant d’être vraiment serré. Mais à présent, nul voyage, nulle absence n’est plus bonne à rien. C’est du chagrin en pure perte. Et le temps qui s’en va, la vie qui passe ! Qui me rendra les jours que vous auriez pu remplir ? Je n’y veux pas penser à présent, si près du 31. J’aurai bien assez de temps plus tard pour les réflexions mélancoliques. Adieu. Je vais me coucher pourtant. Probablement vous vous couchez aussi, à cette heure, même. Adieu, adieu.
Jeudi 7 h 1/4
J’ai bien dormi ; mais d’un sommeil chargé de rêves, tristes et doux, incohérents au delà de toute expression comme la vie. J’hésite beaucoup dans ce que je pense de la vie. J’y connais de si beaux jours, et des temps si sombres ! Il faut que je sois particulièrement né pour le bonheur, car il me laisse une impression si vive qu’elle résiste au malheur même. Un moment de vrai bonheur me paraît digne d’être acheté au prix de toutes les peines. On dit cela dans la jeunesse, avant l’épreuve. Je le dis après. Après cette lettre-ci, je ne vous écrirai plus que deux fois. Mais écrivez-moi encore Dimanche matin. Je ne partirai d’ici lundi qu’à 2 heures 10 h. Je suis charmé que vous soyez contente de ce qu’Ellice est content. Vous savez que j’ai entrepris, non pas de guérir votre tristesse, les vraies tristesses ne se guérissent pas, mais de mettre à côté du bonheur, du vrai bonheur. Soyez tranquille. Je réussirai. Je vous aime trop pour ne pas réussir. Adieu. Adieu.
100. Ems, Dimanche 16 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le grand duc héritier se porte très bien. Les journaux sont bien menteurs. Quel pitoyable article de M. de Sacy dans le [Journal] des Débats de hier. Dîtes lui que je suis luthérienne et que j’ai toujours joui du libre exercice de mon culte. Comment est-on aussi ignorant quand on est académicien ? C’est bon pour une portière. Nicolas Pahlen a eu ses tribulations à Londres. Gréville m'écrit qu'il est au désespoir sa sécurité était dans son insignifiance. Je vois l’objet d'une discussion au parlement ! Pauvre homme il rentrera en Russie pour n’en plus sortir.
Lord Cowley a exprimé quelque chagrin & même du soupçon de la conduite de l’Autriche. Greville ne soupçonne pas et trouve qu’elle peut difficilement se séparer de la Prusse. C’est donc la Prusse aujourd’hui. qui devient premier personnage. Si vous étiez toujours là auprès de moi, quels interminables commentaires sur tout ce qui se passe ! et comme je pense et j’éprouve tout ce que vous dites, du découragement et de l’irritation que donne cette absence de toute conversation intime.
J'ai été interrompue par le prince de Nassau qui est venu à lui tout exprès pour en faire visite. Ce joli jeune homme que vous avez vu chez moi à Paris. Il est déjà reparti. Il me dit d’après le dire de sa mère qui revient de Russie que ce qui a le plus irrité l’Empereur d’Autriche est le ton qu’Orloff avait pris avec lui. Cela a été si fort que l’[Empereur] a été forcé de lui rappeler qu'il était Empereur d’Autriche. L'in solence russe avait été pas bien loin.
La duchesse de Nassau dit que mon Empereur ignore beaucoup de choses qu'il serait fort utile qu'il sût. En Allemagne tous les princes sont russes, tous les peuples sont russes. Il n’y a pas gamin de 15 ans qui ne désire nous faire la guerre. Mon petit prince est un charmant jeune homme. Indépendant, en train, il vient de traverser tout seul toute l’Amérique du Nord. Il a mis à cela presque deux ans. Il m’a beaucoup amusé, il vous aurait plu. Adieu. Adieu.
100. Paris,Lundi 23 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m’avez écrit une aimable et bonne lettre. Nous allons redevenir plus aimables tous les deux, je me sens en disposition de M. Génie vient de me cela tout à fait. faire visite. Il part vendredi pour aller vous trouver si j’ai quelque chose je le lui donnerai. M. Lorain est venu hier sans me trouver, je viens de lui mander les heures où je suis chez moi. J’ai fait ma matinée hier à Longchamp. Ellice a imaginé d’y venir à pied depuis l’hôtel Bristol. Il est arrivé affamé & exténué. Je l’ai ramené chez lui. Le soir j’ai eu mon monde d’habitude et de plus M. Villers que revient de Madrid. Il a bien mauvais visage. Il a beaucoup parlé Espagne pour l’édification de Médem. Cela ne m’intéresse plus du tout.
Alava est nouveau ambassadeur à Londres ; nous le verrons à Paris ce qui me fait plaisir ce qui m’a frappé dans M. Villers est un peu de mauvais ton. Cinq ans de Madrid, & de Madrid en révolution, peuvent bien donner cela. La Reine de Hanovre me mande l’arrivée du grand duc le 18. si faible qu’il ne peut pas marcher seul. Le Roi de Danemark l’avait logé dans un Château qui n’a pas été habité depuis 40 ans. Il y avait bien de quoi prendre la fièvre. Elle ne me dit rien sur les mouvements ultérieurs. Je vais répondre aux questions de votre lettre. Le Hügel de Mühlinen n’est ni le diplomate, ni le voyageur. C’était son attaché ici. Au sur plus ils ne se sont pas battus. Mais Mühlinen est presque fou. Il a menacé le roi de Würtemberg de publier sa correspondance particulière avec lui s’il n’augmentait sa paie. & je crois. que le Roi a fléchi. Sa femme veut se séparer de lui M. Ellice dit qu’il est venu à Paris pour moi, mais on dit qu’il y est venu pour autre chose, qu’il ne veut pas se trouver à Londres si on discute à la Chambre basse l’affaire de Lord Durham. Il est trop lié avec lui pour voter contre, & il lui serait impossible de voter pour quant à ses affections ministérielles. Il est pour Melbourne sans plus, & un peu contre tous les autres. Il veut que Spring Rice, Glenely et Powlett Tompson sortait et qu’on les remplace par Lord Morpeth, Francis Baring & & il voudrait bien aussi chasser Lord Palmerston, mais cela serait plus difficile.
Pourquoi êtes vous toujours enrhumé ? le changement d’air va vous faire du bien. Je m’arrange beaucoup mieux du l’air frais que de la chaleur, mais je n’ai encore à me vanter de rien, et vos glorieuses journées vont m’enlever le peu de sommeil que je prends. On me fait un bruit épouvantable déjà. Je pense quelques fois qu’il n’est pas convenable que je reste ici pendant ces vilaines journées. Mais quelles bonnes journées tout de suite après ! Adieu, adieu en dépit de votre rhume.
100. Paris, Lundi 24 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
100. Val-Richer, Mardi 25 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le rapport du général Simpson est trop laconique sur la France et l’article du Moniteur est trop expansif sur l’Angleterre dans l’un, le chagrin de n'avoir pas eu sa part de victoire, dans l'autre le désir de panser cette plaie là, sont trop évidents. Il ne faut pas tant montrer le but qu’on veut atteindre.
Ce que vous me dites de la lettre de M. de Meyendorff ne m'étonne pas. Je n'ai jamais cru que la chute de Sébastopol fût faire à personne, ni aux vainqueurs ni aux vaincus, un pas vers la paix. Je ne crois pas que vous souffriez aussi peu qu’il vous le dit, ni que vous enleviez aux Anglais tout le commerce de l'Asie, en interceptant quelques caravanes dans l’Asie mineure. Mais peu importe ; de vous défendre ; et personne ne sait jusqu’où ni dans le temps, ni dans l’espace ceci nous conduira. L’Europe est entrée, en aveugle dans un avenir inconnu. Je trouve qu’il y a un peu de fanfaronnade à dire après la prise de Sébastopol : " Voici le commencement de la véritable guerre" ; la guerre qui a mené à la prise de Sébastopol me paraît très véritable, on n'en fera jamais une plus rude ; ce qui commence, c’est la guerre obscure, illimitée, la guerre qu'aucune sagesse humaine ne dirige et n’arrête plus, et que Dieu seul fait aboutir où il lui plaît, et cesser quand il lui plait. On a manqué deux belles occasions de faire la paix ; je doute qu’il s'en présente une troisième ; et si elle se présentait, on la manquerait également.
Parlons d'autre chose. On m'écrit, d'Angleterre qu’on a trouvé la Duchesse d'Orléans fort changée et vieillie. Les projets aussi sont changés à Claremont. Chomel appelé là, a déclaré que la Reine ne pouvait, sans risquer sa vie, passer l'hiver en Angleterre. Elle quittera donc l'Angleterre lundi prochain, le 1er octobre, et ira s’établir, pour l'hiver à Gênes ou aux environs. Le Duc et la Duchesse de Nemours iront avec elle. S’il fait encore beau, on se promènera un peu en Suisse. Les Joinville resteront en Angleterre, mais non pas à Claremont ; ils ont loué une maison près du Duc d’Aumale. La Duchesse de Montpensier
non plus ne se porte pas très bien.
Onze heures
Ni vous, ni personne, ni les journaux ne m’apprennent rien. Il paraît certain que votre Empereur va, ou qu’il est déjà à Odessa. Il est impossible qu’il n’y ait pas là bientôt de nouveaux événements. Adieu, adieu.
Mots-clés : Diplomatie (Russie), Famille royale (France), Femme (portrait), Femme (santé), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866 ; reine des Français), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Europe), Politique (Russie), Réseau social et politique
100. Val Richer, Mardi 20 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà un chiffre qui me fait peur. Autrefois, quand nous étions longtemps séparés, nous savions quel jour nous ne le serions plus. Aujourd’hui, plus nous avançons plus nous entrons dans les ténèbres.
Votre Empereur doit être très froissé de ce qui se passe sur la côte de Circassie ; lutter depuis tout d’années contre ces montagnards et voir le terrain qu’on avait conquis, les forts qu’on avait élevés détruits en quelques jours par des coups de main d'étrangers. Je me figure à la fois la tristesse irritée de votre Empereur et la joie si imprévue de Schamyl. Celui-ci doit éprouver les mêmes transports dont Abdel Kader eût été saisi si, pendant qu’il tenait encore sur le bord du désert, les Anglais fussent venus nous chasser d'Algérie. Abel Kader languit à Pérouse. Schamyl a été plus heureux. Vos armées ne me paraissent pas plus actives ni plus triomphantes. en Asie qu’en Europe.
Que signifient ces quatre lignes du Moniteur. " Un arrangement vient d'être conclu à Constantinople, entre l’Autriche et la Porte, pour l’occupation continuelle des principautés de Moldavie et de Valachie par un corps d'armée Autrichien" ? Si c’est vrai, c’est le fait le plus décisif de la situation ; il indique le parti pris, par les Alliés, de soustraire les Principautés au Protectorat Russe et de les placer sous le Protectorat Autrichien. Je ne sais à quoi vous consentirez lors du rétablissement de la paix ; mais certainement si les choses suivent leur cours actuel vous n'aurez pas le statu quo ante bellium.
Onze heures
Voilà votre N°82 et je n’ai rien à dire pour combattre votre tristesse. Je vous écris tous les jours. Je me plains quand vos lettres me manquent un jour. Mais je sais à quel point les lettres sont insuffisantes. Le Duc de Noailles m'écrit qu’il va vous envoyer ses enfants. Petite ressource. Pas un mot de nouvelles. Adieu, Adieu. G.
100. Val Richer, Vendredi 27 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce n’est pas pour vous que je me lève de si bonne heure, mais je ne puis me refuser le plaisir de commencer par vous. J’attends demain M. Génie et M. Dumon. Ils me prendront un peu de temps, et je veux achever aujourd’hui quelques pages que j’ai promises à la Revue française. Je ne devrais pas promettre, car je tiens.
Cette semaine a marché bien lentement. Enfin la voilà qui s’en va. Dans trois jours, je me mettrai matériellement en route. Il pleuvait à seaux hier au soir ; ce matin, il fait beau. Peu m’importe pour mon voyage ; mais, pour mon séjour, je veux un beau temps frais, un temps qui vous plaise. Quand nous nous promènerons le soir, j’aurai besoin d’un peu de précaution, pas trop tard ou la calèche à demi fermée. Je sens très vite le serein. à la vérité le serein de Paris ne ressemble pas à celui de Normandie. Je suis bien aise que les Brignole et le duc de Palmella vous reviennent de Londres. Le dernier me paraît d’une société agréable et douce, quoiqu’un peu traînante, comme dit Voltaire de la prose de Fénelon. Ils vous raconteront tout, et vous me le redirez. J’aime beaucoup mieux avoir cela de la seconde main quand c’est la vôtre. Le plaisir que vous y prenez fait plus de la moitié du mien. Vous avez tort de vous obstiner sur la Belgique, car vous céderez. Si vous ne voulez qu’avoir un bon procédé pour le Roi de Hollande, à la bonne heure ; mais comptez que trois mois plutôt ou plus tard, l’affaire s’arrangera. En renonçant à toute prétention territoriale la Belgique à de bonnes raisons quant à la dette ; et ce qui vaut mieux que les raisons, peu lui importe d’attendre. Elle a le provisoire, et le temps ajoute à la bonté de ses raisons. Puis elle fera quelque offre raisonnable, quelque grosse somme payée tout de suite qui videra le différend. Du reste, l’Empereur ne me paraît guère vouloir autre chose que garder sa position et satisfaire son humeur. Il n’y a rien là de bien gênant pour personne. Je vous quitte pour travailler.
9 h. 1/2
Je vous reviens pour rire avec vous de la bêtise des journaux anglais. Est-ce qu’il y en a vraiment un qui ait pris cela au sérieux ? Voilà un beau thème d’éloquence pour le Maréchal Soult. Si vous êtes content de Lord Palmerston, j’ai tort au commencement de cette page. En tout cas ne soyez pas malade. J’y tiens beaucoup plus qu’à la dette belge. J’irai y veiller mardi. Adieu. Adieu.
101_1. Lisieux, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’arrive et je repars à l’instant pour Broglie, où je veux arriver pour déjeuner. J’ai été charmé, toute la nuit de mon apparition en passant. Je l’avais désirée sans l’espérer. C’est bien rare d’avoir plus qu’on n’a espéré. Adieu.
Je suis dans le bureau de poste, entouré de courriers et de commis. J’ai oublié la série des Numéros. Je la retrouverai au Val-Richer. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance
101_2. Broglie, Vendredi 17 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je tombe de sommeil. J’ai fort peu dormi cette nuit. Ce matin au moment d’arriver, je dormais profondément. Certainement, je dormirais si je ne vous écrivais pas. Mais je ne puis me résoudre à passer toute cette matinée sans vous. A midi et demie en sortant de déjeuner, il m’a pris un vrai mal aise physique. Que le bonheur devient promptement une habitude ! Une heure après vous avoir retrouvée, il me semblait que je ne vous avais jamais quittée ; et pendant bien des jours, à midi et demie, je m’étonnerai tristement de ne pas sortir pour aller vous voir.
Samedi 7 h.1/2
J’ai été interrompu hier par M. de Broglie. Quand on arrive de Paris, il semble toujours qu’on apporte des nouvelles. Il n’y en a point. Je le dis. La conversation languit un moment. Et puis, à défaut de grandes nouvelles, les petites arrivent, abondent, et la conversation se ranime et devient intarissable. J’ai passé hier ma journée à raconter ce que je ne sais plus aujourd’hui ce que je me rappellerais bientôt si j’allais causer ailleurs. Mad. de Broglie vient de partir ce matin avec sa fille. Elle passera deux jours à Paris pour assister au grand concours de l’université où son fils a des prix, et le ramènera, sur le champ ici. Mad d’Haussonville partira du 28 au 30 pour Milan, Rome, Naples et l’hiver en Italie. Mad. de Broglie voulait absolument que nous passassions encore quinze jours ici. J’y serais revenu reprendre ma mère, et mes enfants, à mon retour de Caen. Mais je veux rentrer chez moi. Il faut une raison pour que je me plaise à en sortir longtemps. J’ai trouvé ma mère bien et mes enfants, à merveille. Guillaume est engraissé. Votre petit nécessaire a eu un grand succès. Henriette veut vous écrire. Et Pauline, qui ne sait pas écrire veut vous écrire aussi pour vous remercier avec sa sœur et pour sa sœur. Mes deux filles, sont très unies. Il faut qu’elles fassent toujours la même chose. Tout est commun entre elles. C’est un appui, et un repos dans la vie qu’une vraie intimité fraternelle. Et puis ce spectacle me plaît. Mes filles sont, dans leur famille, la troisième génération qui me le donne. Et toujours l’aînée supérieure à la cadette, et la plus dévouée, la plus prompte, aux sacrifices matériels pour sa sœur.
101. Ems, Mardi 18 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mardi
Je n'ai rien. Rien qu'un nouveau rhume que je dois au beau temps. Il fait chaud depuis trois jours et j’ai été assez habile pour en profiter de cette façon. Hier presque tout le jour dans mon lit. Cela ne m'empêchera pas cependant d’aller après demain à Schlangenbad. J’y vais sans plaisir comme tout ce que je fais depuis 6 mois. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis Mercredi dernier. C’est bien long.
Voici votre lettre de Vendredi bien courte. Nous ne savons plus que nous dire. Il y a trop pour moi j’étouffe. Une longue lettre de Morny, il a vraiment été bien mal, il l’est encore. On ne sait encore où l'envoyer, Oliffe l’accompagnera. Pas l'ombre d'espérance de la paix. Des bonnes paroles pour moi de St Cloud.
Brockhausen s'écrit ainsi. Il est à Spa avec Hasfeld. Tous deux se lamentent, hopeless case. Au fond j'aimerais aller à Spa. Je suis d’un appétit vorace pour la conversation. L’idée de n'en avoir pas du tout me met dans un vrai désespoir.
Le gros comte Woronov que vous avez vu à Paris le gendre de M. Narchikein vient de mourir subitement du choléra à Peterhof où il était allé pour la fête de l’Empereur. Grande consternation à là cour. Il était fort aimé. Je n'ai rien à vous dire ; tous les jours je suis plus triste. Adieu. Adieu.
101. Paris, Mardi 24 juillet 1838 ,Dorothée de Lieven à François Guizot
Quel bonheur quand il n’y aura plus de lettre à écrire ! Voilà une exclamation d’amour et de paresse. Faites les proportions. Ma nuit a été si mauvaise que j’ai dormi jusqu’à dix heures dans le matinée. Il faisait frais cependant, presque froid en vérité. Ma journée hier a été tellement rien du tout que je n’ai pas de compte à vous en rendre. Je n’ai vu personne que Madame Durazzo et Madame Pozzo. A propros le vieux Pozzo est retenu à Londres parler conférences. Il n’a plus de calcul car Dieu sait comme elles iront. On ne s’arrange pas pour le partage de la dette.
Lady Cowper m’a écrit une amusante lettre toute remplie de petites choses. Entre autres, le duc de Sussex qui est un sot comme vous allez voir a donné à dîner au Maréchal Soult en invitant aussi Sébastiani & Flahaut & en portant la santé du Maréchal il a raconté l’histoire de la candidature pour l’ambassade. Lady Cowper ajoute que Flahaut a fait bonne contenance mais que si Marguerite y avait été, on est sûr qu’elle lui aurait jeté un plat au visage. La Reine à son dîner diplomatique a pris le bras de son oncle, de Coburg, ce que les Ambassadeurs ont été obligés de subir ; mais en revanche ils ont pris le pas sur son frère de Linauge, ce qui a déplu à la Reine. Le bruit court à Londres que le grand duc n’y ira pas cette année. J’ai prié la Reine de Hanovre et mon frère de m’apprendre enfin ce qui va devenir mon mari, car toujours encore je n’ai pas un mot de lui.
Savez-vous que je vis exactement comme je ferais à la campagne ? Comme cela me déplairait fort à la campagne, & comme cela me plait parfaitement ici. De l’air, beaucoup d’air, des heures fort bourgeoises, de la solitude ; mais comme elle est volontaire, voilà la différence. Et puis deux fois la semaine du monde, pour me bien prouver que je fais bien de ne pas le recevoir tous les jours, car il ne m’amuse point du tout. Le Pape a de l’Esprit. Comme il y en a peu dans le monde ! Adieu. Mardi prochain à cette heure-ci midi & demi que d’adieux !
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Angleterre), Réseau social et politique
101. Paris, Mardi 25 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre ce matin contient des appréciations bien justes sur toutes choses. Elle me rappelle que j’ai entendu dire ici. "Nous prendrons des indemnités en Prusse." On me dit, mais pas de source que le vice roi d’Egypte ne vient pas craignant que sa réception en Angleterre ne répond pas à ce qui lui revient. Ni on lui préparait M. Fould m’a simplement l'Elysée. dit qu’il était tombé malade à Malte. J’ai revu hier le duc de Noailles. Il questionne, il ne dit rien. J'ai bien envie de me remettre je ne me remets pas. Le temps tourne au froid, cela m’ira mieux peut-être. Lord Lyndhurst vient passer l'hiver à Paris. Une lettre de Greville. Avec des commérages.
En voici un sur moi. J’ai écrit à Marion dans le temps un récit de la visite de la reine. Elle envoye une lettre à son oncle, l'oncle la renvoie à Lady Asherton à Londres, celle ci à lord Clarendon à sa campagne. & lord Clarendon à Balmoral à la Reine, qui en a été charmée. Voilà qui est long. Adieu. Adieu.
101. Val-Richer, Mercredi 26 septembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ni moi non plus je n’ai rien à vous dire. Quoi que j’ai eu depuis quelque temps, assez de visites, ma vie est la plus calme du monde ; il m’arrive des personnes, mais non des conversations.
J'en ai un peu pourtant avec Mad Austin qui est chez moi encore pour quelques jours et avec qui je m'entends très bien. Elle appartient à une excellente espèce de radicaux intelligents, devenus conservateurs et pacifiques par honnêteté et bon sens. Les lettres qu’elle reçoit de ses amis d’Angleterre sont très judicieuses, mais sans espoir. de 1811 à 1815, l’Angleterre a eu la Russie pour abattre la France ; aujourd’hui elle à la France pour abattre la Russie. Plus je me rappelle 1815 et j'observe 1855 plus je me félicite de ne m'être mêlé des affaires de mon pays qu'entre ces deux époques, et pour pratiquer une politique bien différente de l’une et de l'autre. Je n'entendrai probablement pas de mes oreilles, le jugement qu’en portera l'avenir ; mais je ne le crains pas.
Je suis fort aise que Lady Holland reste à Paris. C’est une bonne pièce pour vous. Quand revient Morny. Il me semble qu’il devrait être déjà revenu. Les Conseils généraux sont finis partout depuis longtemps. dans ce pays-ci, les subsistances sont de plus en plus la grande préoccupation publique. Les ouvriers ont encore beaucoup de travail ; mais, même avec le travail, la vie leur est difficile ; s'ils en manquaient, je ne sais vraiment ce qu’ils deviendraient, et par conséquent ce qu’ils feraient. Je suis convaincu que cela ne peut jamais être dangereux ; mais cela peut être très malheureux et très orageux.
Midi.
Le N°101 arrive tard. Il n’y a pas de mal à ce que votre lettre à Marion soit allée à Balmoral. C’est un bon commérage. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Amis et relations, Circulation épistolaire, Conversation, Femme (de lettres), Femme (politique), Femme (portrait), France (1814-1830, Restauration), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Angleterre), Politique (Russie), Pratique politique, Réseau social et politique, Salon
101. Val Richer, Mercredi 21 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le siège de Silistrie est fatal aux généraux ; Messa Pacha tué et le général Schilder la jambe emportée. La blessure du Maréchal Paskevitch paraît moins grave. Il n’y a pas grand mal à ce que les coups portent un peu haut quelque brave qu’on soit, ces avertissements ont leur effet.
Voilà toutes mes réflexions d'aujourd’hui. Je n'en ai pas plus que de nouvelles. On a beau faire, on a beau écrire tous les jours et n'avoir rien à cacher. Il y a des abymes. entre la correspondance et la conversation. Si nous causions, j’aurais de quoi remplir ces abymes-là.
J’ai eu du regret en vous voyant quitter Bruxelles. Je n’avais pas tort. Vous aviez là du moins des habitués, et des habitués de votre robe. Vous n'aurez à Ems que des rencontres. Le Duc de Richelieu vous restera-t-il un peu longtemps ? C'est à Dieppe qu’il fait ordinairement sa saison d'eaux. Mais pour ce temps-là, les bains de mer ne sont pas encore de saison. Il n’y a encore personne à Trouville. On y attend demain le Chancelier et Mad. de Boigne. Les Broglie y viendront à la fin de Juillet. Assez de monde, dit-on. Cela me dérangera un peu. Le Val Richer est un des délassements de Trouville. Tout le monde n'a pas aussi peur que vous de trois heures de voyage. Vous souvenez-vous comme vous avez été maussade le jour où vous êtes venue ici avec Lady Alice ?
Vous êtes très bonne protestante, mais vous n'êtes ni théologienne, ni philosophe, ni historien ; je ne vous engage donc pas à lire une Défense du protestantisme contre les Ultra Catholiques que M. de Rémusat vient de publier dans la Revue des Deux Mondes. C'est pourtant un écrit très distingué, plein de bon sens et d’esprit, de vérité, et d'à propos. Si nous étions ensemble, je vous le lirais, et je vous le ferais goûter.
Midi
Point de lettre de vous, mais des nouvelles qui seraient bien grosses et bien bonnes, si elles étaient vraies ; le siège de Silistrie suspendu, le maréchal Paskevitch se retirant au delà du Pruth. Il ne manque plus que l'annonce d’un congrès. Je n'ose y croire. En attendant, adieu, Adieu. G.
101. Val Richer, Samedi 28 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier mot. Il sera court. Ni ma joie, ni mon chagrin ne sont bavards. Pourvu que je vous trouve bien portante ! Votre mal aise m’a préoccupé tout le jour. De quoi vous parlerais-je ? J’ajourne tout à mardi. Ce jour là, je n’aurai point encore de jury. Tout mon temps sera à moi. Pourquoi donc, est-ce que je vois encore dans les journaux que Lord Granville a été chez le Roi ? Est-ce qu’il n’est pas parti pour Aix ? J’attends Génie ce matin. Il vous aura vue. C’est quelque chose quelqu’un qui vous a vue, en attendant que je vous voie moi-même. Je laisserai mes enfants très bien et ma mère assez bien. La santé de ma mère, me préoccupe beaucoup. Elle est heureuse. Elle l’a si peu été ! Elle jouit vivement de l’affection de mes enfants. Ils remplissent son temps et son âme. La campagne lui plaît. J’espère que le soir de sa vie se prolongera au milieu de ces impressions douces. Et elle m’est si nécessaire pour mes enfants ! A travers beaucoup de petites choses qui manquent et qui m’impatientent quelquefois, toutes les grandes y sont et me donnent une sécurité habituelle que rien ne pourra remplacer. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu’après l’arrivée du facteur. Mais il sera ici probablement avant M. Génie. Adieu donc. à mardi, midi et demie
9 h. 1/2
Le facteur ne m’apporte pas de lettre. Je suppose que M. Génie me l’apportera dans une heure. Je veux bien de cet échange. Mais sans cela, je serais inquiet. En attendant, adieu, le dernier. G.
102. Ems, Vendredi 21 juillet 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Encore Ems. Tout était prêt ; mes gens à peu près partis & moi sur le point de monter en voiture hier, j’attendais seulement la poste & mes lettres. En voilà une d’Olliffe qui m'annonce que lui & Morny seront ici aujourd’hui. Je remets mon départ, je les attends. Hélène n’a pas pu attendre, elle est partie et mon fils aussi. Ce matin une lettre de Morny du même jour mais plus dubitative. Cela me vexe. Je n’attendrai pas au delà de demain, et je partirai. Par quoi finira ma tristesse ? Je ne me sens de courage à rien si vous étiez là ! Ah mon Dieu quelle bénédiction, quel bonheur ! Mais personne à qui dire ce que je pense, personne même avec qui causer de ce qui se passe et dans quel moment !
Je ne crois pas du tout à la soit-disant dépêche de Nesselrode à Budbery. C’est trop absurde et d'un ton qui n’est pas à notre usage. Les minoteries à droite et à gauche sont incroyables. Constantin est toujours à Peterhof. La mort du Comte Vorontsov a causé là un vif chagrin. Tout de suite après les couches malheureusement de la Grande Duchesse Catherine, femme du Duc George de Mecklembourg. Elle était très mal et l’enfant mort. On ne parle plus des flottes à Peterhof, ni de la guerre.
Évidemment l’Autriche hésite encore. Cela ne peut cependant pas se prolonger. La Prusse est toujours en grande tendresse pour nous. Les petits allemands attendent avec curiosité. Il me paraît que l’Espagne tout entière à fait son prononciamento. Ce n’est pas mauvais, mais cela peut nous donner du nouveau. L’Europe est bien arrangée ! Adieu & Adieu.
102. Paris, Mardi 25 septembre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Madame Sébach est revenue hier, mais ne raconte ou ne sait absolument rien. Je la trouve fort calme, son mari aussi plus de gasconades. Le changement d’itinéraire de mon empereur est un événement. Quand M. m' écrivait le 13 il n'était pas question de cela, & on savait alors Sévastopol. Il me parait évident que nous resterons en Crimée & que nous nous défendrons. Cela peut durer, & surtout coûter encore beaucoup de monde. Ah mon dieu.
Lady Allice me mande en date de hier que la duchesse d’Orléans part aujourd’hui. pour Esenach. Départ un peu brusque car on avait annoncé qu’elle resterait jusqu'au 1er. Le prince de Prusse fait son chemin auprès de la princesse royale. Cela va très bien à Balmoral. Le mariage cependant ne pourra guère se faire.
J’entends de tous côtés faire l’éloge des qualités de cœur de mon empereur mais de l’esprit, personne ne lui en donne. C’est bien dommage. We cannot help it. Moi je crois qu'il a bien des qualités s'acour de qui valent cela. L'amour de la justice et on dit ferme. Adieu. Adieu.
102. Paris, Mercredi 25 juillet 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ellice est entré chez moi hier matin en criant " Vive M. Guizot. Le précepteur est trouvé, une merveille, " et vraiment M. Ellice est d’une joie & d’une reconnaissance sans pareilles. M. Lorain est venu chez moi un moment après, et tous les arrangements ont été faits en ma présence. Je vous remercie beau coup d’avoir si bien arrangé cette affaire. Je n’ai pas vu l’homme mais Ellice le trouve plus gentleman que qui que ce soit.
La petite Princesse et son mari m’ont enlevé un peu de temps hier matin, mais il faisait assez laid et je n’ai pas songé à Longchamp. J’ai fait une visite à Auteuil. Une fort petite promenade après, le dîner ; et puis une heure tout à fait perdue chez moi de 9 à 10. Comme je ne puis ni lire ni travailler. le soir, je vois qu’à moins de très beau temps il me faut un peu de société. Je n’innoverai rien jusqu’à votre arrivée, soyez tranquille. Mais après le honey moon comme vous l’appelez, je reprendrai peu à peu mes anciennes allures. On dit qu’il est sérieusement questions d’appeller le fils du duc d’Orléans, si fils il y a, comte de Paris. On espère qu’il viendra au monde ou le 29, ou le 3 août, ou le 7 ou le 9. En effet voilà plusieurs bonnes occasions. Ce serait maladroit de ne pas en profiter. Londres va finir cette semaine, je me fais fête ds revenants. J’aime votre voisin, ce grand prôneur des mérites de l’Angleterre. Ah quel beau pays. Décidément il faut que nous y allions ensemble, en passant par Boulogne. Que de rêves !
L’Egypte & la Belgique occupent ici le cabinet. Appony était fort interisting & Le comte Pahlen sera de sérieux hier. retour avant le 20 août, je m’en réjouis. Mais nous allons perdre la petite Princesse, quel dommage ! Adieu. Je vous quitte pour aller me réchauffer les pieds au jardin. Voilà où nous en sommes en fait d’été, mais je ne me plains pas, j’aime ceci mille fois mieux que le chaud.
Adieu. Adieu. J’ai des moments de tristesse abominable depuis quelques jours. Vous en sauriez croire tous les efforts que je fais pour combattre cela. Car c’est affreux de me livrer aux souvenirs les plus doux. Je n’ose pas regarder en arrière. Et mon avenir ? Je n’en ai pas. Ah si je n’avais pas votre tendresse, je serais perdue. Ne m’en ôtez rien, jamais, jamais. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Politique (Internationale), Réseau social et politique