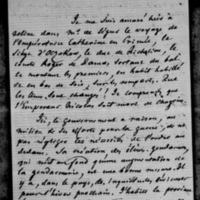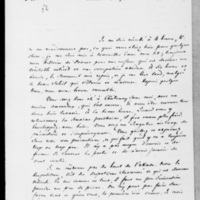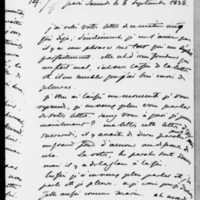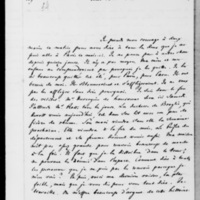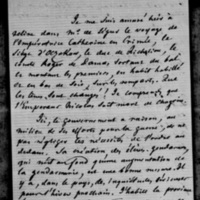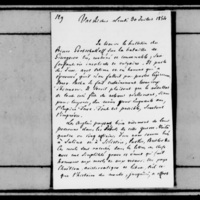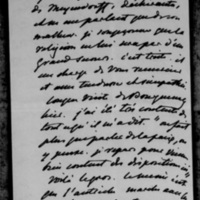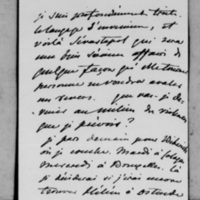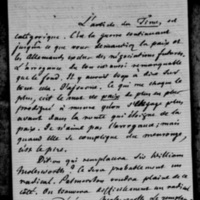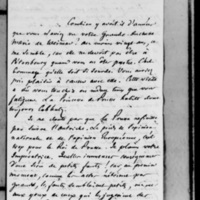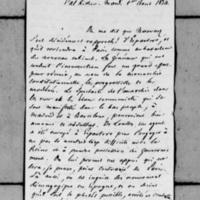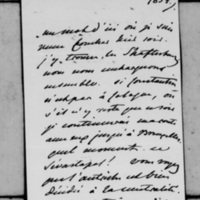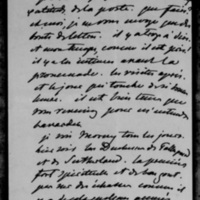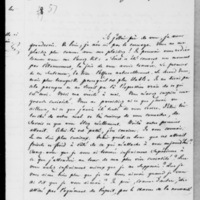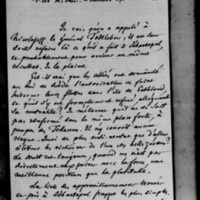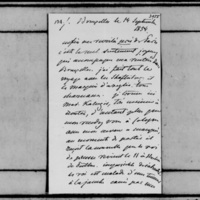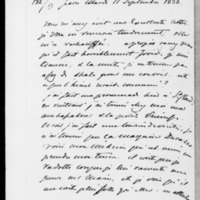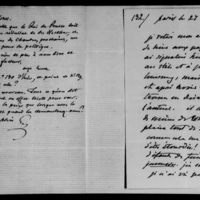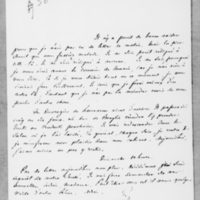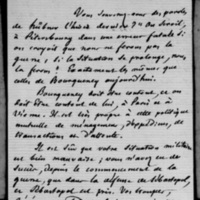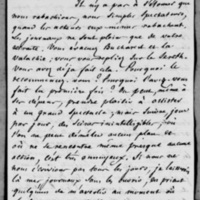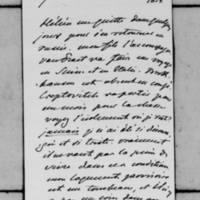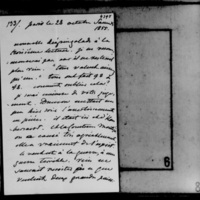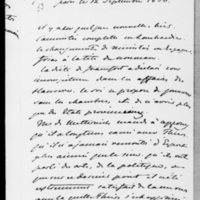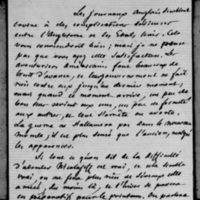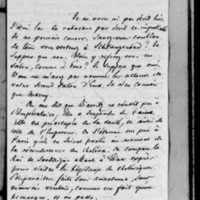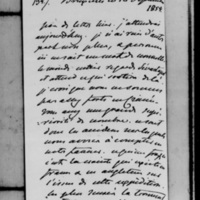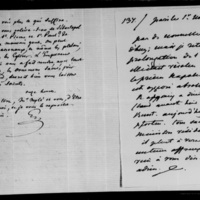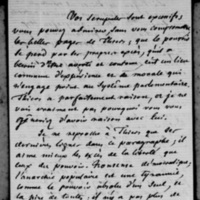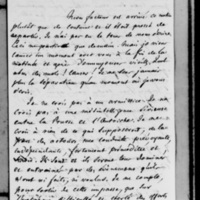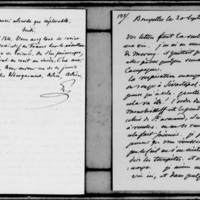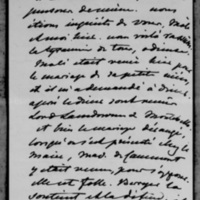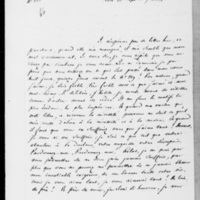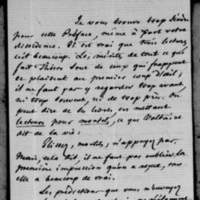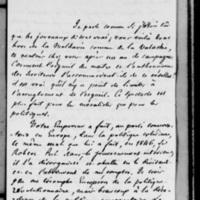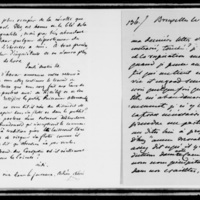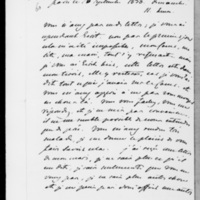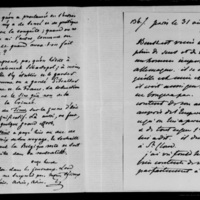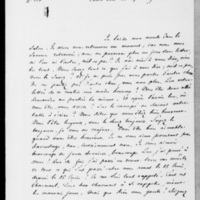Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
128. Schlangenbad, Jeudi 7 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
C. Gr. me dit que l’armée française est tout-à-fait. démoralisée, et diminuée d'un cinquième c’est ce que mande Cowley sur les rapports de St Arnaud. Cependant il voulait faire l’expédition ; mais l’étonnement est grand de ne point parvenir à connaître l’état de nos forces, il ne se rencontre pas un traitre. On dit 150 m.
Cela parait très exagéré, je vous ai dit que Woronzow n’estime pas que nous en Crimée puissions avoir plus de 50 m au surplus. Il ne se disait pas informé. Notre refus des propositions appuyées par l'Autriche laisse celle-ci sans prétexte de procrastinations, cependant on ne croit pas qu’elle nous déclare la guerre, mais on pense qu’elle avancera lente ment à mesure que nous reculerons jusqu’à notre frontière. Elle occupera paisiblement les principautés et se croisera les bras.
La paix paraît plus éloignée que jamais.
Tout cela est un curieux spectacle. Si la guerre a été peu glorieuse pour nous jusqu'ici, elle n'a pas beaucoup réhaussé les puissances alliées. Il semble qu'on soit respectivement frappé d'impuissance, à moins que la Crimée n'en fasse, exception, ceci aura été une pauvre campagne. La durée nous est plus favorable qu’à vous. Nous sommes au centre de nos ressources. Vous êtes éloignés des vôtres. Ce que vous n’avez pas pu attaquer cette année-ci vous le pourrez bien moins l’année prochaine car nous aurons employé le répit à nous renforcer. Vraiment de part & d’autre ce qu'il y a de mieux à faire c’est de s’arranger. Comment faire passer ces vérités dans les têtes qui gouvernement, ou dans plutôt celles que ne gouvernent pas les Anglais. Les Cabarets et les journalistes là. Le journal de Francfort dit que la Reine Christine est atteinte d'aliénation cérébrale. La princesse [Crasalcoviz] vient d’arriver ici. Folle aussi. Elle ne veut pas voir Morny, en ce cas elle ne viendra pas me voir car il y est sans cesse. Demain je vous manderai le jour de mon départ. Adieu. Adieu.
128. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis amusé hier à relire dans M. de Ségur le voyage de l'Impératrice Catherine en Crimée, le siège d'Oczakow, le Duc de Richelieu, le comte Roger de Damas, sortant du bal et montant les premiers, en habit habillé, et en bas de soie, sur les remparts. Que les temps sont changés ! Je comprends que l'Empereur Nicolas soit mort de chagrin.
Ici, le gouvernement a raison, au milieu de ses efforts pour la guerre, de ne pas négliger les nécessités de l’ordre au dedans sa création des élèves gendarmes, qui n’est au fond qu’une augmentation de la gendarmerie, est une bonne mesure. Il y a dans le pays, des inquiétudes sérieuses, pour l'hiver prochain. J'habite la province, la plus tranquille de France, quoique ce soit en même temps celle où le blé est le le plus cher. Je ne crois pas qu’il y ait de désordre ici ; mais on le devra au bon esprit des habitants et à l'étendue de la charité publique. On ne se pas aussi sage partout.
On m’écrit de Paris, et je vois dans Havas que Bourqueney retournera à Vienne comme ambassadeur. Cela ne peut arriver sans qu’on en fasse autant pour Hübner. Il serait bien content.
Est-il vrai que Richard. Metternich aille à Madrid, et que sir William Molesworth soit très mal ? Pure curiosité de conversation, car ni l’une ni l'autre n'a d'importance politique, et ne m'inspire vraiment d'intérêt personnel. Dans trois semaines, je n'écrirai plus mes questions.
Onze heures
Pas de lettre. C'est certainement encore une irrégularité de la poste, service mal fait-ici. Adieu, Adieu. G.
128. Val-Richer, Mercredi 12 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis réveillé à 4 heures, et ne me rendormant pas, en quoi vous étiez bien pour quelque chose, je me suis mis à travailler dans mon lit ; toujours mon histoire de France pour mes enfants qui est devenue un véritable intérêt et une occupation assidue. A six heures et demie, le sommeil m’a repris, et je me lève tard, malgré ce beau soleil qui s’étonne et m’accuse. Depuis quelque temps, nous nous levons ensemble.
Vous avez donc été à Châtenay sans moi, avec un ancien amoureux, qui l’est encore. Et vous êtes revenus tous deux bien transis. A la bonne heure. Quand vous y retournerez, la semaine prochaine, il fera encore plus froid. Enveloppez-vous bien. Vous avez un singulier mélange de précaution et d’imprévoyance. Vous quittez et reprenez sans cesse vos précautions, ce qui fait qu’il y en a toujours trop ou trop peu. Il n’y a pas moyen d’ouvrir et de fermer si souvent les portes et de n’avoir jamais de vent coulis. Je ne m’étonne pas du bruit de l’ukase. Outre le despotisme, c’est du despotisme suranné et qui est devenu ridicule. En ceci comme en tout, il faut un peu d’invention, prendre un peu de peine. On n’y peut pas faire sans façon tout ce qu’on veut, la première idée venue.
Je crois que M. de Pahlen aurait tort de démentir sans être bien sûr de son fait. Il est lui un galant homme et qui se respecte. Il ne lui serait pas indifférent de n’avoir pas dit vrai, ou de n’avoir pas su ce qui était vrai. Et puis c’est une étrange manière de gouverner que de n’informer de rien les agents, de ne pas plus compter avec eux, qu’avec ses sujets. Comment veut-on qu’ils fassent et qu’ils servent surtout dans les pays où on parle de tout, et où il faut avoir au moins l’air de tout savoir ?
Sur le procès du général Brossard, j’ai deux visages, l’un qui pleure, l’autre qui rit. Mon pauvre ami Bugeaud s’est conduit là, avec son esprit grossier et sa probité plus vraie que délicate. Je l’y reconnais bien et j’en suis fâché. Je vous ai dit hier mon impression quant à M. Molé. Je m’afflige moins de ce qui la prouve et la répand. A la légèreté j’ajoute la promptitude à abandonner ses agents. Singulier homme de gouvernement ! Incapable de suffire à la moindre difficulté sérieuse, mais très propre à pallier l’étourderie et la faiblesse ; frivole et poltron en fait, mais grave et digne en apparence. Il a son moment.
Vous voulez que je vous dise souvent que je vous aime. Je voudrais vous le lire toujours. C’est mon chagrin de ne pas le pouvoir. Je mourrai avec l’amer regret de ne vous avoir pas donné, montré toute ma tendresse, de n’avoir pas rempli toute votre âme, embaume toute votre vie de cette joie profonde et douce, solide et charmante que répand incessamment un amour vrai, le vrai amour. Je l’ai en moi pour vous. Je vous crois, je vous sais capable et d’en jouir et de le sentir. Je crois qu’il y a en vous des trésors à vous-même inconnus de bonheur et de tendresse. Je suis sûr que j’ai en moi de quoi vous plaire et vous rendre heureuse bien au delà de notre imagination à tous les deux, car la réalité, quand elle est belle, est supérieure à notre imagination de toute la supériorité de l’œuvre divine sur la pensée humaine. Je sais tout cela, et cela n’est pas, cela ne sera pas. J’aurai, pour vous des joies que je ne vous donnerai pas ; j’en attendrai de vous que je ne recevrai par. Je vous verrai des peines que je ne guérirai pas. Je tiendrai dans mes mains le manteau de Raleigh, et je ne pourrai pas l’étendre toujours devant vos pas. J’ai accepté, j’accepte de bonne grâce l’imperfection la médiocrité, la pauvreté de la vie et des relations humaines. Avec vous je ne l’accepterai jamais.
10 heures
Vous avez raison. Voilà un Numéro 132 bien shabby. J’avais envie de toute autre chose aujourd’hui. Adieu pourtant. Je vous rends votre adieu. C’est ce qu’il y a de mieux dans la lettre. Si Marie n’est pas folle, cela ne vaut pas mieux pour vous et au lien d’avoir pitié d’elle, je suis tenté d’en avoir pour vous.
128. Val Richer, Dimanche 30 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis croire que l’amiral Berkeley soit assez sot pour avoir produit les lettres qu’il a produites à la Chambre des Communes sans que le Cabinet en ait été d’avis. On a probablement, voulu expliquer par là l’inaction d’une si grande flotte. Cela explique en effet l’inaction, mais non pas l'imprévoyance. On aurait dû savoir cela plutôt. Ce serait payer bien cher la découverte qu’une place est imprenable s’il fallait chaque fois équiper et envoyer sous ses murs l'armée nécessaire pour la prendre. En tout cas, ceci ne me donne aucune espérance pacifique. On vous bloquera jusqu'à ce qu’on aie trouvé par où vous êtes vulnérables. L'occupation de l'île de Gothland par nos troupes si elle est réelle est un fait bien grave. La Suède entre donc dans l'alliance. Cela donne aux alliés des ports dans la Baltique, où ils peuvent hiverner, et se trouver prêts dès que la mer sera libre. C'est la principale difficulté de la guerre dans le Nord supprimée pour eux. Je le pense comme vous, toute la politique de l’Europe est changée, toutes les situations, toutes les alliances. Le premier qui démêlera, les conséquences de cette révolution, et qui entrera hardiment dans les voies de l'avenir qu'elle prépare, sera pour un long temps, le maître de l’Europe. Nous n'épuiserions pas ce sujet en huit jours, si nous causions.
Avez-vous remarqué l'article sur les Finances russes qu'a répété le Moniteur d'avant hier vendredi. Je ne connais pas assez bien les faits pour apprécier la valeur de ses assertions ; mais soyez sûre qu’il fera de l'effet. On croira à votre banque route si la guerre se prolonge. Et on fera tout ce qu’il faudra pour vous empêcher de trouver de l'argent hors de chez vous, ce qui ne sera pas difficile si on croit vos finances embarrassés à ce point. Le discours de Lord Palmerston sur le bill de Lord Dudley Stuart, et la faveur avec laquelle il a été reçu, sont très significatifs.
Aberdeen a une joie de famille. Son dernier fils Arthur, qui voulait le faire Clergyman y renonce et entre dans la chambre des communes. Le père le désirait beaucoup. C’est un très honnête et spirituel jeune homme. Je l’ai vu un moment cet été à Paris, où il a passé en accompagnant à Bordeaux une vieille amie de son prre. Je l’ai trouvé très au courant de toutes choses, et très sensé sur toutes choses.
Que dites-vous du mariage de Lord Harry vane. Je n’avais pas remarqué la mort, très peu remarquable, de Lord Dalmeny. Je me rappelle, très bien Lady Dalmeny, vraie beauté de Keepsake. C'est la soeur de Lord Mahon, si je ne me trompe, Midi. J'adresse toujours mes lettres à Schlangenbad. Adieu, Adieu. G.
129. Paris, Samedi 8 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai relu votre lettre de ce matin cinq fois déjà, décidément je ne l’aime pas. Il y a une phrase surtout qui me déplaît parfaitement. Elle est d'une froideur qui me fait mal, c’est vers la fin de la lettre et il me semble que j'ai bien envie de pleurer.
Je vous ai laissé un moment je vous reprends, je ne veux plus vous parler de votre lettre. Savez-vous à quoi je pense maintenant ? Ma lettre, cette lettre de mercredi, il y avait de dures paroles peut-être mais un grand fond d’amour au dessous de cela, la vôtre, les paroles sont douces, mais il y a de la glace à la fin. Enfin je n'en veux plus parler et j'en parle et je pleure. & je crois que je deviens folle aussi comme Marie. Ah mon Dieu que j’ai de peines, et de tout genre ! Mon fils me quitte aujourd’hui, cela me chagrine.
La Duchesse de Talleyrand est venue me voir hier matin. Elle vient plaider contre son mari, et même commencer peut-être le procès. Elle se dit très calme mais elle avait de temps en temps l’air un peu féroce. Fort belle cependant, car la férocité va bien à ses traits. Elle m’a conté mille choses curieuses sur mon empereur & sa femme. On a pour lui, à ce qu’elle dit, et pour les Russes en général, la plus grande haine en Allemagne. On se courbe devant lui, mais on le déteste. En Bavière une peur effroyable qu’il ne veuille y marier sa fille. Enfin c’est curieux, et par dessus cela des bêtises ah !! Les Appony sont venus aussi hier matin. Il parait que vraiment l'Empereur veut du Prince Leuchtemberg pour l'un de ses gendres. Si cela est, on en rira bien ici. Décidément les hôtels d’ambassade respectifs cesseront entre Paris et Pétersbourg. Pahlen va en acheter un pour le compte de l'Empereur. Il voulait acheter à la couronne celui où il est, vous ne le voulez pas. Le Roi est mécontent de cette affaire. Il croit et il a raison de le croire, que ce sera regardé & commenté comme une mesure politique. J’ai dîné comme de coutume avec mon fils et Marie, le temps était affreux je n’ai pas pu sortir le matin. Le soir, j'ai été faire une courte visite à Mad. de Talleyrand, & à Mad. de Castellane que j’ai trouvée seule. Elle paraissait croire qui Louis Bonaparte sortira de Suisse & cette affaire ne donne plus de souci selon les apparences. Thiers a vu M. de Metternich très longuement. On les dit ravis l’un de l’autre. Cela devait être. Des gens d’esprit se séparent toujours satisfaits l'un de l’autre. M. de Metternich est coquet comme une femme. Il aura emporté Thiers, & l'esprit, la vivacité, la franchise, de celui-ci auront plu à M. de Metternich, beaucoup. L'entretien a duré trois heures. Metternich a été chez Thiers. Je suis au bout de mes commérages d’hier. J'ai eu une lettre de Lady Granville, charmante, sur tout parce qu’elle s’annonce pour Mercredi. Le grand Duc est à Weymar depuis hier. Il sera à Baden le 17, pour y rester quinze jours. Adieu, je suis extrêmement triste & par vous. Ah que nous allons mal quand nous somme séparés. Si je vous montrais cette mauvaise phrase, vous auriez froid aussi. Adieu.
129. Schlangenbad, Vendredi 8 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je quitte ceci Mardi le 12. Ce n’est qu’à Cologne que j’apprendrai si je vais droit à Bruxelles ou Ostende. C’est selon où se trouve Hélène. Adressez vos lettres à Bruxelles. Voilà qui nous rapproche. C’est de la pure imagination mais il me semble que je vais vous voir. Il fait déjà très froid ici. La Princesse Crasalcoviz y reste jusqu'à mon départ. Morny partira avant moi et puis il ne restera plus personne.
Regardez un peu vers les Etats-Unis. Il me semble qu'il se prépare là des choses qui peuvent donner une tournure nouvelle aux affaires de ce côté-ci. Les journaux sont assez intéressants. Le journal. de Francfort a des correspondances curieuses et très officielles. Il est au service, de plus d’un gouvernement Adieu. Adieu.
Tout ce que vous dites de là . situation est parfaitement la vérité. Chez nous on ne l'écoute pas, on n'écoute plus que l'orgueil. On a peut être raison.
129. Val-Richer, Jeudi 13 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je prends mon courage à deux main ce matin pour nous dire à tous les deux que je ne puis aller à Paris ce mois-ci. Je ne pense pas à autre chose depuis quinze jours. Il n’y a pas moyen. Ma mère et mes enfants ne comprendraient pas pourquoi je les quitte. Je les ai beaucoup quittés cet été, pour Paris, pour Caen. Ils ont besoin de moi. Ils s’étonneraient et s’affligeraient. Je ne veux pas les affliger sans dire pourquoi.
Je suis dans le feu des visites. M. Duvergier de Hauranne sera ici samedi. J’attends, M. Rassi tous les jours. La Duchesse de Broglie qui devait venir aujourd’hui est dans son lit avec un peu de fièvre de rhume. Son mari viendra sans elle la semaine prochaine. Elle viendra à la fin du mois. Le Préfet du département et sa femme doivent venir aussi. Ma maison n’est pas assez grande pour recevoir beaucoup de monde à la fois. Il faut que je les distribue dans le temps ne pouvant les réunir dans l’espace. Comment dire à toutes les personnes que je ne puis pas les recevoir parce que je m’en vais ?
Et puis voici ma dernière raison, la plus faible mais que je vous dis pour vous tout dire. Je travaille. On m’offre beaucoup d’argent de cette histoire de France que je raconte à mes enfants. Je l’écris. Je voudrai rapporter à Paris un manuscrit déjà un peu long. J’ai besoin d’argent. Celui-là me convient. Je vous ai tout dit excepté mon chagrin. Et mon chagrin, je ne sais pas vous le dire, si j’étais sûr que vous ne croirez pas le vôtre plus grand que le mien, que vous ne serez pas méfiante, injuste ! Mais je n’en suis pas sûr. J’ai le cœur malade. Cela passera ! Cela passera quand nous serons rétablis l’un près de l’autre, quand nous nous serons tout dit quand la parfaite confiance ne sera plus un besoin, mais une habitude. L’hiver, l’hiver.
J’ai touché hier en vous écrivant, mais à peine, mais comme on touche quand on a peur à ma tristesse et à sa vraie cause. Notre affection est intime, bien intime ; mais le lien qui nous unit est bien faible, bien léger. Il y a, entre notre vraie relation, et notre relation apparente autre nos cœurs et notre situation, un contraste, une distance, un abyme qui font trembler. Et qui rendent tant de choses impossibles! Il faut du temps, beaucoup de temps. Le temps peut beaucoup sur ce mal là. Quand bien du temps, aura passé sur nous, il nous aura si complètement révéler, si clairement prouvés l’un à l’autre, que toute méfiance, toute agitation disparaîtra, comme toute obscurité. Le mal de la privation pourra exister, non celui du doute. Et puis le temps rend l’intimité naturelle, et toutes ses preuves extérieure. Le lien le plus faible, selon le monde devient fort quand il a duré, aussi selon le monde. Un jour viendra où le monde, tout le monde, dans ma maison comme dans votre salon trouvera tout simple que nous soyons nécessaires l’un à l’autre, que nous ne puissions nous passer de la société l’un de l’autre. On ne nous connaîtra pas mieux mais on nous acceptera sans nous connaitre. Que les gens qui le trouveront tout simple alors, seraient étonnés aujourd’hui, s’ils voyaient dans le fond de mon âme, s’ils y voyaient ce que vous êtes pour moi, et mon plaisir près de vous, et mon vide, loin de vous, et ma préoccupation de vous, et de quelle importance est pour moi tout ce qui va à vous et tout ce qui en vient ! Ah, croyons, croyons bien du moins l’un ou l’autre, dearest ; quand nous sommes séparés, la foi seule peut nous sauver. Je ne vous parle pas d’autre chose aujourd’hui. Je n’ai cœur à rien.
9 h. 1/2
Je n’ajoute rien. Adieu. Il y a une tendresse de la tristesse. Mais j’aime mieux l’autre. Adieu. G.
129. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vois dans les journaux que votre Empereur vient d’aggraver encore la loi contre les Russes qui restent à l'Etranger au delà du terme de leur passeport, et qu’au bout d’un an leurs biens seront confiqués. Est-ce vrai ? Il ne doit pas y avoir, en ce moment, grande nécessité d’une telle aggravation. On fait, ce me semble, de part et d'autre, en Crimée ses préparatifs pour l'établissement d'hiver. C'est un fait rare dans l’histoire qu’une guerre si lointaine ainsi prolongée, sans interruption, à travers toutes les saisons. Après l’incendie de Moscou, le vieux comte Daru conseilla à l'Empereur Napoléon de s’y établir, d'y passer l'hiver, et de recommencer la guerre au printemps en partant du coeur de la Russie : " C'est un conseil et l'Empereur ; mais nous sommes loin de chez nous que deviendrons nous si nos communications avec la France sont coupées ? " On n’a rien de semblable à craindre en Crimée, sauf la dépense, on peut rester chez vous tant qu’on voudra. Je viens d'écrire à la Duchesse de Sutherland à Meurice. C'est bien là qu'elle est, est-ce pas ?
Midi
Voilà votre lettre d’hier. Je ne pensais pas du tout, à propos de Lady Carlisle, aux petites, et très licites impertinences dont vous vous accusez ; une impertinence, pour se défaire d’un ennuyeux, c’est comme le mensonge qu’on fait quand on ferme sa porte pour ne pas le recevoir. Je pensais à des impertinences plus sérieuses, en même temps que plus spécialement féminines dont j’ai entrevu la trace chez Lady Carlisle, et où perce vraiment tantôt l’une, tantôt l'autre de ces fantaisies, étaler le pouvoir qu’on a, où affecter celui qu’on n’a pas. Les Brabant ont tout Adieu. Adieu. G.
129. Val Richer, Lundi 31 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le bulletin du Prince Gortchakoff sur la bataille de Giurgiu, très modéré et convenable, sans forfanterie insolente et vulgaire. Il parle des Turcs avec estime et en homme qui a éprouvé qu’il n'en fallait pas parler légèrement. Omer Pacha se fait certainement beaucoup d’honneur. Il serait plaisant que le résultat de tout ceci fût de relever réellement, sinon pour toujours, du moins pour cinquante ans l'Empire Turc. Tout est possible, surtout l'imprévu.
Les Anglais paient bien vivement de leur personne dans les débuts de cette guerre. Voilà quatre ou cinq officiers d’un nom commun tués à Sulina et à Silistrie, Parker, Butler & Ces morts sont racontées, dans les lettres des chefs avec une simplicité grave et émue qui fait honneur aux morts et aux vivants. Un pays Chrétien, aristocratique et libre, c’est ce que l’histoire du monde, jusqu'ici, a offert de plus beau.
Les affaires d’Espagne tournent selon mon attente. Espartero sera premier Ministre comme il a été régent, au nom de la Reine Isabelle, et il gouvernera l’Espagne jusqu'à ce qu'à force de mal gouverner, il ramène au pouvoir Narvaez où son pareil. La France et l'Angleterre feront très bien de ne point s'en mêler et je ne crois pas que rien les y oblige.
Je vois que le général Aurep est à la tête de trois corps à Frateschi. Nous aurons encore là, au premier jour, une grande bataille, où comme vous dites, personne ne sera battu.
Vous faites bien de rester à Ems tant que vous y avez quelqu’un dont la conversation vous plaît. Quelle est donc la maladie de Morny et comment fait Oliffe pour abandonner ses maisons, et ses baigneurs de Trouville, du reste, le monde commence seulement à y arriver. Le Prince Murat qui a acheté le château y donne des fêtes à la population, des spectacles, des bals. Cela console médiocrement les familles, dont les chefs et les enfants ont été pris pour les flottes. Dans ce seul bourg de Trouville, on a pris 175 marins.
Midi
Rien de nouveau. Adieu, adieu. Il fait moins chaud, quoique beau. En jouissez-vous ? Adieu. G.
130. Paris, Dimanche 9 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre lettre ce matin me fait un peu oublier celle d’hier. Je suis en meilleure humeur et j’ai hâté à vous le dire. Mon fils est parti. Marie s’est tout de suite remise, comme lorsque vous êtes parti. Ses variations sont si subtiles, si étranges, toute sa manière est si singulière qu'il faut absolument finir cela. Comme préface, je m'en vais l'envoyer à Rochecotte avec Mad. de Talleyrand, qui me l'a beaucoup demandé. Pauline en est transportée de joie, & Marie après m’avoir déclaré hier qu'elle détestait Mad. de Talleyrand et qu’elle n’irait chez elle pour rien dans le monde, vient de me supplier ce matin de l’y laisser aller. Ce sera une absence de 15 jours au moins. Je m’en vais donc rester parfaitement seule et ce sera pour moi abominable.
Hier j’ai eu en entretien de deux heures avec Médem, il part aujourd’hui pour Berlin & de là pour la Russie. Il verra tout le monde dans huit jours. Je lui a demandé ce qu’il dirait de moi. J’ai été parfaitement contente de la réponse. S’il tient parole, j'aurai eu pour la première fois un avocat homme d’esprit. Et je crois qu’il fera comme il m’a dit. Il m’a retenue fort longtemps, je n'ai plus attrapé qu’un bout de promenade avant mon dîné. Le soir j’ai été à Auteuil et je n'en ai rien rapporté. Une peu de causerie avec Pahlen à Armin. Fagel était attendu hier. Marguerite m'écrit une longue lettre remplie d’amitié. La question de l'hiver n’est pas décidée encore. Elle a bien envie de revenir à Paris, mais M. de Flahaut fait des chutes d’eau, une espèce de Niagara qui l’occupe beaucoup. Mon frère & mon mari et l’Empereur se sont trouvés réunis à Weimar avant hier. Certainement il y est question de moi, on y reste jusqu'au 11 ou 12, et de là je recevrai au moins une lettre de mon frère qui m’arrivera à la fin de la semaine. Adieu, que j'aimerais un adieu de plus près ! Je n'ai rien d’agréable à vous dire sur ma santé et ma mine. C’est pourquoi je ne vous en parle pas Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
130. Paris, Jeudi 25 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu quatre longues pages de Meyendorff, déchirante. et ne me parlant que de son malheur. Je soupçonne que la religion ne lui sera pas d'un grand secours. C’est triste. Il me charge de vous remercier et avec tendresse et sympathie.
Longue visite de Bourqueney hier. J’ai été très contente de tout ce qu'il m’a dit. " On fait plus que parler de la paix, on y pense. Je repars pour Vienne bien content des dispositions ici." Voilà le gros. Le même c’est que l’Autriche marche avec les alliés, (marche est encore au figuré) et que nous serions dans une erreur fatale si nous pouvons croire qu’elle en nous fera par la guerre. Si cela traîne, elle la fera.
Les nouvelles hier étaient bien défavorables pour nous. Ochakoff pris, & notre armée en retraite. La situation de l’Empereur Napoléon énorme en Allemagne au moins, le successeur de l'Empe reur Nicolas, mais plus encore parce qu'on a peur de lui. Admi ration sans borne pour lui dans la famille impériale. Bourqueney repart dans quelques jours. Toute sa conversation m’a fort intéressée. On ne sait pas où est mon Empereur ici On le croit toujours à Nicolaieff. On trouve triste pour lui d'être arrivé là tout juste pour voir tous ces désastres.
Bourqueney a accepté de démissioner à l’ambassade d'Angleterre. Je l'ai trouvé que quand j’ai parlé de l'Angleterre. On me dit que Lord [?] remplacera Molesworth, et on parle beaucoup de Grand ville à Vienne. C'est un peu décheoir. Adieu. Adieu.
130. Schlangenbad, Dimanche 10 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis profondément triste. Le langage s'envenime, et voilà Sébastopol qui sera une bien sérieuse affaire de quelque façon qu’elle tourne personne ne voudra avaler un revers.
Que vais-je devenir au milieu de violences que je prévois ?
Je pars demain pour Biberich où je couche. Mardi à Cologne. Mercredi à Bruxelles. Là je déciderai si j’irai encore trouver Hélène à Ostende. Je pense que oui mais vous adresserez toujours à Bruxelles. J’ai vu la duchesse de Nassau chez elle et chez moi. Le duc aussi. Celui-ci très russe. Il a vu l’Empereur d’Autriche dernièrement qui lui a semblé bien pacifique. Il affirme que l’armée autrichienne toute entière voit la guerre avec la Russie avec la plus grande répugnance. L'armée les grands, tout le monde est pour nous. Bach & Bual, contre. Il est bien douteux que l’Empereur se décide à se battre contre nous. Les journaux allemands surs paraissent donner raison à cette opinion là.
Morny part demain aussi. Il retourne à Paris par Strasbourg. Schlangenbad est fini, il n’y reste plus un chat que Crasalcoviz qui ressemble bien plus à un tigre. Adieu. Adieu.
130. Val-Richer, Jeudi 25 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
L'article du Times est catégorique. C'est la guerre continuant jusqu'à ce que vous demandez la paix et les Allemands exclus des négociations futures. L’arrogance du ton est aussi remarquable que le fond. Il y aurait trop à dire sur tout cela. J’ajourne. Ce qui me choque le plus, c’est le mot de paix de plus en plus prodigué à mesure qu’on s’engage plus avant dans la route qui éloigne de la paix. Je n'aime pas l’arrogance ; mais quand elle se complique du mensonge, c'est le pire.
Dit-on qui remplacera sir William Molesworth ? Ce sera probablement un radical. Palmerston voudra plaire de ce côté. On trouvera difficilement un radical aussi modéré que Molesworth. Le remplaçant m’a aucune importance pour la politique étrangère ; mais il peut en avoir pour les questions intérieures.
Sir Hamilton Seymour, comme remplaçant de Lord Westloreland à Vienne, me paraît assez vraisemblable. Je comprends que le comte de Colloredo soit fort dégagé ; on fait en Orient les affaires de l’Autriche et on ne les lui dérange point en Italie. Pourvu que cela continue, elle peut consentir à être pour rien dans les négociations futures.
Onze heures
Pas de lettre. C'est ennuyeux. Adieu, adieu.
130. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de votre Gazette. Je vous aime mieux vous que les nouvelles. Mais j’aime les nouvelles. Quand elles remplissent vos lettre, il me semble qu’elles ont rempli aussi votre temps. Je me trompe. Il faudrait des tas de nouvelles et des plus grandes, pour remplir le temps quand le cœur est triste ! Et encore ! Mais n’importe ; cela me semble ainsi, et ce semblant me plaît. Nous sommes si disposés à nous payer d’apparences. Ne tenez pourtant pas à votre projet de ne me parler que de nouvelles. Je veux savoir ce qui se passe ailleurs que dans le monde. Ne craignez pas les malentendus les mauvaises phrases. Entre nous, les réticences seraient bien pires. Il n’en faut point, même de loin.
A propos de nouvelles donnez-m’en du petit Lord Coke. Je m’intéresse à cet enfant. Il avait l’air si isolé avec une figure si ouverte et si gaie ! J’espère qu’il va bien. Le précepteur s’est-il animé un peu ? Si l’affaire du roi de Hanovre finit comme vous le dîtes, les Allemands diètes et peuples, baisseront beaucoup dans mon esprit. Ils n’auront que ce qu’ils méritent. Il ne faut pas vouloir, ce qu’on ne sait pas défendre. C’est sans doute l’influence de l’Autriche et de le Prusse qui a retourné la Diète, car elle était disposée à reconnaître sa compétence. Pour ce qui se fait en Espagne, Frias vaut Ofalie. Singulier temps que celui où les révolutions elles-mêmes sont apathiques, et vivent sans faire un pas. Que votre Empereur s’en aille d’Allemagne en emportant pour tout résultat, un Leuchtonberg pour gendre, peuples et Princes pourront adopter la même devise ; Much ade about nothing.
Je lève la tête en ce moment. Vous avez parfaitement raison. J’ai devant moi ce soleil froid, qui s’épuise à chasser du Ciel le brouillard, et n’a plus rien pour échauffer la terre. C’est du pur humbog. Pourtant je l’aime mieux que la pluie. J’assiste chaque jour à toute la vie du soleil. Je me couche et me lève de très bonne heure. Physiquement, je m’en trouve bien. Je voudrais vous envoyer un peu de mon sommeil.
Ce qui me fait grand plaisir à voir, c’est la santé de mes enfants. Ils sont à merveille, et d’un mouvement, d’un entrain d’esprit et de corps inimaginable. M. de Metternich n’a pas trouvé Thiers plus animé, que ne l’est ma petite Henriette. Je leur lis le soir l’histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Nous venons de passer trois jours à assiéger, et à prendre Antioche. Au moment où nous y sommes entrés Henriette a jeté sa tapisserie, & ils se sont mis à courir et à sauter dans la Chambre avec des cris de joie, comme les Croisés eux-mêmes. Ce sera bien pis quand nous prendrons Jérusalem.
10 heures ¼
Le facteur arrive tard. Vous êtes bien triste. Il y a une chose que je ne vous pardonne pas, c’est de croire que vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez. Que de choses j’ai à vous dire ? Et je vous ai écrit hier que je n’irais pas à Paris ! Adieu. Ce soir, je vous écrirai longuement. J’ai là du monde. Prenez garde à Marie, je vous en conjure. Les folles qu’on ne croit pas folles me font trembler. Adieu. Adieu. J’ai le cœur plein !
130 Val Richer, Jeudi 3 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Combien y avait-il d’année que vous n'aviez vu votre grande Duchesse Marie de Weimar. Au moins vingt ans, ce me semble, car elle ne devait pas être à Pétersbourg quand vous en êtes partie. C'est dommage qu’elle soit si sourde. Vous auriez pris plaisir à causer avec elle. Cette visite a dû vous toucher, en même temps que vous fatiguer. La Princesse de Prusse habite donc toujours Coblentz.
Je ne doute pas que la Prusse ne finisse par suivre l’Autriche. Le poids de l'opinion nationale et de l’opinion Européenne, c’est trop pour le Roi de Prusse. Je plains votre Impératrice. Quelles immenses conséquences d’une série de petites fautes ! Car au premier moment, comme les actes n'étaient pas grands, les fautes semblaient petites, même aux yeux de ceux qui les jugeaient des fautes. Et les événements ne font que commencer.
Il ne paraît pas que l'île de Gothland soit pour rien dans le départ de nos troupes pour la Baltique. Tout indique que ce sont les îles d'Aland qu’elles vont occuper, et qu'elles y passeront l’hiver. Je ne comprends pas. Mais il y a bien d'autres choses que je ne comprends pas.
Je vous ai dit ce qui m'était revenu sur l’Espagne. Je n’y pense plus. La Reine Isabelle fera tout ce que voudra Espartero. La Reine Christine restera tant qu’on voudra à la Malmaison. Quel rôle que celui de la Royauté dans toutes ces secousses ! Quelle humiliation ! Je ne crois pas la monarchie ébranlée, pour le moment, en Espagne ; mais l'avenir ? Et quel avenir entre la République décriée et la Monarchie avilie ?
Voici une nouvelle qui ne vous touchera guère, mais qui a pour la France une importance réelle. On a depuis longtemps à Rome le désir de condamner solennellement Bossuet et les quatre fameuses propositions, ou Libertés de l'Eglise Gallicane, dont il fut en 1682, le défenseur. On a cru le moment favorable pour faire prendre français par le Clergé lui-même, l’initiative de ce triomphe ultramontain. Un concile s'est tenu naguère à La Rochelle, sous la Présidence du Cardinal Donnet. archevêque de Bordeaux. On a provoqué là une délibération dans le sens que Rome désirait. Mais au dernier moment, la peur a pris au Concile, au Cardinal, et ils n’ont rédigé qu’une délibération très vague, et que Rome juge très insuffisante. Cela cause, dans le monde ecclésiastique, et politico ecclésiastique, une assez vive agitation. En tout, ce monde là est aussi médiocre que l'autre.
Midi
Vous voilà donc de nouveau en retraite. Je comprends encore moins la Stratégie que la politique. Adieu, adieu. G.
130 Val Richer, Mardi 1er août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
On me dit que Narvaez s'est décidément rapproché d’Espartero, et qu’il reviendra à Paris comme ambassadeur du nouveau cabinet. Les généraux qui ont conduit l’insurrection font un grand effort pour réunir, au nom de la monarchie constitutionnelle, les progressistes et les modérés. Le spectacle de l'anarchie dans les rues et les élans communistes qui se sont manifestés dans le bas peuple, à Madrid et à Barcelone, pourraient bien amener ce résultat. De Londres, un agent a été envoyé à Espartero pour l’engager à ne pas se montrer trop difficile avec la Reine et à prendre possession du gouvernement. On lui promet un appui qui ne sera, je pense, point contrarié de Paris. Là aussi, on est inquiet du mouvement démagogique en Espagne, et on désire qu’il soit, le plutôt possible, arrêté et combattu. On ne songe plus à avoir envie soit d'un coup d'Etat quasi absolutiste, soit d’un échec à la maison de Bourbon. Les événements de Madrid ont produit, dans les sociétés secrètes et les ouvriers de Paris, une fermentation dont le danger fait taire toute autre idée. On a expressément interdit aux journaux de publier aucune des proclamations, félicitations et autres pièces révolutionnaires Espagnoles. On combat la contagion par le silence.
On a aussi conseillé le silence aux Débats pour les articles de St Marc Girardin sur l'avenir de la race grecque en Orient. Très poliment et pour St Marc et pour les Débats, mais au nom de l'alliance actuelle et active entre la France et la Turquie. Il paraît que ces articles, qui charmaient à Athènes, ont déplu à Constantinople, et que la Porte a témoigné le désir qu’ils ne continuassent pas.
Vous savez que Walewski va se promener six semaines en Suisse et à Florence. Il l’a désiré et on s'est empressé d'y consentir. On a un peu d'humeur contre lui. Il avait promis la présence de la Reine d’Angleterre à l’embarquement des troupes à Calais. Il s’était trop avancé. C’est une autre présence qu’on recherche maintenant, celle du Prince Albert au camp de Boulogne. On a plus de chances d'y réussir. La même invitation a été adressée au Roi Léopold et il paraît qu’il l’a acceptée. Son neveu fera probablement comme lui. Mais ce n’est pas Walewski qui est chargé de la négociation ; c’est le Prince Antoine Lucien Bonaparte, le même qui vient de voyager en Italie. On le dit spirituel et aimable.
Savez-vous si, comme on me le mande, Rogier est enfin nommé Ministre à Francfort et le Prince de Chimay ambassadeur à Paris ? Je vois que le Prince de Leiningen a pris, avec un officier anglais, le commandement de la flotte Turque sur le Danube. C'est le même, je suppose qui était au service de l’Autriche et qui réussit si bien dans la mission Autrichienne pour le Monténégro. Cela, et le général Hess se concertant avec Omer Pacha, le maréchal St Arnaud et Lord Raglan, c’est presque un commencement d'hostilité.
Onze heures
Je n’ai rien de vous ni dans les journaux. Je vous suppose partie pour Schlangenbad. Adieu Adieu. G.
Mots-clés : Diplomatie, France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (Espagne), Politique (France), Politique (Grèce), Politique (Turquie), Réseau social et politique, Révolution, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
131. Biberich, Mardi 12 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Un mot d'ici où je suis venu coucher hier soir. J'y trouve les Shaftesburg. Nous nous embarquons ensemble. Si Constantin n’est pas à Cologne, ou s'il n'y reste que ce soir je continuerai ma route avec eux jusqu'à Bruxelles. Quel moment. Ce Sébastopol ! Vous voyez que l’Autriche est bien décidée à la neutralité. Je vous ai toujours dit que Je doutais qu’elle put jamais nous faire la guerre. La Suède aussi se tient en prudence. J’apprendrai des nouvelles à Bruxelles. Adieu. Adieu & Adieu.
131. Paris, Lundi 10 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
C’est tout simplement pour vous obéir que je transcris la mauvaise phrase.
" Je vous ai conseillé d’aller à Baden croyant deux choses. L’une, que, si je suis pour vous ce que je veux être vous sauriez bien revenir en France ; l’autre que si je ne suis pas cela, il vous importe par dessus tout d’arranger votre vie avec ceux qui en disposent matériellement. "
Et je suis très fâchée de vous avoir obéi, car ma main redevient froide. N’allez pas commenter, expliquer ; l'impression a été, & reste mauvaise. C'est froid, bien froid. Mais tout ce qui est venu depuis a été bon, bien bon. Ainsi, c’est de tout mon cœur que je vous promets de n’y plus penser.
J'ai été faire visite hier matin à Mad. de Boigne, j’ai pris Palmella, avec moi. Nous avons eu si froid que vraiment lui et moi nous en étions violets ; nous avons marché au pas de charge en revenant. Quel temps abominable ! Nous avons trouvé le chantier à Chatenay. Il en fait les honneurs. Il était élégant frais, vraiment il est fort ridicule. On ne disait rien là, je n’ai donc rien à vous redire J'ai promis d’y aller dîner la semaine prochaine. Le soir j’ai vu du monde, la Duchesse de Talleyrand et M. de Humboldt comme extraordinaires. La Duchesse est embellie, blanchie. M. de Humboldt est plus bavard que jamais il m'a beaucoup parlé de mon mari qu'il rencontrait tous les jours à dîner chez le Roi de Prusse. Il l’a trouvé plus triste qu’il ne l’avait vu en Angleterre. Vous ne dites rien du prince Bugeaud qu’en pensez-vous ? Pahlen est fort en colère de l’article des Débats sur la Pologne. Je lui propose de démentir l’Ukase sur l'habillement ; mais voilà l'embarras. Il peut y avoir du vrai. Cependant vraiment nous ne croyons pas que ce soit tel que le disent les journaux. J'imagine que le démenti paraîtra dans quelque journal allemand. Le mal dans nos Affaires, c’est qu’on croit de nous tout ce qu’on invente, et pour cause ; Tcham avait l’air plus content hier ; l’affaire suisse s'arrangera.
Marie frappe tout le monde pas l’étrangeté de son regard. Demain je parlerai. médecin, et la semaine prochaine. Elle ira je crois à Rochecotte. Elle parait le désirer elle-même. Elle partira le 18 et reviendra le 7 octobre. Dites-moi que vous m'aimez, dites le moi souvent. Il y aura jeudi quatre semaines que vous m'avez quittée. J’ai mal employé ce temps-là. Je devais engraisser. J’ai maigri. Cela m’afflige extrêmement. Je ne vois pas que mes tracasseries présentes puissent me remettre. Adieu. Adieu. Adieu.
131. Paris, Vendredi 26 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je m'ennuie pour vous de l'in gratitude de la poste. Que faire et moi, je ne vous envoie que des bouts de lettres. Il y a trop à dire et mon temps, comme il est pris ! Il y a les intimes avant la promenade. Les visites après. Et le jour qui tombe de si bonne heure. Il est bien temps que vous reveniez pour m’entendre bavarder.
Je vois Morny tous les jours. Hier soir, les Duchesses de Talleyrand et de Sutherland. La première fort spirituelle et de bon goût. Pas sur des échasses comme il y a de cela quelques années. Collaredo a été fort bien reçu par l’Empereur il dîne là aujour d’hui. On a refusé de voir un ministre de Prusse en Espagne qui passe ici pour s’y rendre. Ni général pas de présentations à la campagne.
Lord Lansdowne est arrivé hier. J’apprends que l’Empereur reste à Nicolaieff. Nos légations ont l’ordre de faire, les expéditions en doubles. Pétersbourg pour Nesselrode. Nicolaieff pour l’Emp. Le Baron de Lieven envoyé pour juger la situation militaire en Crimée fait un rapport satisfai sant ce qui veut dire je crois que nous restons là dans de bonnes conditions. Constantin a eu un commandement, hélas.
Les Brabant partent demain à 2 heures. Elle avec désespoir. J’ai rencontré toutes les deux cours hier dans l’allée la plus écartée du bois et où il n'y a que moi qui se promenais. J’étais à pied. Cinq calèches à quatre chevaux. Je n’avais pas fait de rencontre depuis bien bien longtemps.
Voilà Thiers qui m’envoie son 12ème volume. J'ouvre & je tombe juste sur la page 28 de l’avertissement. de là à la fin c.a.d. deux pages admirables. Je suis sure que vous en porterez. le même jugement. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Enfants (Benckendorff), Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Histoire (France), Lecture, Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Russie), Publication, Réseau social et politique, Salon
131. Val-Richer, Vendredi 14 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si j’étais près de vous, je vous gronderais. De loin, je n’en ai pas le courage. Vous ne me plaisez plus comme vous me plaisiez ! Je pourrais vous redire comme vous me l’avez dit : " Tout a été couvert un moment par l’étonnement, la joie de vous avoir trouvée. Le premier de ces sentiments, le temps l’efface naturellement. Le second dure mais plus tranquille parce qu’il est plus établi. Je ne dirai pas cela parce que ce ne serait pas là l’expression vraie de ce qui est en moi. Voici ma vérité à moi. Vous m’avez inspiré une grande curiosité. Vous ne paraissiez ni ce que j’avais vu ailleurs, ni ce que j’avais été tenté de vous croire. J’étais très touché de votre mal et très curieux de vous connaitre, de savoir ce que vous étiez réellement. Voilà votre premier attrait. Celui-là est passé, j’en conviens. Je vous connais. Je ne suis plus curieux. Mais qu’est-ce donc que cet attrait frivole et froid, à côté de ce qui m’attache à vous aujourd’hui ? Savez-vous que je vous ai trouvée infiniment supérieure à ce que j’attendais au temps de ma plus vive curiosité ? Que vous valez infiniment mieux que je ne supposais ? Que je vous aime bien plus que je ne vous aimais quand je vous ai dit que je vous aimais ? Je puis, comme d’autres, être attiré par l’agrément de l’esprit, par le charme de la nouveauté et donner à ce plaisir plus de place qu’il ne lui en est dû et me laisser aller à l’exprimer plus vivement que ne le voudrait l’exacte vérité. Tout cela, c’est de la vie superficielle, qui a son prix, que je ne dédaigne pas.
Mais ce n’est plus de cela qu’il s’agit entre nous ; ce n’est plus dans cette sphère là que nous vivons. Vous avez pénétré au fond de mon âme, dans ma vraie vie, dans ce qu’il y a en moi de plus sérieux, dans ce qui est vraiment moi. Et vous n’y avez pénétré que lentement. Je suis très accessible à la surface très peu au fond. J’ai beaucoup douté. J’entendais beaucoup parler de vous. J’ai tout écouté. Je ne vous ai pas dit le quart de tout ce que j’ai pensé, cherché, sondé, supposé. Je vous ai trouvé des défauts, des torts. Je les ai tournés et retournés en tous sens pour en découvrir l’origine, pour en mesurer la portée possible. Je vous ai traitée sans faveur. Et plus j’ai regardé à vous, plus vous avez grandi et brillé à mes yeux, plus je me suis senti pénétré et d’estime et de goût, et de tendresse pour vous, pour votre nature, votre nature primitive et essentielle telle que Dieu l’a faite. Je n’y regarde plus à présent. Peu m’importent vos défauts ; peu m’importe ce que vous pourriez avoir fait, ce que vous pourriez faire encore. Il y a en vous quelque chose qui est indépendant de tout supérieur à tout, qui domine et efface tout pour moi. Ce quelque chose, c’est le fond de votre être, c’est vous même. comme disent les dévots vous êtes pour moi, en état de grâce. Rien ne peut plus vous en faire sortir. Est-ce là me plaire assez ? Manque-t-il quelque chose à cette affection-là? Et ne croyez pas que, depuis le 15 Juin, elle n’ait pas subi plus d’une épreuve venant de vous ou d’ailleurs. Je vous dirai quelque jour toutes celles qu’elle a surmontées. Vous me direz si j’ai tort de vouloir que vous ayez foi. Mais laissez-moi vous demander une chose.
Soyez fière avec la destinée comme vous l’avez été avec votre Empereur. Ne parlez pas de la décadence qui vous entoure. Ne vous en parlez pas à vous-même. Il y a des impressions très naturelles, presque inévitables, mais qui ne méritent pas de séjourner dans l’âme. Ne leur permettez pas de faire plus que traverser la vôtre. Elle est si grande ! Rien ne lui manquerait si elle était aussi forte. Mais le sort vous a d’abord gâtée, et puis frappée immensément. Il faudrait une force immense pour suffire toujours à cette double épreuve. Je ne vous parle pas trop sérieusement, n’est-ce pas ? J’espère que non. Dites-le moi pourtant. Et chargez-moi de vous apprendre à vous aimer. Ce qui est très sérieux aussi, croyez-moi, c’est Marie. Ce que vous m’en dîtes à propos de l’enfant de la petite Princesse me trouble beaucoup. Je sais de déplorables aberrations qui ont commencé ainsi. Votre médecin est un sot. Que le mal soit déjà réel ou non, de tels symptômes méritent qu’on y regarde J’aurais bien des choses à vous dire à ce sujet. Mais je ne puis les écrire. 10 h. Je n’ai point de lettre aujourd’hui. Je laisse partir celle-ci comme elle est. Je n’y ajoute et n’en ôte rien. Adieu. Adieu. G.
131. Val-Richer, Vendredi 26 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vois qu’on a appelé à Nicolajeff, le général Tollien ; il va sans doute refaire là ce qu’il a fait à Sébastopol et probablement pour arriver au même résultat. Je le plains.
Est-il vrai que les alliés ont demandé au Roi de Suède l'autorisation de faire hiverner leurs flottes dans l’ile de Gothland et qu’il s’y est formellement refusé, alléguant sa neutralité. Je m'étonne qu’il ne se soit pas renfermé dans la même place forte, à propos des Tedeum. Il n'y courait aucun risque. Quoi de plus anti neutre que d'aller célébrer les victoires de l’un des belligérants ? Le droit est toujours, quand on n’est pas directement aux prises avec la force, une meilleure position que la platitude.
La liste des approvisionnements trouvés et pris à Sébastopol frappe les plus simples. C'est la mesure, disent-ils, de vos projets et de votre échec.
Il me semble que le Roi de Prusse doit être content du résultat de ses élections, et qu’il aura, dans ses Chambres prochaines, un appui décidé pour sa politique.
Je n’ai rien de plus à vous dire et j'attends mon facteur.
Onze heures
Je reçois le N°130 d’hier, et point de N°129. Que veut dire cela ? Rien de nouveau. Tout ce qu’on dit ou annonce est en effet triste pour vous. Je ne crois à la paix que lorsque vous la demanderez, et quand la demanderez vous ? Adieu, adieu. G.
131. Val Richer, Vendredi 4 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
L'immobilité militaire et diplomatique est complète pour le moment. Nous apprendrons peut-être un de ces jours la prise des Îles d'Aland, et une bataille sur le Danube. Je ne sais si, de ce dernier côté, St Arnaud se prépare à se battre, comme vous le dites ; mais vous me paraissez décidés à l'éviter. Tous les journaux d’hier annonçaient votre retraite de Guere Gewo sur Bucharest, et même au-delà. A la vérité que signifient les journaux depuis qu'ils ne parlent plus à tort et à travers ?
Nous en saurons encore bien moins quand la session du Parlement sera close. Il me revient qu’elle se prolongera quelques jours de plus qu’on ne croyait. Le fils aîné de Sir John Boileau, qui est private secretary de Lord John, devait venir le 20 passer ici huit ou dix jours ; mais sa soeur écrit à ma fille que Lord John ne quittera Londres que le 28. Le Cabinet, et Lord Palmerston comme les autres, subit impunément une foule de petits échecs. Il durera autant que la guerre. C'est la guerre qui fait la sécurité de Lord Aberdeen. Bizarre situation. Tout est bizarre du reste dans cette affaire. Certainement l’Angleterre déploie et étend beaucoup sa puissance. Ne vous figurez pas que cela fasse quelque chose ici. Personne n’y pense. La faute de votre Empereur, depuis un an, est de croire que les gouvernements se conduiront pas des considérations anciennes et secondaires ; il n’a pas prévu que des idées simples, uniques et nouvelles décideraient de tout ; pour la France, l’intérêt de l'alliance Anglaise ; pour l'Angleterre l’intérêt de l'abaissement Russe. Tout a disparu et disparaîtra devant ces deux desseins.
Le mouvement Espagnol s'est fait à Séville comme ailleurs et le nom du Duc et de la Duchesse de Montpensier n’est pas prononcé dans les journaux. On parle beaucoup du Salon de Mad. de Montijo à Madrid et de son intimité avec les généraux O'Donnell Dulce et autres. Le décret de l'Empereur d’Autriche sur l'établissement des États et des comités de Province est bien conçu et bien rédigé. Quelles en seront l'importance et l'efficacité politiques, et jusqu'à quel point donnera-t-il satisfaction aux intérêts nouveaux, je ne le sais pas ; mais c’est certainement l'œuvre d’un gouvernement sérieux, et qui sait ce qu’il fait. C'est sans doute M. Bach qui en est l'auteur.
Midi
Ceci vous trouvera donc réellement à Schlangenbad. Je suis charmé que vous y ayez Ellice. Adieu, adieu. G.
132. Bruxelles, Jeudi 14 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Enfin me revoilà près de Paris C’est le seul sentiment joyeux qui accompagne ma rentrée de Bruxelles. J’ai fait tout le voyage avec les Shaftesburg et le Marquis d'Areglis. Tous charmants. Je trouve ici Mad. Kalergis, très curieuse à écouter, d’autant plus que mon rendez-vous à Cologne avec mon neveu a marqué au moment de partir il reçoit la nouvelle que le roi de Prusse revient le 11 à Berlin de Pulbus. Impossible de s'absenter. Le roi est malade d'une tumeur à la jambe, causée par une chute, et il revient pour le soigner. Je n’ai encore vu personne de ce pays-ci, mais je trouve les journaux. Evidement l'Empereur ira en Angleterre, ce sera au retour du voyage de La Reine en Ecosse. Il sera reçu là avec enthousiasme. J'ai recueilli ces derniers jours bien des renseignements curieux. Par exemple le prince Albert déteste, mon Empereur. Dépit personnel. C'est étonnant que depuis mon empereur a blessé.
Kalergis raconte beaucoup de choses. Des résolutions soudaines violentes, des défaillances. Un grand décousu. Dirigeant tout jusqu’au moindre détail les opérations qui s’excitent au loin. Pas d’idée de fléchir. Jamais nous ne consentirons à la destruction des traités anciens. La seule chose à concéder serait la liberté de la mer noire. Rien au delà.
L’Empereur très triste, très sérieux. Nesselrode obligé d'obéir, pas très découragé. Orloff n’ayant fait et dit que des bêtises à Vienne. Confiance que l’Allemagne unie empêchera la guerre générale.
D’un autre côté j’entends dire que la conduite de l’Autriche la rendra inévitable, & que vous ne serez pas fâchés de la porter sur le Rhin. Enfin, le présente est détestable et l’avenir est pire.
Je vais me reposer si je puis aux milieu de l’agitation d’esprit où je vis. Que sera Sébastopol ? Le Moniteur a bien fait de tempérer. Le langage de St Arnaud. Le public doit être autrement traité que le soldat. Je regrette que votre Empereur dise des choses dures au mien. Adieu. Adieu.
P.S. Je me reprends. Les journaux demandes les discours.
Mots-clés : Diplomatie, Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Angleterre), Politique (Prusse), Politique (Russie), Réseau social et politique, Salon, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
132. Paris, Mardi 11 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous m'avez écrit une excellente lettre. Je vous en remercie tendrement. Elle à propos savez-vous m’a réchauffée qu'il fait horriblement froid. Je suis transie & la nuit je ne trouve pas assez de châle pour me couvrir. Est ce que l’hiver serait commencé ? J'ai fait ma promenade hier à St. Cloud ; en rentrant j’ai trouvé chez moi mon Ambassadeur & la petite princesse. Le soir j'ai fait une tournée de visites, je n’ai trouvé que la marquise Durazzo. Voici mon médecin qui est venu me prendre mon temps. Il croit que je radote lorsque je lui raconte mes peurs sur Marie, et je vois qu'il me croit plus folle qu’elle. En attendant, il est enchanté que je l'envoie à Rochecotte. Mais il me faudra plus que ce remède, je crois, parce qu'il faut absolument rompre, ces caprices sans cela nous ne pourrons pas continuer à vivre ensemble. Il lui suffit que j’aime quelqu'un pour qu’elle le déteste. Ce pauvre Alexandre si doux et si poli pour elle, et qu’elle a traité avec la même férocité que vous !
M. Aston est venu me voir aussi hier matin. Nous avons à nous occuper ensemble du petit Coke qui nous a donné de l'inquiétude. On a craint un moment pour lui la fièvre scarlatine. Il va mieux.
Point de nouvelles politiques du tout. Je ne sais rien du Hanovre. Le monde dort.
Adieu ma lettre est un peu shabby mais je me suis levé tard. J'ai été interrompue. J’attends la petite princesse et il faut que ma lettre soit remise avant qu’elle ne vienne. Adieu. adieu. Aussi vivement que si vous étiez ici.
Mots-clés : Réseau social et politique
132. Paris, Samedi 27 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je retire mon admiration de hier aux pages que je vous ai signalées hier. Elle reste au style et à quelques mots. heureux ; mais à la réflexion et après avoir relu, je me trouve en désaccord avec l'auteur. Il n’en sera pas de même de vous. Cela vous plaira tout de suite, & toujours comme cela me va à moi d'être étourdie. J’ai bien des défauts de femme & de jeunesse. J'en suis honteuse.
Je n’ai vu personne hier qui vaille. Colloredo a dû dîner hier à St Cloud, Hubner, je crois, pas. Benst et Van des Stratten sont ici, les deux première minis tres de Saxe & de Bavière. Vous n’avez pas d’idée de l’affluence des étrangers dans ce moment. Qu’est devenu ma lettre 129 ? J’espère, si elle est perdue qu'elle n'était pas intéressante.
Molé s'annonce pour Lundi, il vient assister au mariage d'une petite nièce la fille de M. de Caumont. Les Brabant partent tout à l'heure. Voilà l’Indépendance qui annonce un ordre du jour de Gortchakoff par lequel il informe l’armée qu'il défendra la Crimée à toute extrémité. Pour le coup j’ai peur. Nous sommes en infériorité de nombre et certainement en infériorité de talent. hélas. Adieu.
132. Val-Richer, Samedi 15 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’y a point de bonne raison pour que je n’aie pas eu de lettre ce matin. Mais la pire serait que vous fussiez malade. Je ne suis point résigné à celle-là. Je ne suis résigné à aucune. Je ne sais pourquoi je vous écris avant le courrier de demain, car je n’ai rien à vous dire. Et si je vous disais tout en ce moment, je vous écrirais fort tristement. Je crois que je ferai mieux d’en rester là, d’autant que je n’ai pas la moindre envie de vous parler d’autre chose.
M. Duvergier de Hauranne vient d’arriver. Il passera ici cinq ou six jours. Le Duc de Broglie viendra l’y prendre jeudi ou vendredi prochain. Je vais redescendre dans le salon où je l’ai laissé. En général, chaque soir je rentre et je m’enferme avec plaisir dans mon cabinet. Aujourd’hui, j’aime mieux ne pas y rester. Dimanche 10 heures Pas de lettre aujourd’hui, non plus. Décidément je suis inquiet de votre santé. Je vais faire demander de vos nouvelles.
Adieu Madame. Peut-être vous est-il venu quelque visite d’Outre-Rhin. Adieu. G.
132. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous souvenez-vous les paroles de Hübner l'hiver dernier. " On serait à Pétersbourg dans une erreur fatale si on croyait que nous ne ferons pas la guerre ; si la situation se prolonge, nous la ferons ? Exactement les mêmes que celles de Bourqueney aujourd’hui.
Bourqueney doit être content, et on doit être content de lui, à Paris et à Vienne. Il est très propre à cette politique mutuelle de ménagements d'expédients, de transactions et d'attente.
Il est sûr que votre situation militaire est bien mauvaise ; vous n'avez eu de succès, depuis le commencement de la guerre que dans la défense de Sébastopol et Sébastopol est pris. Vos troupes, généraux et soldats doivent avoir peu d’entrain. Combien de temps le dévouement et le courage opiniatre peuvent ils tenir lieu d’entrain ?
Voilà ce pauvre Normanby qui a son tour dans les gracieusetés du Times. Il me semble que tout le monde a eu tort, Piémont et Toscane, dans cette petite affaire, le Piémont d'envoyer un réfugié Lombard à Florence, la Toscane de le refuser après l'avoir accepté. Je doute que l’Autriche fasse bien de faire ainsi sentir, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sa prépondérance sur les gouvernements Italiens de les pousser aujourd’hui à la résistance et demain à la concession. C’est un mauvais jeu. Je vois que le Times recommence à menacer le Roi de Naples. Il n’a donc pas fait ce qu’on lui demandait. Je croyais cette querelle là finie. Il y aura toujours du reste quelque querelle en Italie ici ou là. Les volcans n'ensevelissent plus les villes, mais ils fument toujours.
Onze heures
Décidément le N°129 ne viendra pas. Je n’ai pas encore vu ici le 12° volume de Thiers, car il m'envoye aussi son ouvrage. Il est peut-être chez moi à Paris. Je suis sûr que je serai de votre avis sur les deux pages dont vous me parlez. Il y en a probablement plus de deux. Adieu, adieu. G.
132. Val Richer, Dimanche 6 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’y a pas à s'étonner que nous rabachions, nous simples spectateurs, quand les acteurs eux-mêmes rabâchent. Les journaux ne sont pleins que de votre retraite. Vous évacuez Bucarest et la Valachie ; vous vous repliez sur le Sereth. Vous avez déjà fait cela. Pourquoi le recommencez-vous ? Pourquoi l'avez-vous fait la première fois ? On peut, même à ses dépens, prendre plaisir à assister à un grand spectacle ; mais suivre, jour par jour, des scènes inintelligibles, où l'on ne peut démêler aucun plan et où ne se rencontre même presque aucune action, c’est très ennuyeux. Si nous ne nous écrivions pas tous les jours, je laisserais là mes journaux sans les ouvrir, en priant quelqu'un de m'avertir au moment où le drame reprendrait vraiment, un peu d’intérêt et de clarté.
J'en trouve un peu plus en Espagne depuis deux jours ; je comprends un peu mieux. évidemment, l’anarchie a éclaté si violemment à Madrid, à Barcelone à Valence, partout que la peur prend à tous ceux qui ont quelque chose à perdre à l'anarchie. Espartero en entrant à Madrid comme Manuel de la Concha en revenant à Barcelonne, ne sont occupés que de rallier les troupes, de rassurer les honnêtes gens, de réprimer les perturbateurs. Vous allez voir les auteurs de l'insurrection pratiquer immédiatement la politique de résistance. Cela sauvera, quant à présent, le trône de la Reine Isabelle. Il me paraît que son dernier gouvernement, le Cabinet renversé si violemment, le comte de san Luis et ses collègues dont je ne me rappelle pas les noms étaient vraiment d’une incapacité, d’une immoralité, d’une légèreté et d’une fatuité incomparable ; des doublures de roués et de parvenus. C'est leur détestable gouvernement, plus qu'aucun complot ou aucun projet d'Opposition, qui a fait l’insurrection et son succès. Il y avait bien toutes sortes de coteries, d’intrigues, de rêves et par dessus tout le vent révolutionnaire qui est dans l’air et qui jette bas la porte dés qu’on la lui entrouvre ; mais ce n’est pas là, ce qui a décidé l’événement. On a tout simplement voulu se débarrasser de gens qui gouvernaient trop mal, et on va essayer de gouverner un peu moins mal et un peu plus honnêtement. Voilà l'impression qui me reste de tout ce qui m’arrive. Nous verrons bientôt si elle est fondée.
Avez-vous connu le baron de Vitrolles qui vient de mourir à 80 ans ? C'était un homme d’esprit, courageux, fidèle à sa cause et à ses idées, mais bien brouillon et préférant toujours les détours au grand chemin. C'est avec lui que j’ai eu en 1815, ma première discussion politique, à l'occasion d’un pamphlet qu’il avait publié sur le rôle du Ministère dans le gouvernement représentatif. Je présume qu’il est mort du choléra, outre ses 80 ans. Je ne puis regretter que vous ne soyez pas, dans ce moment à Paris. Le Choléra y est bien plus fort qu’on ne le dit, et qu’il n'est permis aux journaux de le dire. Mad. Gabriel Delessert, en a été à la mort ces jours derniers ; on la croyait perdue. Son beau frère Français m'écrit qu'elle est hors de danger.
Midi
Je n’ai pas de lettre. Je m'en prends à Schlangenbad. Adieu, adieu.
133. Bruxelles, Samedi 16 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hélène me quitte dans quelques jours pour s’en retourner en Russie. Mon fils l’accompagne. Van Praet va faire un voyage en Suisse et en Italie. Brokhausen est absent en congé. Creptovitch va partir pour un mois pour la chasse. Voyez l'isolement où je reste ? Jamais je n’ai été si découragée et si triste. Vraiment il ne vaut pas la peine de vivre dans ces conditions.
Mon logement provisoire est un tombeau, et il n'y a pas un coin dans aucune auberge. Je cherche une maison. On ne les loue que pour l’année. Je n'en veux pas, mon imagination répugne à un pareil engagement. Plaignez-moi beaucoup. Je suis bien à plaindre. Je ne connais ici personne. Cerini pour toute ressource. Et La mauvaise saison qui s'avance.
Le roi Léopold est revenu bien content de son entrevue avec votre Empereur. Elle a été utile pour tout le monde. Il a reçu une impression très favorable. de la manière tranquille et digne de l’Empereur. Il lui a trouvé beaucoup d’esprit, aucune passion dans l’affaire du moment, le désir de la paix. Beaucoup de franchise et de simplicité dans son langage. Enfin il a été parfaitement satisfait de cette entrevue et frappé de la personne.
2 heures.
Quelle fête 4 lettres à la fois ! Je m’inquiétais, je ne savais comment expliquer le silence. La poste était prévenue les journaux venaient. Mais point de lettre. J'envoie Galloni, et les voilà jusqu'au 159 inclus. Merci, merci, et Merci. A présent nous rentrons dans l'ordre. Adressez vos lettres à Bellevue. C'est là que je suis provisoirement. Le temps est encore beau que je regrette l’air vif des montagnes. Adieu. Adieu.
133. Paris, Dimanche 28 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Nouvelle dégringolade à la troisième lecture. Je ne recom mencerai pas car il ne resterait plus rien. "Tous valent mieux qu’un." Tous ont fait 93 & 48. Comment oublier cela ? Je serai curieuse de votre jugement. Dumon mettait un peu hier soir l’avertissement en pièces. Il était ici et d'Haubersaert. Et la comtesse Montijo. On a causé très agréablement. Elle a vraiment de l’esprit.
Le vent est à la guerre, à une guerre terrible. Rien ne saurait résister à ce que veulent deux grandes puissances comme la France & l'Angleterre lorsqu’elles veulent bien. On Nous prendra Cronstadt. On inventera, on parviendra. Il me parait aussi qu'on ne voudra plus souffrir de neutres. Le printemps sera terrible. Les Brabant sont partis hier. La dernière soirée a été des plus gaies, & cette pauvre duchesse répétant à tout. le monde. " Et dire que demain à cette heure je serai à Bruxelles, non, c’est trop triste ". Son mari s'est un peu dégourdi ici, pas assez. Hubner était du dîner. Dans le monde onc ontinue à blamer le voyage & le plaisir qu’ils yont pris. On répéte beaucoup. Le Roi aurait mieux fait de venir lui même.
Je n’ai pas vu lord Lansdowne encore. Il a dit à quelqu’un qu'on délibère encore s'il faut faire sauter Sévastopol ou le conserver. Il commence à faire mauvais temps. Adieu. Adieu.
133. Paris,Mercredi 12 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il y a eu quelques nouvelles hier. L'armistice complète en Lombardie. Le changement de ministère en Espagne. Frias à la tête du nouveau. La diète de Francfort a déclaré son incompétence dans les affaires des Hanovre. Le Roi se propose de gouverner sans les chambres, et de n’avoir plus que des états provinciaux. M. de Metternich mande à Appony qu'il a longtemps causé avec Thiers, qu'il n'a jamais rencontré d’esprit plus animé que que le sien, qu’ils ont parlé des arts, de la politique, & que sur ce dernier point il a été extrêmement satisfait de la mesure avec laquelle Thiers s’est exprimée Le Roi revient vendredi. M. le Duc d’Orléans part le 15 et fera une absence de quatre semaines ; en attendant sa femme n’a pas encore bougé de son lit et sa faiblesse est telle qu’elle ne peut pas lever la tête. Je suis étonnée qu'il la quitte. Madame partira pour son château de Randon avec la princesse Clémentine et les petits princes. Elle ne reviendra qu'au bout d’un mois. La cour rentre aux Tuileries for good. Plus tard il y aura un petit séjour à Trianon, et un autre à Fontainebleau mais private. Je crois que voilà assez de commérage.
J'ai été hier matin à Auteuil. J'y dîne aujourd'hui. Le soir j’ai vu chez moi quelques personnes car je commence J’ai donc fait venir à m’ennuyer. mon Ambassadeur, son frère, la petite Princesse, Armin, & quelques autres. Le temps est froid quoique gai. Un beau soleil, et un vent glacé. Je n’aime pas cela. C’est du humbug. Je viens d'écrire une longue lettre à Marguerite. Je dois bien des lettres à bien du monde. Mon humeur est si chagrine que je n’ai pas le courage de me mettre à l’oeuvre. J'attends maintenant ce qui ressortira de Weymar, et au fond je n’attends pas grand chose. Je vous remercie de la lettre reçue ce matin. Le mauvais moment est passé n’est-ce pas ? Je suis presque impatiente de voir Marie partir, et cependant je serai bien seule. Je n’attends mon fils que vers le 22 pour quatre ou cinq jours. Lady Granville demain. Adieu, with all my heart.
Mots-clés : Diplomatie, Réseau social et politique
133. Val-Richer, Dimanche 28 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les journaux Anglais semblent croire à des complications sérieuses entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Cela vous conviendrait bien ; mais je ne pense pas que vous ayez cette satisfaction. Les aventuriers amérais font beaucoup de bruit d'avance, et leurgouvernement ne fait rien contre eux jusqu'au dernier moment ; mais quand ce moment arrive, un peu de bon sens revient aux uns un peu de fermeté aux autres et tout s’arrête ou avorte. La guerre ne s'allumera pas dans le nouveau monde ; il est plus sensé que l’ancien malgré les apparences.
Si tout ce qu’on dit de la difficulté d'abonder Nicolaleff est mai, et cela semble vrai, on ne fera plus rien de sérieux cette année, du moins là, et l’hiver se passera en préparatifs, pour le printemps. On parlera de paix pendant ce temps là, mais pour rien Fâcheuse condition, j’ai autant de peine à croire à la paix que j'en ai eu à croire à la guerre. Votre Empereur ne restera certainement pas longtemps à Nicolajeff, s'il ne s'y passe rien.
Rappelez, je vous prie à Lord Lansdowne ce qu’il nous disait à Bruxelles, que la paix devait se faire quand Sébastopol serait pris et détruit : " Nous aurons alors, me disait-il, de la récurité pour 25 ans. Qui peut prétendre plus ?
Je suis bien aise que les Brabant soient partis. La durée ne fait pas oublier, l'inconvenance. Celle là a été sentie plus loin que je ne l'aurais cru ; je suis allé dîner mecredi dernier à Lisieux ; tout le monde m'en a parlé pour s'en étonner.
La Reine Amélie est établie à la Villa Pellegrini, tout près de Gênes. Le Roi de Sardaigne lui a offert avec beaucoup d’instances son palais à Gênes. Le Roi de Naples a insisté encore plus pour qu’elle vint à Naples, dans son propre palais, ou dans tout autre qu’elle préférerait. Elle a tout refusé, et elle a eu raison. Elle a vu en passant à Francfort sa fille la Princesse Clémentine avec ses enfants, son petit-fils Philippe, de Wurtemberg avec le Duc son père, et la Duchesse d'Orléans qui a voulu venir, avec ses fils, lui renouveler les adieux.
La Duchesse de Sutherland m'a répondu très gracieusement. Comme de raison, elle ne sait rien elle-même de ce que je lui ai demandé ; mais elle me promet un livre et des questions à son frère. Je désire qu’elle n'oublie pas, si elle quitte Paris avant que je n’y arrive, soyez assez bonne pour le lui rappeler.
Je vous envoie une lettre qui vous touchera. Bonne impression à recevoir. Le pasteur de notre église, M. Adolphe Monod, est mourant, tout-à-fait mourant ; homme d’un talent, et d’un caractère vraiment rares. Le Protestantisme Français aura fait, en dix huit mois des grande pertes, M. Verny et lui. La lettre est écrite à mon gendre Cornélis, par un jeune homme de ses amis, fort malade lui-même. Renvoyez- la moi, je vous prie, dés que vous l'aurez lu. Cornélis tient à la garder.
Onze heures
Voilà votre lettre. Cela m'amuse que vous retiriez votre admination aux dernières pages de Thiers ; comme si vous ne l’aviez pas éprouvée. Voici, M. de Talleyrand: " Ne croyez jamais les premiers mouvements car ils sont toujours bons." C'est votre étourderie. Adieu, Adieu.
133. Val-Richer, Mardi 18 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui, je vous aime, je vous aime, plus que je ne vous ai jamais aimée, plus que vous ne le croirez jamais. Vous êtes malade depuis trois jours. On peut être bien malheureux sans être malade. Que n’ai-je pas pensé, que n’ai-je pas senti depuis trois jours ?
Laissez-moi être heureux de toutes ces lettres d’aujourd’hui ; heureux, oui heureux, laissez-moi être heureux de tout ce que je lis là. Je ne l’espérais pas. Je ne l’espérais plus. Dearest ever dearest, je vois ce que vous avez souffert. Pardon, pardon, laissez-moi être heureux. J’en ai un remord immense ; mais je suis si heureux. Trois jours sans lettres et en supposant toutes les causes, des causes bien pires que de vous savoir malade ! Ce que je dis là est affreux. Mais pardon encore pour cela. Adieu Adieu. Je vous aime. Ce soir, je vous dirai tout. Je vous aime.
133. Val Richer, Mardi 8 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne vous ai pas écrit hier. J'étais las de rabâcher par écrit et impatienté de ne pouvoir causer. Savez-vous combien de temps vous resterez à Schlangenbad ? Je suppose que non. Vous y referez-vous un salon, comme à Ems ? Je suppose que oui. Vous ne m’avez pas nommé les acteurs de votre second salon d’Ems. Je n'en connais que Morny.
On me dit que Biarritz ne réussit pas à l'Impératrice. Elle a suspendu ses bains. Elle est préoccupée de sa santé, et aussi de celle de l'Empereur. On s'étonne un peu à Paris qu’ils en soient partis au moment de la recrudescence du Choléra. On compare le Roi de Sardaigne allant à Gênes exprès pour visiter les hôpitaux cholériques. Comparaison faite sans amertume, sans mauvais vouloir, comme un fait qu’on remarque, et on passe.
La recrudescence est en effet assez vive ; samedi dernier 106 morts constatées à Paris, Vendredi 113. C'est peu en comparaison des chiffres des grandes crises ; pourtant c’est sérieux. Duchâtel m’écrit que le déclin paraît commencer. Ce sont les grandes chaleurs, et les orages qui ont multiplié les cas. Le frais est revenu. Duchâtel reste à Paris jusqu'au 12, à cause des prix de son fils ; après quoi il va s'établir dans la Gironde jusqu’au mois de décembre. J’ai aussi des nouvelles de Montebello qui ne va pas en Champagne parce que le Choléra y est plus fort qu'a Paris. Il viendra passer les vacances de ses enfants à St Adresse, près du Havre, et il me dit que de là il viendra passer deux ou trois jours avec moi. Je voudrais vous l'envoyer, mais je n'y compte pas.
La lettre de l'Empereur au Ministre de la guerre, à propos des marches des troupes vous aura un peu surprise. Il a très bien fait de l'écrire, mais moins bien de la publier. L'Empereur son oncle lui aurait dit qu’on ne lave pas son linge sale en public, surtout quand c’est la tête de ses propres généraux qui est le linge sale. Il y a eu certainement de grandes étourderies des Chefs ; la plus criante, dit-on, est celle d’un colonel à Vincennes qui, par un jour des plus ardentes chaleurs, a fait faire à ses soldats, au pas de course, le voyage de Vincennes à Paris. Il en est tombé beaucoup sur la route, et on assure, ce que j’ai peine à croire, que 37 sont morts à l'hôpital. Certainement cela méritait une vive admonition impériale et ministérielle, mais sans recherche de popularité, aux dépens des chefs.
Les nouvelles de Madrid sont un peu meilleures. M. Drouyn de Lhuys s'attendait à ce qui est arrivé, et avait donné à M. Turgot des instructions en conséquence. On dit que M. Turgot les a bien suivies et n’a point fait de faute. On est content de lui et de soi. Au fond, on est fâché et inquiet de ce qui se passe là. Il y aura à Madrid une presse et une tribune fort mal contenues. L'Empereur est moins inquiet que ses ministres ; il les rassure en disant : " Nous donnons quelquefois la peste aux autres ; nous ne la prenons pas."
Midi.
Voilà votre N°129. Long et curieux. Nous nous envoyons les mêmes bons mots. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Correspondance, Diplomatie, France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Ministère de la Guerre (France), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Espagne), Politique (France), Réseau social et politique, Salon, Santé
134. Bruxelles, Lundi 18 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Pas de lettre hier. J’attendrai aujourd’hui. Je n'ai rien d’autres part non plus, & personne ici ne sait un mot de nouvelles. Le monde entier regarde Sébastopol et attend ce qui sortira de là. Je crois que nous ne sommes pas assez forts en Crimée.
Vous avez une grande supériorité de nombre. Ce sont donc les accidents sur lesquels nous avons à compter en notre faveur. Ce qui me frappe c’est la crainte qui excite en France & en Angleterre sur l’issue de cette expédition. Les plus sensés la trouvent extravagante. J’ai peur qu’elle ne le soit pas. Nous ne pourrons savoir des nouvelles que dans quelques jours d'ici. Quel moment curieux. Le roi Léopold part ce matin pour aller visiter sa villa sur le lac de Come. C’est agréable de pouvoir se donner ce loisir au temps qui court. Il reviendra à la mi octobre pour les chambres. Ses ministres ont retiré leur démission. Hélène et Paul me quittent à la fin de la semaine ; quelle perte !
Dans ce moment une lettre de Constantin. Je n’y trouve pas de gasconade sur Sébastopol. Bien mauvais signe pour nous. Evidemment nous n'y sommes pas forts. Le dernier mot est : « Si Sébastopol est, détruit, l’Empereur ne peut plus faire la paix de sitôt. » Toute sa lettre est triste. Voici la vôtre aussi qui n’est pas plus gaie mais plus agréable dans tous les sens. que vous voudrez donner à ce mot. Pauvre Constantin ! Je vous ai dit que je suis à Bellevue, mais ni chez Kisseleff ni chez moi. A propos il est ici, il est tout de suite venu, empressé et embarrassé. Je le mets à son aise, c’est fini, il sentira son tort longtemps cela me suffit.
Barrot est très empressé aussi, les autres diplomates sont absents. Bruxelles est un désert. Molé a été si malade. qu'il lui a fallu se transporter à Paris pour rester sous la main d'Andral. Aucun de ses enfants ni de ses amis, tout seul. Une lettre triste et bonne. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Armée, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Correspondance, Diplomatie, Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Belgique), Réseau social et politique, Salon, Tristesse
134. Paris, Jeudi 13 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous êtes toujours égal, toujours bon pour moi. Votre lettre ce matin me fait plaisir à relire. Mais au milieu de vos plus douces paroles je vois bien que je ne vous plais plus comme je vous plaisais et me je prends moi en véritable horreur. Il n’y a pas de sentiment plus pénible que celui-là. Je ne m’aime pas, voilà ce qui fait mon humeur. Du reste j'ai bien de quoi en avoir et de la très mauvaise. Il me semble que tout, en grand, en détail tout est en décadence pour moi, de temps en temps il s’offre à mon imagination quelque lueur, mais elle n’a pas de duré. Vous seul vous êtes pour moi une réalité, je le sens mille fois le jour, & je ne vous le dis jamais comme je le sens, parce qu'il me parait que je n’en ai pas le droit, que mon humeur mobile me porterait le lendemain à vous dire des paroles, plus tièdes, que tout cela n’est pas. digne de vous. Ah mon Dieu quelle confusion dans mon cœur ! Ma destinée est si triste que mon pauvre esprit succombe et quand vous n'êtes pas auprès de moi, il ne me reste pas un brin de courage, pas un brin de raison.
Le temps froid me tient loin du bois de Boulogne, j'ai été du côté de la ville hier, dans quelques boutiques. C’est des meubles que je vais voir. Quelques fois l’envie de m’arranger me prend, et puis, je trouve si pitoyable de m’arranger à la Terrasse. J’attends un bel hôtel ; le luxe, le confort dans lesquels j'ai vécu toute ma vie, et mon bivouac actuel me parait insoutenable. C’était drôle en commençant, cela ne me parait plus drôle du tout. J'en suis excédée. La petite princesse a tous les jours quelque nouveau récit à me faire sur Marie ; elle me démontre claire ment que Marie me déteste et qu’elle parle mal de moi. Cela ne me fâche pas, mais cela m’afflige. Comment pas un peu de reconnaissance pour tout ce que j'ai fait pour elle. Je ne sais par quoi nous finirons.
A propos Marie hait les petits enfants de la petite princesse. et a proposé un jour à sa nourrice de lui jeter une pensée à la tête ; une autre fois de l’étouffer. Eh bien & le médecin dit qu’il n’y a pas l'ombre de folie en elle ! Sneyd est arrivé & m’a fait une longue visite hier matin. Il m’a apporté une lettre de Lady Clauricarde que je vous enverrai. J’ai été dîner à Auteuil, j'y ai rencontré Fagel que j'aime beaucoup. Nous nous sommes arrangés pour un long tête à tête Samedi. Pas de lettre pas la moindre nouvelle de mon mari. Adieu. Adieu. Pourquoi ne suis-je pas née en province, d'une famille amie de la vôtre. Vous auriez pris soin de me former, plus tard de m’aimer, & puis. Adieu, adieu.
134. Paris, Lundi 29 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Lundi
J’ai vu hier Lord Lansdowne Je lui ai rappellé Bruxelles. Il convient qu'il a dit cela mais il ajoute qu'il faut à présent le côté nord. C’est des mots. He is shuffling. En termes généraux il m’a dit que la paix pouvait être plus prochaine qu'on ne le pense. C'est pour se moquer de moi ou s’en débarasser. J'ai laissé là le sujet. Je ne l’ai vu d’ailleurs seule qu’un instant.
L’Empereur a reçu très gracieusement M. de Buat une demi-heure de conversa tion tête-à-tête. Il lui aura trouvé beaucoup d’esprit, & je crois qu'il aura su soutenir ses opinions. De son côté Buat a été charmé de l’Empereur. Je ne sais cela encore que par voie indirecte. Je le verrai aujourd’hui. Mon neveu Appony a eu son audience aussi, dont il est revenu enchanté. Celui là est un grand admirateur. L’Impératrice l’a reçu après et a été pleine de grace & de mémoire pour sa famille.
La lettre que je vous renvoye est bien touchante. Je vous remercie de me l’avoir fait lire. C'est bien élevé, je me suis bien petite. Adieu. Adieu.
134. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos scrupules sont excessifs vous pouvez admirer, sans vous compromettre les belles pages de Thiers que le pouvoir se perd par ses propres excés, qu’il a besoin d'être averti et contenu, c’est un lieu commun d'expérience et de morale qui n’engage point au systême parlementaire. Thiers a parfaitement raison, et je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous géneriez d'avoir raison avec lui. Je ne reproche à Thiers que ses dernières lignes dans ce paragraphe ; il aime mieux les excés de la liberté que ceux du pouvoir. Non sense démocratique l’anarchie populaire est une tyrannie, comme le pouvoir absolu d’un seul, et la pire de toutes ; il n’y a pas plus de liberté dans l’un que dans l'autre cas. L’anarchie populaire n’a qu’un avantage c’est d'être de toutes les tyrannies, la moins durable, étant la pire.
La Préface de Thiers est excellente et charmante, parfaitement, sensée et naturelle. très souvent spirituelle, quelquefois trop vraie, cest-à-dire un peu commune au fond, en étant toujours d’une forme, très agréable. Parfaite image de lui-même de son esprit, de son caractère vif, facile, souple, étendu, comprenant tout propre à tout. Mais je ne comprends pas comment n'ayant mis dans ce volume que les trois chapitres dont en donne les têtres, il enfermera toute la fin de cette grande histoire dans les deux ou trois volumes qu’il annonce encore. Je suis curieux de son chapitre sur le blocus continental.
Je vois avec plaisir que vous n'avez pas de vide. L'affluence des étrangers vous profite, et vous ne savez à quelle heure placer toutes vos visites. Est-ce qu’on prolongera comme on dit, l'Exposition jusqu’au printemps ? Je ne trouverais pas cela bien calculé ; il vaut mieux s'en aller au milieu du regret qu’au bout de la satiété.
Onze heures
Si nous avons l’air de ne pas nous entendre sur le pouvoir absolu, nous sommes parfaitement d'accord sur la tyrannie démagogique. Et d'accord comme il faut l'être, sans nous être rien dit. Adieu, adieu. Je crois à la guerre acharnée dont vous me parlez, et je la trouve de plus en plus absurde et coupable. Adieu, adieu. G.
134. Val-Richer, Mardi 18 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pardonnez-moi ce que je vous ai dit ce matin, ce que je vous redirai. J’étais si heureux ! Je suis si heureux ! Je n’ai pas pu, je ne puis pas, je ne veux pas vous le faire. Il faut que vous me le pardonniez. Oui vous m’aimez, vous m’aimez beaucoup. J’en ai douté. Moi aussi j’ai souffert, depuis plus de trois jours. J’ai cru depuis plus de trois jours, non pas que vous ne m’aimiez plus, non pas que vous m’aimiez moins mais que vous ne m’aviez jamais assez aimé que nous nous étions trompés tous deux, vous sur ce que j’étais moi, sur ce que je pouvais être pour vous. Que me fait l’étonnement ? Que me fait la nouveauté ? Moi, je vous aime plus, oui, beaucoup plus que le premier jour, que le premier mois. Je suis bien plus à vous. J’ai bien plus besoin de vous.
A Paris, quand je vais vous voir, le second quart d’heure vaut mieux que le premier, le troisième mieux que le second ; de moment en moment, près de vous, je me sens plus animé, plus reposé, plus confiant, plus heureux, plus avide. My beloved il en est des jours comme des heures, des mois comme des jours ; il en sera des années comme des mois. Le temps, loin de rien user, apporte à vous de l’attrait pour moi, à moi de l’amour pour vous. Je sais cela ; j’en suis sûr je l’éprouve. J’ai cru qu’il en était autrement pour vous, que ce même temps qui, pour moi, augmentait le charme et l’empire de notre lien, pour vous l’affaiblissait et le décolorait un peu. Et un peu, c’est tout. Je l’ai cru. Et au milieu de cette crainte, je suis trois jours sans lettre de vous ! J’ai tout supposé, tout m’a paru possible, des choses absurdes, folles, odieuses criminelles. Votre chagrin, votre violent chagrin de ce que je ne pouvais aller vous voir, était pour moi une explication inespérée, ravissante. Et c’est la vraie ! Et vous m’aimez comme je le veux, vous me le dites comme je le veux ! Encore une fois, pardonnez-moi mon bonheur. Vous grondez ! Non, dearest non ; je vous rends grâces, je vous aime. Vous ne savez pas combien je vous aime. Oui, je puis contenir, je puis taire ce que je sens. Je le contiens toujours. Je ne vous ai jamais exprimé ma tendresse sans me sentir le cœur plein d’une tendresse inexprimable, qui montait, montait en moi, et s’efforçait en vain de passer de moi à vous, et retombait en moi, sans que vous l’eussiez vue, sans que vous en eussiez joui. Désirez, mon amie, imaginez, inventez, rêvez tout ce qu’il vous plaira, je vous défie. Vous le savez ; je vous ai défiée une fois. Je vous défie toujours. Et laissez-moi vous tout dire.
Quand j’ai cru ce que je vous disais tout à l’heure, je ne m’en suis point pris à vous ; je ne vous l’ai point imputé à mobilité, à Caprice. J’ai tout attribué à la force d’un autre sentiment, un moment contenu et distrait, mais redevenu tout puissant dans votre cœur. Dearest, je puis tout accepter de la créature, que j’aime, tout, excepté l’inégalité, la moindre inégalité en fait de tendresse. Être pour elle moins qu’elle n’est pour moi, je ne puis pas, je ne veux pas. Il ne croyez pas que ce soit fierté seulement, pur orgueil. Non, non. Mais je vous aime de cet amour au delà duquel il n’y a rien et qui ne veut rien voir au delà, qui ne veut pas avoir un regret à sentir, un désir à former, que rien ne peut contenter si ce n’est le même amour. Je puis tout sacrifier, tout, même le bonheur que j’attends de vous, même le bonheur que j’ai à vous donner ; mais renoncer à la moindre part de votre cœur, de mon ambition sur votre cœur, jamais. Le jour où je le pourrais vous n’auriez pas tout mon cœur à moi.
Mercredi matin, 3 heures
Je vous ai quittée hier au soir pour redescendre dans le salon. J’attendais un messager que j’avais envoyé le matin à Broglie. La Duchesse de Broglie est malade, très malade ; une fièvre catarrhale aiguë, compliquée d’une inflammation d’entrailles, & de graves accidents spasmodiques. M. Chomel a quitté Paris pour venir passer quelques heures à Broglie. Il est reparti inquiet. L’état était le même hier. Dans tous les cas, ce sera très long. Son pauvre mari me fait une pitié profonde. Il l’aime autant qu’il peut aimer. Il serait très malheureux. J’espère cependant, et on espère. Je vous donnerai de ses nouvelles. J’en ai tous les jours. Je me suis couché tard et je me lève tard ce matin. J’étais fatigué. Depuis trois jours, j’ai fait de très longues courses, un peu pour promener mes hôtes, beaucoup pour me distraire. J’ai chassé même, ce qui ne m’était pas arrivé depuis plus de treize ans. Vous me parlez de lettres froides, de lettres bien écrites, bien raisonnées. C’est impossible. Vous me dîtes que je ne vous comprends pas. Vous ne m’avez pas compris non plus. Ah comprenons, nous toujours. Il y a trop à souffrir autrement.
10 h. 1/2
Je n’ai rien de vous ce matin, un seul mot de Génie que j’avais chargé d’aller savoir si vous étiez malade. Demain j’aurai une lettre de vous. Vous ai-je bien dit que je vous aime ? Vous ai-je dit quelque chose ? Je n’en sais rien. J’ai tant à vous dire. Je recommencerai. Adieu, adieu. Jamais tant d’adieux. G.
134. Val Richer, Mercredi 9 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon facteur est arrivé ce matin plutôt que de coutume et il était pressé de repartir. Je n’ai pas eu le temps de vous écrire. Ceci ne partira que demain. Mais je viens causer un moment avec vous à la fin de la matinée et après d'ennuyeuses visites. Quel abus des mots ? Causer ? Je ne sens jamais plus la séparation qu’au moment où je vous écris. Je ne crois pas à un armistice. Je ne crois pas à une mésintelligence, sérieuse entre la Prusse et l’Autriche.
Je ne crois à rien de ce qui supposerait, de la part des acteurs une conduite prévoyante indépendante, fortement préméditée et suivie. Ils sont et ils seront tous dominés et entrainés par des événements qu’ils n’ont ni faits, ni voulus. Je ne compte pour sortir de cette impasse, que sur l'extrême difficulté et cherté des efforts qu’il faudra faire pour y rester, et sur la presque impossibilité d’arriver à des résultats qui soient une solution. La guerre finira de guerre lasse, sans vraie victoire pour personne. Ses auteurs ne méritent pas mieux que cela.
Certainement l'Empereur Napoléon y a gagné, et il y gagnera encore s’il continue à ne faire ni plus, ni moins. Il a fait preuve de sagesse, car il n’a cédé à aucune tentation d'ambition ni de révolution. L’Angleterre y gagnera aussi ; elle a fait preuve de puissance ; elle a protégé efficacement l'Empire Turc contre vous, après l'avoir protégé efficacement contre nous en 1840. Un Empire protégé deux fois en quinze ans est bien près d'être un territoire sujet. L’Autriche, si elle garde jusqu'au bout la position qu’elle a en ce monent y gagnera aussi beaucoup ; elle aura fait preuve d'habilité ? Jusqu'ici, ce sont là, je crains, les seuls gagnants.
Jeudi matin 10.
J’ai devant moi, un brouillard qui me présage une belle journée. Les brouillards du matin, sans pluie, ont ici ce mérite. Je leur en saurai aujourd’hui, un gré particulier Les Broglie viennent, de Trouville, passer ici, la journée. Il vaut mieux pouvoir se promener en causant. Il n’y a pas grand monde à Trouville. Le Prince Murat y fait la pluie et le beau temps. Très grand train et train populaire. L’Espagne a bien mauvais air et Espartero bien de la peine à établir son autorité. Je persiste pourtant à croire qu’il l'emportera sur les juntes. Il aura toute l’armée pour lui et c’est l’armée en Espagne qui fait et réprime tour à tour les révolutions. Gréville a raison ; si Palmerston était aux affaires étrangères, il s'en mêlerait et dans un mauvais sens. Il vaut mieux qu’il passe son temps à faire faire, pour Mistriss Hume, le portrait de M. Hume.
Onze heures
Vous évacuez donc la Moldavie comme la Valachie et vous rentrez chez vous. Ainsi soit-il ? Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Correspondance, France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (Autriche), Politique (Espagne), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie)
135. Bruxelles, Mercredi 20 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres font la seule joie de ma vie. J'en ai eu une excellente de Morny. Il quittait Paris pour aller passer quelques semaines à la campagne.
La respiration manque quand on songe à Sébastopol & on ne pense qu’à cela. Quelle boucherie cela va être ! L’ordre du jour de Menchikoff est le pendant de celui de St Arnaud, il n’y a pas à reculer. On ne se rendra pas. Cela fait frémir. Je persiste à penser que vous réussirez à moins que le ciel ne s’en mêle, c’est à dire les tempêtes. Et voilà l'équinoxe.
Je mène une pauvre vie ici, et dans quelques jours ce sera complet par le départ d'Hélène et de Paul. Van Praet habite la campagne, je ne le vois qu'un instant dans la journée, mais tout cela qui est cependant tant dans ma vie ne serait rien si je n’avais l’esprit bien agité. Je ne dors pas, j’ai perdu tout appétit. Je m'efforce de me tenir sur mes jambes, de vivre encore un peu de temps. Cela n’ira pas. La tête est trop tristement remplie et personne auprès de qui m'épancher et chercher conseil.
Un moment suprême s’approche pour moi. Dites-moi, si vous vous sentez le cœur de me faire un sacrifice. Vous allez faire des visites de 15 jours chez le duc de Broglie, vous faites des courses de Paris au Val Richer pour un jardinier. Ne pourrais-je pas être un peu le jardinier, un peu le duc de Broglie ?
Pour moi c’est un peu la vie ou la mort. Je ne sais pas prendre un parti et je suis force cependant de le faire. Je ne vais pas au devant des bombes, mais elles peuvent venir à moi. Il m'en est arrivée déjà une indirecte hier qui me bouleverse. Il faut bien du courage et j’en manque. C’est du très loin que je vous parle. Et bien, dites-moi, voulez-vous ? pouvez-vous ? quand pouvez-vous ?
J’ai été interrompue par la visite du G. D. de Weymar. Il ne passe ici que quelques heures. Même langage que tous les Princes en Allemagne. La paix, la paix. Votre Empereur. Blâme du mien. Pas de confiance dans le roi de Prusse. L'Empereur d'Autriche ne permet qu'à ses ministres de lui parler d’affaires. Bual & Bach, tous deux nos ennemis. Sébastopol agace les nerfs de tout le monde. Le temps est beau encore. Que me fait le beau temps. Adieu. Adieu, mon Dieu que je suis triste et flottante. Adieu.
135. Paris, Mardi 30 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
A la bonne heure et nous pensons de même. Nous étions inquiets de vous, Molé et moi hier. Nous voilà rassurés. La tyrannie de tous, odieuse. Molé était venu hier pour le mariage de sa petite nièce, et il m’a demandé à dîner. Après le dîner sont venus Lord Lansdowne & Montebello Et bien le mariage dérange. Lorsqu'on s’est présenté chez le maire, Mad. de Caumont y était venue pour s'opposer. Elle est folle. Berryer la soutient et la défend, il est depuis quelques temps pour toutes les mauvaises causes.
Molé a usé dans la journée du peu qu'il a d'influence et on va faire prononcer la séparation qui donnera au Pair seul toute autorité. En attendant voilà un esclandre. Lady Allice m'écrit, fort réjoui ede la perspective d'une brouille avec les Etats Unis. Elle ajoute. I think we deserve any misfortune that may befall us. Voilà une bonne anglaise. Je ne crois pas que j’ai la moindre nouvelle à vous dire. Adieu. Adieu.
135. Paris, Samedi 15 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne vous ai pas écrit hier. Aujourd’hui j'essaie de le faire mais je ne crois pas que Vous me dites je vous envoie ma lettre aujourd’hui il faut tout se dire, même de loin. Cela me semble impossible si je vous disais tout, tout ce que j’ai sur le cœur. Ah que je vous blesserais. Et en ne vous le disant pas, je ne sais de quoi vous parler, car je n’ai plus qu'une idée, une seule. Vous m'avez fait bien du mal. Et vous voulez que je croie, vous voulez de la foi. Et tous les jours vous prenez soin de m’en enlever. En me quittant le 16 août vous étiez décidé à ne pas revenir. Je l’ai vu, je l’ai senti. Je me suis fait effort pour en douter. Votre proposition de Baden m'a rendu mon soupçon. Je ne vous ai pas aidé à vous débarrasser de moi, M. Duvergier de Hauranne, M. le préfet, Madame sa femme, sont venus à votre aide. Convenez que ce sont de pauvres raisons ! Les autres valent mieux ; et cependant l’année dernière elles n’étaient pas suffisantes pour vous retenir ? Vous êtes venu me voir deux fois, cela ne vous a pas semblé difficile. C’est que vous m’aimiez bien alors. Non, je ne suis pas injuste je ne suis pas défiante, je vois les choses comme elles sont. Je mérite tout ce qui m'arrive, c’est moi, toujours moi que j’accuse. Je vous l’ai dit, je ne m’aime pas, et je trouve que les autres ont raison de ne pas m’aimer. Je sens ce malheur profondément. J’ai cru que vous m'aimeriez beaucoup, beaucoup, j’avais repris confiance en moi-même, je l’ai perdue, tout à fait perdu, et je me retrouve plus isolée, plus malheureuse que je ne l'ai jamais été. Mon âme est tout à fait abîmée, flétrie. Je n'ai courage à rien. Je ne sais que vous dire. Je ne vous dis pas tout encore. Je ne vous crois plus, et le 31 octobre ! Vous reverrai-je le 31 octobre. Vous me l'avez promis, mais est-ce une raison pour que j'y crois maintenant ?
Dans ce moment il passe un convoi sous mes fenêtres. Le cercueil est tout blanc tout est recouvert de blanc. Qu’est-ce que c'est que le blanc pour les morts ? Dimanche 16 Sept. 8 h 1/2 Vous voyez bien que je ne puis pas vous envoyer ma lettre, Et j'ai besoin de vous écrire, de vous parler à tout instant. Je vous aime, je vous aime beaucoup. Pourquoi m'aimez-vous si peu ? Vos lettres sont bien écrites mais elles me semblent si froides ! Je me couvre beaucoup. Je ne parviens pas à me réchauffer.
135. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’espérais pas de lettre hier ; et pourtant, quand elle m’a manqué, il m’a semblé que mon mal recommençait. Je vous dis, je vous répète que vous ne savez pas combien je vous aime. Que ne donnerais- je pas pour que vous eussiez vu ce qui s’est passé dans mon cœur huit jours, quinze jours avant le n°127 ? Par nature, quand j’aime je suis faible, très faible avec ce que j’aime et avec moi-même. Je délibère, j’hésite, je recule avant de résister comme d’autres avant de céder. Il me faut les motifs les plus évidents, les plus impérieux. Et quand ma raison, qui reste libre, a reconnu la nécessité, personne ne sait ce qu’il m’en coûte d’obéir à la nécessité et à la raison. Et quand il faut que vous en souffriez, vous que j’aime tant ! Dearest, je vous ai vu souffrir ; je sais ce que c’est que votre abandon à la douleur, votre angoisse, votre désespoir. Pardonnez-moi, Pardonnez-moi. Hélas, je ne puis pas vous promettre de ne vous faire jamais souffrir, pas plus que vous ne pouvez me promettre de ne jamais blesser mon insatiable exigence, de me donner toute votre vie. Mais je vous aime tant, je vous aimerai tant ! De loin, de près ! Et près de vous, je serai si heureux, je vous rendrai si heureuse. Vous vous en souvenez, n’est-ce pas de ces heures charmantes que nous avons si souvent passées ensemble si animées et si douces, si confiantes, rapides à ce point que nous ne les voyons pas passer et pourtant pleines comme une vie, et laissant des traces si profondes ! Vous me les rendrez, je vous les rendrai ; et quand nous les aurons retrouvées, quand je vous aurai là, devant moi, près de vous, il n’y aura plus pour nous de chagrin passé, ni de chagrin à venir. Nous n’aurons ni mémoire, ni prévoyance, comme des enfants, de vrais enfants, car le mal reviendra ; ce qui nous manque, nous manquera encore souvent. Il n’est que trop vrai qu’il nous manque beaucoup, beaucoup ?
10 heures
Oui, oui, je vous aimerai toujours, immensément, à combler, à dépasser votre plus insatiable ambition. Moi aussi, en ouvrant votre lettre excellente, charmante, j’ai poussé un soupir de délivrance. Moi aussi, je suis heureux bien heureux. Dearest, je l’ai été avant vous ; j’ai été soulagé avant vous. C’est là mon remord. Vous me pardonnez, n’est-ce pas ? Non, nous ne nous connaissions pas ; nous ne nous connaîtrons jamais, jamais assez pour que notre sécurité soit complète. Il n’y a de sécurité complète que dans un bonheur complet. Comment n’aurions-nous jamais un mauvais jour, une pensée triste une inquiétude amère ? Sommes-nous toujours ensemble ? Pouvons-nous à chaque instant, sur la moindre occasion, nous délivrer l’un l’autre, par un mot, par un regard, de ces nuages qui passent, de ces poids secrets qui tombent tout à coup sur le cœur ? Mais n’importe ; nous sommes, bien heureux ; nous serons bien heureux. Nous nous aimerons encore plus que nous ne serons heureux. Adieu. Adieu. Que de choses, j’ai encore à vous dire ! Oui, c’est une longue, longue histoire. Adieu. Je vous aime ; je vous aime comme le dit le petit papier dans le petit sachet noir. Adieu. G. Mad de Broglie est un peu mieux, c’est-à-dire un peu moins mal. Je viens de recevoir des nouvelles jusqu’à hier midi. Ils sont toujours bien inquiets. Cependant il y a plutôt du mieux. On me dit : " La nuit a été plus tranquille qu’aucune des précédentes depuis que la maladie a pris un caractère de gravité. La matinée commence bien. "
135. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous trouve trop sévère pour cette préface, même à part votre dissidence. Il est vrai que trois lectures c’est beaucoup. Les mérites de tout ce que fait Thiers sont de ceux qui frappent et plaisent au premier coup d’oeil ; il ne faut pas y regarder trop avant, ni trop souvent, ni de trop près. On peut dire de ses livres en mettant lecteurs pour mortels, ce que Voltaire dit de la vie :
Glissez mortels n’appuyez pas. Mais cela dit, il ne faut pas oublier la première impression qu’on a reçue, car elle a beaucoup de vrai.
Les prédictions que vous m'envoyez pour le printemps prochain ne m'étonnent pas ; c’est la conséquence naturelle, nécessaire forcée de la politique qui a fait entreprendre cette guerre et qu’on a proclamée en l’entre prenant. Il n’y a de sensé et de pratique que la paix ou la conquête ; quand on ne veut ni l’une ni l'autre, comment en finira-t-on et quand aura-t-on fait ce qu’on veut ?
Je ne comprends pas qu’on hésite à détruire radicalement Sébastopol ; à moins qu’on ne veuille s’y établir et le garder contre vous comme on a garde Gibraltar toute l’Espagne et la France. La destruction de Sébastopol est le sine qua non de la destitution de la Crimée.
L’article du Times sur la guerre d’Asie me paraît significatif. La aussi, on fera au printemps, quelque grand effort.
Le Moniteur a payé hier au Duc de Brabant le prix de son voyage. Je souhaite que maintenant la Belgique reste et soit laissée tranquille dans sa neutralité.
Onze heures
Absolument rien dans les journaux. Lord Lansdowne ne me surprend pas. Moins sérieux, qu’il n'en a l’air. Adieu, adieu.
135. Val Richer, Vendredi 11 août 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je parle comme si j'étais sûr que les journaux disent vrai ; vous voilà donc hors de la Moldavie comme de la Valachie, et rentrés chez vous après un an de campagne. Comment l'orgueil du maître et l’enthousiasme des serviteurs s'accommodent-ils de ce résultat ? Il est vrai qu’il n’y a point de limites à l'aveuglement de l'orgueil. Ce spectacle est plus fait pour les moralistes que pour les politiques.
Votre Empereur a fait, au parti conservateur en Europe, dans la politique extérieure, le même mal que lui a fait, en 1846 sir Robert Peel dans le gouvernement intérieur ; il l'a désorganisé, et abattu en le divisant et en l'abreuvant de mécomptes. Je crois peu au triomphe Européen de la politique révolutionnaire, mais beaucoup à la décadence de la politique conservatrice. Le mal n'est pas puissant, mais le bien est très malade. Le monde sera longtemps ballotté entre le bien et le mal sans périr et sans se relever.
Les Broglie ont passé hier la journée ici. Le Duc revenait de Paris, uniquement préoccupé (Paris) du choléra qui est pourtant en déclin. Comme je vous le disais, on remarque que l'Empereur est parti, et qu’il ne revient pas pour la fête du 15. La Place Louis XV, les Champs Élysées, le Pont, les entours du Corps législatif sont dans un sens dessus dessous extraordinaire à cause de cette fête. On s'amuse assez de ces préparatifs et aussi de ceux de l'Exposition industrielle de l’année prochaine qui sera très belle, dit-on, quoique le Palais soit trop petit.
Voilà Montalembert hors de cause. Les journaux ont eu la permission d’annoncer le fait, sans aucun détail, ni réflexion. Après ce succès, je ne pense pas qu’il donne sa démission du Corps législatif. Il peut y rentrer en souriant.
Les pauvres Ste Aulaire sont menacés d’un grand chagrin. Leur fille aînée, Mad. de Langsdorff est très dangereusement. malade ; un dépérissement rapide dont on ne connaît pas la cause. Elle est à Etiolles avec son mari et ses enfants. Sa mère la soigne avec désespoir.
Quelque russe que soit la Princesse Koutschoubey parlez-lui de moi, je vous prie. Je m'intéresse à son chagrin. Je suis sûr que moi Français, je causerais avec elle plus doucement que vous. Vous savez que je vous trouve une très mauvaise sœur grise, parfaitement impropre à panser les blessures.
Midi.
La nouvelle est officielle. Vous évacuez les Principautés. Mais la paix n’est pas faite. Si on cesse de se battre, et si on commence à négocier, elle se fera. Adieu, Adieu. G.
136. Bruxelles, Vendredi 22 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma dernière lettre vous a-t-elle contrarié, touché ? Je reste perplexe et la respiration me manque quand je pense au faible fil qui me tient encore en vie et en good sense. Car je crois quelque fois que ma tête, m’abandonnera. Certainement je n’y trouve pas la force nécessaire pour prendre un parti. Vous me dites bien à propos aujourd’hui aucun moraliste n’a assez dit ce qu'il y a de contradictions dans notre cœur. Tantôt nous nous précipitons follement dans nos craintes, tantôt nous les repoussons absolument. Un rien chez moii fait pencher la balance vers un côté, & puis je m'arrête effrayée. Ah que j'ai besoin de secours. Je vous remercie de critiquer l'article sur Meyendorff. L'auteur est bien léger, il traite les sujets qu'il ne comprend pas. Quel dommage ! L'occasion était si bonne pour de bonnes choses.
Brunnow et Kisseleff ne sont pas infames, surtout le premier. Je ne sais pourquoi cettedistinction. L'un et l'autre ont mal servi, mal renseigné. Dans ce moment on leur ordonne de faire les morts, on ne veut pas d'eux à Pétersbourg. Meyendorff, que le public accuse aussi, a conservé toute sa faveur personelle auprès de l'Empereur. Il a été nommé grand [?] de la cour, mais on le conserve sur les cadres de la diplomatie et certainement il reparaitra quand la Russi retrouvera sa place ne Europe. Quand cela sera-t-il ? Mad. Kalerdgis part dans quelques jours pour Paris où elle va passer l'hiver. Elle est très agréable et bonne à faire jaser. Au fond là à Pétersbourg comme de ce côté-ci on pense de même, on reconnait les fautes. L’auteur seul ne les reconnait pas.
Le drame de la Crimée peut traîner en longueur. Quelle angoisse. Adieu. Adieu, que me répondrez-vous ? Je crois que j’ai tort de douter, mais je suis si accoutumée aux revers. Ah que celui-ci serait dur. Adieu.
136. Paris, Dimanche 16 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous n'avez pas eu de lettre ; cependant je vous ai écrit. Non pas le premier jour cela m’a été impossible, mon cœur, ma tête, ma main, tout s’y refusait. Mais je vous ai écrit hier, cette lettre est dans mon tiroir, elle y restera, car je vous ai dit tout ce que j’avais sur le cœur. Et vous m’avez appris à ne pas vous envoyer ces choses-là. Vous vous fâchez, vous me répondez, et je ne suis pas convaincue. Il ne me semble possible de nous entendre que de près. Vous m'avez rendue très malade, je me donne le plaisir de vous faire savoir cela. J'ai reçu une lettre de mon mari, je ne sais plus ce qu’il me dit, je sais seulement que vous ne venez pas, je ne sais plus autre chose et je ne pense pas vous offrir une autre manière de vous aimer que de perdre la tête de ce que cette année présente un tel contraste avec l’année dernière.
2 heures
Je rentre de l’église, je suis mieux. Un peu plus calme. J’y ai pensé à vous. Il m’a semblé que je devais tout vous dire, et je suis bien convaincue que je ne puis vous écrire qu'à cette condition. J'ai le cœur si plein, si plein, & vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez. pas le mal que m'a fait votre N°129. Je l'ai lue, relue, étudiée, encore une fois, toutes ces pauvres raisons. La seule, pratique est celle que vous regardez comme la plus faible. J’ai disposé du préfet & de M. Duvergier de Hauranne. Votre mère, vos enfants sûrement ils n’aiment pas à vous voir partir, mais quelques jours ! Vous l'avez bien fait l’année dernière. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi vous venez, vous m’avez souvent répété que vous conserviez votre parfaite liberté d’actions. Je ne me range qu'à la dernière raison et celle-là m’afflige au delà de ce que je puis vous exprimer. Je ne puis donc rien. Est-ce les moyens de venir ? Le temps que cela vous prend et que vous enlèveriez à votre travail ? Mais ce temps pourrait être abrégée. Je vous aurais vu ; et vous voir, vous entendre, me faire entendre de vous, voilà ce qui m’eût comblée, voilà ce que j’attendais, et il m’est impossible de vous rendre l’impression qu'a fait sur moi l’annonce que je ne vous verrais pas. Il m’a semblé que le monde finissait pour moi. J’ai pleuré, je pleure encore, je pleurerai toujours.
Dimanche midi
Je vais à l’église demander à Dieu de remettre ma pauvre tête ! Je vous écris tous les jours, mais je ne vous enverrai ma lettre que si vous me l’ordonnez et n’ordonnez pas légèrement car mon cœur est tout entier dans cette lettre. Je vous en ai écrit trois ce matin que j'ai déchirées. Peut être ferai je le même usage de ce billet. Je n'en sais rien. Je ne sais plus rien, sinon que vous ne venez pas.
136. Paris, Mercredi 31 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mercredi.
Bualt est venu me voir hier plein de ses et de viens. C’est un homme important ici Allemagne. Il se croit sûr qu'elle est nièce et le restera. Il croit aussi que l’Autriche, ne bougera pas. Il est bien content de son audience auprès de l’Empereur, de tout ce qu'on lui a permis de dire & de tout ce que l’Empereur lui a dit. Il dîne aujourd’hui à St Cloud. J’ai vu Fould hier et je suis bien contente de son langage. parfaitement à la paix. Hubner est survenu. Superlativement pacifique, & déclamant vivement sur ce ton si bien qu'il a fini par craindre d'en avoir trop dit, il est parti brusquement en évident mécontentement de lui-même. Nous en avons bien ri Fould et moi.
Il parait qu’il n’y aura plus d'opérations militaires cette année. On restera comme on est. Le roi de Sardaigne arrive le 24 Novembre ou prolonge l'ouverture de l'exposition jusque sur la fin du mois. Et la cloture n’aura lieu que le 2 Xbre. J’ai oublié de vous dire que la question d’hivernage des vaissaux dans les ports suédois ne peut pas être une question. Le gouvernement suèdois dés l'origine de la guerre a déclaré ses ports étaient ouverts, sauf deux, je crois, par conséquent il n’y a pas à négocier. C'est de Molke que je tiens ceci. Greville m'engage fort à lire the Pruss qui contient dit-il d’admirables articles pour la paix. Cela vient. d'Israeli. Il n’est pas vrai qu'il y a coalition entre lui, Gladstone & Bright. Adieu pour aujourd’hui.
136. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je laisse mon monde dans le salon. Je viens vous retrouver un moment ; car nous nous sommes retrouvés ; nous ne passerons plus un jour sans lettre, ni l’un, ni l’autre n’est-ce pas ? Je n’ai rien à vous dire, rien du tout. Vous savez tout ce que j’ai à vous dire ; n’est-ce pas, vous le savez ? Et je ne puis pas vous parler d’autre chose. Ne me parlez pas d’autre chose, vous non plus.
Que votre lettre de ce matin, m’a rendu heureux ! Vous êtes donc allée demander au portier la mienne. Et après l’avoir lue, où vous êtes-vous assise ? Sur le canapé ou devant votre table à écrire ? Vous dîtes que vous étiez bien heureuse. Vous l’êtes toujours, vous le serez toujours. Soyez le toujours, je vous en conjure. Vous êtes bien aimable quand vous êtes heureuse. Je ne vous aime pourtant pas davantage non, certainement non. Je vous aimais beaucoup ces jours derniers, beaucoup. Que j’ai pensé à vous ! Que de fois j’ai passé en revue, tous vos mérites et tout ce qui s’est passé entre nous avant le 15, puis depuis le 15 Juin ! Je me suis tout rappelé. Tout est charmant. Tout sera charmant à se rappeler, même les mauvais jours. Mais que Dieu vous garde. Soignez vous bien ne soyez pas malade. Génie n’a donné hier de vos nouvelles. Dites-moi comment vous êtes bien exactement.
Vendredi 10 heures
Je me suis encore levé tard. Je n’ai pas eu un quart d’heure à moi. Je mène mes hôtes faire une grande promenade à quatre lieues d’ici. Nous déjeunons plutôt. Voilà une sorte lettre. Je ne puis souffrir de vous écrire ainsi. Aujourd’hui surtout. Je prendrais ma revanche ce soir. La lettre de votre mari ne me laisse pas un doute. Lady Granville a raison. L’Empereur a commandé la lettre comme le silence. M. de Lieven vous le dit en propres termes. Ils ont peur de vous. Il n’y a pas de mal. Amour ou crainte, il faut inspirer l’un des deux. L’état de Mad. de Broglie est le même. On m’écrit ce matin que le mal violent n’est pas revenu, mais le mieux a fait peu de progrès. Il est clair qu’on espère un peu plus seulement un peu ! J’en suis très préoccupé. J’ai une vraie amitié pour elle. Les personnes rares, sont très rares. Je vous tiendrai exactement au courant. L’an dernier, ma mère et mes enfants étaient à Trouville. L’an dernier je ne travaillais pas. Je vous aime plus que l’an dernier. Adieu dearest. Le meilleur adieu possible. Ce possible est bien peu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée