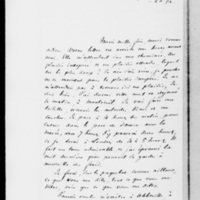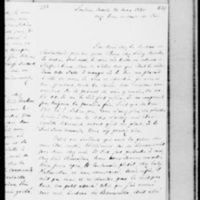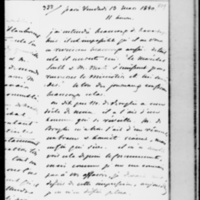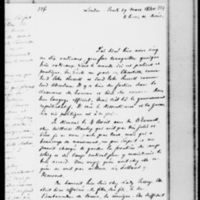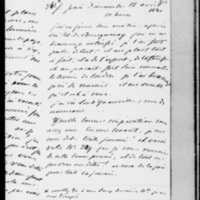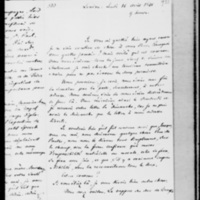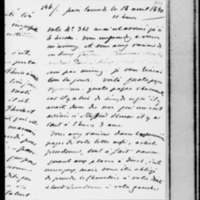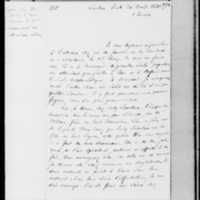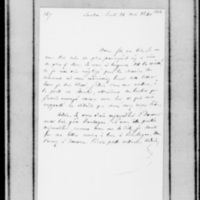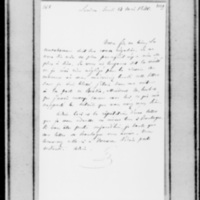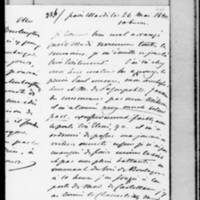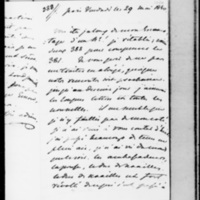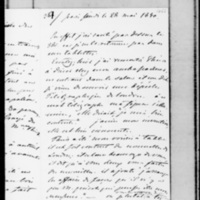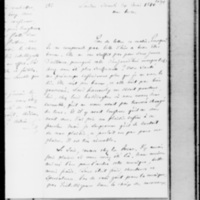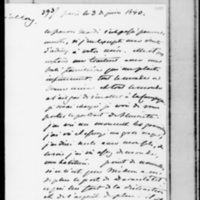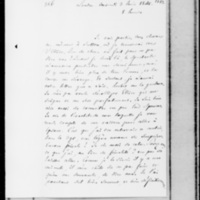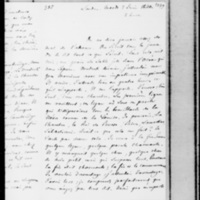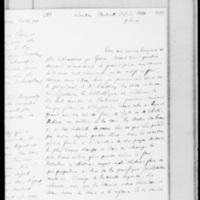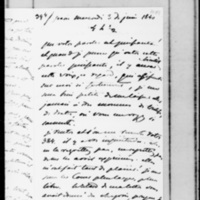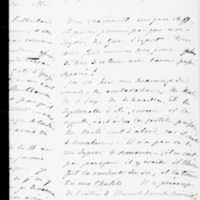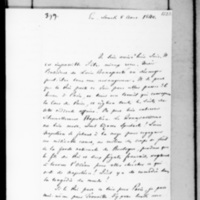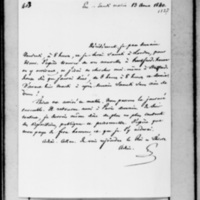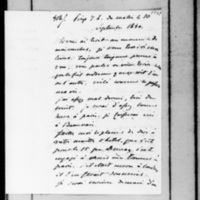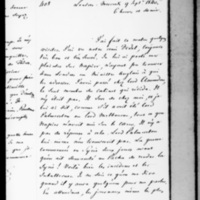Votre recherche dans le corpus : 847 résultats dans 3827 notices du site.
316. Calais, Mercredi 26 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
318. Londres, Samedi 29 février 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
318 Londres Samedi 29 février 1840
9 heures du matin
J’éprouve ici le matin une grande impression de calme. Personne ne vient. Personne ne me parle. Je n’entends point de bruit. C’est le repos de la nuit, sauf les ténèbres. Il me semble que je sors d’un guêpier bruyant, et que je contemple une ruche d’abeilles qui travaillent toutes sans bourdonner. Vous avez raison. Avec du bonheur domestique, la vie peut être ici aussi douce que grande. Il y a en France trop de mouvement extérieur; ici, pas assez de mouvement intérieur. En tout, l’aspect de cette société me plaît; je m’y sens à l’aise et dans un air sain, bien que trop froid.
Voilà du bonheur, le 316. Décidément chaque fois, je vous dirai mille fois merci. Oui, c’est du bonheur, un bonheur charmant quoique triste. Que serait-ce s’il était gai ? Je ne comprends pas Mad. Sébastiani ; malgré tout ce que j’en savais, ceci est plus bête. Mais je comprends encore moins Génie. Je lui ai répété ma recommandation pour tous les jours, cinq minutes avant de monter en voiture. Je n’entrevois qu’un motif, les obsèques de ce pauvre M. Devaines. Elles ont dû avoir lieu avant-hier jeudi, et Génie aura eu toutes sortes de soin à prendre. C’est un travail de mourir, et ceux qui s’en vont lèguent à ceux qui restent l’embarras avec le chagrin. Il est impossible que Génie ne soit pas allé vous voir hier.
4 heures Je viens d’avoir des aventures. Je sors de chez la Reine. Imaginez que je reçois, à une heure dix minutes, un billet de Lord Palmerston qui me dit que la Reine me recevra à une heure. J’envoie sur le champ chez Lord Palmerston pour constater mon innocence. Je m’habille en toute hâte. Je demande mes chevaux. Je pars. J’arrive avant 2 heures, à Buckingham. Comme de raison, on m’attendait. Je monte et trouve Lord Palmerston qui arrivait aussi. Les ordres de la Reine lui étaient parvenus tard. On ne les lui avait pas remis tout de suite. Heureuse-ment la Reine avait d’autres audiences qu’elle avait données en atten-dant. [Point de maître des cérémonies. Sir Robert Chesler, prévenu en même temps que moi, n’avait pas été aussi preste que moi.]
Bref, la Reine m’a reçu avec beaucoup de bonne grâce; sa dignité la grandit; son regard est intelligent et animé. Je lui ai dit en entrant : « J’espère, Madame, que Votre Majesté sait mon excuse, car je serais inexcusable. » Elle m’a répondu en souriant, et j’ai vu que Lord Palmerston était excusé aussi. Mon audience a été courte. Le Roi, la famille Royale, les relations du Roi avec le Duc de Kent son père, la surprise que je ne fusse jamais venu en Angleterre etc, etc. [Je suis sorti. Lors Palmerston est resté un moment après moi. Je m’en allais ; il m’a rejoint en courant : « Vous n’avez pas fini ; je vais vous présenter sur le champs au Prince Albert et à la Duchesse de Kent ; sans cela, vous ne pourriez leur être présenté qu’au prochain lever, le 6 mars ; et il faut qu’au contraire que, ce jour-là, vous soyez de vieux amis. »]
Nous avons été chez le Prince Albert, très beau et agréable jeune homme d’une physionomie douce, ouverte, intelligente, simple et élégant de langage. Il m’a retenu un quart d’heure. Nous avons causé. Il m’a plu tout à fait...
[De là, chez la Duchesse de Kent, au rez de chaussée. Elle était un peu malade de la goutte. Au moment où je traversais le vestibule pour aller reprendre ma voiture, sir Robert Chester est entré descendant de la sienne. Je lui ai fait toutes mes excuses dont je n’avais pas besoin. Je suis rentré chez moi, j’ai quitté mon harnois. J’ai couru une heure et demie pour aller m’écrire chez les Ducs de Sussex & de Cambridge, la duchesse de Glocester, les Princesses Auguste et Sophie-Mathilde, et me voici de retour. Demain les visites du cabinet. Après demain celle du Corps diplomatique. Les cartes pleuvent chez moi ce matin. On me remet à l’instant celle de Lord Aberdeen, Lord Holland et Lord Howe. Je demanderai demain à être reçu par la Reine Douairière.
Je suis allé hier soir chez Lady Holland sans la trouver. Elle était à Covent Garden où la Reine a été fort bien reçue. Les loges en face ont été louées pour 20 £ pour la voir, et les loges à côté 10 liv., pour ne pas la voir.
Dimanche 9 heures.
J’ai été plongé hier en Angleterre ; jusqu’au fond. A dîner le duc de Sussex, le Duc de Norfolk, le Duc de Devonshire, Lord Carlisle, Lord & Lady Albermarle, Lord & Lady Minto, Lord & Lady Elisabeth Howard, Lady Seymour, &, &, tous Whigs sauf un petit Tory dont j’ai oublié le nom. Le soir un rout immense, tout ce qu’il y a de ministres, de corps diplomatique, de membres des deux chambres, Whigs, Torys, radicaux, depuis lors Aberdeen jusqu’à M. Grote ; mais les Whigs souverains, selon leur droit.
J’ai passé ma soirée à être présenté et à accueillir des présentés. On me dit que je dois être content, très content que j’ai été bien lion et bon lion. Il me semble que j’ai rencontré de la curiosité et de la bienveillance. Je suis décidé à y être difficile. Je ne fais nul cas des demi-succès et des succès de début. Il les faut, mais pour commencer, comme il faut un premier échelon à la plus haute échelle. Si je suis bon à quelque chose ici, pour mon pays & pour moi, ce ne peut être qu’en inspirant une estime & un intérêt soutenu & croissants.
Fanny Cowper est charmante ! Elle promène partout, modestement mais sans embarras, un regard si jeune et si indépendant ! Je serais surpris si elle n’avait pas des goûts très décidés, en attendant des volontés.
Lord Aberdeen est venu à moi avec un empressement marqué. Je l’ai trouvé plus vieux et l’air moins sombre que je ne m’y attendais.
Lord Melbourne m’a parlé français de très bonne grace et longtemps. Il n’y a qu’Ellice qui soit décidé à ne pas me dire un mot de français. Il a raison. Je lui ai promis d’aller diner chez lui mercredi, en famille, et vendredi, chez Lord Charendon, en petit comité. Lord Charendon a été très aimable.
Je n’ai pas vu, du Cabinet, Lord John Russel, et du corps diplomatique, le Baron de Brunnow.
Connaissez-vous une Mad. Stanley, jolie, vive, spirituelle, whig très décidée et très active, que Lord Palmerston appelle notre Chef d’Etat major ? Son mari est un whipper-in important.
J’ai trouvé là le Prince de Capoue et sa femme. Il y a plus que l’océan entre les façons anglaises et les façons napolitaines.
Le Duc de Sussex a l’air d’un très bon homme. Il m’a beaucoup parlé de ses voyages sur le continent. Il a vu commencer toutes les révolutions, en France, en Espagne, en Portugal. Il prenait grand plaisir à me raconter Mirabeau. Vous savez que M. Croker m’a dressé à ces leçons-là.
J’étais à table entre Lady Cecilia Underwood (vous savez) et Lady Albermarle qui m’a mis très bonnement, au courant de tout le monde. Lady Palmerston avait à côté d’elle le Duc de Sussex et le duc de Norfolk. C’est la règle, n’est-ce pas ?
J’ai échangé en courant quelques paroles avec Lady Palmerstonn affectueuses pour vous. Elle a l’air très contente, et répand avec beaucoup de grace son contentement tout autour d’elle. Son fils, Lord Cooper m’a paru sprituel.
Si nous étions ensemble, je vous dirais mon compliment de Lady Palmerston à mon sujet, que j’ai entendu en passant. Mais cela ne se dit que tout bas quoique tout seuls.
Vous avez raison ; elle a l’air très fine et voyant tout sans y regarder.
5 heures
J’ai eu toute à l’heure un vrai plaisir. J’ai été à Stafford house. Le Duc et la Duchesse de Sutherland m’ont accueilli presque avec amitié. J’aime Stafford-house. C’est très beau, très beau. Et ce sera encore plus beau, car le premier étage n’est pas fini. J’ai vu ce qui est fait et ce qui se fait. Le Duc m’a promené partout. L’Escalier a vraiment de la grandeur, assez pour que la richesse y soit bien placée. Le comte de Montfort m’y a succédé.
J’apprends que j’ai eu tort de ne pas me mettre à côté de Lady Palmerston. C’est Lady Albermarle qui m’a trompé. Je lui donnais le bras. Je l’ai consultée ; elle m’a dit que je devais me placer à côté de Lady Cécilia Underwood, quasi altesse royale. Je prendrais ma revanche.
J’ai fait ce matin toutes mes visites de cabinet, et Lord Charendon sort d’ici. Il a vraiment de l’esprit, et un esprit gracieux. Nous nous sommes entendus au-delà de mon attente. Je dine chez lui vendredi, samedi chez Lord Lyndhurst, Dimanche chez Lord Landsdown. Il y a aussi un dîner arrangé chez le duc de Devonshire, avec le duc et la duchesse de Cambridge. Je subis cette première bouffée , j’espère qu’elle ne soufflera pas toujours.
Je vous parle de tout, et pas un mot de ce qui se fait à Paris. Que serviraient mes paroles ? Vous en savez plus que moi. J’attends ce que me mandera le duc de Broglie. Il a mes pouvoirs, sauf ratification. Adieu pour Aujourd’hui. Il fait très froid. Mais je n’ai pas l’impression d’un changement de climat.
M. Dedel sort aussi de chez moi, très ouvert et très bienveillant. Je crois que je me trouverai bien de lui et avec lui Lundi.
Lundi 2 mars 9 heures
Je ne compte pas avoir de lettre de vous ce matin, par la poste. Vous aurez attendu le courrier des affaires étrangères. C’est horrible une poste qui arrive et qui ne m’apporte rien de vous. Le Val-Richer, Baden ne m’ont jamais coûté si cher. Je m’y accoutume tous les jours moins. C’est déjà si peu qu’une lettre ! Et pourtant c’est tout.
J’ai passé deux heures et demie hier soir chez Lady Holland, empressée, charmante. J’ai trouvé Lord Holland toujours le même, absolument le même, la seule personne qui ne m paraisse pas vieillie, d’esprit ni de corps. Lord John Russel et Ellice y avaient dîné. Lord & Lady Palmerston y sont venus le soir. J’ai un peu causé avec Lady Palmerston, et j’ai protesté contre l’erreur où m’avait attiré Lady Albermarle avant-hier. Voici mes dîners de la semaine. Mercredi Ellice. Vendredi, Lord Clarendon. Samedi, Sir Robert Peel. Dimanche, Lord Landsdown. Mardi 10, le Duc de Sutherland. Il me semble que je vous en ai dit la moitié plus haut.
10 heures ¼
J’avais tort de ne pas espérer. La poste est charmante. Que de choses à vous répondre ! En attendant vous gagnerez quelque chose à ma joie. Je ferai partir ce volume aujourd’hui. Un autre suivra promptement. Que ne donnerais-je pas en ce moment pour causer une heure avec vous ! Adieu. Adieu.
318. Paris, Dimanche 1er de mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
318. Paris, le 1er mars 1840, dimanche
10 heures
Après avoir fermé ma lettre hier, je suis allée chez votre mère. Le cœur m’a battu en entrant. Elle m’a reçue avec bonté. Vous ne sauriez croire comme elle me plaît. C’est un visage si serein, un regard si intelligent et si doux, et même gai.
Je l’ai beaucoup regardée. Quand je ne la regardais pas, il me semble qu’elle me regardait aussi. Le Duc de Broglie y était, et y est resté. Il a parlé de la situation tout le temps. Pourquoi le Duc de Broglie a-t-il cet air moqueur et désobligeant ? Je conçois qu’il ne plaise pas. Moi, je l’aime assez malgré cela, et malgré autre chose que je déteste et que j’ai découvert en lui hier. Il a commencé par dire qu’il ne savait absolument rien ; que depuis trois jours il n’avait vu personne du tout ; et puis il nous a raconté son entretien avec le Roi, la veille, et un long entretien avec Thiers le soir, et puis, et puis, tout ce qui se passe. Pourquoi commencer par mentir ? Vous savez l’horreur que j’ai de cela. Si jamais je commence, moi, je continuerai. Mais il me semble que je suis trop fière pour commencer. Les Français ont décidément l’habitude du mensonge ; je ne connais pas d’Anglais dans lequel j’aie surpris ce défaut. Voyez bien et vous trouverez si je dis vrai!
Mais je reviens à la rue de la Ville-l’Evêque. Vos enfants ont couru à ma rencontre dans la cour, cela m’a fait plaisir. Ils ont une mine excellente, surtout Henriette. J’ai demandé à votre mère de me les envoyer ce matin pour voir passer le bœuf gras, elle ne le veut pas à cause de leur deuil. Votre mère a été bien polie et affectueuse pour moi.
Delà je fus chez Lady Granville qui est bien malade ; elle n’avait pas dîné ni assisté à la soirée la veille. Nous avons causé pendant une heure, elle et son mari, du nouveau ministère, de votre situation ; il ne sait trop qu’en dire. Moi, je ne me permets pas d’avoir une opinion devant les autres ; j’attends que vous ayez pris votre parti.
J’ai été rendre visite à Mad. Sebastiani sans la trouver. De là chez les Appony qui sont consternés. Appony ne conçoit pas le Roi, et il ajoute qu’il n’aura certainement aucune affaire à traiter avec Thiers, et qu’il entre en conséquence en vacances.
J’ai dîné seule. Le soir la diplomatie est venue. Granville croyait savoir que la nomination du ministère avait été mal accueillie à la Chambre. Médem est enchanté de n’avoir plus Soult et d’avoir Thiers. Il est tout remonté. Brignoles n’a pas d’opinion.
Quand aurai-je mes lettres ? à propos notre correspondance ! Cela ne sera plus très commode. Cela prouve bien votre situation naturelle vis-à-vis de ce ministère.
Bulwer est très malade, je ne puis pas le voir. Il m’écrit ce matin ce matin & me dit qu’Odillon Barot est très piqué contre Thiers qui ne l’aurait pas même consulté pendant la crise. Cela n’est pas trop d’accord avec d’autres avis.
Midi
Génie sort d’ici, il a un peu ébranlé mes opinions d’hier, par les récits qu’il m’a faits de ses entretiens avec vos amis. Il faut attendre ; mais si on tire à gauche, revenir sur le champ : voilà ce qui me paraît ressortir des avis les plus sages. En attendant, la puissance de Thiers me paraît établie dans tous les départements du Ministère.
J’attends votre lettre , car on me dit qu’il y a un gros paquet au bureau de l’hôtel des Capucines.
1 heure
La lettre n’arrive pas. La voilà. Je vous en remercie.
Lundi 2 mars, I heure
Je ne sais pas trop comment vous envoyer cette lettre. Cependant, jusqu’à nouvel avis, je ferai comme vous me l’avez indiqué. Lundi et jeudi au bureau des Affaires étrangères et samedi par la poste.
J’ai été voir hier les trois malades, la petite Princesse, Lady Granville & Mad. Appony. Même fureur chez ceux-ci. Il veut aller au château ce soir.
J’ai eu à dîner M. de Pogenpohl. Ah! mon Dieu, Dimanche passé c’était autre chose! Le soir j’ai été faire visite à Mad. de Castellane; mais quoique j’aie tenu bon jusqu’à onze heures, M. Molé n’y est pas venu, je le regrette. Mad. de Castellane est fort opposition. En bonne catholique, elle a une sainte terreur de M. Vivien. Outre ces faits là, je n’ai rien relevé dans sa conversation.
Lord Palmerston mande à Lord Granville que dimanche il devait avoir un long entretien avec vous. Vous voilà lancé dans les affaires, les dîners et les fêtes. Je crains que, pour commencer, le Duc de Sussex ne vous ait fait longtemps rester à table. Je vois tout cela, et un peu tout ce que vous en pensez. Votre première impression de Londres m’a divertie. Elle est vraie; je n’oublierai pas vos colonnettes et vos figurines.
J’ai fait venir mon petit brigand et l’ai envoyé chez votre mère avec des nappes de Saxe. Elle choisira ; il a tout ce que vous demandez. Les services ordinaires pour 12 personnes, étonnamment bon marché, 129 francs.
Je n’ai de lettres de personne.
Le temps est toujours brillant et froid. Ceci ne me plait pas ? Je crains la grippe des ambassadeurs. Je ne marche pas.Adieu, il me semble que je vous ai tout dit, tout ce que peut porter une lettre. J’aurais mieux dit à la chaise verte. Ah! que cette chambre est vide! Adieu. Adieu.
320. Paris, Vendredi le 6 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Paris, vendredi 6 mars 1840
Il me semble que le courrier de Londres doit être arrivé hier, mais je n’ai pas eu de lettres, et je n’ai pas revu Génie depuis dimanche. Notre correspondance ne me parait pas bien réglée encore, c’est ennuyeux. Hier j’ai envoyé une lettre aux Affaires étrangères. Je me suis promenée seule au bois de Boulogne, j’ai fait ensuite une longue visite à la petite Princesse que j’ai trouvée dans son lit et puis Lady Granville. Elle m’a lu une lettre de son frère qui fait de vous le plus excellent éloge. Vous avez réussi parfaitement, votre air grave, vos bonnes manières and his talk charmed every body. Vous saurez en vivant à Londres que l’opinion du Duc de Devonshire y compte. Et moi, je vous le donne pour très fin. Lady Cowper me parle beaucoup de vous aussi. Elle dit que vous excitez une curiosité générale, que tout le monde veut faire votre connaissance et que tout le monde a été content de vous extrêmement. Elle se réjouit de vous voir plus familièrement. Voilà donc un début excellent; je n’en ai pas douté un instant. Elle aime la distinction de votre air, et votre sérieux, et votre envie de plaire. Je vous redis tout. On dit aussi que la Reine a été très aimable avec vous.
J’ai dîné seule et je suis allée aux Italiens. J’y avais assigné M. de Noailles, mais il m’a écrit pour me dire que Berryer réunissait son parti le soir et qu’on l’invitait à y assister pour délibérer sur la marche à suivre dans les nouvelles circonstances. A son défaut j’ai été prendre M. de Brignole. Lui et Granville ont fait ma soirée avec Rubini dans le Pirate. J’étais dans mon lit à onze heures, et pas très bien portante depuis quelques jours. L’Opéra Italien va finir ici et commencer à Londres. Prenez garde qu’on ne vous entraîne à prendre une loge. Je connais l’indiscrétion des Anglaises. Vous payeriez une loge excessivement cher, et vous n’en serez jamais le maître. En général ne permettez à personne de la familiarité avec vous ; cela ne vous va pas, et cela entraîne beaucoup plus loin que vous n’imaginez. Encore une fois, et toujours, restez là ce que vous êtes. N’est-ce pas?
J’ai envie de vous conter un peu ce qui se passe à Londres. Eh bien, il s’y passe, que la Reine mécontente même le parti whig, et que de grosses défections viendront frapper le gouvernement. Il suffit pour cela de quelques exclusions de ses bals.
Samedi 7 mars, midi
Génie est venu m’interrompre hier. Merci de votre lettre et merci beaucoup des copies. Je suppose que vous avez raison. Je suppose que vous avez raison. Vous saurez mieux que moi si vos idées sur Duchâtel sont exactes. Il me revient à moi tout le contraire de ce que vous pensez et désirez à cet égard. Mais cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde c’est vous. Lady Holland écrit que tout le monde est charmé de vous. Et la Reine aussi ; et puis elle ajoute : « The public augurs well from his having placed the celebrated Louis at the head of his kitchen department. Few things tend more to popularity in this town than la bonne chère ; however what is more important is Lord Palmerston appearing really to like him, and confide in his warm expressions in favor of peace and amity with us.»3 Je veux cependant vous dire en passant que vous avez déjà fait des confidences là, qui me paraissent ne pas rentrer dans la résolution que vous aviez prise de ne pas les prodiguer. Cela est revenu ici ; tout y reviendra; et surtout vos opinions sur les personnes. Il ne faut pas trop adorer l’inconnu (ici) et surtout, surtout, il ne faut pas tout dire! Vous voyez que je parle à la chaise verte.
Lord Won Russell est tombé dans une champbre hier au moment où je voulais sortir. Il vous a vu chez Lady Palmerston et chez Lady Holland, mais à la manière des Russell il ne s’est pas fait présenter à vous. Il me dit qu’on est enchanté de vous. Il me dit cela de Lord Palmerston et de la Reine. Il passera ici quelques jours, je le fais dîner chez moi demain. J’ai dîné avec lui chez Lord Granville, aujourd’hui chez la Duchesse de Talleyrand.
Mme Thiers est allé faire visite à la Comtesse Appony, ce qui fait la réconciliation complète. On dit qu’il y a un traité secret entre le Roi et Thiers par lequel celui-ci s’engage à demander à la Chambre 10 millions pour les dettes du Roi. En revanche le Roi le soutiendra pour les fonds secrets. Thiers dit que ceci est la seule question de Cabinet. S’il la traverse, il fera comme les Ministres Anglais, il se moquera de toutes les défaites. Vous comprenez qu’il y a maintenant beaucoup de bavardages. Le corps diplomatique est encore tout ahuri et ne sait trop que penser de ceci ; cependant il est évident qu’ils ont plus confiance dans la durée du Ministère que dans sa chute.
Vous me paraissez bien occupé, car vos lettres à moi sont courtes. Vous vous trompez de N°. Vous m’avez envoyé deux 318. Vous ne me dites pas un moment d’Orient. Voilà un petit paquet de petits griefs.
Je n’ai pas vu un seul personnage politique hier à l’Ambassade. Il y avait des curieux, mais rien pour les satisfaire. Thiers y dine aujourd’hui.
Adieu, je dis adieu, car je n’ai plus rien à dire, et je n’ai guère à répondre. Le temps est toujours froid. Je me suis promenée hier avec Marion. Mais cela ne m’a fait aucun plaisir. Je n’ai plus de plaisir à rien. Adieu. Adieu.
322. Londres Mardi 10 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Londres, mardi 10 mars 1840, 11 h 1/2 du soir
J’ai dîné chez la Duchesse de Sutherland, puis un quart d’heure chez Lady Minto. Je rentre. Moi aussi, le coeur m’a battu en entrant à Stafford house, dans ce salon vert qui était le vôtre, dans cette salle à manger où le Duc me plaçait à côté de vous. Je vous ai cherchée, je vous ai vue, partout, toute la soirée. Cette maison vous convient. On se promet de vous y revoir. On me l’a dit. Je me le suis fait redire. Je ne comprends pas toujours la première fois. Qu’il y a de temps d’ici là! n’est-ce pas, vous n’avez plus de plaisir à rien? vous me le dites. Laissez-moi être égoïste librement, autant qu’il me plaît. Je le suis sans remords. Vous n’y perdez rien. Voici un incident qui vaut la peine de vous être conté. Décidément M. de Brünnow1 n’est pas venu chez moi. Il s’est fait présenter à moi chez Lord Clarendon. Nous nous sommes rencontrés deux jours après, le lendemain plutôt, chez Lady Palmerston et nous avons causé. Mais enfin, il n’est pas venu et ne viendra pas. Ce n’est pas tout. Un petit attaché, celui que j’ai amené avec moi, Gustave de Banneville, était allé porter à Ashburnham-House, qui est toujours le quartier général de l’Ambassade Russe, sa carte pour M. de Kisselef qui n’y demeure plus. Au lieu de porter cette carte à M. de Kisselef, on l’a portée à M. de Brünnow qui demeure Mywart’s Hotel. M. de Brünnow est venu en hâte ce matin, à ma grille, sans entrer dans la cour, porter une carte de lui sur laquelle il avait écrit au crayon, pour M. Gustave de Banneville. Je me suis fait expliquer la méprise, et quelques heures après, j’ai envoyé M. de Banneville porter sa carte chez M. de Brünnow, en écrivant aussi au-dessus, au crayon, pour M. le Baron de Brünnow. Il se trouve ainsi que M. de Brünnow a fait la première visite au dernier attaché qui s’est empressé de la lui rendre. Nous en avons un peu ri.
Evidemment M. de Brünnow a des instructions spéciales à mon égard. Il a l’air d’être, et on me dit qu’il est le plus poli, le plus obséquieux des hommes. Il l’a été beaucoup dans nos deux rencontres chez autrui. A la première, je passerai devant lui sans le voir. Il paraît qu’on a été très fâché de ma mission ici. J’espère qu’on aura raison. Convenez que cela est drôle, et qu’en fait de mes dispositions envers la Russie, me voilà bien loin de mon point de départ. J’ai attendu très tranquillement et avec réserve avant de parler à personne de cette boutade de mauvaise éducation officielle. Mais cela commence à circuler, à la grande surprise et moquerie de tout le monde. N’en parlez pas du tout avant deux ou trois jours, je vous en prie, à qui que ce soit. J’en rendrai compte après-demain.
[Neumann part dans les premiers jours d’avril , aussi tôt après le lever que la Reine tiendra le 1er. Il l’annonce lui-même, sans dire si c’est un départ temporaire ou définitif. Brünnow part toujours aussi à la fin du mois. Le champ de bataille me restera, en attendant le combat.
On attendra aussi le plénipotentiaire turc. L’officier qui en a porté la demande à Constantinople doit y arriver en ce moment. Il n’y allait pas exprès pour cela. Il passait par Constantinople en retournant aux Indes.
Adieu pour ce soir. Je vais me coucher. Je me suis couché fort tard tous ces jours-ci, et je n’ai pas assez dormi. Adieu
Mercredi, 9 heures
J’espérais une lettre ce matin. J’y compte pour demain. Je n’ai pas été content du N° 320, venu lundi, non parce qu’il portait un petit paquet de petits griefs, mais parce qu’il y avait, ou je me trompe fort, des réticences. La dernière que vous veniez de recevoir de moi, était courte. Je vous disais ma résolution de rester ici, sans vous rien dire de la joie que m’aurait value la résolution contraire. Enfin, elle était écrite un triste jour, et je ne vous en parlais pas2. Vous avez pensé à tout cela, et vous ne m’en avez rien dit. Dites-moi si je me trompe. Et si je ne me trompe pas, une autre fois dites-moi tout ; point de réticence, en fait de griefs surtout. Presque toujours, j’aurai raison, et je me sens en état d’avoir un tort... que vous me pardonnerez.
Une heure
Je viens de faire un déjeuner savant chez M. Hallam, avec Lord Landsdowne, Lord Mahon, Lord Southampton, Sir Francis Palgrave, et M. Milman, Chanoine de Westminster. Vrai intérieur de savant Anglais. On m’a reçu dans la bibliothèque de M. Hallam. Puis nous avons passé dans la salle à manger, où nous avons trouvé Misstriss Hallam et sa fille, debout à nous attendre. Une salle à manger très nue, quasi sans meubles, mais de petites colonnes et un grand portrait sur la cheminée. [Du café d’abord, avec de la cassonade grise. Puis des côtelettes chaudes, une volaille froide. Puis du fromage rapé, du caviar. Puis des œufs, du beurre, toutes sortes de pain grillé. Enfin du thé. Et tout au travers une très bonne conversation, point politique du tout mais bien substantielle et variée dans l’ordre scientifique. Il m’a paru que les convives s’y plaisaient, et j’ai bien peur qu’une nouvelle porte ne se soit ouverte là aux invitations. En voilà une qui m’arrive de Lord Mahon pour déjeuner Mercredi prochain.]
Miss Hallam jolie, de 25 à 30 ans, peu d’espoir de se marier, parfaitement silencieuse, le regard très modeste, mais doucement animé, et se soulevant quelquefois avec une curiosité très intelligente, pour se rabaisser aussitôt. Tout cela était très Anglais, et pas du monde anglais que je vois tous les jours.
Jeudi midi
Pas de lettre ce matin. Je n’y comprends rien. Comment ne m’avez-vous pas écrit par la poste après avoir manqué lundi le courrier des Affaires Etrangères? Est-ce que je suis destiné à subir le même chagrin que vous avez eu ici en 1837 ? Ce qui me rassure un peu, c’est que j’ai ce matin des nouvelles de Génie qui ne me dit pas un mot de vous. Le mal se sait si vite ! Mais c’est une triste sécurité que le silence. Adieu. Je vais attendre jusqu’à demain matin.
Pour Dieu, convenons bien de nos faits : le lundi et le jeudi, écrivez-moi par le courrier des Affaires Etrangères et le samedi par la poste. Et si le lundi ou le samedi le courrier des Affaires Etrangères ne partait pas, écrivez-moi par la poste, ne fût-ce que quelques lignes pour que je ne sois pas inquiet. Je cherche un moyen de me faire arriver ici les lettres que vous ne voudrez m’envoyer ni par les Affaires Etrangères, ni directement par la poste. Je n’ai encore rien qui me satisfasse pleinement. Adieu. Je suis dans une triste et déplaisante disposition.
323. Paris, Vendredi 13 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
324. Paris, Dimanche 15 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
324. Paris, dimanche 15 mars 1840,
10 h 1/2
J’ai été hier au Bois avec Marion, j’ai fait une longue visite à Lady Granville. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Lord Granville, W. Russell, les Brignole, les Capellen. Le matin j’avais eu une longue visite de M. de Werther, que j’ai beaucoup questionné sur Londres, sur le bal de la Reine dont vous ne m’avez rien dit. Je lui ai demandé ce que vous faisiez dans cette longue soirée ; « La cour aux dames. » En rentrant chez moi, avant dîner, j’ai trouvé Nicolas Pahlen qui m’attendait depuis une demi-heure. Il venait m’annoncer qu’enfin son frère devait quitter Pétersbourg le 10 mars. Cette décision a été Irise après l’arrivée des réponses de Medem, et avant encore l’arrivée du courrier à Barante. Je suis fort contente. Mais j’aimerais encore mieux le savoir vraiment en route. Ma manière est de douter toujours des choses qui me font plaisir. Je crois vite celles qui m’affligent. Vous vous arrangez autrement.
La journée d’hier semble bonne et très bonne aux partisans des Ministres. J’ai eu une lettre de Lord Aberdeen dans laquelle il me dit qu’il vous voit fort peu, qu’il ne vous avait rencontré qu’une fois encore, et qu’il y a beaucoup de regret. Je ne suis pas bien, toujours pas bien. C’est un véritable spleen. Et je crois que je prierai Vérity de ne plus revenir, parce qu’il ne peut rien du tout. J’ai perdu mon cher William Russel. Il est parti hier pour Berlin.
1 heure
Je suis si triste, si triste ! J’aurais tant besoin d’ouvrir mon cœur. Je ne puis pas.
Lundi le 16.
9 heures
Mon médecin m’a interrompue hier, et m’a défendu d’écrire, de lire, de rien faire. Je suis restée couchée sur un canapé. Mad. Appony est venu me lire des lettres de son fils. Le mariage est retardé de quelques jours, ils ne quitteront Pétersbourg que le 1er de Juin pour être ici le 15 ou à la fin du mois. Je ne suis sortie qu’un moment pour prendre l’air en voiture. En rentrant j’ai trouvé le Prince Paul qui m’attendait. Il avait vu le Roi la veille. Son impression est que le Roi attend avec certitude la chute de Thiers. Il avait causé avec Thiers aussi qui n’a aucun doute sur l’action du Roi contre lui. J’ai dîné chez Mad. De Talleyran, rien de nouveau de là. Le même bavardage qu’on retrouve partout sur ce qui se passe en ce moment ; la même incertitude sur le dénouement.
De là j’ai été chez Lady Granville et à 10 heures chez Mme de Castellane. J’ai passé une grande heure seule avec elle et M. Molé. M. Molé dit que son parti est ferme, fort, numériquement plus nombreux que Thiers et la gauche réunis ; que Duchâtel et 22 doctrinaires ont passé de son côté. Teste est plus douteux. Duchâtel sera de son Ministère ; il serait insensé de rien entreprendre sans lui et ses amis. Le Roi est parfaitement neutre dans la lutte, mais le Roi est l’homme le plus triste et le plus inquiet de toute la France. M. de Broglie est un enfant, ce qu’il a fait est trot naïf. M. de Broglie soutiendra tous les Ministères moins un, celui de M. Molé. M. de Rémusat est enragé pour la gauche. Jaubert, tout le contraire, il ne tiendra pas longtemps. Le mot de M. Thiers dans le bureau : « Si l’on me renverse, gouverne --qui-pourra»-a fait grand scandale. Je cherche, il me semble que je vous ai tout dit. En somme M. Molé a l’air d’un homme qui s’attend à être Ministre la semaine prochaine. J’ai très mal dormi. J’ai tout le côté gauche engourdi, j’ai de la peine à marcher, mais mon cœur est encore plus malade que mes jambes. J’attends Génie ce matin. Il est allé faire des enquêtes sur certaine lettre remise lundi aux Affaires étrangères et qui n’étaient pas arrivé à Londres jeudi.
Midi
Voici le 323, long et bon. Je vous remercie d’avoir été inquiet et triste. Vous ne savez pas le plaisir que me cause votre peine. Est-ce que vous me comprenez bien ? Vous ne vous fâchez pas je suis sûre. Vous me pardonnez ; nous sommes si loin ; je suis si seule, je n’ai au monde que vous! Songez à cela toujours, dans tous les instants. Ne vous inquiétez jamais de moi que comme santé, moi je m’inquiète de beaucoup d’autres façons. Je suis faite comme cela, c’est pourquoi une séparation est une si odieuse chose. Votre foreign office a menti, ou bien vous vous trompiez en me disant d’y remettre une lettre avant 5 heures. J’avais porté la mienne Lundi à 4 heures moins ¼. Je vous prie bien de croire, qu’il ne s’agira jamais de visite prolongée, de négligence d’un domestique. Je n’ai pas de ces négligences quand il s’agit de vous. Je me suis arrêtée moi-même à la porte quand il s’est agi des affaires étrangères, et j’ai moi-même mis ma lettres aux finances, pour la poste. Maintenant je crois que Génie, Génie for ever, est ce qu’il y aura de mieux. Il me dit qu’il vous tient bien au courant de la situation. Je doute que les lettres apprennent suffisamment. Il ne vous restera probablement que confusion de tout cela. Moi je suis parfaitement ahurie, mais si vous étiez ici vous comprendriez. Moi je ne recueille que les commérages. Je vous les redis comme on me les donne. Si je devais juger sur la Diplomatie, je dirais que Thiers tombera. ; car Appony est content aussi mais par raison contraire, c’est qu’il ne croit pas qu’on ait le courage de renverser Thiers. Il voit trop de danger à cela. C’est bien un peu l’opinion de beaucoup de monde.
Je ne connais pas du tout Mrs Stanley dont vous me parlez tant. Je l’ai vue mais elle ne m’a pas paru assez jolie pour la regarder ,et je ne lui ai jamais parlé ; elle n’était pas du cercle dans lequel je vivais. C’était des fonctionnaires subalternes. Dites-moi toujours tout ce que vous faites et avec qui vous causez dans les soirées. Moi je vous raconte minutieusement toute. Aujourd’hui je vais dîner chez Mad. Salomon si Vérity me le permet. M. de Bacourt est allé prendre congé du Roi ier, il part dans huit jours. Walesky dit qu’il est désigné pour aller à Constantinople et Alexandrie terminer la grande affaire. Le Maréchal Soult m’invite à ses lundis. Vous savez que j’ai pour règle de n’aller dans aucun salon politique, et je crois que celui-ci a cette couleur. Ma belle-sœur arrivera en Septe pour passer huit mois à Paris ! Jugez comme cela m’amusera. Est-il vrai que la duchesse de Kent va mourir ? Où en êtes-vous avec M. de Kisselef ? Celui-là au moins est-il allé vous faire visite ? Car pour tous les autres j’ai la réponse ; M. de Werther m’a dit que tous les diplomates étaient allés se présenter chez vous. La Duchesse de Sutherland écrit de vous mille biens. Je finis, et je voudrais ne finir jamais. Je vais convenir avec Génie du départ de mes lettres. De votre côté je voudrais bien que vous prissiez pour règle de m’en envoyer tous les deux jours bien régulièrement. N’est-ce pas ? Adieu. Adieu, vous savez tout ce que je ne vous dis pas, vous voyez que toutes, toutes mes pensées sont à Londres. Adieu.
326. Londres, Jeudi 19 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
330. Londres, Mercredi 25 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le 328 m’est arrivé tard hier. Mon homme avait été le matin hors de Londres. Il n’y a pas moyen d’éviter ces petits ennuis là. Je dis petit, par acte de raison. Je le dis plus facilement aujourd’hui. Ce 325 m’a été si doux ! Les œuvres de surérogation sont toujours charmantes. On me l’a apporté en venant me chercher au club de l’Athénoeun où l’on m’avait donné à dîner ; Lord Landsdowne, Aberdeen, Northampton, Mahon, Montègle, Sir Francis Palgrave MM. Milmes, Holland, Hallam, Milman &etc un diner agréable et assez bon en dédommagement de celui du Raleigh Club vrai dîner Anglais, plus ardent que le charbon le plus ardent. Vous ai je dit que j’avais fait là mon début de speech, en Anglais, à la grande joie de mes auditeurs ? Joie morale plus que littéraire, je pense. Mais n’importe ; ni embarras, ni prétention ; n’est ce pas ce qu’il faut ?
Sur la proposition du Chairman appuyée par Lord Prudhor on m’a élu membre honoraire du Raleigh Club, the only Honorary member in the wortd, m’a-t-on dit. De là on m’a mené, à la Royal geographical society, nombreux meeting où nous avons été en exhibition, moi et trois sauvages des bords de l’Orénoque, tatoués et emplumés comme je ne le serai jamais. Pourtant et sans vanité, j’excitais plus de curiosité qu’eux.
Une heure
Jeudi, 9 heures
Une heure
333. Paris, Dimanche 29 mars 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Pour le 1er de mai. Melbourne, Landsdowne, Clarendon, Palmerston, Normanby, John Russell, Minto, Holland, lord Leveson, Hill, Huxbridge, Albermarle, Erroll s il est comme je crois grand maitre de la cour (Lord Stewart), le Duc de Somerset, Sutherland, Anglesea, Devonshire, s’il y est, mais je ne crois pas. Ellice non, il n’y a pas de raison, c’est un dîner d’étiquette, et puis les chefs de mission. Laissez moi penser encore au dîner Tory. Votre discription de l’ancient Musique est excellente. En général vous excellez dans la description. Mais que vous êtes faible de vous laisser entraîner à de parails ennuis! Au reste je me souviens que dans le temps de mon innocence, la 2ème année de mon sejour en Angleterre, j’y ai été une fois, en jurant, par trop tard, qu’on ne m’y prendrait plus, car il faut avoir vu ces choses nationales une fois. C’est comme je vous conseillerais d’aller au diner de Pâques à la Cité, si vous n’avez pas des raisons politiques de vous abstenir. J’ai été voir hier mes pauvres et puis Madame de Talleyrand. J’y ai trouvé le Duc de Broglie. Décidément nous n’avons pas de goût l’un pour l’autre. Il ne me regarde pas, et moi je lui trouve l’air si dédaigeux, si satisfait et si gauche, ou du moins si disgracieux, et puis cet air de moquerie insolente que je déteste. J’ai parlé avec une grande admiration du discours de Berryer, j’esperais qu’il me dirait ce qu’il a dit à Granville et je préparais ma réplique ; il n’a rien dit, il ne m’a absolument pas adressé la parole ni directement ni indirectement. Restée seule, avec Mad. de Talleyrand elle m’a dit qu’elle venait de chez Madame qui était consternée, accablée, elle disait, " le Roi est étonnant tant de courages, tant de résignation dans une situation si terrible. " Voilà le dire de Madame.
Le duc d’Orléans a la grippe. Son voyage est toujours à l’ordre du jour mais pas absolument fixé. La noce Nemours aura lieu le 23 avril. Jai reçu hier une lettre de Pahlen du 17. Il quittait Pétersbourg le lendemain 18, il sera ici le 10 avril sürement. Maintenant Je me réjouis tout de bon. A propos, il me dit que Lady Palmerston mande à Lady Clauricarde que je serai à Londres en avril, il se désole de ne plus me trouver ici. J’ai dîné seule, et le soir j’ai vu Mad de Contades, Mad. de Courval, Brignoles, d’Haubersaert, la Redorte. Celui-ci a un air bien triste ; de quoi ? On sortait de chez M. Thiers, un salon bien rempli ; il a pris les Samedi comme les Mardi.
Midi. Je reviens à vous après ma toilette. M. Royer Collard a voté pour Thiers avec ostentation et parlait tout à fait dans le sens de le soutenir, c’est de Mad. de Talleyrand que je le sais. A propos quelqu’un qui est de l’avis de M. de Broglie sur Berryer a dit de lui, c’est Talma et Rubini, mais ce n’est ni Corneille ni Rossini. Et bien à la bonne heure mais comme on applaudit Rubini ! Ce qui est très vrai, c’est que ses discours perdent à être lus.
On dit que M. de Ste Aulaire est sûr de conserver son poste de Vienne. M. de Barante est-il aussi sûr de Petersbourg ?Dites-moi des nouvelles de là.
Lundi le 30, 10 heures
Médem a enfin reçu de Pétersbourg une lettre qui lui annonce sa nomination. Il n’a pas assez de tenue dans cette circonstance, car il dit après beaucoup d’autres choses, qu’il avait réfusé le poste de Londres ! On peut bien se fâcher, mais il ne faut pas mentir. Au reste il se défâchera aussi, et il faudra bien qu’il aille. Je trouve au fond que Médem avait besoin d’une petite leçon de modestie, il était trop arrogant. Au surplus il passera encore quelques mois à Paris parce que Kisselef va d’abord à Pétersbourg. Je viens de parcourir les journaux dans la séance du 27 aux Communes je lis de très bonnes parole de Lord Palmerston sur la Russie. John Russell, un peu, sur la France. Au total il est évident que vous n’avez pas Lord Palmerston.
J’oublie, et je vous demande pardon de cet oubli mille fois, que j’ai été hier chez votre mère. Mais je l’ai peu vue ou plutôt nous avons peu causé ensemble ; il y avant M. Priscatory ; je lui ai parlé des discussions de la semaine passée. Il m’a assez plus il était moins arrogant dans ses paroles que dans son air.
Votre mère a bonne mine et l’air toujours si serein et si doux ! j’aime extrémement l’expression de sa physionomie. Vos enfants se portent à merveille. Il y avait bal chez eux, et ils faisaient. bien du tapage, mais cela m’a fait plaisir ! M. de Rémusat s’est trouvé hier au soir fort longtemps auprès de moi. Je trouve qu’il ressemble en colossal à Bulwer. Il n’est pas beau.
1 h 1/2
Il faut donc que je ferme cette lettre seule et sans vous remercier de la votre, cela me choque. Adieu. Adieu. Mille fois.
2 heures
Je n’ai lu votre lettre que très rapidement encore, je vais bien la relire Adieu. Adieu.
Où en êtes vous avec Brünnow ? Lord Holland se moque de lui dans une lettre à Granville. Toutes les lettres parlent de vous avec enthousiasme. Je me crois toujours obligée après vous avoir dit cela d’ajouter, restez ce que vous êtes. J’ai rencontré dans le monde des gens de beaucoup d’esprit qui oubliaient cela. Mais moi j’oublie que vous ne ressemblez à personne. Adieu.
343. Paris, Mardi 14 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai fait visite à Lady Granville hier matin, et une très longue promenade avec Marion. Je me suis même fatiguée, je suis rentreée pour me reposer. J’ai dîné seule. Le soir j’ai vu Mad. de Boigne, Razonmowsky & Lobkowitz, quelques petits hommes et mon Ambassadeur nous sommes restés seuls après onze heures. Il est très difficile de tirer de Pahlen quelque chose, cependant cela est venu. Et bien il n’y a rien de nouveau. L’Empereur est ce qu’il était, toujours la même hostilité personnelle toujours la même passion. M. de Pahlen a toujours combattu sans gagner un pouce de terrain. Il n’est chargé d’aucune parole aimable, de rien du tout. Il a vu Thiers. Ils ont un peu causé. Il lui a dit que favoriser le Pacha, c’est affaiblir la porte & que puisqu’on veut l’intégrité de l’Empereur ottoman, puisqu’on le dit, il faut lui rendre la Syrie. The Old story again and again. Voilà tout. On pense mal de tout ceci. il est bien égal qui gouverne ici Thiers ou tout autre. Cela s’en va. Je crois que je vous ai donné l’essence. Pahlen a fort bonne mine ; il est content d’être ici et de n’être plus là. Il ne parle pas très bien de M. de Brünnow, un plat courtisan dont les longues et habiles dépêches sont lardées de flatteries pour l’Empereur. On le croit un grand homme. Sa nomination a fort mécontenté en Russie. Lady Clanricarde me le mande aussi. A propos, elle m’a écrit une lettre fort spirituelle. Je vous l’enverrai, par courrier Français car elle est volumineuse. Il n’y a rien de pressé, car il n’y a rien de nouveau, mais vous la lirez avec plaisir. Le temps est doux et charmant aujourd’hui. J’ai déjà marché. Et puis j’ai fait ma longue toilette et je ne viens à vous qu’à une heure. Aujourd’hui vous dînez chez les Berry. Je suis sûre qu’elles vous donneront lady William Russell et que sans jamaisvous plaire beaucoup elle vous paraîtra une bonne ressource de conversation. L’impératrice vient en Allemagne à Erns. La grande duchesse Hélène aussi.
Mercredi 15 avril 1 heure
Je suis tellement occupée de cette idée que je ne vois que cela dans votre lettre par le premier moment des pars. Est-ce que rien ne m’avertissait que vous seriez à Richmond un jour ? Voilà que je bavarde et je veux parler.
340. Londres, Samedi 11 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est pas le moins du monde question de la translation du corps de Napoléon en France. M. Molé me paraît peu au courant des Affaires étrangères. Car ici je ne vois pas pourquoi il mentirait. Du reste je ne suis pas surpris qu’il soit peu au courant. On ne l’aimait pas du tout dans le département, et parmi les gens qui y restent toujours, je n’en sais aucun qui prenne soin de l’instruire.
L’Angleterre a fait le geste pour Naples ; à l’heure qu’il est, l’amiral Stopford doit avoir saisi des bâtimens napolitains et les avoir envoyés à Malte où ils resteront en dépôt jusqu’à l’arrangement. Lord Palmerston est pourtant un peu préoccupé des conséquences possibles du coup. Nous nous emploierons à les prévenir et à amener un accommodement.
J’ai renoncé, bien contre mon goût et mon naturel, à la prétention de tout régler d’avance et pour longtemps. Mais pour ceci et dans les limites que je vous dis c’est parfaitement décidé. Il n’y a donc rien là, absolument rien qui dérange nos projets ni qui puisse nous causer aucun mécompte. Tenez pour certain que sauf les plus grandes affaires du monde ce qui ne se peut pas à Londres à cette époque.
Je serai à Paris d’octobre en Février avec ma mère et mes enfants. Il faudrait donc que je ne les fisse pas venir du tout d’ici là ce qui leur serait et à moi aussi un vif chagrin. Ils viendront donc en Juin, Notre seul dérangement portera, sur nos visites, de châteaux qui en seront, nullement supprimées mais un peu abrégées. Ces visites-là seront pour moi une convenance et presque une affaire. Ma mère le sait déjà et en est parfaitement d’accord. Je ne la laisserai pas seule à Londres. Mlle Chabaud viendra l’y voir au mois d’aout. Je ferai donc des visites, nos visites seulement un peu plus courtes. Il faut bien quelques sacrifices. Je voudrais bien sur cela, n’en faire aucun.
Que signifie cette phrase : "Je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi "? Si vous parlez de mes devoirs, de mes premiers devoirs vous avez raison. Est-ce là tout ? Dites-moi. Et puis dites-moi aussi que vous vous associez à mes devoirs, et que vous m’en voudriez de ne pas les remplir parfaitement.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Famille Guizot, Femme (politique), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Protestantisme, Relation François-Dorothée, Religion, Réseau social et politique, Salon, Santé (Elisabeth-Sophie Bonicel)
342. Paris, Dimanche 12 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mettez 40 à mes deux derniers n° je me suis trompée. Je retourne à hier. Thiers m’avait dit la veille mille bien de Lord Granville. Celui-ci est enchanté de Thiers a son tour. certainement l’envie de rester bien, est grande de part & d’autre, & vous par dessus le marché ! Il est difficile de croire que cela puisse s’ébranler. J’ai marché au bois de Boulogne, avec Marion. J’ai eu à dîner M. Pogenpohl. Le soir Appony. Capellen, Berryer, le Duc de Noailles, la Pcesse d’Haubersaert, Soltykoff. Appony m’a raconté la note de l’ambassadeur Turc à Londres et la colère de Thiers en conséquence Berryer nous a un peu dépeint la situation de la Chambre sans y trouver encore aucun élément de vraie force pour le gouvernement il a fort déclamé contre l’Angleterre dans l’affaire des souffres. le Duc de Noailles nous a répété le discours du Duc de Broglie, la majorité de la Commission votant parce qu’elle a confiance, la minorité votant pas prudence. Il ne m’a pas dit assez de bien du discours. Je le trouve très bien à la lecture et je crois que vous devez en être content. Vous savez sans doute qu’il y a eu un délai de 24 heures parce qu’on avait trouvé d’abord le rapport, trop favorable à l’opinion de la minorité. Je vous raconte des choses que vous devez savoir la discussion appellera sans doute tous les hommes importants la Tribune. Le Duc de Noailles, me parait décidé à parler. il dit que son discours qui ne sera que sur l’Orient. doit plaire au ministère et le servir, en ce qu’il mettra bien en lumières l’opinion Égyptienne dans le pays. Il voudrait forcer Thiers à s’expliqué un peu nettement sur ce point. J’ai été si frappée de votre gouvernement représentatif à vous la représentation, aux Anglais le gouvernement » que je l’ai raconté hier au soir, c’est la première fois qu’il m’est arrivé de citer un mot de ce que vous dites. Ai-je fait une grande indiscrétion ? j’en serais désespérée. Ce que c’est la vanité ! J’en ai pour vous extrêmement et quand vous dites bien, j’ai envie de confidence, peut-être ai je eu tort hier ? Cela me tourmente. Je ne crois pas avoir jamais autant vécu hors du lieu où je me trouve qu’à présent. Je vous assure que je crois quelques fois que je suis à Londres, tant je vous suis partout partout, et dans tous les instants de la journée et dans toutes les situations. Merci du drawing room. Vous avez bien choisi les plus belles, surtout bien choisi la plus jolie, car certainement Lady Ashley est ravissante. Mais vous ne me dites pas assez que cette masse de belles personne vous a frappé. Convenez au moins que vous n’avez jamais vu autant de beautés réunies qu’à un drawing room. Je vous attends à Paris. Après un peu de séjour en Angleterre, vous ne trouverez pas une femme jolie. Vous leur trouverez à toutes plus d’élégance, plus de grâce, mais de la beauté non. Il n’y en a vraiment qu’en Angleterre. Enfin une laide est une merveille. Vous savez que M. Etienne Marnier est mort ; cela fait beaucoup de sensation dans le monde élégant de Paris. Je ne me souviens pas de l’avoir jamais vu. Il passait pour le fils de M. Molé, et on a été choqué de le rencontrer le même jour à la musique chez Mad. de Castellane. Cependant il affichait un peu la mère s’il n’y était pas venu.
M de Pahlen arrive ce matin. Le temps se radoucit. J’ai pris la calèche hier, je la prendrai encore aujourd’hui. Ma femme de chambre Charlotte est venue me voir ce matin pour la première fois, elle est bien changé, et encore bien faible. Mais je l’ai bien frappée. Elle m’a trouvé très maigrie et très mauvaise mine; elle ne m’avait pas vue depuis la mi février. Certainement j’ai maigri encore depuis votre départ, et je commence à être en grande défiance de Vérity. Je ne peux plus rien prendre. Connaissez-vous un remède qu’on appelle. Salsaparilla ou quelque chose comme cela. Il me dit ce matin que si j’avale cela, j’engraisserai, je me porterai bien. N’est-ce pas des bêtises. Conseillez moi. A propos, M. de Bourqueney me dit que l’Angleterre convient à votre santé parfaitement et que vous avez bien bonne mine.
Lundi 13, onze heures
Il y a un peu de cela aussi dans le "je ne veux pas que votre première pensée soit pour moi ?" Mais au fond ; je ne veux pas signifie seulement "Je n’ose pas vouloir, car vous n’accorderiez pas." Et je connais ma place. Elle vient après beaucoup d’autres. Votre mère vos enfants. Vos devoirs publics. Je comprends tout cela, j’approuve tout cela. Ai je répondu? Et bien je suis triste.
Je vous remercie de la promesse de ne plus me tromper. Vous ajoutez "je commence à vous aimer trop pour cela." Ah vous m’aimez donc plus que vous ne m’aimiez. Cela me plaît parfaitement, cela doit être ainsi. Cela est pour mon compte. Le temps compense, ce qu’il emporte Dieu merci. Et comme rien ne reste parfaitement semblable à ce qu’il était si vous ne m’aimiez pas plus, vous m’aimeriez moins. Ainsi plus, plus, tous les jours davantage. Allons voilà votre lettre suffisamment répondue.
Voici ma journée hier, Lady Granville chez moi le matin, en suite promenade en calèche au bois de Boulogne. Après la visite du Duc de Devonshire et du Prince Paul de Wurtemberg. Dîner chez Mad. de Tallyrand avec le duc de Noailles, et le Prince de Chalais. Visite de Pahlen avant dîner que je n’ai pas pu recevoir parce que j’étais à ma toilette.
Au sortir du dîner j’ai été chez lui. Grande joie de nous revoir, grande joie d’être à Paris, de se trouver bien dans une bonne maison. Pas de conversation politique, des amitiés de la famille impériale pour moi, moins l’Empereur. Voilà le premier moment. J’ai passé un instant chez Lady Granville, et une demi-heure pour finir chez Mad. de Castellane. M. Molé fort content du discours de M. de Broglie appuyant beaucoup sur ce que M. de Broglie n’irait jamais à la gauche. Riant un peu de l’embarras que son rapport pouvait donner à Thiers. Voilà le ton. Assez d’abattement et d’aigreur. Je trouve aussi que la gauche pourrait bien n’être pas aussi contente du langage tenu par Thiers dans la Commission. Nous verrons.
Le prince Paul trouve la situation de Thiers très précaire. Le Roi ourdit toujours quelque trame. Il n’y a aucune sécurité de ce coté là. Il n’y en a aucune dans la chambre. Les deux extrémités donnent la majorité voilà tout. Le jours où elles ne la donneront plus, il tombe. M. Molé a dit au duc de Noailles : "Si le ministère tombe par le fait de la Chambre, je suis prêt à le remplacer. Si le roi le renvoie dans l’intervalle des sessions. Je ne me charge pas de prendre le ministère et je l’ai dit au roi. "
J’ai été interrompue par M. de Valcourt. Il est midi. Je n’ai pas fait encore ma toilette. Adieu. Adieu. Adieu. Quel plaisir que des lettres! Quel bonheur que le mois de juin ! Adieu.
Voici la première fois que vous me dites que vous pouvez recevoir de lettres le Dimanche. J’en userai. Il me paraît de cette façon que nous nous écrirons à peu près tous les jours. Adieu.
342. Londres, Mardi 14 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes invitations à dîner pour le 1er mai sont parties hier. Le chancelier et le speaker. Melbourne, Lansdowne, Clarendon, Normanby, Palmerston, J Russel, Holland, Minto. 15 Diplomates, y compris Neumann, Le Duc de Wellington. Mon ambassade 8 personnes. En tout 34. C’est le maximum possible de ma salle à manger, et j’espère qu’il m’en manquera, deux ou trois. Déjà le speaker, à son grand regret, m’écrit-il, à cause de la séance de la Chambre. Le duc de Wellington a accepté sur le champ, par un billet de sa main, main tremblante. Lord Melbourne aussi viendra ce qu’il ne faisait guère. Qui dois-je mettre en face de moi comme maîtresse de maison ? Lui à côté de moi? Qui à côté de mon vis-à-vis?
Mercredi 10 heures
La Diplomatie ne m’a pas encore envahi à ce point. Il est bien sûr que j’aime mieux vous écrire tous les jours, et avoir une lettre tous les jours. Nous y avions renoncé par ménagement extérieur de peur qu’ici cela ne parût trop étrange. Nos moyens de correspondance sont maintenant variés, établis.
343. Londres, Jeudi 16 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous ai quittée hier ayant encore je ne sais combien de choses à vous dire. Pourquoi vous quitter jamais ? Mais voilà qui est convenu. Nous nous écrirons tous les jours, sauf le dimanche.
4 heures
346. Paris, Samedi 18 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Votre n° 342 ne m’est arrivé qu’à 6 heures. Vous me grondez et vous m’aimez et vous avez raison de ces deux façons. J’enverrai chercher Andral d’ici à deux jours si je ne suis pas mieux. Je vous écrirai tous les jours. Voilà quatre pages répondues. Quatre pages charmantes car il y a bien de l’...., de ce qu’il avait dans des vers qui me sont arrivés à Stafford House il y a tout-à-l’heure 3 ans. Vous avez raison dans les premières pages de votre lettre aussi, article prudence, tout-à-fait raison. Quant aux places à dîner, c’est ennuyeux mais vous êtes obligé de prendre le Chancelier à votre droite et lord Lansdowne à votre gauche. Vous pririez lord Palmerston de se placer vis-à-vis de vous entre le duc de Willingtom et lord Melbourne. Voilà ce qui me semble la règle, mais laissez-moi, encore y penser. D’où vien que vous avez prié le Duc de Wellington ?
352. Paris, Samedi 25 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris seulement afin que vous ne me croyiez pas morte. Je me porte même bien. Mais je suis si lasse que je ne puis plus tenir la plume, je l’ai trop fait aller ce matin. J’ai reçu votre 349 dont je vous remercie beaucoup. A demain une grande lettres. Adieu, Adieu.
356. Paris, Mercredi 29 avril 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Montrond me raconte toujours l’amour du roi pour Thiers, et la nécessite que vous et Thiers restiez bien ensemble, comme un homme qui aurait bien envie que ce fût le contraire, car quand je lui demande pourquoi tant désirer quelque chose qui est, il me répond que les rivalités, les clabaudages peuvent altérer cela ! Moi j’affirme que vous avez tout deux trop d’esprit pour vous brouiller, à moins de très grosses raisons, et que je suis convaincue que vous vous entendez à merveille. Il serait possible que cela déplût au roi. M. Molé est si aigre qu’il trouve même que la duchesse de Nemours n’est pas très jolie. On la dit cependant charmante. Mes diplomates affirment que si une révolution éclate à Naples, l’Autriche doit s’en mêler et s’en mêlera. Je trouve à Appony l’air bien préoccupé et même égarré. Brignole trouve qu’il s’est trop fait l’homme du Roi, que c’est inconvenant et fort compromettant. J’ai causé beaucoup avec lui hier, il était mon voisin à dîner. On raconte dans la diplomatie que Thiers ayant lu dans l’Allgemeine zeitung un article insolent sur lui, a fait venir M. de Luxbourg et lui a très franchement lavé la tête. Il a raison, le journal est censuré, et dès lors le gouvernement bavarois a à en répondre. Luxbourg n’a pas trouvé une parole à répliquer.
1 heure pas de lettre. Fagel me parle toujours beaucoup de vous. Dédel lui rend compte d’un entretien qu’il a eu avec vous avant son départ qui a été pour lui d’un grand intéret.
[Monsieur Guizot
Ambassadeur de France
Manchester Square
Angleterre.
à Londres]
355. Londres, Jeudi 30 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais déjeuner aujourd’hui à Battertea chez un des favoris de la Duchesse de Sutherland, le Dr. Khay. On veut me faire voir là et à Norwood, de grandes écoles populaires en attendant que j’aille à Eton et à Oxford voir les écoles aristocratiques. A Norwood, je m’enquerrais aussi d’autre chose. Le soleil est décidé à ne pas quitter Londres. Il y fait pourtant une pauvre figure, dans son plus grand éclat. Hier, à dîner, chez Lady Lovelace, l’évêque de Norvich, bon homme un peu ridicule, un M. Villiers, frère de Lord Clarendon. Tous ses frères ont de l’esprit. Vous savez que Lady Lovelace est la fille de Lord Byron, cette petite Oda sur laquelle il a fait des vers charmants. Elle a de très jolis yeux et l’air spirituel naturel et affecté à la fois. Vous arrangerez cela, car cela est, et même, je trouve cela assez comme en Angleterre. Ils sont naturels et point à l’aise dans leur naturel ; d’où leur vient l’affectation. Je me suis ennuyé. J’ai été finir ma soirée chez Mad. Grote au milieu des radicaux. Mad. Grote, devient un personnage. Lady Palmerston l’a invitée à une soirée. J’ai entendu avant-hier Lady Holland faire un petit complot pour l’avoir à dîner la semaine prochaine à Holland, house, et bien recommander à Lord John Russell d’y venir et de plaire à Mad. Grote. Ils ne lui plairont pas, et elle ne leur plaira pas. Elle a de la hauteur et prend de la place. Ils ne lui en feront pas assez ; elle aimera mieux être reçue des radicaux chez elle qu’une étrangère poliment accueillie, à Holland house. Les complaisances aristocratiques ne peuvent plus se mettre au niveau des fiertés démocratiques. Il peut y avoir là des rapprochements sérieux et sincères, par nécessité, par bon sens, par esprit de justice. Tout ce qui est factice, superficiel, momentané ne signifie plus grand chose. On n’aura pas le vote de M. Grote comme Don Juan a eu l’argent de M. Dimanche.
J’ai été voir hier Lady Palmerston, fort contente de son petit séjour à Broadlands, pas rajeunie pourtant ; je lui trouve l’air fatigué. Elle a besoin de toilette. Le négligé du matin ne lui va plus. Elle est préoccupée des Affaires de Naples. A part l’intérêt du moment, cela lui déplaît qu’on dise que les révolutions naissent sous la main de Lord Palmerston et de le craindre elle-même un peu. Nous attendons des nouvelles. Je pense que j’aurai un courrier ce matin. Voilà mon courrier. Il m’apporte : 1° de de longues dépêches sur Naples et l’Orient avec de curieuses conversations de Méhémet Ali ; mais point de réponse encore du Roi de Naples. Cela m’impatiente. 2°des lettres et des livres des Etats-Unis d’Amérique où l’on me reproche d’avoir dit trop de bien de Jefferson. 3° l’ouvrage de M. de Tocqueville sur la démocratie en Amerique. 4° Le grand cordon de la légion d’honneur, pour que je le porte demain.
10 heures et demie
367. Londres, Jeudi 14 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
368. Londres, Jeudi 14 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
374. Londres, Mercredi 20 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ayez l’esprit d’être ici avant le 15 juin. J’y compte ; mais j’en parle. Je ne sais pas encore sûrement quel jour part votre fils. On m’a fait dire samedi, mais par approximation. Il n’y a du reste plus de nouvelles à vous en donner.
Je suis sorti cette nuit à 2 heures de la Chambre des Communes. Débat très médiocre et très ennuyeux. Nul homme important n’a parlé. Sauf lord Howick qui a bien parlé, mais sans faveur et dans une position délicate. J’y ai gagné un torticolli. On est mal assis et j’avais un vent coulis sur l’épaule gauche. Pourtant j’y retournerai ce soir. Je veux voir la fin. On me dit qu’O’Connell parlera ce soir. Evidemment, il n’a pas voulu répondre sur le champ à Lord Stanley. Sur son hardi et puissant visage, il y avait un peu de timidité et d’embarras.
Je ne doute pas que M. Molé ne remue ciel et terre pour nous brouiller Thiers et moi. Il n’est pas le seul. Et il est vrai que Thiers, a laissé entrevoir un défaut à la cuirasse par le puéril silence de sa presse à mon sujet à propos de Napoléon. Je m’étonne que les journaux qui ont envie de nous brouiller ne s’en soient pas déjà avisés. Cela viendra très probablement. Quant à moi, je me suis contenté d’écrire à deux ou trois personnes comme vous : " Cela ne m’étonne pas ; mais je le remarque. " Je ne me brouillerai point. Un moment viendra, peut-être où je me séparerai. Je suivrai exactement la ligne de conduite que vous savez.
Je regrette que vous n’ayiez pas vu ma petite note pour redemander Napoléon. Je crois que vous la trouveriez convenable par la simplicité et la mesure. Je suis pour les Invalides ; une sépulture militaire, religieuse et exceptionnelle. Les places publiques sont impossibles et inconvenantes. Le Panthéon est un lieu commun profane et profané. La Madeleine serait un tombeau grec. St Denis est pour les Rois de profession. Les Invalides seuls vont bien à l’homme, et à lui seul. Adieu.
Cela me déplait de vous quitter. Je voudrais vous écrire toujours. Mais j’ai des affaires. Venez et laissez moi le soin de votre place. Vous serez ma première affaire et mon seul plaisir. Adieu, Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Voyage
376. Londres, Vendredi 22 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Voilà une bonne lettre. J’aime votre bonheur autant que le mien. Je ne peux pas dire plus. Quel ennui de parler à Londres et d’être quatre jours avant de savoir que vous m’avez entendu à Paris ! Vous voyez bien qu’il faut être juste et se comprendre sans avoir besoin de se parler. C’est vraiment odieux et ridicule de se donner à soi-même des chagrins, qui sont parfaitement absurdes, et qu’on découvrira absurdes en quatre jours. Mais il y a des chagrins qui aboutissent à des joies ravissantes. Je n’ose pas le dire ; je ne devrais pas le dire. En ce moment à aucun prix, le N° 379 ne me paraît trop payé.
Non, je n’ai point été consulté sur Ste Hélène. On m’a demandé, prié, conjuré de réussir dans une négociation dont on avait fait la première ouverture, à Lord Granville. On me l’a demandé, le 2 mai. On m’a parlé de "grande reconnaissance personnelle". On a fini en me disant : " Réussissez, et nous vous en laisserons tout l’honneur." J’ai réussi le 9 mai. Je l’ai annoncé le 10. On m’a répondu : " Je vous remercie mille fois : nous vous reportons la part qui vous est due. " Le Ministre de l’intérieur m'a écrit : " Votre affaire, des restes de Napoléon a fait un effet immense." J’ai souri de tant de reconnaissance ici, de tant de silence là. Et depuis je figure bien me tenir parfaitement tranquille. Je remets ici la phrase que je viens de rayer. C’est ici qu’elle doit être.
Savez-vous ce que j’ai fait hier soir? J’ai joué au whist, au coin de mon feu avec mon monde ; et je me suis couché à 10 heures et demie. J’étais excédé des routs. des bals, des Communes. J’avais besoin de silence et de sommeil. Je joue certainement au whist, aussi bien que vous. J’étais allé le matin, passer une heure à la Chambre des Lords où l’archevèque de Dublin devait faire une motion qu’il n’a pas faite. J’ai entendu Lord Lyndhurst à propos d’une pétition. Je trouve qu’il parle très bien, très bien avec une grâce forte et tranquille qui ne va pas à l’ensemble de sa vie. Mais il est bien changé. Il est devenu vieux depuis que je suis ici.
3 heures
J’ai été interrompu par le chargé d’affaires de Naples G. Capece Galeota dei Duchi di Regina, bien noir, bien crépu, pas si long que son nom, mais assez intelligent et sensé? beaucoup plus que le Prince de Castelcicala qui fait ici une figure bien ridicule et bien vulgaire. Il veut être venu pour quelque chose ; il a essayé de parler d’affaires à Lord Palmerston qui l’a renvoyé à Paris, et à Naples. Il a imaginé, de se lier avec les Torys, les plus violents Torys, et de leur parler de ce que Lord Palmerston ne voulait pas écouter. Il promène de côté et d’autre sa tête trépanée. Tout le monde prend pour de beaux coups de sabre les cicatrices de ce trépan qu’il a subi à Naples pour une chute de cheval. Il a porté sa carte à tout le corps diplomatique, moi compris, et ne s’est fait du reste présenter à personne, moi compris. En sorte que presque personne ne lui parle. Le Roi de Naples ferait bien de rappeler ce gros Pulcinella, au crane fendu, et de ne faire parler de ses affaires que par ceux qui peuvent les faire.
Je viens de recevoir un billet de Mad. de Chastenay qui est arrivée hier avec Mad. de St Priest ; elles viennent passer quinze jours à Londres, et un mois en Angleterre. Je vais tâcher de les amuser un peu. Dites-moi ce qu’il faut faire. Elles auront peut-être envie d’être présentées à la Reine, au drawing room. Est-ce Lady Palmerston ou la comtesse de Björstyerna, la doyenne du Corps diplomatique qui se charge de cela ? C’est pour lundi. Vous n’avez pas, le temps de me répondre. J’irai le demander à Lady Palmerston. Il faut aussi que je leur donne un petit dîner, pas trop ennuyeux ; quelques hommes, Lord Elliot, Lord Mahon, lord Leveson. Dites-moi quelques noms. Pas de femmes, n’est-ce pas ? Mon Dieu, que vous êtes loin ! Alava, Bülow, M. et Mad. Dedel ?
Ma galerie de portraits va être complète. Mad. Delessert vient de faire celui de Guillaume, et va faire celui d’Henriette. Je les aurai tous les deux dans quelques jours. Guillaume avec sa toque. On dit que le portrait est charmant. Je pense que je vais engager Mad. de Chastenay et Mad. de St Priest à venir dîner demain samedi avec tous mes Whigs. C’est, pour elles, une très bonne entrée dans le monde et qui préparera le reste. Adieu.
J’espère que vous me direz que vous vous portez bien. Voilà une espérance bien pleine de fatuité, n’est-ce pas ? Mais vous me la permettez ; vous voulez que je l’aie. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait, Posture politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique
385. Paris, Mardi 26 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
10 heures
Je trouve bien mal arrangé que le mardi revienne toutes les semaines. Je m’éveille ce jour-là bien tristement. J’ai vu chez moi hier matin les Appony, le prince Paul encore, mon ambassadeur et M. de Pogenpohl. J’avais dû commencer par mon médecin. Il m’a trouvée very much below. parr, excessivement faible avec le pouls très élevé 90. Il m’a ordonné de passer ma journée en voiture ouverte ce que je n’ai manqué de faire même le soir et par une pluie battante. En revenant du bois de Boulogne, à 10 heures j’ai frappé à la porte de Mad. de Castellane ; j’y ai trouvé le chancelier, Mad. de Boigne, mon Ambassadeur, M. Molé, quelques autres. Point de causerie le matin j’avais peu recueilli aussi.
La médiation de Naples. ira bien difficilement. On ne regarde pas comme impossible que le sultan et le Pacha s’arrangent entre eux. Ce dernier devient bien puissant dans le divan et dans les provinces Turques. Un accommodement serait tout à son avantage et nous y verrions la ruine prochaine de l’empire Ottoman. Vous soutenez l’acheminement à ce résultat. Au fait puisque l’Europe ne parvient pas à arranger ces Messieurs il faut bien qu’ils finissent par s’arranger eux-même any how. J’ai eu une lettre de mon frère ce matin, qui me croit déjà à Londres. Il allait partir pour Varsovie avec l’Empereur, de là ils retournent à Pétersbourg.
Midi. Mes vertiges reprennent, et alors je vois à peine ce que j’écris. Le temps est à l’orage, le ciel bien triste s’il est comme cela ici, j’imagine ce qu’il doit être à Londres. Au fond l’air de Londres ils abominable ; ce n’est pas de l’air, et je suis sûre que vous vous sentez suffoqué, quelquefois. C’est la campagne en Angleterre qui est ravissante. C’est là où je voudrais être avec vous.
J’ai eu une longue lettre de la duchesse de Sutherland pleine de larmes et d’amitié. Elle attend encore Lord Burlington à Stafford house, je n’y peux pas être. J’irai à l’auberge. Cela ira pour quinze jours, mais au vrai je ne pourrai pas soutenir Londres plus longtemps. Il me faudra absolument de l’air. Je ne me fais une idée claire de la combinaison de l’air et de vous, mais il faudra cependant trouver moyen. Je vous écris demain par le gros Monsieur. Adieu, à demain, Adieu toujours.
378. Londres, Dimanche 24 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je crois qu’on s’est amusé hier chez moi, et qu’on a trouvé le dîner bon. Mais Lady Holland a eu un moment affreux. Elle avait dîné la veille à 5 heures, pour aller au spectacte. Pas déjeuné le matin. Elle mourait de faim. Lord Palmerston nous a fait attendre jusqu’à 8 heures un quart. Lady Holland a commencé, par l’humeur. Puis le désespoir. Enfin, l’inanition. au moment de passer dans la salle à manger elle a appété Lord Duncannon et s’est recommandée à lui, car elle n’était pas sûre de pouvoir aller jusque là sans se trouver mal. Le dîner a dissipé, l’inanition. Mais je ne suis pas sûr qu’un peu de rancune ne lui ait pas survécu de ce que j’avais attendu Lord et Lady Palmerston. Pour le 13 juin mon dîner Tory. Voici ma liste. Le duc et la duchesse de Cambridge, le Prince George, la Princesse Angusta, Une dame un aide de camp, le duc de Wellington, lord et lady Aylesbury, lord et lady Jersey, lady Sarah Villiers, lord et lady Stuart de Rothsay, lord Abordeen, lord Hertford, lord Howe, lord Stanley, Sir Robert et lady Peel, lord Lyndhurst,lord Ellenborough.
Connaissez-vous Sir Edward Disbrowe, le ministre d’Angleterre à La Haye ? Il a de l’esprit et des manières agréables. Il vit dans une grande intimité avec M. de Boislecomte qui me l’a fort recommandé. Si les deux pays avaient partout, des agents pareils, il pourrait y avoir entre eux des affaires, jamais d’embarras.
Savez-vous que je commence à compter les jours ? C’est charmant et très impatientant. Vous n’êtes pas seule à prendre de grandes résolutions depuis la mort de ce pauvre lord William. Lady Fanny Cowper ne couche plus qu’avec un grand poignard. Elle l’a essayé l’autre jour contre son oreiller et elle a trouvé qu’il coupait très bien. Lord Leveson n’est qu’arrivé qu’après lord Palmerston. Pour lui, je ne l’avais pas attendu. Nous étions à table depuis un quart d’heure. Je cherche s’il y a encore quelque évènement que je ne vous aie pas dit. A propos de lord Leveson, tirez-moi, je vous prie, de peine avec Lord Granville. Je viens de retrouver perdu dans un tas de papiers un petit billet qu’il m’a écrit il y a déjà bien longtemps pour me recommander un M. Rey ingénieur français venu à Londres. J’ai vu ce M. Rey et je l’ai bien reçu. Mais je ne me rappelle pas si j’ai répondu à Lord Granville et son billet enfui et retrouvé, m’en fait douter. Sachez-moi cela, je vous prie, et si je n’ai pas répondu, excusez-moi par la vérité, en attendant, que je mexcuse moi-même.
4 heures
Je comprends que vous ayez oublié le vendredi. Mais je ne comprends pas pourquoi le n° que je reçois aujourd’hui s’appelle 383. Celui d’hier était 380. J’en place bien entre ces deux-là, un qui viendra demain et qui sera 381. Mais je ne puis trouver le 382. Je viens de faire quelques visites, le Maréchal Saldanha, lord Combermere &. Il y en a beaucoup ici, mais on va vite. Quand vous serez arrivée comment réglerons-nous nos heures ? Pensez-y d’abord parce qu’il faut le régler, ensuite parce qu’il est agréable d’y penser. Vous savez ma maxime que le temps ne manque jamais là où est le désir. Le temps ne me manquera donc pas ; mais je veux du fixe, sans renoncer au variable. En voiture, un quart d’heure pour aller à Stafford-House ; à pied, par les rues une demi-heure, par les pars, trois quarts d’heure. Vous ne m’avez pas dit, si la Duchesse de Sutherland vous avait répondu. Point de nouvelles, ou bien petites. La querelle avec le Portugal s’arrangera ; le maréchal Saldanha a tous les pouvoirs nécessaires. Le Roi de Naples est parti pour la Sicile fort irrité contre ceux de ses conseillers qui l’ont embarqué dans cette mauvaise affaire, entr’autre contre le prince de Satriano. On les a payées et il aura, lui, à payer. Là est la plaie. On croit ici comme vous, le Roi de Prusse fort malade. Nous en sommes fâchés, sincèrement fâchés, quoique sans rien craindre du successeur. Que je vous dise un bon procédé de M. de Brünnow. C’est demain le jour de naissance de la Reine. Jusqu’ici, d’après la tradition on n’illuminait pas à l’Ambassade. Un scrupule m’a pris. Je n’ai pas voulu prendre des airs d’empressement exclusif en illuminant tout seul, ni courir le risque de ne pas illuminer si d’autres, si un autre quelconque, illuminaient. J’ai tout simplement fait demander à Ashburnham-House ce qu’on faisait. On m’a fait dire qu’on n’illuminait pas. Trois heures après, M. de Brünnow m’a envoyé un valet de chambre pour me dire qu’il illuminait. J’illumine donc, et je le remercierai de ne m’avoir pas laissé dans l’erreur. J’ai un peu ri de la fluctuation. M. de Poix avait grande raison de compter que votre intervention serait heureure. Mais pour être heureuse, il faut qu’une intervention intervienne. Si l’affaire est faite avant que l’intervention ait paru, ce n’est pas la faute de l’intervention mais de ceux qui l’ont réclamé trop tard. Il y a trois mois que je suis ici, et cinq mois que cette place d’attaché- payé à Londres est en perspective.
Lundi 25, 8 heures
Un très petit dîner chez lord Palmerston, lord et lady Holland, lord et lady Normansby, lord John Russell, lord Leveson et moi. Décidément, on veut me mettre là dans l’intimité. Lady Holland se charge de mon éducation. Il m’est arrivé hier de citer un proverbe Anglais : Hell’s way is paved with good intentions. Elle m’a demandé bien bas bien pardon de son impertinence et m’a averti que jamais ici on ne prononçait le mot de Hell, à moins qu’on ne citât des vers de Milton. La haute poésie est la seule excusée. L’autre jour, elle m’avait repris parce que je disais always pour still. Je l’ai beaucoup remerciée. Je vois que l’inanition n’a pas laissé de rancune. A onze heures chez lady Jersey. Lord Stuart, lord Heytesbury, Sir Robert Wilson, et une femme d’esprit, point tulipe dont j’ai oublié de demander le nom quand elle est partie. Lord Heytesbury me convient : bonne conversation, pleine, sensée, tranquille, un peu triste. Il dit. "J’ai fini." Et on voit que ceux qui n’ont pas fini lui inspirent un peu d’envie sans malveillance. La beauté de mon surtout fait du bruit. Il en était question hier au soir chez Lady Jersey. 4 heures Je reviens du Drawing-room. Immense. La Reine en aura, certainement jusqu’à 7 heures. J’espère qu’on la décidera à s’asseoir. C’est fort cohue, tant on est pressé pour arriver, pressé quand on y est, et pressé en sortant. Le palais est beaucoup trop petit. Pas de place pour les queues ; pas de place pour le spectateurs. Il y a une infinie quantité de beaute perdue, choses et personnes. Adieu. Votre fils part demain. Il ira lentement de Calais à Paris. Je suis bien heureux de le voir partir. Adieu. Adieu. Par le Télégraphe.
388. Paris, Vendredi 29 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous êtes jaloux de mon escamotage d’un n° ! Je rétablis ; voici deux 388 pour componser le 381. Je vous prie de ne pas me traiter en abrégé, quoique notre rencontre soit prochaine. Jusqu’au dernier jour j’aimerai les longues lettres et toutes les nouvelles. Il me semble que je n’y faiblis pas de mon côté. Je n’ai rien à vous conter d’hier. J’ai passé beaucoup de temps en plein air, je n’ai vu du monde que le soir. Les Ambassadeurs, la Prusse, le Duc de Noailles. le Duc de Noailles est fort révolté de ce qui s’est passe à la Chambre des députés. Révolté pour Napoléon, honteux pour le pays. Cela, et tout ce qui peut s’en suivre encore. Ces querelles sur le lieu de la sépulture. Cette manière de marchander les frais, les désordes qui peuvent survenir à l’occasion de la Cérémonie, tout cela est à ses yeux des insultes à un grand honme. Il ne méritait pas cela. Il méritait bien tant d’honneur, mais il ne méritait pas autant d’indignité. Il ne fallait pas remuer sa cendre. Il y avait bien plus de grandeur à rester à Ste Hélène. Cette souscription ouverte va être un grand scandale. Scandale si elle réussit. Honte complète si elle avorte. Tout cela est pitoyable. J’ai entendu quelques plaintes hier sur ce que M. Thiers n’a pas le temps de s’occuper d’affaires. Mais il faut que j’ajoute que les affaires qu’on me citait à l’appui des plaintes étaint tout ce qu’il y a de plus infimes. Au fond Thiers ne peut pas s’occuper de détails, c’est trop exiger. Je m’étonne qu’il ne succombe pas sous les affaires en gros. J’attends mon fils aujourd’hui. J’en suis bien impatiente. Ne soyez pas trop impatient pour le 15. Ne me forcez pas à traverser un jour de gros temps. Ne me faites pas courir la poste comme un courier. Je partirai le 13 si mon fils n’y fait pas obstacle. C’est ma volonté et surtout mon désir. Mais je ne puis pas être absolument sûre. Ne vous lassez pas d’écrire. Je vous en prie. Je n’ai pas vu Lord Granville depuis trois jours, je n’ai donc pas pu lui faire votre message encore, mais je ne l’oublierai pas. Adieu. Adieu, mille fois, adieu.
387. Paris, Jeudi le 28 mai 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
En effet, j’ai sauté par dessus le 381 car je ne le retrouve pas dans mes tablettes. Ecoutez ; hier j’ai rencontré Thiers à dîner chez mon ambassadeur en entrant dans le Salon il me dit : " Je viens de recevoir mes dépêches télégraphiques de Londres ". A ce mot télégraphe ma figure s’illumina, elle disait : " Je suis bien contente." J’aime mon invention, elle est bien innocente.
Thiers a été mon voisin à table. Il est fort content des nouvelles de Londres. Il se loue beaucoup de vous, il dit qu’à vous deux vous faites des merveilles. Il ajoute :
" J’arrange les affaires de façon qu’il n’y a que M. Guizot qui puisse être mon successeur.
- Ou plutôt vous les arranger de façon à les garder toujours pour vous ?
- Oh Je vous en réponds ; mais tenez, je suis jeune, je sais bien qu’une fois je les garderai toujours, je ne sais si cette fois là est à présent ; c’est possible, cela n’est pas sûr ; nous verrons, mais si M. Guizot s’ennuyait à Londres, je l’arrangerais ici.
- Il me semble que M. Guizot s’amuse fort bien à Londres et qu’il aimera à y rester.
- Oui , mais allez-y car sans cela bientôt, il vous fera des infidélités ! " Voilà vous.
Après cela il m’a parlé du vote d’avant-hier. Il me dit : " j’ai fait une faute, je devais parler. J’ai eu grand tort de ne pas le faire. Je n’avais pas idée que le Chambre. voterait comme elle a fait. J’étais ennuyé de parler, et puis j’aurais dit des paroles peut être trop excitantes. Enfin, j’ai mal décidé et une fois le vote, je me suis mis dans un grande colère. J’ai dit des choses très dures au président. Je lui ai dit : " Monsieur, vous ne connaissez pas votre devoir, vous ne savez pas présider, ce que vous venez de faire est absurde, je répète absurde. " Je lui ai dit tout cela là à sa chaise. J’ai dit des paroles dures, à Dupin, j’en ai dit au secrétaire de la justice, à tout le monde. J’étais en grande colère." Il a causé de tout, et m’a beaucoup divertie. Il dit des choses très piquantes. A propos de la responsabilité ministérielle, il dit : " C’est l’hypocrisie du despotisme." Au fait hier il était en train ; il n’a fait que causer avec moi. Nous avions commencé par Sauzet, nous avons fini à César. Il dispute tout au duc de Wellington, et plus que jamais il glorifie Napoléon. C’était hier un dîner de 30 personnes. Mad. de Boigne a essayé des agaceries à M. Thiers, à Mad. Thiers. Rien n’a réussi. Ils viennent de louer à Auteuil cette grande maison qu’avaient les Appony. Au sortir du dîner, j’ai été en calèche me rafraîchir au bois de Boulogne. Cela m’a fait dormir.
Je vous préviens que hier je n’ai eu votre lettre que vers cinq heures. Le joli garçon sort de chez lui avant l’heure de la poste. Il y rentre quand il peut, et moi je suis longtemps à attendre. Voici midi. Je n’ai rien encore. J’aime beaucoup Simon, et je regretterai beaucoup le gros Monsieur.
Je suis un peu mieux depuis hier. Ce matin mon fils m’écrit du 26 qu’il partait ce jour là et qu’il serait ici le 29 ou le 30. Brünnow l’a chargé de m’assurer de sa joie de me revoir, et qu’il se mettrait entièrement à mon service. Cela ne ressemble pas au premier message. Je vous remercie tendrement de tous vos enquiries au N°2 Berkley square. Je suis bien heureuse que vous n’ayez plus à y envoyer.
J’ai envie de vous redire les petits mots entrecoupés entre Thiers et moi. " Vous êtes très fine, pas plus que moi, mais je crois presque autant."
(moi) " Vous avez beaucoup d’esprit mais je pense quelques fois que vous en avez trop.
- Cela voudrait dire, pas assez ? non mais vous abusez." (Thiers) " Il n’y a de véritable ami qu’une femme. Dans les amitiés d’hommes il y a toujours un peu de jalousie."
" J’ai peu à faire avec les étrangers nous n’avons rien à nous dire ! Je suis poli, je pense qu’ils n’ont pas à se plaindre mais voilà tout. "
1 heure
Je viens de recevoir votre lettre des mains du joli garçon. Hier ce n’était par lui, c’était je ne sais qui, car on avait laissé la lettre ici et je l’avais trouvé à mon retour de ma promenade. Tout cela n’est pas en règle, et je m’en vais aller aux enquêtes par Génie. Lord Palmerston n’a pas bu la santé des souverains parce que vous n’avez pas fait à votre dîner du 1er mai ce que je vous avais dit. Je vous avez dit de répondre à la santé du roi par la santé de la Reine. Vous avez voulu faire mieux, vous avez ajouté les souverains. Cela n’est pas correct Granville l’autre jour a répondu à la santé de la reine, par la santé du roi. Barante à Pétersbourg répond par la sante de l’Empereur. Partout cela se fait comme cela, et la raison en est claire. Lord Palmerston c-est-à-dire l’Angleterre porte la santé du roi. Le représentant du roi répond par la santé de la Reine d’Angleterre, les autres souverains n’ont rien à faire la dedans. En revanche vous à la fête de la reine vous portez sa santé non parce que vous êtes la France mais parce que vous êtes doyen du corps diplomatique, c’est donc l’Europe qui parle, et alors il répond à l’Europe en portant en masse la santé des Souverains. Il ne l’a pas fait, il a voulu se venger de votre petit mistake. Voyez- vous, une autre fois lisez mes lettres et croyez. Je vous ai répété la Reine, la Reine. Je vous l’ai dit deux fois, vous deviez bien penser que j’aurais ajouté les autres s’il pouvait s’agir d’eux ; et j’ai été fâchée quand vous m’avez mandé les santés supplémentaires. Rappelez- vous de tout ceci l’année prochaine. Si. J’ai bien envie que vous n’ayez pas à vous en rappeler.
Dès que mon fils sera arrivé, je fixerai l’époque de mon départ pensez de votre côté que je ne puis pas résider longtemps à Londres. Qu’on y étouffe, qu’on y mène une vie abominable, que ce qu’il y aurait de bien, ce serait une quinzaine de jours là, et puis les campagnes. Mais pour cela il faut l’époque où l’on y va. Or cela dépend pour vous et pour les autres du parlement. Ces deuils anglais me déroutent un peu, et pour Londres et pour les châteaux. Chatsworth eût été charmant je devais y passer tout le mois d’août, vous deviez y venir. Il n’y a plus de Chatsworth. Il n’y a plus de Treutham. Je ne sais trois ce qu’il y aura en commun. Middleton chez les Jersey. Broadlands chez les Palmerston. Je cherche, je ne vois pas trop. Bowood est pour vous seul, je ne suis pal assez liée avec eux. Howick, est je le crains trop loin pour vous ; et puis vous ne faites guères connaissance avec Grey. Les Londonbery vous ne es voyez pas du tout. Il faut abandonner au hasard à nous arranger peut-être. J’aimerais bien quelque chose près de Londres. Mais il n’y a plus personne de ma connaissance intime près de Londres. Hatfield, Woburn, Stoke, Pamzhänger, tout cela est mort. Allons à Tumbridge voilà qui est charmant. Je dirais Richmond ! Mais il n’y a plus de Richmond possible pour moi ! Mad. de Boigne va s’établir à Chatenay aujourd’hui, Votre dîner Tory est très bien.
Adieu. Adieu. Le temps est redevenu charmant. Adieu.
383. Londres, Samedi 30 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Pas de lettre ce matin. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Celle d’hier a beau être bonne. Elle ne me suffit pas pour deux jours. D’ailleurs, pourquoi celle d’aujourd’hui manque-t-elle ? Avez-vous été plus souffrante ? Votre santé me préoccupe infiniment plus que je ne vous le dis. Elle n’est pas bonne, et elle n’est pas bien gouvernée. Lord Harrowby me disait pourtant hier, chez Lord Haddington où nous avons dîné ensemble, qu’il ne vous avait pas trouvée changée du tout. Et il y avait longtemps qu’il ne vous avait vue. J’ai pris, un plaisir infini, à ces paroles. Mais je soupconne qu’il se doutait de mon plaisir, et parlait un peu pour me plaire. Il est très aimable. Le soir concert chez la Reine. J’y aurais pris plaisir si vous aviez été là. Nous aurions animé l’un pour l’autre cette musique, belle mais froide. Tout était froid, chanteurs et spectateurs. Pas de vrai goût pour la musique ; pas d’intelligence dans le choix des morceaux. Ils se sont fait chanter là de grandes scènes dramatiques, qui ont besoin du théâtre, du mouvement de la scène, du concours passionné du public. C’était très froid, un plaisir de convention. La Reine y prenait un intérêt plus vif que la plupart de ses hôtes. Le Prince Albert dormait. Elle le regardait dormir moitié en souriant, moitié avec impatience. Elle le poussait du coude. Il se réveillait, et à peine réveillé, il applaudissait de la tête. au morceau du moment. Puis il se rendormait en applaudissant. Et la Reine recommençait. Nous sommes sortis à une heure et demie.
Je ne sais pourquoi je vous raconte cela car je ne m’y intéresse pas. Je ne m’intéresse à rien aujourd’hui. Il me faut une lettre ! Et demain elle n’arrivera que tard ; et ce sera une lettre officielle. Tout cela est très mal arrangé. lord Grey m’a invité à dîner pour le 10 Juin, à mon vrai regret, j’avais un engagement, qui m’avait déjà fait refuser deux autres invitations. Il a fallu refuser la sienne. Je lui ai écrit un billet bien aimable qui à très bien réussi. Il m’a répondu avec une vraie satisfaction. J’irai le voir ce matin, et causer avec lui. Puis un de ces soirs, chez lady Grey qui ne sort presque jamais. Lord Durham est vraiment mal, et va partir pour Carlsbad.
2 heures et demie
J’ai été interrompu par Dedel. Nous sommes toujours tendrement ensemble. Il me convient fort. Tout le monde croit que le Roi de Prusse va mourir. M. de Bülow, qui avait été si longtemps mal avec le Prince royal, est aujourd’hui très bien ; à ce point qu’on ne serait pas étonné que le Prince devenu Roi il fût appelé à Berlin. Je vous quitte pour des visites. Lord Grey monte à cheval entre 3 et 4 heures Je vous dirai adieu en rentrant, un adieu triste mais non pas moins tendre.
4 heures et demie
Je rentre triste, comme j’étais sorti. Je suis resté assez longtemps chez lord Grey qui me plaît. Lady Grey est venue, et m’a touché par sa sollicitude pour son mari. Elle l’a grondé devant moi de ce qu’il n’allait plus à la Chambre, ne parlait plus, ne se souciait plus de rien. Elle m’a demandé de venir souvent le voir, les voir, de l’aider, elle, à combattre, à changer la disposition de Lord Grey, avec abandon, simplicité, presque avec confiance, comme si elle me connaissait depuis longtemps. Je suis entré dans ses désirs ; j’ai flatté son malade. Je suis un très habile flatteur, car je ne mens jamais, mais je choisis les choses, et les paroles avec une sympathie intelligente et bienveillante. J’irai les voir en effet. J’ai assez de goût pour les âmes nobles et faibles. Leur noblesse me plaît, et il me semble que je suis bon à leur faiblesse. Je cause presque comme si j’avais le coeur content. C’est encore parce que vous étiez là. Lord Grey m’a très bien parlé de vous. Très bien veut dire très à mon goût. Adieu. Pourquoi n’ai- je pas de lettre? Adieu.
384. Londres, Dimanche 31 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure et demie
Le voilà ce prétendu 388 qui est le 387. Où est-il allé ? Qui l’a arrêté en route? Je n’en sais rien. Je n’y comprends rien. Enfin le voilà, avec le vrai 388. J’ai passé une très mauvaise journée. J’avais l’imagination très noire. J’ai promèné mon mal partout, chez Lady Kinnout à Holland-House, chez Lady Jersey. Vous m’avez suivie partout, malade, mourante, je ne sais quoi. En rentrant, j’ai monté l’escalier quatre à quatre ; j’ai regardé sur ma table, s’il n’y avait pas une lettre quelque oubli de la poste, quelque voyageur. En ne voyant, rien, j’ai eu un mécompte comme si j’avais attendu quelque chose. Par moments, des moments bien courts, je m’en voulais de tant d’anxiète que les spectateurs, s’il y en avait eu, auraient à coup sûr, appelée tant de faiblesse. Ah, que les spectateurs sont sots ! Pour comprendre le chagrin, il faut sentir l’affection ; et l’affection, le chagrin, tout cela est personnel ; on ne le sent que pour soi-même. On passerait pour fou si on laissait entrevoir la millième partie de ces suppositions, de ces émotions innombrables, ingouvernables, qui obsèdent le cœur.
Il y avait dans la lettre du gros Monsieur, 386 une phrase dont je ne pouvais me délivrer : " Je me sens si malade ? " Je lisais cela partout, dans les yeux de mes voisins, dans les journaux du soir. Je n’y veux plus penser. Non, je ne veux pas vous faire courir la poste comme un courrier, ni vous forcer à traverser un jour de gros temps. Mais voulez-vous bien sérieusement que je ne sois pas trop impatient pour le 15 ? Voyons dites ; voulez-vous ? Convenez que j’ai un bon caractère. Rappelez- vous vos colères, vos reproches quand j’ai tardé d’un jour, quand je n’ai pas été parfaitement sûr. J’ai bien envie, pour me venger, de vous conter toutes les coquetteries que m’a faites hier Lady Kinnoul. Je voudrais bien savoir de quel droit lady Kinnoul me fait des coquetteries. Mais droit ou non, elles étaient bien coquettes.
Lord & lady Hatherton, lord et lady Manvers, lord et lady Cadogan, lord et lady Poltiemore, lord Liverpool, M. Leshington. Voilà le dîner. Personne, le soir à Holland house, Si ce n’est au bout de la bibliothèque, lady Essex, l’actrice Miss Stephens, assise au piano et chantant très agréablement pour Lord Holland et M. Allen. 3 heures J’ai été interrompu par la visite de Chekib. Effendi. Celui-là est intelligent. Il est pressant. aussi. Il a raison. Son Empire s’en va. Et si on fait naître là une guerre, quelle qu’elle soit il s’en ira encore plus vite. L’immobilité de l’Orient, l’accord général de l’Occident, à ces deux conditions la Porte peut encore durer. Si l’une ou l’autre manqur, si nous nous divisons ici et si on se bat en Asie, c’est le commencement du grand inconnu. Je dis cela beaucoup, et tout le monde est de mon avis, presque tout le monde. Mais les avis sont peu de chose ; c’est la volonté qui fait.
Ce cabinet-ci est dans une situation bien critique pour élever dans ses chambres et dans le monde, une si grande question. Et je doute que sa situation critique soit de celles dont en sort en élevant une grande question. Je ne crois pas qu’il y ait à s’abstenir définitivement, beaucoup de jugement, ni de prévoyance. Et j’attendrais sans beaucoup de crainte la démonstration des évènements. Votre conversation avecT hiers est charmante. Je suis quelque fois tené de croire qu’il est embarrassé et se déchargerait volontiers de son embarras, pour un temps, sur les épaules d’autrui. Nous verrons jusqu’à quel point la fécondité de l’esprit, la dextérité de la conduite et le talent de la parole suffisent au gouvernemen t! En attendant, il est absurde de se plaindre qu’il ne s’occupe pas des petites affaires. Je suis sûr qu’il s’en occupe plus qu’on n’a le droit de l’exiger dans sa situation. C’est précisément une de ses qualités de pouvoir penser à la fois à beaucoup de choses, grandes et petites, et porter rapidement de l’une sur l’autre son activité et son savoir faire.
Lundi 1 juin
Je trouve en m’éveillant le Roi de Prusse mort de plus grands que lui sont morts. Je le regrette. C’est toujours beaucoup qu’un Roi honnête et sensé. Je me suis intéressé à lui dans ses temps de malheur. La façon dont ils étaient traités lui, sa femme, son pays, m’indignait. Je n‘ai pas à me reprocher d’avoir pris plaisir à à Mexico et à Calcutta comme dans un écho. La place manquera à l’ambition et à la puissance des hommes. Priez Dieu qu’ils ne deviennent pas fous.
2 heures
Je reviens d’un meeting on the slave trade, où le Prince Albert a fait son début in the chair. et je trouve le 389, votre départ pour le 13. Vous ne m’avez jamais donné de si principale nouvelle. J’ai quelques doutes sur un congé à demander à Thiers pour Génie. Sans cela, rien de plus simple que de le faire venir ici pour huit jours en vous accompagnant. Il faut que j’y pense, et que je lui en écrive à lui-même. Cela se pourra peut-être sans inconvénient. Je serais charmé de vous donner ce gardien là. Mais je ne veux pas que Thiers suppose je ne sais quoi. C’est bien intime de faire ainsi passer mon intérêt avant votre agrément. Mais je suis sûr que vous le trouvez bon. Le meeting était très nombreux et intéresant. Le Prince a été fort bien reçu. O’Connell et Sir Robert Peel également bien reçus, également applaudis. Public très impartial, et prenant. plaisir à se séparer de la politique. Grand applaudissement aussi à mon nom et à ma l’arrogance brutale et déréglée que j’ai vu régner. Elle était pleine de grandeur ; mais la grandeur à son tour était pleine de grossiéreté et de folie.
Le rappel de Ste Hélène, c’est juste. Les Invalides c’est juste, St Denis aussi serait juste, quoique moins convenable. L’apothéose serait une impièté. Et aussi une demence. La Prusse elle-même m’intéresse. Il y a en Europe trois pays que j’aime après le mien : l’Angleterre, la Hollande et la Prusse. Je suis très protestant par là. C’est la Réforme qui a fait ces trois pays, qui a fait leur caractère, et en bonne partie leur grandeur. Et l’Europe leur doit une bonne partie de la sienne, sans compter l’avenir. Il n’y en a plus pour la Hollande. Les petits pays sont morts. Deux choses aujourd’hui sont trop grandes pour eux, les idées et les évènements. Ni l’esprit, ni l’activité des hommes ne peut plus se contenir dans un étroit espace sur notre terre, le plus grand espace sera bientôt si étroit ! De Londres à New York, douze jours ; bientôt six jours ; on construit en ce moment à Bristol une machine qui double la force de la vapeur. On se promènera autour du monde. Les paroles dites à Paris retentiront. personne, mentionnés assez éloquemment par le sir Lushington. Mais puisque, vous ne devez ignorer aucune de mes vanités, voici mon plaisir de ce matin. Je suis arrivé un peu tard à Exeter hall. Le Prince était déjà in the chair. On se pressait pour entrer. Sur l’escalier, à la porte de la salle dans la salle, la foule était immense. En abordant la foule, j’ai dit the french ambassador, pour m’aider à avancer. Le premier venu à qui je l’avais dit, a dit à ses voisins. Mr Guizot. Tout le monde, a répété mon nom, personne ma qualité, et tout le monde m’a fait place. Un fils de M. Wilberforce, archidiacre dans l’ile de Wight, a parlé supérieurement avec beaucoup d’éloquence, naturelle et spirituelle. Sir Robert Peel a bien parlé, éternellement bien. Je vous dis que vous ne connaissiez pas M. de Brünnow. Savez-vous comment il était vendredi dernier, à une heure du matin, dans le vestibule de Buckingham Palace, sortant du concert de la Reine et attendant sa voiture au milieu de la très bonne compagnie qui attendait comme lui ? Une sale casquette de voyage sur la tête pour ne pas s’enrhumer. Je suis un peu choqué que vous m’ayez dit que je lui plairais. Du reste, je crois que vous avez eu raison. Il parle très bien de moi Il me semble que l’approche de notre rencontre me rend bien bavard. Vous ne vous plaindrez pas que cette lettre soit courte. J’en ai bien plus long à vous dire. Adieu. Adieu. Quand vous serez ici, il me semble impossible que nous n’arrangions pas tout vous, moi, Londres, et la campagne. Il y a deux choses avec lesquelles on peut tout. La seconde, c’est de l’esprit. Devinez la première. Adieu. Ma mère vous priera peut-être de m’apporter le portrait d’Henriette, dans une boite. J’espère qu’il ne vous embarrassera pas trop. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Progrès, Relation François-Dorothée, Religion, Séjour à Londres (Dorothée)
392. Paris, Mardi le 2 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis bien fâchée et même bien inquiète que ma lettre de jeudi ne vous soit pas parvenu samedi. Elle renfermait le récit de mon. dîner chez M. de Pahlen. Elle avait de l’intérêt et je serais tenter de croire que c’est pour cela que vous ne l’aurez pas reçue lorsque vous m’écriviez. Malheureusement aujourd’hui, je ne puis pas être rassurée sur ce point puisque c’est mon mauvais jour. J’ai les nerfs bien mal arrangés. Je suis bien triste sur mon compte. Je ne vois pas comment je pourrai me remettre. Tous les jours je deviens plus poorly. Tout m’agite, tout m’agace. Je suis dans une dipoution bien malheureuse pour moi-même et qui doit me faire hair de tous ceux qui m’approchent. Et peut-être de ceux qui ne m’approchent pas. Ma pauvre tête me semble. bien malade Je ne passe que deux jours sereins. La moindre chose la fait partir. Et alors son vagabondage est extraordinaire.
Lord Harroby ment, vous me trouvez bien changée. Votre ambassade ne m’a pas porté bonheur. Ne serez-vous pas triste de me revoir comme cela ? Ne ferai-je pas une pauvre et ridicule mine à Londres dans cette déplorable disposition à la melancolie. Croyez- vous que vous la dissipiez ? Quelques fois je crois oui bien sincèrement d’autres fois j’ai peur, peur de moi. 2 heures J’ai dîné hier chez les Appony avec mon fils. Ensuite j’ai été marché au bois de Boulogne jusqu’à 10 heures. Et de là chez Mad. de Castellanée où j’avais donné rendez-vous a M. de. Pahlen. il y avait un M. Sue, auteur de romans. Mad. de Castellane ne s’est occupé que du romancier, laissant tout-à-fait du côté l’Ambassadeur, ce que celui-ci m’a fait observer 3 fois en allemand et 3 fois en Russe ! M. Molé causait assez. La lettre de M. Odillon, Barrot occupe. Évidemment Barrot gouverne, mais ici cela a été for the hest.
Qu’entendez-vous dire de Bresson ? Restera-t-il sous le nouveau règne ?
Toujours adieu. Adieu, Adieu. Malgré la mauvaise tête le cœur reste ce que vous connaissez. Adieu. Je m’en vais prendre congès de votre mère.
393. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le pauvre mardi s’est passé pauvrement, si j’en excepte une visite d’adieux à votre mère. Elle et vos enfant un traitent, avec une bonté familière qui me plait infiniment, tout le monde a bonne mine et tout le monde a l’air gai de s’en aller à la campagne. Je serai chargée je crois de vous porter le portrait de Henriette.
J’ai vu un moment les Granville. J’ai vu et essuyé un gros orage ; J’ai diné seule avec mon file et le soir j’ai vu assez de monde. Mes habitués. Point de nouvelles, si ce n’est que Médem a eu de plus le poste de Darmstadt, ce qui lui fait de la distraction et de l’argent de plus. Il est fort content. le Duc de Noailles dit qu’on va s’ennuyer, il n’y a plus ni affaire, ni scandale. Les ambassades attendent le mort du Roi de Prusse. La duchesse de Mouchey est accouchée d’un garçon mort. C’est un grand désespoir. Je vais dîner à Boulogne aujourd’hui chez Rothschild, demain chez Brignoles, après demain chez les Granville. Vous avez là mes disssipations. J’attends votre lettre qui me dira j’espère que mon 388 ne s’est pas égaré. Je suis aujourd’hui un peu mieux qu’hier, mais pas assez bien pour aller à Epson. Qui était de votre partie, et à dîner chez Motteux ? Où allez-vous pour le ..... ? Irez-vous à Salhill, avec qui ? Je fais une quantité de questions, toutes petites, et peut-être toutes grandes. Je suis bien loin de vous, je suis bien triste d’être si loin. Serai-je bien heueuse quand je serai près ? Lord Grey m’écrit pour me presser d’arriver ; il part avant la fin du mois. Leveson mande à son père que vous êtes établi parfaitement bien. 1 heure. Pas de lettre encore. Cela est devenu bien singulier depuis le départ du gros Monsieur. 2 1/2 il faut fermer ceci. Fermer sans avoir à répondre. Je ne sais plus de vos nouvelles depuis samedi. Le cinquième jour ! Que c’est long. Adieu, Adieu.
386. Londres, Mercredi 3 juin, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je vais partir. Mes chevaux me menent à Sulton où je trouverai ceux d’Ellice. Que de choses on fait pour ne pas dire non ! Quand je serai là, le spectacle m’amusera peut-être une demi-heure ; mais il y aura bien plus de temps d’ennui, et la course me dérange. Et surtout, je n’aurai votre lettre que ce soir. Herbet me la gardera. Je n’ai pas voulu désobliger Ellice qui me soigne et me sert parfaitement. Je suis bien aise aussi de connaître un peu lord Spencer. Je ris de l’exactitude avec laquelle je vous rends compte de mes raisons pour aller à Epsom. C’est que j’ai cru entrevoir ce matin, dans le 390, une légère nuance de surprise. Encore frivole? Je ris aussi de cela. Savez-vous. ce que j’ai au lieu de frivolité ? Un peu de laisser-aller. Comme je le disais il y a une minute, il m’en coûte de ne pas faire ce qu’on me demande, de dire non. Je l’ai pourtant dit bien souvent, et bien définitivement. Et je suis fort capable de le dire. Mais il faut que j’y pense, et que je m’y arrête. Mon instinct est la complaisance. Je n’en passe pas moins pour très raide. Personne n’a autant qu’on le croit, les défauts qu’on lui croit ; et nous avons tous un peu ceux qu’on ne nous croit pas. Adieu. Je ne puis penser sans une vive contrariété à cette lettre qui va m’attendre. Ce n’est pas leur coutume. Adieu. Adieu.
385. Londres, Mardi 2 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
On ne dira jamais assez de mal de l’absence. On s’écrit tous les jours. On se dit tout ce qui s’écrit. Tout cela n’est rien ; un grain de sable jeté dans l’océan qui nous sépare. Vendredi dernier, j’attendais mon gros Monsieur avec une impatience inexprimable. Il arrive. J’attends trois ou quatre heures ce qu’il m’apporte. Il me l’apporte. J’ouvre, bien seul, dans ma chambre. Les premières lignes me ravissent ; ces lignes où sont ces paroles qui dissiperaient tous les brouillards de la Néva comme de la Tamise. Je poursuis. La Chambre, le Rois de Prusse, Thiers, Lamartine, Sébastiani. Qu’est-ce que cela me fait ? Je saute par dessus cela. Je cours à la fin. Encore quelques lignes, quelques paroles charmantes. Il y manquait quelque chose, quelque chose de bien petit mais qui surpasse tout. Pourtant. la fin était charmante ; la fin et le commencement. Je voulais d’avantage ; j’attendais davantage. J’avais tort ; je comprends parfaitement que vous n’ayez pas tout dit. Mais que m’importe ce que je comprends à côté de ce que je désire ? Je vous réponds, au moment même. Je ne vous dis pas ce qui m’a manqué ; non, j’aurais cru être injuste; je ne vous reprochais rien. Mais je ne vous dis pas non plus ce qui m’a charmé. Je vous réponds avec mon impression, pas triste, mais pas transporté ; pas mécontent mais pas satisfait. Ma reponse vous arrive. Vous aussi, vous trouvez qu’il vous manque quelque chose. Et vous avez raison, encore plus raison que moi ; car moi, j’avais trouvé quelque chose de charmant. Vous vous plaignez de ce qui manque ; je vous remercie de votre plainte ; elle m’enchante. Mais du regret de vos paroles, de celles qui m’ont charmé ! Non, non, je ne vous le permets pas ; si j’ai eu tort, vous n’avez pas le droit de vous plaindre de mon tort. Vous plaindrez vous que je ne sois jamais satisfait, qu’il me faille toujours plus, toujours tout ? Moi, je me plains d’une chose, c’est que vous n’ayez pas deviné tout ce que je vous dis là. Mais je ne me plains pas bien fort, car vous êtes charmante ; je vous aime et vous allez venir. savez, vous ce que cela prouve ? C’est qu’à cent lieues l’un de l’autre, l’océan entre nous rien ne nous échappe, rien n’est inaperçu ; nous voyons tout ce qu’il y a ; tout ce qu’il n’y a pas, comme si nous nous voyions, si nous nous parlions. On s’aime beaucoup quand on en est là; et quand on s’aime beaucoup, on a tort d’être séparés.
C’est bien pour le 13. A présent le départ est sûr. Un beau temps et pas beaucoup de fatigue le premier jour pour que l’arrivée le soit aussi. Hier, le temps était admirable. Ce matin un orage. Je viens de faire quelques visites par la pluie. Le soleil revient. J’en suis bien aise pour demain, pour le peuple qui va à Epsom. C’est Ellice qui m’y fait aller. Je n’y pensais pas. Je ne suis pas fâché de voir cela une fois. Nous dinons dans une petite maison de M. Metteux, près d’Epsom. M. Motteux n’y est pas et lord spencer y vient. Il a désiré dîner là avec moi. Nous dînerons à nous trois Lord Spencer, Ellice et moi, plus un quatrième curieux que je ne connais pas et dont j’ai oublié, le nom.
Lady Normanby a donné hier à la Reine, un concert de famille. En fait d’artistes Rubini et Lablache seuls. En fait d’amateurs, lady Barrington, lady Williamson et lady Hardwicke. C’était beaucoup mieux que mon attente. Lady Williamson a une belle voix infatigable et Lady Hardwicke une voix très expressive. Pas beaucoup de monde, très choisi. La Reine ne s’en est allée qu’après la dernière note, à une heure et demie. Je viens de chez le duc de Cambridge. Mon dîner Tory est dérangé et rarrangé. Le vendredi, 12 juin, il y a un grand débat à la Chambre des lords sur les corporations municipales d’Irlande. Le duc de Wellington, lord Lyndhurst, lord Aberdeen, lord Ellenborough & & ne pourraient probablement pas venir dîner. Il a fallu trouver un nouveau jour. Presque tous étaient pris. La Duchesse de Cambridge y a mis beaucoup de bonne grâce. Enfin c’est pour le vendredi 26 juin. Je vais désinviter et rinviter tout le monde. Vous serez à Londres ce jour-là ? Serez vous chez moi à dîner ? Ce que vous voudrez comme de raison. Je le voudrais bien et il me semble que ce serait fort naturel. Ce sont tous vos amis.
La mort du Roi de Prusse est en suspens. M. de Bülow n’a rien reçu. Je ne crois pas que Paris et Pétersbourg en soient beaucoup plus près. D’ailleurs il n’y a plus de pièces de porcelaine ; tout est balles de coton. Lisez; je vous en prie attentivement le petit débat d’hier soir aux Communes sur les affaires d’orient et dites-moi si Lord Palmerston vous fait l’effet d’un peu d’embarras et d’un léger mouvement de retraite. Il y a au moins le désir et le dessein de rester très bien avec la France quand même on s’en séparerait en Orient. La question va traverser dans quelques jours une petite bouffée de flamme. Mon instinct est que la souscription Bonapartiste échouera. C’était bien la peine de faire tant de bruit. L’affaire avait grand air en passant le détroit. Soyez sure qu’il y a les deux choses, l’étourderie et la prémédi tation. Je suis de votre avis sur les funérailles. Adieu. Mille adieux en retour du pauvre petit adieu qui est tout seul dans la dernière page du 390, ce qui prouve que vous aviez encore en finissant quelque regret des douces paroles que j’ai trouvées si charmantes et si courtes. Plus de regret et beaucoup plus d’adieux. Adieu.
388. Londres, Vendredi 5 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Eton est moins bruyant, et plus intéressant qu’Epsom. Avant-hier quatre chevaux m’ouvraient à grand peine un chemin à travers cent cinquante mille oisifs et fous, comme vous dîtes. Hier, je parcourais seul avec le principal, le Pr Hawtrey, les salles d’étude, les refectoires, la bibliothèque où s’élévent les six-cents membres du Parlement, géneraux, amiraux évêques futurs de l’Angleterre. Tout cela a bon et grand air, un air de force, de règle et de liberté. Debout, au milieu de la cour, la statue de Henri, 6, ce roi imbécile à peine Roi, et qui n’en préside pas moins depuis quatre siècles dans la maison qu’il a fondée à l’éducation de son pays. Autour les plus beaux champ et dans ces champs les plus beaux arbres qu’on puisse voir. En face, Windsor, le chateau Royal resté château fort et qui perpétue au soin de la pacifique civilisation moderne, l’image de la vieille royauté. La Tamise, rien que la Tamise entre Windsor et Eton, entre les Rois et les enfants. Et la Tamise couverte de jolis bateaux long et légers remplis de jeunes et beaux garçons, en vestes rayées bleu et blanc,, avec de petits chapeaux de matelots ramant à tour de bras pour gagner le prix de la course. Les deux rives couvertes de spectateurs à pied, à cheval, en voiture, assistant avec un intérêt qui quoique silencieux à la rivalité des bateaux. Et au milieu de ce mouvement, de cette foule, trois beaux cygnes étonnés effrayés, se réfugiant dans les grandes herbes du rivage pour échapper aux usurpateurs de leur empire. C’était un charmant spectacle, qui a fini par un immense dîner d’enfants. Sous une tente bien blanche, entourée, comme jadis les dîners royaux de la foule des spectateurs. Mon seul reproche est l’excès du vin de Champagne qui a fini par jeter ces enfants, dans une gaité plus bruyante qu’il ne leur est naturel. Je suis revenu comme j’étais allé par le Great. Western Railway qui nous a menés, moi, ma voiture et mes chevaux de Londres à Eton en moins de trois quarts d’heure. Grand dîner, de toutes les Puissances de la maison et de beaucoup de visiteurs de Londres.
Une heure
Nos chagrins sont alternatifs. Je suis désolé que vous n’eussiez pas reçu ma lettre à 2 heures et demie. Je l’avais pourtant adressée par la voie que je crois la plus prompte, en l’absence du gros Monsieur. Vous l’aurez eue dans la journée. C’est un immense ennui que les inexactitudes. Il y en a un plus grand, ce sont les doutes " Je suis bien triste d’être si loin. Serai-je bien heureuse quand je serai près ? " Oui à moins que vous ne vouliez pas. Il n’y a pas quinze jours, vous m’avez promis beaucoup de foi. Et vous ne savez pas si vous serez heureuse quand vous serez près ! Et vous me faites une quantité de petites questions, " peut-être toutes grandes " ! Voici ma réponse. Je n’irai à Salt hill avec personne, car je n’irai pas à Salt hill ; car je ne sais pas ce que c’est que Salt hill ; car je n’ai pas pu lire votre mot précédent. " Où allez-vous pour le.....? Vous voyez que je ne suis pas encore si enfoncé que vous le croyez dans ce qui est loin de vous et sans vous.
3 heures et demie
Je rentre et mes yeux tombent sur ce que je vous écrivais tout à l’heure. Je corrige une phrase : " serai-je bien heureuse de près ? " Oui, quand même vous ne sauriez pas. Voilà ma vraie idée et ma confiance. J’ai été interrompu par M. de Pallen et lord Clarendon. Puis, je suis sorti pour aller voir un moment lady Palmerston. Je l’ai trouvée près de monter en voiture pour Broadlands où elle va jusqu’à mardi. Lord Palmerston y va aussi. Mais il reviendra demain pour dîner chez la Reine où je dine aussi. Le rail-way de Southampton, les mêne à Broadlands en trois heures. Vous savez probablement que lord Beauvale a été fort, fort malade, d’une goutte remontée qui a failli l’étouffer. Il ne pouvait plus avaler et à peine respirer. Les nouvelles de ce matin sont meilleures. Voilà la Commission Rémilly qui a rejeté toutes les incompatibilités nouvelles, et qui fera un rapport insignifiant, lequel ne sera point discuté. C’est la session close sans bruit, autant qu’on peut prévoir. J’en suis bien aise. Que de choses, j’ai à vous dire ? J’en oublierai beaucoup. C’est mon dépit continuel. Mille idées me viennent dans l’esprit, mille paroles sur les lèvres qui voudraient aller à vous, qui vous plairaient, je croiset qui s’évanouissent perdus et tristes. Vous voyez bien qu’il faut que vous arriviez. Adieu. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire. Adieu, adieu.
394. Paris, Mercredi 3 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
4h 1/2
Que votre parole est puissante ! Et quand je pense qu’outre cette parole puissante, Il y aura bientôt cette voix, ce regard, qui agissent sur moi si fortement, je me sens bien petite de me laisser aller jamais à des moments de tristesse, de doute, où vous me voyez si souvent. Je rentre et l’on me remet votre 384. Il y a vos inquiétudes. Ah ne les regrettez pas, ne regrettez pas de me les avoir exprimées. Elles m’ont fait tant de plaisir. Je me sens le cœur plus large, plus libre. Le retard de ma lettre vous avait donnée du chagrin, presque l’angoisse. Je suis si contente ! Voyez cet atroce égoïsme. Haïssez-moi bien, car je jouis vivement de vos peines quand c’est à moi qu’elles s’adressent. Nous nous sommes souvent dit que nous ne savions pas rendre tout ce qu’il y a dans notre âme. Jamais je n’ai tant senti l’insuffisance de mes paroles. Mais vous verrez quand vous m’entendrez ! De près, il me semble que je serai bien éloquente Jeudi le 4 de juin.
Voici le 385, et des volumes que j’aurais à répondre, que de choses à vous dire, bien tendres, des reproches, de la reconnaissance. Vous deviez me dire un mot sur le gros Monsieur tout de suite. vous me les dites à présent. Mon cœur allait au devant des paroles de 385. si je les avais trouvées plutôt vous m’auriez épargné quelques jours de peine. Vous avez raison. Il y a bien de la susceptibilité dans l’absence. On remarque tout, cela veut bien dire que nous nous aimons, mais pour cela même il faut que nous nous épargnions mutuellement tous les petites images, car il n’y a rien de petit quand on ne peut que se dire adieu tout de suite après. N’est-ce pas ? Ne faites rien pour Génie si vous y voyiez le moindre inconvénient. Gardez-moi une place à dîner le 26. Cela vous plait, et à moi aussi.
Mes matinées sont très coupées par mon fils et mille bêtises. J’ai à peine le temps d’écrire trois lignes de suite. J’ai dîné hier chez Rothschild à Boulogne. Nous avons beaucoup causé Thiers et moi. Il m’a dit beaucoup de choses qui méritent que je m’en souvienne. Il est très sage, très contenu. La guerre à la toute dernière extrémité, il la reculera plus que ne la reculerait tout autre ! Mais si un jour elle éclate s’il la faut absolument oh alors, par tous les moyens et ravoir ce que la nature indique. Il y a deux forts arguments. L’un pour l’autre contre la guerre. Contre, parce que personne ne la veut. Pour, parce qu’il y a 25 ans qu’on ne l’a faite. Sur l’Orient, sait-on bien, sait-on assez en Europe, que la France sur ce point est in-fle-xible ? Prononçant comme cela et répétant. En Angleterre, il n’y a que Lord Palmerston qui soit de l’avis contraire à tout le monde. La session finit, dans 10 jours tout sera terminé. Odillon Barrot s’est conduit parfaitement. Sa lettre est excellente. On s’est tiré habilement du mauvais pas de la souscription. Les funérailles, qui sait ! Il est vrai que l’épreuve sera forte, car l’émotion sera dans tous les cœurs. Le million de Joseph ? Il na pas voulu me répondre du tout sur cela, il m’a dit simplement : " C’est un vieux fou. C’était une veille créance." Cela confirme sans expliquer ce qu’il veut faire. Je suppose que cela l’embarrasse.
La Prusse. La mort du Roi c’est là révolution. Je suis parfaitement de son avis et vous verrez. Au bout d’une bien longue conversation il me dit que si je ne vais pas en Angleterre, il me jure qu’il viendra deux fois par semaine causer avec moi.
There is a bribe ! I go to England.
Je vois que l’affaire Rémilly est noyée par conséquent rien de grave ou d’immédiat. Il me semble que les rapports de Thiers avec le roi doivent être meilleurs, presque vous. Cela perce dans le paroles respectives. Il me semble que je vous ai tout rapporté. Ah encore, tous les deux lui et moi nous sommes pour une République aristocratique, franchement de tout notre cœur. Je vous assure que nous avons fort bien parlé sur cela, et je crois que vous aurez fait le troisième. Nous nous sommes bien promis de nous garder le secret. Ainsi gardez-le.
Je fais mes préparatifs, et j’ai mille embarras petits et grands, parce que vous savez que je n’ai personne pour me les épargner. Simon m’a dit ce matin qu’il a vu partir toute votre famille en très bonne santé. Il se plaint que la poste lui apporte maintenant les lettres plus tard que de coutume. Je vous en préviens, moi je me plains bien plus que lui. Je suis charmée de ce que vous me dites sur meeting du Slave trade. Vous faites bien de me dire toutes les petites vanités. Cela cela devient bien grand pour moi. de tous côtés j’entends parler de vous, parfaitement J’irez voir. Adieu Adieu, et jamais assez.
400. Paris, Mercredi 10 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici vraiment, un gros chiffre, et qui ne prouve pas que nous soyons des gens d’esprit. Trois ans font environ 1100 jours. Plus du tiers de ce temps nous l’avons passé séparés !
J’ai vu hier soir beaucoup de monde ; les ambassadeurs, M. Molé, M. de Poix, M. de Noailles et les diplomates d’été comme il les appelle, c’est-à-dire les petites puissances. M. Molé seul d’abord car il vient de bonne heure. Il n’a pas vu le Roi depuis 6 semaines ; il ne voit pas pourquoi il y irait. Il blâme fort la conduite du Roi, il la trouve très malhabile. Il se préoccupe de l’entrée de Barrot dans le ministère il croit qu’on le nomme à la justice. M. Vivien au commerce, et M. Gouin dehors. Si l’entrée de Barrot faisait sortir les doctrinaires, ah, cela serait un gros événement. Alors le ministère ne peut pas tenir, les conservateurs se retrouvent compactes, forts. Cela lui plait beaucoup. Le maréchal Valée aura pour successeur au commandement de l’armée, le général Bugeaud. Dufaure serait nommé gouverneur civil de l’Algérie. Voilà le dire de M. Molé.
Les ambassadeurs étaient occupés de Berlin. Le Roi était à l’agonie. Ils commencent à trouver que ce sera une immense perte. Les derniers 6 mois de l’année 40 peuvent développer beaucoup de mauvais germes. Il y a longtemps qu’on se sent menacé de tous côtés, ne croyez vous pas que le moment est prochain où l’orage doit éclaté ? On dit que Don Carlos est dans la misère. Les légitimistes se cotisent pour le faire vivre.
2 heures
Votre n°390 me laisse un grand remord de ne pas partir Samedi. J’ai tort de dire remord, c’est regret qu’il faut dire, parce qu’il n’y a pas de ma faute à ce retard. Ma seule faute c’est d’avoir du malheur dans les petites choses comme dans les grandes. Je n’en connais qu’une grande qui ne soit pas entachée de cela. Elle couvre tout.
Vous m’apprenez que les Sutherland me donnent Stafford house, et vous concevez que ce n’est pas comme cela que je dois l’apprendre. Assurément ce serait un grand tracas et un bien mauvais gîte d’épargné. Mais encore une fois, ils ne me l’ont pas dit. J’écrirai à Benckhausen. La veille de mon départ pour qu’il me trouve un appartement convenable. dans l’une des auberges de Londres. Je ne partirai pas sans avoir vu Génie. Je serai à Londres jeudi le 18 au soir ou vendredi dans la journée. Cela dépendra du passage. Je vous écrirai de Douvres si je m’y arrête ; si non, comme je devancerai la poste, vous saurez mon arrivée quand je serai arrivée.
N’ayez pas peur que je perde une minute jusqu’à mon départ vous aurez tous les jours une lettre, et une de la route, pour que vous me sachiez vraiment en route. Adieu. Adieu. Je ne pense qu’au bonheur qui m’attend. Adieu.
406. Boulogne, Jeudi 18 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens d’arriver. Le vent est si fort qui s’il continue à souffler demain avec cette violence. Je n’aurai pas le courage de passer. Cette lettre passerait donc au lieu de moi. Je veux que vous me sachiez partie et près d’arriver, et heureuse de me sentir si près ! Je suis fatiguée, mon dernier jour à Paris a été abominable. Prise par tout le monde, et par mille choses.
Thiers est venu et a causé beaucoup. Rien de nouveau, Je vous conterai. On entre, et on me remet dans ce moment votre lettre de hier. Je vois que Samedi sera mauvais et comme je ne pourrais dans aucun cas arriver à Londres demain il faudra bien attendre dimanche. Le bateau ne part demain qu’à midi, je ne serai à Douvres qu’à 5 heures. J’irai donc coucher en route. Voilà bien du retard.
Dès mon arrivée à Londres j’enverrai chez vous. Je vous verrai peut-être entre le rail road et le dîner voilà tout ce que je puis esperer. Je suis très faliguée mon petit compagnon de voyage est très utile, lui et mon courrier m’enlève tout souci mais ils n’empêchent pas que je trouve l’hôtel Talleyrand plus commode que la voiture et les auberges.
Vendredi 7 heures du matin.
Je n’ai pas décidé encore si je pars ou si j’attends demain. Le vent souffle, on dit le duc de Wellington (paquebot) mauvais. Tout cela avec votre promenade à Southampton fait que je ne vais pas risquer. Je verrai. Je ne suis pas décidée, encore. J’ai dormi presque sans réveil, ce qui est rare. En m’éveillant j’ai pensé avec joie que j’étais bien près. Adieu, adieu. Adieu.
408. Boulogne, Samedi 20 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
La mer est toujours abominable quoique le veut commence à diminuer un peu, la traversée serait encore horrible, il faut attendre à demain. Le ciel n’est plus si chargé, le bateau de demain passe pour avoir le mouvement plus doux, c’est donc demain que je passerai j’espère.
Je veux vous dire ce petit mot par dessus mes deux lettres d’hier. Quel ennui ! Il faut que ma terreur du mal de mer soit bien forte pour me faire me résigner à Boulogne pendant 4 jours. Je marche, je lis, je fais des patiences. Mon compaqnon de voyage va me chercher des nouvelles. Nous mangeons lentement, enfin nous traînons une pitoyable journée. J’ai dejà pris Boulogne en horreur, Boulogne que nous trouvions si charmant en imagination. Il me semble que vous recevrez cette lettre et celle d’hier au soir en même temps demain matin. J’aurais tant aimé passer le dimanche à Londres. C’est un jour tranquille, je l’aurais bien employé. Adieu. Mon impatience est bien grande. Je n’ai jamais été contrariée par les éléments. Ils se mêlent de cela aussi. Mais cela revient à ce que Louis quatorze disait au Maréchal de Villeroi. Adieu. Adieu, Monsieur, adieu.
407. Boulogne, Vendredi 19 juin 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma lettre ce matin n’est point partie par l’occasion régulière. J’ai donc quelque crainte qu’elle ne vous parvienne pas, ce qui fait que je recommence à vous conter mes doléances. La mer est affreuse je n’ai pas eu le courage de m’embarquer. J’attends du calme demain. S’il ne venait pas il faudrait le prendre, mais j’aime presque cela mieux que le mal de mer. Vos n’avez pas d’idée de l’ennui de ceci. Il fait très froid, très gris. Il pleut à verse ; si je n’avais mon compagnon de voyage deux heures dans la journée ce serait horrible, je lis les journaux de Paris et de Londres, je vous cherche. Ne devrais-je pas vous chercher à Boulogne aussi ? Vous aviez une fois le projet d’y être ? J’attendrais plus patiemment que la tempête se calme.
Je vous écrirai aussi longtemps que durera ma quarantaine. Je regarde les girouettes et les nuages, ils me sont bien hostiles. Adieu monsieur adieu. J’avais bien espéré, ne plus vous dire. Adieu aujourd’hui je comptais vous voir ce soir ! Quel guignon ! Un temps superbe jusqu’au jour où j’ai quitté Paris, et depuis toujours tempête. Adieu. Adieu.
400. Trouville, Dimanche 9 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Ce qui est vrai, c’est qu’à tout prendre je suis content de ce que j’ai vu à Eu, des deux partis. J’ai vu, d’une part de la révolution, de l’autre, de la modération. Les penchants, les désirs au fond ne sont pas, les mêmes ; mais les conduites pourront fort bien s’accorder. On travaillera sincèrement à maintenir la paix ; on fera hardiment la guerre si l’occasion l’exige. Et on prévoit des occasions qui pourraient l’exiger. On ne provoquera point ; on ne commencera point. Mais on n’éludera point. Le pays est dans la même disposition ; nulle envie de la guerre, tant s’en faut ; mais un grand parti pris de ne pas accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyiez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs. J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs.
J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous serez déjà à la campagne. Je vous écrirai encore 400 demain, à tout hasard. Samedi, en revenant de West, vous trouverez une lettre et moi. Adieu. J’aspire à demain. Trois jours sans un signe de vie ! Cela m’est-il jamais arrivé ? Adieu Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Famille Guizot, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait
399. Eu, Samedi 8 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis arrivé hier au soir. Il est impossible d’être mieux reçu. Mais l’incident de Louis Bonaparte va déranger peut-être tous mes arrangements. Il se peut que le Roi, parte ce soir pour aller passer 36 heures à Paris, et tenir un Conseil qui convoquera la cour des Pairs, et règlera toutes les suites de cette ridicule affaire. On peut bien enterrer solennellement Napoléon. Le Bonapartisme est bien mort. Quel bizarre spectacle ! Louis-Napoléon se jetant à la nage pour regagner un misérable canot, au milieu des coups de fusil de la garde nationale de Boulogne, pendant que le fils du Roi et deux frégates françaises voguent à travers l’Océan, pour aller chercher ce qui reste de Napolèon ! Qu’il y a de comédie dans la tragédie du monde ? Si le Roi part ce soir pour Paris, je pars moi-même pour Trouville. J’y passe Lundi avec mes enfants, et je reviens ici, mardi soir pour y passer le Mercedi et me remettre le jeudi en route, pour Londres où j’arriverai toujours vendredi.
J’emploie tout ce que j’ai d’esprit pour que rien ne dérange ce dernier terme qui est mon point fixe. C’est bien bon et bien doux d’avoir un point fixe dans la vie, un point où l’on revient toujours, et où l’on ramène tout. Il y a des biens (j’ai tort de dire des) qu’on n’achète jamais trop cher. Je vis tout le jour, je pourrais dire la nuit avec M. Thiers. Nos appartements se tiennent ; nos chambres à coucher se touchent. Il a ouvert ma porte ce matin à 6 heures à moitié habillé, pour me trouver encore dans mon lit et presque endormi. Nous nous sommes promenés ensemble de 7 heures à 9. Puis, dans le cabinet du Roi, à déjeuner, sur la terrasse après-déjeuner, toujours ensemble jusqu’à midi et demi, heure où je vous écris. L’estafette part à une heure. Je les trouve tous très animés et très calmes, en grande confiance, sur l’avenir, convaincus qu’on s’est fort trompé dans ce qu’on a fait et qu’on le verra bientôt. Le Pacha ne cédera point, et ne fera point de folie. La coërcition maritime ne signifiera rien. La coërcition par terre, ne s’entreprendra pas. Le Roi et son Cabinet, sont très unis. On n’exagère rien dans ce qu’on dit de l’animation du pays. Adieu. J’ai tout juste le temps, de vous dire adieu, ce qui est bien court, trop court, infiniment trop court.
Je m’aperçois que j’ai oublié de vous dire que le Roi reviendrait de Paris à Eu mardi avec M. Thiers. C’est ce qui me fera répasser par Eu. Adieu. Depuis avant-hier je n'ai rien vu, rien entendu de vous. Encore Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Turquie)
401. Trouville, Lundi 10 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Je ne devrais plus vous écrire. Cette lettre-ci sera à Londres, Vendredi. Vous n’y serez pas. Et quand vous y serez, j’y serai. N’importe. Je vous écris. Je viens de recevoir votre lettre 409. J’ai oublié de numéroter les miennes. Il me semble que ceci doit être 405. Il y a trois jours, je ne me résignais pas aux lettres. Aujourd’hui une lettre vient de me charmer. Il fait très chaud, très beau. J’irai tout à l’heure promener ma mère et mes enfants, dans la forêt de Touques ; ma mère en calèche, mes enfants, sur des ânes. Ils sont bien heureux. Je les ai menés à la mer ce matin ; ils se sont baignés devant moi. Mad. de Meulan vient d’arriver. Elle retournera au Val-Richer demain. Ma mère et mes enfants samedi 15.
J’ai déjà parlé à Eu de mon congé en octobre. J’y compte. Toujours subordonné à l’état de cette malheureuse question d’Orient. Mais ou je me trompe fort ou elle sera immobile à cette époque. Le blocus durera sans aboutir. C’est, je vous jure un curieux spectacle que la complète opposition des conjectures sur le Pacha, les uns si sûrs qu’il cédera, les autres qu’il ne cédera pas. Très sincèrement sûrs. Il y a de quoi prendre en grande pitié les convictions diplomatiques. L’erreur sur l’insurrection de Syrie a été grossière ; elle n’a pas été un moment sérieuse, et Lord Alvanley est un badaud. Lord Francis Egerton a donné aux insurgés trois canons rouillés, et 800 fusils hors de service ; par ardeur chrétienne et pour affranchir les frontières de la Terre Sainte. Il n’y a eu personne pour se servir de ses fusils. Méhémet en profiterait s’ils étaient bons à quelque chose. Les Carlistes aussi ont eu la main dans l’insurrection ; par Catholicisme et par Carlisme. Tout cela a abouti à élever un nuage de poussière que Lord Palmerston a pris, pour un orage. De son erreur je conclus qu’il se trompe probablement sur Alexandrie comme sur Beyrout. M. Thiers est infiniment plus sceptique, plus modeste. Pourtant il ne doute pas de la résistance obstinée du Pacha.
Conseillez à Lady Clauricarde de retirer sa joie sur Louis Bonaparte. Elle a des joies un peu légères. Voilà les obsèques de Napoléon accomplies, tranquillement accomplies. Le Roi, ses ministres, le public, tout le monde est charmé. Le Bonapartiosme est tombé plus bas que l’insurrection de Syrie, le pauvre Louis Bonaparte ne voulait pas se coucher dans le château de Boulogne parce qu’il n’avait pas son valet de chambre pour le déshabiller. Et jeudi dernier, quand on l’a retiré de l’eau et conduit en prison, comme il ne voulait pas poser sur la pierre froide ses pieds nus (il venait d’ôter ses bas) un des gardes nationaux qui venaient de lui tirer des coups de fusil, l’a pris dans ses bras, et l’a porté sur son lit.
Vous avez bien fait de m’envoyer la lettre du duc de Poix. Il n’y a en effet rien à faire à présent. On a fait quelque objection à son fils, très haut. Cette nouvelle vilenie de Pétersbourg (pardonnez-le moi) m’a indigné comme si elle m’avait surpris. Je croyois que nous avions atteint le terme. Vous n’avez sans doute plus rien entendu dire de la prochaine arrivée. Vous m’en parleriez. Mais j’oublie que vous m’avez écrit vendredi, vingt, heures après m’avoir vu. Les heures sont bien longues.
Adieu. Ceci est pourtant ma dernière lettre. Mais non pas mon dernier adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Vie familiale (François)
403. Eu, Jeudi 13 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Décidément, je pars demain Vendredi, à 8 heures, et je serai samedi à Londres, pour dîner. J’espère trouver de vos nouvelles à Hertford house en y arrivant, et j’irai, en chercher moi-même à Stafford house dès que j’aurai dîné, de 8 heures à 8 heures et demie. D’avant-hier mardi à après-demain samedi sans rien de Vous ! Thier est arrivé ce matin. Nous passons la journée ensemble. Il retourne ausi à Paris demain. Je suis content, je devrais même dire de plus en plus content des dispositions publiques et personnelles. J’espère que mon pays se fera honneur et que je l’y aiderai.
Adieu. Adieu. Je vais rejoindre, le Roi et Thiers. Adieu.
411 bis. Wrest Park, Vendredi 14 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens de recevoir votre lettre de Trouville de Dimanche ! Que c’est long ! Mais vous arrivez à Londres aujourd’hui vous me le dites, vous me le promettez. Je me suis ranimée. Je balance, puis-je partir aujourd’hui ? J’en ai si envie, une si grande envie.
3 heures.
Je me décide, je pars, je porte ceci chez vous.
7 heures. Dernier adieu. Je suis à votre porte. Venez me voir à Stafford house après votre dîner. Vous me trouverez malade et heureuse.
411. Wrest Park, Jeudi 13 août 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai quitté Londres hier sans lettre je n’ai eu de vous qu’un mot de Calais, et un mot d’Eu de Samedi matin. Depuis rien du tout. Cela m’inquiète et m’afflige. Je suis venue ici malade. On me drogue ici ; je suis vraiment, souffrante. Des vertiges abominables. Je m’ennuie parfaitement : c’est bien long d’y rester encore aujourd’hui et demain !
Si j’avais une lettre je partirais peut être demain. Dans tous les cas je serai à Stafford house.
Samedi 3 heures. Je vous préviens que j’ai accepté dîner à Holland house dimanche. Lady Palmerston est ici ; elle va à Windsor demain, son mari y est et y reste jusqu’à Mercredi. J’ai eu à me plaindre de la cour et de mes amis ministériels ces derniers jours. J’ai eu une lettre de Mad. de Flahaut. Une lettre de mon frère. La première ne n’envoie pas de copie. L’autre ne me répond pas encore. Il n’avait par reçu Adieu, adieu. Je suis très mécontente de n’avoir pas eu de lettres. Adieu.
404. Du château de Windsor, Mardi 18 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
404 est le vrai numéro de ceci. J’ai refait ma chronologie. Rétablissez la vérité sur mes six dernières lettres de France. Elles sont comprises entre 397 et 404. J’arrive. Le Roi Léopold n’est pas encore rentré de la promenade. Je l’attends et je pense à autre chose. Je suis dans une grande et belle chambre en damas jaune, en face de la grande allée. Je soupçonne que c’est votre chambre. Je soupçonne qu’on me l’a donnée à dessein. J’ai envie de ne pas me tromper. Une alcôve en face de la cheminée, avec une grande glace au fond, recouverte par une tenture flottante. La grande fenêtre en face de la porte. Une petite fenêtre longue dans un enfoncement à côté de la cheminée. Une toilette dans la grande fenêtre. Trois commodes, secrétaires, & l’un en ébène, très doré ! Un joli petit cabinet de toilette à côté. Ai-je raison ? Je suis venu en deux heures. J’ai dormi une heure ; dormi et rêvé. Éveillé l’autre heure en pensant comme j’avais rêvé. Une pensée unique et immuable dans une vie animée et variée.
Que d’espace j’ai parcouru, que de choses j’ai vues, et dites et faites depuis quinze jours ! Deux grands pays, deux châteaux royaux, trois rois dont une reine, la paix ou la guerre en Europe et en Asie. Et tout cela, c’est la surface. Il y a tout autre chose, au fond, une seule chose?
Mercredi 19 août. Midi. J’ai vu deux fois le Roi Léopold hier à 7 heures et tout à l’heure. Je suis content de ma conversation. J’espère qu’il m’aidera bien. Il comprend très bien la situation de la France. Il a plus d’esprit dans les grandes choses que dans les petites. Il devait partir demain 20 ; mais, il restera jusqu’à samedi 28 et plus longtemps s’il le faut. Je le laisse parler et agir. Je lui ai bien expliqué que mon attitude à moi, C’était l’attente, l’attente froide et tranquille. Nous sommes en dehors. Nous restons en dehors, jusqu’à ce qu’en dedans on sente et on nous dise qu’on a besoin de nous. Je ne change donc rien à mes premiers projets. Je retourne à Londres demain matin. L’affaire d’étiquette s’est passée hier comme nous l’avions prévue. On a coupé le différend par la moitié. J’ai donné le bras à la Princesse de Hohenlohe et je me suis placé à la gauche de la Reine, qui avait le Roi, Léopold à sa droite. Le Prince de Hohenlohe qui avait passé avant moi donnant le bras à la duchesse de Kent, était au dessous de moi à table. Mais au retour, j’ai repris la moitié que je n’avais pas eue en allant. Il n’y avait point de femme, personne ne donnait le bras à personne. Je me suis arrêté à la porte de sa salle à manger pour me faire présenter au Prince de Hohenlohe qui y arrivait en même temps que moi, et la présentation faite, j’ai passé devant lui en rentrant dans le salon. J’en ai fait autant en passant d’un salon dans l’autre. Ainse j’ai exercé tout mon droit. A dîner la Reine et la famille royale ont été, pour moi, particulièrement aimables. A glass of wine avec le prince Albert, le roi Léopold et la Reine elle-même, d’une façon marquée. Lord Melbourne et Lord Palmerston comme à l’ordinaire. Lady Palmerston gracieuse avec empressement ; tout à l’heure à déjeuner, elle se désolait du mauvais temps ; elle s’était promis de me faire faire une jolie promenade de me montrer Virginia-water.
- Mais le temps se lèvera, certainement il se levera.
- Prenez garde, Mylady ; je prends les promesses au sérieux. Lord Palmerston intervient, de l’autre côté de la table.
- Je donne ma garantie ; je suis sûr qu’il fera beau. Je me retourne vers sa femme.
- Lord Palmerston est bien heureux ; il est sûr avant. Moi, je ne le suis qu’après.
Adieu. J’attends Herbet, dans trois quarts d’heure. Je vous redirai adieu.
P. S. Voilà votre lettre. Je ne réponds à rien qu’à Adieu. A demain, entre midi et une heure.
415. Calais Mardi 8 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
le 8 Septembre 1840
J’arrive il y a une demi-heure. J’ai été bien malade en mer. Je me reposerai ici une heure et puis Boulogne. J’ai pris Calais parce que le bateau partait une demi-heur plus tard que celui de Boulogne, et qu’il y avait possibilité d’avoir ma lettre. On me l’avait promis pour de l’or si je restais jusqu’à 7 heures J’ai trouvé mon or bien placé. J’ai lu, j’ai tenu sur mon cœur, je viens de relire. Merci. Merci. La poste part dans 5 minutes. je ferme ceci. Vous aurez donc tous les jours de mes nouvelles. Je ne suis pas si heureuse.
Adieu. Adieu. Je n’ai pas fermé l’œil de toute la nuit et j’hésitais bien à partir car je ne me sens pas bien. J’ai fait lever le docteur, il m’a dit que ce ne serait rien. Je vous écrirai de Boulogne. Adieu mille fois.
406. Londres, Mardi 8 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Je crois que c’est une habitude que je prends. Je me réveille à 6 heures et ne me rendors plus. Il fait un temps admirable. Je regarde les arbres de mon square. J’ai un souffle qui remue les feuilles. C’est bien ce qu’il vous faut ; vous êtes aussi délicate qu’une feuille. Point de vent qui vous agite et du soleil qui vous plaise ; je ne ferais pas mieux, si je faisais le temps. Le courrier que j’ai fait partir hier soir m’a dit que la marée était ce matin à 5 heures. Il ne comprenait pas pourquoi je le lui demandais. Vous ne passerez pas, je pense par cette marée là, vous attendrez la seconde. J’ai employé doucement ma soirée d’hier. Seul dans ma chambre, de 5 heures et demie à onze heures, j’ai classé vos lettres par année, par mois, par lieu de séjour, chaque mois dans une grande enveloppe.
A onze heures j’ai eu Charles Greville qui revenait de Holland-House où il avait dîné avec Bourqueney On y était fort agité, fort troublé, comme à la Bourse, comme partout dans Londres hier, c’est-à-dire partout où l’on pense à ce qui se passe. Napier devant Beyrouth, sommant les Egyptiens d’évacuer la Syrie, le 14 août, deux jours avant que Riffat Bey eût notifié à Alexandrie, au Pacha les propositions de la Porte cela paraissait monstrueux, et très alarmant. Les Rothschild étaient inquiets au dernier point, inquiets au point de contremander une partie de chasse qu’ils avaient arrangée pour ce matin, ne voulant pas s’éloigner aujourd’hui de Londres. Mais vous en saurez, sur tout cela, plus que je ne puis vous en mander. Vous aurez le haut du pavé sur moi pour les nouvelles. Elles passeront par vous pour venir à moi. Il me semble que les ouvriers s’apaisent un peu. J’y regarde bien plus attentivement depuis hier. En soi ce n’est rien ; mais, c’est bien assez pour vous agiter. Quand quelque chose de ce genre vous préoccupera, faites venir tout de suite Génie ; il vous dira exactement ce qui en est. Et pour peu que vous en ayez besoin ou envie, M. de Rémusat. S’il peut vous être bon à quelque chose, il en sera charmé.
Moi, je le suis qu’il n’y ait plus rien que de convenable entre vous et Paul. Son voyage à Paris consolidera et améliorera. Il s’y plaira près de vous. Faites avec lui comme il faut faire avec les hommes en général ; attendre peu, et demander moins qu’on n’attend. Quelque douceur rentrera, dans votre relation redevenue convenable.
2 heures
Malgré le retard de ma lettre, je suis bien aise que vous soyez partie ce matin, par ce beau temps. Vous partiez au moment où j’ouvrais ma fenêtre où je saluais le soleil pour vous. Vous êtes depuis longtemps à Boulogne, peut-être déjà repartie pour Paris. Je le voudrais. C’est que la mer ne vous aurait pas fatiguée. Ma pensée vous suit partout. Dieu est bien heureux. Il est toujours à côté de ceux qu’il aime. Je garde ma fleur de Stafford-House morte comme vive. Dimmanche soir, je l’ai serrée dans mon portefeuille, à côté d’un petit sachet noir qui contient autre chose, encore plus précieux qu’elle. Le lierre ira là aussi, quand j’aurai bien joui de ce qu’il m’a apporté. J’écris beaucoup ce matin. Si je puis sortir à temps vous aurez aujourd’hui votre chêne. Sinon demain. Il n’y a point de petit plaisir. Je viens de revoir les Rothschild toujours très inquiets de ce que leur oncle écrit de Paris. Pourtant la partie de chasse se reprend demain. Inquiet ou non, il faut que la vie aille, et qu’on s’amuse. J’attends avec impatience votre impression sur Paris. J’ai presque autant de confiance dans votre jugement que dans autre chose ; presque.
4 heures
J’ai parcouru Regent’s Park, les jardins clos au bout de Portland Place. Pas un chène, ni jeune, ni vieux. Enfin j’en ai trouvé un dans le Regent’s park du public. Voici sa feuille. un peu passée. L’automne approche. Les feuilles passent ; mais tout ne passe pas comme elles, quoiqu’on en dise. C’est la prétention vulgaire que ce qui est rare ne soit pas possible. Il y a un plaisir profond à lui donner un démenti. Adieu. J’ai bien peur de n’avoir rien demain. A présent, je vous veux à Paris, bien reposée. Adieu. Adieu. Infiniment.
418. Poix, Jeudi 10 septembre 1840, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous ai écrit au moment de mon coucher, je vous écris à mon lever. Toujours toujours penser à vous ; vous parler on vous écrire selon que le ciel ordonne que ce soit l’un ou l’autre. Voilà comme se passera ma vie. J’ai assez mal dormi bien du bruit. Je serai d’assez bonne heure à Paris, je laisserai ceci à Beauvais Faites-moi le plaisir de dire à votre maître d’hôtel, que c’est pour le 15 que Denay s’est engagé à venir me trouver à Paris. S’il était encore à Londres il l’en ferait souvenir.
Je serai curieuse demain d’en tendre du bavardage. Je lis les journaux en route en attendant et je trouve qu’il y a bien de la confusion. C’est probablement là le régime auquel sera livré le monde pour longtemps.
Beauvais midi. N’est-ce pas que vous avez eu une lettre de moi tous les jours ? Je suis à la 6 ème depuis Londres. Je m’arrête ici pour manger et boire de votre vin. Je viens de parcourir le Constitutionnel de hier 9. C’est assez bien répondu aux Débats. Au reste vous n’attendez pas des commentaires politiques de Beauvais ?
Adieu. Adieu. Voilà le couvert mis, c’est important pour un voyageur et j’ai faim. Adieu. Adieu mille fois. God bless you que dit-on à Londres de Napier. Adieu
408. Londres, Mercredi 9 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
J’ai fait ce matin quelques visites. J’ai vu notre amis Dedel, toujours très bon et très sensé. Je lui ai porté mes plaintes sur Napier n’ayant pu trouver dans Londres un ministre anglais à qui les adresser. J’avais passé chez Lord Clarendon le seul membre du Cabinet qui réside. Il n’y était pas. Il sort de chez moi, et je lui ai dit comme s’il avait été Lord Palmerston ou Lord Melbourne tout ce que Napier m’avait mis sur le cœur. Il n’y a pas de réponse à cela. Lord Palmerston lui-même n’en trouverait pas. La guerre commencée en Syrie deux jours avant qu’on ait demandé au Pâcha de rendre la Syrie ! Voilà bien les incidents et les subalternes. Je ne sais ce qu’on me dira quand il y aura quelqu’un pour me parler En attendant les journaux même les plus hostiles au Pacha, le Standard par exemple, se récrient contre une telle légèreté ou un tel manqué de foi. On verra ce que c’est que d’entreprendre à 7ou 800 lieues et par toutes sortes de mains une opération bien plus vaste, bien plus compliquée, bien plur longue que cette expédition de Belgique que nous avons eu tant de peine à conduire à bien, sous nos propres yeux et de nos propres mains.
Jeudi 6 heures et demie
Je m’éveille. Achevez. J’ai eu hier quelques personnes à dîner. Rien. Après dîner, j’ai joué au whist. Quelle décadence. C’est demain que je commence à rester chez moi le soir, mardi et vendredi. J’achète une seconde table de whist, des échecs. Je fais venir du Val-Richer mon tric-trac. On ne trouve pas un tric-trac dans Londres. Je n’aurai pas mes deux soirées par semaine à Holland house. Ils vont décidément à Brighton pour quinze jours. Cependant Lady Holland va mieux. Lord John est retourné à Windsor. La Reine ne voulait pas qu’il en sortit, même pour un jour. Pourtant quand elle a su que c’était pour dîner avec moi, elle a dit : " A la bonne heure. Je crois que la Reine a grande envie de la paix. Lord Clarendon est invité à Windsor pour vendredi, la première fois. Lord Holland n’y a pas encore été invité. On en a de l’humeur. On s’en prend à qui de droit.
Lord Tankerville a été opéré hier matin, avec plein succès, dit-on. On n’en sera tout-à -fait sûr que dans quelques jours. Dites-moi ce qu’il y a de réel dans le succès de l’opération sur les yeux de votre nièce. Je déteste la loucherie. Je penserais avec plaisir qu’on a trouvé un moyen de la chasser de ce monde. Je n’ai pas eu hier de lettre du Val. Richer. Je m’en prends aux désordres des ouvriers dans Paris. Je sais que le service des postes en a été un peu dérangé. J’attends encore plus impatiemment le courrier de ce matin. Je n’ai pas besoin d’un redoubement d’impatience. Qu’a donc été votre si mauvaise nuit à Douvres que vous ayez hésité à partir ? Il ne faut pas dire des choses pareilles, cela donne des pensées abominables. Au moins ne soyez pas malade loin.
Midi
Votre fatigue me préoccupe beaucoup. Je m’y attendais. Mais qu’importe ? Vous ne vous réposerez qu’à Paris. Tout y est tranquille. J’ai reçu ce matin une bonne lettre de Thiers. Il paraît que malgré Napier, les syriens n’ont pas envie de se faire égorger pour faire plaisir à Lord Palmerston. Tout optimiste que je suis, je ne le suis pas tant que d’autres. Je trouve qu’on est déjà bien engagé. Je crains toujours les coups fourrés et soudains. Pourtant il est sûr que jusqu’ici tous les mécomptes ont été d’un seul côté. Où aurez-vous couché hier ? A quelle heure arrivez-vous aujourd’hui à Paris ? Je me fais cent questions; et j’ai beau savoir que je ne trouverai pas la réponse; je recommence toujours. Adieu. Adieu. Adieu.