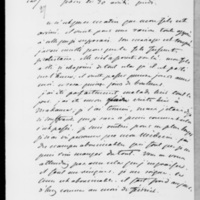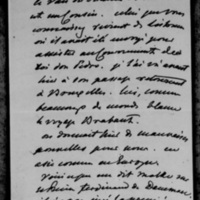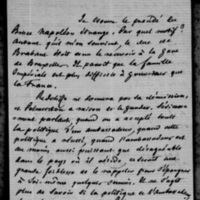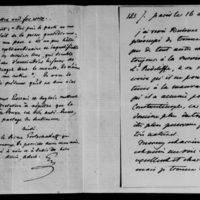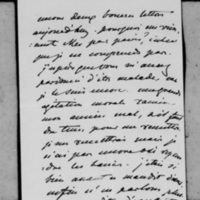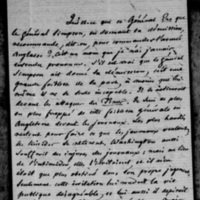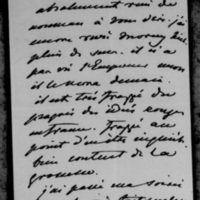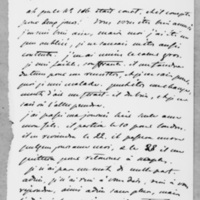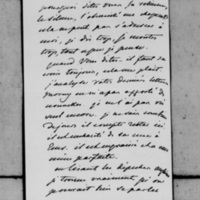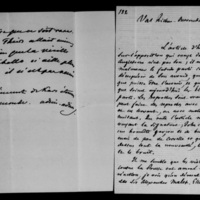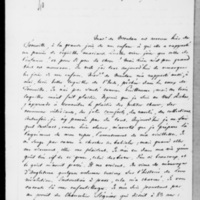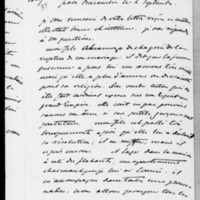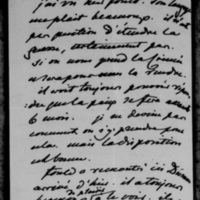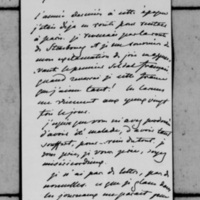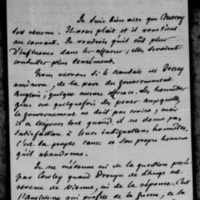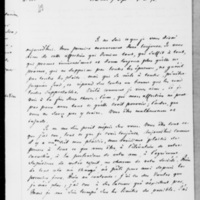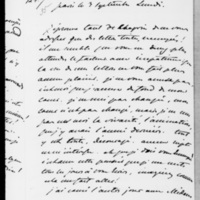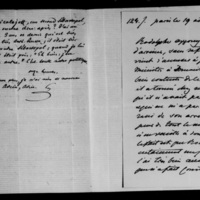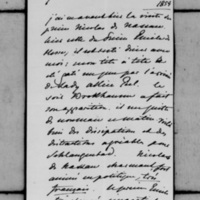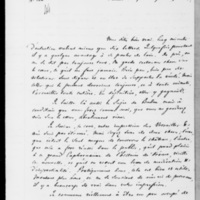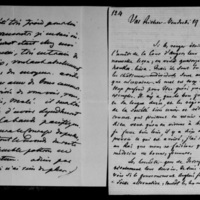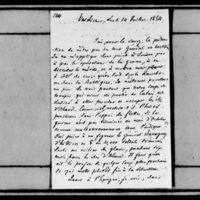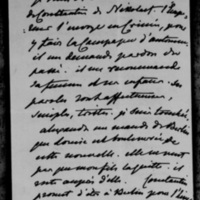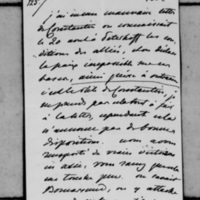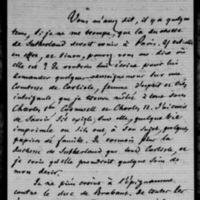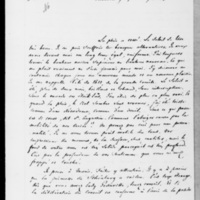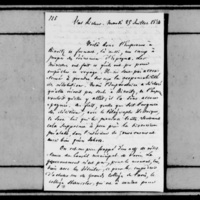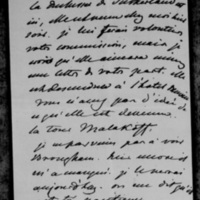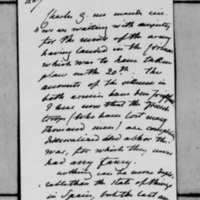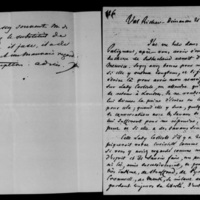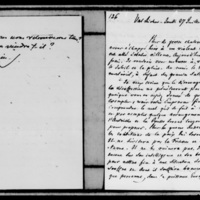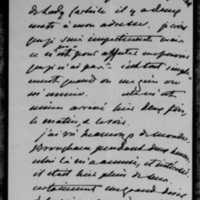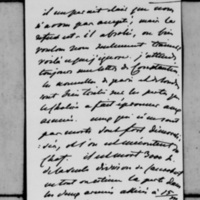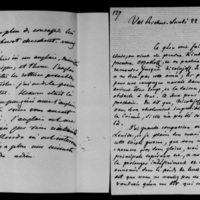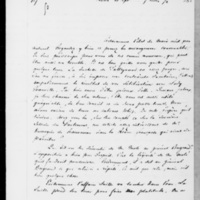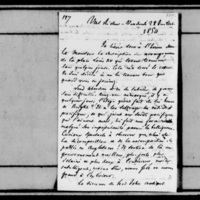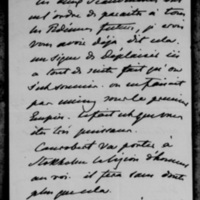Votre recherche dans le corpus : 6062 résultats dans 6062 notices du site.
120. Paris, Jeudi 30 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ce n’est que ce matin que mon fils est arrivé. Il vient pour une raison toute opposée à celle que je supposais. Son mariage est rompu. J’avais insisté pour que les fils fussent protestants. Elle ne l’a point voulu. Mon fils a été si chagriné de tout cela qu'il est parti sur l’heure ; il vient passer quinze jours avec moi. Ce sera quinze jours de bonheur. J’ai été parfaitement malade hier tout le jour. J’ai été encore faire visite hier à Madame, je l’ai trouvée mais j’étais déjà si souffrante que je sais à peine comment cela s’est passé. Je suis rentrée pour ne plus bouger. Je n’ai vu personne que mon médecin. J'ai des crampes abominables qui font que je ne puis rien manger du tout. Vous ne vous attendrez pas avec cela que j’engraisse. Il faut me résigner. Je me soigne. Le temps est abominable. Il fait froid aujourd’hui comme au mois de février.
La Duchesse de Talleyrand arrive demain, à ce que m’a dit Madame. Elle a des affaires pressantes importantes. On dit que son mari lui dispute la tutelle de sa fille, & qu'aux termes de la loi il a raison. Vous voyez que vous jugez bien en me parlant de l’archevêque. Son discours au Roi n'était pas du tout ce qu’il devait être. Je pense qu’on est très fâchée contre lui. J'écris à mon mari et à mon frère. A l’un et à l’autre je promets d’aller en Angleterre en juin. Pardonnez-moi si je vous quitte, je vous assure que je suis tout à fait malade. Je n'ai la force de rien faire. Adieu. Adieu. Avez-vous lu le discours de Berryer à des écoliers je ne sais où ? Il leur recommande beaucoup le latin & le grec. Adieu.
Remerciez je vous en prie M. Génie, on n’a pas dit un mot de moi.
Mots-clés : Politique (France), Santé (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
120. Paris, Lundi 15 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le van de Stratten de Madrid. est un cousin. Celui que vous connaissez revient de Lisbone où il avait été envoyé pour assister au courronement du roi don Pedro. Je l’ai vu avant hier à son passage retournant à Bruxelles. Lui, comme beaucoup de monde, blâme le voyage Brabant.
On donnait hier de mauvaises nouvelles pour nous. En Asie comme en Europe. Voici ce que me dit Molke sur le Prince Ferdinand de Danemark. Il n’a pas juré la première constitution, il ne veut pas davantage prêter serment à la seconde parcequ'il se réserve le droit d'abolir l'une & l’autre quand il sera roi. Voilà le secret, de son refus. La Constitution actuelle est beaucoup moins démocratique que la première. J’étais restée trois jours sans voir Molke. Voilà pourquoi ma réponse vous arrive si tard. Montebello est enfin revenu mais il croit sa mère mourante. Ce qui fait que je le verrai peu, le remplaçant provisoire de Hazfeld absent, est beaucoup plus causant que lui. La légation ne l’aime pas & se méfie de lui, & Hazfeld, le déteste, ça m’est égal.
Les diplomates ne sont pas pris à St Cloud pendant le séjour Brabant. Il y eu cependant trois spectacles. Adieu. Adieu.
120. Schlangenbad, Lundi 21 août 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai passé par toutes les angoisses. Voici deux lettres. j'ai d'abord remercié Dieu. Je l’avais tant invoqué. Pour vu que vous soyez en vie j’aurai bien joui que vous me conserviez votre affection. Mon Dieu que j’ai souffert !
J’allais écrire par télégraphe, mais à qui, où ? Vous n’avez pas de ligne le télégraphique, & fois mes amis sont absents de Paris. Ah quelle angoisse, j’ai éprouvée. Je vous en prie n’aller plus à Trouville. Soignez-vous.
Mardi 22. J’ai dormi vous êtes vivant. Si vous savez tout ce qui se logeait dans ma tête. Un accident de voiture, le roi de Saxe une indigestion, le choléra, sans compter la Duchesse de Galliera. J’ai bien souffert et je ne suis pas remise encore de cette secousse. Ne m'en donnez plus. J’étais folle. Ma joie en voyant vos lettres était aussi extravagante que mes inquiétudes. J’ai fait des largesses à Emilie, à tout ce que je rencontrais, j’avais besoin de donner de la joie à d’autres. Finissons parlons d’autre chose. Voilà Bomarsund pris. Je vous ai toujours dit qu’Aland serait la première victime. Peut être sera-t-elle la seule de ce côté. C'est une position très avantageuse. Nous n’avions pas de quoi la défendre. 2 contre 11, cela ne va pas.
On dit que l'expédition sur la Crimée est ajournée à cause des chaleurs. Mais on savait bien d’avance qu'il fait chaud en été. Les journaux allemands parlent de mésintelligences diplomatiques en Orient.
La Prusse décidément nous reste. L'Autriche ne se battra pas contre nous. Il y a encore des échanges de dépêches et la conférence de Vienne ne se réunit pas encore. Attendons, c’est un plaisir que nous nous donnons depuis assez de temps. Je n’ai donné à personne le droit de dire que je reviendrai bientôt à Paris. Le droit ardent, il y est, Dieu le sait, mais voilà tout.
Si le prince Worosow se tait et surtout se bouche les oreilles, sa femme les ouvre et jase. Elle est assez cosaque aussi, mais avec tant de douceur et de gentillesse qu’on ne peut jamais disputer. Elle me plait et elle mériterait d’avoir l’esprit plus éclairé sur ce qui se passe. Je ne me mêle pas de faire son éducation. Adieu, adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Angoisse, Armée, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Femme (diplomatie), Femme (éducation), Femme (portrait), Femme (santé), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Autriche), Politique (Prusse), Politique (Russie), Portrait, Salon, Santé (François)
120. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le procidé du Prince Napoléon étrange. Par quel motif ? Autant qu’il m'en souvient, le Duc de Brabant était venu le recevoir à la gare de Bruxelles. Il paraît que la famille Impériale est plus difficile à gouverner que la France.
Redcliffe ne donnera pas sa démission, et Palmerston a raison de le garder, sérieuse ment parlant quand on a accepté toute la politique d’un ambassadeur, quand cette politique a réussi, quand l’ambassadeur est au moins aussi puissant que désagréable dans le pays où il réside, ce serait une grande faiblesse de le rappeler pour s’épargner à soi-même quelques ennuis. Il ne s’agit plus de savoir si la politique et l’ambassadeur sont bons ou mauvais ; Palmerston est marié, à l’une et à l'autre, et il faut qu’ils vivent ensemble, for better and worse.
Reeve m'écrit : " J’ai pris le parti de me retirer tout-à-fait de la presse quotidienne. Cette décision de ma part a été un peu hâtée par la conduite extraordinaire et inqualifiable, du Times, dans les derniers temps, qui semble avoir pris à tâche d’amoindrir les forces de ce pays et d’outrager tout le monde. Je n'aime pas cela et je me retire." Je vous le dis parce que je présume qu’il est bien aise qu’on le sache.
Les journaux Ecossais et Anglais mettent une grande affectation à répéter que le Prince royal de Prusse est très anti-russe, et que son fils partage ses sentiments. Midi C'est sans le Prince Gortschakoff qui défraye ces journaux. Je persiste dans mon avis. J’ai été accoutumée à voir et à subir de bien autres mensonges. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Armée, Circulation épistolaire, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Presse, Réseau social et politique, Salon
120. Val-Richer, Mardi 4 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mots-clés : Discours du for intérieur, histoire, Vie familiale (François)
120. Val Richer, Mercredi 19 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement, on pourrait se parler, et il y a, dans votre réponse aux dernières ouvertures de l’Autriche, de quoi arriver à la paix. Mais on n’y arrivera pas ; on est de part et d'autre sous le poids des fautes passées et des arrières-pensés d'avenir. On ne voulait pas de la guerre qu’on se fait, et aujourd’hui, quand on parle de paix, on veut autre chose que ce qu’on se dit. Sans nécessité, par imprévoyance et malhabileté, contre le voeu naturel des peuples et des gouvernements eux-mêmes, on a laissé se poser publiquement, avec éclat, deux questions énormes, la question de la lutte entre les gouvernements libéraux et les gouvernements absolus, et la question de prépondérance entre l’Angleterre et la Russie en Europe, et en Asie. Que fera-t-on de ces deux questions dans la paix qu’on peut faire aujourd’hui ? Evidemment on ne les résoudra pas, on n'en fera pas même entrevoir la solution. Il faut rétrécir et abaisser infiniment, les négociations pour arriver à un résultat, il faut fermer les perspectives qu’on a ouvertes, arrêter les esprits qu’on a lancés, ramener les choses et se réduire soi- même à de très petites proportions après avoir tout exagéré, enflé, soulevé. C'est bien difficile, et je n'ose pas espérer, pour arriver maintenant à la paix, un degré de sagesse, de prévoyance, de mesure et de fermeté bien supérieur à ce qu’il en aurait fallu pour éviter la guerre. Voilà, mon inquiétude et ma tristesse. Je n’y échappe. qu'en espérant que la fardeau des questions soulevées sera trop lourd pour ceux qui ont à le porter, gouvernements et peuples, et qu'à tout prix, ils s'en débarrasseront plutôt que d’y succomber avec un éclat honteux. Nous ne sommes pas dans un temps de grands desseins, ni de grandes persévérances. On peut sortir, par faiblesse du mauvais pas où l’on s’est engagé par maladresse. Dieu veuille qu’on soit aussi faible qu'on a été maladroit.
En attendant nous allons apprendre quelque grosse bataille entre Giurgiu et Bucharest. Je doute que le gros de l’armée Anglo-Française, soit déjà là, mais il paraît bien certain que Canrobert était arrivé le 9 avec sa division, au quartier général d’Omer-Pacha.
Je suppose que c’est une bouffonnerie des journaux qui disent que votre Empereur a interdit l'enseignement du Français et de l'Allemand dans votre École militaire d'Orembourg pour y substituer celui du Persan, de l’Arabe, et du Tartare. Vous n'en êtes pas encore à quitter aussi l'Europe pour l’Asie.
J’ai des nouvelles de la Reine Marie Amélie. Lettre du pure amitié, en arrivant à Claremont. Elle me dit : " Je crois avoir fait un beau rêve de six mois, car rien n'a été plus satisfaisant et plus doux pour mon coeur que le temps que j'ai passé à Séville ; le bonheur que j'y ai éprouvé et la douleur et la beauté de ce délicieux climat ont rétabli ma santé qui est tout à fait bonne. " Pas un mot, comme de raison, des troubles d’Espagne qui s'aggravent évidemment.
Midi
J'ouvre d’abord votre lettre, puis mes journaux. Est-il vrai que le Général [?] se soit suicidé ? J’espère G.
121. Paris, Mardi 16 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai revu Bulwer hier. Plus préoccupé de trouver un poste que de tout autre chose. Il vient toujours à la survivance de Lord Redcliffe, & on s'obstine à croire qu’il ne pourra pas tenir à la mauvaise situation qu'il a amené pour lui à Constantinople, car il n'y donne plus du tout. Vous êtes plus puissants que lui, c’est très naturel.
Morny est arrivé hier. Il est venu me voir de suite. Excellent et charmant. Mais je trouve trop en poltronerie de l'Angleterre. c.a.d. lacheté devant elle de qui l’Empereur Napoléon. A-t-il besoin d’avoir peur au jourd’hui ? Tout le monde a peur de lui. Ecoutez la duchesse de Talleyrand, elle vous dira bien à quel point il règne en Allemagne, par la terreur, par l’admiration aussi, car on sait reconnaître son grand mérite.
J'ai vu hier Hubner. Assez curieuse révelation. Il m’a dit que dans le temps de l'affaire de Drouin de Luys, Cowley avait posé ici l’alternative. L'amitié de l'Angleterre ou l’amitié de l'Autriche. ou après l'Angleterre. Quand on nomme Drouin de Lhuys, c’est toujours de la part de tous avec regret. & respect. Vous ai-je dit que Madame Thiers est bien dangereuse ment malade. Adieu. Adieu.
121. Paris, Vendredi 31 août 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
En effet il ne m’est point venu de lettre ce matin. Cela me parait singulier et cela me parait triste. La journée sera lorsque. Au lieu d'une lettre de vous j'ai lu votre discours à la société des antiquaires. C’est beau et les dernières sentences. sont admirables. Vous produisez toujours de grands effets. Et j'aime les beaux finales (dit-on beaux ou belles ?) dans les morceaux d'éloquence comme en musique.
Je vais mal, toujours mal. Hier au soir il a fallu me faire frotter pendant plus d’une heure dans mon lit et me couvrir de trois grands châles avant de pouvoir me réchauffer. J’étais comme une glace. Je ne mange rien. Je ne sais ce que j'ai. Le médecin dit que c’est le temps. Je suis beaucoup maigrie. Tout mon monde ordinaire est venu hier au soir. Mon fils me dit que Naples vous envoie enfin un ambassadeur. Le vieux comte Ludolf père de Mad. de Stakelberg, il y a 25 ans qu'ils sont à Londres. Le mari et la femme sont des ennuyeux que j’ai toujours bien mal traités. Ah que j’étais difficile à Londres ! La cour part demain. Le Roi a eu la bonté de faire donner des ordres à Versailles pour moi. Je crois que j’y irai cette semaine avec mon fils ; mais rien que pour une matinée. No ever whatever. and no letters. Adieu. Je pense beaucoup à vous beaucoup. Adieu.
Si la Suisse refuse votre demande. L'Autriche rappellera son ministre.
Mots-clés : Diplomatie, Enfants (Benckendorff), Mandat parlementaire, Santé (Dorothée)
121. Schlangenbad, Jeudi 24 août 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Encore deux bonnes lettres aujourd’hui. Pourquoi me viennent elles par paires ? C’est ce que je ne comprends pas. J’espère que vous m’aurez pardonné d’être malade, car je le suis encore. Une grande agitation morale ramène mon ancien mal, & il faut du temps pour me remettre. je me remettrai, mais je n’ai pas encore osé reprendre les bains. J’étais si bien avant ce maudit diner. Enfin n'en parlons plus. Vous me dites, d’excellentes choses sur la nécessité de s’arranger. Je les fais passer plus loin, je crois toujours que cela a son utilité. Cela ne va pas tout [?], mais presque. Il est évident que le choléra vous a fait perdre beaucoup de monde. Les journaux Anglais disent 7000 hommes. Ce serait énorme.
Bomarsund peut cependant décider la Suède. Sous ce point de vue la capture serait importante.
4 heures
Voici une troisième lettre de Mardi 22. Le surlendemain nouvelles de Vienne. Cela ne m’est jamais arrivé. Quelle belle journée. Que vous êtes doux & bon pour moi. Quelle dommage que je vous sois si inférieure en raison. Comme je me porterais mieux, et comme je vous plairais davantage !
Comme l'absence est rude, sur de choses intimes j’aimerais à vous dire, tout juste sur ma déraison. J’ai la confiance que cela vous toucherait et que vous me pardonneriez tous mes pêchés passés et futurs. Je n'ai rien de Russie du tout. On me dit par voie indirecte, qu'à Pétersbourg on se tenait préparé également à la paix, ou à la guerre, on attendait les nouvelles de Vienne.
Il fait bien froid ici. 7 degrés la nuit et bien peu de plus le jour. Adieu. Adieu.
Voilà Morny arrivé, j’en suis charmé. Mais je n’ai pas de quoi l’amuser.
121. Val-Richer, Mardi 16 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quest-ce que ce général Ere que le général Simpson, en donnant sa démission, recommande, dit-on, pour commander l’armée Anglaise ? C’est un nom que je n’ai jamais entendu prononcé. S'il est vrai que le général Simpson ait donné sa démission, c’est une grande faiblesse de sa part, à moins que lui- même il ne se sente incapable. Il se retirerait devant les attaques du Times. Je suis de plus en plus frappé de cette faiblesse générale, en Angleterre devant les journaux. Les plus hardis restent pour faire ce que les journaux veulent ; les timides se retirent. Washington aussi souffrait des injures des journaux ; mais au lieu de l’intimider, elles l'irritaient et il n’en était que plus obstiné dans son propre jugement. Seulement cette invitation lui rendait la vie publique désagréable, et lui aussi, il aspirait à la retraite. C'était là sa faiblesse. Mais il ne se retirait qu'après avoir vaincu. Je ne connais pas de meilleur exemple pour les hommes de notre temps que celui de Washington ; il servait une grande société démocratique, mais il la servait avec autant d’indépendance que de fidélité, un aristocrate honnête et fier, n'ayant et ne faisant point d'autres affaires, que celles du peuple, mais décidé à les faire toujours, selon son bon sens, non selon la fantaisie populaire. Sinon, non.Seule situation digne, auprès des peuples comme des rois. Et aussi la seule efficace, quoiqu’elle ne le soit pas toujours.
Je ne comprends pas Lord Cowley, avec ses compatriotes. A moins qu’il n’y ait de leur part à eux, c’est-à-dire de la part de la plupart pas plus d'envie de le voir, lui, qu’il n'en a de les voir, et d'aller à la cour que lui de les y mener. S'ils le voulaient bien ils le feraient vouloir à Lord Clarendon, qui le ferait vouloir à Lord Cowley.
Combien de temps peuvent durer encore les opérations de guerre en Crimée ? A en juger par le grand nombre de troupes qu’on y envoie, il faut qu’on croit pouvoir agir. encore pendant deux ou trois mois. Si on était sur le point de prendre des quartiers d'hiver on ne se presserait pas tant de faire partir tant de régiments pour aller les prendre en Crimée, où ils sont infiniment plus chers. Je me figure qu’il y aura encore de grands coups ports ou tentés avant qu’on se repose.
Je serais assez curieux de savoir s’il se trouvera une compagnie sérieuse pour faire le chemin de fer que propose la Porte, de Belgrade à Constantinople. C'est l’Autriche qui y gagnerait le plus ; mais elle n’a pas d'argent à jeter là.
Onze heures
Merci de vos renseignements très précis. Je vais répondre au Vanderstraten que je ne connais pas. Adieu, adieu. G.
121. Val-Richer, Mercredi 5 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Plus j’y pense, plus je suis d’avis que vous alliez à Baden. Evidemment vous ne sortirez de cette mauvaise position que par vous-même en voyant et causant. Et M. de Lieven ne vous fournira pas l’occasion de voir et de causer, car il ne viendra pas vous chercher. Médem a raison. Il faut que l’Empereur lui ait prescrit le silence. Le retrait des subsides ayant échoué, on veut essayer l’abandon de la personne. Vous romprez toutes ces combinaisons-là en marchant dessus, comme on dit à la guerre. La circonstance est favorable. Le grand Duc et M. de Lieven doivent passer à Baden quelques semaines. Vous aurez du temps pour tout expliquer, tout arranger. Vous ferez rentrer le grand Duc dans votre intimité. Vous avez Alexandre qui pourra, je pense, vous accompagner. Le voyage n’est pas long. La saison est encore bonne. Il ne se présentera peut-être de longtemps une occasion de tous points aussi propice pour mettre fin à une situation si pénible. Et après tout, Baden n’est pas un pays barbare. Il a fallu l’Empereur Napoléon pour y enlever le duc d’Enghien. L’Empereur Nicolas ne vous y traitera pas de cette sorte. On vous pressera d’aller en Italie, de retourner en Russie, que sais-je ? Mais en définitive, vous ne ferez que ce que vous voudrez. Et peut-être, le changement de lieu, la nouveauté de la situation, la nécessité de la résistance, vous rendront quelque chose de cette animation de cette énergie intérieure que vous ne pouvez retrouver. Cela vaut la peine d’être tenté et il y a bien des chances de succès. Et enfin vous passerez avec un peu de mouvement un mois, deux mois. Le temps vous pèse. Il est si lourd quand il est vide !
Si la situation actuelle devait se prolonger jusque l’été prochain jusqu’à votre voyage annoncé en Angleterre, je ne sais comment, vous la supporteriez. J’ai cherché, je cherche comme vous me le demandez. Je n’ai pas plus d’invention. J’arrive toujours à reconnaître que vous n’avez, auprès de l’Empereur, ni auprès de votre mari, personne qui sache vous servir et que vous seule pouvez quelque chose pour vous-même. Vous avez fait tout ce qui se pouvait faire de loin et par écrit. Cela ne suffit pas. Il faut aller à l’assaut. Êtes-vous en état ? Le voyage ne vous fatiguera-t-il pas trop ? Soutiendrez-vous les agitations de la lutte corps à corps ? Voilà mon inquiétude. J’espère pourtant. On est toujours plus fort quand on agit que lorsqu’on attend. Enfin, pensez-y et dites-moi ce que vous pensez.
M. Molé, qui ne faisait aucun cas des dires d’Horace Vernet, ne devait pas attendre grand chose du retour de M. de Pahlen. Je ne comprends pas qu’on se préoccupe de cette situation. Elle n’a point de danger, et elle cessera le jour où le moindre intérêt sérieux conseillera à l’Empereur de cesser. Il n’y a point là de passion vraie et entreprenante. On joue son rôle. Il y en a un à jouer de ce côté-ci, tout aussi fier et plus commode. Et en le jouant, on peut attendre à l’aise que le jamais s’évanouisse. Mais M. Molé ne le jouera pas.
10 h.
Il faut que la course de Versailles ne vous fatigue pas du tout pour que je lui pardonne si une lettre me manque. J’avais un peu prévu votre réponse sur l’Angleterre, car j’avais pensé aux absents. Je pense à tout ce qui vous touche. Adieu. Je ne sais pas, vous parler d’autre chose aujourd’hui. Adieu. G.
121. Val Richer, Jeudi 20 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis charmé que votre fils Paul vous ait rejointe ; avec lui de moins vous pouvez causer en liberté. Vous avez donc trouvé un logement à Schlangenbad. Si le ciel y est aussi pur et le soleil aussi chaud que nous l'avons ici depuis trois jours, ce doit être charmant.
Je ne prévois pas ce qui arrivera des affaires d’Espagne ; le bouleversement revient bien complet. Je penche à croire que la bombe éclatera encore cette fois sur la tête. de la Reine Christine, et non par sur celle de la Reine. Les insurgés, qui sont d'origine très diverse, auraient trop de peine à s'entendre sur quelque autre solution, si la Reine Isabelle disparaissait, la réunion au Portugal, la République, l'infante Montpensier tout cela est factice et combinaison du coterie ; il n’y a que deux partis sérieux. la Reine Isabelle et les Carlistes. Il ne me revient absolument rien de Narvaez ; je ne rencontre sans nom nulle part. Les chefs civils, et modérés du parti constitutionnel, Mon, Pidal, ont également disparu. Étrange pays dans un temps où tous les pays sont étranges.
Que fera le duc de Montpensier à Séville, si les insurgés y arrivent ? Je suis assez curieux de savoir qui sera, ou était à la tête de votre armée dans la grande bataille qui va être, ou qui a été, livrée entre Giurgiu, et Bucharest. Le Maréchal Paskevitch est-il réellement disgracié ? Il avait raison de ne pas se soucier de la guerre. Je m'étonne de plus en plus que pas un de vos grands Ducs ne soit à l’armée.
Ce n’est pas avec la Reine d'Angleterre, c'est avec le commodore Grey que l'Empereur Napoléon s'est rencontré à bord d’un vaisseau Anglais. Grand honneur pour le fils de votre ancien ami.
Midi
Adieu, adieu. Nous causerons demain, comme on cause de loin. G.
122. Paris, Mercredi 17 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Absolument rien de nouveau à vous dire. J’ai encore revu Morny hier plein de sens. Il n’a pas vu l’Empereur encore. Il le verra demain. Il est très frappé du progrés des idées rouges en France. Frappé au point d’en être inquiet bien content de la grossesse. J’ai passé ma soirée, hier tout-à-fait seule. C’est rare et je suis bien aise que ce soit rare. Mad. Thiers allait mieux Je crains que la vieille Montebello n’aille plus mal. Il n’est pas venu hier. L’événement de Paris étonne tout le monde. Adieu. Adieu.
122. Paris, Samedi 1er septembre 1838,Dorothée de Lieven à François Guizot
Ah que le N°116 était court, et il compte pour deux jours ! Vous vous êtes bien amusé, j'en suis bien aise, mais moi, j’ai été un peu oubliée, je ne saurais être aussi. contente. J’en ai même le cœur gros. Je suis faible, souffrante. Il me faudra du temps pour me remettre et je ne sais pour quoi je suis malade. Peut-être un change ment d'air me ferait il du bien, et je ne sais où l’aller prendre. J’ai passé ma journée hier, seule avec mon fils. Il partira le 10 pour Londres. Il en reviendra le 22 et passera encore quelques jours avec moi, & le 28 il me quittera pour retourner à Naples. Je n’ai pas un mot de nulle part. Adieu. Je n’ai rien à vous dire, rien à vous répondre, ainsi adieu sans plus, mais l'adieu n’est pas moins que de coutume.
122. Schlangenbad, Vendredi 25 août 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Pourquoi dites-vous la réticence, le silence, l’obscurité me choquent ? Cela ne peut pas s’adresser à moi, je dis trop, je montre trop tout ce que je pense. Quand vous dites il faut se croire toujours cela me plait. J'analyse votre dernière lettre. Morny ne m’a pas apporté de nouvelles. Je ne l’ai pas vu seul encore. Je ne sais combien de jours il compte rester ici. Il est enchanté de sa cure à Ems. Il est engraissé et a une mine parfaite.
En lisant les dépêches Anglaises je trouve vraiment qu'on pourrait bien se parler et je ne suis pas sans espérer que d’autres trouveront cela aussi. Qu’en pensez-vous ?
Le 26. Le choléra paraît avoir été terrible dans votre armée. On mande de Paris à Morny qu’on est plus que jamais content de l’Autriche.
Grande difficulté de se loger à Bruxelles et hausse de tous les prix de logement & & Je ne sais comment je vais faire pour me caser. A Bellevue pas de place. Ah quelle misère et cela quand je pense à mon charmant appartement à Paris ! On me refuse net à Bellevue.
Je n’ai point de lettres aujourd’hui de nulle part. Pour vous cela ne m'inquiète pas, il m’en viendra j’espère demain. Adieu. Adieu.
122. Val-Richer, Mercredi 17 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
L’article d’hier dans les Débats sur l'opposition qui essaye de s'organiser en Angleterre n’est pas bon ; il ne faut pas malmener le futur parti conservateur, ni désespérer de son avenir quelque éloigné que puisse être l'avenir, et quelque incohérents que soient aujourd’hui les éléments du parti. Les reproches sont vrais ; mais on peut faire des reproches avec bienveillance et en servant, ou avec malveillance et en nuisant. Du reste l'article ne m'étonne pas voyant la signature John Lemoinne est un honnête garçon et de beaucoup d’esprit mais de peu de cervelle et qui aime par dessus tout la nouveauté, le mouvement et le bruit.
Il me semble que les violences du Times, contre la Prusse ont amené un peu de réaction, je vois qu’on dément les brutalités de Sir Alexander Malet. Elles sont probablement très vraies, mais le démenti n'en vaut que mieux.
Les Turcs n'ont décidément de bonheur, que lorsqu’ils sont tout seuls en face de vous et vous, on dirait que vous les ménagez, et que vous ne voulez pas, même en vous battant, vous brouiller sans retour avec eux.
Soyez assez bonne pour remercier, de ma part, M. de Moltke d'avoir dissipé mon ignorance. Si j'étais Danois, je ne comptais pourtant guère sur ce que fera le Prince Ferdinand quand il sera roi ; il fera comme les autres ; il donnera ou acceptera au constitution, en tâchant de s'en tirer au meilleur marché possible. Les Rois ne sont aujourd’hui, ni fous, ni braves.
Avez-vous fait attention aux derniers document publiés à Turin et reproduits à Paris sur la tentative d'alliance contre vous, et dans l’intérêt de la Turquie, avant 1789 ? Ils font honneur à l’intelligence Piémontaise. L’analogie des situations est singulièrement frappante. Seulement était alors la France qui prenait l’initiative, dans un intérêt Français ; et l'Angleterre s'y refusait, tenant plus de compte de l’intérêt anglais d'alors que de l’équilibre Européen. La France a été plus désintéressée. aujourd’hui.
Onze heures
La cloche du déjeuner sonne. Adieu, adieu.
122. Val-Richer Jeudi 6 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mad. de Meulan est revenue hier de Trouville, à la grande joie de mes enfants, à qui elle a rapporté un panier de coquilles marines. Quelles vives joies que celles de l’enfance ! Et pour si peu de chose ! Mais rien n’est peu quand tout est nouveau. Du reste j’ai tort aujourd’hui de remarquer les joies de mes enfants. Mad. de Meulan m’a rapporté aussi, à moi trois belles coquilles de l’Inde, pêchées dans les eaux de Trouville. Je n’ai pas sauté comme Guillaume ; mais ces trois coquilles m’ont fait plaisir. Depuis que je suis au Val-Richer, J’apprends à reconnaître le plaisir des petites choses, des ornements intérieurs, des jolis conforts, des raretés, des collections. Autrefois, je n’y pensais pas du tout. Aujourd’hui je ne sais quel instinct, encore bien obscur, m’avertit que je prépare là l’agrément de mon repos, l’amusement de ma vieillesse. Je ne songe pas encore à chercher ces babioles ; mais quand elles me viennent, elles me plaisent. Je n’ai eu dans ma vie qu’un goût très vif de ce genre, celui des livres. J’en ai beaucoup, et le goût m’avait passé. Il me revient. On vient de m’envoyer d’Angleterre quelques volumes curieux sur l’histoire de leur révolution. Instruction à part, cela m’a charmé. Je vous raconte là mes enfantillages. Je n’en suis pourtant pas au point du Chancelier Séguier qui disait à 83 ans : " C’est bien heureux ; bien des gens ont eu envie de me réduire & personne n’a jamais su comment. Pourtant on l’aurait pu, avec de beaux livres bien reliés. "
Vous m’avez menacé de n’avoir pas de lettre ce matin. J’attends pourtant avec grande impatience votre avis sur le voyage de Baden. Je pense sans cesse à ce qui vous touche. Je donnerai tant pour vous voir sortir de votre mauvaise position et surtout de votre abattement qui est bien pis qu’une mauvaise position. Aucune heure ne se passe certainement dans la journée sans que je me demande comment vous avez passé cette heure-là qu’est-ce qui l’a remplie pour vous, qu’elle était votre disposition intérieure. Vous m’êtes une préoccupation constante. Si j’étais près de vous, ce serait une occupation. Cela vaudrait mieux. Le Duc d’Orléans vient de me répondre d’une manière très aimable. Il est très heureux. Il me parle beaucoup de son bonheur privé, et de la bonne étoile de son père, dont il espère bien hésiter. Je vois que l’Empereur est retrouvé. Cet hiver que le grand Duc va passer en Italie prolongera le séjour de votre mari auprès de lui. Je suis bien aise que ce jeune homme soit mieux. L’intérêt que vous lui portez m’a gagné. Et puis, j’ai envie de voir un Prince doux sur ce trône barbare. Quoique l’histoire de ce monsieur, qu’il a fait brusquement enlever du milieu du parterre pour lui faire couper la barbe, donne la mesure de ce qu’est de, même la douceur dans ce monde là.
10 h.
Si je suivais mon premier mouvement, le mouvement qui me presse, je serais fâché comme je ne l’ai jamais été ; je vous gronderais comme je ne vous ai jamais grondée. Comment ? Je fais sur moi le plus amer effort, vous me demandez depuis quinze jours quelque chose à faire, quelque chose absolument pour sortir d’une situation que vous ne pouvez plus supporter. Je vous indique, malgré moi, en m’oubliant moi, la seule chose qui me semble offrir quelque chance, puisque toutes les autres sont épuisées ; et vous me dites que je veux me débarrasser de vous ! Ah, Madame! Votre pénétration vous manque. Vous ne me connaissez pas ? Et moi aussi, je ne vous dis pas la moitié, pas la centième partie de ce que je sens. Si je vous le disais en ce moment, je vous affligerais beaucoup, je vous blesserais peut-être. Je ne le ferai pas. J’ai pour vous une pitié immense. Mais je vous aime encore plus que je n’ai pitié de vous. Voilà le mal. J’essaierai de vous plaindre plus que je ne vous aime. Adieu.
Je vous écrirai plus en paix demain. Il y a pourtant au fond de mon cœur, en ce moment même, une vive joie. Non, je ne vous envoie pas à Baden. Adieu. G.
122. Val Richer, Vendredi 21 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sacy (ou son rédacteur) a eu certainement tort ; la liberté des cultes existe en Russie ; elle a même, depuis longtemps été l’un des mérites de votre gouvernement, et l’un de ceux dont on l’a et dont il s'est avec raison, le plus vanté. Les Débats n'auraient pas eu tort s'ils avaient simplement dit qu’en sa double qualité de chef de la religion grecque et de souverain absolu, votre Empereur avait fait souvent, dans l’intérêt de l’unité de son pouvoir religieux comme politique, de la domination et de la propagande tyrannique, aux dépens des cultes non-Grecs de ses états Catholiques, Protestants, Juifs, en ont souffert et s'en sont plaints. Vous vous rappelez les religieuses persécutées, les Jésuites bannis, les Provinces Baltiques tracassées, les Juifs de Lithuanie transportés en masse. Il y a eu certainement là de quoi réclamer au nom de la liberté religieuse. Mais on ne s’inquiète jamais assez de savoir la vérité des faits et de ne parler que dans la mesure de la vérité. Je comprends qu’on se préoccupe des lenteurs de l’Autriche ; je n’y mets, pour mon compte que très peu d'importance ; je suis de l’avis de Gréville ; à cause de la Prusse, l’Autriche ne peut faire autrement. Le dénouement sera le même : ou bien vous vous déciderez à faire la paix, une paix désagréable pour vous, mais nécessaire, ou bien l’Autriche prendra décidément parti contre vous et la Prusse elle-même un peu plus tard. Au point et dans le courant où sont les choses, cela me paraît inévitable.
C'est étrange qu'Orloff ait été si insolent avec l'Empereur d’Autriche de deux choses l’une ou le comte Orloff n’a pas autant d’esprit qu’on lui en donne, ou s’il n'a fait qu’agir selon les instructions de votre Empereur, votre Empereur s'est bien trompé sur le caractère et la situation du jeune souverain auquel il avait affaire. Infatuation ! Infatuation. C'est la maladie des jolies femmes, des peuples en révolution et des souverains absolus. J’aurais certainement pris plaisir à causer avec votre jeune Prince de Nassau. Je me le rappelle, très bien. Ces deux ans passés à parcourir l’Amérique du nord, lui font honneur.
Onze heures et demie
Rien dans les journaux, ni du Danube, ni d’Espagne. Deux lettres de Paris qui ne m’apprennent pas. L'Impératrice n’est pas grosse puisqu'elle va prendre des bains de mer. Adieu, Adieu. G.
123. Paris, Dimanche 2 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous remercie de votre lettre reçue ce matin ; elle était bonne et intime. Je vais répondre à vos questions. Mon fils a beaucoup de chagrin de la rupture de son mariage. Il dit que la jeune personne a pour lui un amour très visible mais qu’elle a plus d’amour ou de crainte pour sa religion. Son oncle Acton qui va être fait cardinal exerce sur son esprit un grand empire. Elle croit ne pas pouvoir sauver son âme si ses petits garçons sont protestants. Mon fils est parti très brusquement après qu’elle lui a déclaré sa résolution ; il ne souffre, mais il espère encore. Il loge dans la maison à côté de Flahaut un appartement charmant que je lui ai trouvé. Il m’accompagne dans toutes mes promenades. Nous allons presque tous les jours à St Cloud. Longchamp depuis votre départ m’a paru bien ennuyeux.
Tout le monde parle de l’affaire de la Suisse sans comprendre comment elle finira. Louis Bonaparte y reste, cela est sûr. Pour le moment je pense que le rappel de l'Ambassadeur sera la seule mesure qu'on prendra, mais c’est peu de chose. Nous nous retirerons peut-être aussi tous les trois, mais les Suisses s’en consoleront. On s’étonne un peu que la Russie ait si vite et si fermement soutenue là dedans votre gouvernement. Mais c’est que, à part les caresses, vous nous trouverez peut-être meilleurs collègues que tous les autres. L’Empereur évite tout ce qui peut vous donner ombrage. Par exemple il n'a jamais reçu chez lui à Toplitz La Feronnays ou Marmont. Il ne les a vus qu'à leur promenade publique. Il a toujours beaucoup aimé M. de La Ferronays. M de Stakelberg a donné hier à dîner à mon fils qui a longtemps servi sous ses ordres. J’y ai dîné aussi & mon Ambassadeur & Médem. De là j'ai été à Auteuil. J’y ai trouvé M. Molé très entouré de la diplomatie. Il me dit qu’il est plus que jamais accablé de travail. Il a pris l’intérieur dans l'absence de M. de Montalivet. Il y avait hier plus de monde que de coutume à Auteuil. On ne sait pas où est l’Empereur de Russie dans ce moment. Il est attendu partout, et il ne parait nulle part. Le 15 Septembre lui & l’Impératrice seront. à Berlin.
Les derniers mots de votre lettre me plaisent et me font du bien. J'ai l’âme un peu moins triste depuis l'arrivée de mon fils, mais toujours ce silence inexpliqué de mon mari me donne beaucoup de chagrin. Je ne sais que penser, et l’avenir me parait abominable. Mon fils aîné me mande que si sa situation secondaire doit se prolonger il quittera le service, & pour ce cas l'idée de venir vivre auprès de moi est ce qui la donne le plus de plaisir. Adieu. Adieu. Adieu, trouvez-vous que c'est assez ? Par moi.
123. Paris, Jeudi 18 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier Fould. Son langage. me plait beaucoup. Il n'est pas question d’étendre la guerre, certainement pas. Si on nous prend la Crimée ce sera pour nous la rendre. Il croit toujours pouvoir répon de que la paix se fera avant Je ne devine pas 6 mois. comment on s’y prendra pour cela. Mais la disposition est bonne.
Fould a rencontré ici Dumon arrivé d’hier. Il a toujours de plaisir. beaucoup à le voir. Ils ont beaucoup causé surtout Ce qui ne m’intéresse pas. Agriculture, canaux, chemin de fer.
On a trouvé le spectacle à St Cloud avant hier très amusant, mais très leste. Les premières armes de Richelieu. Cela semble un épigramme à l’adresse du duc de Brabant. Je ne crois pas à l’intention. Je ne connais pas la pièce, je vais Du reste les la lire. Augustes visiteurs plaisent & se plaisent beaucoup ici.
Nouvelle lettre de Greville bien persuadé que les Français resteront à Constantinople quoiqu'il arrive, & trouvant la paix surtout difficile pour que les alliés ne pourront pas s’accorder entre eux. C’est un côté nouveau de la question ! Il me dit aussi la retraite de Reeve, et tonne contre Le Times à quoi cela sert il ? Adieu. Adieu.
123. Schlangenbad, Lundi 28 août 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
L'année dernière à cette époque, j’étais déjà en route pour rentrer à Paris. Je revenais par la route de Strasbourg et je me souviens de mon exclamation de joie en apercevant le premier Soldat Français. Quand reverrai-je cette France que j’aime tant ! Les larmes me viennent aux yeux vingt fois le jour.
J’espère que vous m’avez pardonné d’avoir été malade, d’avoir tant souffert pour rien du tout. Je vous prie, je vous prie, soyez miséricordieux.
Je n’ai pas de lettre, pas de nouvelles. Ce que je glane dans les journaux me parait peu encourageant pour la paix. maudite guerre.
Je passe mes soirées seule avec Morny et Cerini. Nous faisons de la musique. Il chante à ravir. Je vois dans la journée quelques orientaux (Worosow) et la tribu Pembroke. Ils n’aiment pas les rencontres du soir.
6 heures
Je crois savoir que l’expédition à Sébastopol ne se fera pas et que l’Empereur [priant] en conséquence à son cousin le prince Napoléon de revenir à Paris. Lui-même retournera à Bordeaux le 15 7bre pour chercher l’Impératrice.
[Cambest] fait avec 25 m hommes une expédition je ne sais où. L’Empereur d'Autriche a dit il y a huit jours au duc de Nassau qu’il ne pensait pas du tout à la guerre avec la Russie. On dit que M. Bach est tout puissant sur l’esprit de son maître, entre lui & Bual ils gouvernent l’Autriche. Le petit prince Nicolas de Nassau est venu me faire une visite aujourd’hui. Il a beaucoup plu à Morny et cela a été réciproque. Il est très impérialiste.
J’ai recommencé à me baigner hier, & je crois que Je me remets un peu de mon mauvais moment. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Autriche), Politique (Russie), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée), Tristesse
123. Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis bien aise que Morny soit revenu. Il vous plaît, et il vous tient au courant. Je voudrais qu’il eût plus d'influence dans les affaires ; elles seraient conduites plus sensément.
Nous verrons si le scandale de Jersey amènera de la part du gouvernement Anglais, quelque mesure efficace. Les honnêtes gens ont quelquefois des peurs auxquelles le gouvernement ne doit pas croire ; mais il a toujours tort quand il ne donne pas satisfaction à leurs indignations honnêtes. C'est la propre cause et son propre honneur qu’il abandonne. Je ne m'étonne ni de la question posée, par Cowley quand Drouyn de Lhuys est revenu de Vienne, ni de la réponse. C’est l’Angleterre qui profite de la guerre, et la France ne se séparera point d'elle. Je n’entrevois toujours pas plus d’issue. On fera de Nicolajeff, un second Sébastopol, et il faudra encore dire après ?
J’ai un petit fils de 3 ans et demi qui est très guerrier, et très anti-russe ; il était très décidé à prendre Sébastopol ; quand je lui ai dit qu’il était pris : " Eh bien j'en prendrai un autre !" C'est toute notre politique.
Onze heures
Ni moi non plus, je n’ai rien de nouveau à vous dire. Adieu, Adieu. G.
123. Val-Richer, Vendredi 7 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais ce que je vous dirai aujourd’hui. Mon premier mouvement dure toujours. Je vous aime de cette affection qui domine tout, qui suffit à tout, qui promet immensément et donne toujours plus qu’elle ne promet, qui ne supprime pas toutes les épreuves ne guérit. pas toutes les plaies ; mais qui se mêle à toutes, pénètre jusqu’au fond, et répand sur toutes un baume qui les rend toutes supportables. Voilà comment je vous aime. Et je vois à la fois deux choses ; l’une, que mon affection ne peut pas pour vous tout ce quelle croit pouvoir ; l’autre que vous ne savez pas y croire. Vous êtes malheureuse et injuste. Je ne me suis point mépris sur vous. Vous êtes tout ce que j’ai cru tout ce que je crois toujours. Aujourd’hui comme il y a un an c’est mon plaisir, mon ravissant plaisir de penser à tout ce que vous êtes, à l’élévation de votre caractère, à la profondeur de votre âme, à l’agrément supérieur de votre esprit, au charme de votre société. Rien de tout cela, n’a changé n’a pâti pour moi depuis le premier jour. Bien au contraire : j’ai eu des doutes que je n’ai plus ; j’ai cru à des lacunes que n’existent pas. Mais je me suis trompé sur les limites du possible. J’ai cru que, malgré l’incomplet de notre relation, malgré la cruauté de votre mal, même sans pouvoir vous donner toute ma vie, je ranimerais, je remplirais la vôtre.
Vous m’aviez inspiré avant le 15 juin un intérêt momentané mais au moment sérieux et profond. Depuis le 15 juin, ma pensée et mon cœur ne vous ont pas quittée une minute. Vous êtes entrée et entrée avec un charme infini, dans les derniers replis de mon âme. Vous m’avez convenu, vous m’avez plu dans tout ce que j’ai en moi de plus intime, de plus exigeant, de plus insatiable. Je vous l’ai montré comme cela se peut montrer toujours bien au dessous de ce qui est, mais enfin, je vous l’ai montré. Et en vous le montrant, à vos émotions, à vos regards, à vos paroles en vous voyant renaître, et revivre, et déployer devant ma tendresse votre belle nature ranimée, je me suis flatté que je vous rendrais, et qu’à mon tour je recevrais de vous, non pas tout le bonheur, mais un bonheur encore immense, un bonheur capable de suffire à des âmes éprouvées par la vie, et qui pourtant n’ont pas succombé à ses épreuves, qui portent la marque la marque douloureuse des coups qu’elles ont reçus, et pourtant savent encore sentir et goûter avec transport les grandes, les vraies joies. Voilà ce que j’ai cru, ce que je me suis promis. Je n’ai pas de désirs médiocres. Je n’accueille que les hautes. espérances. Je sais me passer de ce qui me manque, mais non me contenter au dessous de mon ambition. Et dans notre relation, de vous à moi mon ambition a été, est infiniment plus grande que dans tous les autres intérêts où peut se répandre ma vie. Je ne saurais la réduire. Je ne regrette pas d’être ainsi. Et d’ailleurs cela est. Je puis me gouverner, non me changer.
Comment l’idée que je voudrais vous envoyer à Baden pour me débarrasser de vous, pour ne plus porter le poids de vos faiblesses et de vos peines a-t-elle pu vous entrer dans l’âme ? Je crois vous l’avoir déjà dit ; vous avez certainement passé votre vie avec des cœurs bien secs et bien légers. Vous ne pouvez parvenir à croire à une vraie affection. Vous retombez sans cesse dans vos souvenirs de la froideur et de l’égoïsme humain. C’est encore pour moi un mécompte. Je m’étais flatté qu’en dépit de votre expérience je vous rendrais une confiance, qui est dans votre nature, que je vous ferais trouver en moi ce que vous n’aviez rencontré nulle part qu’en vous-même. Je suis bien orgueilleux, n’est-ce pas ? Mon orgueil n’a rien qui puisse vous blesser. Que me dites-vous que votre esprit est bien soumis à mon esprit ? Est-ce votre soumission que je veux ? Je méprise la soumission, je méprise toute marque, tout acte d’infériorité. Je ne me plais que dans l’égalité. Je veux une nature égale comme une affection égale. Je veux vivre de niveau et en pleine liberté avec ce que j’aime. Je veux sentir à la fois son indépendance, et son union avec moi, sa dignité et son abandon. C’est à cause de vous seule, c’est en désespoir de moi sur vous et pour vous, que je vous ai conseillé d’aller à Baden ; croyant deux choses ; l’une que si je suis pour vous ce que je veux être, vous sauriez bien revenir en France, l’autre que, si je ne suis pas cela, il vous importe par dessus tout d’arranger votre vie avec ceux qui en disposent matériellement. Dites-moi que j’ai eu tort, et n’allez pas à Baden. Vous ne m’aurez jamais fait un plus immense plaisir.
9 h. 1/2
Oui, vous êtes bien douce ; mais cela ne me suffit pas. Adieu pourtant. Et adieu comme toujours. G.
123. Val Richer, Dimanche 23 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce que je regrette bien vivement pour vous, malgré la passion Russe, c’est Hélène ; elle vous était très bonne et sa fille très agréable. A part les grandes tristesses de la vie, c’est une tristesse véritable que ces liens de quelques mois, de quelques semaines qui se rompent au moment même où ils devenaient. utiles et doux. Que devient Hélène après Schwalbach ? Retourne-t-elle immédiatement à Pétersbourg. Faites lui, je vous prie, de ma part, un adieu un peu affectueux. Je compte bien la revoir à Paris. Car nous avons beau être tristes, et avec grande raison ; ce qui se passe passera, et si Dieu nous laisse encore en ce monde, nous n’y serons pas toujours séparés.
On m'écrit, que Morny se refuse aux instances de l'Empereur qui veut le faire président du Corps législatif à la place de Billaut. Je doute que si les instances sont sérieuses, la résistance le soit longtemps. Et vraiment l'Empereur aurait raison d'insister Morny conviendrait très bien à ce poste. Il n’est pas lettré et habile écrivain, comme l'était M. de Fontanes ; mais il servirait. avec une certaine mesure d'indépendance, dans l’attitude, et un vernis de dignité, comme faisait M. de Fontanes sous le premier Empereur. Cela aussi est un service qui a son prix. On me dit, en même temps que si Morny refuse décidément, c'est M. Rouher qui remplacera Billaut, et que c’est Morny qui le propose. Il paraît que l’incapacité a été la seule cause du renvoi de Persigny. Son idée fixe n’a pu suffire, plus longtemps à couvrir sa paresse et sa nullité comme ministre de l’Intérieur. Certainement Billaut sera plus actif et plus capable. Il a de la ressource dans l’esprit, et je ne serais pas surpris qu’il menât assez bien et assez rondement l'administration. On dit que l'Empereur commence à s'apercevoir, que même le pouvoir absolu d’une part et le dévouement absolu de l'autre, ne suffisent pas, et que les hommes capables sont nécessaires. Il est très content de Bourqueney ; à ce point que s’il y avait un congrès, ce serait probablement Bourqueney qui y serait son homme. Il proposerait cela aussi à Morny ; mais Morny se dit aussi peu de goût pour le congrès européen que pour la Présidence du Corps législatif.
A Paris, on est content et confiant ; bien disposé pour la paix et prêt à s’arranger. de conditions modérées pour vous, mais convaincu que Londres en voudra de fort dures, et bien décidé à ne pas se séparer de Londres. On jouit du charmant mécompte qu’on a, depuis trois mois, à votre égard : " Nous qui étions persuadés que c’était un colosse, que ses ressources étaient inépuisables et ses armées invincibles ; et tout cela n'était qu’une apparence, à peine de la fumée ! " Ce sont là les propos courants, dans les cafés et au foyer de l'opéra, comme ailleurs. Voilà Espartero en scène en Espagne. Je l’attendais, lui ou Narvaez. L’un exclut l'autre, on plutôt l’un pousse l'autre de l'autre côté. Malgré l'extrême décri de la Reine Isabelle, je doute qu’elle tombe ; la Reine Christine sera encore une fois le bouc émissaire. Espartero, c’est-à-dire le parti progressiste, s'emparera de la Reine Isabelle et gouvernera sous son nom. Puis, un jour Narvaez viendra la délivrer et délivrer l’Espagne d’un autre mauvais gouvernement. Je ne m'attends pas à autre chose qu'à la répétition des vieilles scènes.
J’ai des nouvelles du Prince de Joinville. Purs remerciement pour le Cromwell qu’il a trouvé, en arrivant à Claremont. Remerciements tristes, d’une tristesse digne et abattue.
Midi
Adieu, adieu. J'espère que vous avez aussi. beau et aussi chaud que moi, et que votre rhume est parti. Adieu. G.
124. Paris, Lundi 3 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'éprouve tant de chagrin de ne vous adresser que des lettres tristes, ennuyées ! Il me semble que vous ne devez plus attendre le facteur avec impatience, que la vue de mes lettres ne vous fait plus aucun plaisir. Je ne vous amuse pas, c'est moi que j'accuse du fond de mon cœur. Je ne suis pas changée ; mon cœur n’est pas changé, mais je ne sens pas en moi la vivacité, l’animation, que j’y avais l’année dernière. Tout y est triste, découragé. Aucun sujet ne m'intéresse. Ah que je dois vous ennuyer ! C’est avec cette pensée que je me mets tous les jours à vous écrire. Imaginez comme cela me fait aller ! J'ai causé l’autre jour avec Médem et hier il a longtemps causé avec mon fils avec lequel il est très lié. Il n’a pas le moindre doute que le silence de mon mari lui est prescrit par l’Empereur. Dites moi, dites-moi ce qui mérite à faire ? Il est clair par les lettres de mon frère que lui n'est pas dans la confidence de cet arrangement, et je doute que l'Empereur en convienne avec lui. Mais encore. Une fois que faire ? & où on peut s'arrêter une si horrible persécution. J’en perds la tête. J’en perds le sommeil, l’appétit. Il n'y a que vous qui soyez bon, qui m'aimiez, mais vous ne pouvez rien pour moi. Votre affection est un bien immense, mais encore une fois, elle ne peut pas remplacer tout, me consoler de tout. Et l’abandon de mon mari, sa faiblesse, la cruauté de l'Empereur, tout cela jette dans l'âme un effroi, un désespoir dont je ne puis pas vous donner une juste idée. Je ne vois d'avenir pour moi, de repos pour moi, que dans la tombe.
J'ai fait la promenade hier avec mon Ambassadeur. Nous étions seuls, je l’ai mené à St Cloud nous avons marché. Nous avons parlé de tout avec une grande intimité, mais je ne lui ai plus parlé de moi du tout. C'est inutile. Il n’y a plus que vous qui soyez ma victime. Hier au soir il est revenu, & assez de monde. En fait de nouvelle figure, il m’est venu un Prince Waisemsky, littérateur distingué chez nous, grand avec de Toukowsky. il vient d’Erns, il a demandé à mon mari une lettre pour moi ; mais il n’a pas eu le temps de écrire. Il me dit que le grand duc allait mieux. Le monde diplomatique est très préoccupé de l’affaire Suisse. Personne n'en comprend l’issue. M. Molé est étonné à ce qu'on dit que Pahlen soit revenu sans plus. Il n’y aura jamais plus. J'ai eu une longue lettre de Lady Clauricarde mais qui n’a pas le moindre intérêt.
Le temps s'est mis au beau, cela m’est égal. Ah mon Dieu, quelle vie que la mienne ! comme il vaut peu la peine d'y rester ! Pardonnez-moi tout je vous en conjure. Ma tristesse est si grande, que j'oublié que je ne devrais pas vous parler ainsi. Adieu, Adieu. Ecrivez-moi, trouvez quelque parole de consolation, d’espérance. Adieu !
124. Paris, Vendredi 19 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Rodolphe Appony vient d’arriver, sans sa femme. Il vient s’amuser à Paris, il est ministre à Munich. J’ai été bien contente de le revoir. Il a trouvé chez moi Hubner. qu’il n’avait pas vu encore. & qui ne m’a pas paru très ravi de son arrivée. Il a peur de tout le monde & qu'on n'en veuille à son poste. Le fait est que Rodolphe l'aura certainement un jour. Je l’ai très bien accueilli, mieux que n’a fait Constantin qui a été très froid pour lui à une rencontre je ne sais où.
Lundhurst était chez moi hier aussi, très entrain de la paix, voulant absolument. trouver des moyens. Avide de causer avec de bons causeurs bien pressé de vous voir vous, Broglie, Molé. Il sera trés utile d’avoir Lundhurst dans la bande pacifique lui aura le courage de parler, car tout le monde du reste me semble poltron en Angleterre. Adieu parce que je n’ai rien de plus.
124. Schlangenbad, Mercredi 30 août 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu avant hier la visite du prince Nicolas de Nassau hier celle du Prince Emile de Hesse, il est resté dîner avec moi, mon tête à tête a été gâté un peu par l’arrivée de Lady Allice Peel. Le soir, Brockhausen a fait son apparition. Il me quitte de nouveau ce matin. Voilà bien des dissipations et des distractions agréables pour Schlangenbad.
Nicolas de Nassau, charmant, fort année en politique, très Français. Le prince Emile très sensé, impartial, reconnaissant les fautes d'un côté l'habilité de l’autre. Assurant sur serment que l’Empereur Nicolas veut la paix ; seulement il ne faut pas qu'on la lui rende trop difficile, (il est très bien placé pour tout savoir.)
L'Autriche est très sincère ; elle ne nous aime pas et vous pouvez compter sur elle dans cette affaire. Bual et Bach nos ennemis personnels comme Redcliffe vraiment nous avons été bien maladroits en gros et en détail.
Les gouvernements allemands presque tous bienveillants pour la Russie. Les peuples tous contre elle. On agit de différents côtés puissants pour amener un congrès. Si rien de trop gros n’avait lieu bientôt cela se pourrait mais un gros échec n'importe porte à quel côté empêcherait tout.
Je ne sais que penser de l’expédition en Crimée ce que je vous ai mandé avant hier me venait d’excellentes sources, & cependant les journaux ont l'air bien affirmatifs dans le sens contraire. Jamais on ne décidera le roi de Prusse à nous faire la guerre. On dit que votre Ministre à Berlin a dit que si la Prusse ne nous la ferait pas, la France la lui ferait à elle. Je serais étonnée d'un si gros propos. Je suis interrompue, adieu. Adieu.
124. Val-Richer, Samedi 8 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous dites bien vrai. Cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres. Quelque fois pourtant il y a quelque avantage à se parler de loin de près, on ne se dit pas toujours tout. On garde certaines choses sur le cœur, ce qu’il ne faut jamais. Bien peu, bien peu de relations sont dignes et en état de supporter la vérité. Mais celles qui le peuvent devraient toujours, et à toute minute, l’accueillir toute entière. En définitive elles y gagnent. Je laisse la aussi, le sujet de Baden, mais à condition que vous ferez comme moi, que vous ne garderez rien, sur le cœur absolument, rien.
Je devine je crois votre impression sur Versailles et n’en suis pas étonné. Mais soyez sûre de deux choses, l’une que c’était le seul moyen de conserver le château, l’autre, que cela a fort réussi dans le public, qu’il prend plaisir à ce grand Capharnaüm de l’histoire de France, vieille et nouvelle, et qu’il en reçoit une leçon de modération et d’impartialité. Pratiquement donc cela est bien et utile. Montant plus haut, et ne se souciant de rien ni de personne, il y a beaucoup de vrai dans votre impression.
Je commence réellement à être un peu occupé de l’affaire de Suisse. Cependant je crois comme vous, qu’il n’en sortira rien que du ridicule. Rien, c’est la passion du temps. Mais si l’affaire n’est pas finie au moment de la session de manière ou d’autre, la discussion sera désagréable pour le Cabinet.
J’ai M. et Mad. Lenormant depuis deux jours. Ils partent aujourd’hui. Ils ont amené leurs trois enfants qui joints aux trois miens, font un grand bruit dans le tranquille Val-Richer. J’ai été consterné hier matin, en voyant tomber des torrents de pluie noire. La journée est longue quand on ne peut pas promener ses hôtes. Mais à midi, il ne pleuvait plus. J’ai conseillé de braver les nuages et notre courage a été récompensé. Le soleil est venu. Le terrain que j’ai choisi n’était pas trop mouillé. Nous avons fait une agréable promenade. Il n’y a rien eu ici avant- hier qui ressemble à votre orage.
On me dit que M. de Châteaubriand est revenu très frappé de l’état du midi de la décadence du Carlisme, et des progrès de l’esprit nouveau. Il vient d’écrire à Melle de Fontanes, une longue lettre très agréable, dit-on, sur le souvenir et le talent de son père. Cette lettre doit servir de Préface aux œuvres de M. de Fontanes que sa fille va publier. Je n’accepte pas votre envie. Oui, nous sommes des êtres, horriblement jaloux, mais non pour toutes choses, ni de tous. Je ne porte pas, la moindre envie aux possesseurs de parcs et de châteaux qui ne sont pas à moi. Je suis charmé qu’ils les aient et qu’ils en jouissent, et il ne m’est jamais entré, dans l’âme, à leur sujet, le plus léger sentiment d’amertume ou de tristesse. Seulement le plaisir d’y regarder s’use vite pour moi, parce que je n’y porte pas non plus cet inépuisable intérêt très naturel et très légitime, qui s’attache, pour chacun de nous à notre propre existence et à tout ce qui y tient de près ou de loin. Il y a, dans l’égoïsme, comme dans tous les sentiments naturels et universels, une part très légitime, juste en soi et nécessaire à la marche du monde. Il faut accepter hautement cette part là en lui assignant sa limite.
La Duchesse de Talleyrand revient-elle décidément ? Je suppose que le Duc de Noailles est retourné à Maintenon. Pour vous, vous y avez tout à fait renoncé, n’est-ce pas ? On me dit que Mad. Pasquier va tout à fait mourir. Je penche fort à croire que le Chancelier finira par épouser Mad. de Boigne ; et à mon avis, ils auront raison tous les deux. Ils finiront doucement leur vie ensemble sans avoir la peine d’aller se chercher deux ou trois fois, par jour. 10 h. Adieu. Adieu. Et ni Madame, ni morale. Adieu. J’avais eu la même idée sur Marie. Elle n’avait fait que me traverser l’esprit ; mais je l’avais eue, tant je trouvais cela fou. Adieu. G.
124. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si les rouges étaient corrigibles, l’arrêt de la cour d’Angers leur serait une nouvelle leçon ; en voilà quatre envoyés à Nouka Hiva. Mais ils sont incorrigibles ; les châtiments individuels sont aussi insuffisants que nécessaires. Le mal est trop étendu, et trop profond pour être guéri par quelques exemples. Il n’y a que le bon gouvernement et sa longue durée, et les régions supérieures de la société bien unies et résistant de concert qui puissent en venir à bout, si Dieu veut qu’on en vienne à bout. Quoique je fasse bien loin, il y a dix ans, de prévoir ce qui est arrivé, j’ai souvent dit au Roi que nous ne faisions que de la médecine de bonnes femmes.
Les honnêtes gens de Jersey font très résolument leur devoir. Je suis curieux de voir si le gouvernement anglais fera le sien. Toute alternative, tantôt les honnêtes gens manquent au pouvoir, tout le pouvoir aux honnêtes gens.
Je suis frappé de ces officiers Français enlevés par des brigands à la porte du Pirée. C'est pis que les brigands dans les Etats du Pape. La Grèce n’est pas en meilleur état que la Turquie, et le résultat de la guerre d'Orient pourrait bien être une occupation permanente d'Athènes comme de Constantinople. Voilà deux rayaumes dont l'Europe proclame, et poursuit depuis trente ans, l’intégrité et l'indépendance.
On me dit qu’il y a plus de monde à Paris, dans le moment-ci que jamais ; surtout des provinciaux de France, ce qui ne vous est bon à rien. On s'empresse pour voir encore l'exposition. Il me semble qu'à tout prendre, après avoir commencé par a failure, elle finit par un succès.
Je vous quitte pour aller faire un tour de jardin. Il fait un temps admirable, après trois semaines de pluie. Je voudrais que les jours que je passerai encore ici fussent beaux. J’irai peut-être en passer quelques uns à Broglie. Je me propose d'être à Paris le lundi 12 novembre. Qu'il y ait ou qu’il n’y ait pas d'événements d’ici là, nous causerons abondamment.
Onze heures
Je voudrais bien croire au sérieux et à l'efficacité des bonnes paroles que vous me répètez ; mais je n'y crois pas. Adieu, adieu.
124. Val Richer, Lundi 24 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai, vous le savez, la prétention de n'être pas du tout général et tacticien. Je ne m’applique donc point à suivre pas à pas les opérations de la guerre, à eu discuter le mérite, et à mettre mes jalons à côté de ceux qu’on suit sur le Danube. ou dans la Baltique. Je m'étonne pourtant un peu de voir partout que notre corps de troupes qui vient de partir de Calais, est destiné à aller prendre et occuper les Îles d’Alaud. Comment y restera-t-il l’hiver prochain, sans l’appui des flottes, si la guerre n’est pas terminée au mois d'Octobre ? Comme malheureusement tout l'indique ? J’ai peine à me figurer le général Baraguey d'Hilliers et 8 ou 10 000 soldats Français seuls au milieu des glaces, pendant six mois dans les Îles d’Alaud. Il faut qu’on ait le projet de quelque coup plus prochain et qui mette plutôt fin à la situation.
Quant à l’Espagne, je vois, dans le Moniteur d'avant hier samedi, que Narvaez et Espartero sont d'accord. Si cela est, la Reine Isabelle n'a qu'à se soumettre. Il est vrai qu’il y a aussi moins de chance qu’elle soit détrônée.
Savez-vous pourquoi, le voyage du Roi de Portugal à Paris est remis au mois de septembre ? Est-ce simplement un arrangement convenu de bonne grâce entre lui et l'Empereur Napoléon, ou bien y a-t-il quelque intention de ne pas faire la visite ? C'est du reste quelque chose d’assez singulier qu’un Roi de Portugal absent de Lisbonne pendant qu’il sa passe de telles choses en Espagne. J’ai des nouvelles de Piscatory revenu en Touraine après deux mois passés en Italie avec sa femme et ses enfants. Pas plus content de l'Italie que d'autre chose. Il veut absolument que je le tire de ses ténèbres sur l'avenir, les plus noires le monde : " Est-ce la paix ou la guerre qui décidément résultera de tous ces mouvements belliqueux et de toutes les volontés pacifiques ? J’ai peut-être grand tort, mais tout cela me paraît pitoyable, d’un bout. du monde à l'autre. " Je ne lui dirai rien qui lui apprenne ce qu’il cherche, ni qui change sa disposition.
Midi
Rien de nouveau, ni à Giurgiu, ni à Madrid. J'espère que vous ne souffrez pas de cette chaleur qui me convient très bien à moi. Adieu, Adieu. G.
125. Paris, Mardi 4 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je connais parfaitement le refrain. Je ne connais pas la chanson ; mais ce refrain je l'ai entendu cent fois chantée par mon pauvre frère en imitation d’un buffo de l'opéra Italien à Pétersbourg l’année 1802 ou 3. Il y a longtemps. Je suis plus instruite que vous ne pensez ! Votre proposition pour l'Angleterre est exactement ce que je pensais ces jours-ci, et j’y serais allée cette semaine avec mon fils s'il se trouvait une seule de mes connaissances auprès de Londres. Mais toutes absolument toutes sont absentes. Lady Cowper en Ecosse. Les Sutherland dans les Staffordshire, Lady Jersey en Allemagne. Les Bedford dans la Devonshire. Lord Aberdeen en Europe, Lord Grey, trop loin ; tous les autres trop loin En principe et pour l’avenir me partager entre Paris et l'Angleterre est une très bon place, et qu'il faut encore, mais qu'arrivera-t-il encore avant qu'il me soit permis de me faire une idée exacte de mon avenir ? Quelle situation que la mienne !
Ce que je vous ai dit sur la duchesse d'Orléans est exact. C’est Madame de Boigne & M. Pasquier qui me l’ont dit & tel que je vous l’ai redit. En y pensant plus tard on aura jugé qu'il valait mieux retrancher quelque chose au récit. Je n’ai vu personne hier. Je me suis promenée le matin à St Cloud avec mon fils, le soir encore avec lui. Il a dîné chez Pahlen, Marie au Cabaret avec la petite Princesse, & moi toute seule. Voilà ma journée, et à peu de différence près mes journées je suis aussi ennuyée que je suis triste. C’est beaucoup dire ! Si je ne parviens pas à vous écrire ce soir, vous manquerez peut être de mes nouvelles après demain, car je pars demain de bonne heure pour Versailles et je n’en reviendrai que tard. Je ne fais cette course que pour faire plaisir à mon. fils, moi cela me fatigue et m’ennuie. beaucoup. Adieu. Adieu, mais je suis bien maigre.
Mots-clés : Réseau social et politique, Vie familiale (Dorothée)
125. Paris, Samedi 20 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je viens de recevoir une lettre de Constantin de Nikolaef. L'Empereur l'envoye en Crimée, pour y faire la campagne d'automne. Il me demande pardon du passé. Il me recommande sa femme et ses enfants. Ses paroles sont affectueuses. Simples, tristes. Je suis touchée, Alexandre me mande de Berlin que Louise est bouleversée dans cette nouvelle. Elle ne veut pas que mon fils la quitte. Constantin reste auprès d’elle. Il promet d’être à Berlin pour l'hiver. si... Ah, cette maudite guerre.
J’ai vu hier Morny. Il était fort content de l'accueil qui lui a été fait à St Cloud. L'opinion commence à s’établir que c’est nous qui ne voulons pas de la paix et c’est vrai, tout ce que j’apprends indirectement de Russie le confirme. J’étais sûre que vous seriez passé quelques jours chez le duc de Broglie. Lord Brougham est arrivé, il est venu me voir, je l'ai manqué. Madame Thiers est hors de danger. La mère de Montebello ne quitte plus le lit. Il ne veut plus la quitter le soir. Je suis très seule. Un peu Dumon, depuis deux jours. Adieu. Adieu.
125. Schlangenbad, Vendredi 1er septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai eu une mauvaise lettre de Constantin on connaissait le 20 août à Peterhof les conditions des alliés, et on déclare la paix impossible sur ces bases, ainsi guerre à outrance c’est le style de Constantin, je ne prends pas cela tout à fait à la lettre, cependant cela n’annonce pas de bonnes disposition. Nous avons remporté de vraies victoires en Asie, vous savez que cela me touche peu. On savait Bomarsound, on y attache peu de valeur, style de Constantin. Je suis très curieuse d’apprendre ce que vous allez faire en Crimée et si vous y allez.
J’ai vu les Shafterbury. Ils sont prés d’ici à Schlangenbad. Il dit qu’en Angleterre on souhaite la paix mais une bonne paix. La popularité de Lord Palmerston a un peu baissé. Il a trop promis & trop peu tenu comme ministre de l’Intérieur. Le ministère actuel tiendra aussi longtemps que durera la guerre. Une fois la paix faite il touchera ; mais alors il n’a pas intérêt à la faire ? J’espère que votre prochaine lettre m’annoncera la déroute de votre migraine. Nous avons eu quelques belles journées. Voilà le temps froid revenu. Ceci va devenir intenable bientôt. JE tiens encore tant qu’il y a un peu de société. Morny est inépuisable. Adieu. Adieu. J’ai vu aussi le frère de Duchâtel qui m’a beaucoup demandé de vos nouvelles. Adieu.
125. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous m'avez dit il y a quelque temps, si je ne me trompe que la Duchesse de Sutherland devait venir à Paris. Il est-elle en effet et sinon, pouvez-vous me dire ou elle est ? Je voudrais lui écrire pour lui demander quelques renseignements sur une comtesse de Carliale, femme d’esprit et très intrigante, que je trouve mêlée à tout sous Charles 1er, Cromwell, et Charles II. J’ai envie de savoir s'il existe, sur elle, quelque Vie imprimée, ou s'ils ont à son sujet, quelques papiers de famille. Je connais plus la Duchesse de Sutherland que Lord Carlisle, et je crois qu’elle prendrait quelque soin de mon désir.
Je ne puis croire à l’épigramme contre le Duc de Brabant de toutes les épigrammes, elles là sont celles qui se pardonnent le moins. Je crois plutôt au défaut de bon goût et à d'inadvertance ; faute très commune dans le choix des spectacles de cour. Au château d’Eu, le roi voulait un jour devant la Reine Victoria, le Minuit d'Arnal la Reine Amélie ne voulait pas, trouvant Minuit peu convenable. Je ne connais ni l’une ni l’autre pièce ; il me semble que Les premiers armes de Richelieu doit beaucoup surpasser Minuit.
Tout le monde, excepté vous, restera à Constantinople. Greville a raison ; les alliés auront grand peine à s'accorder pour la paix. Quand une guerre n’a plus qu’un objet vague et qu’on s’est promis. " Point de conquête", comment s'entendre pour la finir ? Il n’y a point de parti à donner à chacun.
A en juger par l'article du Times, les mesures du cabinet anglais contre les Jacobins de Jersey se borneront, quant à présent, à une menace, on ne les expulsera que s'ils recommencent. Ils recommenceront et on ne les expulsera pas.
Onze heures
J'arriverai à Paris, le 12, comme je vous l’ai dit hier. Je serai charmé de causer avec Lord Lyndhurst. Pourquoi donc s’est-il engagé si avant dans la mauvaise politique ? Adieu, Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Archives, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Femme (portrait), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Histoire (Angleterre), Ministère des affaires étrangères (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Réseau social et politique, Salon, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
125. Val-Richer Dimanche, 9 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
La pluie a cessé. Le soleil se lève très beau. Je ne puis souffrir ces brusques alternatives. Je veux avoir devant moi un long temps égal, uniforme. J’ai toujours trouvé le bonheur ancien supérieur, au bonheur nouveau. Ce qui me plaît vraiment ne s’use jamais pour moi. J’y découvre au contraire chaque jour un nouveau mérite et un nouveau plaisir. Je me rappelle l’été de 1811 de la grande comète. Le soleil a été plus de deux mois brillant et chaud, sans interruption. Tout le monde en était las. J’en étais de plus en plus ravi. Et quand la pluie, le ciel sombre sont revenus, j’ai été triste comme d’une décadence, comme d’un deuil. Tout ce qui passe est si court, dit St Augustin. Comment l’abréger encore par la mobilité de nos désirs ?
Ne prenez pas ceci pour une personnalité. Je ne vous trouve point mobile du tout. Vos impressions du moment de la surface sont mobiles ; mais le fond de votre âme est très solide parce qu’il est très profond. C’est par la profondeur de vos sentiments que vous m’avez frappé et touché. Je pense à Marie. Faites y attention. Il y a à parier que la princesse de Schönburg a raison. C’est trop étrange. dès que vous aurez Lady Granville, tenez conseil. Et si la délibération du conseil est conforme à l’avis de la petite Princesse ayez sans doute tous les ménagements possibles ; mais ne tardez pas trop à prendre une résolution. Vous ne pouvez en conscience charger de plus votre vie d’une folle. Pauvre enfant ! J’espère encore qu’il n’en sera rien. Mais s’il y a quelque chose, ce n’est pas près de vous qu’elle se guérira. Elle y manque à la fois de sérénité et de mouvement. Elle s’agite et s’ennuie. Mauvaise condition à tout âge, encore plus dans la jeunesse.
Je suis charmé que Lady Holland, Lady Granville. et tout ce monde dont vous me parlez reviennent. Cela vous distraira l’une et l’autre, et l’une de l’autre. Que devient l’affaire du Roi de Hanovre ? Est-ce que celle-là s’en ira aussi en fumée comme les autres ? Que veut dire cette apathie, cette impuissance universelle ! Est-ce un monde fatigué qui se remet, ou un monde usé qui s’affaisse ? J’ai cru. je crois toujours à la première explication. Mais il faut de temps en temps quelque grand événement, quelque voix bien haute pour secouer cette torpeur, et interrompre la prescription de la vie. Rien ne paraît.
Je ris de moi-même en écrivant cela. Que la préoccupation de l’égoïsme est forte ! Il y a à peine huit ans que nous avons ébranlé le monde. Il n’y a pas trois ans que nous sommes sortis, nous autres Français d’une lutte intérieure terrible qui a duré cinq ans. Et nous nous plaignons de l’apathie ! Nous trouvons l’entracte bien long ? S’il m’arrive d’oublier ainsi les choses, à cause de moi, de ne pas juger mes impressions et mes désirs personnels, rappelez-moi à l’ordre, je vous prie. Je veux surtout être juste et sensé.
9. 1/2
Cela ne se peut pas. Il ne peut pas y avoir une phrase froide, ni à la fin, ni au commencement, ni nulle part. Je vous ai écrit très triste, très jaloux, mais triste, mais jaloux par une tendresse infinie, insatiable, désolée de ne pas tout pouvoir, de ne pas tout avoir. Que mes paroles sentissent l’effort ; qu’elles fussent pénibles, raides, cela se peut ; mais ce que vous dites est impossible. Je veux savoir qu’elle est cette phrase. Je suis sûr que vous vous êtes trompée. Je ne l’en efface pas moins puisqu’elle vous a affligée. Il m’arrivera peut-être encore de vous affliger. Quand il m’en viendra du chagrin de vous, je ne vous promets pas de ne pas vous en rendre. Mais jamais ce chagrin-là, jamais. N’est-ce pas que vous ne l’avez plus, que vous n’y pensez plus, que vous n’avez plus froid ? Dites-le moi ; redites. le moi. Que d’Adieux. Je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant, cette lettre. Adieu dearest, adieu. G.
Quand je dis que je ne vous ai jamais plus aimée qu’en vous écrivant cette lettre ce n’est pas de celle-ci, c’est de l’autre que je parle, de celle où vous dites qu’il y a une mauvaise phrase. Renvoyez-moi la phrase. Je l’ai sur le cœur, mais je n’y crois pas.
125. Val Richer, Mardi 25 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc l'Empereur, à Biarritz et formant, là aussi, un camp à propos des événements d’Espagne. Les ministres ont fait ce qu’ils ont pu pour empêcher ce voyage. Ils ne sont pas accoutumés à prendre sur eux la responsabilité des résolutions. Mais l'Impératrice a déclaré qu’elle n'irait pas seule à Biarritz, et l'Empereur voulait qu’elle y allât ; il l'a donc accompagnée. Au fait, qu’elle que soit l'arrogance des décisions, avec le télégraphe électrique, ce sera lui qui les prendra toutes. Seulement cela supprime à peu près la discussion préalable, dans l’intérieur du gouvernement aussi bien qu’en dehors.
On est un peu frappé d’un acte de résistance du Conseil municipal de Paris. Le gouvernement n'est pas, pour le moment, très bien avec les Jésuites, et pour les empêcher d'acheter un des grands collèges de Paris, le collège Stanislas qui est à vendre pour cause de mauvaises affaires, il a voulu que la ville de Paris elle-même l'achetât. Il en a fait faire la proposition dans le conseil municipal ; le ministre de l’Instruction publique et le Préfet de la Somme s’y sont vivement employés. La discussion a abouti à 16 boules blanches et 16 boules noires, de sorte que la proposition n’a pas été adoptée. C'est M. Delangle, le premier président de la cour impériale qui a été à la tête de l'opposition. Autre petit fait, moins sérieux. La visite. de l'Empereur au Commodore Grey, devant Calais, n’a pas été sans mésaventures. Le beau steamer La Reine Hortense, sur lequel l'Empereur s'est embarqué, était entré trop avant dans le port et a voulu en sortir trop tôt, avant la marée pleine. Il a fallu une heure et demie d'effort pour y réussir. Puis on n’a pas bien abordé le vaisseau Anglais ; on a eu besoin d’un remorqueur anglais. Puis, le maréchal Vaillant a manqué l'échelle et est tombé à moitié dans l'eau, où il serait tombé tout-à-fait si on ne l’avait ressaisi à temps. Voilà l’histoire qui court le long de la côte.
On dit beaucoup à Paris que les événements de Portugal tourneront au profit de la maison de Bragance. Bragance et Cobourg. M. de Païra est fort dans l’intimité de M. Drouyn de Lhuys.
10 heures
J’ai mes lettres de bonne heure. Je pense avec plaisir au plaisir que vous aurez eu à causer un peu avec Morny. Mais dites-moi que ce beau temps là vous fait du bien ; il est si beau ! On m'écrit de Paris : " On commence à s’inquiéter, dans les régions officielles, du caractère révolutionnaire, et anarchique du bouleversement Espagnol. Les révolutionnaires ici sont en grande jubilation, et annoncent de prochains mouvements en Italie, surtout dans le royaume des deux Siciles. "
Adieu, adieu. G.
126. Paris, Dimanche 21 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
La duchesse de Sutherland est ici, elle est venue chez moi hier soir. Je lui ferais volontiers votre commission, mais je crois qu’elle aimera une une lettre de votre part. Elle est descendu à l'hôtel [?] Vous n’avez pas d’idée de ce qu’elle est devenue la tour Malakoff. Je ne parviens pas à voir Brougham. Hier encore et m’a manqué. Je le verrai aujourd’hui. On me dit qu'il est très pacifique. J'ai encore vu Morny hier. Je vois assez souvent M. de Romberg le substitut de Hatzfeld. Il jase, il a de l’esprit, et un mauvais regard. Interruption. Adieu.
126. Paris, Mercredi 5 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous annonçais point de lettres aujourd'hui et vous en aurez au contraire une longue. Par deux raisons. La première que je ne crois pas que le temps me permette d’aller à Versailles. La seconde : parce que je viens de recevoir de votre part. Vous m'envoyez à Baden bien lestement. Vous oubliez tout. Vous oubliez donc que je ne puis pas bouger, qu’officiellement au moins cela est établi, que je viens encore de l'écrire à mon frère, que tout le passé aurait l'air d'une comédie si je faisais ce voyage. Vous oubliez qu'une fois hors de France je n’y rentrerai pas. Vous savez cela parfaitement, vous me l'avez dit vous même cent fois. Et vous m'envoyez à Baden !
Vous êtes ennuyée de moi et vous voulez vous en débarrasser. Je le conçois un peu, je ne le conçois pas tout-à-fait. Je ne suis pas tout ce que je vous ai semblé être au commencement. Vous vous êtes mépris sur mon caractère. Vous ne pensiez pas qu’il fût si mobile, et si vous y regardiez bien cependant, est-il si mobile ! Le fond de mon cœur c'est de la douleur, une douleur éternelle. Une douleur qui a été couverte par l’étonnement, la joie de vous avoir trouvé. Le premier de ces sentiments, le temps l’efface actuellement. Le second dure, mais plus tranquille, parce qu’il est plus établi. Il y a donc dans mon cœur, ma douleur et vous. Voilà la vérité, voilà ce que je sens qui est la vérité aujourd'hui. Je ne sais ce que peut le temps. Jusqu'ici Il ne m'a été d’aucun secours. Ma situation depuis que je vous connais s’est empirée. Vous connaissez toutes les pensées toutes les tracasseries qu'on me fait éprouver. Il est impossible que mon humeur ne s’en ressente pas. J’ai l’esprit agité sans cesse. L'âme aigrie. Nulle ressource autour de moi. Un home le plus ennuyeux du monde. Tout cela ensemble fait de moi une triste société pour vous lors que nous sommes ensemble, et une plus triste encore quand je ne suis réduite qu'à vous écrire. Le fait est donc que je vous suis à charge un peu, que pour vous comme pour moi vous seriez bien aise que je sois tirée de mes peines présentes, que vous me conseillez Baden comme un moyen possible, et que s’il ne réussit pas. Eh bien, vous n'avez plus mes plaintes à recueillir, mes inégalités à supporter. Voilà tout ce que deux mots de votre lettre ont fait naître en moi de réflexions et remarquez bien, je ne vous en veux pas, je trouve que vous avez raison un peu raison, pas tout à fait.
Je vaux mieux que vous ne croyez, mieux que je ne me montre mon cœur vous est bien attaché, mon esprit est bien soumis à votre esprit. Si je vous perds, il ne me reste rien vous avez encore pour vous les joies et les gloires de cette terre. Il n’y en a plus de possibles pour moi. Et vous qui me donnez la seule félicité que je puisse goûter ici bas, la parfaite intimité de pensées, de cœur, vous voulez m’exposer à la perdre ?
Si je vous ai dit une parole un mot qui vous semble dur, pardonnez le moi, vous m'avez déjà tant pardonné. Vous savez que je dis tout ce que j'ai sur le cœur, mais vous ne savez peut-être pas que je dis peut-être pire. Il y a aussi peu de coquetterie dans mon cœur que dans ma personne. Je suis sévère pour moi. Je m’amuse. Je me montre moins bien que je ne suis. Je vous aime plus que je ne vous le dis, je vous excuse vous du fond de mon cœur. Je me rappelle avec une tendre reconnaissance votre inaltérable douceur, je reconnais avec humilité et repentir, une vivacité, les caprices de mon humeur ; je conçois que je vous ennuie quelques fois, mais je ne concevrais pas que vous puissiez cesser de m’aimer. Et vous m’envoyez à Baden.
Je suis interrompue sans cesse. Mon fils me parle ; je ne puis pas écrire, de suite, comme je voudrais. J’ai tant dans le cœur tant dans la tête. Je vous envoie ceci, sans presque savoir ce que je vous envoie. Dans les relations ordinaires de la vie, c’est mal, on a souvent tort de se laisser aller à son premier mouvement. Dans les relations qui existent entre nous c’est le premier mouvement qu'il faut suivre parce que rien ne doit rester caché. Adieu, adieu, vous verriez bien mal si vous ne voyez beaucoup beaucoup d'amour dans cette lettre. Adieu.
126. Schlangenbad, Dimanche 3 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Charles G. me mande ceci. " We are mating with anxiety for the news of the army aving landed in the Crima which was to have taken The place on the 20 th. accounts of the sidense in both armies have been frightful. I hear non that the french, troop (who have lost many thousand men are completely dismoralized and abhor the War, for which they never had any fancy. Nothing can be more deplorable than the state of things en Spain, but the last et account Look rather better ; queen Christina got away with a whole skin, and this appear to have mustered up courage to pact down [?] of the club & revolutionary journals, but Clarendon thinks Espartero with not last long. We have no treaty with Spain wich obliges us to interfere, and England & France are both agree not to burn their fingers by any wedding with Spain but to let them manage or miscarriage their own affairs as best they way. I hop the Emp. of the french will be so wise as to adhere to this policy, and you may be sure we shall, people here will never believe that Austria is taking part against Russia till a battle has been fought between the two armies. You do not care about America, but we are very ne at the conduit of that gt and live in dread of some event which may embroil us with them "
Cette dernière partie de la lettre a de l’importance. Il me parait certain que nous repoussons les quatre propositions. Je ne m’aviserai plus d'espérer, ni surtout de le dire. Je vois assez les Woronzow et toute la tribu, mais la soirée se passe toujours à 3 avec Morny. Les ministres Belges n'ont pas vu de bon œil la visite de leur roi à l’Empereur, ils trouvaient que c’était sortir du caractère de neutralité d’aller au milieu d'une armée destinée à combattre peut être une autre puissance. C'était un peu pédant cependant ils avaient raison rigoureuse ment. On a tourné la difficulté en choisissant Calais.
Le prince Albert sera à Boulogne le 6. Je crois vous l’avoir dit déjà. Greville me mande que le général l'Espinasse s’est tué. C'est faux puisque le voilà de retour à Paris, mais il est très vrai qu'on l’accuse d’avoir aventuré une partie de l’armée dans un pays pestiféré, et d’avoir sans profit aucun sacrifice la vie de quelques milliers d’hommes. Nos victoires en Asie sont bien attestées, c’est un rude coup pour les Turcs, et on dit qu'ils auraient bien envie de la paix, mais vous ne leur permettez plus de la faire.
4 heures
J'ai reçu une lettre de bon lieu que me dit que la troupe est assez mécontente de son inaction, & qu’elle va marcher avec répugnance C'est hier le 2 qui l’expédition devait partir. On ne sait pas du tout ce que nous avons là de troupes. On varie de 40 000 à 150 000. (Worosow pense toujours que c’est plutôt le premier chiffre) On est frappé de l'éloge que fait le bulletin russe de la bravoure des Turcs. On dit que ceux-ci ont bien mon de la paix. M. de Bruk. Le ministre d'Autriche à Const. tient à son gouvernement un langage, assez sinistre. Je vous redis la phrase sans me l’expliquer. Dans le courant d'octobre on s’attend à un armistice de fait, ou de droit. Je n’ai point de commentaires à ajouter, je ne sais rien de plus. Constantin m'écrira sans doute demain ou après demain, mais ce qu'il me mandait de Peterhof me prépare à du mauvais. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Circulation épistolaire, Correspondance, Diplomatie, France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Réseau social et politique, Salon
126. Val-Richer, Lundi 10 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’aurai le cœur en paix que lorsque, vous aurez reçu mon démenti à votre tristesse qu’elle que soit ma phrase, et à ma phrase qui ne méritait certainement pas votre tristesse mais qui en tous cas ne valait rien puisqu’elle l’a causée Le Cardinal de Pretz dit quelque part qu’il y a des situations où l’on ne peut faire que des fautes. Il y en a aussi où l’on ne peut rien dire que de triste et d’attristant. J’avais bien ce sentiment-là en vous écrivant Vendredi. Je vous trouvais si abattue, si inquiète, et moi si impuissant pour vous guérir, que j’ai été tout à coup à la dernière extrémité de votre mal et du mien.
Quand j’aime, je prends toujours au pied de la lettre ce qu’on me dit et je crois toujours que cela durera. Je n’ai pas l’instinct de ce qui passe. La réflexion seule me l’apprend. Et puis, résignez-vous à ne me voir jamais résigné à vos mauvais moments, à ces moments qui me font douter de ce que je suis et puis pour vous. Je ne veux rien ôter à personne. Je ne veux rien envier à personne. J’aime tous vos sentiments, oui je les aime, et je vous aime vous, de les avoir tels. Vous ne savez pas pour combien l’état de votre âme, le deuil de votre âme et de votre personne est entré dans l’affection que je vous porte. S’il y a en moi quelque chose de profond, c’est mon aversion pour la légèreté de cœur, pour la promptitude de l’oubli, pour ces sentiments qui dans le vol de notre vaisseau tombent à la mer et s’y abîment avec les créatures qui en sont l’objet. Je déteste cela en moi, quand je l’y trouve, comme dans les autres. Je ne sais comment parviennent à se concilier des sentiments qui existent ensemble dans mon âme. Il y a là un mystère que je ne m’explique pas du tout qui m’a bien souvent tourmenté ; mais Dieu m’est témoin qu’ils existent ensemble, et que l’un n’abolit point l’autre, et que la mémoire de ceux que j’ai aimés est en moi, toujours présente et toujours chère. Et quand je rencontre un cœur qui n’oublie point, un cœur où les morts vivent, je me sens à l’instant pénétré pour lui de sympathie et de respect. Vous avez eu, pour moi, à ce titre seul, un attrait immense. Et il s’est toujours accru plus je vous ai connue. Dans les premiers temps, il a surmonté les doutes qui me venaient à votre sujet, soit de moi-même, soit de ce que j’entendais dire. Plus tard, il m’a fait vous pardonner ce qui m’affligeait ce qui me blessait. Il existe aujourd’hui aussi puissant, bien plus puissant que ce jour où j’ai dîné à côté de vous chez le Duc de Broglie, et où votre regard, deux ou trois fois troublé et plein de larmes au milieu d’une conversation insignifiante, m’a frappé et pénétré jusqu’au fond de l’âme. N’ayez donc jamais, dans aucun cas, pas une minute, le moindre doute sur mon inépuisable, mon infatigable sympathie pour votre mal. Quand Dieu ne m’aurait pas condamné à le ressentir pour moi-même et à le ressentir en ne vous en parlant presque jamais, à cause de vous, je trouverais en moi, dans ma disposition la plus intime de quoi vous comprendre, et m’unir à vous et vous en aimer toujours davantage. Croyez-le bien, croyez-le toujours ; et en même temps laissez-moi toute mon ambition sur vous auprès de vous. Résignez-vous à ses exigences à ses susceptibilités. Je n’y puis rien. Je n’y veux rien pouvoir. Si j’y pouvais quelque chose, vous ne seriez pas pour moi ce que vous êtes. Voulez-vous être moins?
10 heures
Le N°130 m’arrive avec trois personnes qui viennent me demander à déjeuner. Je voudrais ajouter beaucoup de choses à celui-ci. Il n’y a pas moyen. Adieu. Adieu. Votre mine m’importe beaucoup. Mais toujours, le même adieu. G.
126. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai vu hier dans mon Galignani, après vous avoir écrit, que la Duchesse de Sutherland venait d’arriver à Meurice. Soyez assez bonne pour me dire si elle y restera longtemps, et si je dois lui écrire là pour avoir mon renseignement sur Lady Carlisle, ou attendre qu’elle soit de retour à Londres. Je ne voudrais pas lui donner la peine d'écrire en Angleterre, pour cela, quand elle y sera, quelques mots de conversation avec les savants de sa famille, lui suffiront pour me répondre, si elle le peut et si elle a des savants sous sa main.
Cette Lady Carlisle, d'il y a 200 ans piquerait votre curiosité comme la mienne. Si vous y aviez regardé comme moi. Beaucoup d’esprit et de savoir faire, un peu sans foi, ni loi, amis successivement, et probablement très intime, de Stratford, de Pym, de Cromwell, de Monk se mêlant de tout, en gardant toujours sa liberté. J’entrevois qu’elle était bonne, obligeante, pas plus haineuse que fidèle, quelque fois très impertinente, l'impertinence est l’une des petitesses des femmes, même distinguées ; elles y prennent un plaisir d'enfant ; c’est leur manière d'étaler le pouvoir qu'elles ont ou d'affecter, celui qu'elles n’ont pas. Bref, j'en voudrais savoir davantage sur Lady Carlisle. Je doute que personne en sache assez pour m’apprendre ce que je voudrais, tant de personnes, très distinguées ; les femmes surtout, tombent si vite dans un si profond oubli, mais enfin, je veux questionner.
Si j'étais votre Empereur, je trouverais mauvais que votre neveu Constantin eût été mal pour Rodolphe Appony. La Russie doit savoir gré à l’Autriche de sa neutralité, et conserver soigneusement les liens, de politique ou de personnes, qu’elle a encore avec Vienne.
Après le concordat qu’elle vient de conclure avec le Pape, l’Autriche doit être très bien en cour de Rome. Joseph II, et même Marie Thérése, seraient un peu étonnés et irrités s'ils lisaient cela ; tout d’indépendance. à l'Eglise ! J’aurais objection à plus d’un article, mais à tout prendre, je crois que le jeune Empereur a eu raison et que s’il perd à ce concordat, quelque autorité dans l’Eglise, il y gagnera beaucoup d’appui pour son autorité dans l'Etat.
Onze heures
Je suis bien aise que votre neveu vous ait écrit sur ce ton et très fâché qu’il rentre dans la guerre active. Dieu sait qui en reviendra Adieu, adieu. G.
Vous savez bien que je vais, tous les ans passer quelques jours chez Broglie. Ordinairement quinze jours. Beaucoup moins cette année-ci. Je ne sais pas encore quel jour j’irai. Je veux finir ici ce que j'ai commencé. Adieu. G.
126. Val Richer, Jeudi 27 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Plus de grosse chaleur. Nous avons échappé hier à un violent orage qui est allé éclater ailleurs. Aujourd’hui, il fait frais. Je voudrais vous mesurer à votre goût le soleil et la pluie. Au moins le bien être matériel, à défaut des grandes satisfactions. Je veux croire que le découragement et la désaffection ne pénétreront pas chez-vous, quoique vous en ayez donné de grands exemples ; mais votre Empereur, finira par comprendre, le mal qu’il se fait à lui-même, et par accepter quelque arrangement que l’Autriche et la Prusse seront toujours là pour proposer. Plus la guerre durera, plus les conditions de la paix lui seront dures. Il ne divisera pas la France et l’Angleterre. Il ne les ruinera pas. Je compte encore sur son intelligence, et son bon sens pour mettre fin à une situation dont il souffre et dont il souffrira beaucoup plus que personne, dans la puissance Européenne et dans la prospérité intérieure de son peuple ai-je tort ?
J’ai grand peine à croire qu’on soit obligé de se mêler de l’Espagne. Le désordre intérieur sera énorme peut-être la guerre-civile ; mais rien qui affecte l’Europe, même les voisins. Les révolutions Espagnoles ne sont pas contagieuses chez nous. Je doute quelles se propagent en Italie. Je vois qu'une tentative a déjà échoué à Péronne. Je persiste à penser qu’il n’y aura là, qu’une mauvaise monarchie radicale, substituée à une mauvaise monarchie quasi absolutiste.
Je vois par le bulletin d'Havas que c’est aussi le pronostic du gouvernement, et qu’il se prépare à vivre en bons termes avec Espartero. Il n’y aura plus de rivalité Franco-anglaise qui y mette obstacle.
Faites-vous envoyer l’histoire de la Turquie de M. de Lamartine. Ce ne sera certainement qu’une série de coups de théâtre et de décorations d'opéra. Mais comme décorateur, comme Sicari de l’histoire, il a beaucoup de talent. Il vous amusera. Lisez aussi le Charles Quint de M. Mignet. Il le mérite. Mlle de Cerini vient elle à bout de vous lire un peu ?
Midi
Adieu, adieu. Je ne reçois absolument rien ce matin.
127. Paris, Jeudi 6 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma lettre d’hier a répondu à votre lettre d’aujourd’hui. Je laisse donc tout-à-fait ce sujet. Ah que c’est peu de chose de s’écrire comme cinq minutes d’entretien valent mieux que dix lettres ! Vous me disiez l’autre jour que vous n'aimez de jardin et de pare que le jardin ou le parc qui vous appartient, que ce qui appartient à un autre vous lasse vite. C'est très vrai, c’est ce que j'éprouve aussi, et cela s appelle de l’envie. Cette définition est peu brillante, mais elle est vraie. Soyez sûr que nous sommes des êtres horrible ment jaloux, et que la belle nature toute simple nous charme parce que nous ne sommes pas jaloux de Dieu. A propos, j’ai cependant été à Versailles hier, mais seule avec mon fils & le le petit Coke. Celui-là nous pouvions le mettre à l'abri dans ma calèche sans nous gêner, il n’en eut pas été de même de Marie, du prince Howard & de M. Acton qui devaient tous aller avec moi. A 10 heures le matin il y a eu un orage épouvantable, j'ai envoyé ma circulaire pour renoncer à la partie. A midi le temps est redevenu beau, mon fils avait une grande curiosité de Versailles, et nous y sommes allés comme je viens de vous dire.
Eh bien je dis de Versailles ce que tout le monde en dit, me réservant de penser toute autre chose. C’est de l'hérésie, c'est de l'impolitesse et voilà pourquoi je me tairai. Les ordres avaient été donnés, j’ai tout vu à mon aise ; traînée dans les petites chaises. J’ai été ensuite regarder la façade du château dans le jardin. J’ai fait un très mauvais dîner au réservoir, et je suis revenue pas l’orage le plus horrible que j'ai jamais vu nous nous sommes abrités sous une porte cochère à Sèvres. La grêle était grosse comme des prunes. Je me suis couchée à 9 heures, & à me voici. Il y a deux jours que je n’ai pas vu une âme. Je n’ai pas un mot de nouvelles à vous dire. Je suis curieuse de la Suisse. Mon fils me quitte après demain. Il reviendra le 25, pour repartir le 2 ou le 3 octobre.
Que va devenir cette affaire de la Suisse, cela commence à devenir très curieux, et cependant vous verrez que cela s'en ira en fumée. Adieu Adieu. Dites-moi toujours adieu avec le même plaisir que je le dis, je suis bien triste et bien douce aujourd'hui. Je pense bien à vous.
127. Paris, Lundi 22 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il me semble que dans le portrait de Lady Carlisle, il y a deux mots à mon adresse. Je crois que je suis impertinente mais ce n’est pas pour affecter un pouvoir que je n’ai pas. C’est tout simplement quand on me gêne ou m'ennuie. Cela m'est même arrivé hier deux fois le matin, & le soir. J’ai vu beaucoup de monde Brougham pendant deux heures. Celui-là m’a amusé, et intéressant. Il était hier plein de sens. Certainement un grand désir de la paix. Quand on a tant d’esprit pourquoi n’avoir pas un peu plus de courage. Lui & Lundhurst cherchent. [?] les aider. J'avais hier ici un anglais, Ministre au Mexique, et Thone. L'Anglais a dit toutes les sottises possibles de l'Autriche. J’ai eu de la peine à l’arrêter. Heckern était là aussi, un peu gêné avec l'Anglais. La petite scène vous aurait amusé. L'Anglais est un Irlandais que rien n'intimide. Les Collaredo m'ont interrompu. Il y a plus une minute à perdre. Adieu.
127. Schlangenbad, Mardi 5 septembre 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Il me parait clair que nous n’avons pas accepté, mais le refus est-il absolu, ou bien voulons-nous seulement traîner ? J’attends. Voilà ce que j’ignore.
Toujours une lettre de Constantin. Les nouvelles de Paris et de Londres sont bien tristes sur les pertes que le choléra a fait éprouver avec armes. Ceux qui n'en sont pas morts sont fort démoralisés, et l'on est mécontent du chef. Il est mort 3000 h. de la seule division de Canrobert. En tout, on estime la perte dans les deux armées alliées à 15 m.
Le gl l'Espinasse est venu excuser expliquer les mouvements ou plutôt l’inaction. On dit de lui qu'il est fou. Grande incertitude si l’expédition se fera ou non. Cela dépend des amiraux. C’est vraiment bien triste de penser à tant de victimes de cette malheureuse guerre. Les Woronsow partent demain. Les derniers jours ont été très tendres. Ils auraient pu l’être plutôt. Je trouve qu'on ne m'apprécie pas assez, quand on commence, & lorsque cela arrive c’est trop. Je les regretterai ; pas beaucoup. Je ne m'ennuie pas énormement. Il me semble que je partirai le 12. Mais je n'en suis pas sûre encore. Vos saurez cela à temps. Adieu. Adieu.
127. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce qu’on veut faire me semble clair, on vient de prendre Kimburu, ou prendre Oczakoff, et on partira de là pour remonter jusqu'à Nicolajeff. Je me figure que ce ne sera pas cette année ; les préparatifs pour une campagne navale dans un fleuve, doivent être long et la saison fera bientôt, obstacle à tout. Ce sera pour le printemps prochain. On dit que, Nicolajeff tombé, il vous sera absolument impossible de défendre la Crimée, si elle n’a pas été conquise d’ici- là.
J’ai grande compassion de votre nièce Louise, et je plains son mari d'aller faire cette triste guerre, que vous ne ferez certain nement pas sans gloire, mais où votre principale espérance est, ce me semble, de la prolonger indéfiniment et de lasser vos ennemis sous le poids de leurs succès. On dit que vous ne voulez pas de la paix. Je voudrais qu’on me dit qui en veut.
Vous devriez faire, demander, à la circulating Library de Galignani, deux nouveaux romans anglais, North and South, de Mistriss Gaskall, ce Merkland, par l’auteur de Margaret Maitland que je vous engage aussi à lire. Tous les trois sont pleins de vérité et d'intérêt. Les éditions que mes filles ont ici sont si fines qu'elle ne vous serviraient à rien ; mais les éditions originales Anglaises sont en assez gros caractères, et Galignani doit les avoir à la fin de la matinée vers 6 heures quand je suis las de travailler, je lis les romans qui m'intéressent vraiment beaucoup.
J'ai vu deux lettres de Constantinople, assez curieuses, en ce qui touche l’armée anglaise, elle se fortifie, et se reforme. Il y a beaucoup d’ardeur parmi les officiers, un désir passionné de retrouver leur part de succès, et les nouveaux soldats profitent des exemples Français. Ils travaillent davantage, supportent mieux la fatigue. Ceux qui écrivent sont des officiers français blessés et point suspects de complaisance anglaise.
Onze heures
Brougham pacifique, Lyndhurst pacifique, Gladstone pacifique, d'Israeli pacifique. Qu'importe ? J'écrirai à la Duchesse de Sutherland. Adieu, adieu. G.
127. Val-Richer, Mardi 11 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passe-temps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra. Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ? L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation, d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive, n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ; mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.
127. Val Richer, Jeudi 27 juillet 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je lisais tout à l'heure dans le Moniteur la déception des arrangements de la place Louis XV qui seront terminés dans quelques jours. Cela m'a serré le cœur. Je suis décidé à ne les trouver bons que quand vous en jouirez.
Lord Aberdeen a eu ses subsides de guerre sans difficulté. Avez-vous remarqué, il y a quelques jours l’éloge qu’ont fait de lui Hume et Bright ? Il a les suffrages des radicaux pacifiques, et qui, joint aux dévots pacifiques qui l’aiment aussi, lui fait une force réelle malgré son impopularité parmi les belliqueux. Curieux spectacle à observer que celui de la décomposition et de la composition de partis en Angleterre. Il sortira de là un gouvernement meilleur, plus juste, plus éclairé et plus doux à l’intérieur, moins. intelligent, moins sûr, moins fort et moins grand à l'extérieur.
La discours de Lord John contient obscurément tout ce que vous a dit Morny sur les bases de négociation convenues entre la France et l'Angleterre. Vous en passerez par là, ou l'Europe sera radicalement bouleversée.
Le difficile, dans ce plan, c'est la station fortifiée à trouver dans la Mer noire pour que des forces Anglo-françaises s’y établissent en sûreté, et surveillent de là vos forces à vous, quoique réduites. Grande nouveauté qu’un établissement de ce genre commun, à deux nations, dans l'hypothèse d’une alliance perpétuelle. La paix perpétuelle de l'abbé de St Pierre n'était pas plus chimérique. Et quelle dépense pour une surveillance permanente, au bout de l'Europe ! C’est une rude entreprise de lutter contre la Géographie.
Qu’est-ce que le général Butturtine qui a été blessé à Giurgiu. J’ai comme autrefois. un jeune comte Boutourlin qui m’avait l’air d’un homme d’assez d’esprit.
Midi.
Mon facteur arrive tard, pendant que je déjeune. Adieu, adieu. G.
128. Paris, Mardi 23 octobre 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Les deux Scandinaves ont eu l'ordre de paraître à tous les Tédéum futurs, je crois vous avoir déjà dit cela. Un signe de déplaisir ici à tout de suite fait qu'on s’est soumis. On ne faisait pas mieux sous le premier Empire. Le fait est que vous êtes très puissants.
Canrobert va porter à Stokholm la légion d’honneur au roi. Il fera sans doute plus que cela. Les Brabant se séparent d'ici avec tant de chagrin qu'on dit qu’on a obtenu jusqu’à Samedi au lieu de demain. La duchesse est enivrée. On s’amuse beaucoup, surtout les jours où il n'y a pas spectacle. On fait des charades, & &. La gaieté est générale. Je ne sais pas si Nicolaief est abordable, mais c’est certainement là le but.
Je vois Morny presque tous les jours il avait dîné hier à St Cloud, il y déjeune aujour d’hui. Colloredo est fort dégagé. Quand je lui dis " vous êtes l’allié de nos ennemis" il me dit que c’est pour nous servir, et que l'Autriche ne pense qu'à cela c-a-d à la paix, et qu'on y parviendra. Adieu. Adieu.
128. Paris, Vendredi 7 septembre 1838, Dorothée de Lieven à François Guizot
Monsieur,
J'aurais bien envie de ne vous envoyer que cela, pour me venger du madame. J'en suis enragée. Savez-vous la réflexion que j’ai faite en recevant votre lettre ce matin, c’est que même dans une relation comme la nôtre on a tort de dire tout ce qu'on a sur le cœur, de l'écrire s’entend. Il ne faut jamais tout écrire, cela veut dire qu'il ne faut jamais être séparé. En paroles on peut tout se permettre il faut même tout dire, mais je ne vous écrirai plus rien de ce qui me passe par le cœur. Je vous manderai des nouvelles si j’en sais et pas autre chose. Vous m'avez fait du mal l’autre jour ; je vois que je vous en ai fait à mon tour. Et puis arrive votre Madame et je vous renvoie un Monsieur. Voyez où tout cela nous mène ? Mettrai-je un adieu pour terminer ? Surement c’est comme cela que cela finirait, si vous étiez là près de moi.
Je ne sais plus ce que j’ai fait hier. Je crois que je me suis promenée à pied au bois de Boulogne. C'est cela ; le temps était mauvais, je n'ai rien entrepris de lointain. Le soir j’ai vu beaucoup de monde et je n'ai pas appris grand chose. Pozzo s'annonce pour la fin de ce mois au grand contente ment des jeunes Pozzo qui devaient partir ce matin pour l'Angleterre, & qui restent. Fagel arrive demain. Les Holland mardi. Les Granville mercredi on parle beaucoup du général Bugeaud & du général Brossard. Quelle sale affaire ! De la Suisse, on ne sait qu’en dire. On croit toujours que la Suisse s'humiliera parce que tout le monde le veut ainsi. Un voyageur russe arrivé hier raconte que le grand duc est allé à Weymar. Une lettre que j’ai écrite à mon mari à Erns ne l’y aura donc pas trouvé. De Weymar mon frère m'a promis de me mander quelque chose de clair sur mes affaires, mais je ne crois plus aux promesses de personne.
Vous allez tant aimer le Val-Richer que vous serez désolé de rentrer à Paris. Regardez, voilà que la jalousie me gagne. Ah le mauvais cœur que le mien ! J'ai beaucoup causé avec la petite Princesse sur Mari. Elle a beaucoup plus d’esprit que moi et elle croit que Marie est en train de devenir folle. Serait-il possible ? Elle hait mon fils Alexandre, pas autant que vous, mais elle est en chemin. Je suis très troublée de cette idée. Je n’attends que Lady Granville pour voir ce qu’il y aurait à faire. Adieu. Adieu, si vous voulez je garnirais d’adieux, toute cette demi page. Ne me faites point de belle morale mais envoyez. moi ces petits mots là. Adieu.