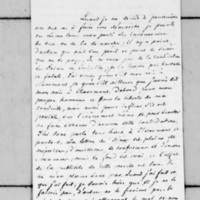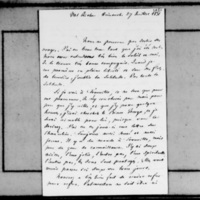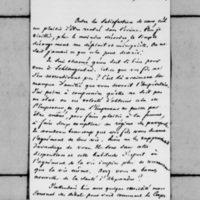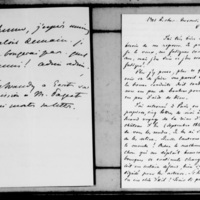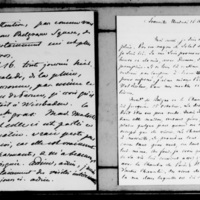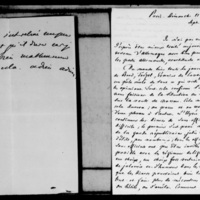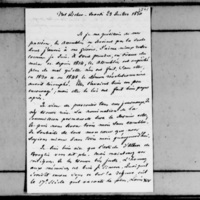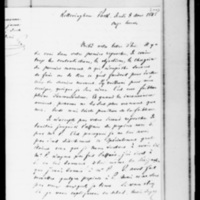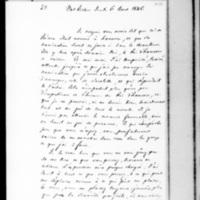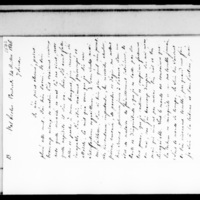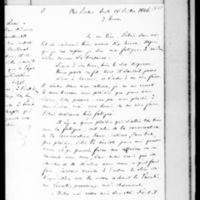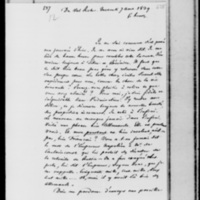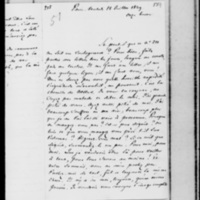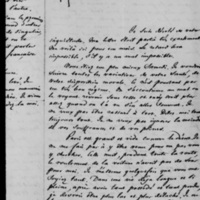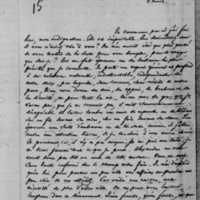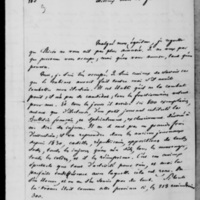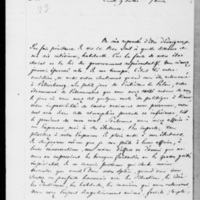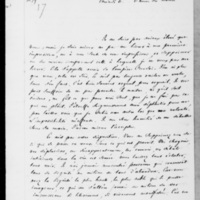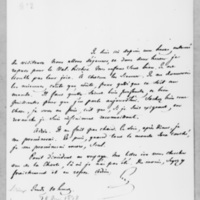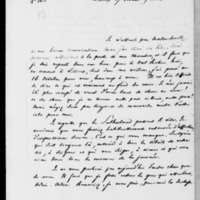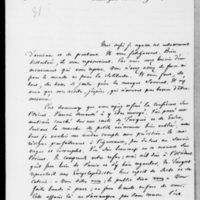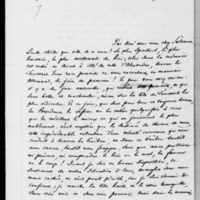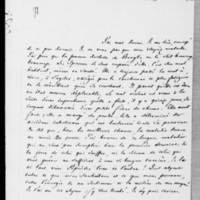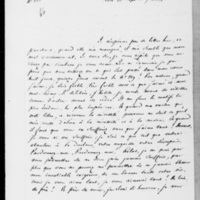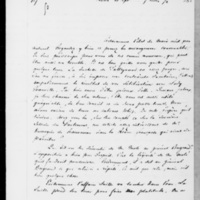Votre recherche dans le corpus : 144 résultats dans 3515 notices du site.
Val-Richer, Mercredi 5 novembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve vraiment comique les prédictions et ces bravades contraires que s'adressent les amis du Président et ceux de l'Assemblée comme pour se faire peur mutuellement et d'avance, sans doute dans l’espoir d'avoir, au moment du combat, meilleur marché les uns des autres. C’est bien Gascon et bien puéril. Le chef d'œuvre du genre, c’est Thiers ayant peur d'être arrêté et le Président lui faisant dire de n'avoir pas peur et qu’il ne le fera pas arrêter. Ce sont là des façons du temps de la Fronde qui ne vont plus au nôtre, quelque irrégulier et inattendu qu’il soit tout cela ne supporte ni la presse, ni la tribune au milieu des formes publiques et graves de nos gouvernements et de nos révolutions, ces finesses deviennent des enfantillages ce qui était de la gaieté devient du ridicule ; les hommes se diminuent à jouir de vieux jours. Voilà les réflexions pédantes de ma solitude.
Je parie toujours pour mon même dénouement. Rejet de l'abrogation, patience du Président, modifications indirectes de la loi du 31 mai par l'Assemblée ; acceptation de ces modification par le Président ; rentrée de l’ancien ministère, sauf Léon Faucher. M. de Lamartine a fait bien d'avoir un rhumatisme aigu à Macon, cela le dispense de figurer, en personne dans cette journée des dupes.
Quand j’ai lu mes lettres de Paris et les journaux, je ne pense plus à tout cela, je suis tout entier dans mon discours d'Académie qui me plaît à faire. J’ai déjà une grande satisfaction. Je suis sûr que je serai court. Quelque réduction que M. de Montalembert, fasse subir au sien, il restera long et quelque curieux que soit le public de cette séance, il ne faut pas le mettre à l'épreuve de deux longs plaisirs.
Est-il vrai que Lord Palmerston ait adressé au Cabinet de Vienne quelque explication sur le séjour et le bruit de Kossuth en Angleterre ? Cela me paraît peu probable. Je trouve que le journal des Débats fait à Kossuth une guerre très spirituelle, et qui devrait être efficace si quelque chose était efficace contre les Charlatans et les badauds. On fait trop de bruit de la circulaire du ministre de la guerre. Que ses paroles aient été écrites à mauvaise intention, cela se peut mais on n'en est pas à faire du bruit pour les mauvaises intentions, et il y a là une question que les hommes d’ordre doivent laisser dormir sauf à se bien défendre si on abuse un jour contre eux du principe de l'obéissance militaire qui est tous les jours leur sauvegarde.
4 heures
Merci, merci. Le plaisir de voir votre écriture efface le chagrin de vos nouvelles de Claremont. Faiblesse déplorable et ridicule. Que deviendra tout cela ? La situation paraît bien tendue. Je persiste à ne pas croire aux grands coups. Adieu. G.
Et Adieu.
Val-Richer, Jeudi 23 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voulais rentrer à Paris du 2 au 5 novembre. Ma réponse à M. de Montalembert exige, absolument huit jours de plus. Je veux l'apporter à peu près terminée, et il n'y a pas moyen pour moi de travailler un peu de suite à Paris surtout quand j’y arrive. Je ne rentrerais donc que du 10 au 12. Et Falaise me fait perdre deux jours. Ce retard me déplaît beaucoup, et à vous, j'espère autant qu'à moi. Bien à cause de vous seule, et de mon plaisir à me retrouver auprès de vous, car je ne me sens aucun empressement à rentrer dans cette atmosphère d'activité bavarde et vaine. La solitude rend sérieux et difficile. Je le deviens tous les jours davantage. D'autant plus que je vois clairement, pour le bon parti, une bonne conduite à tenir, je ne dis pas qui le conduirait promptement à son but mais qui certainement, l’y ferait marcher et qui en attendant, le lierait intimement au pays de l'aveu et de l’appui duquel il ne peut se passer. Mais cette bonne conduite, on ne la tiendra pas ; elle exige trop de bon sens de patience, et de sacrifice des fantaisies personnelles. Connaissez-vous un pire ennui que de voir faire et défaire soi-même de compagnie, des fautes qui déplaisent autant qu'elles nuiront, et de se donner beaucoup de mouvement pour aboutir, le sachant, à beaucoup d'impuissance ?
Le discours de M. de Montalembert est un ouvrage, un long ouvrage beaucoup trop bong, excellent au fond, très hardi, et souvent très beau dans la forme. Ni l'Académie ni son public n’ont jamais rien entendu de si hautement et brutalement anti-révolutionnaire. La vérité y abonde ; la mesure et le tact y manquent. Ceci entre nous. C’est toujours l'homme qui, selon le dire de M. Doudan, commence toujours par les paroles : " Soit dit pour vous offenser " Certainement, ni la Commission de l'Académie, ni l'Académie elle-même, si on est obligé de recourir à elle avant la séance, ne laisseront passer ce discours tel qu'il est. Je m'attends à une vive, controverse intérieure et antérieure. On demandera à M. de Montalembert beaucoup de changements, et le changement d'abrègement sont indispensables, pour son propre succès J'appuierai auprès de lui ces changements-là car je désire son succès autant que lui-même ; d'abord parce qu'il le mérite et aussi parce que son succès sera bon pour la bonne cause Quant au fond des choses, je défendrai son discours contre les gens à qui il déplaira et contre ceux qui en auront peur, sans qu’il leur déplaise. Ne parlez de ceci, je vous prie qu'à des amis de M. de Montalembert ; je ne veux pas qu’il puisse me reprocher d'avoir ébruité d'avant son discours. Mais si vous voyez son beau frère Menode, il n’y à pas de mal qu’il sache un peu mon impression et ma prévoyance.
Berryer a raison de se présenter pour l'Académie. Je crois pleinement à son succès. Cependant il faudra en prendre soin. Bien des gens croiront faire par là de la politique et en auront peur. Le Gouvernement qui, à la vérité, n'a à peu près aucune influence dans l’Académie, lui sera certainement fort contraire. S'est-il assuré de ce que fera Thiers ?
Si vous voyez Vitet soyez assez bonne pour lui demander de ma part des nouvelles de Duchâtel. Il m’a écrit. Je lui ai répondu au moment de la mort de ma petite-fille, depuis, je n'ai rien reçu de lui. Je pense pourtant que ma lettre lui est arrivée.
Onze heures
Il ne faut pas de défaillance et je suppose que Chomel n'a pas compté pour longtemps sur l'artichaut strict. Adieu, Adieu. G.
Broglie, Jeudi 18 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà vos deux lettres. Celle d’hier me convient, puisque vous avez dormi. Ne vous couchez-vous pas trop régulièrement à une heure trop constamment la même ? Peut-être feriez-vous bien de ne vous coucher que lorsque vous avez envie de dormir, tôt ou tard selon que l’envie de dormir vous vient. L’irrégularité est difficile à pratiquer systématiquement. Pourtant vous êtes bien maîtresse de votre temps et de vous-même. Le pire, c'est d'être dans son lit sans envie de dormir ; elle ne vient pas là ; il faut l’y porter.
J'espère que votre lettre à l'Impératrice fera l'affaire de votre fils Alexandre. Mais je persiste ; un état de choses où il faut faire mouvoir tant de ressorts et avec tant d’incertitude, pour avoir un passeport n'est pas de mon goût. J'aime mieux plus d’orages, et être libre d’aller et venir comme il me plaît, quelque temps qu’il fasse. Autre dissidence entre nous. Quand j'étais jeune, je faisais comme vous faites ; je méprisais beaucoup, et j'exprimais très haut mes mépris. Aujourd’hui non seulement je méprise moins haut, mais je suis moins prompt et moins dur dans mes mépris. Si je m'y laissais aller, ils iraient trop loin.
Je serais étonné si le Prince de Metternich était de votre avis sur l'article des Débats malgré le fracas assez ridicule qu’on y a fait de ses courriers et de son regain de crédit. Montebello aura parfaitement raison d'aller à Claremont avant le 4 novembre, et d’y dire ce qu’il y veut dire. Il a l’esprit aussi droit et aussi courageux que le cœur. On paye cela assez cher ; mais en définitive, cela vaut plus que cela ne coûte.
Je trouve qu'on meurt bien vite dans ce moment-ci. Un de mes amis du Calvados, membre éclairé et influent du conseil général vient de mourir subitement d’un anévrisme. Le Duc de Noailles fait vraiment une perte. Est-il capable de beaucoup d'affection et de chagrin ? Je lui écrirai un mot de condoléance.
La vie se passe ici fort tranquillement, et on me sait évidemment beaucoup de gré du mouvement que j'y apporte. Ils sont à merveille entre eux mais peu animés et peu expansifs. Le château a été plein hier de visiteurs. Aujourd’hui grande chasse dans la forêt pour les jeunes gens. Ils sont montés à cheval sous mes fenêtres à six heures et demie, pour aller courir un chevreuil.
La jeune Princesse de Broglie est très fatiguée de sa grossesse, maigrie et abattue. Désirant bien vivement une fille. Elle a trois petits garçons qu'elle élève bien. Aussi bonne de caractère que d’air. M. et Mme d’Haussonville viendront ici au mois d'octobre.
Le Duc de Broglie est comme vous sinon en principe, du moins en résultat. Vous êtes très président ; il est, lui, très résigné au Président, ne voyant ni mieux, ni aussi bien, ni autre chose. Tout le reste est intrigue et aventure. En attendant un grand événement, s’il est jamais possible, il ne faut avoir que des événements naturels et tranquilles. Je ne suis pas pressé que Lopez soit tué.
Autant vaudrait qu'on fût assez, et assez longtemps inquiet de cette affaire de Cuba pour qu'on en parlât un peu sérieusement et de concert, aux Etats-Unis. Adieu, Adieu. Dormez donc.... Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Femme (maternité), Femme (politique), Femme (portrait), Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Mort, Portrait, Portrait (Dorothée), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), VIe quotidienne (Dorothée)
Val-Richer, Lundi 8 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quand je me décide à poursuivre un but ou à faire une démarche, je prends en même temps mon parti des inconvénients du but, ou de la démarche ; il n’y a point d’action qui n'ait son péril et point de succès qui ne se paye.
Je ne veux pas de la candidature du Prince de Joinville ; je la trouve peu honorable et fatale. J'ai voulu qu'on sût mon avis à Claremont, et qu’on sût ailleurs que j’avais dit mon avis à Claremont. D'abord pour mon propre honneur, et pour la liberté de ma conduite, mais aussi pour influer, s'il est possible sur l'événement même et pour écarter ou faire échouer d'avance cette candidature. J’ai donc parlé tout haut à Claremont et partout.
La lettre du Times est pleine de méprises, d'omissions de confusions et d'incon venances ; mais le fond est vrai, et l'effet de la publicité de cette vérité est bon. Je ne m'en plains donc pas. Quand j’ai fait ce que j’ai fait, je savais bien que si je ne le faisais pas, d'autres ne le feraient pas. Je suis de ceux qui attaquent le mal et non pas de ceux qui se contentent de le critiquer. Soyez tranquille ; je ne serai pas brouillé avec Claremont pour cela. On y a certainement beaucoup d'humeur contre moi ; mais on ne se brouille pas parce qu'on a de l'humeur. Tous les Princes sont prudents. Et puis il y en a là qui m’approuvent, quoique je les embarrasse.
L'article du Constitutionnel sur les Débats est bien inopportun. Quand on veut réussir, il faut savoir se taire et être modeste dans le succès ; mais peu importe le succès aux journalistes. Ils sacrifient tout au plaisir de la vanterie et de la taquinerie. Énorme difficulté dans les affaires.
Mad la Duchesse d'Orléans a quitté Claremont avant que M. le Duc d’Aumale y fût arrivé. La délibération de famille ne sera donc pas complète ; il y manquera une grosse pièce. On ne donne pas ses pouvoirs indéfiniment en pareil cas. Je trouve ce voyage de Mad. la Duchesse d'Orléans assez singulier dans ce moment. Du reste ils peuvent rester encore indécis et silencieux. Elle sera sûrement de retour à Claremont au mois de Novembre. Je suis curieux de savoir si Thiers restera à Paris. Son journal l'Ordre devient bien violent contre les légitimistes et les fusionnistes.
10 heures
Je n'ai que le temps de fermer ma lettre. Je viens d'en écrire une très longue à Croker qui en avait besoin pour le L. R. Merci des détails que vous me donnez. Je suis bien aise que Changarnier aille à Champlâtreux avec Montebello. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 30 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai un ennui aujourd’hui ; je vais dîner à Lisieux. Le mouvement physique commence à me déplaire beaucoup. Signe de vieillesse. Du reste, il ne m'a jamais plu. Toute l'activité possible, assis dans mon cabinet ou en me promenant dans mon jardin, la méditation, la discussion, la conversation, les grandes affaires dans un intérieur tranquille, et presque immobile, voilà ma vie de choix. C'est l’évêque du département qui vient faire sa visite pastorale à Lisieux, et il a désiré dîner avec moi. J’ai, plus que jamais, le vent des évêques et des curés.
Le conseil d’Ellice à Lord John sur Lionel Rothschild est un acte d'insolence révolutionnaire envers la Chambre des Pairs qui y répondra, je l'espère, en ne recevant pas le nouveau Pair. Je ne pense pas que Lord John suive ce conseil. M. de Metternich dit vrai quand il dit que tous les Anglais sont un peu fous ; mais il est également vrai de dire que tous les fous anglais ont un peu de bon sens. Je ne m'étonne pas que Gladstone ait publié une lettre sur Naples. Il m’avait paru très animé à ce sujet. J’ai peur que la plupart des faits qu’il aura dits ne soient vrais, et que là ne se prépare une triste réaction. Mais je n'admets pas qu’il y ait aucune conséquence à en tirer en faveur de la politique de Lord Palmerston envers Naples. Le mauvais gouvernement intérieur du Roi de Naples ne donne à Lord Palmerston nul droit de faire là de la mauvaise politique internationale.
Avez-vous entendu dire quelque chose d'un projet de Thiers d'aller faire un voyage en Allemagne en revenant des Pyrénées ? Est-ce qu’Ellice et lui se seraient donné rendez-vous là ?
10 heures
Je n'ai que le temps de vous dire adieu. Il m’arrive plusieurs lettres insignifiantes, mais auxquelles il faut répondre un mot tout de suite. J'adresse toujours à Ems comme vous le voulez. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 27 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
Paris, Samedi 12 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
La rumeur de la visite à Claremont, va croissant. Et aussi l'humeur en certains lieux. On dit que le Président et ses ministres en sont très préoccupés. Je le comprendrais s'ils étaient, comme moi, des philosophes patients et regardant au loin dans l'avenir. Mais pour des hommes d'affaires et d'affaires à courte échéance, je m'en étonne. Ils sont bien bons. Le fait n'a pas d’importance directe et prochaine. On n’a rien réglé, rien avancé ; on est resté dans la situation où l'on était, et que l’en connaissait. Seulement on s’est mutuellement exprimé des sentiments, et fait des politesses qui un jour rendront l’événement plus facile et qui, d’ici là, rendent tout autre événement plus difficile. C'est beaucoup à mon avis ; mais ce n’est pas redoutable pour 1852.
J'ai dîné hier à Passy, chez François Delessert. J’ai été frappé de la vivacité du sentiment des femmes de la famille pour Mad. la Duchesse d'Orléans, ses enfants, ses droits & C'est comme Mad. de Ségur, Mad. de Vatry, Mad. Rothschild &. Il faut que l’idée de la légitimité monarchique soit bien naturelle, car elle naît bien vite. Mais en même temps, on est bien aise, là, de tous les symptômes de conciliation et de paix entre les personnes et les partis. Si le mot de fusion était venu s'en mêler, c'eût été autre chose ; on l'aurait repoussé. Mais on aime la conciliation, et on me questionnait sur la visite avec bienveillance et en s'en félicitant.
La poste est venue et ne m'a rien apporté de vous. Vous m'aurez-peut-être déjà écrit au Val Richer. Je pars toujours ce soir, sans savoir quel jour ma fille aînée pourra venir me rejoindre ; il faut que son enfant soit tout-à-fait bien. Elle a confiance dans le médecin qui la soigne ici. Je travaillerai je lirai et je me promènerai en attendant.
Une heure
Je renvoie les visiteurs et je ferme ma porte ; je n'aurais pas le temps de ranger mes papiers et de faire mes malles. Dumon a causé hier longtemps avec Bocher qui est parti de Claremont après les visiteurs. Le dire de Bocher, confirme pleinement le récit de Berryer.
Voici deux phrases assez significatives, dans la conversation au moment où il était question de l’exil des Princes, le duc de Nemours a dit : " M. le comte de Chambord peut être bien certain que nous ne désirons, et que nous ne tenterons rien contre ses intérêts. Ceci allait à l'adresse de la proposition Creton, et pour écarter la crainte d’un coup de moins régentiste. Bocher a conduit la Reine mardi au chemin de fer d’Edimbourg ; elle lui a dit : " Nous avons été très contents d'eux et j’espère qu’ils ont été contents de nous. " Thiers, Lasteyrie, et Duvergier de Hauranne sont visiblement troublés et fâchés.
Ma petite fille va mieux mais doucement. Adieu. Adieu.
Je compte trouver votre lettre demain, au Val Richer. Adieu. G. Grande réunion hier soir à la rue de Rivoli. MM. Nettement et Léo de Laborde ont vivement poussé Berryer pour qu’il leur redit tout ce qu’il était allé dire et tout ce qu'on lui avait dit. Il a vivement repoussé leur curiosité radicale, et avec très grand succès. Approbation presque unanime de la réunion. G.
Mots-clés : Autoportrait, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Enfants (Guizot), Famille royale (France), Femme (politique), Femme (statut social), Politique (Analyse), Politique (France), Réseau social et politique, Salon, Santé (enfants Guizot)
N°35. Val-Richer, Jeudi 8 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
A part la fatigue les bains de Schlangenbad vous ont-ils fait quelque bien ? Vous êtes-vous baignée régulièrement ? Et l'Impératrice, comment s'en est-elle trouvé ? Le mois de Juillet vaudra mieux que celui de Juin pour des eaux allemandes. Par cette chaleur-là, les environs d’Ems doivent être charmants. Je conserve une impression singulièrement vive des lieux qui m'ont plu, et où je me suis plus.
A mesure que les élections anglaises, approchent, il me semble que leur aspect en plus favorable à Lord Derby. La question sera décidé ces jours-ci. Je veux du bien à Lord Derby quoi que je n'en espère pas beaucoup. Si Lord John ou sir James Graham reviennent au pouvoir ils y feront les affaires des radicaux, ce qui fera, sur le continent, les affaires, soit des révolutionnaires, soit des absolutistes. Ni les unes, ni les autres ne sont les miennes. Ceci ressemble presque à une provocation. Ce n’est pourtant pas mon goût. Je n’aime pas du tout à me disputer avec les gens que j’aime. J’aimerais bien que nous fussions toujours du même avis. Mais puisque vous êtes toujours du même avis que le Prince Charles de Prusse, il n’y a pas moyen.
Il m’est arrivé ces jours-ci de l'administration locale, une question très bienveillante, elle m’a demandé, si je voulois être porté au conseil général dont les élections se feront bientôt, comme de raison, j’ai répondu que non, que je voulais rester en dehors des affaires comme de l'opposition. Je n'ai jamais vu l’horizon plus calme. Pour mieux dire, il n’y a rien du tout à l'horizon. C'est même là le mal principal de la situation. Il faut qu’un gouvernement ait devant lui un avenir. Celui-ci est traitement renfermé dans le présent. C’est là ce que je crains pour lui ; il ne se résigne pas à une portée si courte ; il voudra étendre plus loin la main, et il se fera de mauvaises affaires sans nécessité, si ce n’est qu’il faut avoir des affaires.
11 heures
Je suis charmé de vous savoir arrivée même en compagnie de Juifs, vous devez avoir en effet grand besoin de repos. Je vous ai écrit hier qu'à moins de vraie nécessité, je n'irais pas vous voir tout de suite. Cela me dérangerait vraiment beaucoup. Ne vous tourmentez pas trop de l'avenir quant aux Ellice. J’espère bien que vous n'aurez pas à y renoncer. En attendant, vous allez avoir Aggy. Nous verrons ce qu’il faudra faire pour vous l’assurer, elle ou la sœur. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Elections (Angleterre), Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Posture politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Dispute), Santé (Dorothée), Travail intellectuel
N°34. Val-Richer, Mercredi 7 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous arrivez, je pense, aujourd’hui. à Paris. J’espère que malgré votre vaillance. vous vous serez reposée un jour à Bruxelles. Le voyage, par cette chaleur doit vous fatiguer beaucoup. Je regrette que vous ne jouissiez pas de ce temps-là comme j'en jouis. Je me promène dans mon jardin à toutes les heures. La chaleur, et la lumière, c’est la vie. à moins que vous n'ayez tout-à-fait besoin de moi, je n’irai pas vous voir tout de suite. J’attends quelques visites. Je suis en train d’un travail que je ne voudrais pas interrompre. Je me suis promis de finir cet été plusieurs choses que je tiens en effet à finir d'avance dans la vie, et j'ai l'âme encore assez pleine pour désirer que les années qui me restent ne soient pas vides. J’aimerais mieux aussi placer nos quelques jours de réunion un peu moins loin du terme de notre longue séparation. Quand vous aurez un peu entrevu ce qu’il vous convient de faire dans ce moment, vous me le direz, et j'adapterai mes plans aux vôtres.
J’espère bien qu’Aggy ne se fera pas attendre longtemps. C'est bien dommage que la maladie de cette pauvre Fanny’s soit venue troublée vos arrangements avec ses deux soeurs ; ils étaient bien bons pour vous. Vous garderez, je vois, de votre séjour à Schlangenbad. Un agréable souvenir ; agréable au coeur, ce qui vaut mieux que tout ; et aussi comme agrément d’esprit. Je ne suppose pas qu’à prendre les choses, en grand et dans leur ensemble, vous ayez beaucoup appris là ; il n’y a plus de grands secrets ; mais beaucoup de détails intéressants, et qui rectifient les idées. Il n’y a rien de si commun aujourd’hui que les idées vrais en gros et chargées d’erreurs ou pleines de lacunes. Je n’aime pas cela. J’aime à savoir les grandes choses exactement, et par le menu.
Vous ne lisez pas les feuilles d'havas. Je vous assure qu’elles le mériteraient quelque fois. Il y avait hier, sur les prétentions et le ton du gouvernement anglais dans les affaires Mather à Florence et Murray à Rome, un article excellent. On comparait ces deux affaires à celles du général Haynac et du prêtre Achille, et on demandait à l’Angleterre. si elle avait de quoi être si exigeante, en fait de police et de justice. C’était de la justice amère, et dont il ne faudrait pas tirer des conclusions générales, mais de la justice vraie et topique dans l'occasion.
Je suis curieux de savoir si lord John Russell sera élu dans la cité. Cela se décide aujourd’hui. 11 heures Je n’ai pas de lettre aujourd’hui. Je m’y attendais un peu. J’ai bien envie de vous savoir arrivée à Paris et pas trop fatiguée de cette chaleur. Adieu, Adieu. G.
N°30. Val-Richer, Samedi 3 juillet 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon gendre arrive de Paris. Il n’y a pas la moindre nouvelle. Tout le monde se promène et s'ennuie. Plusieurs mois vont se passer dans cet état. On a été un moment très troublé de l'ombre d'opposition du Corps législatif. Il a été question de le dissoudre. Le décret, dit-on a été signé. On est rassuré. La manie de l'opposition était jadis de supprimer le pouvoir ; la manie du pouvoir est de supprimer l'opposition ; ni l’un ni l'autre ne réussira.
Vous avez passé hier la journée à Stolzenfels. J'espère que vous avez eu le magnifique temps que nous avions ici. Un beau soleil est encore plus beau sur la vallée du Rhin que sur mon vallon. Je suis d’un bon caractère ; j’aime les grandes choses et je jouis des petites.
Je crois que le comte de Chambord persiste à interdire le serment, et il ne peut faire autrement. Ce sont des questions sur lesquelles on peut se taire ; mais quand on parle, il faut bien parler d’une certaine façon, et quant on a parlé d’une certaine façon, il faut bien s'y tenir. Voilà les querelles de Protestants et de Catholiques qui commencent en Angleterre. Ils se sont battus à Stockport. Il se battront peu. Le vent n’est pas à la guerre, à aucune guerre, étrangère ou civile. Ils se querelleront, se dénigreront, se verront.
Est-il vrai qu’on est très préoccupé en Prusse aussi de l’attitude agressive du catholicisme, et qu’on se disposa à ne pas se laisser faire ? Cela paraît dans les journaux, et il me revient que le Roi de Prusse, ses conseillers, ses anciens sujets, toute l'Allemagne protestante, princes et peuples, sont extrêmement sur le qui vive. Ceci influera beaucoup sur la politique.
Je me suis abonné pour trois mois au Moniteur. J’ai voulu voir la métamorphose annoncée. Il n’y paraît pas encore, et on dit qu’il n’y en aura point du tout. Moniteur et autres, tous les journaux sont insignifiants.
Si vous restez sur le Rhin, tout le mois de Juillet, il me semble qu'Aggy pourra aller vous y rejoindre ; c’est le 30 Juin qu’il lui était impossible d’y arriver, à ce que me disait Marion, je crois. Puisqu'elle devait venir vous joindre à Paris dans les premiers jours de Juillet, elle pourrait de là, aller vous chercher sur le Rhin. Du reste tout est difficile pour une personne encore trop jeune pour courir seules.
11 heures
Malgré votre N°25, je vous adresse encore ceci sur le Rhin. Vous me direz quand il faudra cesser. J'étais sûr que votre dîner en plein air ne vous réussirait pas. Je voudrais vous savoir revenue de Stolzenfels, autre plein air, Adieu, adieu. G.
23. Val-Richer, Vendredi 25 juin 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Outre la satisfaction de cœur, c’est un plaisir d'être rentré dans l’ordre. Plus je vieillis, plus le moindre désordre le simple dérangement me déplait et m'inquiète. On ne sait jamais ce que cela peut devenir.
Je suis charmé qu’on soit si bien pour vous à Schlangenbad. Est-ce que vos fils ne s'en ressentiront pas ? C'est là vraiment la marque d’amitié que vous devrait l'Impératrice. J’ai peine à comprendre qu’elle ne soit pas en état ou en volonté d'obtenir cela de l'Empereur, et que l'Empereur ne puisse pas être amené, pour faire plaisir à sa femme, à faire deux exceptions au régime des passeports. Je voudrais beaucoup que vos fils vous dussent l’agrément de leur vie. Rien ne les rapprocherait d'avantage de vous. Ils sont dans cette disposition et cette habitude d’esprit, où l’agrément de la vie inspire plus de reconnaissance que la vie même. Avez-vous de bonnes nouvelles de la santé d'Alexandre ?
J’attendais hier avec quelque curiosité, mon Journal des Débats pour voir comment le corps législatif aurait pris la lettre de M. Casabianca sur le rapport de M. de Chasseloup Laubat. Je vois seulement que beaucoup de personnes ont parlé, MM. de Montalembert, de Kerdrel, de Chasseloup deux ou trois conseillers d’Etat, et M. Billault lui-même, du haut de son fauteuil. Mais le procès-verbal détaillé n'était pas encore prêt et communiqué aux journaux hier, à 4 heures. Il aura probablement été un peu difficile à rédiger.
Les ministres Anglais, Lord Malmesbury surtout, ont l’air d'écoliers à qui le Parlement fait la leçon et qui recommencent leur tâche quand le Parlement leur a montré qu’elle n'était pas bien faite.
Voilà votre ami Bulwer qui va rentrer en négociation à Florence pour les coups de sabre de M. Mather, et qui est chargé d'obliger le grand Duc de Toscane à dire, s’il répond ou non, de ce qui se passe chez lui. Ainsi les plus petits incidents ramènent les plus grandes questions. Et M. Mornay, sera-t-il ou ne sera-t-il pas pendu à Ancône ? A Dieu ne plaise que je regrette si un homme n’est pas pendu ; mais vraiment, si M. Mourray est l’un de ces mauvais sujets errants qui vont se faire partout où l'occasion s'en présente, les complices de l'anarchie et de l’assassinat révolutionnaire, c'est une grande indignité au gouvernement Anglais de forcer la main au pauvre Pape pour lui faire faire cette grâce. Le Pape portera ici la peine de la mauvaise réputation, très mérité, du gouvernement Papal en fait de justice et de jugements criminels.
J’ai connu, il y a quelques années, à Paris un M. de Harthausen qui était un homme d'esprit, et qui écrivait. Il avait écrit quelque chose sur le rôle et la politique de l’Autriche en Allemagne. Je ne suppose pas que ce soit là ce que l'Impératrice, s'est fait lire. Comme M. de Meyendorff lit sans doute le Français aussi bien que l'Allemand, je vous signale un article sur St Ambroise, de M. Villemain, inséré dans le Journal des Débats d’hier. Jeudi 24 ; c’est un morceau très intéressant, et assez court pour être lu tout haut. Je serais surpris s’il ne plaisait pas à l'Impératrice, et même à vous. Cependant je dois convenir que St Ambroise résistait quelques fois aux Empereurs, mais à des Empereurs qui ordonnaient le massacre de Thessalonique. On est infiniment plus juste et plus doux à Pétersbourg, au XIXe siècle, qu’à Rome ou à Constantinople, au IVe.
Onze heures
Mon facteur arrive tard et doit repartir promptement. Je regrette que vous n'ayez pu causer à l'aise avec le Roi de Wurtemberg. Voilà un chapitre au budget rejeté. On me dit que c’est celui du Ministère de la police générale. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 17 octobre octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le temps est étrangement beau et doux. Un soleil d’été sur une nature, d’automne. Je me suis promené hier deux heures. J’avais trop chaud. Vous auriez beaucoup joui de cet avis-là. Il vaut mieux que celui du bois de Boulogne. Mais dans quinze jours nous serons en hiver. Il ne faut pas s’attacher à ce soleil. Je n’y penserai pas quand je serai avec vous. Mais, hors ce qui me plaît par dessus tout, la liberté, le repos et les spectacles de la campagne, me plaisent maintenant plus que le reste. La nature a du bon sens et de la grandeur.
10 heures
Kisselef a tort d'être si troublé. Certainement, s’il y a guerre en Allemagne (ce que je ne crois toujours pas), il y aura en France à l'Elysée et dans les journaux, des velléités de s'en mêler. Des velléités sincères, et des velléités hypocrites. Le public, le vrai public n'en voudra pas. L'assemblée sera comme le public ; le ministère comme l’assemblée ; et on ne s'en mêlera pas. Et l'Elysée sera fort aise qu’on ne veuille pas s'en mêler, et qu’on ait l’air de croire qu’il voulait s'en mêler. L'ancienne politique subsistera. Il n’y a plus en France, de gouvernement capable de la changer, ni de l'avouer. On en voudra le profit, en en éludant la responsabilité. Ce sera le Général Lahitte qui en aura l'honneur.
A propos du Général Lahitte, je vois dans tous les journaux qu'on veut le nommer à l’assemblée pour le département du Nord, et dans la Gazette de France qu'il y a, dans ce département, des gens, conservateurs, et légitimistes, qui pensent aussi à moi. Je n'en ai point entendu parler, et je n’ai pas besoin de vous dire que je n'en veux pas entendre parler. Le Moment n’est pas venu, et on a grande raison de porter le Général Lahitte. Je lui donne ma voix.
L'Indépendance Belge m'amuse. Vous savez mon billet à Morny. Je prévoyais bien qu’on en ferait un peu de bruit. A la bonne heure. Je ne l’ai pas écrit parce que le bruit, mais quoique. Un avis très décidé, et dit très haut, et une entière liberté d’attitude et de langage quotidien, c'est mon parti pris. Je suis plus indépendant que l'Indépendance Belge. La fusion de l'autre côté du fossé ; le Président tant qu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, ou qu’on ne sait pas sauter le fossé; voilà mon avis, et je ne m’en gênerai pas de le dire, et de le pratiquer.
Ecrivez-moi à Broglie, (au château de Broglie, par Broglie. Eure) lundi, mardi et mercredi. Je n'en partirai que jeudi après le déjeuner. Le courrier y arrive à 9 heures du matin. J'y vais seul. Le médecin de Pauline ne veut pas qu'elle remue au delà du strict nécessaire. Entre nous, mes deux filles. sont grosses. Elles ne le disent pas encore. Je persiste à croire que Mad. Rothschild a raison, et que le Général d'Hautpoul s'en ira. Adieu, Adieu G.
Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
J’ai très bien dormi. J’ai besoin de me reposer. Je puis encore, quand je le veux, me fatiguer comme il y a douze ans ; mais j’en suis et j'en reste quelque temps fatigué. Plus j’y pense, plus ce que je viens de voir, et de faire, me paraît bon. Maintenant la bonne conduite doit conduire au succès avec un peu de bonheur pourtant, c’est à dire un peu d'aide de Dieu.
J'ai retrouvé à Paris, en rangeant mes papiers cinq lettres de moi à vous, le second voyage de la reine d'Angleterre au château d'Eu (septembre 1845). J'ai oublié de vous les rendre. Je les ai ici. Je viens de les relire. Quelle lanterne magique que le monde. Outre le malheur, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup dans ces brusques et continuels changements de scène ; c’est un certain défaut bien involontaire de dignité pour les acteurs. Si haut et si bas en un clin d'œil ! Tenir si peu et pouvoir si peu ! Des marionnettes, sans cesse remuées par des fils invisibles ; des plumes, dans l’air flottant en tous sens, sous des souffles inconnus. J'ai bien envie de finir comme Massillon commence son oraison funèbre devant le catafalque de Louis XIV : " Dieu seul est grand. "
M. de Witt est revenu de Cherbourg. Le Président mieux traité le second jour que le premier, et le troisième que le second. A tout prendre, accueil médiocre. La flotté très exacte, dans ses houras. (sept) au coup de sifflet, mais très froide. Les matelots Joinvillistes. Les officiers partagés, les uns Joinvillistes, les autres républicains. La population amusée, et indifférente beaucoup plus occupée du spectacle que de l'acteur principal. Petit, très petit complot des rouges pour crier sans relâche, sur ses pas, " vive la république sociale ! " Le peuple haussant les épaules et repoussant les gamins, avec mépris mais sans colère, Très bonne tenue de la troupe, faisant son devoir avec calme. Concours immense. Grande difficulté de trouver à manger. Quatre dîners de table d’hôte par jour dans toutes les auberges, et bien des gens ne parvenant pas à dîner. La flottille anglaise bien reçue et charmée de sa visite. quand le Président a passé devant elle en visitant la flotte, il a été accueilli par des houras très vifs.
10 heures
Je suis bien fâché de votre mal de gorge. Je ne peux pourtant pas me résoudre encore à vous envoyer à Madère. J'espère que ce ne sera pas long. Ne manquez pas, je vous prie de me dire aussi quand ce sera passé. C'est bien dommage que nous n'ayons pas rencontré Thiers sur la route, entre Esher et Claremont comme Salvandy.
Je doute un peu de la nouvelle de la Princesse Mathilde ; elle aura parlé d’un projet comme d'un fait. Je reçois un mot de Marion qui me dit que décidément ils quittent Brighton du 16 au 20, et qu’ils seront à Paris au commencement d'octobre. Vous le savez sûrement déjà. Adieu, adieu, adieu. G.
Trouville, Jeudi 22 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous rendez compte dans la perfection. Reste à mettre à sa juste valeur l'impression et le dire de vos deux interlocuteurs, vous feriez cela à merveille aussi. Si vous aviez vu vous-même. Pourvu que vous laissassiez aussi à votre propre impression le temps de s'apaiser et de le juger. En tout cas, ce que vous me redites est très curieux et très important. Et il y a au bout des paroles, un fait très significatif, l’attitude prise envers. M. de la Rochejaquelein. Le jour où les hommes sérieux et sensés dirigeront au lieu de suivre, le parti sera un parti politique. Cela lui a manqué jusqu'ici. Strasbourg et Wiesbaden, la rive gauche et la rive droite, étrange spectacle ! J'attends avec curiosité des détails sur le Président à Strasbourg. Je les aurai ce matin. Il ne me paraît pas que Besançon, ait été merveilleux. Je suis frappé de ce bal où le Président s’est vu obligé d'aller et dont il s’est hâté de sortir. M. de Montalembert devrait régner à Besançon.
J’ai fait hier ma course chez Mad. Denois par une tempête de pluie, en allant et une tempête de vent en revenant. Ce que c’est que d'avoir promis. Je ne puis souffrir de faire manquer ce que les gens ont pris peine à arranger. C’est un très joli cottage dans un joli pays un peu sauvage. De bons conforts et de beaux tableaux au au milieu des bois et au bord de la mer. J’ai assez conservé la faculté de prendre intérêt quand j'y suis, aux choses dont je ne me soucie pas du tout quand je n’y suis pas. Wiesbaden est très populaire dans cette maison-là. Ce qui n'empêche pas le Président d'y être populaire aussi. On voudrait bien l'avenir qui plaît mais à condition de ne rien risquer dans le présent.
Midi
Je ne m'étonne pas que Duchâtel n’eût rien à vous dire. Il paraît que Creuznach est un vrai trou. Thiers à Bade, Duchâtel à Creuznach pendant que le comte de Chambord est à Wiesbaden, et personne ne leur en demande raison. M. Royer Collard redirait bien encore : " pour M Guizot, on ne lui passe rien. " J’avais raison sur Besançon. Evidemment le Président n'y a pas été bien reçu, s’il ne l'est pas bien à Strasbourg, le voyage sera médiocre. On comptait beaucoup sur la Lorraine et la Champagne, Nancy, Metz, Châlon, Reims. Nous verrons. Ici c'est-à-dire à Cherbourg, il n’aura ni désagrément, ni grand agrément. On l’y attend le 4 ou le 6 septembre.
M. de Daunant m'écrit des Pyrénées où, il se promène depuis six semaines, qu’il n’y trouve pas l'ombre d'un rouge ou d’un socialiste. Rien d’ailleurs dans les journaux. Est-il vrai que Radowitz tombe tout-à-fait ? Adieu, Adieu.
Je voudrais, pour votre plaisir, que vous rencontrassiez votre grande Duchesse. Elle vous intéresserait quelques heures. Adieu. G.
Trouville,Vendredi 16 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi, je suis abreuvé de pluie. Pas un rayon de soleil depuis que je suis ici. Je me suis promené hier une heure et demie avec Dumon sous mon parapluie. Si ce temps là continue, je ne resterai pas longtemps à Trouville, enfermé pour enfermé, j’aime mieux l'être au Val Richer, dans mes meubles, et avec mes livres.
Mad de Boigne et le Chancelier restent ici jusqu'au 15 octobre. Le dernier mois doit être un peu rude. Mais ils se plaisent dans cette maison autant qu'on peut se plaire quelque part quand on n’est plus occupé que de vivre. Le Chancelier se porte à merveille, se promène tout le jour et cause tant qu’on veut, ou tant qu’il veut lui-même. Au fond, je crois que la fin de sa vie lui convient assez ; il est tombé avec la Chambre des Pairs. ( Il n'y a pas d'autre Chancelier.) On vient de donner à la rue dans laquelle est ici sa maison, le nom de rue du Chancelier. Il croit que le président durera bien autant que lui. Il a assez de sécurité, beaucoup de confort, et pas mal de petits plaisirs d’amour propre. Cela lui suffit. Il a plus de sens que M. Molé. Mes enfants sont allés hier soir danser au salon. Je suis resté seul. J’ai lu à mon aise toutes vos pièces diplomatiques. Décidément, celles de M. de Brünnow sont très inférieures aux autres. L'embarras y perce à chaque ligne, et la platitude, envers Lord Palmerston, n'y manque pas. On s’occupe assez du voyage du Président. Dumon croit que ce succès, tout contesté qu’il est, pourra lui tourner la tête et lui faire faire quelque sottise. Nous avons, en France, en fait de réceptions impériales et royales, une routine magnifique qui s'applique à lui aujourd'hui et qui peut lui faire illusion. Nous verrons. On dit toujours que Strasbourg est le gros écueil.
J’ai oublié, je crois, de vous dire que les Saint-Aulaire m'avaient bien recommandé de vous parler d'eux vraiment avec amitié. Et aussi que j’ai demandé de votre part des nouvelles de Melle Augustine, la femme de Chambre qui vous a bien soignée. Elle est venue m'en remercier, rouge comme une écrevisse. Sainte-Aulaire passe ses journées à écrire ses mémoires. J’en suis bien aise. Il dira beaucoup de choses qui me conviennent, et qui ne seraient pas dites sans lui.
J'attends la poste. Elle m’apportera votre lettre, et peut-être quelque nouvelle. Adieu en attendant.
Midi
Pas de nouvelle, excepté votre aventure que j'espère bien avoir demain. Mad. de Clairville était bien étourdie et M. de Clairville bien bon homme. Evidemment la réception du Président à Dijon a été très mêlée. Ce voyage donnera de l'excitation à tout le monde, à ses ennemis comme à ses amis. De tout ceci pour peu que ceci dure encore, et quoiqu'il arrive après, il résultera que le parti républicain, modéré ou rouge restera un gros parti qui donnera d'immenses embarras. L’avenir est bien obscur. Adieu, Adieu. Cette abominable humidité me porte un peu sur les entrailles. Rien de sérieux. Adieu encore, et toujours. G.
Paris, Dimanche 11 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Sept heures
Je n’ai pas eu de lettre hier. J'espère être mieux traité aujourd’hui. Je suis revenu d'Allemagne avec bien peu d'estime pour les postes allemandes, exactitude, et promptitude. Du monde hier toute la journée. Jayr, Muret, de Bort, Frezel, Granier de Cassagnac, Lavalette, un pêle-mêle de tout ce qui reste à Paris de toute les opinions. Tout cela confirme l'idée que nous nous faisions de la situation en nous promenant sur la route de Nassau. Cela ne peut pas durer, cela durera ; on passe et on revient sans cesse d’une phrase à l'autre. L’Elysée voudrait bien continuer les dîners de sous officiers ; mais c’est difficile ; le premier s’est passé avec les sous officiers de la garde républicaine, jadis municipale, corps d'élite, peu nombreux ; tous les officiers et les sous-officiers ont pu être invités. Cela n’est pas possible avec les régiments de ligne ; il faut faire un choix, un choix fort restreint. De là beaucoup de jalousie et d'humeur dans les régiments ; en sorte que les dîners pourraient bien tourner contre leur but et faire plus de mécontents que de dévoués. On hésite, on s'arrête. Comment se passeront les voyages ? C’est la question à l’ordre du jour. Je crois plutôt au succès, c’est-à-dire au succès extérieur, apparent ; mais je ne crois pas aux résultats du succès. Il en sera comme pour les dîners ; on hésitera et on s'arrêtera, faute de confiance et de vraies bonnes chances. De part ni d'autre, il n’y a de force pour agir ; on ne peut qu'empêcher et le paralyser mutuellement.
En revenant de Bruxelles, Mad d’Hulot m'a dit qu’elle avait lu une lettre de la Duchesse de Fitzdame qui affirmait avec grande joie, que Madame la comtesse de Chambord était grosse. On le nie ici absolument. Vous devriez bien, de Schlangenbad, tâcher de savoir ce qui en est. Cela en vaut la peine.
J’ai manqué hier Salvandy qui est venu pendant que j'étais sorti. J’en suis fâché. Je le verrai peut-être d’ici à après-demain, s'il n’est pas reparti. On m'avait dit qu’il ferait, à l'Académie française, un discours très politique. Il n’y paraît pas, dans ce que rapportent les journaux. Je me suis trompé sur cette séance. Je croyois qu’elle devait avoir lieu hier samedi. Elle a eu lieu jeudi dernier. On a été surpris, et un peu piqué, dans l'Académie que ni le Duc de Broglie, ni son fils, ni personne de la famille, n’y assistât, à propos de l'éloge de Madame de Staël, couronné dans cette séance et proposée autant pour plaire aux vivants que pour rendre justice aux morts. Ils (les vivants) sont tous partis deux jours avant la séance. M. Villemain surtout est assez piqué, dit-on.
Voilà votre lettre. Pour dire vrai, cela me fait plaisir que moi parti, vous ayez eu froid, et mauvais temps. J’espère que cela n'aura pas duré. Je suis bien aise que vous ayez un bon appartement à Schlangenbad. Mais j'aurais mieux aimé que la Princesse de Prusse y fût restée et que vous eussiez fait connaissance avec elle. Un peu pour ce que vous lui auriez dit et plus encore pour ce que vous n'en auriez dit. J'aime à connaitre les gens qui sont quelque chose dans le monde, et je ne crois les connaître que par moi-même ou par vous. On me remet avec votre lettre un billet de Salvandy et son discours à l'Académie. Il est reparti. c’est un singulier esprit. Il y a, dans son discours des embryons de belles idées, et de belles paroles, presque grandes, mais toutes dans cet état nébuleux et inachevé où la beauté et la grandeur disparaissent au moment même qu’elles se font entrevoir. Ma lettre a en effet fait de l'effet ici. La conduite, et la lettre ont été approuvées. Je ne veux pas faire autre chose que saisir les bonnes occasions quand elles viennent naturellement de reparaître [...]
Mots-clés : Académies, Autoportrait, Politique (France), Réseau social et politique
Val-Richer, Mercredi 24 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Partant dans quatre jours pour aller vous voir, il me semble déjà que ce n'est plus la peine de vous écrire. D’aujourd’hui en huit, nous causerons, s'il plaît à Dieu comme disent toujours mes amis anglais, qui ont raison. Certainement, nous avons beaucoup à nous dire ; il n’y a point de temps si stérile en événements qui le soit, entre nous, pour la conversation. Et puis, on appelle aujourd’hui stérile toute semaine qui n'amène pas quelque grosse chose. Je me défends de cette disposition qui est, au fond, celle qui fait faire, de nos jours, tant de sottises. Je tâche de ne pas m'ennuyer de ce qui dure et de contenter ma curiosité à meilleur marché que des révolutions.
J’ai des nouvelles de Rome. Le Gouvernement du Pape ne s’y rétablit guère ; mais l'ébranlement s’apaise. On oublie le passé et l'avenir. On vit au jour le jour, en rentrant dans les anciennes habitudes. C’est un repos qui reste à la merci d'une poignée de conspirateurs et d’une occasion. Le Pape est dans Rome, mais Mazzini n’est pas vaincu. Il faudra que l’armée française reste là longtemps. Et quand elle quittera Rome elle restera encore longtemps à Civita Vecchia. Personne n’y pense et ne s'en soucie. Lord Palmerston aurait bouleversé, l’Europe pour me chasser de là. Peu lui importe que la République y soit. Il a raison. La République, pour garder Rome, n'en est pas plus puissante en Italie ; pas plus que la sentinelle qui garde la Banque n'en possède les trésors. Quand les révolutions sont à la porte, les gouvernements ne sont plus que des sentinelles. La question italienne est insoluble. Autrefois, on se résignait aux questions insolubles ; on cessait d’y penser. Aujourd'hui, on ne se résigne à rien : on pense toujours à tout. Aussi la force matérielle doit être toujours partout. L’Etat de siège devient l'ordre Européen.
10 heures
La Commission permanente est nommée bien péniblement, et bien mêlée. L'opposition légitimiste et montagnarde a fait passer plusieurs des siens. Le gâchis augmente. La nouvelle querelle de Changarnier avec le Ministre de la guerre est encore replâtrée, mais cela ne peut guère aller loin. Le Président, ne pourra pas soutenir toujours d’Hautpoul.
Ce que vous me dites d'Angleterre me préoccupe. Si la Chambre des communes se met aussi à démolir son propre gouvernement, cela finira par mal tourner. Adieu, adieu. J’ai plusieurs petites lettres à écrire et mon facteur ne peut pas attendre longtemps aujourd’hui. Adieu G.
Val-Richer, Mardi 23 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.
L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.
J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.
Midi
Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.
Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.
Val-Richer, Vendredi 19 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis de l’avis de votre Princesse de Lippe-Schaumburg, (n'est-ce pas de la Lippe ?) ; il me semble que tout le monde se retire de l’union, et que le faiseur de l'Union est bien près lui-même d'y renoncer. Je saurai ces affaires-là avec précision d’ici à peu de jours ; mon gros, petit factotum a été de nouveau sollicité de faire en Allemagne le voyage que vous savez ; il est parti mardi, et il reviendra la semaine prochaine.
On tient beaucoup là, à ce qu’il me paraît, à établir avec les Débats de bonnes et un peu intimes relations. On a raison. Quand le jour de la bonne politique reviendra, car il reviendra, il importe que les Débats y soient engagés d'avance et la soutiennent pour leur propre compte, seule manière d'avoir un peu de zèle et d’autorité. C'est ce qui fait que je ne suis pas du tout fâché du ton qu’ils ont pris sur la nouvelle loi de la presse. Cela leur donnera crédit pour approuver et défendre le régime, plus sensé, qui sera fait un jour à la presse, quelque sévère qu'il soit. La République a cela de bon qu’elle tente toutes sortes de rigueurs inefficaces qui feront plus tard, passer et presque trouver douces de justes et efficaces de vérités. Vous voyez ; je ne me guéris pas de croire à l'avenir et d’en parler comme s’il était à moi. Au fait j'y crois; il s'est fait et il se fera bien des absurdités dans le monde ; mais l'absurdité petite et basse ne l’a jamais gouverné longtemps. Ce qui n’est pas sûr du tout, c’est que le meilleur avenir vienne assez tôt pour que j'en aie encore ma part. Je suis tout résigné à cela, mais je ne vois pas pourquoi je m'imposerais, à chaque minute, la fatigue et l’ennui de parler, ou de me taire, comme si j'étais mort, pendant que je suis encore vivant. Je me laisse aller à ma pente ; Dieu disposera de moi comme il lui plaira.
9 heures
C’est bien bête, en effet de manquer d'eau faute de machine. J’ai en idée que ces eaux d'Ems vous font du bien. Ma conjecture se fonde sur votre silence.
Je reçois ceci du meilleur des Burgraves : " Nous venons de terminer une loi qui n'a pas trop bonne mine, mais qui contient cependant plusieurs dispositions efficaces. Elle a été faite à peu près comme tout ce qu’on fait avec les légitimistes, c'est-à-dire comme une distribution de prix et une table de proscription, chacun récompensant les siens et poursuivant ses adversaires. Elle est très sévère, ridiculement et un peu bêtement sévère quant à la presse de Paris, indulgente sans choix et sans mesure pour la presse des départements. Somme toute, il en résultera du bien. Nous allons nous séparer ; nous en avons grand besoin ; la place n'est plus guère tenable, et la session prochaine ne sera possible qu’autant qu’il se formera, une majorité nouvelle composée des gens de bon sens de tous les partis ; la majorité actuelle est à bout de voie."
Vous ai-je dit que Saint Marc Girardin avait offert à Armand Bertin, d’écrire et de signer (Saint Marc Girardin, membre de l’Institut) le premier article politique que publieraient les Débats sous l'empire de la loi nouvelle ? Adieu, Adieu.
J’ai la pluie depuis deux jours ; à mon grand déplaisir. J’aime de plus en plus le soleil. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 4 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je ne cesse de penser à cette brouillerie. Je n’y crois pas. Il me semble impossible que le président. rompe ainsi avec la majorité au moment où il vient de s'unir, si intimement à elle par la loi électorale. La majorité laisserait-elle partir Changarnier, sans prendre fait et cause pour lui ? Je ne crois pas cela non plus. Mais tout est possible aujourd’hui ; le bon sens n’est plus une boussole. Plus j’y pense, plus cela me paraît grave si cela arrive. La majorité brouillée avec le Président et brouillée dans ses propres rangs ; l’armée aussi troublée et divisée ; les fonctionnaires, partout incertains et cherchant leur voie. C'est le chaos jeté dans le chaos, et des enfants jouant avec le chaos. Je n'y veux plus penser ; je n’y ai rien à faire et n’y puis rien prévoir. Etes-vous inquiète ? Voyez-vous des chances de désordre dans Paris ? J’espère que non.
Mes préoccupations sont peut-être fort ridicules et tout est arrangé pour quelques jours. Vous me direz cela dans une heure. Quel ennui d'attendre !
Avez-vous très chaud à Paris, et en souffrez-vous ? Ici le temps est admirable. Le souffle de l’été sur la fraîcheur du printemps.
Les nouvelles de St Léonard ne sont pas bonnes. Le mieux s'est arrêté. Des jaunes d'oeuf pour toute nourriture. Le Roi fait à peine quelques pas dans sa chambre, soutenu par deux hommes. M. de Mussy est très inquiet, sans croire pourtant à rien d’imminent. Je crains que mon voyage ne soit fort avancé. J'attends demain une lettre qui me fera peut-être écrire au duc de Broglie pour lui demander s'il est prêt.
10 heures
Votre lettre me rassure un peu. Je vois que c'est votre maniaque surtout qui croit le mal imminent. Tout le monde n’est pas aussi près d'une convulsion que lui, quoique personne n’en soit bien loin. J’espère que tout se calmera, ou s’ajournera. Je reçois à l’instant de divers côtés des nouvelles très diverses de St Léonard ; les unes inquiétantes, les autres rassurantes, du moins pour le moment. Faites-vous dire, je vous prie, exactement par Duchâtel ce que dit son frère Napoléon qui en arrive. On me presse de presser mon voyage. Je vais écrire au Duc de Broglie. Je ne voudrais pas avoir l’air trop empressé, et aller pour rien. Il ne faut pas non plus attendre trop tard. Personne n'a moins de goût que moi pour l'indécision. Il n’y a pas moyen d’y échapper toujours.
Que signifie cette joie de Berlin sur l'adhésion de l'Empereur à la politique germanique et à l'union restreinte de la Prusse? J’ai peine à croire qu'entre ces deux Princes, le Prince de Prusse soit le convertisseur et l'Empereur le converti. Adieu, Adieu. Dût-il m'en coûter quelques lignes, je suis bien aise que vous écriviez des volumes à Aberdeen. Il a besoin d'être informé et encouragé. Adieu. G.
Brompton, Lundi 30 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je pars aujourd’hui pour Cambridge à 2 heures. Cela ne me plaît guères. Nous serons plus loin. Je crains le retard des lettres. J’étais en train de travail. Quand vous n’y êtes pas, c'est mon amusement. Je fais de la très bonne politique. Trop bonne. Toujours la même faute. Je puis vous le dire à vous. Je puis être avec vous aussi orgueilleux qu’il me plaît. Vous savez que je suis modeste en même temps qu'orgueilleux.
Point de nouvelles hier. Je suis allé voir Duchâtel qui n’en avait pas plus que moi. Nous verrons le courrier d’aujourd’hui. Il ne nous apportera pas grand chose. Nous vivrons dans le statu quo jusqu'au 10 Décembre. Mais nous comprendrons mieux une situation vraiment obscure pour moi. Duchâtel soutient que notre procès finira aussi tôt après l'élection du président. Par une ordonnance de non lieu. Si Louis Bonaparte est nommé et Thiers son ministre, il est impossible que notre procès ne finisse pas tout de suite malgré le peu d'envie.
Lisez je vous prie, attentivement le Constitutionnel. Cherchez y Thiers envers Louis Bonaparte. Là est la clef de l'avenir. D'un avenir qui dans aucun cas ne sera bien long, j’espère, mais qui pourrait être très court si Louis Bonaparte n’épousait pas Thiers. Vous devriez engager Marion à écrire à Madame de La Redorte et à la questionner un peu. Peu importe que les réponses soient des mensonges. Vous voyez clair dans le mensonge comme dans la vérité.
Les histoires des Gardes nationaux de Paris ne finissent pas. Le Duc de Somerset a demandé à Panton Hôtel, Panton Street, qu’on en priât quatre à dîner chez lui, n'importe lesquels. On lui en a envoyé quatre dont il a fait une exhibition. Entre autres un Capitaine Gonet qui est un beau parleur, et qui s’est fait l’intermédiaire entre tous ses camarades et la légation de la République à Londres. M. de Beaumont est assez embarrassé de la visite de quelques-uns à Claremont. Il a fait un rapport à ce sujet, fort modéré, atténuant au lieu de grossir. Cependant on croit qu’il y aura quelque mesure prise à Paris, qu’on défendra ces visites en uniforme hors des frontières. Il me paraît qu'à tout prendre l’excursion nationale n’a pas beaucoup plu à Paris. Entre les promeneurs eux-mêmes, il y a un peu de mauvaise humeur. Ceux qui ne sont pas allés à Claremont se sont plaints d'être compromis par ceux qui y sont allés. Ceux-ci se sont fâchés. On dit qu'au retour à Calais, il y aura quelques duels. Ici, évidemment, le peuple les a pris en très bonne part. Adieu.
Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Savez-vous ce qu'a fait Guillaume avant-hier dans un metting où les jeunes gens de King's college se réunissent les samedi pour s'exercer à parler ? Il a fait un speech en Anglais pour M. de Metternich qu’un autre attaquait comme l'auteur, par son obstination, des malheurs de l’Autriche. Guillaume a fait l’apologie de la consistency politique. Assez bien pour être fort cheered et pour faire voter à une voix de majorité, que la consistency était une vertu, non pas un tort. Il m’a redit son speech qui n’était pas mal. Il a pour la politique une passion au moins aussi effrénée que celle de mon garde national d’avant Hier. Midi Je suis désolé que ma lettre vous ait manqué, Elle a été mise à la poste avant 5 heures Peut-être est-ce trop tard pour Brighton. Celle-ci sera mise avant l’heure, par Guillaume que j'envoie exprès. C'est votre seul chagrin de Brighton que je regrette beaucoup. Je prends mon parti des autres. J’ai eu tort de ne pas insister davantage pour vous y conduire moi-même. Je n’aime pas que vous ayez peur et froid toute seule. Adieu Adieu.
Je n'ai qu’une longue lettre de Bruxelles, d’Hébert. Adieu. G. Mes amitiés à Marion, je vous prie.
Ketteringham Park, Jeudi 3 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Onze heures
Voilà votre lettre d’hier. Il y a du vrai dans votre premier reproche. Je crains trop les contradictions, les objections, les chagrins, du premier moment, ce qui m'empêche souvent de faire ou de dire ce qu’il faudrait pour éviter ceux du dernier moment. J’y veillerai pour m’en corriger quoique je sois vieux. C’est une faiblesse pleine d'inconvénients. Et quand les inconvénients arrivent, personne ne les sent plus vivement que moi. Juste mais triste punition de la faiblesse. Je n'accepte pas votre second reproche. Je traitais jusqu'ici l'affaire des papiers avec Génie par M. Palmerston. C'est pourquoi je ne lui avais pas écrit directement et spécialement quels étaient ceux que je tenais surtout à avoir ici. M. Palmerston n'ayant pas fait l'affaire, j’ai écrit à G. en lui donnant, à lui-même la résignation que j’avais donnée à M. P. G. avait fait remettre quelques papiers à P.. Mais ce ne sont pas ceux auxquels je tiens. Si vous étiez là, je vous expliquerais en détails. Mais soyez sûre que j’ai mis à cette affaire là tout le soin possible ! Soin difficile de si loin, et avec toutes les réserves qu’il faut garder.
On est bien craintif à Paris. On ne parle qu’à demi-mot. On ne remue qu'en hésitant. Pour tout ce qui se rapporte à certains moments et à certaines personnes. Mais j'en viendrai à bout. Et malgré, ma vive contrariété du retard, je ne puis avoir d'inquiétude réelle, et définitive. Ecrivez-moi, encore ici jusqu’à samedi après demain. Je n'’en partirai probablement que lundi matin. Moyennant que j'abnéguerai le séjour en Ecosse. J’irai seul chez Lord Aberdeen, pendant que mes enfants seront à St Andreas, Melle Chabaud y restera avec eux jusqu’au moment du départ. Viendrez-vous maintenant chez Lord Aberdeen ? Ce serait bien joli, j’emploierai ainsi le temps des bains St. Andrews. Il serait bien long et pas bien amusant de vous dire pourquoi ce nouvel arrangement se rattache à deux jours si plus passés ici. Mais c’est le fait, et le bon fait si vous venez à Haddo.
Voilà le Roi de Sardaigne bien évidemment en retraite. Retraite heureuse pour lui, si elle le force à traiter avec les Autrichiens c’est-à-dire si elle force les Italiens à le laisser traiter avec les Autrichiens au prix de Venise. Je vois ce matin dans le Globe qu’il a demandé à Paris l’armée française et qu’on lui a répondu par le médiation française. Ce serait un peu votre politique. Cependant M. Bastide vient de promettre encore l’intervention, si l'Italie insiste. Et j'ai peur qu'elle insiste. Charles Albert ne me paraît guère, en état de dire non à Mozzini. Les honnêtes gens en France regarderont comme une victoire l’ordre du jour de l'Assemblée nationale sur le discours de M. Proudhon. Et en effet, s'en est une, à quelles victoires sont tombés les honnêtes gens ! Cavaignac et Bastide ont eu toute raison de se refuser à Mauguin. Adieu. Adieu. Je vous quitte pour aller à Norwich voir une belle cathédrale. Je fais comme si j'étais curieux et on m’en sait gré. Le temps est passable. J’ai marché hier deux heures dans la campagne. Connaissez-vous Lord et Lady Woodhurst ? Non pas les personnes mais le nom. Les personnes sont deux jeunes gens de bon air et d'assez d’esprit qui sont venus dîner hier. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Archives (Guizot), Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), Exil, France (1848-1852, 2e République), Politique (Autriche), Politique (France), Portrait, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique
23. Val-Richer, Jeudi 6 août 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir dit que M. de Béarn était nommé à Hanovre, et que sa nomination serait ces jours-ci dans le Moniteur. Elle y sera après-demain. Oui, le Roi d’Hanovre a raison ! Et moi aussi. J’ai temporisé, traîné, attendu jusqu'à ce que j'aie pu arranger la nomination que j’avais absolument besoin d’arranger, celle de Lavalette, et qui dépendait de l'autre. Cela m'importait plus qu’un peu d'impatience et d'humeur du Roi d’Hanovre ce que je ne pouvais ni ne devais dire. Maintenant tout est au gré de tout le monde. Si je n’avais pas attendu le moment favorable, rien ne serait au gré de personne. Ce qui n'empêche pas que vous n’ayez, vous, parfaitement raison de me remettre sans cesse sous les yeux ce que j’ai à faire. Je le crois bien que vous ne vous gênez pas de me dire ce que vous pensez, discours ou actions. L'expression m'a presque choqué. J’ai droit à tout ce que vous pensez, à ce qui peut me déplaire comme à ce qui peut me plaire. Et vous vous me plaisez toujours ; jamais plus que par la sincérité parfaite si vous saviez à quel point la flatterie m'ennuie ! Je devrais dire m'humilie. C'est le mot propre. J’ai toujours envie de dire aux gens : " Vous ne savez donc pas ce que je suis ? "
Je vous renvoie la lettre de Bacourt. Intéressante. Et je vous envoie aussi la mienne Curieux bruit. Je n’y crois pas. Tâchez de découvrir s’il y a à cela quelque fondement, et renvoyez-moi, je vous prie, la lettre de Bacourt qui ira ailleurs. Voilà qu’on m’annonce trois visites qui m’attendent en bas. De gros bonnets du pays. Je suis, avec eux, dans la lune de miel. Je ne veux pas les faire trop attendre. J’aurai Glücksbierg demain matin et Jarnac demain soir. Je ne me fais pas du tout encore une idée nette de Palmerston sur le mariage Espagnol. Les protestations de W. Hervey ne m’ont pas convaincu. Pour peu qu’il faille résister à la Reine et au Prince Albert, le cœur leur manquera. Nous verrons. On s'attend en Espagne à des conspirations, des insurrections. Palmerston sera aussi faible avec Espartero qu'avec Buckingham Palace. Adieu, dearest. Quel ennui de vous quitter ? Ce serait bien pis si vous étiez là. Il fait très beau aujourd’hui. Hier, orage continuel. Le temps qui vous étouffe me déplaît, quel qu’il soit. Adieu, Adieu dearest beloved. Adieu. G.
20. Val-Richer, Lundi 3 août août 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est fini ici. S’il en était ainsi partout, il n’y aurait certainement pas assez d’opposition. Il en faut plus que cela. Mais je suis tranquille ! D'après ce qui me revient, la lutte est extrêmement vive dans les environs. On s'est presque battu à Bernay et un peu battu à Cherbourg. Aucun résultat n'était encore connu hier à 9 heures, quand j'ai quitté Lisieux. Je me suis levé ce matin de très bonne heure pour dicter encore quelques paroles de remerciement que j’ai dites hier, quand l'élection a été proclamée et qu'on a voulu absolument recueillir. Elles ont bien réussi. Je retourne à Lisieux ce matin à 10 heures, pour entendre, lire et signer le procès verbal du Collège électoral. Puis, j’irai à Trouville, avec ma mère et Henriette, pour y chercher Pauline et la ramener demain au Val Richer que je ne quitterai plus que pour aller vous retrouver, vous mon seul vrai plaisir, mon plus charmant repos. Oui, nous retrouverons ensemble des soirées comme les deux dernières : nous irons les chercher. Leur parfum ne s'est pas encore évanoui.
Je suis un peu fatigué. J’ai eu hier & avant-hier deux déjeuners, et deux dîners assommants. Je n’ai certes pas plus mangé ni bu qu'à mon ordinaire, mais l'estomac se fatigue de ce qu’il voit comme de ce qu’il prend. Et l’assiduité, tant d’heures durant à une conversation si insipide, & qui ne doit pas un moment en avoir l’air ! J'y réussis très bien. Je ne fais pas les choses à demi. J’attends bien impatiemment l’estafette qui m’apportera les premiers résultats. Elle ne sera pas encore arrivée à Lisieux quand j’y passerai tout à l'heure. On me l’enverra à Trouville. Vous aurez tout cela avant moi. Castellane m’écrit de ses montagnes : " Je crois moi, au grand succès dans les élections ; ce qui est très juste, car l'opposition est enviable et ce qui donnera de grands devoirs au parti conservateur. J’irai à la petite session, à moins qu’elle ne soit tout-à-fait une forme. Je m’attends en effet, en cas de grand succès aux exigences du parti conservateur. Il se sentira à son aise et voudra avoir quelques plaisirs de popularité. Nous verrons. Je vous quitte pour écrire au Roi. J’ai à lui envoyer une lettre de Bresson qui ne m'apprend pas grand chose. Plus j’y pense, plus je me persuade qu’à Londres on n’a pas en effet dessein d'entrer en lutte avec nous. Mais je crains leur faiblesse, faiblesse pour la Reine, faiblesse pour Espartero faiblesse pour les préjugés des journaux. Ils ont besoin de tout le monde, et l’âme pas bien haute. Je n’ai pas autre chose à faire que ce que je fais. Adieu. Adieu. En attendant votre lettre.
8 heures. La voici. Charmante. J'y comptais. Quand j’ai lu et relu, je passe aux affaires. Il y en a beaucoup aujourd’hui mais rien d'important. Deux lettres du Roi qui se porte mieux que jamais. " Toutes nos santés sont bonnes, me dit-il, la forte secousse que la Reine et ma sœur ont éprouvée est bien passée. Quant à moi, je suis à merveille, et je fais faire un peu d'exercice au Ministre de la guerre, dans mes promenades dont je jouis beaucoup. ". Et dans la seconde : " Je vais me promener dans mon char à bancs. Hélas ! avec escorte ! " La formation des bureaux, que m’apportent les Débats, est de bon augure. Adieu. Adieu. Je vous écrirai demain de Trouville. Je n'en reviendrai que le soir. Soyez tranquille. Ni assassin, ni rhume. Adieu. G.
13. Val-Richer, Vendredi 24 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n'ai point éternué, point pleuré cette nuit. J’ai bien dormi. Je suis beaucoup mieux ce matin. C’est vraiment curieux avec quelle vivacité ce mal-là me vient, avec quelle rapidité il s'en va. Hier, s'il avait fallu aller et parler à mon banquet, j’en aurais été incapable. J'en étais vraiment préoccupé, et attristé. Ce n’est qu'à vous que je dis mes satisfactions orgueilleuses, à vous seule aussi mes faiblesses. J'en ai bien plus qu’il n'en paraît. Les circonstances importantes, les nécessités absolues, prévues, annoncées, de paraître et d’agir, me mettent bien souvent, plusieurs jours à l'avance dans un état de malaise, de frémissement intérieur, de doute et d’inquiétude, que je ne laisse pas du tout percer, que je contiens et comprime fortement en moi, car j’ai beaucoup d'empire, sur moi-même mais qui n'en est pas moins, très réel et très désagréable. Tout le monde est convaincu que la tribune ne m'inquiète et ne me trouble jamais. Tout le monde se trompe. Je suis très souvent et très vivement troublé, pas quand une fois je suis à la tribune et dans l’action, mais auparavant, en pensant au succès nécessaire et toujours incertain.
8 heures Décidément les bains ne vous valent pas mieux que le serein à moi. Cela m'étonne. Nerveuse comme vous l’êtes il me semble que les bains devraient vous être bons, J’espère que votre estomac se remettra bientôt en ordre. Pour les petits soins contre les petits maux, j'ai assez de confiance dans Chermside. Il vous connait bien et me parait sensé. Pourvu qu’il n'abuse pas des blue pills. Je vais attendre tout le jour la lettre de demain. Que de temps dans la vie on passe à attendre ? Palmerston me fait demander, en effet ce que nous pensons des Affaires de Rome, [?] et autres, et ce qu’il doit dire et faire pour être comme il veut, d'accord avec nous. Cela sera facile à Rome où il n’est rien, et nous n'en tirerons pas grand profit. C’est à Madrid qu’il faudrait-se mettre d'accord, et j'en doute tous les jours d'avantage. J’ai fait ma démarche. Nous verrons le résultat. En tout cas elle est bonne, et si elle ne nous met pas d’accord ; elle me mettra, moi, à l'aise. Comme on peut être à l'aise dans une si grosse et si difficile affaire. Un grand point sera au moins obtenu. Il n’y aura, rien avant mes élections. Les nouvelles en sont toujours très bonnes. De plus en plus bonnes, si je m'en rapporte à ce qui m’arrive de tous côtés. Mais j’ai aussi ma méfiance. Le Roi d’Hanôvre a été assez malade pour qu’on ait été sérieusement inquiet pendant trois jours. C’est du moins ce que M. d’Houdetot m'écrit. Il est mieux. Il aura M. de Béarn le 4 août. L’ordonnance sera signée ce jour-là comme ministre définitif.
Les bains de mer réussissent parfaitement à ma fille Pauline. On lui jette sur les reins des seaux d’eau qui j’espère seront bons à sa taille. Le temps est charmant depuis trois jours. Revenu au chaud, trop peut-être à Paris, et pour vous. Pas ici. Adieu, dearest. Plus j'avance, moins l'adieu me suffit. Je pense sans cesse à vous. Je vous suis dans tous les détails, à toutes les heures de votre journée. Il me semble que si j'étais là, tout serait mieux. Adieu. Adieu. G.
5. Val-Richer, Jeudi 16 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Je me lève. J’étais dans mon lit et endormis hier avant dix heures. Depuis que je me repose je sens ma fatigue. Je voudrais vivre comme La Fontaine : Quant à son temps, bien le sut dispenser ; Deux parts, en fit, dont il voulait passer L’une à dormir, et l’autre à ne rien faire. Je n'entre dans mon Cabinet, je ne me remets à mon bureau avec plaisir que pour vous écrire. Cela passera ; non pas, mon plaisir à vous écrire, mais mon besoin de ne rien faire. J'étais vraiment bien fatigué. Il n’y a qu’un plaisir qui s’allie très bien avec la fatigue, c’est celui de la conversation, de la conversation douce, intime, sans but, pur plaisir. Celui-là n'existe pour moi qu'avec vous. Si je pouvais faire mes affaires en en causant avec vous, sans autre souci que de chercher et de décider avec vous ce qu’il faut faire, laissant ensuite à d’autres le soin de l'exécution avec les autres, ce serait le Paradis, un Paradis paresseux, mais charmant.
Dites-moi votre avis sur ceci. Faut-il attendre que Palmerston ait parlé à Jarnac des affaires d'Espagne et lui ait indiqué sa disposition ou bien faut-il que Jarnac, prenant l’initiative, aille droit à Palmerston et lui dise : « L'Infant D. Enrique va arriver à Londres ; le parti progressiste veut en faire son instrument et votre candidat. Ce sera le retour de l’ancienne situation qui a été si nuisible au repos de l’Espagne, et à la bonne intelligence entre nous ; la France et les Modérés, l'Angleterre et les Progressistes, deux mariages, deux gouvernements ; une lutte continuelle, dans laquelle nous aurons l’air d'être les patrons, et nous ne serons que les instruments des partis Espagnols. Voulez-vous que nous coupions court à tout cela, et que nous travaillions, ensemble, sincèrement activement, à marier promptement la Reine d'Espagne à l’un des fils de D. François de Paule à celui qu’elle et son gouvernement préfèreront ? Nous sommes prêts ? C’est là, je crois ce qu’il y aurait de mieux. J’ai posé hier la question au Roi. J’attends sa réponse et la vôtre qui est déjà dans votre lettre d’hier. 9 heures Voilà une lettre qui me désole. Moi, Marion, Verity absents, c’est trop. Je vais attendre bien impatiemment la lettre de demain, j’espère que vos yeux ne s'obstineront pas à mal aller. Vous avez déjà eu souvent ces oscillations. Je me dis ce que j'ai besoin de croire. Si vous revenez à votre gold anointment (est-ce le nom ?), faites le vous-même plutôt que de le faire faire par Chermside.
Comment réussit Mad. Daucan ? Au moins, elle sera bonne pour vous lire. Tant que vous serez inquiète de vos yeux, vous serez mieux à Paris qu’à St Germain. La solitude est le pire. Je suis vraiment bien fâché pour cette pauvre Marina. Elle vous convenait. Le mal est-il si avancé qu’il n’y ait rien à faire ? Sinon, elle ferait bien d’aller consulter, M. Velpeau, ou M. Jaubert, ou M. Cloquet. Ce sont les habiles en ce genre. Avez- vous quelque femme de chambre en vue ? Qu’est devenue votre ancienne Marie ? Je vous questionne à tort et à travers. Si j'étais là, je saurais tout et je ferais quelque chose. Il me paraît difficile que vous ne donniez pas une petite indemnité au courrier qui vous a attendue, et ne s’est pas engagé à d'autres. Je n’ai pas d’idée du chiffres. Entre 60 et 100 fr. Ce me semble. Je dis cela au hasard. J’ai trouvé en effet, au fond de la grande enveloppe, une lettre particulière de Rayneval. Absolument rien qu’un compliment sur la mort de Mad. de Meulan.
Bonnes nouvelles de Rome. Rossi a présenté ses lettres d’Ambassadeur. Bon discours au Pape. Bonne réponse du Pape. Excellente position. Les Autrichiens se disent très contents de l’élection du Pape. Au fait si le cardinal Autrichien Gaysruck était arrivé à temps, il se serait opposé au choix de Martaï. Cela paraît certain. Il n’est plus guère douteux que le Pape ne fasse bientôt l’amnistie et des améliorations considérables dans les états romains. Gizzi Secrétaire d’état à peu près sûr. Amal, à l'intérieur ; moins sûr, mais probable. Tous deux très bons. Adieu. Adieu. Je recommande à Génie de vous montrer une dépêche de Naples qui vous amusera. Adieu. Que Dieu garde vos yeux ! Et vous toute entière ! Adieu.
223. Val-Richer, Samedi 20 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé mes enfants très bien. Cependant Guillaume tousse un peu depuis quinze jours. Il mange et dort parfaitement. Il est très gai. Mon médecin dit que ce n’est rien du tout et que quelques pastilles d’ipécacuanha l’en débarrasseront.
Le Duc de Wellington s’est bien fâché contre Lord Melbourne. J'en ai été un peu surpris. Non qu’il n’eût parfaitement raison ; mais au dire de Pozzo, il y a entre eux la meilleure, intelligence ; et Lord Melbourne ne fait à peu près rien sans s'en être de près ou de loin, entendu avec le duc. Du reste il arrive à Birmingham ce qui arrive dans les grandes villes des Etats Unis d'Amérique, ce qui arrivera partout où la contagion de l'esprit démocratique aura atteint le gouvernement lui-même. On élit des magistrats mais il n’y en a plus. Il n’y a que des adorateurs et des serviteurs de la multitude. Elle est pour eux ce qu’était le Pape au Moyen-Âge pour l’Europe chrétienne. Leur premier mouvement est de la croire infaillible, et ils ne se décident à la réprimer un peu qu’en cas de nécessité absolue et après les derniers excès. Lord John s'est mieux défendu aux Communes que Lord Melbourne chez les Lords. Lord Melbourne a toujours l’air d’un homme qu'on réveille en souriant, et qui dit : " Laissez-moi tranquille. Pourquoi me tracassez-vous ? Croyez-vous que je sois là pour mon plaisir ? J’y suis pour vous empêcher d'être dévorés par cette bête. féroce. " Le Parlement ne sera prorogé que dans la seconde quinzaine d'août.
8 heures
Je rentre de bonne heure quoiqu’il fasse beau. Les soirées normandes sont trop humides pour moi. Je retomberais dans ces éternuements insensés qui m'hébètent et me fatiguent. Décidément, l’atmosphère du midi est la seule agréable la seule ou la chaleur ne soit pas celle d’une étuve et la fraîcheur celle d'une cave. C'est bien dommage que le proverbe ait raison : " Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. " J’aimerais bien à choisir mon herbe. A tout prendre, je me suis assez réglé, dominé, gouverné selon la raison, et je passe pour cela. Mais il me prend quelquefois de furieux accès de fantaisie, un désir passionné de n'en croire que mon goût mon plaisir. Personne ne saura jamais ce qu'il ma fallu d'effort la semaine dernière pour ne pas partir pour Baden dans la journée, et y aller voir moi-même.
Dimanche 6 h. 1/2
Je me lève de bonne heure ici, comme vous à Baden. Le calme du matin est charmant. La nature est animée et il n'y a point de bruit. Je crois que je travaillerai beaucoup, et avec plaisir. Pourvu qu’on ne vienne pas trop me voir. J’attends la semaine prochaine M. et Mad. Lenormant ; puis M. Devaines et son fils, puis M. Rossi. Mad. de Boigne qui ira passer un mois chez Mad. de Chastenay, près Caen, me fera une visite en passant. Ma route n'est pas tout à fait achevée. Cela éloignera quelques personnes.
Ne mettez pas grande importance, à ce que vous lisez dans les journaux sur les dissensions intérieures du Cabinet, sur le travail de M. Dufaure au profit, de la gauche, &. On essaie d’amener cela en le disant ; mais cela n'est point. Il n’y a dans le Cabinet point de dissensions, point de travail de personne au profit de personne. Ils sont tous contents d'être où ils sont, chacun tâche à se maintenir bien avec ses anciens amis pour en tirer quelque appui, M. Dufaure avec la gauche, M. Duchâtel avec le centre ; mais tout cela, sans conséquence. Au fait, ils s'accordent sans peine ; et quand ils différent, chacun dit son avis, le Roi décide, et ils n’y pensent plus.
9 heures
Je suis désolé que le courrier vous ait manqué. J’aime mieux que cela soit tombé sur le jour où vous avez eu Lady Carlisle. Lady Granville m’avait dit qu’elle irait passer une journée avec vous. Merci de ce premier aperçu sur vos arrangements. Ils me conviennent, à présent, il me faut les détails. Adieu. Adieu. Vous aurez été bien rassurés sur Paris. Adieu dearest. G.
237. Val-Richer, Mercredi 7 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
228. Val-Richer, Samedi 27 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis seul, très seul. Non pas seul comme vous, hélas ! Je suis entouré de gens qui m’aiment, qui s'occupent de moi, qui ont besoin de moi. Mes enfants sont bien gentils bien affectueux. Ma journée est très pleine de personnes et de choses. Mais moi, je vous le répète, moi, je suis très seul. Je suis seul quand je ne me donne pas tout entier. Je suis seul quand je ne trouve pas tout ce qui me plaît, quand je rencontre, non pas des défauts ; que m'importent les défauts ? Mais des lacunes, des impossibilités. On me dit et vous même me dîtes que je suis orgueilleux. Je ne puis pas être heureux de haut en bas. Je ne puis pas aimer de haut en bas. Je veux que les yeux qui me charment soient là, devant moi, à la hauteur des miens ; et aussi les idées, les instincts, les goûts les désirs, comme les yeux. Je veux admirer et me soucier qu’on m'admire. Que personne n'entende jamais, ne sache jamais ce que je vous dis là. Pour rien au monde, je ne voudrais affliger ou blesser une affection tendre, un dévouement vrai ; ils sont si rares, & on les mérite si peu quand on ne les rend pas tout entiers ! Je vous dis qu’avant le 15 juin, j'étais seul et m’y étais résigné, qu'aujourd'hui je suis seul et ne m'y résigne pas.
3 heures
Voilà bien du nouveau en Orient. Le protectorat Européen et le Protectorat Russe se disputaient Constantinople. Elle se place sous le protectorat égyptien. A la barbe des Chrétiens divisés, les Musulmans se rallient. Je suppose que cela déplaira beaucoup chez vous. C'est évidemment un tour de M. de Metternich et du Roi Louis- Philippe. Que dira l’Angleterre ? Elle déteste l’Egypte. Serait-ce tout bonnement un coup de tête du jeune Sultan, et de ses Conseillers qui auraient voulu trancher d’un seul coup & eux-mêmes toutes les questions ? Méhémet. Ali Généralissime de l'Empire Turc ! Méhémet. Ali à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Si toute l’Europe s'en arrange, il n’y a plus d'affaires-là, pour quelque temps. Si elle ne s'en arrange pas, les grandes affaires commencent. Encore une fois, dites-moi qui a fait cela, M. de Metternich, les Turcs seuls, ou peut-être Méhêmet lui-même, par son argent et ses amis à Constantinople. Je ne voir que votre Empereur qui ne puisse pas l'avoir fait. l’acceptera-t-il ?
Il m'est arrivé ce matin bien des nouvelles. Vous savez le dehors ; voici le dedans. Des conférences ont eu lieu ces jours derniers, entre les meneurs de la gauche, députés et journalistes sur la conduite à tenir d’ici à la prochaine session notamment sur la réforme électorale. M. Barrot y présidait. Voici ce qui s’y est passé. La proposition du suffrage universel a été écartée. Il en a été de même de l’élection à deux degrés quoiqu'elle ait été vivement soutenu par quelques personnes. De même aussi de la réunion de tous les électeurs de chaque département en un seul collège siégeant au chef lieu du département, et nommant ensemble tous ses députés.
On a adopté.
1° La suppression de tout cens d'éligibilité. Le premier venu pourra être député sans payer un sou d'impôt.
2° L'admission, comme électeurs de tous les citoyens qui sont admis à être jurés.
3° Une indemnité pour les députés, à raison de 20 francs par jour pendant les sessions.
4° Aucun collège électoral ne pourra être de moins de 600 électeurs, et on admettra pour compléter ce nombre, les citoyens les plus imposés après les électeurs légaux.
5° Les délégués des colonies et les membres de la maison du Roi ne pourront être députés.
6° Les fonctionnaires accusés de corruption dans les élections pourront être poursuivis par qui voudra, et devant les tribunaux ordinaires sans aucune autorisation du Conseil d'Etat.
7° Enfin, il a été question d’interdire à tout député non-fonctionnaire d'accepter une fonction quelconque pendant la durée de la législature même en donnant sa démission. Ceci n'a été ni adopté, ni rejeté. C'est là le thème que les journaux de la gauche vont broder dans l’intervalle des sessions. La personne qui me donne ces détails, venus de source, ajoute : " Je crois cette question de la réforme très importante, en ce qu’elle décidera selon moi, la question ministérielle. Le Ministère actuel n’est assez fort ni pour accepter, ni pour rejeter une réforme électorale. Parmi les amis des Ministres centre gauche quelques uns vont disant que la crise ministérielle va commencer, et que M. Passy, Teste et Dufaure sont déterminés à ne plus souffrir le Maréchal aux Affaires étrangères, et M. Cunin- Gridame au commerce. Ce sont- là de belles paroles dont les ministres en question bercent leurs amis sans en penser un mot. "
Thiers sera à Paris dans les premiers jours d'août. Il dit beaucoup qu’il n’a d’engagement avec personne et qu’il est parfaitement libre dans ses mouvements. Le journal le Temps vient d'être acheté, dit-on, par M. de Conny, pour les Carlistes. La Presse reste entre les mains de M. Emile de Girardin et devient de plus en plus vive contre le Cabinet. Voilà un vrai Journal. Personne n'a acheté celui-là et il ne se donne qu'à vous.
Dimanche 9 heures
Je vois que les journaux ne donnent pas toutes les nouvelles d'Orient, et que vous ne comprendrez qu’à moitié ce que je vous en dis. La flotte turque est allée. Je mettre sous la protection de Méhémet. Le divan lui a écrit. Le Sultan l’a confirmé dans le gouvernement de l’Egypte et de la Syrie avec l’hérédité pour sa famille. Il l’a nommé Généralissime et soutien de l'Empire Ottoman, et l'a engagé à se rendre à Constantinople pour présider au début du nouveau règne. Il est probable que Méhémet ira, avec les deux flottes réunies. Voilà les faits qui du reste vous sont probablement déjà venus d'ailleurs. Ils ne sont pas officiellement connus, mais presque Certainement. Adieu. Adieu.
216. Paris, Samedi 13 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'attends. Je devrais ne rien dire de plus, car d’ici à 10 heures je suis tout là. La Cour des Pairs a rendu hier au soir son arrêt, au milieu d’un calme profond. La délibération intérieure a été solennelle. Les plus difficiles sont contents de sa gravité, de sa liberté, de sa probité. La majorité sur le point capital, Barbès a été grande 133 contre 22. Le parti de l'indulgence a été soutenu par des hommes de tous les partis et surtout par ce motif qu’il fallait craindre d'exciter le fanatisme jusqu'à la rage, et de concentrer cette rage sur une seule tête. M. Cousin a soutenu cela avec beaucoup de talent. M. Molé a bien parlé, brièvement, mais nettement, pour la condamnation à mort. Je n’ai encore vu personne ce matin ; mais rien ne m'indique qu’il y ait eu le moindre bruit cette nuit. On en attendait un peu autour de la prison. En fait de forces et de précautions, il y a du luxe. On a raison. Le Duc de Broglie repart ce matin pour la Suisse. Nous nous sommes dit adieu hier au soir. Pendant son séjour, quelques uns des ministres l’ont pressé d'entrer avec eux aux Affaires étrangères. Je l’en ai pressé moi-même, me mettant, s’il entrait, à sa disposition pour le dehors. Il a positivement refusé.
10 heures
J'attends encore. Montrond sort de chez moi, guéri de son érésipèle. Il part dans deux jours pour Bourhame. Delà à Bade. Je regrette bien qu’il m’y soit pas allé plustôt. Quoique vous l'eussiez probable. ment bientôt aisé. Il est bon à retrouver souvent, mais non pas à garder longtemps. Le Maréchal se trouve fort bien aux Affaires Etrangères, et n'a aucun dessein de les céder à personne. L'Orient va très bien, grâce à lui. Tout s’y arrange, et s’y arrangera encore mieux si le Sultan meurt. Un jeune Prince, un Divan nouveau se hâteront de faire la paix avec le Pacha. La paix donc, le Sultan vivant. Encore plus la paix, le Sultan mort. D'ailleurs, il y aura une conférence, à Vienne, et vous y viendrez. M. de Metternich vous promet. ainsi sera réglée la plus grosse affaire de l’Europe. Rien n’est tel que les petits Ministères pour les grosses affaires.
Voilà le N°212. Les dernières lignes valent Je vois que le bruit d’une conférence à Vienne est Baden, comme à Paris. M. Villemain a défendu hier son budget spirituellement mais trop plaisamment. Notre Chambre n’aime pas qu'on plaisante. Il lui semble qu'on ne la prend pas au sérieux. Elle n'aime pas non plus les compliments et M. Villemain en est prodigue. C'est l’usage à l'académie. Entre gens d’esprit de profession, on se croit obligé de ne pas passer sans une révérence devant l’esprit, les uns des autres comme les prêtres catholiques ne passent pas sans un salut, devant l'autel. Notre Chambre ne se pique pas d’esprit, et n'en juge que plus sévèrement ceux qui en ont. Adieu. J’y vais à cette Chambre qui ne se pique pas d’esprit. Je verrai aujourd'hui quand nous finirons. Adieu Adieu. Encore une fois des détails.
G.
J’irai voir Pozzo aujourd'hui ou demain à votre intention.
215. Paris, Vendredi 12 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Se peut-il que ce N° 211 me soit un soulagement ? Pour Dieu, faites partir vos lettres tous les jours, longues ou courtes gaies au tristes. Il me faut une lettre ; il me faut quelques lignes ; il me faut vous, vous ! Vous ne savez pas avec qu’elle horrible rapidité l'inquiétude m’envahit, me poursuit. C’est la chemise de Nessus. Je vous en conjure ; ne soyez pas malade et dites-le moi. J'ai grande pitié de vous. Ayez aussi pitié de moi. J’ai beaucoup souffert, en ma vie ; beaucoup plus que je ne l'ai laissé voir à personne. Pourquoi ne mangez-vous pas ? Est-ce pour dégoût ? Ou bien ce que vous mangez vous pèse-t-il sur l'estomac ? Digérez-vous mal ? Si ce n’est que dégoût, surmontez-le un peu ! Pour moi, pour moi. Que je voudrais être là pour veiller à tout, pour tous savoir au moins. Et votre sommeil vous ne m'en parlez pas. Parlez-moi de tout, fût-ce toujours la même chose. Il n’y a en moi, toujours, qu’une même pensée. Je voudrais vous envoyer l'image complète de mes journées de ce qui les remplit en dedans. Vous verriez. Je devrais peut-être ne pas vous dire tout cela, ne pas ajouter mon inquiétude à votre fatigue. Si vous étiez près de moi, je me tairais mieux. Ne renoncez pas à marcher cela vous est bon. J'ai vu par vos lettres que vous dormiez quelquefois dans le jour. Ne vous en défendez pas.
Je veux parler d'autre chose. Nous sommes assez préoccupés ; agités dirait trop. La Cour rendra son arrêt aujourd’hui. Si Barbès est condamné à mort, le parti fera quelque démonstration, sans espoir, sans dessein sérieux même, par honneur, pour ne pas paraître frappé et mort du même coup. Peut-être quelque tentative sur la prison ; peut-être quelque coup de pistolet sur quelque voiture de Pair.
Paris est fort tranquille. Vous y seriez fort tranquille Je regarde votre lettre. Une chose m’en plait. Votre écriture est bonne et ferme.
J'ai vu Pozzo. Affreusement maigri, rétréci rapetissé, les yeux enfoncés dans un cercle de charbon, la parole chancelante, les épaules voûtées, les jambes ployées, les habits trop larges, l’esprit aussi chancelant que la parole. Nous causions seuls dans le premier petit salon de Mad. de Boigne, Edouard de Lagrange est entré. Il l’a pris pour le Marquis de Dalmatie, lui a parlé du Maréchal ; puis M. de Lagrange passé, il m'a dit tout bas : " C’est bien le marquis de Dalmatie, n’est-ce pas ? " en homme qui doute de lui-même. Pourtant, il m’a parlé longtemps de ses dernières affaires à Londres de ses conversations avec Lord Melbourne et Lord Palmerston de tout ce qu'il leur avait dit sur la nécessité de maintenir la paix sur leurs intérêts et les vôtres dans la paix ; tout cela très nettement, très spirituellement, comme par le passé avec verve dans l'imagination, en même temps qu'avec faiblesse et trouble dans le langage. Puis en finissant : " C'est ma campagne de vétéran. Un autre hiver à Londres me tuerait." Il ne s’est pas pris de goût pour l'Angleterre, en y vivant, Madame de Boigne va mieux, beaucoup mieux. Elle est retournée hier à Châtenay. J’irai y dîner demain.
Connaissez-vous un M. de Lücksbourg, bavarois, qui remplacera probablement ici M. de Jennisson ? Il est venu me voir avant hier. Je l’ai trouvé bien. Si M. de Jennisson s'en va, peut-être son appartement se trouvera-t-il vacant. C’est un peu cher, mais bien gai. A présent tout à côté de la maison est arrangé. Vous n'auriez pas de bruit. Adieu. Je vais à la Chambre. On commence de bonne heure. Pourquoi n’êtes-vous pas à la Terrasse ? Adieu. Adieu. J’aurai de vos nouvelles demain n’est-ce pas ? Ah que la vie est mal arrangée ! Adieu. G.
214. Paris, Mercredi 10 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre santé d'abord. Vous me mettez au supplice en me demandant de la gouverner. Je connais ce mal-là. Je frissonne encore en y pensant. Au bord du précipice dans les ténèbres, pousser ou retenir, on ne sait lequel, ce qu'on aime le mieux au monde ! Si vous étiez là, si j’avais là vos médecins, si je ne vous quittais pas un instant, si je voyais, si j’entendais tout mon anxiété serait affreuse. Et de loin, quand je ne sais rien, rien, quand vous me dîtes hier que vous dormez, aujourd'hui que vous ne dormez pas, tantôt que vous faites de longues promenades, tantôt que vous ne pouvez plus marcher. C'est impossible. Je vois bien que Baden ne vous fait pas le bien que vous en espériez. Ne vous en fait-il aucun ? Vous y êtes bien seule. Ou irez-vous ? à Paris quand je vais le quitter. Aux bains de mer ? Où ? En France, vous y serez plus seule que partout ailleurs. En Angleterre ? Dans cette terre de Lady Cowper dont j'ai oublié le nom, près de Douvres, Broadstairs, n'est-ce pas? Je l’aimerais mieux. Si cela se peut je l'approuverais. Cela se peut-il ? Si le cabinet reste, comme tout l’indique Lady Cowper ne viendra pas sur le continent. Tout à l'heure, je crois, elle vous a de nouveau pressée d’aller la voir.
Jusqu'au moment qui nous réunira à Paris, je ne vois que l'Angleterre qui vous convienne un peu, un peu. Et j'y crains pour vous le manque de repos, les obligations gênantes, le climat triste, les souvenirs. Je ne m’arrêterais pas si je disais tout ce qui me vient à l’esprit sur un tel intérêt, dans un tel doute. Ecoutez ; il y a des choses qu'on peut faire, des résolutions qu'on peut prendre quand la nécessité est là, la nécessitée actuelle pratique, quand l'action suivra immédiatement la résolution, quand on est là soi-même pour agir comme pour parler. Mais décider sans agir, par voie de conseil, envoyer par la poste une décision pareille. Cela ne se peut pas vous ne me le demandez pas. Madame de Talleyrand m’avait promis de me donner de vos nouvelles. Pourquoi ne le fait-elle pas ?
Jeudi 7 heures
Après votre santé, vos reproches. Je les accepte et je les repousse. Moi aussi, j’ai été gâté. Je n’ai pas prodigué mon affection ; et j'ai vu, jai toujours vu celle que j’aimais heureuse, très heureuse. Je l'ai vue heureuse à travers les épreuves, sous le poids des peines de la vie. J’ai toujours eu le pouvoir de la soulever au dessus des vagues, de rappeler le soleil devant ses yeux, le sourire sur ses lèvres, de placer pour elle, au fond de toutes choses ce bien suprême qui dissipe ou rend supportables tous les maux. De quel droit me plaindrais-je que, sur vous, le pouvoir me manque souvent ? Qu’est-ce que je fais, qu'est-ce que je puis pour vous ? Une heure, où une lettre tous les jours. C'est pitoyable. Parce que je suis avec vous ambitieux, exigeant, ne me croyez pas injuste où aveugle. Vos douleurs passées, vos ennemis présents, ce qui vous a brisée, et ce qui vous pèse, je sens tout cela ; je le sens comme, vous-même, oui comme vous- même ; et je sais le peu, le très peu de baume que je verse dans ces plaies qui auraient besoin que la main la plus tendre fût toujours là, toujours. Je sais de quoi se fait le bonheur ; je sais ce qu’il y faut, et à tout instant. Vous ne l’avez pas même par moi. Ma tendresse s’en désole ; mon orgueil s'en révolte ; mais je ne m’abuse point et ne vous reproche rien. Pourtant ne me demandez pas de changer. Je ne changerai pas. Je ne me contenterai pas pour vous, à meilleur marché que je n'ai toujours fait. Je ne prendrai pas mon parti qu’il y ait entre nous tant d'insuffisance et d’imperfection. Ce temps que je ne vous donne pas, il est plein de vous. Ce bien que je ne vous fais pas, je m’en sens le pouvoir. Ce qui manque à votre bonheur ne manque pas à ma tendresse. Ce contraste est poignant. N'importe. Je garderai avec vous mon ambition infinie, insatiable, souvent mécontente ; et je vous la montrerai, comme vous me montrez ce mal que je ne puis guérir. Voilà la vanité. Déplorons la ensemble. Pour tous deux cela vaut mieux que de s'y résigner.
Je viens à vos affaires. Ceci est plus aisé et sur ceci, j’ai un parti pris. J’ignore si votre fils fera ce qu’il doit. Mais, s’il le fait, je suis d’avis que vous mettiez de coté tout fâcheux souvenir, & que vous acceptiez de bonne grâce ce qu’il fera pour vous au delà de votre droit. Vous n’avez point cédé à sa fantaisie, à sa colère. Votre dignité est à couvert. Vous pouvez, vous devez vous montrer facile avec lui, quant à la réparation. Et s'il agit convenablement, s’il met votre droit de côté pour faire son devoir, il y a réparation de sa part. Le fait suffit pour que vous présumiez l’intention. Saisissez la et reprenez votre fils dès qu’il reprendra lui la physionomie filiale. Je n'hésite pas dans mon conseil et je souhaite beaucoup que cela finisse ainsi. Onze heures Voilà mes lettres. Point de vous. Pour le coup, ceci m'inquiète. Je ne vois point d'explication. Peut-être quelque orage. Mais la poste est arrivée. Il faut attendre à demain. Adieu. Un tendre et triste Adieu. G.
206. Paris, Mercredi 3 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai parlé hier. Vous lirez cela. Je regrette bien que nous ne puissions en causer à l'aise. Je suis sûr que j’ai bien parlé. J’ai réussi beaucoup auprès des connaisseurs, convenablement auprès des autres. La portée de ce que j'ai dit n'a pas été vue de tous. De M. Dupin, par exemple qui n’y a rien compris. Quelques uns ont trouvé que je parlais trop bien de votre Empereur, & se sont étonnés qu’en parlant si bien, je n'en parlais pas encore beaucoup mieux. Je crois avoir quant aux choses mêmes, touché au fond, et quant à moi pris la position qui me convient. Vous savez que je suis optimiste, pour moi comme pour les choses. A tout prendre, je ne pense pas que mon optimisme m'ait souvent trompé. Et puis si vous étiez là, je vous dirais bien qu'elle en est la vraie source. Mais vous êtes trop loin. En tout, c’est un grand débat. Et n'oubliez pas ce que je vous disais hier. Pour la première fois, la question est entrée très avant dans la pensée publique. Elle y restera. Elle s’y enfoncera. A mesure que les événements se développeront. S’ils se développent, le Gouvernement peut venir demander aux Chambres ce qu’il voudra, elles le lui donneront. Et si les événements se développent sans lui, il aura grand peine à rester en arrière. Du reste, je crois au bon sens de tout le monde, en ceci. Je ne vous dis rien des nouvelles. Les dépêches télégraphiques sont publiées textuellement. M. Urquart, sur qui je vous avais demandé si vous pouviez me donner quelques renseignements est à Paris, et m’a fait demander à me voir ce matin. Tout brouillé qu’il est avec Lord Palmerston, il me paraît un des hommes les plus curieux à entendre sur l'Orient. Si je vous répétais ce que tout le monde dit, je vous dirais que la session est finie, que ceci est le dernier débat que la Chambre est extenuée et n'écoutera plus rien. J’en doute. La Chambre écoute quand on parle. Ce sont des esprits très médiocres, très ignorants, très subalternes, mais au fond plus embarrassés que fatigués, et qui n'hésiteraient pas tant s’ils y voyaient un peu plus clair.
10 heures
J’ai été interrompu par des visites. Elles prennent beaucoup de place dans ma journée. Je ne me lève guère avant 8 heures et depuis que je suis levé jusqu'au moment où je pars pour la Chambre, j'ai du monde. Je ne ferme point ma porte. Je suis seul ici ; je n’y suis pas venu pour travailler. Je travaillerai au Val-Richer. Ici j'écoute et je cause. Bien dans une vue d’utilité car pour du plaisir je n’y prétends pas. Je suis très difficile, en fait de plaisir. J'en puis supporter l'absence, mais non la médiocrité. Je déjeune à 1 heures. Je vais à la Chambre à l'heure. Quelques fois, je sors une demi-heure plutôt pour passer au ministère de l’Intérieur. Je passe à la Chambre toute, ma matinée. Je lis les journaux. Je cause encore. J’écoute un peu. Je rentre au sortir de la séance. Je m'habille. Je vais dîner bien rarement au café de Paris, trois fois seulement depuis que je suis ici ; hier chez Mad. de Gasparin, aujourd’hui chez Mad. Eymard avec le Duc de Broglie. Jeudi chez M. le Ministre de l’instruction publique, Vendredi, chez M. Devaines etc. Je rentre de très bonne heure. Je lis. Je me couche et je dors ou je rêve, quelquefois bien mal, comme vous savez, souvent mieux. Quand je dis que je dors, je me vante un peu. Depuis quelque temps je dors moins bien. Je rallume mes bougies. Je lis ou je pense. Je n’ai pas deux pensées.
11 heures
Voilà votre Numéro 205. Je viens de faire ce que vous me demandez. Je vous ai raconté mes journées. Elles se ressemblent beaucoup. Les vôtres me chagrinent. Vous savez que je déteste les sentiments combattus. Vous m’y condamnez. J’aime le vide que je fais dans votre vie, et celui que vous souffrez ne désole. Je vous pardonne tous vos reproches. Adieu. J’ai ma toilette à faire, et à déjeuner. Je veux être à la Chambre de bonne heure, M. Douffroy résumera la discussion. Ce ne sera pas brillant, mais sensé et bien dit. Adieu. Adieu. Tout est insuffisant, tout ; et c’est le mal de notre relation qu'elle est vouée à l’insuffisance. Je supporte ce mal avec une peine extrême, et je le retrouve à chaque instant pourtant. Adieu
204. Paris, Dimanche 30 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis excédé. Après ma corvée de visites du Dimanche, il m'a pris la fantaisie de mettre un peu d'ordre dans un horrible fouillis de livres, planches, cartes & que j’avais laissé entasser. J’y travaille depuis trois heures. La tête m'en tourne. Je ne puis me redresser. Pour moi, l'activité morale et l'activité physique s'excluent l’une l'autre. Quand je ne fais rien, quand je ne pense à rien et ne me soucie de rien, je puis marcher, courir, supporter autant de fatigue corporelle que tout autre. Mais quand j'ai l’esprit très occupé, il faut que mon corps se repose. Toute ma force va à l’un ou à l'autre emploi.
Je ne suis pas content de votre N° 203. Ce peu de succès du lait d’ânesse et des bains, cette lassitude invincible dans une vie si tranquille, cette impossibilité de reprendre un peu d’embonpoint, tout cela me désole. Je vous en conjure ; nous avons assez souffert l'un et l'autre ; ne nous soyons pas, l’un à l’autre, une cause de souffrances nouvelles. Ayons pitié l’un de l'autre. Et que Dieu ait pitié de tous deux ! Je me défends du mieux que je puis mais j’ai le cœur serré. Dites-moi que vous êtes mieux ; mais ne me mentez pas. Vous pouvez être tranquille sur Paris. Il n’y aura infailliblement point de pillage très probablement, point d'émeute, et probablement rien du tout. Le procès se passe dans un calme profond, dans la salle et autour de la salle. Les accusés ne sont pas même insolents. En cas de condamnation à mort seulement, on peut craindre quelque tentative, tentative d'assassinat, d'enlèvement, de coup fourré, qui sera déjoué, mais dont il est difficile de prévoir le mode. On croit à deux condamnations à mort. Le procès sera moins long qu’on n'imaginait. Les interrogatoires marchent vite. Pozzo a pu partir, car il est arrivé à Calais. Une dépêche télégraphique l’a annoncé ce matin. L’envie dont je vous parlais l'autre jour s'est manifestée. Le marquis de Dalmatie est allé trouver M. Duchâtel pour lui demander de la part du Maréchal, s'il croyait possible de me déterminer à aller à Constantinople. C’est décidément M. de Rumigny qui ira à Madrid et M. de Dalmatie, sera nomme à Turin. Le Duc de Montebello se désole de rester Ambassadeur à Naples in partibus. Le Roi de Naples est toujours mal et ne remplace pas M. de Ludolf. C’est Mad. la Dauphine qui a fait rompre le mariage de Mademoiselle avec le comte de Lecce, par vertu et pour ne pas sacrifier cette jeune Princesse à une espèce d’idiot.
8 heures et demie
Je viens de dîner au café de Paris, avec M. Duvergier de Hauranne, uniquement occupé des chemins de fer, qu’on discutera après l'Orient. Dans mes études, je n'ai jamais eu aucun goût pour les sciences physiques. Je reste fidèle à cette disposition. Il me faut des hommes à remuer. Les pierres m'ennuient.
Lundi 8 heures
Il fait froid. Je viens de faire faire du feu. Ce temps là vous gâte vos promenades, tout ce que vous avez de bon à Baden, n’est-ce pas ? Mes enfants m'écrivent qu’il pleut sans cesse au Val-Richer. Pour eux, ils ne s’en promènent guère moins. Ils sont très bien. Guillaume a été un peu enrhumé, mais sans la moindre conséquence. Ma mère est très bien aussi. Montrond me dit que décidément il ira à Baden. Mais il va d’abord à des eaux de malade, je ne sais lesquelles, dix en Savoie, je crois. J’ai peur qu’il ne vous arrive bien tard. Adieu. Donnez-moi de meilleures nouvelles si vous voulez que je ne sois pas triste et abattu. Ce n'est pourtant pas le moment.
La discussion sur l'Orient commence aujourd’hui. J’ai envie de parler et je doute. On dit que M. de Lamartine dira toutes sortes de choses, qu'il faut tuer, l’Empire Ottoman parce qu’il va mourir qu’il faut vous donner Constantinople pour l'ôter aux Barbares, & Adieu. Adieu.
10 heures
J’aime les plaisirs inattendus. J’aime les exigences. Je les rends. Je puis donner beaucoup, beaucoup beaucoup plus qu’on ne sait ; mais je veux reprendre tout ce que je donne. Je vous écrirai demain. Je vous écrirai deux fois par jour, si vous voulez me promettre de vous bien porter. Vous me dites que vous pensez sans cesse à moi. Je vous défie d'envoyer vers moi une pensée qui n'en rencontre une de moi vers vous. Je suis sujet à vous de fier. On dit que j'ai l’esprit actif. J’ai le cœur bien plus actif que l’esprit ; et il me passe bien plus de peines ou de joies dans l'âme que d’idées dans la tête. Mais l’esprit montre tout ce qu’il a, & l'âme en cache beaucoup. Je m'arrête, car j'irais à des subtilités de théologiens ou de Bramine. Il y a du vrai pourtant dans ce que je vous dis là. Adieu jusqu’à demain. Je vais déjeuner & puis me promener en allant à la Chambre. Je ne fais point de visites. Adieu.
198. Paris, Mardi 18 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis désolé de votre inquiétude. Ma lettre était partie très exactement. Me voilà ici pour un mois. Le retard sera impossible, s'il y a un mal impossible. Vous étiez un peu mieux samedi. Je voudrais suivre toutes les variations de votre santé, de votre disposition morale. Ce n'est pourtant pas un très bon régime. On s'accoutume au mal en le voyant revenir sans cesse, et on n'y croit plus assez quand on l’a vu s’en aller souvent. Je ne veux pas être rassuré à tort. Dites-moi tout, toujours tout. Je ne veux pas ignorer la moindre de vos souffrances et de vos peines.
Paris est grand et vide comme le désert. Je ne me fais pas à y être venu pour ne pas vous y chercher. Cette nuit, pendant toute la route le roulement de la voiture n’avait pas de sens pour moi. Je m'étonne quelquefois que vous me soyez tant. Dans une vie déjà longue et si pleine, après avoir tant possédé et tant perdu, je devrais être plus las et plus détaché. Je ne le suis pas du tout quant à vous. J’ai, quant à vous, cette ambition vive, indomptable et pleine d'espoir de la jeunesse. Je ne renonce à rien, je ne me résigne à rien. Je veux tout et que tout soit parfait. Je ne sais quelles années Dieu me réserve, ni quelles épreuves encore dans ces années. Mais il y a en moi un côté, un point que la vie la plus longue n'usera pas, et qui descendra jeune dans le tombeau.
8 h. 1/2
Je rentre. Je viens de traverser la place Louis XV par le plus magnifique spectacle. Sur ma tête, le ciel noir, parfaitement noir, le déluge près de tomber, et ce voile noir jeté tout autour de la place, entr'autres sur les deux colonnades. Au bout des Champs-Elysées, derrière les Champs-Elysées, le soleil couchant dans un cercle de feu, sur un bûcher embrasé, comme pour braver au moment de s'étendre, la nuit et l'orage. Et la moitié supérieure de l'obélisque brillante, rouge des derniers rayons du soleil, un jet de flammes suspendu au milieu des ténèbres, et les hiéroglyphes visibles et inintelligibles, comme des caractères cabalistiques. Effet étrange et grand qui ne se reproduira peut-être jamais. Je regrette que nous ne l’ayions pas vu ensemble. Je vous ai désirée au moment où il a frappé mes yeux. J’ai passé ma matinée à la Chambre, le seul lieu de Paris où il n’y ait point d'orage. Tout le monde repart de la session comme finie. Ministres et députés ont l’air de s'entendre pour ne rien faire et ne rien dire. Le Cabinet a perdu ce qu'il n’avait pas. Le Maréchal a été la risée de la Chambre des Pairs à propos des fonds secrets. M. Villemain y a été battu avec gloire à propos de la légion d’honneur. Le Ministre de la guerre ne se bat nulle part. M. Duchâtel est ce qu’il était. M. Dufaure ne devient rien, M. Passy paraît le plus sérieux ; c’est lui qui cause de l’Europe dans les couloirs. Tout va cependant, et tout ira cla se, comme le monde. Convenez qu'il est plaisant d'entendre un Russe dire dédaigneusement que " tout cela finira par un bon petit despotisme, le seul gouvernement possible avec les Français. " Du fait, ce ne sont là que les petits moments d'une grande histoire. Et il y a beaucoup de petit dans le plus grand. Le petit s’en va & le grand seul demeure. Nous ne supporterions pas la lecture du passé s’il nous était arrivé chargé de tout son bagage. L'Assemblée constituante, l'Empire, la Charte, la Révolution de 1830, c’est un manteau assez large pour couvrir bien des misères.
On me dit que M. Molé s’est beaucoup remué contre le Cabinet dans l'affaire de la Légion d’honneur tandis que M. de Montalivet se faisait très ministériel. Aussi ils se renient l’un l’autre. M. Molé part pour Plombières dans les premiers jours de Juillet. La fantaisie lui reprend d'entrer à l'Académie française. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu'elle lui reprend sans qu’il y ait en ce moment aucune vacance. On m'en fait parler par avance. Est-ce bien de l'Académie française qu’on veut me parler ?
Mercredi 1 heure
J’ai eu du monde depuis que je suis levé. Je vais à la Chambre. C’est aujourd'hui mon mauvais jour. Je n’ai pas de lettre. Adieu. Adieu. Je viens de revoir la mine de M. Saint. Rendez-la moi. Adieu. G.
196. Val-Richer, Vendredi 14 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je commence par où j’ai fini hier, mon indignation. Elle est inépuisable. Que deviendriez-vous si vous n'aviez rien à vous ? On n'en aurait été que plus pressé de vous traiter de la sorte pour vous dompter, pour se venger que sais-je ? Ceci me fait éprouver un des sentiments les plus pénibles que je connaisse. Je porte un respect général et profond à ces relations naturelles, indestructibles, indépendantes de notre choix, par lesquelles, sans concours, sans mérite de notre part, dieu nous donne des amis, des appuis, du bonheur et de la sécurité ; et pour toute la vie. Même avec des gens que je n’aime pas, que je ne connais pas, il m'est souverainement désagréable de laisser tomber un mot de reproche ou de blâmer sur un fils devant sa mère, sur un frère devant sa sœur. J'en éprouve une sorte d’embarras et de tristesse comme si j'allais contre une intention divine, si je touchais à une œuvre sacrée. Et pourtant ici, il n'y a pas moyen. Je ne puis me taire ; je ne dirai jamais tout ce que je pense. Alexandre ne vous avait donc pas dit un mot de cette mesure. Vous en avez sans doute informé sur le champ votre frère. Je n'ai d'espoir qu'en lui pour pousser un peu vite vos affaires et prendre un peu soin de vos intérêts. Car voilà une raison, une nécessité de plus d’aller vite. On ne peut vous laisser longtemps dans ce dénuement. Qu’on finisse, qu’on finisse, et que vous puissiez ne plus penser qu'au lait d’ânesse et aux bains de son. Votre médecin de Baden est plein de bon sens ; il sait ce qu’il vous faut. Pour dieu, qu’on le laisse faire.
Je trouve votre réponse au Grand Duc excellente. Pour tout dire, je ne lis pas sans quelque mouvement d’impatience ces belles paroles, ces tendres épanchements de votre âme jetés à un pauvre jeune homme qui ne comprend pas, qui n'ose pas, devant qui tout cela passe comme les élans de la piété et de la prière devant une idole. Il y a un Dieu au-dessus de l’idole, dont l’idole n’est que l’image, et qui comprend l'âme qui prie. Mais ici... Décidément, je ne vaux rien pour l’idolâtrie. J’admire, j’aime le respect et le dévouement, deux vertus rares, beaucoup trop rares de mon temps et dans mon pays ; mais j'y porte, je l'avoue, un peu d'exigence superbe. Passé cette explosion de fierté libérale, je ne vois pas le moindre mot à redire dans votre lettre ; elle est triste, pénétrante, et très digne dans sa ferveur impériale. C’était le problème et vous l’avez résolu.
Samedi 9 heures
Mes hôtes viennent de partir, et moi je partirai après demain pour un mois, je présume. Si vous étiez à Paris, ce mois serait charmant. On est assez occupé du procès. Concevez-vous l'audace de ces gens-là qui font fabriquer une pièce de canon & la trainent dans les rues de Paris ? On l'a saisie. C'était une machine pitoyable ; mais enfin, au dire des ingénieurs, elle aurait pu tirer encore 40 ou 50 coups. Les sociétés secrètes viennent de modifier, leur organisation ; elles se sont constituées par armées ; à un homme par jour. Cinq armées sont organisées, formant donc à peu près 2000 hommes. Elles se sont épurées dans ce nouveau travail, comme tous les partis en déclin, mais très vivaces, qui opposent le redoublement du fanatisme au progrès de l'impuissance. La dernière insurrection n'a pas eu, dans les Provinces, le moindre retentissement. Presque toujours quand un orage éclatait à Paris, il grondait à Lyon à Strasbourg, à Marseille. Rien de semblable cette fois. L’épreuve a même été très complète car il y a eu à Lyon, un peu de tumulte parmi les ouvriers pour une question de salaires, et la politique n’y a paru en rien.
Voilà votre n°195. Merci de vos détails. J'en avais besoin. La lettre de votre frère me rassure un peu. Mais j'aspire à la fin. Du reste, après l'acceptation de vos pouvoirs par le comte de Pahlen et la surveillance déclarée de votre frère, vous pouvez certainement être plus tranquille. Il me faut la permission de l'Empereur. Ce qui vous revient de droit sera trop peu. Votre lettre à votre frère est très convenable. Adieu. Je vous dirai en arrivant à Paris, s'il faut m’écrire rue de l'Université ou rue Ville l'évêque. Adieu. Adieu. Commencez-vous à engraisser ? G.
194. Val-Richer, Lundi 10 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que vous avez à Baden un climat moins variable que le mien. Je ne puis garder le soleil deux jours de suite. Je n’aime pas cela. J’aime l’égalité et la durée. Plus ce qui me plaît dure, et dure toujours le même, plus j'en jouis. Je n’ai jamais compris ce que c'était que de se blaser. Il m'est arrivé (et même bien rarement) de reconnaitre que je m'étais trompé, que j’avais eu tort de prendre plaisir à quelque chose ou à quelqu'un ; mais m'en lasser à cause du temps seul, non. Bien loin d'user pour moi ce que j'aime, le temps m’est trop court pour en jouir, selon mon cœur. L’éternité seule y suffirait. Vous êtes-vous jamais figurée ce que serait le bonheur avec la perspective de l'éternité ? Il n'y a d'éternel que mon rhume de cerveau. Ceci, par exemple, je m'en ennuie. Depuis quelques jours, je ne vois rien qu’à travers un nuage, ma vallée, mes enfants, mes idées, sauf une qui est toujours claire et vive. A force d'éternuements de brouillards, de larmes, je me suis endormi hier sur mon canapé en lisant l'Orient. Car décidément je regarde beaucoup à l'Orient. J’en saurai très long sur ces affaires-là. C’est bien dommage que nous ne puissions pas en causer encore avant que j'en parle. Evidemment les évènements ne marchent pas vite, là, et les efforts de l’Europe pour les ajourner arriveront à temps. D'après ce qui me revient, pour peu que l'affaire fût bien conduite, l’hérédité de Méhémet-Ali sortirait de cette crise, et le statu quo, dont on parle toujours après un changement, recommencerait pour un temps.
8 heures et demie
Je viens de faire placer mes orangers. On peut prendre beaucoup d’intérêt à ce qu’on fait par cela seul qu'on le fait. Mais, c’est seulement pendant. qu'on le fait. J’ai planté un monde de fleurs. Dans six semaines le Val Richer sera un bouquet. Que vous revient-il de Londres? Le Cabinet me semble dans une situation de plus en plus précaire Lord Melbourne et Lord John ont l’air d’honnêtes gens à bout de voie, qui ont de l'humeur contre tout le monde, contre qui tout le monde a de l'humeur, et qui ne voulant par aller plus loin, ne peuvent plus aller du tout. On ne me mande rien de Paris, sinon que les grands projets historiques de Thiers, ne sont pas si sérieux qu’on l'affiche, et que tout cet étalage de 500 000 fr. a surtout pour but de rassurer des créanciers, et de les engager à prendre patience. A défaut du Ministère, on leur montre en perspective l'histoire de l'Empire. La Chambre des Pairs s’est bien échauffée sur la Légion d’honneur. Le Ministère y a repris ses avantages. Décidément M. Villemain est l'homme résolu et agissant aussi bien qu'éloquent du Cabinet. Il est toujours question du voyage du Roi à Bordeaux. M. Dufaure l'accompagnerait. Le Roi prend tout à fait possession de M. Dufaure. Il ( je veux dire M. Dufaure) avait aussi votre faveur, Madame ; mais je doute qu'il la conservât de près. Il n’a d’esprit et de talent qu'à la tribune.
Mardi 9 h. J’attends le courrier ce matin avec un surcroit d'impatience. Je n’ai pas eu de lettre depuis deux jours. Enfin celle-ci ouvrira une ère régulière. C’est bien le moins qu’elle soit régulière. Vote embonpoint et vos lettres, je veux ces deux choses-là de votre absence.
1 heure Voilà enfin votre N°193. Encore un nouveau retard de la malle poste. Je suis désolé d'avoir dit qu'il ne fallait pas destituer M. Conte. A demain ma réponse. Il faut que je donne tout de suite ceci. Je suis charmé de vous savoir arrivée bien logée. Adieu. Adieu. Mille et un.
183. Lisieux, Jeudi 28 février 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Malgré mon égoïsme, je regrette que Thiers ne vous ait pas plus amusée. Je ne veux pas que personne vous occupe ; mais qu’on vous amuse, tant qu’on pourra. Moi, je suis très occupé. Je suis curieux de savoir ce que le cabinet aurait fait contre moi s’il avait combattu mon élection. Il est établi qu’il ne la combat point ; il n’a pas de candida t; tous les fonctionnaires votent pour moi. Et tous les jours il arrive ici 800 exemplaires autant que d’électeurs, d’un petit journal intitulé le Bulletin français, et spécialement, exclusivement dévoué à me dire des injures. Il ne se met pas en grands frais d'invention ; il va reprendre dans les anciens journaux depuis 1830, carlistes, républicains, oppositions de toutes sortes, toutes les injures qu’on m'a dites, tous les mensonges, toutes les colères, et il les réimprime. C’est un curieux spectacle que tant d'activité pour rien, et aussi la parfaite indifférence avec laquelle cela est reçu. On s’en étonne et on ne s’en soucie pas du tout. Si toute la France était comme cette province-ci, les 213 reviendraient 300.
Je vais ce matin au Val-Richer. J’y aurai le plaisir d’être seul quelques heures. Après vous, ce que je désire la plus en ce moment, c’est un peu de votre solitude. Depuis quelque temps, ma disposition est assez combattue. Je ne suis point las de la vie active et des affaires ; elles me plaisent toujours ; il me semble même que ce que j'y voudrais faire est à peine commencé. J’ai la tête de la volonté encore très pleines. Pourtant je suis un peu las des hommes ; j'en ai assez de leur conversation de leur figure. Je suis au milieu d'eux comme dans une foule qu’on est pressé de traverser pour rentrer chez soi. Rentrerais-je jamais chez moi ?
Maroto ne me rejoint ni ne m'afflige comme Granville ou Pahlen. Il me prouve que j'ai raison de ne rien attendre de personne en Espagne. On y fera ce qu’on y fait ; on y restera comme on est. Il n’y a là point de vainqueur. C’est parce que nous sommes des Européens que nous nous en étonnons. Il y a un pays dix fois grand comme l’Europe, où les choses se passent et demeurent ainsi depuis des siècles. Ce pays s’appelle l'Asie. Là par exemple, on a bien raison d'être las des hommes. Quoique vous ne sachiez pas le Latin, vous savez que Tacite a dit en parlant des statues de Brutus et de Cassius : « Elles brillaient d’autant plus qu’elles n’y étaient pas." C’est votre condition dans toutes ces conversations, ces correspondances, ces articles de journaux à propos de Prince de Lieven. Laissez- moi vous répéter ce que je vous ai dit. Vous êtes trop fière pour être faible. Et vous n'êtes pas plus fière qu’il ne convient.
On a tort en Belgique d'attendre l'issue de nos élections. Elles n'enverront pas cinq hommes et un caporal dans le Limbourg. Si j’avais eu besoin d'apprendre que ce pays-ci veut la paix, je l'apprendrais au milieu de toutes les oppositions, n'importe laquelle. Il a raison. La guerre pour de grandes raisons, à la bonne heure ; mais la guerre pour des querelles de journalistes ou pour des fantaisies, de gens d’esprit, c'est absurde. Adieu. De loin, je cause avec vous de ce qui ne me fait rien, ou pas grand chose. Voyez à quels scrupules d'exactitude vous m'avez accoutumé. Au fait, vous ne savez pas, personne ne saura jamais combien tout ce qui ne me tient pas au fond du cœur est peu pour moi, et quel abyme il y a en moi entre une chose et toutes les autres. Adieu. Vous ne me donnez pas des nouvelles de votre rhumatisme. A la vérité, il était passé quand je suis parti. Mais il me semble que de ce qui vous touche, rien ne passe. Adieu, Adieu.
82. Val-Richer, Lundi 9 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
On m’a reproché d’être dédaigneux. J’en fais pénitence. Je vis ici Dieu sait à quelle distance de ma vie intérieure, habituelle. C’est la faute de notre état social et la loi du gouvernement représentatif. Vous n’avez jamais éprouvé cela. Je me trompe. C’était là votre, condition, et aussi votre sentiment quand vous êtes retournée à Pétersbourg. Les petits jeux de l’intérieur du Palais, votre étonnement de l’étonnement que vous avez excité autour de vous le jour où vous avez dit quelques mots de politique à dîner. Votre impossibilité de causer vraiment avec personne votre mal aise dans cette atmosphère pesante et inférieure, c’est le pendant de mon mal. Seulement vous aviez affaire à un Empereur, moi à des électeurs. Peu importe. Vous plaisiez à votre Empereur. Je plais aussi à mes électeurs. Je soupçonne même que je me prête à leurs affaires, à leurs conversations, avec moins d’effort et d’ennui que ne vous en imposaient les brusques fantaisies, ou les grosses gaietés impériales. Je ne connais personne qui sache moins descendre que vous.
Dans votre sphère, quand vous vous sentez en parfaite harmonie avec les situations, les idées les sentiments, les habitudes, les manières qui vous entourent vous avez l’esprit singulièrement animé, fertile souple ; vous êtes pleine de facilité, de laisser aller. Mais vous ne pouvez pas du tout vous dépayser. Sur tout autre échelon, dans tout autre air, vous êtes comme sous la machine pneumatique, mal à l’aise, froide immobile. Vous êtes, en fait, d’élévation et de tous les genres d’élévation, ce qu’on appelle aujourd’hui une spécialité. Vos habitudes sont devenues, votre nature. Restez comme vous êtes. Ce que vous avez me charme, et je ne vous désire point ce qui vous manque.
Je suis bien aise qu’Emilie Flahaut se marie bien. Mais c’est triste d’épouser un mari qui mourra dans deux ans. Si elle l’aime ? Est-ce qu’il est menacé de la maladie de Lord Kerry ? Qu’est devenue Lady Kerry ? Est-elle morte aussi ? Elle avait bien un air à mourir. Je n’ai jamais vu de structure si frêle et de blancheur si pâle. Voilà un singulier effet d’imagination. Je vous croyais en Angleterre. Je vous écrirais à Londres. J’allais vous prier de faire mes amitiés à Lord Landsdown. C’est un souvenir de l’an dernier. Et aussi un effet de ce que depuis quelques jours, vous passez comme vous dîtes, votre vie, en Angleterre. Je la regretterai bien pour vous dans quelques jours.
J’espère que vous verrez aujourd’hui, le Duc de Broglie. Je le désire. Je le verrai après-demain. Que nous sommes enfants ! Nous avons bien raison. C’est la vie que ces enfantillages-là. Je voudrais bien voir ce qu’elle serait si on les en retranchait tous, tous absolument. Mais j’aime mieux les enfantillages de près et sans intermédiaire. Dans un poète persan qui s’appelle Saadi, un voyageur s’arrête auprès d’une fleur : " Fleurs d’un parfum si doux, es-tu la rose ? - Non, mais j’ai vécu près d’elle. "
10 heure ¼
Votre n°85 est bien triste, triste pour vous, triste pour moi. De près, votre tristesse m’est douloureuse de loin intolérable. Mais pourquoi dit-on intolérable quand on tolère ? Et puis, ne m’en veuillez pas d’être triste aussi pour moi. Il faut me pardonner mon immense exigence. Adieu Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Interculturalisme, Poésie, Portrait (Dorothée), Réseau social et politique
79. Val-Richer, Vendredi 6 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas mieux élevé que vous ; mais je sais mieux ne pas me livrer à ma première impression, ou à une seule de mes impressions, et supprimer ou du moins imprimer celle à laquelle je ne veux pas me livrer. Cela s’appelle avoir de l’empire sur soi. J’en ai plus que vous, cela est sûr. Ce n’est pas toujours raison ou vertu, tant s’en faut. C’est bien souvent orgueil, pur orgueil. Je ne puis souffrir de ne pas paraître le maître, ni qu’il soit évident, ne fût-ce que pour moi seul, que je ne fais pas ce qui me plaît. J’étouffe soigneusement mon déplaisir pour ne pas laisser voir que je subis une autre loi que ma volonté. L’impossible m’offense. Je me sens humilié de me débattre sous sa main. J’aime mieux l’accepter. Ce n’est pas votre disposition. Vous ne supprimez rien de ce qui se passe en vous. Tout ce qui est paraît. Vos chagrins, vos déplaisirs, ces désappointements, ces ennuis, ces débats intérieurs dont la vie est semée, vous laisser tout éclater, tout voir. Je n’ai jamais rencontré personne qui conservât tant de dignité au milieu de tant d’abandon. Car vous avez la dignité la plus haute, la plus noble qui se puisse imaginer, et qui ne s’altère jamais au milieu de vos impressions si librement, si vivement manifestés. C’est un des traits les plus originaux de votre caractère, et l’un de ceux qui pour moi, de très bonne heure dans notre relation vous ont le plus mise à part de toutes les femmes. L’abandon, leur est naturel mais il les fait un peu descendre. Vous avez plus d’abandon, plus de transparence, comme vous dîtes, que personne vous restez toujours à votre hauteur. Vous me demandez si je ne vous trouve pas un peu d’humeur. Oui, Madame, quelquefois. J’ai été quelquefois tenté de m’en choquer. Excepté de ma mère, je n’ai jamais supporté l’humeur de personne. Quand la vôtre m’a apparu, je vous aimais déjà beaucoup, beaucoup. L’affection a contenu la surprise. Et puis, j’ai bientôt reconnu la source de votre humeur. Elle ne vient en vous d’aucun défaut, d’aucun désagrément de caractère, ni de susceptibilité, ni de brusquerie, ni d’exigence ni d’attachement aux petites choses. Vous êtes naturellement très douce, très égale, charmante à vivre. Votre humeur ne naît jamais que du chagrin d’un grand, d’un profond chagrin. Il vous indigne, il vous révolte, il s’empare de vous tout entière. Et alors ce qui ne répond pas pleinement à votre chagrin, ce qui n’est pas en harmonie, en parfaite harmonie avec l’état de votre âme, vous donne de l’humeur. L’humeur est pour vous l’une des formes de la douleur. Je vous aime trop, Madame, pour que cette forme là ne s’efface pas devant la profonde sympathie que votre douleur m’inspire. Vous avez cruellement souffert. Mais laissez-moi vous le dire ; je suis plus fait à la douleur que vous, à la douleur morale, comme à la douleur physique. Vos épreuves vous sont venues tard, au milieu d’une vie qui avait été constamment facile, agréable, brillante. Vous n’aviez connu ni le malheur, ni la difficulté, ni la contrariété. Vous n’aviez porté aucun fardeau. Vos émotions même malgré le sérieux de votre naturel, avaient été assez superficielles, et bien loin d’ébranler toute votre âme. Un seul sentiment, le dernier venu, était en vous très puissant et profond. Quand vous avez été frappé, vous avez éprouvé cette immense surprise, cette révolte intérieure qui accompagne, les premiers chagrins, les chagrins de la jeunesse ; et comme vous n’aviez plus, pour y échapper les ressources de la jeunesse, sa mobilité, sa facilité à se distraire, son empressement à jouir de la vie encore inconnue, vous êtes restée sous l’empire de cette impression de surprise et de révolte. La douleur vous a atteinte tard, et trouvée jeune pour souffrir. Et vous avez souffert avec l’impatience avec l’âpreté de la jeunesse. J’ai éprouvé, j’éprouve encore, en vous voyant souffrir, le sentiment d’un vieux soldat couvert de blessures, qui voit les fatigues, les langueurs, les souffrances d’un jeune homme qu’il aime et qu’il soigne...
10 heures
Je m’étais levé de bonne heure pour vous écrire bien à l’aise. J’ai été interrompu par mes enfants, par ma mère, par Mad. de Meulan, par je ne sais quel incidents insignifiants dans la maison. Voilà le facteur, et il faut qu’il reparte. J’en suis très contrarié. J’ai besoin de causer avec vous. J’ai une infinité de choses à vous dire. A demain. Ou plutôt à ce soir. Je me suis couché hier de bonne heure. Je tombais de sommeil, je ne sais pourquoi. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Portrait (Dorothée)
72. Lisieux, Jeudi 28 juin 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis ici depuis une heure entouré de visiteurs. Nous allons déjeuner et dans deux heures je repars pour le Val-Richer. Mes enfants sont bien. Je ne trouble pas leur joie. A chacun les siennes. Je ne donnerais les miennes, coûte que coûte, pour quoique ce soit au monde. Il faut qu’elles soient bien profondes, et bien puissantes pour que j’en parle aujourd’hui. Sachez bien une chose, je vous en prie, c’est que si je suis exigent, en revanche je suis infiniment reconnaissant. Adieu. Il ne fait pas chaud. Ce soir après dîner, je me promènerai. Et puis, quand tout le monde sera couché, je me promènerai encore, seul. Point d’incident en voyage. Ma lettre ira vous chercher rue de la Charte, là où je n’ai pas été. Du moins, soyez y fraîchement et en repos.
Adieu. G.
Lisieux jeudi 10 heures.
Mots-clés : Autoportrait, Vie familiale (François)
178. Lisieux, Vendredi 2 novembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous écris debout, auprès de ma fenêtre, avec trois personnes dans ma chambre, certains attendent en bas dans le salon. C'est mon dernier séjour ici : on se presse. Deux choses dominent en province, les intérêts privés et l’ennui. On me trouve bon pour l'un et l'autre mal. Je ne suis bon à présent qu’à une chose, à désirer mardi. L'impatience de vous revoir m'envahit. Ma solitude de deux mois et demi pèsera tout entière sur chaque moment jusqu'à ce que je vous aie retrouvée, vue, entendue, à côté de moi, devant moi, bien près de moi. Si les trois personnes qui sont là, et qui m’interrompent savaient quel sentiment me tient et ce que j'écris, elles seraient bien étonnées. Soyez, soyez impatiente. Soyez-le autant que moi. Il me le faut absolument. Je vous écrirai encore demain et après demain, mais lundi, non, ce sera moi qui partirai. Vous m’écrirez aussi Dimanche pour la dernière fois.
Il a fait cette nuit un temps épouvantable du vent, de la pluie, de la grêle avec fracas. Et au milieu de ce fracas, la sonnerie de toutes les cloches de la ville pour la fête de la Toussaint. Tout cela m'a éveillé, comme de raison. J’ai pensé à vous; je n'ai plus rien entendu. Il y avait une chanson où un pauvre jeune conscrit partant pour l’armée disait à sa maîtresse, Charlotte, je crois. Les cent voix de la renommée de ta voix n'ont pas la douceur. Je dis bien mieux, votre voix, votre seule pensée couvre toutes les voix de la renommée, des cloches, de l'orage. Adieu. Adieu.
Je retourne à mes ennuyés. Adieu. G.
Ma mère était bien hier. Je repars dans une demi-heure pour arriver avant le déjeuner. J’ai Mad. de Meulan avec moi. Elle était invitée à ce dernier dîner. Voilà mon courrier. Pas de lettre. Pourquoi ? J’ai le cœur bien serré. Adieu encore. G.
Mots-clés : Autoportrait, Relation François-Dorothée
169.Lisieux, Mercredi 24 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier au moment où j’allais partir, deux personnes me sont arrivées qui viennent passer deux ou trois jours au Val Richer. Il a bien fallu les y laisser pour venir dîner ici, et je les laisserai encore aujourd’hui. Aussi je retourne, sur le champ pour être poli au moins à déjeuner. Encore aujourd’hui vous n’aurez donc que quelques lignes. Cela me déplaît, je vous assure autant qu’à vous. Il me semble que je vous ai sous ma garde, et que je manque à ma consigne quand je vous quitte. Il faut que vous me plaisiez beaucoup et bien sérieusement pour qu’il en soit ainsi. Je n’ai pas le goût ni l’habitude, des devoirs factices, et je n’aliène pas aisément une part de ma liberté. Vous avez vécu dans un pays libre, représentatif, électoral. Mais vous n’en avez jamais mené la vie. Vous ne savez donc pas ce que c’est qu’un grand dîner d’électeurs importants, où viennent s’étaler toutes les importances, toutes les magnificences de l’endroit où il faut passer deux heures à table mangeant et causant, deux heures après la table causant et jouant au trictrac, avec 40 personnes. Voilà ma vie hier et aujourd’hui. Cela aussi, il faut que ce soit bien sérieux pour que je le fasse. Mais c’est un sérieux moins plaisant.
Je crois comme Berryer que la prochaine session sera importante et très animée si chacun consent à prendre sa position simplement, nettement, sans but immédiat et sans combinaison factice. C’est, pour mon compte, ce que je me propose de faire. Adieu. On me dit que ma calèche est prête. La poste n’est pas encore arrivée. J’espérais l’avoir avant de partir. Elle viendra me chercher au Val-Richer. Il a fait un brouillard abominable, cette nuit. Le courrier aura marché plus lentement. Adieu. Adieu. Non pas comme si nous nous promenions, aux Tuileries, mais comme dans notre cabinet. G.
166. Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me lève au milieu d’un brouillard incomparable. Je ne vois pas les arbres qui sont devant mes fenêtres. Quand je me reporte en Languedoc, en Provence, sous ce ciel toujours si pur où les regards s’enfoncent sans que rien, les gênes et dont pourtant ils n’atteignent jamais le terme, je ne conçois pas comment je ne suis accoutumé à ces caves du Nord. Et je m’y suis accoutumé et je dis qu’elles sont vertes et fraîches. Il est vrai qu’elles le sont, qu’elles ont leur beauté, et que la sagesse de l’homme consiste à savoir jouir partout de la richesse de Dieu. Je le pense. Je le fais. Et pourtant je regrette, mon soleil. Il sera plaisant en effet que l’Empereur ait fait en Allemagne tout ce chemin et tout ce bruit pour y venir chercher, un Leuchtenberg. Du reste, je ne sais si c’est parce que je demeure loin ; mais il me semble que ce bruit ne retentit plus du tout. Je n’en entends plus rien. Tout passe bien vite de nos jours. Des intérêts, des affaires, qui jadis auraient rempli des mois, obtiennent à peine des heures. Les choses s’en vont comme les personnes en chemin de fer. Je le comprends il y a vingt cinq ans, dans le temps des batailles de Leipzig. Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas si riches, ni si pressés. Au fait, nous avons raison. Il ne faut pas regarder, longtemps, les petites choses, quand on a vécu dans les grandes.
Pour me distraire des petite choses, j’ai lu hier soir à mes enfants le Malade imaginaire. Vous n’avez pas d’idée de leurs transports de rire. Je posais mon livre pour les regarder. Je m’amuse de bon cœur avec mes enfants. Je jouis de leur gaieté. Mais je ne sais plus rire. Vous êtes et vous serez la dernière personne qui m’ait vraiment vu et fait aire. Par exemple je ne rirai pas demain. J’ai vingt personnes à déjeuner qui me prendront toute ma matinée. Je suis charmé que Pozzo vienne passer quelques mois à Paris. Je l’ai vu vous faire rire encore lui et Brougham. Comment a-t-il fait pour que sa maison ne soit pas confortable? Heureusement sa conversation le sera toujours. C’est donc à force d’esprit que Montrond se porte mieux. Il faut qu’il en ait vraiment beaucoup pour en conserver. Je causerai volontiers avec lui. J’ai besoin de causer. J’ai bien des choses à apprendre, et quelques unes à dire. Quoique vous m’ayiez admirablement tenu au courant. Vos lettres sont un miroir d’une vérité parfaite. Je n’ai jamais vu de source plus limpide que votre esprit. Rien ne le trouble et il coule toujours. Nous nous serons beaucoup écrit dans notre vie, beaucoup trop.
Avez-vous remarqué avec quel soin on a fait mettre dans les journaux que ce n’était pas la liste civile, mais l’Etat qui avait loué à M. Appony sa maison ? Il ne faut pas aller si vite au devant des propos. Est-il vrai que les Appony y soient déjà établis ? J’ai peine à le croire. Je suis curieux de voir comment on a arrangé cette maison-là. J’en aurais fait une habitation charmante. Je connais beaucoup l’hôtel Beanay que veut M. de Palhen. J’y ai vu le Président de la Chambre, M. Royer-Collard, et avant lui le directeur général des Ponts et Chaussées, Me Pasquier, je crois. C’est une assez grande maison, c’est-à-dire avec beaucoup de logement, mais rien de très grand, une cour médiocre, et si je ne me trompe une seule sortie. Deux millions me paraissent beaucoup. A la vérité il faut la meubler. Je n’y pensais pas. Ce n’est pas trop.
10 heures
Je suis désolé que vous dormiez toujours si mal. Est-ce que je ne trouverai pas, quand je serai là, des moyen d’y mettre ordre ? Adieu. Adieu. G.
162. Lisieux, Mercredi 17 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’attends pas Matonchewitz, ni une bonne conversation. Mais j’ai dîné ici hier. Trois personnes attendent à la porte de ma chambre et il faut que je sois reparti dans une heure pour le Val Richer. Hier en venant à Lisieux seul dans ma voiture, j’ai pensé au 16 octobre pour vous, beaucoup à vous. Il est bien difficile de dire ce qui est vraiment au fond du cœur. Je n’ai jamais été plus occupé de vous. J’aime tant de choses en vous ! Et des choses que je ne trouve nulle part ailleurs nulle part mais n’ayez donc pas toujours de mauvaises nuits. Faites cela pour moi. Je regrette que les Sutherland passent si vite. Je voudrais que vous fussiez habituellement entourée d’affection d’impressions douces. C’est ce qui vous manque. Quelqu’un qui soit toujours là, associé à tous les détails de votre vie, à soigner et qui vous soigne, à aimer et qui vous aime dans tous les moments de la journée. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’autre chose que de vous. Il faut que je fasse entrer les gens qui attendent. Adieu. Adieu. Remerciez ; je vous prie, pour moi la Duchesse de Sutherland de son souvenir. J’espère que je serai plus heureux quand elle repassera par Paris pour retourner en Angleterre. Adieu. Adieu. Je voudrais couvrir d’adieux le papier blanc qui me déplaît. G.
Mots-clés : Autoportrait, Discours du for intérieur, Relation François-Dorothée
161. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi je regrette cet entassement d’arrivants et de partants. Ils vous fatigueront. Bien distribués, ils vous reposeraient. Car vous avez besoin d’un mouvement qui vous repose. Vous n’avez assez de force ni pour le monde, ni pour la solitude. Il vous faut de tout, des doses, si justes qu’on les manque souvent. Il n’y aura que mes visites, j’espère, qui n’auront pas besoin d’être mesurées. C’est dommage que vous ayez refusé la conférence sur l’Orient. J’aurais demandé à y être envoyé.
J’ai passé ma matinée couché sur une carte de Turquie et de Grèce suivant la marche de petits événements bien oubliés, mais dont je voulais me rendre compte avec précision. Je me résigne parfaitement à l’ignorance, pas du tout au savoir vague et incomplet. J’en sais beaucoup en ce moment sur l’Orient. Je comprends votre refus ; mais c’est dire à l’Occident. qu’il fera bien de s’unir et d’y bien regarder. M. Turgot reprochait aux Encyclopédistes leur esprit de secte et de coterie : " Vous dites nous ; le public dira vous. " Vous faites bande à part ; on fera bande en face de vous. Cette affaire-là, ne s’arrangera pas sans canons. C’est dommage encore une fois. Ce serait un beau spectacle que l’Europe maintenant l’Orient de concert tant qu’il pourra être maintenu, et le partageant de concert quand il tombera. Si nous nous entendions, cela se pourrait peut-être. Vous voyez que j’ai aussi mes utopies. Mais elles sont très dubitatives. Et à tout prendre, comme il faudra bien un jour que le canon recommence, il vaut mieux que ce soit là qu’ailleurs. Je ne m’étonne pas que Lord Palmerston soit avec vous dans l’affaire belge. Soyez sure qu’on n’en est fâché nulle part. Il faut une raison de céder.
Mardi 7 heures
e reprends la politique. J’ai des nouvelles de la frontière d’Espagne. Les succès des carlistes sont réels et les provinces carlistes dans l’enthousiasme. Les gens sensés n’en tirent pas de grandes conséquences.. Cela arrive près de l’hiver, quant la campagne ne peut être tenue longtemps. Les Chrisminos y perdront plus que les Carlistes n’y gagneront. La solution en Espagne est toujours qu’il n’y ait pas de solution. Notre petit duc de Frias me paraît faire la même figure qu’il a faite chez vous (C’est bien chez vous n’est-ce pas?) le jour où il n’a pas voulu se coucher dans la Chambre cramoisi. Ici, le Ministère est très préoccupé d’affaires qui ne vous intéressent pas du tout des chemins de fer, du sucre de betterave, un peu de la pétition sur la réforme électorale ; pas autant peut-être qu’il le devrait, car elle a plus de signatures qu’on ne le dit. dans la 6e région, la majorité, à ce qu’il paraît, a signé. Je vous prie de vous souvenir un jour que je vous ai toujours dit que le mal essentiel, le déplorable effet de l’administration actuelle, c’est de pousser ce pays-ci vers la gauche de lui faire regagner quelque chose beoucoup peut-être du terrain que nous lui avions fait perdre. En voilà pourtant bien assez. Que faites-vous du Duc de Noailles ? Il me semble qu’il devrait être revenu à Paris avec son soleil, qui n’est pourtant pas à lui tout seul. On m’écrit que les Holland ne se sont pas fort amusés à Paris. Ils ont mal pris, leur temps.
10 heures 1/2
Le facteur est arrivé au milieu de ma toilette. J’ai lu votre lettre. Puis, j’ai achevé. Il faut que je le fasse repartir. Je n’avais pas du tout, du tout pensé à vous en vous parlant. de Lord Holland. En cachetant ma lettre, l’idée m’est venue que vous me diriez ce que vous me dîtes ; et qu’au fait vous pourriez me le dire. N’importe. C’est bien simple de vous dire de rester comme vous êtes. Je n’ai pourtant que cela à vous dire. Quand vous voudrez changer. j’y mettrais mon veto. C’est comme vous êtes que je vous aime, sauf à vous critiquer, soit sans y penser; soit en y pensant. Adieu Adieu, le plus tendre que je sache. G.
149. Val-Richer, Jeudi 4 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné avec vous chez Salomon. Quelle chute que celle de ce nom ? Le plus spirituel, le plus hautain, le plus aristocrate des Rois, celui dont la mémoire est restée en orient à côté de celle d’Alexandre devenu le Turcaret d’une race proscrite et vous racontant, en mauvais allemand, ses joies de parvenu ! Et puis vous avez raison : il y a des joies naturelles, qui restent aux proscrits et qui sont belles et touchantes, même sur la tête des Turcarets les plus ridicules. Et ces joies, qui sont pour tous et toujours bonnes, la Providence les refuse ou les enlève quelques fois à ceux qui les méritent le mieux et qui en jouiraient le plus noblement. Quel mystère que la destinée de chacun de nous, cette impénétrable intention d’une volonté inconnue qui nous conduit à travers les ténèbres, et dans ces ténèbres tantôt nous caresse, tantôt nous frappe, sans que nous puissions ni prévoir ni comprendre le bien ou le mal, la faveur ou le coup ! Quand je suis en bonne disposition, ce sentiment de notre situation à tous, aveugles sous une main cachée, ne m’est point pénible, car je suis soumis et confiant ; je marche la tête haute et le cœur tranquille sans rien voir et sans rien pouvoir. Mais dans les mauvais jours, dans les heures faibles, soit pour moi-même, soit pour ceux que j’aime, je succombe sous ce fardeau sans limite comme je ferme les yeux, je prends ma tête dans mes mains, comme pour me cacher et me soustraire à cette mystérieuse et irrésistible Puissance. Oui vous dites vrai, vous êtes bien seule. Vous êtes faite pour n’être pas seule ; vous avez le cœur très ouvert, très vif pour ces affections et ces joies intimes, de tous les moments, Gnimhich und Gnimhich, qui sont le vrai, le seul bonheur. Et vous êtes bien seule. J’y pense sans cesse.
Laissez-moi vous dire tout ce que je pense. Pour ce bonheur-là comme en toute chose, vous êtes délicate, difficile ; vous ne savez vous contenter de rien de médiocre. Si le médiocre, le commun pouvait vous suffire vous l’auriez, vous l’avez. Il vous reste un mari, des enfants. Vous pourriez, avec ces liens tels quels, avoir un intérieur tel quel, comme tant d’autres. Mais vous n’acceptez pas ce que d’autres acceptent ; vous ne supportez pas ce que d’autres supportent. Vous répudiez ce que d’autres gardent. Vous résistez quand d’autres cèdent. Vous ne consentez jamais à descendre, à vous abaisser à vous mutiler ni dans vos instincts, ni dans vos jugements ni dans vos désirs, ni dans vos plaisirs, ni dans vos douleurs. Ne soyez pas autrement ; n’essayez jamais d’être autrement. C’est votre nature, c’est votre supériorité, si rare et si charmante. Quand vous le voudriez, vous n’y pourriez pas renoncer. Ne le veuillez jamais. Ce serait une abdication, une profanation. Mais c’est là ce qui fait que vous êtes seule. Dites-moi que vous n’êtes pas seule quand vous êtes avec moi. Vous vous le rappelez ; c’est ce que je vous ai promis.
9 h 1/2
J’ai aussi un soleil superbe. Réunissons-nous dans ce soleil qui brille sur tous deux. Je me suis promené hier toute la matinée. J’en ferai autant aujourd’hui, mais à pied et avec mes enfants. J’ai vu Rogers une fois ; mais je ne le connais pas. J’ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas. Vous savez que je ne suis pas curieux. Le curiosité ne me vient qu’après autre chose. Je suis curieux de savoir comment sera Marie. Je voudrais bien que vous n’eussiez pas là une tracasserie de plus. Adieu. Le temps marche et me pousse vers vous. Adieu. Adieu. Si je m’en croyais, je ne finirais pas. G.
138. Val-Richer, Dimanche 23 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai mal dormi. Je me lève ennuyé de ne pas dormir. Je ne veux pas que vous soyez malade. J’ai peur que la pauvre Duchesse de Broglie ne le soit beaucoup, beaucoup. Les spasmes se sont emparés d’elle. C’est son mal habituel même en santé. Elle a toujours passé la nuit à rêver, à s’agiter, assiégée par le cauchemar, et plus fatiguée, en se réveillant qu’en se couchant. Il parait qu’elle est dans un état nerveux déplorable. Le mal violent est venu à la suite d’une imprudence qu’elle a faite, il y a quinze jours se croyant débarrassée d’une petite fièvre de rhume. Elle avait faim ; elle a mangé du poulet. Cela a déterminé des accidents intestinaux qui ont bouleversé toute sa personne. On dit que, dans les meilleures chances la maladie durera au moins 40 jours. J’ai horreur de ces longues maladies, qui ne sont pas domptées dans la première semaine. Ni la force de celui qui souffre, ni la science de celui qui veut guérir, ne suffisent à une si longue carrière. Je les ai tant vues s’épuiser l’une et l’autre !
Quel abyme entre ce que nous souhaitons, et ce que nous pouvons entre l’énergie de nos sentiments et la misère de nos moyens. Je l’ai vu cet abyme ; j’y suis tombé. Je n’y puis croire. Il me semble impossible, absolument impossible que des affections si profondes, des vœux si ardents, toute l’âme attachée à une seule pensée à un seul effort, n’aient qu’une si pauvre puissance. Toute ma nature se refuse à cette cruelle conviction. Et quand je la sens venir, quand je me vois au terme du savoir et du pouvoir humain, je fais comme les plus simples, je me réfugie dans la prière, cette tentative d’attirer, par un désir immense et vrai, la force de Dieu au secours de notre faiblesse. Je ne sais ce que peut la prière ; je ne prétends pas entendre la réponse de Dieu à ce cri de l’homme. Mais que Dieu n’écoute pas, que le cri de l’homme se perde dans l’air comme le bruit du vent, que notre âme ne puisse, en faveur de ceux qu’elle aime infiniment, rien de plus que ce qui se voit ici bas, je ne le crois point, je ne le croirai jamais. Et je prierai toujours, dût ma prière échouer toujours. Je puis me soumettre aux plus terribles volontés de Dieu, non à la certitude de mon impuissance après de lui, et j’aime bien marcher dans les plus épaisses ténèbres que rester immobile avec désespoir, sûr qu’il n’y a aucun moyen d’arriver.
9 heures
Je vous ai quittée. J’étais trop triste. Avec vous, je me défends de ma tristesse. Je crains pour vous la contagion. Pardonnez moi quand je me laisse aller. Je vous aime beaucoup, & je le sens au moins autant quand je suis triste que dans mes meilleurs moments. Votre grand Duc va-t-il décidément mieux ? N’a-t-on plus de crainte ? Savez-vous qu’il est fort connu que c’est la brutale imprévoyance de son père qui a failli le tuer ? Les hôtes que j’ai ici me le disaient hier ; et ils ne le tenaient pas du tout de moi. Ils me quittent aujourd’hui, M. Duvergier de Hauranne ce matin. M. Rossi ce soir. Mes nouvelles sont que le Ministère est de nouveau sérieusement inquiet de la Suisse. Louis Buonaparte ne s’en ira pas. Le parti radical suisse et Français, avec lequel, il est en intelligence, lui défend de s’en aller. Et puis, il est sot au-delà de tout ce qui se peut imaginer. Il y a quelques année, à Florence, il envoya chercher en toute hâte un homme d’esprit que je connais voulant de lui un conseil. Il lui montra une lettre de Corse où on lui promettait 1500 hommes, s’il voulait aller les chercher, et débarquer avec eux en France. Son conseiller l’en détourna, l’assurant qu’il ne réussirait pas. " Mais pourquoi donc ? Mon oncle l’a bien fait avec la moitié. " L’avis de M. Hess de Zurich, qui veut qu’on demande à Louis B. de s’expliquer catégoriquement et de déclarer s’il est français ou suisse, pourrait bien offrir une issue. Il sera peut-être difficile à L. B. de dire officiellement et décidément qu’il n’est plus français. Je sais qu’on attend quelque chose de là. Probablement on a tort. En telle situation, le plus grossier mensonge ne coûte rien et ne fait pas grand chose, car il ne trompe personne.
9 h. 1/2
Elle est morte. Je viens de recevoir un mot de son mari. Je pars pour Broglie dans deux heures. Adieu. Adieu. G.
135. Val-Richer, Jeudi 20 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’espérais pas de lettre hier ; et pourtant, quand elle m’a manqué, il m’a semblé que mon mal recommençait. Je vous dis, je vous répète que vous ne savez pas combien je vous aime. Que ne donnerais- je pas pour que vous eussiez vu ce qui s’est passé dans mon cœur huit jours, quinze jours avant le n°127 ? Par nature, quand j’aime je suis faible, très faible avec ce que j’aime et avec moi-même. Je délibère, j’hésite, je recule avant de résister comme d’autres avant de céder. Il me faut les motifs les plus évidents, les plus impérieux. Et quand ma raison, qui reste libre, a reconnu la nécessité, personne ne sait ce qu’il m’en coûte d’obéir à la nécessité et à la raison. Et quand il faut que vous en souffriez, vous que j’aime tant ! Dearest, je vous ai vu souffrir ; je sais ce que c’est que votre abandon à la douleur, votre angoisse, votre désespoir. Pardonnez-moi, Pardonnez-moi. Hélas, je ne puis pas vous promettre de ne vous faire jamais souffrir, pas plus que vous ne pouvez me promettre de ne jamais blesser mon insatiable exigence, de me donner toute votre vie. Mais je vous aime tant, je vous aimerai tant ! De loin, de près ! Et près de vous, je serai si heureux, je vous rendrai si heureuse. Vous vous en souvenez, n’est-ce pas de ces heures charmantes que nous avons si souvent passées ensemble si animées et si douces, si confiantes, rapides à ce point que nous ne les voyons pas passer et pourtant pleines comme une vie, et laissant des traces si profondes ! Vous me les rendrez, je vous les rendrai ; et quand nous les aurons retrouvées, quand je vous aurai là, devant moi, près de vous, il n’y aura plus pour nous de chagrin passé, ni de chagrin à venir. Nous n’aurons ni mémoire, ni prévoyance, comme des enfants, de vrais enfants, car le mal reviendra ; ce qui nous manque, nous manquera encore souvent. Il n’est que trop vrai qu’il nous manque beaucoup, beaucoup ?
10 heures
Oui, oui, je vous aimerai toujours, immensément, à combler, à dépasser votre plus insatiable ambition. Moi aussi, en ouvrant votre lettre excellente, charmante, j’ai poussé un soupir de délivrance. Moi aussi, je suis heureux bien heureux. Dearest, je l’ai été avant vous ; j’ai été soulagé avant vous. C’est là mon remord. Vous me pardonnez, n’est-ce pas ? Non, nous ne nous connaissions pas ; nous ne nous connaîtrons jamais, jamais assez pour que notre sécurité soit complète. Il n’y a de sécurité complète que dans un bonheur complet. Comment n’aurions-nous jamais un mauvais jour, une pensée triste une inquiétude amère ? Sommes-nous toujours ensemble ? Pouvons-nous à chaque instant, sur la moindre occasion, nous délivrer l’un l’autre, par un mot, par un regard, de ces nuages qui passent, de ces poids secrets qui tombent tout à coup sur le cœur ? Mais n’importe ; nous sommes, bien heureux ; nous serons bien heureux. Nous nous aimerons encore plus que nous ne serons heureux. Adieu. Adieu. Que de choses, j’ai encore à vous dire ! Oui, c’est une longue, longue histoire. Adieu. Je vous aime ; je vous aime comme le dit le petit papier dans le petit sachet noir. Adieu. G. Mad de Broglie est un peu mieux, c’est-à-dire un peu moins mal. Je viens de recevoir des nouvelles jusqu’à hier midi. Ils sont toujours bien inquiets. Cependant il y a plutôt du mieux. On me dit : " La nuit a été plus tranquille qu’aucune des précédentes depuis que la maladie a pris un caractère de gravité. La matinée commence bien. "
127. Val-Richer, Mardi 11 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement l’état de Marie n’est pas naturel. Regardez-y bien et prenez les arrangements, convenables. Je suis préoccupé pour vous de cet ennui nouveau, qui peut- être aussi un trouble. Il est bon qu’elle vous quitte pour quelque temps. La Duchesse de Talleyrand est assez propre, avec son air féroce, à lui imposer une contrainte sanitaire. J’attends impatiemment le résultat de vos délibérations avec Lady Granville. J’ai bien envie d’être jaloux d’elle. Quoique jaloux, je suis charmé de son retour. Elle vous est aussi utile qu’agréable, de bon conseil et de doux passe-temps. Nous avons raison de tenir au Cabinet Whig. Du reste, j’espère qu’il tiendra. Avez-vous lu sur son compte et sur la dernière session du Parlement, un article assez intéressant de M. Duvergier de Hauranne dans la Revue française qui vient de paraître ? Qui dit-on des démentis de M. Molé au général Bugrand ? L’opposition a bien peu d’esprit. C’est la légèreté de M. Molé qu’il faudrait poursuivre. Evidemment, il a dit au général Bugrand ce que celui-ci a répété. Ce n’est que cela ; mais c’est bien quelque chose. Evidemment l’affaire suisse va tomber dans l’eau. La suisse prend son temps pour faire une platitude. On a fait de tous temps des platitudes, mais autrefois, elles n’étaient pas précédées de ces éclats publics de ces fanfaronnades qui sans les empêcher aujourd’hui, les rendent parfaitement ridicules. A la vérité, il n’y a plus de ridicule ; nous en avons perdu la liberté et presque le sentiment. Depuis que le genre humain tout entier est en scène, on n’ose plus se moquer de personne.
Vous vous seriez moquée de moi hier si vous aviez eu avec quelle prolixité, quelle gravité je discutais avec les autorités de St Ouen, la question d’un bout de chemin vicinal que je veux échanger contre un autre. Vous vous sentez un peu jalouse du Val Richer. Vous avez bien tort. Je fais de mon mieux pour prendre intérêt à tout cela. J’y donne du temps, de l’attention. Je m’occupe sérieusement d’une plantation, d’un vase, d’un meuble d’une gravure. Je n’y ai point mauvaise grâce, je vous assure, et les assistants me savent, je crois, très bon gré de mon empressement et de mon plaisir.
Mais au fait tout cela est parfaitement superficiel tout cela ne m’occupe, ni ne m’amuse ; mon temps est plein mais rien que mon temps ; et quand je rentre dans mon Cabinet, je ne retrouve dans ma pensée à peu près rien de ce qui a rempli ma journée. Je ne puis me soucier vraiment et m’occuper sérieusement que de trois choses, les gens que j’aime, les affaires publiques, et les questions religieuses. Je comprends qu’on se donne tout entier à une personne, à la politique, ou à Dieu. Le reste n’en vaut pas la peine.
Je suis bien aise que vous ayez causé à fond avec Médem. Il faut qu’une fois au moins un homme d’esprit dise votre position ici et comment vous vivez. Si de l’autre côté, il y avait aussi un vrai homme d’esprit, rien de tout ce qui vous arrive, n’arriverait. Vous avez bien raison. Toutes les fois que deux hommes d’esprit se voient, ils se séparent contents l’un de l’autre. M. de Metternich et Thiers ont dû s’amuser beaucoup. Thiers fait profession d’être absorbé dans l’histoire de Florence.
10 heures
La phrase me déplaît aussi. Merci de me la pardonner. Un seul mot pourtant, pour excuser. Je ne veux, je ne puis penser à moi, à mon bonheur, à mon plaisir et y subordonner toutes choses, que si je suis pour vous tout ce que je veux être. A cette seule condition, je vous garde à tout prix. Si cela n’était pas, je ne penserais plus qu’à vous, aux intérêts et aux convenances de votre avenir, de votre avenir à vous seule. Voilà mon sentiment quand j’ai écrit cette phrase. Pardonnez-la moi encore ; mais ne dites pas qu’il y a de la glace dessous. G.