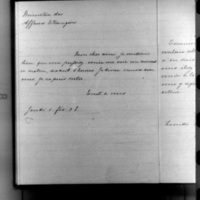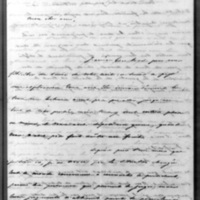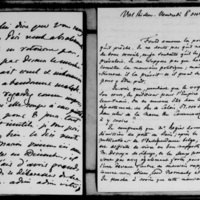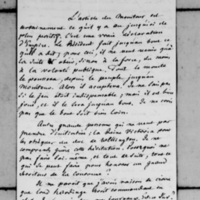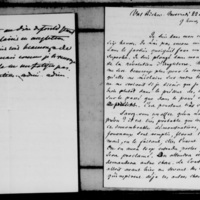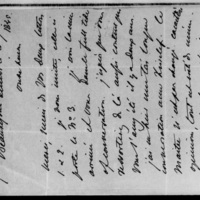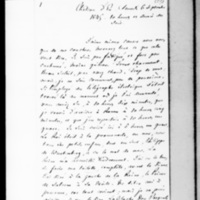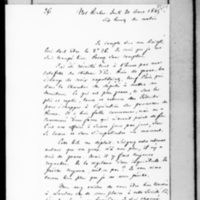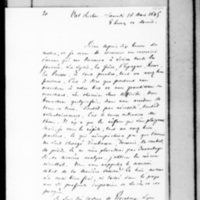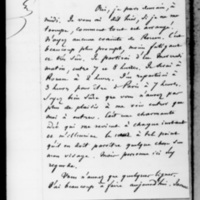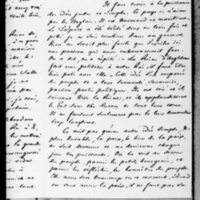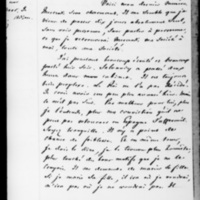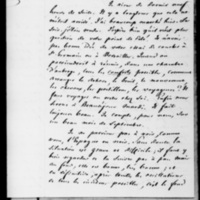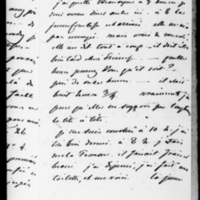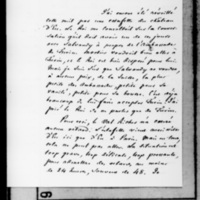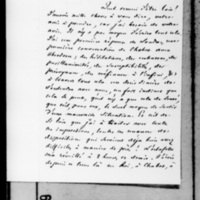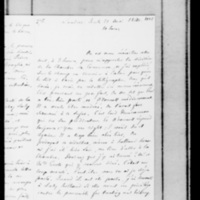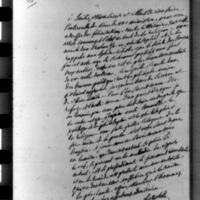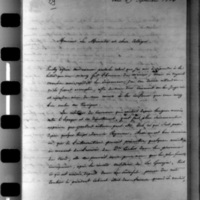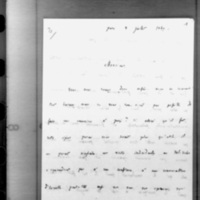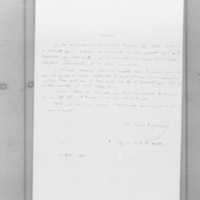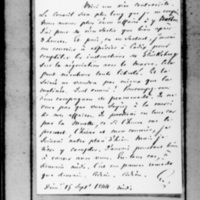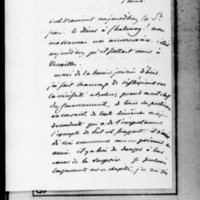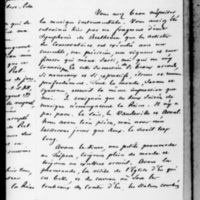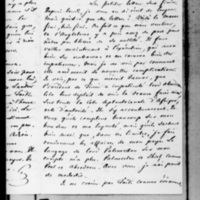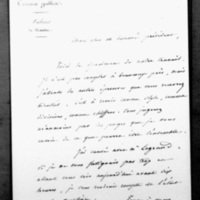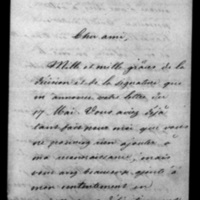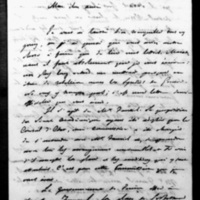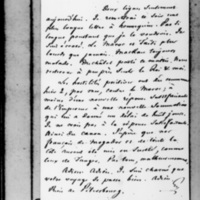Votre recherche dans le corpus : 54 résultats dans 6062 notices du site.
Paris, Jeudi 1er février 1844, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Paris, le 22 janvier 1849, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Val Richer, Vendredi 8 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Fould annonce la politique qu’il prêche. Je ne doute pas qu’il ne donne de bons conseils, et je souhaite qu’il les fasse prévaloir. Je ne suppose pas que Heeckeren conseille la mauvaise politique ; mais probablement, il la prévoit, et il prend ses mesures pour y être prêt. Je vois que, pendant que le voyage suit son cours, les pétitions pour l'Empire vont leur train. On en annonce 521 dans le seul département du Pas de Calais, 51 000 signatures, dans celui de la Marne & Commencez-vous à y croire ?
Je comprends que M. Hogier donne sa démission du poste de Paris ; après les dernières publications de l'Indépendance belge, il lui est difficile de vivre en bons rapports avec M. Drouyn de Lhuys, et les deux partis ne sont pas assez également fortes pour rester l’une devant l'autre en mauvais rapportss comme nous étions, lord Normanby et moi. Je penche à croire que cette mauvaise humeur officiellement affichée sont le commencement de quelque chose de pire.
Avez-vous des nouvelles d’Ellice et compte-t-il toujours venir à Paris à Noël ? Il aura, je suppose, un peu plus d’embarras à être toujours de l’avis de son petit ami, car Ellice est très pacifique et ne se soucie pas de se faire de mauvaises affaires.
J’avais ici hier un petit anglais fort obscur et assez intelligent, traducteur de mes ouvrages en Anglais, qui m’a dit que l'opinion publique en Angleterre était toujours très malveillante, et que le Times, la suivait bien plus qu’il ne la poussait.
J’ai eu avant hier à dîner les gros bonnes négociants et manufacturiers de Lisieux, tous contents et présidentiels, acceptant l'Empire sans le désirer. Les agriculteurs eux-mêmes commencent à être un peu contents ; leurs denrées se vendent mieux.
Je suis vraiment très fâché pour vous du départ de Kisseleff. Je suis moi-même bien plus tranquille sur vous quand il est là. La petite Princesse va donc mieux puisqu’elle sort. Adieu, Adieu.
J’espère que l'ouragan a cessé à Paris, comme ici. C’est un temps qui ne vous vaut rien. G.
Val Richer, Samedi 25 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
L'article du Moniteur est certainement ce qu’il y a eu jusqu'ici de plus positif. C'est une vraie déclaration d'Empire. Le Président fait jusqu'au bout ce qu’il a dit ; pour ceci, il ne veut venir qu’à la suite et obéir, sinon à la force, du moins à la volonté publique. Tout le monde le poussera, depuis le peuple jusqu'au Moniteur. Alors il acceptera. Je ne sais pas si le jeu était indispensable ; mais il est bien joué, et il le sera jusqu'au bout. Je ne crois pas que le bout soit bien loin.
Autre grande personne qui ne veut pas prendre d'initiative ; la Reine Victoria pour les obsèques du Duc de Wellington. Je ne comprends guère cette hésitation. Pourquoi ne pas faire soi-même, et tout de suite, tout ce qui se peut faire pour honorer un grand serviteur de la couronne ? Il me paraît que j’avais raison de croire que Lord Hardinge serait commandant en chef. Je le vois dans mes journaux. Est-ce sûr ?
Si Chomel voit aller voir la Duchesse d'Orléans, je suis bien aise qu’il ne vous quitte que lorsque vous commencez à être mieux. La Duchesse d'Orléans ferait bien, je crois, de ne retourner à Eisenach que lorsqu'elle sera tout-à-fait rétablie ; elle est là bien seule et bien loin.
J’ai reçu hier des nouvelles de Mad. de Staël qui me dit que les Broglie la quittent tous dans les premiers jours d'octobre pour revenir à Broglie. Mad. d’Haussonville est allée rejoindre son mari à Gurcy. Il y est fort tranquille, et ne songe plus qu’à chasser.
J’ai peine à croire que le Roi Léopold joue dans la question commerciale avec la France. Ses ministres actuels ne se refusent à ce que la France demande que parce qu'ils n'osent pas ; ils craignent les Chambres et l'opinion Belges. Les ministres que Léopold aurait, s'il renvoyait ceux-ci, oseraient encore moins ; ils auraient tout le cri libéral contre eux. Je n’entrevois pas comment on sortira de cette impasse. Ni à Paris, ni à Bruxelles on n'osera céder. Voilà votre petite lettre. Il ne dépend ni de vous, ni de moi de faire des nouvelles, et la correspondance ne vaut pas la conversation. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Empire (France), Famille royale (France), Femme (santé), Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait, Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
Val Richer, Mercredi 22 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures et demie
Je suis dans mon Cabinet depuis six heures. Je n'ai pas encore mis le pied dans le jardin quoiqu’il fasse un soleil superbe. Je suis plongé dans mon histoire de la révolution d'Angleterre. Notre temps me sert beaucoup plus pour la comprendre qu’elle ne m'éclaire sur notre temps. Personne, ne me croirait si je disais que je cherche bien plutôt dans le présent des lumières sur le passé que dans le passé des allusions au présent. C'est pourtant très vrai.
Savez-vous un effet qu’on n’a pas prévu ? Il est très probable que ces bruyantes et innombrables démonstrations dont les journaux sont remplis, feront l'Empire ; mais en le faisant, elles l’usent d'avance. On en aura trop entendu parler quand il sera proclamé. On attendra et on demandera autre chose.
Le Constitutionnel allait avant hier au devant des craintes qu'inspirent déjà ces autres choses ; il promettait un Empire qui ne serait pas l'Empire, qui ferait des sociétés de crédit foncier et des chemins de fer une monarchie pacifique et bourgeoise. C’est trop de bruit pour arriver là. Il fallait attendre plus patiemment la nécessité de la monarchie ; elle serait venue, et elle serait venue plus tranquillement, sans blaser d'avance et sans exciter outre mesure. J'en reviens toujours, au chancelier Oxenstiern, qu’il y a peu de sagesse, même dans ce qui réussit !
C'est probablement par mauvais vouloir pour Lord Douro que le Duc de Wellington n’a pas fait de testament ; il a voulu que son second fils, qu’il aime mieux, et qui a des enfants, ont la moitié de sa fortune. Peel et Wellington, jamais les fils n'ont moins ressemblé aux pères ; le contraste est choquant.
Je suis convaincu qu’il y a de la faute des pères en cela, et que des enfants vraiment bien élevés, et en intimité avec leur père, n'en sont jamais si loin, quelque différente que Dieu ait fait la pâte, de toutes les jalousies, celle de père à fils est la seule que je ne comprenne pas du tout. Je ne conçois pas de plus grande satisfaction que de se survivre, et de la perpétuer soi-même dans ses enfants. J’ai pourtant vu de grands exemples de cette jalousie là, et dans de bien frappantes occasions.
Je vous quitte pour faire ma toilette. Je suis impatient de savoir Aggy revenue.
Onze heures
Je remercie Aggy de ses quelques lignes, quoiqu’elles me chagrinent. J’espère qu’un peu de nourriture vous relèvera de votre abattement. Le temps mou et pluvieux paraît vouloir casser ; peut-être qu’un air plus sec et plus vif vous vaudra mieux. Adieu, Adieu, en attendant demain. G.
Mots-clés : Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Education, Empire (France), Famille royale (France), Fusion monarchique, Histoire (Angleterre), Parcs et Jardins, Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Presse, Régime politique, Santé (Dorothée), Travail intellectuel
3. Beauséjour, Lundi 8 septembre 1845, Dorothée de Lieven à François Guizot
Onze heures
Merci, merci de vos deux lettres 1 & 2. Je vous imite, celle-ci porte le N°3. Je crois la reine arrivée et vous dans le full time of conversation. J’espère que vous ressortirez de là aussi content que vous l'avez été il y a deux ans.
J’ai eu hier une très longue conversation avec Kisseleff. Le maître n’est pas changé. Caractère, opinion, tout est resté de même. Seulement de plus en plus inaccessible à tout conseil. Personne ne rêve plus à en donner. Vraisemblance qu’il ira de la mer noire en Sicile. Je pense qu'il verra le Sultan un moment. Evénement ! J’ai été chez les Appony le soir ; assez mauvaise humeur mais qu'on cache.
Paris 1 heure. Je suis ici pour un moment. Je viens de voir Vérity. Il me trouve mieux qu'à Londres. Mais ce sera tout. Pas la moindre nouvelle à vous donner. Le plus beau temps du monde. et moi adieu adieu. Voilà tout et toujours.
4. Château d'Eu, Lundi 8 septembre 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures et demie
Au lieu du char à bancs royal et de la forêt, deux heures et demie de promenade à pied, dans le parc, tête-à-tête avec Lord Aberdeen. Très, très bonne promenade, affectueuse, confiante et sensée. Toute utilité à part, j’y ai pris un vrai plaisir. Lui aussi j’en suis sûr. La politique ainsi faite est grande et douce. Il y a plus ; elle semble facile. Ce n'est pas vrai. Les difficultés des choses se replacent bien vite, entre les bons sentiments des hommes. Et les hommes se séparent bientôt. N'importe ; il est impossible que de telles conversations, il ne reste pas beaucoup. Il y a des paroles qui tombent au fond des cœurs, s’y endorment, et se réveillent infailliblement quand le moment arrive où elles sont bonnes à entendre une seconde fois. Nous avons parlé de tout. Nous recommencerons un peu demain ; mais pas avec la liberté et le loisir d’aujourd’hui.
Les arrangements de demain sont un peu changés. A dix heures le déjeuné. A onze heures et demie promenade dans la forêt. pas très loin, et pas de luncheon. On revient à 3 heures dîner à 4, à 5 et demie départ pour le Tréport où la Reine s'embarquera pour être à l’île de Wight Mercredi matin. Et moi je m'embarquerai jeudi avant 7 heures pour être à Beauséjour avant 7 heures du soir. Adieu. Adieu. Je vais m'habiller pour le dîner.
Mardi, 9 sept. 8 heures et demie. Dîner encore à côté de la Duchesse d’Aumale ; Lady Canning à ma droite. Elle a du good sense, de la dignité et de la bonne grâce, mais peu de mouvement et de fécondité dans l’esprit. Lord Aberdeen, à la gauche de la Reine. On le traite très bien et on a très raison. Le spectacle commence trop tard et fini trop tard. Très jolie salle ; sous une immense tente, fort bien ornée et point froide ; au milieu du parc. Le nouveau seigneur a fait rire la Reine. Richard l’a fait pleurer. Nous n'avons ri ni pleuré. Aberdeen, et moi. Nous aurions mieux aimé causer encore.
Je lui demandais hier comment il avait trouvé le Prince des Metternich. Il m’a répété ce qu’il vous a dit, en ajoutant : " Mais vous vous n’avez pas le droit dire que le Prince de Metternich est baissé, car en nous séparant au dernier moment, comme je lui ai dit que j'allais probablement vous voir, il m'a répondu : " Je voudrais bien en faire autant ; il y a bien longtemps qu'on n'a vu en France un tel ministre. "
Je n'étais dans mon lit qu’à une heure moins un quart. Rien n’est changé, pour aujourd’hui aux dispositions d’hier. Voilà votre N°3. Je suis charmé que Verity soit de retour, et qu’il vous trouve mieux qu'à Londres. Nous prendrons les soins qu’il faudra prendre. Je ne fermerai ma lettre qu'entre 3 et 4 heures, en revenant de la promenade, car je crois qu’aujourd’hui il convient d’y aller. Adieu. Adieu jusqu'à 3 heures. Onze heures Je sors de déjeuner. J'envoie une estafette à Génie. Vous aurez ma lettre ce soir. Adieu. Adieu. G.
Pas ce soir. C’est presque impossible. Vous vous couchez de trop bonne heure. Mais demain matin.
1. Château d'Eu, Samedi 6 septembre 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures et demie du soir
J’aime mieux causer avec vous que de me coucher. Mesurez tout ce que cela veut dire. Je suis peu fatigué et fort peu enrhumé. Moins qu’hier. Temps charmant. Beau soleil, pas assez chaud. Trop de vent ; mais, je ne sais comment peu de poussière. Si l'employé du télégraphe électrique s’était trouvé là au moment où je l'ai demandé, vous auriez su à 10 heures dix minutes que je venais d’arriver à Rouen, à 10 heures cinq minutes, et que j'en repartais à 10 heures un quart. Je suis arrivé ici à 5 heures un quart. Le Roi était à la promenade, en mer, avec tous ses petits enfants dont un seul, Philippe de Wurtemberg, a eu le mal de mer. La Reine m’a accueilli tendrement. J’ai eu le temps de faire, ma toilette complète avant le dîner.
J'ai dîné à la gauche de la Reine, le Prince de Salerne à sa droite. Ne dites ceci à personne, car tout revient ; mais je ne plus résister à vous le dire. La Blache Don Pasquale, moins la belle figure de La Blache. Très bon homme du reste et très empressé pour moi. L’archiduchesse, vrai portrait de sa fille ; assez de ressemblance avec la Reine ; sourde à ne pas entendre les 400 tambours du roi de Prusse. L’air doux et fort polie. Madame la duchesse d’Aumale inconsolable de l'absence de son mari. Madame la Duchesse d'Orléans pas à dîner. Ce soir dans le salon de la Reine. Soyez tranquille; le Prince de Joinville sera ici demain matin. Le Roi l'a appelé et il vient de bonne grâce. Il reconnait que c’est convenable au point d'être nécessaire. On fait toutes sortes de calculs pour savoir quand la Reine arrivera. Les plus vraisemblables la font arriver Lundi, à 5 heures du matin. Trois bâtiments croisent pour venir nous avertir à temps. Le séjour sera court. On croit comme vous qu’elle veut être sur terre Anglaise mardi soir.
La galerie Victoria n’était pas finie. Depuis six jours tous les peintres sont arrivés de Paris, et tout sera prêt demain. Prêt du moins pour l’apparence et l'éclat. C'est fort joli. Toutes les scènes des deux voyages, la Reine au château d’Eu et le Roi à Windsor. Lundi soir, spectacle ; l'opéra comique, Richard cœur de Lion et un petit opéra gai.
En attendant, je viens de passer deux heures assis auprès du Roi, à passer et repasser en revue, tout ce qu’on peut nous dire et tout ce que nous devons dire. Mes thèmes de conversation ont été tous adoptés. Adieu pourtant. A demain le reste. Il n’y a pas de reste, car je vous ai dit tout ce que je sais ce soir. Demain, il y aura autre chose. Salvandy couvert de gloire de se trouver à Eu un tel jour. Je suis logé dans mon grand appartement. Lord Aberdeen sera près de moi Adieu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Famille royale (France), Femme (politique), Femme (portrait), Louis-Philippe 1er, Ministère des Affaires étrangères, Pratique politique, Relation François-Dorothée, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
25. Val-Richer, Jeudi 21 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Six heures du matin
Je compte sur mes doigts. Ceci doit être le N°26. Je crois que je me suis trompé hier. Prenez sans compter. J’ai été réveillé tout-à-l'heure par une estafette du château d'Eu. Rien de grave. Un échange de croix napolitaines. Neuf Pairs pris dans la Chambre des députés à mettre au Moniteur. Ce qui est plus grave, ce sont les plis et replis, tours et retours des Jésuites pour échapper à l'exécution des promesses de Rome. Il a bien fallu commencer ; mais on a commencé, d’une façon qui n'aurait point de fin. C’est une affaire à suivre jour par jour, sans se lasser et sans s'impatienter un moment.
Cette bile me déplait. Soignez votre estomac autant que vos yeux. Là non plus, il n’y a rien de grave. Mais il y faut toujours regarder. De la vigilance, sans inquiétude. Je prêche, toujours, n’est-ce pas ? Je vous aime encore bien plus que je ne vous prêche. Vous avez raison de vous être bien trouvée à Londres et de vous plaire à cette société-là. Grande, sensée et honnête. Je suis charmé que vous en rapportiez une impression agréable. Que de choses vous aurez à me dire ! Vos longues lettres m’ont beaucoup, beaucoup manqué. Mais en les regrettant beaucoup, je ne me suis pas surpris une seule fois à les désirer. J’aime encore mieux vos yeux que vos lettres. C’est bien beau ce que je dis là. De près, c'est sûr ; j'aime mieux vos yeux. De loin, il y a bien de la vertu pour moi à le dire.
Dites-moi pourquoi Brignole m'écrit si tendrement. Voici ce qui m’arrive de lui ce matin. Je vais lui répondre bien poliment. J’attendais le Chancelier à déjeuner ce matin. Il m'écrit qu'il est pris de courbature et de fièvre et qu’il reste encore à Paris. J’aurai, d’aujourd’hui à Mercredi prochain 60 personnes à déjeuner en trois fois. Et samedi 30, à 5 heures du matin, je serai sur la route de Beauséjour.
On m’écrit de Mayence du 17. " S. M. Britanique avait annoncé à la chapelle Anglicane qu’elle assisterait ce matin au service divin, à 10 heures et demie. Mais au dernier moment, il y a eu subitement contre-ordre, & demande d’un second service pour 3 heures ; lequel, en troisième ordre a été porte à 4 heures. Cette instabilité se manifeste en toutes choses. " Grande disette de Princes Allemands à Mayence. Rien que le Prince et la Princesse héréditaire de Hesse d'Armstadt ; encore venus après longue hésitation et délibération. Personne de Bade, ni de Würtemberg, ni de Hesse-Cassel. " On s'attendait à voir arriver la Duchesse douairière de Nassau avec le Duc régnant. Mais le refus donné par la Reine de passer par Biberich, était si peu oublié que le Duc ne s’est pas gêné de venir hier à Mayence, comme simple particulier, & de prendre part, comme tout le monde, à ce qui se passait au débarcadère et à la parade. " Mon correspondant finit par cette drôle de phrase: " En résultat général, jusqu'à présent, il paraît y avoir eu plus de mauvais sang que de bon sang ? "
Ne me faites pas de mauvais commérages, je vous prie vous savez que vous n'en faites que de bons. Adieu. Je suppose que cette lettre vous trouvera encore à Boulogne. En tous cas vous aurez informé Génie de vos mouvements. Adieu Adieu. G.
22. Val-Richer, Lundi 18 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous êtes en France. Vous avez certainement passé hier car il faisait beau. Le beau temps continue. J’aurai après demain de vos nouvelles de Boulogne. C’est charmant. Ce sera bien mieux, le 30.
Point de nouvelles du tout ce matin. Sinon des frontières d'Espagne. L’enthousiasme des populations basques, autrefois carlistes, pour les deux Reines, est curieux. Bresson m’en écrit des détails amusants qui lui arrivent à Bagnères d’où il partira bientôt pour rejoindre M. le duc de Nemours à Bayonne et aller avec lui à Pampelune. Les Reines se prêtent de très bonne grâce à ce mouvement populaire. Elles se promènent à dos de mule ou à pied dans les vallées, dans les montagnes. Les paysans illuminent les montagnes, les vallées et escortent les Reines en bande de milliers d'hommes. C’est une fête, et un chant universel de ce côté des Pyrénées qu'on entend presque de notre côté. Le Roi de Prusse ne fait pas mieux sur le Rhin pour la Reine d'Angleterre. Je suis charmé de cet accueil Espagnol. Il consolide le cabinet, satisfait & calme le Général Narvaez. Le gouvernement rentrera à Madrid raffermi. J’ai tort de prédire ainsi sur l’Espagne. Mais voilà mon impression.
A propos du Roi de Prusse, la Reine reste un jour, de plus à Stolzenfels. Elle en partira le 16 au lieu du 15. " On est parvenu, m'écrit-on de Mayenne, à lui faire comprendre que le Roi était fort affecté de voir qu'en public, une visite annoncée et préparée de si longue main, ressemblait si fort à un passage."
Je suis charmé que vous approuviez mon discours. Ici et à Paris, il a fort réussi. On s'en occupe encore. A dire vrai, on ne sait de quoi s’occuper. Le calme est profond, la prospérité toujours croissante, la satisfaction réelle, la confiance dans l'avenir plus grande qu’elle ne devrait. Tout cela ne me supprimera, à la session prochaine, ni un débat, ni un embarras, ni une injure. Le bien et le mal marchent, dans le pays-ci à côté l’un de l'autre, sans se faire tort l’un à l’autre. Nous verrons. Au fond, moi aussi j’ai confiance. Mais quand j'étais jeune, j’avais une confiance joyeuse. A présent, il n'y a pas de joie dans ma confiance. Je sais trop combien le succès même coûte cher et reste toujours mêlé et imparfait. Adieu.
Il faut que j'écrive au Maréchal, au Garde des sceaux, à Salvandy, à Génie. J’écris beaucoup, à vous c’est mon repos comme mon plaisir. Adieu. Adieu.
Je vous trouve très raisonnable sur vos yeux, voyant ce qui est, restez dans cette disposition .
Mots-clés : Débats parlementaires, Diplomatie (Angleterre), Discours du for intérieur, Femme (politique), Louis-Philippe 1er, Ministère des Affaires étrangères, Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
20. Val-Richer, Samedi 16 août 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
J’écris depuis six heures du matin, et je viens de recevoir, un courrier énorme qui me donnera à écrire toute la journée. La Syrie, la Grèce, l’Espagne, Rome la Prusse. A tout prendre tout va assez bien partout ! C’est à dire que partout, nous marchons à notre but, et nous grandissons en marchant. Les chemins sont difficiles. Nous bronchons quelques fois. Nous nous arrêtons de temps en temps, tantôt par nécessité, tantôt volontairement. C'est le cours ordinaire des choses. Il n’y a que les enfants qui s'en plaignent. Mais, je vous le répète tout va assez bien partout. Ce qui n'empêchera pas que l'avenir ne soit chargé d’embarras, d'ennemis, de combats, de périls. Je ne m'en plaindrai pas davantage, si, en dernière analyse, j’obtiens les mêmes résultats. Vous vous rappelez le mauvais début de la dernière session. Et bien aucune n’a aussi bien fini, ni laissé dans le pays une si profonde impression de succès et de progrès.
Je suis très content de Piscatory. Lyons travaille avec passion à faire ce qu’il lui reproche d'avoir fait, à allier M. Mavrocordato et M. Metaxa pour renverser. M. Colettis. L'alliance Anglo-Russe à la place de l'alliance Franco-Russe maintenant debout. Lyons a échoué. Et dans l'alliance Franco-Russe, Colettis a gagné beaucoup de terrain. Piscatory a vraiment beaucoup de savoir faire. Et je ne vois pas qu’il se soit écarté de l'épaisseur d'un cheveu, de la ligne que je lui ai tracée à Constantinople, on s'occupe sérieusement des affaires de Syrie. Le Ministre des Affaires étrangères, Chékib Etfendi, y est envoyé en mission pacificatrice, avec de grands pouvoirs. Nous verrons s'il en sortira quelque chose. Le public est exigeant. Il ne se contente pas d'être bien gouverné lui-même. Il veut que tous les gouvernements soient bons, même le Turc.
En Espagne, le duc de Séville a réellement, gagné un peu de terrain. Même ce me semble dans l’esprit de la Reine Christine. Vous savez que nous n'avons ni extérieurement ni au fond du cœur, pas la moindre objection à cette combinaison. J’ai averti à Naples qu’elle était en progrès. Le langage de M. le Duc de Nemours à Pampelune sera très bon. Il a été un peu indisposé à Bordeaux. Pure fatigue du voyage, qui est fatigant en effet, mais utile.
Thiers aussi va voyager en Espagne. Pour voir les champs de bataille. Et aussi en Portugal. Il y emploiera, le mois de septembre. Il va en compagnie. peut-être MM. de Rémusat, Mérimée (votre bon député), &... Bülow de plus en plus mal. D'après le langage, de ses amis mêmes, on croit sa situation désespérée. Les émeutes religieuses se multiplient en Prusse. Halberstadt a eu la sienne pour Ronge comme Posen pour Cgerski. Je ne crois pas au succès des nouvelles religions. Mais elles feront du mal aux anciennes, et j’en suis fâché. Adieu.
C'est mardi seulement que je vous saurai arrivée à Boulogne, car je compte que vous n'aurez quitté Londres qu'aujourd'hui. Ce que vous me dîtes de vos yeux me charme. Adieu. Adieu
9. Château de Windsor, Dimanche 13 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Oui, je pars demain à midi. Je vous ai dit hier si je ne me trompe comment tout est arrangé. N'ayez aucune crainte de Rouen. C’est beaucoup plus prompt moins fatigant et très sûr. Je partirai d'Eu Mercredi matin, entre 7 et 8 heures. Je serai à Rouen à 2 heures. J’en repartirai à 3 heures pour être à Paris à 9 heures.
Soyez bien sûre que vous n'aurez pas plus de plaisir à me voir entrer que moi à entrer. C’est une charmante idée qui me revient à chaque instant et m'illumine le cœur à tel point qu’il en doit paraître quelque chose sur mon visage. Mais personne ici n'y regarde. Vous n'aurez que quelques lignes. J'ai beaucoup à faire aujourd’hui. Jarnac vient de passer deux heures dans mon Cabinet. J’aurai une dernière conversation avec Aberdeen et avec Peel. Je dois voir aussi le Prince Albert. Puis une foule de petites affaires à régler avec le Roi.
Par une faveur que Lord Aberdeen a arrangée, Lord John Russell est invité à dîner pour aujourd’hui. Aberdeen m’a engagé à causer avec lui, assez à cœur ouvert ; et des rapports des deux pays et du droit de visite. Il lui croit bonne intention, et est lui-même avec lui, en termes très bienveillants.
Merci de la lettre de Bulwer. Je vous la renvoie. Il écrit ici sur le même ton parfaitement content de Bresson et de Glücksbierg. Je ne compte pas laisser M. de Nion à Tanger. Lui-même demande à aller ailleurs. J’ai dîné hier à côté de la Duchesse de Gloucester qui me demande de vos nouvelles et m’a parlé de vous avec un souvenir affectueux. Elle m'a dit que la société anglaise avait perdu sa vie en vous perdant. Après dîner de la conversation avec Aberdeen, un peu avec Peel. Un vrai plaisir à revoir les Granville qui étaient là. Lord Granville est réellement mieux ; toujours faible et chancelant, mais se tenant assez longtemps debout et parlant. Le Roi a été très aimable pour eux. Mad. de Flahaut aussi était là. Tout juste polie. Je l’ai été un peu plus, et voilà tout. Du reste d’une humeur visible et naturelle. Personne ne lui parlait, ne faisait attention à elle.
Votre discours final à Aberdeen est excellent, et je le tiendrai. Il faut que je vous quitte adieu, adieu, dearest. Je tâcherai de vous écrire un mot demain, je ne sais comment, et puis d'Eu, Mardi, en y arrivant. Et puis, ce sera fini. Je vais très bien. Vous me trouverez, moins maigre qu'à mon départ. Adieu. Adieu G.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Louis-Philippe 1er, Ministère des Affaires étrangères, Portrait, Pratique politique, Récit, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Santé (François), Voyage
7. Château de Windsor, Vendredi 11 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Votre pauvre frère est donc mort. Tristesse ou joie, toute chose m'est un motif de plus de regretter l'absence. Loin de vous ce qui vous afflige me pèse ; ce qui me plaît à moi, me pèse. Je ne puis souffrir cette rupture de notre douce et constante communauté. Je suis vraiment triste que votre frère n'ait pas eu la consolation de mourir chez lui, dans sa chambre au milieu des siens. Il semble qu’on ne meure en repos que là. Et cette pauvre Marie Tolstoy ! Je ne lui trouvais point d’esprit. Mais elle a un air noble et mélancolique qui m’intéressait. Non, vous n’êtes pas seule, car je vais revenir.
Nous partons toujours lundi 14, pour nous embarquer à Portsmouth vers 5 heures et arriver au château d'Eu mardi 15 à déjeuner. J’y passerai le reste de la journée du mardi et je serai à Paris mercredi soir. Bien profonde joie.
Le voyage est excellent et laissera ici de profondes traces. Mais cinq jours suffisent pleinement. Je sors de la cérémonie de la Jarretière. Vraiment magnifique et imposante, sauf toujours un peu de lenteur et de puérilité dans les détails, 14 chevaliers présents. Le Roi, très bonne mine, très bonne tenu ; point d'empressement et saluant bien. Lord Anglesey a failli tomber deux ou trois fois en se retirant. Je ne vous redis pas ce que vous diront les journaux.
Hier à dîner entre la Duchesse de Mecklembourg et la Duchesse de Norfolk. La première spirituelle, et gracieuse ; la seconde pompeusement complimenteuse. Après dîner, Lord Stanley. Longue et très bonne conversation. Il m'a dit en nous quittant : " Je vous promets que je me souviendrai de tout ce que vous m'avez dit. " Je crois avoir fait impression. Le Roi en croit autant pour son compte. Quel dommage de ne pas voir les hommes là tous les trois mois ! Qu'il y aurait peu d'affaires. Lord Stanley m’a fait à moi l'impression d'une grande franchise & straightforwardness. Le tort des Anglais, c'est de ne pas penser d’eux mêmes à une foule de choses, et de choses importantes. Il faut qu'on les leur montre.
Outre Stanley, un peu de conversation avec M. Goulburn. Je les ai soignés, tous. Voilà deux soirées où je vous jure que j’ai été très aimable. Hier trois heures avec Aberdeen. Parfait sur toutes choses. Nous sommes de vrais complices. Nous nous donnons des conseils mutuels. Il est bien préoccupé de Tahiti et bien embarrassé du droit de visite. Ce matin deux heures et demie avec Peel. Remarquablement amical pour moi. Les paroles de la plus haute estime, de la plus entière confiance. Il a fini par me tendre la main en me demandant mon amitié de cœur. A un point qui ma surpris. Du reste très bonne intention ; plus d'humeur. Le voyage en effacera toute trace : mais des doutes, des hésitations et des inquiétudes dans l’esprit qui est plus sain que grand. Il m'a répété deux fois, qu’il s’entendait parfaitement et sur toutes choses avec Lord Aberdeen. Se regardant comme brouillé avec une portion notable de l’aristocratie anglaise, & le regrettant peu.
L'Empereur et M. de Nesselrode ont pris plus d’une demi-heure de notre temps. Les choses sont parfaitement tirées au clair. Il a fort approuvé ma conduite de ce côté depuis trois ans. Que de choses j'aurais encore à vous dire. Mais il faut finir. Mon courrier part dans une demi-heure et j’ai à écrire à Duchâtel. Adieu. Adieu. Dearest ever dearest.
J'oublie toujours de vous dire que je vais bien. Un peu de fatigue le soir. Je suis toujours charmé de me coucher. Mais je suffis à chaque jour, et mieux chaque jour. Je mange, quoique je ne puisse pas avoir un bon poulet. Demain, la Cité de Londres envoie à Windsor son Lord Maire, ses douze Aldermen et 18 membres de son common council pour présenter au Roi une adresse excellente pour lui, excellente pour la France. N'ayant pu obtenir le banquet à Guildhall ils n'en ont pas moins voulu manifester leurs sentiments. Ici, cela fait un gros effet. J’espère que chez nous, il sera très bon. Je n'écris pas à Génie dites-lui je vous prie ceci et quelques autres détails pour sa satisfaction. Adieu adieu. G.
Paris, Samedi 28 septembre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens du Conseil. Je suis fatigué et du conseil et de la longue course. Quel beau temps ! Je me suis promené une demi-heure. Si je n’avais fait que cela tout serait bien. Le Roi a été d’une grande discrétion. Il m’a renvoyé sans longue conversation quelque envie qu’il en eût. Je retournerai le voir, mardi et nous causerons.
Il part Mercredi pour le château d'Eu ; rien qu'avec la Reine et Madame. Il n’y passera que quatre ou cinq jours au retour de Windsor. J'ai vu le Maréchal, très amical, de bonne humeur, mais faible aussi. L’âge prend tout-à-fait le dessus & il le sent. Pas la plus petite nouvelle. Le Roi a été il y a trois jours, parfaitement content d'Appony. Le reflet de ma grande conversation avec lui quelques jours auparavant. Il s'est engagé aussi formellement que possible toute l’idée de mariage du Duc de Bordeaux. Adieu. Adieu. Je vais signer les dépêches indispensables, et me reposer jusqu'au dîner. A demain dimanche. Ce sera bien joli. Adieu. G.
Auteuil, Mercredi [25] septembre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai de longues dépêches et lettres de Pétersbourg. Peu intéressantes. Encore, un homme qui ne sera pas grand chose. Mais cela vous intéressera toujours. Adieu. Adieu.
Je suis charmé de rentrer à Paris. J’ai assez bien dormi, et ce matin, je viens de manger un peu. Adieu.
Auteuil. Mercredi 25 Sept.
8 h 3/4 1844
5. Château d'Eu, Dimanche 3 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Il faut croire à la puissance des idées justes et simples. Ce pays-ci n’aime pas les Anglais. Il est Normand et maritime. Le Tréport a été brulé deux ou trois fois, et pillé, je ne sais combien dans nos guerres. Rien ne serait plus facile que d'exciter ici une passion qui nous embarrasserait fort. On a dit, on a répété : " La Reine d’Angleterre fait une politesse à notre Roi ; il faut être bien poli avec elle. " Cette idée s'est emparée du peuple et a tout surmonté, souvenirs, passion, partis politiques. Ils ont crié et ils crieront Vive la Reine, et ils applaudissent le God save the Queen de tout leur cœur. Il ne faudrait seulement pas le leur demander, trop longtemps. Ce n'est pas qu'une autre idée simple et plus durable, la paix, le bien de la paix, ne soit devenue et ne devienne chaque jour très puissante. On la voit au dessus du peuple, parmi les petits bourgeois, et parmi les réfléchis, les honnêtes du peuple. Elle nous sert beaucoup on ce moment. " Quand on veut avoir la paix, il ne faut pas se dire des injures et se faire la grimace." Cela aussi était compris, hier de tout le monde sur cette rive de la Manche. Il y avait vraiment beaucoup de monde.
Voici le N°3 ! Qu'il me plaît malgré, votre peine, à cause de votre peine ! Je me le reproche. Pardonnez-moi ; mais aimez-moi comme vous m’aimez. C’est tout ce que j’aime au monde, tout ce à quoi je tiens vraiment au fond. Vous avez vraiment eu tort d'être si inquiète. Je n’aurais pas risqué César et sa fortune, et bien plus que la fortune de César. Nous n'avons fait d'ailleurs que ce que vous même jugez nécessaire : Un mille en rade, dans le canot royal ; c'était charmant, dix huit rameurs, tous beaux jeunes gens, en chemise blanche, pantalons blancs, l’air si gai sous la sueur qui ruisselait de leur front, la mer aussi sereine aussi bleue que le ciel. Et vous étiez inquiète à ce moment là ! Je pensais à vous ; je vous plaçais dans ce canot ; je vous faisais monter avec moi à bord du yacht de la Reine. Vous aviez un peu peur, peur pour vous. Moi, je n’avais pas peur je tenais votre bras, et j'étais heureux. Que tout ce qui se passe dans la vie extérieure est peu de chose à côté de ce qui traverse et remplit l'âme !
Vous ai-je dit hier soir que décidément il n’y aurait pas de Paris. Je le crois. Je vous répète peut-être souvent les mêmes choses. C’est bien long d’ici à jeudi ! Je vous aime réellement mieux à Beauséjour. A Versailles, vous êtes à la merci des autres. Ils vont ou ne vont pas vous chercher. A Beauséjour, vous pouvez aller chercher quelqu'un, faire vous-même quelque chose pour vous.
Midi . Je reviens du déjeuner. Hier, j'étais en uniforme, en grand uniforme. J'y avais fait mettre Mackan, Lord Cowley, Lord Aberdeen, Lord Liverpool. Le Roi et les Princes, et tous les autres sont venus dîner en frac. Et le Roi ma dit après dîner que la Reine l’aimait mieux. Pour la commodité du Prince Albert, je présume. Ils ont tort. Quand on ne peut plus se gêner en haut, il ne faut pas s'étonner qu'on ne se gène plus en bas. Hier, à dîner à côté de Lady Canning moins jolie qui je ne l’avais laissée ; des sourcils trop noirs et qui se rejoignent. Ce matin, à déjeuner, Lady Cowley. Elle m’a dit qu’elle allait vous écrire pour vous dire ce qu'on (moi) ne vous disait pas, les toilettes, les bêtises. Est-ce que je ne vous en ai pas dit ? Elle m’a parlé de vous avec un intérêt assez vrai et un vrai respect. La reine la traite bien. Elle me paraît très contente.
Les Anglais qui entourent la Reine se préoccupent, en ce moment même, à ce qu’on vient me dire, du lieu et de la manière dont se feront aujourd'hui, pour elle et pour eux, les prières. Le lieu, ils n'en manqueront pas, on arrangera une salle du château ; mais la manière, je ne sais ce qu’elle sera si la Reine n’a pas amené de chapelain. Je suis ici, je crois le seul Protestant, et point chapelain. Je vais causer avec Lord Aberdeen à une heure, et il ira chez le Roi, à 2.
Vos préceptes sont excellents et je les mettrai en pratique. Demain, pendant la grande promenade de la forêt, je m’arrangerai pour l'avoir près de moi et lui vider mon sac. Je le trouve fort enclin à comprendre que le Prince de Metternich ne veut plus avoir d'affaire et que tout le monde ne peut pas être aussi fatigué que lui. Adieu. Adieu.
Il faut que je ferme mes dépêches, quelques mots à Génie, et puis que j'aille chez Lord Aberdeen. Il y a deux mois que la Reine était décidée à ce voyage et en a parlé à Lord Aberdeen et à Sir Robert Peel qui l’ont fort approuvé, en lui demandant de n'en point parler jusqu’après la clôture du Parlement. Voilà leur dire. Il ajoutent que l’opposition, Palmerston surtout, y était contraire et eût travaillé à le faire échouer, si on en eût parlé. Adieu, encore. G.
Mots-clés : Amour, Conversation, Description, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Femme (portrait), Histoire (Angleterre), Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Pratique politique, Protestantisme, Récit, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
10, Val-Richer, Lundi 21 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici mon dernier numéro. Mercredi sera charmant. Il me semble que je viens de passer dix jours absolument seul sans voir personne, sans parler à personne et que je retrouverai Mercredi, ma société à moi, toute ma société.
J’ai pourtant beaucoup écouté et beaucoup parlé hier soir. Salvandy a passé deux heures dans mon cabinet. Il est toujours bien perplexe. Le Roi ne l’a pas décidé. Je crois avoir un peu plus avancé hier. Mais ce n'est pas sûr. Par malheur pour lui, plus je l’entends, plus ma conviction qu'il ne peut pas retourner en Espagne s'affermit. Soyez tranquille. Il n’y a point de chance de faiblesse. Et en même temps je dois le dire, je le trouve plus honnête, plus touché des bons motifs que je ne le croyais. Il me demande de marier sa fille. Si je marie sa fille, il ira où je voudrai, n’ira pas où je ne voudrai pas. Il sera parfaitement content. Elle a vingt ans, de l’esprit, pas jolie, fort peu d’argent, quelques espérances et elle lui dit : " Mon père, prenez garde ; se brouiller avec le Cabinet, c’est se brouiller avec le Roi, et le parti conservateur." Je crois qu’en définitive. il prendra Turin. Il me revient de Madrid qu'Aston laisse voir quelque envie d'y rester. Il a fait donner par le Chargé d'affaires du Danemark, M. d'Alborgo, un dîner au Duc de Baylen. Tout le corps diplomatique y était. Aston a été fort poli, et presque caressant avec tout le monde. En même temps pourtant il parle mal du nouveau gouvernement. A propos du départ de Prim comme gouverneur de Barcelone il disait : " Il va se faire fusiller, ou bien il bombardera Barcelone, ou bien il se mettra à la tête d’une nouvelle insurrection. " Prim répond bien qu’il ne fera rien de tout cela. Il est tout-à-fait dans la main du Général Serrano qui me parait de plus en plus, l'homme de tête et de cœur de l’évènement. Narvaez se conduit plus sagement et avec moins de prétentions que dans les premiers jours.
Il a plu hier au soir par torrents. Ce matin le soleil reparait. En tout ces dix jours ont été très beaux. J'en ai joui à St Germain autant qu’au Val-Richer. Avez-vous fini par vous arranger avec les gens d'écurie comme avec les coqs de Beauséjour ? Je sais bon gré à la jeune Comtesse de ses soins pour vous. Je chercherai quelque manière de lui faire plaisir.
Je commence à croire tout-à-fait que le général Oudinot n’a pas été à Pétersbourg. Il y serait depuis longtemps et d'André me l’aurait écrit. Nous aurons fait de la sévérité en l’air. Il n’y a pas de mal. Il en saura quelque chose, l'Empereur aussi, et l'effet en sera bon. J’espère que d'André aura eu l’esprit de ne pas tenir absolument caché ce qu’il était chargé de faire en cas. Je vous quitte, selon ma coutume, pour ma toilette.
Je vous reprendrai tout à l'heure. Adieu. Adieu.
10 heures Je ne vous reprends que pour deux minutes. Il m’arrive une foule de dépêches que je veux lire avant de les renvoyer. Elles me conviennent en général. Celles de St. Domingue sont très bonnes. Je ne vous ai jamais parlé de cette affaire-là. J'y mets de l’importance. Le Prince de Joinville et le Duc d’Aumale vont en se promenant en mer, faire une visite à Woolwich, et de là à Windsor. Je suis toujours bien aise qu’on les voie. Adieu Adieu. A après-demain.
8. Val-Richer, Samedi 19 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je viens de dormir neuf heures de suite. Il y a longtemps que cela ne m'était arrivé. J’ai beaucoup marché hier. Le soir, j'étais rendu. J'espère bien qu'il n’est plus question de votre point de côté.
Je n’avais pas bonne idée de votre essai de coucher à St Germain ou à Versailles. Quand on parviendrait à réunir, dans une chambre d’auberge, tous les conforts possibles, comment arranger le dehors, le bruit, le mouvement, les chevaux, les postillons, les voyageurs ? Il faut voyager ou rester chez soi. Enfin nous serons à Beauséjour, mardi. Il fait toujours beau. Je compte, pour nous, sur un beau mois de septembre.
Je ne parviens pas à voir comme vous l’Espagne en noir. Sans doute la situation est grave et difficile ; il faut y bien regarder, et la suivre pas à pas. Mais au fond, elle est bonne, très bonne ; et en définitive, après toutes les oscillations et tous les incidents possibles, c’est le fond des choses qui décide. La conduite sera bonne aussi. J’ai de plus maintenant l'autorité car j'ai réussi. Je m’en servirai au dedans et au dehors. Au dedans, je crois à ma force dans la discussion. Au dehors, je crois au bon sens anglais. Voilà ma confiance. Voici mes craintes, car j’en ai plus d'une. Je crois que les Espagnols les vrais meneurs ne veuillent absolument un grand mari, et que ne pouvant avoir Aumale, ils ne reviennent au Cobourg. Je crains que malgré le bon sens de Londres, les vieilles routines Anglaises et Palmerstoniennes ne persistent dans les agents secondaires et éloignés, que l’esprit d’hostilité contre la France ne les porte à fomenter toujours en Espagne, les intrigues Espartéristes et radicales. Je crains que la bouffée de raison et de modération qui souffle en ce moment en Espagne, ne soit courte, et qu’on n’y retombe bientôt dans l’anarchie des passions et des idées révolutionnaires. Trois grosses craintes, n'est-ce pas ? Je m'y résigne. Il y a, dans le fond des choses de quoi lutter contre ces périls-là. Je sens tout le poids du fardeau que je porte. Mais je suis convaincu que les hommes qui ont gouverné leur pays, dans les grands temps n’en portaient pas un plus léger. Il faut accepter sa condition.
10 heures Voilà le 10. Je suis charmé que le point de côté soit passé. Vous avez toute raison de ne pas choquer la jeune comtesse. Je ne partirai d’ici que mardi, et ne serai à Auteuil que mercredi. Je reçois à l’instant même une lettre du Roi, qui m'avertit que Salvandy est parti d'Eu hier soir et viendra demain au Val-Richer. Tout n'est pas arrangé, bien s'en faut d'après ce que me mande le Roi. Pourtant il y a du progrès. Il faudra que j'aille faire une course à Eu dans les premiers jours de septembre ! Je l’ai promis au Roi et il me le rappelle encore aujourd'hui. Ce sera deux nuits en voiture et 36 heures de séjour. Je vais lire le discours de Palmerston sur la Servie. On m'écrit de Londres qu'il a fait de l'effet, et la réponse de Peel pas beaucoup. Adieu. Adieu. Je n’aime pas ces 24 heures de séparation de plus, mais il le faut.
Adieu. Cent fois G.
8. Versailles, Mercredi 16 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcours politique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon
5. Val-Richer, Mercredi 16 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
J’ai encore été réveillé cette nuit par une estafette du château d’Eu. Le Roi me consultait sur la conversation qu’il doit avoir un de ces jours avec Salvandy à propos de l’Ambassade de Turin. Mortier voudrait bien aller à Turin et le Roi est bien disposé pour lui. Mais je suis sûr que Salvandy ne voudra à aucun prix de la Suisse, la plus petite des Ambassades, petite pour sa vanité ; petite pour sa bourse. C’est déjà beaucoup de lui faire accepter Turin. J’ai prié le Roi de ne parler que de Turin. Pour ceci, le Val Richer n'a causé aucun retard. L’estafette vient aussi vite d'Eu ici que d’Eu à Paris. Mais en tout, cela ne peut pas aller. La situation est trop grave, trop délicate, trop pressante pour admettre des retards au moins de 24 heures souvent de 48. Je Je m’arrange pour partir d’ici lundi ou mardi, le 21 ou le 22.
Mon Conseil général, les électeurs qui voulaient me donner un banquet en auront de l'humeur. J’en suis fâché, car ils sont très bien, et je tiens à ce qu’ils soient très bien pour moi. Mais il n'y a pas moyen. J'ai vu beaucoup de monde hier et je les ai préparés tous à ce désappointement. Dearest, de quel mot je me sers là! Admirez l'empire des situations. C’est au désappointement de mes électeurs que je pense quand je dois vous revoir cinq jours plutôt. Vous me le pardonnez n’est-ce pas ? Croyez-moi ; vous pouvez me tout pardonner, chaque nouvelle séparation, chaque jour de séparation me fait mieux sentir tout ce que vous êtes pour moi. Que de choses à nous dire ce jour charmant où nous nous reverrons et tous les charmants jours suivants Je vous crois parfaitement quand vous me dîtes que ce n’est pas à vous que vous pensez quand vous me parlez de la nécessité de mon retour. Vous ne m’avez pas envoyé la lettre d'Emilie. Je la plains de se marier sans goût. L’intimité de la vie quand celle du cœur n’y est pas me paraît odieuse à 55 ans comme à 20. Emilie s’y accoutumera comme presque tout le monde s’y accoutume. Mais il en résulte une certaine décadence intérieure qui me déplait infiniment. Il pleut ce matin. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai dans une heure Adieu jusque là.
10 heures Voilà bien une autre raison de revenir plutôt. Mon courrier de Paris me manque ce matin, tout entier, journaux comme dépêches, et vous par dessus tout. Je n'y comprends rien. Mais quelle que soit la cause, l'effet me déplait horriblement. Quelque négligence, un quart d’heure de retard du commis expéditeur au Ministère. C'est odieux. Je vais me plaindre amèrement à Génie. Adieu. Adieu. Ma journée sera bien longue. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Femme (mariage), Femme (politique), Femme (statut social), Louis-Philippe 1er, Mandat local, Mariage, Politique (France), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Politique)
4. Val-Richer, Mardi 15 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures du matin
Quel ennui d’être loin ! J’aurais mille choses à vous dire, votre avis à prendre, car j'ai besoin de votre avis. Il n'y a pas moyen d’écrire tout cela. J’ai une première réponse de Londres, une première conversation de Chabot avec Aberdeen, des hésitations, des embarras, des pusillanimités, des susceptibilités, des prévoyances, des méfiances à l'infini, et à travers tout cela, un désir sincère de s’entendre avec nous, un fort instinct que cela se peut, qu’il n’y a que cela de sensé que c'est pour eux, le seul moyen de sortir d'une mauvaise situation. Et c'est de si loin que j’ai à traiter avec toutes ces impressions, toutes ces nuances de dispositions qui seraient déjà bien assez difficiles à manier de près !
L’estafette m'a réveillé à 2 heures et demie J’écris depuis ce temps-là au Roi, à Chabot, à Génie. Je viens de renvoyer l’estafette et je vous écris à vous, pour me rafraîchir. J'étais venu ici pour me promener, et ne rien faire. Ce n’est pas le tour que je prends. Je me suis beaucoup promené hier. J’ai arrosé mes fleurs. J'en ai beaucoup et de charmantes, des raretés. Vous les aimeriez. Ce matin, il y a un brouillard immense. Il enveloppe tout. Il fera très beau à
Midi. Vous n’avez nulle raison d'être inquiète ; mais vous avez grande raison de m’aimer plus que jamais et de me le dire. Mon plaisir à l’entendre mérite tout ce que vous voudrez. Je crois aussi que Salvandy acceptera Turin. Pourtant il n’y a jamais à compter sur les esprits mal faits, et mal faits surtout par la vanité. Ils déjouent toute prévoyance. Je vais faire ma toilette en attendant la poste. Puis j’essaierai de dormir un peu. Je m'étais couché hier avant 10 heures. Mais de 10 heures à 2 heures et demi, c’est trop peu de sommeil.
10 heures et demie. C’est charmant deux lettres. Oui, il y a, en ce moment, un inconvénient réel à être loin et très probablement je n'attendrai pas, le 26. N'en dites rien à personne. Je suis frappé d'Espartero faisant un manifeste donc n'abandonnant pas tout-à-fait la partie. On fera de lui, si on veut, un instrument d'intrigues en Espagne, et on le voudra, si nous ne nous accordons pas. Tout cela a besoin d'être conduit avec une grande précision et heure par heure. Je suis bien aise que vous ayez reçu une lettre de votre frère. Il paraît certain que l'Empereur ira à Berlin. On l’y attend. Bresson me mande que M. de Bülow est revenu en très bon état. Je vous quitte pour Génie à qui j’ai plusieurs choses à dire. Adieu. Adieu. Soyez charmante tous les jours, Adieu. G.
24. Val-Richer, Lundi 14 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ceci est mon dernier mot. Vous l’aurez jeudi. Vendredi, j’apporterai moi-même ma lettre. Que celle de ce matin, m'a fait plaisir ! Elle est calme, gaie. Certainement vous êtes mieux. Savez-vous ce qui me trouble avec vous, quant à votre santé ? Vous avez besoin, je crois, d’en être distraite, de porter votre imagination ailleurs. J’hésite donc à vous en parler. Et pourtant ! Et puis à part la contrainte, il y a, dans cette réticence, dans le soin de détourner vos pensées en retenant les miennes, un arrangement une petite supercherie qui me déplaît.
J’ai besoin de laisser librement, aller près de vous mon esprit, mon cœur, ma parole, ma vie. Il m’en coûterait infiniment de vous tromper tant soit peu, même pour vous servir. Je le ferais cependant si votre santé y était intéressée. Qu’elle ne le soit pas Madame; que je puisse vous parler de tout, vous tout montrer, vous tout dire ! Nous nous sommes en effet écrit très peu de nouvelles. Nous les avons peut-être réservées pour le moment où nous serons ensemble.
Y a-t-il des nouvelles aujourd’hui du reste ? Toutes choses sont si prévues qu’on n’en parle plus quand elles arrivent. Savez-vous ce que c’est que l’escompte en fait d’argent ? On escompte tous les événements. Tout se passe tout se fait d’avance. Les élections anglaises finissent à peine. Leurs résultats n’ont pas encore commencé. On n’y pense déjà plus. Les nôtres se préparent. On en a déjà tant parlé, on en parlera tant d’ici à quelques jours, qu’on y arrivera blasé, épuisé. C’est une vraie maladie que ce long bavardage préalable, et une maladie sans remède, car elle est dans nos institutions, dans nos mœurs. Que deviendraient des jeunes gens qui disserteraient, bavarderaient, rêvasseraient, écrivailleraient sur l’amour bien avant de l’éprouver avant de voir une femme ? J’aime que la pensée et l’action, le dire et le faire se suivent de plus près et se lient plus intimement. Je suis sûr que l’un et l’autre s’en trouvent mieux.
Mardi 9 heures
Je me suis levé tard ce matin, et voilà l’homme de la poste qui arrive plutôt. Il faut que je lui donne ma lettre ! J’ai moins de regret qu’elle soit courte. J’y supplierai vendredi. Je lis en courant votre n°25. N’ayez plus de chagrin de mon chagrin. Il est passé puisque vous me rassurez, puisque d’ici déjà je vous vois mieux. Vendredi! Point d’adieu. G.
375. Londres, Jeudi 21 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
On est venu m’éveiller cette nuit à 3 heures, pour m’apporter la division de la Chambre des Communes, et j’ai expédié sur le champ un courrier à Calais pour qu’on le sût à Paris par le télégraphe. Non qu’il doive, je crois, en résulter ici aucun evènement. C’est pourtant un gros fait. On me dit que Peel a très bien parlé et O’Connell médiocrement. Il a voulu être modèré. On l’avait fort sermoné à ce sujet. C’est Lord Duncannon qui est son prédicateur. Et O’Connell répond toujours : " you are right ; I won’t do it again." Il a trop bien obéi hier. On prévoyait ce résultat, même à Holland House où j’ai été hier soir au lieu d’aller à la chambre. Devinez qui j’y ai trouvé? Mr Mrs Grote qui y avaient dîné. C’était un coup monté. Peut-être vous en ai-je déjà parlé quand ils ont été partis, j’ai demandé à lady Holland si elle avait un privilège contre les poursuites, for treating and bribery.
2 heures
Je viens de chez Lord Aberdeen. J’aime sa conversation, et je crois qu’il aime la mienne. Il y a beaucoup de shyness dans sa froideur. Et aussi de sadness. Il est préoccupé de cette affaire Napoléon. On commence à l’être ici, beaucoup plus qu’au premier moment & plus que moi. Je suis accoutumé aux apparences, et aux démonstrations bruyantes. Cependant, il est sûr que des embarras viendront de là. Ce qu’il y avait de bien est déjà recueilli ; il faudra subir le mal. Mais je ne crois pas au danger. Pourvu qu’il y ait un pouvoir qui s’en défende. En tout cas, la question est lointaine. Le retour n’est pas possible avant le mois de Novembre.
L’Orient est stationnaire. Je reste toujours sur mon terrain. On n’y vient pas. Mais on n’ose pas avancer sur le sien. Je m’applaudis du parti que j’ai pris de dire dès le premier moment, ce que je devais dire à la fin. Plus j’y pense, plus je suis convaincu que notre politique est la seule sensée. Rallumer la guerre entre les Musulmans, et courir le risque de l’allumer entre les Chrétiens pour la question de savoir si quatre ou seulement deux Pachalih de la Syrie appartiendront au vieillard qui règne à Alexandrie ou à l’enfant qui dort à Constantinople, en vérité c’est bien léger. Et je tiens pour certain qu’ici il n’y a pas trois personnes qui ne soient au fond de mon avis. De celles qui y ont pensé, s’entend. Il n’y en a pas beaucoup.
Les Affaires Etrangères occupent bien peu le public anglais. Je dis beaucoup sur cette question d’Orient ce qui est parfaitement vrai ; la politique que nous soutenons ne nous causera aucun embarras, à l’intérieur, car tout le monde, en France en est d’avis ; aucun embarras à l’extérieur, car le jour où l’on voudra agir sans nous, les embarras seront pour ceux qui entreprendront de faire, et non pour nous qui regarderons faire. L’hypothèse la plus défavorable ne nous met donc pas dans une position redoutable.
M. de Metternich a eu certainement beaucoup d’humeur pour Naples ; et dans son humeur, il s’est montré plus disposé à faire ce que voudrait Lord Palmerston en Orient. Mais sa disposition est vague, comme tout dans l’affaire. Quant au Pacha, il dit que si on le bloque dans Alexandrie, il sautera par dessus le blocus, c’est-à-dire pas dessus le Taurus. Je connais ces petites biographies, les premiers cahiers, le mien compris, qui était très bienveillant, et assez spirituel. Je connais Thiers, aussi ; mais non pas, le Duc de Broglie, ni Berryer, ni Dupin, ni Lamartine, vous serez bien aimable de m’envoyer ceux-là. L’ouvrage m'a paru écrit à bonne intention. Sait-on par qui?
Certainement, je porterai la santé de la Reine, le 25. Je suis en pension chez lady Palmerston. Elle dine samedi chez moi ; moi dimanche chez elle en petit comité, et lundi en full house. Je l’ai beaucoup vue depuis quelque temps et plus je la vois, plus je la trouve aimable. Elle dit qu’à présent je plais beaucoup à M. de Brünnow et qu’il parle de moi tendrement. Adieu.
J’ai le cœur à l’aise depuis hier à votre sujet. Je voudrais que ma grande lettre vous fût arrivée avant la petite. Je ne l’espère pas. Adieu.
Vous devriez vous arranger pour être ici le samedi 13 Juin. Au plus tard le Dimanche 14. Vous ne vous faites pas scrupule, je pense, de voyager le dimanche. Je ne trouve pas qu’on soit aussi austère ici à ce sujet, qu’on me l’avait dit. Le gros Monsieur vient passer quelques jours à Londres et vous en avertira. Ce que vous pourriez lui remettre passera de sa main dans la mienne. Que j’ai de choses à vous dire ! Et que de choses à entendre, que j’aime mille fois mieux !
Adieu, encore ; jamais pour la dernière fois.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Posture politique, Pratique politique, Salon, Séjour à Londres (Dorothée)
369. Londres, Vendredi 15 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
3 heures et demie
J’ai été chargé de l’arranger ici. Je l’ai fait. Je ne suis pas chargé des conséquences. Du reste, nous sommes, je crois, destinés à vivre sous un horizon couvert de gros nuages qui ne portent pas de tonnerre.
Je n’ai pas éte surpris de ne pas voir mon nom dans le discours de M. de Rémusat, et je le trouve assez convenable. Il ne devait y avoir dans ce discours comme il n’y a en effet, que quatre noms : le Roi, Napoléon, la France et l’Angleterre. Ce que j’admire, sans en être surpris c’est l’art avec lequel les journaux, ministeriels ou de la gauche, ont évité de parler de moi à ce propos. Cela m’arrivera souvent. Même quand on m’aura écrit : " Réussissez dans cette affaire et nous vous en laisserons tout l’honneur."
Moi aussi, je suis préoccupé de l’été qui commence et de ce qu’il peut apporter dans ma destinée. Mais ma situation est claire pour moi et ma résolution arrêtée. Je suis donc préoccupé sans agitation. Un homme d’assez d’esprit m’écrit : " On connait ici tout l’avantage de votre position, on l’admire et on l’envie. Vos amis sont peut-être ceux qui s’en arrangent le moins. Ils trouveraient assez bon que quelque cause de mécontentement vous ramenât à Paris afin que vous passiez leur dire ce qu’ils ont à faire. Il n’y a de direction nulle part. Le ministère manque complètement d’assiette. La gauche n’en sait pas encore assez long pour se conduire sagement ; et la droite paye en détail pour ses lachetés précédentes. Restez bien longtemps le plus loin possible de ces misères et gardez le moins de pitié possible pour les détresses de l’amitié.
Qu’en dites-vous ? Pourtant je me méfie de ce conseil, car c’est mon penchant. Je ne veux pas devancer d’une minute la nécessité ; mais je ne veux pas lui manquer.
5 heures
Votre fils n’est pas sorti à cause de la pluie, et aussi par prudence. Il ne sortira probablement pas avant Lundi. Mais il va de mieux en mieux. Je ne doute pas qu’il ne préfère aller à Paris, et ne vous engage à l’y attendre. Adieu. Je vous ai écrit hier à Boulogne et à Douvres, poste restante. Adieu. Adieu
Réposez-vous.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Angleterre), Politique (France), Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée (Dispute), Santé (enfants Benckendorff)
[?], le 10 mars 1838, Charles Lacretelle à François Guizot
Paris, le 4 juillet 1843, Gabriel Moulin à François Guizot
Paris, le 7 juin 1843, Gabriel Moulin à François Guizot
Paris, le 1er septembre 1836, Adolphe Granier de Cassagnac à François Guizot
Paris, le 25 mai 1869, Ximénès Doudan à François Guizot
[Auteuil], Dimanche 15 septembre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pourvoyez-vous d'un compagnon de promenade. Je ne veux pas que vous soyez à la merci de mes affaires. Je passerai en tous cas par la Muette et si l’heure me le permet, l’heure et mon courrier, je suivrai notre plan d’hier. Mais je n’ose y compter. J’aurais pourtant bien à causer avec vous. En tous cas, à demain midi. C’est un pauvre remède que demain. Adieu. Adieu. G.
Dim. 15 sept 1844 -
Midi
Auteuil, Vendredi 6 septembre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'ai besoin du Conseil ce matin chez le Roi, à 2 heures. J’irai vous voir, entre midi et une heure. Adieu. Adieu.
Auteuil Vendredi, 6 sept 1844 9 h. 1/2
[Paris], Mardi 27 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je suis bien fâchée de voir dans la dépêche télégraphique le mot " pris possession. Ne pouviez-vous pas faire mettre " nous avons occupé " ? Il me parait que vous devriez ne pas tarder un moment à faire à Londres cette rectification. Car si je juge sur mon impression ce mot en produira une très vive en Angleterre. Je m’inquiète de tout, c’est que vous savez comme je trouve qu'on est léger ici.
J'ai une lettre de Constantin. Mon frère traîne. Il parait que l’hydropisie se déclare. Il est plus triste que jamais. On lui mande de Pétersbourg que l’Empereur mène l’Impératrice à Berlin. Je n’ai pas vu une âme encore.
J’attends votre billet, et je viens de prier Génie. Le voilà qui entre et me remet votre billet. Vous ne me dites rien sur ce qui m’inquiète. Je répète hâtez vous de réparer à Londres. De dire à Cowley, occupation temporaire cela ne peut être que cela. En général, le ton de la dépêche télégraphique est de mauvais goût. Ecraser la ville comme c'est fanfaron. Vous voyez que je suis de mauvaise humeur vous avez un peu tort de ne pas vous mêler davantage de tous ces détails.
Voici mon fils qui sort de chez moi. Avez-vous lu le rapport de Lloyds compagnie d'assurance. Cela n’est pas suspect, qui dit qu'à Tanger à cinq heures de l’après-midi seulement la flotte française s’est retirée et les batteries tiraient encore sur elle tandis que la dépêche disait : L’attaque commence à 8 h. du matin au bout d'une heure on avait tout détruit. Accordez cela. Le Lloyds ajoute : toutes les batteries sont restées debout. C'est drôle !
Si je puis j’irai vous voir un moment mais je ne suis pas sûre de le faire, d'abord il faut absolument que je rende enfin les visites que m’ont faites Mad. Appony & Mad. Brignole, & puis je ne vous trouverais pas seul, quel profit ? Mais ne manquez pas de venir à 8 1/4. J’aurai certainement vu Lady Cowley, je la chercherai même car j’aime le cœur [?] la possession. What could possess you to write that word. Adieu. Adieu. Peut-être encore me verrez-vous arriver. Adieu.
Au fond, c'est vous qui avez tort d'être à Auteuil dans ce moment. C'est un anxious moment, où votre présence à Paris est nécessaire à tout instant. Vous pourriez y aller dîner tous les jours. Cela conclurait tout. Je pense que vos collègues seraient charmés s’ils savaient que je vous propose cela. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Maroc), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Santé (famille Benckendorff)
11. Auteuil, Samedi 10 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
Je comptais passer ma journée ici tranquillement. Mais nous avons conseil à Neuilly, au lieu de demain. Cinq ministres seulement au conseil, qui va tout de même. Je jouis tous les jours d'avoir un vrai Ministre de la marine. Il n’est plus malade. J’envoie le Duc de Glücksberg à M. le Prince de Joinville pour négocier, conclure et signer avec le Maroc, les arrangements auxquels donnera lieu le rétablissement de la paix si, comme je l’espère, la bonne dépêche est bien vraie & bien définitive. Nous aurons là, pour la délimitation des frontières, une négociation assez longue.
Decazes est charmé pour son fils. Je l’ai pris comme le plus capable parmi ceux qui étaient disponibles, et à portée. Bresson ne sera pas si content. Il est très jaloux et n'aime que les gens bien subalternes bien dépendants de lui seul. Grand signe d'infériorité, quoique j'aie vu cela à des hommes de beaucoup d’esprits, de bien plus d’esprit que Bresson. Mais j’ai toujours trouvé le coin par où ils étaient subalternes eux-mêmes. On dit que sa femme est avare et sans esprit. Je le connais bien à présent, lui et sa position. Il est descendu dans mon opinion, mais il reste capable. Il jouit petitement de la petite position de Bulwer. Et son inquiétude, son humeur viennent de ce qu'elle n'est pas encore aussi petite qu’il le voudrait. Elle est vraiment très petite, du fait de Bulwer lui-même encore plus que du fait des événements. Il a pourtant donné l’idée qu’il était homme d’esprit et bon enfant. Cela le relève par moments un peu ; mais il retombe toujours par manque de tact, de tenue, par les velléités d’intrigue, et ses pitoyables relations. La considération est d’autant plus nécessaire en Espagne qu’il y a fort peu d'hommes considérés.
La Reine Christine a enfin revu le Duc de Riansarès, bien en cachette, bien peu de jours ; mais enfin elle l’a revu ; ils ont réglé leur marche à venir. Leurs confidents sérieux en sont d'accord. Cela lui a remis un peu de joie et de repos dans l'âme. Toute sa vie est là. Elle part, décidément avec ses filles, le 18 pour être à Madrid du 22 au 24. On peut espérer que rien n’arrivera avant l'ouverture des Cortés. La petite Reine commence à être lavée et propre, presque aussi bien qu'Hennequin.
Midi.
Il n'y a point eu de note échangée sur Tahiti. Rien du tout d’officiel. Des conversations particulières d'Aberdeen avec Jarnac et de moi avec Cowley. Si on m'adressait quelque chose d’officiel, je prendrais du temps pour répondre. Je fais dépouiller tous mes documents sur Pritchard. Je veux mettre toutes ses manières en lumière, et j’enverrai cela à Lord Aberdeen, avec ma réponse s’il y a lieu à réponse. Soyez tranquille : elle sera bonne. Ne vous ai-je pas dit que, très cordialement, très amicalement je saisirais cette occasion de montrer que je sais aussi dire non ? Génie est revenu. Il est impossible de n’être pas touché de tant d'affection. Il se désolait d'être loin, de penser que je pouvais avoir besoin de lui, et qu’il n’était pas là. Il a repris son service avec une joie tendre. Vous avez raison ; adressez-lui quelquefois les lettres.
Je viens d'avoir des nouvelles de Duchâtel, d'Ems, le 7. En très bonne humeur. Il a rencontré sur le bateau à vapeur du Rhin Lord Clarendon qui lui a tenu, un bon langage, fort ami de la France et de moi. Mais Lord Clarendon veut toujours plaire. Perpétuel mensonge. Mardi 30 Juillet à notre dernier bon moment, Lady Cowley m'a prié de lui demander quelquefois à dîner. Je l’ai fait hier pour lundi. Cela me plait. Adieu. Adieu. Je vais au Conseil. G.
P.S. 3 heures Je reviens du Conseil. La Princesse de Béna est malade. Don Carlos a écrit au Roi une lettre convenable, pour demander la permission de la conduire aux eaux de Neris. Le Roi le lui permet. Je suis charmé que votre frère soit un peu moins mal. Je désire bien qu’il puisse partir. Adieu Adieu.
9. Baden, Jeudi 8 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres m’arrivent ici à 2 heures c’est un charmant moment, j’ai bien soin de le passer seule. J’attends aujourd'hui les journaux avec impatience pour lire la discussion de lundi. Plus je pense à Tahiti et plus je me fâche. Vous vous êtes donné là une place éternelle, je ne crois pas que l’avantage de cette possession ou protectorat peut valoir les inconvénients incessants qu’elle vous suscitera. Il y aura d’autres Pritchard. Je suis curieuse des explications qui auront été échangées. Le [blâme] ou le regret de la conduite incivile de M. d’Aubigny peut bien se trouver dans une note, mais son éloignement ultérieur ne devrait pas s’y trouver, à moins que les anglais ne vous aient dans le temps promis par note aussi l’éloignement de Pritchard, ce que j'ignore. Dans tous les cas ils ont bien peu tenu parole, et vous avez tout-à-fait le droit de les imiter certainement ni vous ni aucun ministre quelconque en France ne pourrait risquer. Je ne dis pas même le désaveu mais seulement l'éloignement de M. d'Aubigny dans ce moment. Vous savez bien cela. Vous savez aussi que les Anglais ne se feront aucun scrupule de publier votre note. Vous avez été plein de procédés et de ménagements pour eux. Ils ne vous imiteront pas, j'espère donc que votre réponse si elle est faite peut risquer le grand jour sans me faire évanouir de terreur. Je suis bien fâchée d’être loin car tout ceci me tracasse bien fort. Rassurez-moi un peu.
Je crois que je vous ai écrit une lettre quelque peu anglaise, mais j’étais sous l'impression que Pritchard avait well deserved ce qui lui est arrivé ; j’avoue que je ne trouve pas cela dans ce que je lis dans les journaux. je suppose que les rapports officiels sont plus positifs. Je rabâche, vous n'avez pas besoin que je vous redise de Bade l’affaire de Tahiti. Lady Cowley wishes the whole island at the bottom of the sea ! La journée a été moins mauvaise hier. Il a parlé, & à deux reprises, j’ai même eu une assez bonne conversation avec lui. Il est possible que je le laisse ici vivant.
Il est décidé que Constantin ne le quittera plus, que Mad. de Krudner viendra le rejoindre à Hambourg, et qu’il se rendra d'ici là à très petites journées. Il est très impatient de reprendre ses affaires. L'habitude de l'occupation et de l’agitation est plus forte que la maladie. Je le trouve sensé, modéré, et d’après ce qu’il me dit courageux. Le seul qui ose parler et qui le fasse. Nesselrode bien poltron Orloff secondant mon frère mais en auxiliaire. Il déteste Brunnow et ne lui pardonne pas mon affaire. En tout il se montre non seulement quand il me parle, mais lorsqu'il cause avec Constantin, tout-à-fait mon ami et mon frère.
Je ne sais pas vous rendre compte de mon temps. J’en ai de reste, et en même temps la journée est bien vite finie. Je vais chez mon frère trois, quatre fois le jour. Constantin, Hélène, Annette vont et viennent de chez lui chez moi. Et puis les médecins, les courtisans, on se redit chaque impression. Je me promène avec Constantin, à pieds ou en calèche. Je vais m'asseoir sous les arbres. Je dine seule. Je lis, si on me laisse seule. J’ai reçu un ou deux russes de la dernière insignifiance. Bacourt vient une heure avant mon dîner me raconter tout ce qu’il a lu dans tous les journaux. Nous rabâchons Tahiti ou autre chose. Voilà tout. Je me couche à 9 heures. Je me lève avant 7.
Je pense à vous, je rêve à vous, je prie pour vous. Soyez bien sûr qu’à quelque moment du jour que vous pensiez à moi, vous me rencontrez. Adieu. Adieu. Adieu mille fois.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Femme (diplomatie), Politique (Internationale), Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Santé (famille Benckendorff), VIe quotidienne (Dorothée)
8. Baden, Jeudi 8 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres m’arrivent ici à 2 heures c’est un charmant moment, j’ai bien soin de le passer seule. J’attends aujourd'hui les journaux avec impatience pour lire la discussion de lundi. Plus je pense à Tahiti et plus je me fâche. Vous vous êtes donné là une place éternelle, je ne crois pas que l’avantage de cette possession ou protectorat peut valoir les inconvénients incessants qu’elle vous suscitera. Il y aura d’autres Pritchard. Je suis curieuse des explications qui auront été échangées. Le blâme ou le regret de la conduite incivile de M. d’Aubigny peut bien se trouver dans une note, mais son éloignement ultérieur ne devrait pas s’y trouver, à moins que les Anglais ne vous aient dans le temps promis par note aussi l’éloignement de Pritchard, ce que j'ignore. Dans tous les cas ils ont bien peu tenu parole, et vous avez tout-à-fait le droit de les imiter certainement ni vous ni aucun ministre quelconque en France ne pourrait risquer. Je ne dis pas même le désaveu mais seulement l'éloignement de M. d'Aubigny dans ce moment. Vous savez bien cela. Vous savez aussi que les Anglais ne se feront aucun scrupule de publier votre note. Vous avez été plein de procédés et de ménagements pour eux. Ils ne vous imiteront pas, j'espère donc que votre réponse si elle est faite peut risquer le grand jour sans me faire évanouir de terreur. Je suis bien fâchée d’être loin car tout ceci me tracasse bien fort. Rassurez-moi un peu. Je crois que je vous ai écrit une lettre quelque peu anglaise, mais j’étais sous l'impression que Pritchard avait well deserved ce qui lui est arrivé ; j’avoue que je ne trouve pas cela dans ce que je lis dans les journaux. je suppose que les rapports officiels sont plus positifs. Je rabâche, vous n'avez pas besoin que je vous redise de Bade l’affaire de Tahiti. Lady Cowley wishes the whole island at the bottom of the sea !
La journée a été moins mauvaise hier. Il a parlé, & à deux reprises, j’ai même eu une assez bonne conversation avec lui. Il est possible que je le laisse ici vivant. Il est décidé que Constantin ne le quittera plus, que Mad. de Krudner viendra le rejoindre à Hambourg, et qu’il se rendra d'ici là à très petites journées. Il est très impatient de reprendre ses affaires. L'habitude de l'occupation et de l’agitation est plus forte que la maladie. Je le trouve sensé, modéré, et d’après ce qu’il me dit courageux. Le seul qui ose parler et qui le fasse.
Nesselrode bien poltron Orloff secondant mon frère mais en auxiliaire. Il déteste Brunnow et ne lui pardonne pas mon affaire. En tout il se montre non seulement quand il me parle, mais lorsqu'il cause avec Constantin, tout-à-fait mon ami et mon frère. Je ne sais pas vous rendre compte de mon temps. J’en ai de reste, et en même temps la journée est bien vite finie. Je vais chez mon frère trois, quatre fois le jour. Constantin, Hélène, Annette vont et viennent de chez lui chez moi. Et puis les médecins, les courtisans, on se redit chaque impression. Je me promène avec Constantin, à pieds ou en calèche. Je vais m'asseoir sous les arbres. Je dine seule. Je lis, si on me laisse seule. J’ai reçu un ou deux russes de la dernière insignifiance. Bacourt vient une heure avant mon dîner me raconter tout ce qu’il a lu dans tous les journaux. Nous rabâchons Tahiti ou autre chose. Voilà tout. Je me couche à 9 heures. Je me lève avent 7. Je pense à vous, je rêve à vous, je prie pour vous. Soyez bien sûr qu’à quelque moment du jour que vous pensiez à moi, vous me rencontrez. Adieu. Adieu. Adieu mille fois.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Eloignement, Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Politique (France), Politique (Internationale), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Santé (famille Benckendorff), VIe quotidienne (Dorothée)
6. Auteuil, Mardi 6 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteuil Mardi 6 août 1844
2 heures
Pas de lettre aujourd’hui. Je m’y attendais un peu. C'est le Rhin qui me coute cela. C’est un déplaisir que vous soyez de l'autre côté. Que de petits déplaisirs en ce monde, sans parler des grandes peines ! Je suis très raisonnable sur les petits déplaisirs. Je les repousse ; mais je sens leur piqure. Fagel sort d’ici. J’ai repris mes mardi d’Auteuil. Ils dureront, car je ne peux pas penser au Val-Richer à présent. Fagel m'a amené un de ses amis, un M. Van der Tix, membre des Etats Généraux, homme d’esprit. Il y a pas mal de gens qui ont de l’esprit la première fois. On n'en a vraiment qu’à condition d'en avoir toujours, et toujours plus.
Fagel m’a demandé de vos nouvelles. Je lui crois un sentiment vraiment bienveillant pour vous. Je ne m'y trompe guères.
Voilà donc la session close. J’ai peine à y croire. Elle m'a grandi et je suis debout. Mais debout sur la brèche. Et je serai sur la brèche dés l’ouverture de la session prochaine. Les relations avec l’Angleterre seront la grosse question de l'adresse. Plus grosse peut-être que jamais. J’y pense beaucoup. Mon parti est bien pris, tant que je pourrai pratiquer la politique, que je pratique depuis quatre ans, je resterai. Mais un jour peut venir où il y aura à faire une platitude ou une folie. Ce ne sera pas moi. Le Roi a des hommes pour cela.
4 heures 3/4 Appony, Brignole, Armin, Serracapriela Peruzzi, Koso. J’aurais beaucoup à vous dire. Il n'y a pas moyen. Il faut que j'envoie mes lettres à Paris si je veux qu'elles partent. Adieu. Adieu. Demain j’aurai une lettre. G.
Versailles, Lundi 24 juin 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
1 heure
C’est vraiment aujourd’hui la St. Jean. Le dîner à Chatenay ! Nous massacrons nos anniversaires. C'était aujourd’hui qu’il fallait venir à Versailles. Merci de la bonne journée d’hier. J'ai fait beaucoup de réflexion sur la nécessité absolu, quand on est chef du gouvernement, de tenir les partisans au courant de toute démarche ou ligne de conduite qui a de l'importance. L'exemple de Peel est frappant. Il n'aurait dû rien commencer, sans en prévenir ses amis. Il y a bien des dangers à leur causer de la surprise. Je parlerais longuement sur ce chapitre, j’en suis très préoccupée depuis hier. Quelles séances à la Chambre du commerce ! What a shame !
J’attends mon cuisinier et puis j’attends mon neveu ; avant tout cela j’attends un orage, car le temps est bien couvert. L'orage m’est égal en bonne compagnie. Seule, je ne l’aime pas du tout.
5 heures. L'orage n’est pas venu. Je me suis fait traînée en calèche. Seule là où j’étais hier avec vous ! La lettre de Brünnow à la Duchesse de Somerset a été insérée dans le journal de Hambourg. Je serai curieuse des commentaires ici si on en fait.
Rue St Florentin, 10 heures du soir. J’ai attendu votre lettre. Elle n’est point venue. à 7 3/4 je me suis mise en voyage. J’ai marché, j’ai roulé avec Constantin. J'ai été à Auteuil. J’ai vu des voitures. On m’a dit à votre porte qu'il y avait beaucoup de monde. Je n’ai pas osé vous faire sortir ; et n'ayant pas prévu ce contre-temps. Je n’avais pas de lettre à vous faire remettre. Je vous envoie ceci avant de me coucher. Stryboss va le remettre au foreign office. Adieu. Adieu. Je vous attendrai demain à midi ici. Adieu.
Val-Richer, le 16 septembre 1869, François Guizot à Louis Vitet
Mots-clés : Autoportrait, Circulation épistolaire, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1852-1870, Second Empire), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Analyse), Politique (France), Pratique politique, Réseau social et politique
15. Auteuil, Jeudi 15 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Voilà la guerre commencée au Maroc, bien commencée. M. le Prince de Joinville a attendu tant qu’il a pu. Il a pris, pour la sureté de M. Hay, toutes les précautions et donné tout le temps possible. Nos demandes étaient reduites au strict nécessaire. La réponse n’était pas acceptable. Le canon a dû intervenir. Il ne serait pas intervenu si l'Angleterre avait eu au Maroc, l'empire pour nous faire obtenir ce qu'elle-même trouvait juste et modéré. A défaut de son empire, il a fallu user de notre force. Le début est bon. J'attends les détails. Puis nous verrons. J'espère que les premiers coup suffiront. En tout cas, nous en avons d'autres à porter, & sans nous écarter de ce que j'ai dit. Nous ferons nos affaires en restant fidèles à notre politique. Je suis dans un moment grave et difficile ; mais je vous répète qu’il ne me déplaît pas.
La joie était vive hier soir à Neuilly. Joie paternelle et Royale. C’était l’anniversaire de la naissance du Prince de Joinville. Il a eu hier 26 ans, une fille, et la nouvelle d’un succès. J'ai dîné à côté de la Reine, très heureuse, mais trouvant trop d’émotions dans sa vie. La Princesse de Joinville est à merveille. Mad. la Duchesse d'Orléans était là, en gris et blanc, très bonne contenance, son fils à la main. J’irai causer avec elle un de ces jours.
2 heures
Vous partez donc décidément le 20 au plus tard. Vous serez donc à Paris le 22. Il est bien clair que tant que le Maroc sera ce qu'il est, je ne puis penser au Val-Richer. J’ai pourtant bien besoin de distraction, de mouvement physique. Je suis fatigué en me portant bien. Mon rhume ne s'en va que lentement. Il faut que je fasse provision de force pour la campagne prochaine, Elle sera rude. Les rivaux sont assez émoustillés. Je le comprends quoique je ne m'en inquiète pas.
Thiers a passé par Paris, allant à Dieppe où il sera dix ou douze jours me dit-on, et de là à Lille, Molé devait aller à Plombières. Il n’y va pas. Le temps est affreux et il a ici un procès qui le tracasse pour cette compagnie de chemin de fer dont il s'est retiré ostensiblement, mais où il reste intéressé. On peut préparer les intrigues de Janvier prochain ; mais intriguer à présent, il n'y a pas matière ni profit. Peu m'importe du reste. Ce qui m'importe, c’est que vous reveniez.
Vous aurez une lettre de M. Greterin pour la douane ; lettre générale, bonne pour tous les bureaux. Elle partira demain. C’est drôle que M. Tolstoy vous ramène.
J'ai de curieux détails sur Méhémet Ali, son cerveau me parait un peu dérangé. Il veut, il ne veut pas ; il résiste, il cède ; il pleure, il jure. Il fait venir un de ses fils ; il le renvoie, il en fait venir un autre, vieux et despote cela ne va pas ; pour être Pacha, il faut être jeune. Rien ne m'indique qu’on ait conspiré autour de lui ; loin de là, tout le monde continue d'avoir peur et d'adorer. On s'étonne de ne pas reconnaître l’idole, bien plus qu’on ne songe à la renverser. Bref, il est parti pour la Mecque. Il ne veut plus être que Hadji (pèlerin). S'arrêtera-t-il ? Reviendra-t-il sur ses pas ? Personne n'en sait rien. En attendant, son fils et son petit fils, et 36 de leurs camarades arrivent à Marseille en grande pompe pour venir achever leur éducation en France ; et le Pacha, qui part pour la Mecque fonde à Paris, pour eux, et pour leurs descendants, un établissement d’instruction publique, & nous fait demander, au Maréchal Soult et à moi, d'en choisir les chefs ! Adieu.
Je ne me promène, ni à pied, ni en calèche. Je travaille, je vous écris et je dors. J’ai tous les jours deux ou trois personnes à dîner, aujourd’hui Baudrand et sa femme, demain Broglie et son fils. C'est mon moment de conversation si tant est qu’il y ait pour moi une conversation autre qu'avec vous. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Chemin de fer, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Economie, Famille royale (France), Femme (maternité), Femme (santé), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Guerre, Ministère des affaires étrangères (France), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Maroc), Politique (Turquie), Portrait, Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (François), Vie quotidienne (François)
1844, Sarah Austin à François Guizot
Paris, 20 juin 1844, François Guizot à Sarah Austin
Claremont, le 27 mars 1863, Louis d'Orléans à François Guizot
Twickenham, ce 29 juin 1863, Henri d'Orléans à François Guizot
Château d'Eu, Mercredi 6 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Vous avez beau mépriser la musique instrumentale. Vous auriez été entrainée hier par un fragment d'une symphonie de Beethoven que les artistes du conservatoire ont exécutée, avec un ensemble, une précision, une vigueur et une finesse qui m'ont saisi, moi qui ne m’y connais pas et cette succession de si beaux accords, si nouveaux et si expressifs, étonne et remue profondément. Tout le monde, savants et ignorants, recevait la même impression que moi. Je craignais que ces deux soirées de musique n'ennuyassent la Reine. Il n’y a pas paru. Ce soir, le Vaudeville et Arnal. Nous avons trois pièces, mais nous n'en laisserons jouer que deux. Ce serait trop long. Avant le dîner, une petite promenade, au Tréport, toujours plein de monde, et toujours un excellent accueil. Avant la promenade, la visite de l’Eglise d’Eu qui est belle, et du caveau où sont les tombeaux des comtes d’Eu, les statues couchées sur le tombeau, les comtes d'un côté, leurs femmes de l'autre, et le caveau assez éclairé, par des bougies suspendues au plafond, pour qu’on vit bien tout, assez peu pour que l’aspect demeurât funèbre. Les Anglais sont très curieux de ces choses là. Ils s'arrêtaient à regarder les statues, à lire les inscriptions. Notre Reine et Mad. la Duchesse d'Orléans n'y ont pas tenu ; elles étaient là comme auprès du cercueil de Mrs. le Duc d'Orléans. Elles sont remontées précipitamment, seules, et la Protestante comme la Catholique sont tombées à genoux et en prières dans l’Eglise devant le premier Autel qu’elles ont rencontré. Nous les avons trouvées là, en remontant. Elles se sont levées, précipitamment aussi et la promenade, a continué.
J’ai eu hier encore une conversation d’une heure et demie avec Aberdeen. Excellente. Sur la Servie, sur l'Orient en Général et la Russie en Orient, sur Tahiti, sur le droit de visite, sur le traité de commerce. Nous reprendrons aujourd’hui l’Espagne pour nous bien résumer. Le droit de visite sera encore notre plus embarrassante affaire. " Il y a deux choses m’a-t-il dit, sur lesquelles notre pays n’est pas traitable, et moi pas aussi libre que je le souhaiterais, l'abolition de la traite et le Propagandisme protestant. Sur tout le reste, ne nous inquiétons, vous et moi, que de faire ce qui sera bon ; je me charge de faire approuver sur ces deux choses là, il y a de l’impossible en Angleterre, et bien des ménagements à garder. " Je lui demandais quelle était la force du parti des Saints dans les communes : " They are all Saints on these questions. " Je crois pourtant que nous parviendrons à nous entendre sur quelque chose. Il a aussi revu le Roi hier et ils sont tous deux très contents l’un de l'autre. La marée du matin sera demain à 10 heures. On pourra sortir du port de 10 h.
à midi.
Ce sera donc l'heure du départ, nous ramènerons la Reine à son bord comme nous avons été l’y chercher. Il fait toujours très beau. Je demande des chevaux pour demain soir, 9 heures. Je vous écrirai encore demain matin pour que vous sachiez tout jusqu’au dernier moment. Pas de santé de la Reine à dîner. Les toasts ne sont pas dans nos mœurs. Il faudrait porter aussi la santé du Roi, et celle de notre Reine, et peut-être pour compléter nos gracieusetés, celle du Prince Albert. Cela n'irait pas. Je ne me préoccupe point de ce qui se passe entre la Cité et Espartero. C'est ma nature, et ma volonté de faire peu d’attention aux incidents qui ne changeront pas le fond des choses. Lord Aberdeen, m'en a parlé le premier, pour me dire que ce n’était rien et blâmer positivement Peel d'avoir dit qu’Espartero était régent de jure. Il n’y a plus de régent de jure, m’a-t-il dit, quand il n’y a plus du tout de régent de facto. La régence n’est pas, comme la royauté, un caractère indélébile, un droit qu'on emporte partout avec soi. J’ai accepté son idée qui est juste son blâme de Peel sans le commenter, et son indifférence sur l'adresse de la Cité qui du reste est en effet bien peu de chose après la discussion et l’amendement qu’elle a subi.
Vous auriez ri de nous voir hier tous en revenant de la promenade, entrer dans le verger du Parc, le Roi et la Reine Victoria en tête, et nous arrêter devant des espaliers pour manger des pêches. On ne savait comment les peler. La Reine a mordu dedans, comme un enfant. Le Roi a tiré un couteau de sa poche : " Quand on a été, comme moi, un pauvre diable, on a un couteau dans sa poche. " Après les pêches, sont venues les poires et les noisettes. Les noisettes charmaient la Princesse de Joinville qui n’en avait jamais vu dans son pays. La Reine s'amuse parfaitement de tout cela. Lord Liverpool rit bruyamment. Lord Aberdeen sourit shyement. Et tout le monde est rentré au château de bonne humeur. Adieu. Adieu. J’oublie que j'ai des dépêches à annoter. Adieu pour ce moment.
Midi et demie
Nous venons de donner le grand cordon au Prince Albert, dans son cabinet. Le Roi. lui a fait un petit speech sur l’intimité de leurs familles, et des deux pays. Une fois le grand cordon passé : " Me voilà votre collègue, m'a-t-il dit en me prenant la main ; j’en suis charmé. " Je crois que la Jarretière ne tardera pas beaucoup. Je vous dirai pourquoi je le crois.
Le N° 7 est bien amusant. Pourquoi ne pas être un peu plus spirituel d'abord ? Cela dispenserait d'être si effronté après. Le pauvre Bresson a bon dos. Il n’a jamais voulu rien forcer, car il n’a jamais cru qu'on vînt. Je reçois à l’instant une lettre de lui. M. de Bunsen venait d’écrire à Berlin le voyage de la Reine comme certain. Bresson est ravi : " Il faut, me dit-il, avoir, comme moi, habité, respiré pendant longues années au milieu de tant d'étroites préventions de passions mesquines, et cependant ardentes, pour bien apprécier le service que vous avez rendu, et pour savoir combien vous déjouez de calculs, combien de triomphes vous changez en mécomptes. "
C'est le premier écho qui me revient. Je dirai aujourd’hui un mot de Bulwer. Soyez tranquille sur la mer. Nous ne ferons pas la moindre imprudence. Je me prévaudrais au besoin de la personne du Roi dont je réponds. Il n’y aura pas lieu. Le temps est très beau, l’air très calme. Le Prince Albert est allé nager ce matin avec nos Princes. Le Prince de Joinville reconduira la Reine jusqu'à Brighton et ne la quittera qu'après lui avoir vu mettre pied sur le sol anglais.
Voici ma plus impérieuse recommandation. Ne soyez pas souffrante. Que je vous trouve bon visage ; pas de jaune sous les yeux et aux coins de la bouche. Si vous saviez comme j'y regarde, et combien de fois en une heure ! Je n’arriverai Vendredi que bien après votre lever ; pas avant midi, si, comme je le présume, je ne pars qu'à 10 heures. Adieu. Adieu. Il faut pourtant vous quitter. Nous partons à deux heures pour une nouvelle et dernière promenade dans la forêt. Adieu. G.
Collections Musée Louis-Philippe du Château d'Eu
Eugène Isabey : Départ de la reine Victoria du Tréport
Huile sur toile, 1844

Mots-clés : Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Discours du for intérieur, Famille royale (Angleterre), Famille royale (France), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Mariages espagnols, Ministère des affaires étrangères (France), Musique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (Internationale), Portrait (Dorothée), Posture politique, Pratique politique, Réception (Guizot), Récit, Religion, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
12. Auteuil, Lundi 12 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Les petites lettres sont finies. Depuis jeudi, je vous en ai écrit de longues. Mais qu'est-ce que des lettres ? Voilà le Maroc fini, bien fini. On fait ce que nous voulons et l'Angleterre y a pris assez de part pour n’être pas blessée de sa nullité. Il faut veiller maintenant à l'exécution, qui aura bien ses embarras et me causera bien des impatiences. Mais je ne vois pas comment elle amènerait de nouvelles complications. Je vois, par ce que m’écrit Jarnac, que l’incident de Tunis a impatienté Lord Aberdeen. Cela leur déplaît de voir la France faire ainsi ; sur toute la côte septentrionale d'Afrique, acte d'autorité. Ils s’y accoutumeront. Je veux qu'ils comptent beaucoup sur mon bon sens et ma loyauté, mais qu'ils sachent bien aussi que dans ces limites, je fais rondement les affaires de mon pays. Le langage de Lord Palmerston sur mon compte m'a plu. Palmerston et Shiel comme Peel et Aberdeen, avec vous, je n'ai point de modestie. Je ne crains pas Tahiti comme évènement La guerre ne viendra pas de là. Mais il peut en venir bien des embarras de situation et de discussion. Vous avez toute raison ; il faut beaucoup penser à l’hiver prochain et à l'adresse. Ils y pensent aussi à Londres, pour leur propre compte et par les mêmes motifs. Le problème, c'est de concilier ces deux exigences. Sans doute, c’est une bonne fortune d'avoir là Jarnac. Je le sens tous les jours. Je vous répète que je crois avoir pris une bonne position et que je m'y tiendrai. Mais précisément parce qu'elle m'est bonne ici, elle leur est incommode à Londres. J'en prendrais plus aisément mon parti si je n’avais rien à leur demander. Mais le droit de visite ! Je ne puis oublier cette question là, qui viendra aussi dans l'adresse.
Vraiment, j'ai assez d'affaires. J‘ai pourtant le sentiment du repos ; hier et avant-hier, je ne suis pas allé à Paris. Je passe ma matinée dans mon Cabinet. Pas de chambres, pas de visites. Je peux lire et écrire. Toujours pas de petit duc de Penthièvre. Le Chancelier, Decazes, M. Barthe et l’amiral Rosamel (les deux témoins) grillent d’impatience. Rosamel avait pris sa dignité au tragique. Quand il a reçu sa lettre close de témoin, il s'est mis en uniforme et s'est enfermé chez lui attendant qu’on vint le chercher. Decazes a eu quelque peine à lui persuader qu’il pouvait en prendre un peu plus à l'aise, se remettre en frac et se promener dans Paris.
Montebello a failli mourir d’une angine ulcéreuse. Il est hors de danger. J’ai eu hier M. Villemain, à dîner avec ses trois petites filles. Il était charmé. De bonnes âmes s'appliquent à lui faire croire que je veux me défaire de lui et prendre M. Rossi à sa place. Il m’a quitté fort rassuré et content. Point d'inquiétude point d'ébranlement dans les personnes. Aucun changement que par une nécessité évidente, involontaire. Cela m'a réussi. Je continuerai. Adieu.
Je vais à Paris à 2 heures. Je vous dirai là un autre adieu. J’évite de passer dans la rue St Florentin. Il a fallu aller l'autre jour au Ministère de la Marine, par cette porte-là. J’en ai eu un vif déplaisir. M. de Nesselrode est à Londres. Les plus clairvoyants persistent à n'y voir qu'une tournée d’observation ordonnée avec affectation et exécutée sans plaisir. Lord Aberdeen comprend très bien qu’il n’y a plus d’entente ou de bon accord avec nous s'il y a un jeu caché ou séparé avec les autres, et on renarde comme certain que tout en acceptant les politesses qu'on lui fait, il ne se laissera entraîner à rien dont nous ayons à nous préoccuper.
Paris 4 heures
Rothschild me quitte. Il part ce soir pour Francfort. Je partirais volontiers avec lui, pas pour Francfort, ses lettres de Londres l'inquiètent. On est bien monté sur Tahiti. Gabriel Delessert m'en disait tout à l'heure autant. On n’est pas moins monté ici. Les plus sensés. Cependant, j’ai le sentiment qu’à tout prendre le flot baisse un peu. Je l’observe et l'attends. Adieu. Adieu. Etienne sort d’ici. Il m’apportait une sommation des contributions pour vous. Il n’avait pas assez d'argent pour payer. Je lui ai donné 150 fr. Adieu donc. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Maroc), Pratique politique, Réception (Guizot), Relations diplomatiques, Réseau académique, Réseau social et politique, Rossi, Pellegrino (1787-1848), Travail politique
Paris, le 15 décembre 1847, Hippolyte-Paul Jaÿr à François Guizot
Rome, le 28 mai 1846, Pellegrino Rossi à François Guizot
Mots-clés : Clergé, Diplomatie (France), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Grégoire XVI (1765-1846, pape), Louis-Philippe 1er (1773-1850), Ministère des affaires étrangères (France), Politique (France), Politique (Vatican), Pratique politique, Réception (Guizot), Réseau social et politique, Santé
[Genève], le 20 mars 1830, Pellegrino Rossi à François Guizot
3. Paris, Samedi 3 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Deux lignes seulement aujourd’hui. Je remettrai ce soir une plus longue lettre à Hennequin. Pas si longue pourtant que je le voudrais. Je suis écrasé. Le Maroc et Tahiti plus lourds que jamais. Mackan toujours malade. Duchâtel parti ce matin, nous resterons à peu près seuls, le Roi & moi. Les hostilités positives ont du commencer hier 2, par mer, contre le Maroc ; à moins d’une nouvelle réponse satisfaisante de l'Empereur à une nouvelle sommation qui lui a donné un délai de huit jours. Je ne crois pas à la réponse satisfaisante. Ainsi du canon. J’espère que nos français de Mogador et de toute la côte auront été mis en sureté, comme ceux de Tanger. Pas tous malheureusement. Adieu. Adieu.
Je suis charmé que votre voyage se passe bien. Adieu. G.
Rien de Pétersbourg.