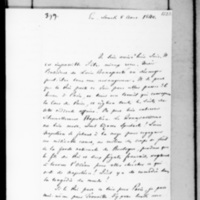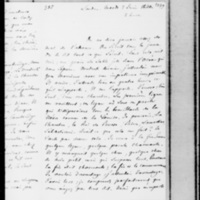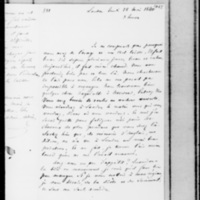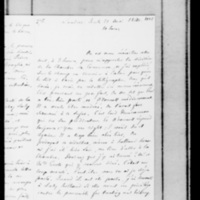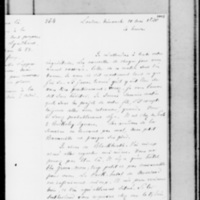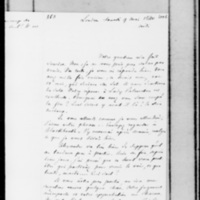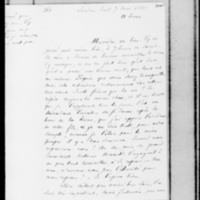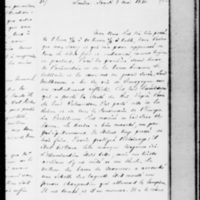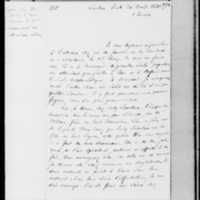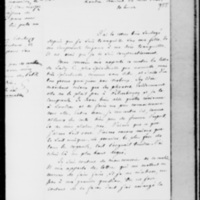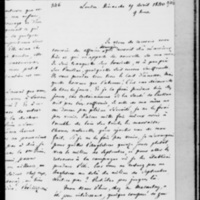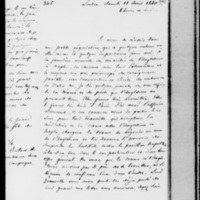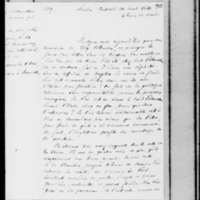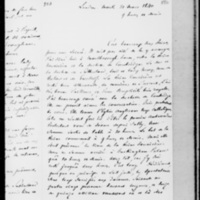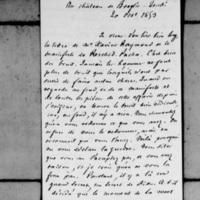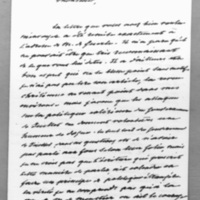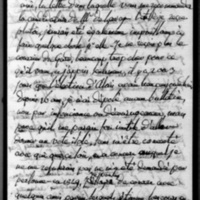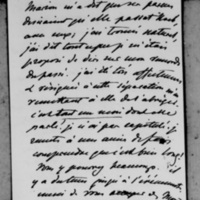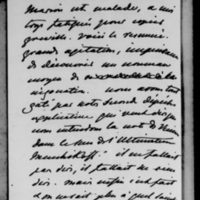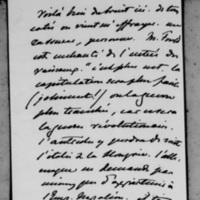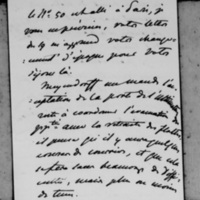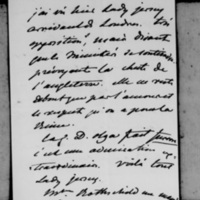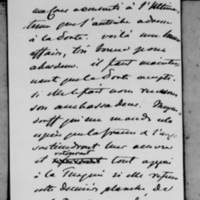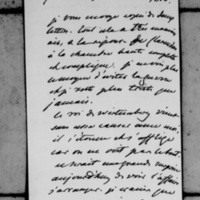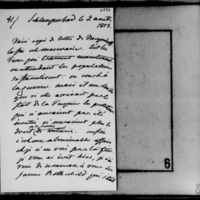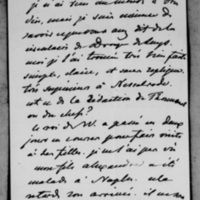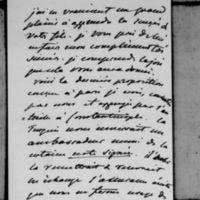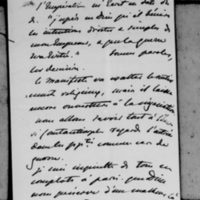Votre recherche dans le corpus : 324 résultats dans 3630 notices du site.
406. Londres, Mardi 8 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Je crois que c’est une habitude que je prends. Je me réveille à 6 heures et ne me rendors plus. Il fait un temps admirable. Je regarde les arbres de mon square. J’ai un souffle qui remue les feuilles. C’est bien ce qu’il vous faut ; vous êtes aussi délicate qu’une feuille. Point de vent qui vous agite et du soleil qui vous plaise ; je ne ferais pas mieux, si je faisais le temps. Le courrier que j’ai fait partir hier soir m’a dit que la marée était ce matin à 5 heures. Il ne comprenait pas pourquoi je le lui demandais. Vous ne passerez pas, je pense par cette marée là, vous attendrez la seconde. J’ai employé doucement ma soirée d’hier. Seul dans ma chambre, de 5 heures et demie à onze heures, j’ai classé vos lettres par année, par mois, par lieu de séjour, chaque mois dans une grande enveloppe.
A onze heures j’ai eu Charles Greville qui revenait de Holland-House où il avait dîné avec Bourqueney On y était fort agité, fort troublé, comme à la Bourse, comme partout dans Londres hier, c’est-à-dire partout où l’on pense à ce qui se passe. Napier devant Beyrouth, sommant les Egyptiens d’évacuer la Syrie, le 14 août, deux jours avant que Riffat Bey eût notifié à Alexandrie, au Pacha les propositions de la Porte cela paraissait monstrueux, et très alarmant. Les Rothschild étaient inquiets au dernier point, inquiets au point de contremander une partie de chasse qu’ils avaient arrangée pour ce matin, ne voulant pas s’éloigner aujourd’hui de Londres. Mais vous en saurez, sur tout cela, plus que je ne puis vous en mander. Vous aurez le haut du pavé sur moi pour les nouvelles. Elles passeront par vous pour venir à moi. Il me semble que les ouvriers s’apaisent un peu. J’y regarde bien plus attentivement depuis hier. En soi ce n’est rien ; mais, c’est bien assez pour vous agiter. Quand quelque chose de ce genre vous préoccupera, faites venir tout de suite Génie ; il vous dira exactement ce qui en est. Et pour peu que vous en ayez besoin ou envie, M. de Rémusat. S’il peut vous être bon à quelque chose, il en sera charmé.
Moi, je le suis qu’il n’y ait plus rien que de convenable entre vous et Paul. Son voyage à Paris consolidera et améliorera. Il s’y plaira près de vous. Faites avec lui comme il faut faire avec les hommes en général ; attendre peu, et demander moins qu’on n’attend. Quelque douceur rentrera, dans votre relation redevenue convenable.
2 heures
Malgré le retard de ma lettre, je suis bien aise que vous soyez partie ce matin, par ce beau temps. Vous partiez au moment où j’ouvrais ma fenêtre où je saluais le soleil pour vous. Vous êtes depuis longtemps à Boulogne, peut-être déjà repartie pour Paris. Je le voudrais. C’est que la mer ne vous aurait pas fatiguée. Ma pensée vous suit partout. Dieu est bien heureux. Il est toujours à côté de ceux qu’il aime. Je garde ma fleur de Stafford-House morte comme vive. Dimmanche soir, je l’ai serrée dans mon portefeuille, à côté d’un petit sachet noir qui contient autre chose, encore plus précieux qu’elle. Le lierre ira là aussi, quand j’aurai bien joui de ce qu’il m’a apporté. J’écris beaucoup ce matin. Si je puis sortir à temps vous aurez aujourd’hui votre chêne. Sinon demain. Il n’y a point de petit plaisir. Je viens de revoir les Rothschild toujours très inquiets de ce que leur oncle écrit de Paris. Pourtant la partie de chasse se reprend demain. Inquiet ou non, il faut que la vie aille, et qu’on s’amuse. J’attends avec impatience votre impression sur Paris. J’ai presque autant de confiance dans votre jugement que dans autre chose ; presque.
4 heures
J’ai parcouru Regent’s Park, les jardins clos au bout de Portland Place. Pas un chène, ni jeune, ni vieux. Enfin j’en ai trouvé un dans le Regent’s park du public. Voici sa feuille. un peu passée. L’automne approche. Les feuilles passent ; mais tout ne passe pas comme elles, quoiqu’on en dise. C’est la prétention vulgaire que ce qui est rare ne soit pas possible. Il y a un plaisir profond à lui donner un démenti. Adieu. J’ai bien peur de n’avoir rien demain. A présent, je vous veux à Paris, bien reposée. Adieu. Adieu. Infiniment.
405. Londres, Lundi 7 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Je ne puis pas me rendormir. Je vous écris de mon lit hier en rentrant chez moi, j’ai essayé de travailler. Je n’ai pas réussi. Votre billet m’est arrivé. Que j’aime Guillet ! J’avais envie de le remercier. J’ai encore essayé de travailler. Pas mieux. J’ai pris le parti de sortir, de marcher. J’ai marché deux heures un quart, dans Regent’s Park dedans, à travers, autour. Je me suis arrêté devant trois prédicateurs. L’un prêchait contre le libre arbitre de l’homme. Un autre lisait, dans je ne sais quel voyage, une histoire de Missionnaire pour prouver à ses auditeurs qu’il était plus sage et plus sain de ne boire que de l’eau. Je n’ai pu entendre le troisième. J’ai passé devant une petite porte de Regent’s Park, où est la statue du duc de Kent. Je me suis arrêté. Personne ne parlait là ; mais moi, j’entendais, des choses charmantes Je suis rentré à 6 heures un quart. J’étais las très las. Je me suis endormi dans mon fauteuil, en face de ma fenêtre. Quand je me suis réveillé, j’ai aperçu la lune devant moi, une petite lune claire et douce. Vous l’aurez vue aussi, entre Dartford et Rochester.
A 9 heures et demie j’ai été à Holland house où j’ai mené Bourqueney. Lady Holland est toujours souffrante. Je lui ai remis votre billet. Elle ne voulait pas croire que vous fussiez partie. Il a fallu le lui répéter. Peu de monde. Luttrel, Alava, Moncorvo, Neumann. J’ai demandé à lady Holland quel jour elle voulait venir dîner chez moi en petit comité. Elle craint que sa santé ne le lui permette pas. Ils iront à Brighton pour un peu d’air de mer, mais pas longtemps. Je doute qu’ils y aillent, et je crois qu’ils viendront dîner chez moi la semaine prochaine. J’y dine demain (chez eux) avec lord John Russell. Les nouvelles d’Alexandrie les ont fort troublés. Lady Holland prend le trouble fort au sérieux. Lord Holland dit que le Pacha commence à lui plaire. Il le trouve spirituel et fier. J’étais rentré à onze heures et demie Je suis charmé que votre fils soit venu. Je l’espérais à peine. Et qu’il ait été bien. Puisqu’il a commencé, il continuera. Vous retrouverez quelque chose. Demandez-lui peu. Ne le blessez pas et ne vous blessez pas. Que je voudrais que votre relation redevint convenable et douce.
3 heures
Merci de Rochester comme de Guillet, vous étiez fatiguée. Mais n’est-ce pas que cela ne vous fatigue pas de m’écrire. Il ne fait pas si beau qu’hier ; mais bien doux et pas de vent. J’épie le vent ; je lui parle ; je le prie de se taire. Que de choses je dis et que les paroles qui sortent des lèvres sont peu de chose auprès de celles qui y meurent ? J’ai été obligé de sortir un moment et j’ai manqué George d’Harcourt qui est arrivé hier et repart ce soir. La maladie de son oncle l’a fait venir. Il a causé avec Bourqueney. Il est très frappé de la légèreté des esprits d’ici, qui ne se doutent de rien et se réveilleront un matin tout surpris de trouver le monde en feu et d’apprendre qu’ils y ont eux-mêmes mis le feu pendant leur sommeil. Il y a bien des manières d’être léger. Si tout ceci tourne mal, ce sera la faute des hommes. Les choses ne se portent point d’elles-mêmes à une telle explosion. L’aveuglement et le mismanagement auront leur fait. C’est une de mes raisons d’espérer. J’ai peine à croire que les méprises humaines puissent faire, à ce point violence, à la pente naturelle des choses. G. d’Harcourt dit du reste que, s’il y avait guerre, l’unanimité serait grande en France et qu’on verrait quelle conduite tiendraient les Carlistes eux-mêmes. J’essaie de causer avec vous. J’ai été ce matin savoir des nouvelles de la Princesse Auguste, pour voir Stafford house. Elle était assez tranquille ; mais elle s’affaiblit beaucoup. Adieu. Est-ce vraiment adieu ? J’ai le cœur bien serré. Adieu. Adieu.
404. Du château de Windsor, Mardi 18 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
404 est le vrai numéro de ceci. J’ai refait ma chronologie. Rétablissez la vérité sur mes six dernières lettres de France. Elles sont comprises entre 397 et 404. J’arrive. Le Roi Léopold n’est pas encore rentré de la promenade. Je l’attends et je pense à autre chose. Je suis dans une grande et belle chambre en damas jaune, en face de la grande allée. Je soupçonne que c’est votre chambre. Je soupçonne qu’on me l’a donnée à dessein. J’ai envie de ne pas me tromper. Une alcôve en face de la cheminée, avec une grande glace au fond, recouverte par une tenture flottante. La grande fenêtre en face de la porte. Une petite fenêtre longue dans un enfoncement à côté de la cheminée. Une toilette dans la grande fenêtre. Trois commodes, secrétaires, & l’un en ébène, très doré ! Un joli petit cabinet de toilette à côté. Ai-je raison ? Je suis venu en deux heures. J’ai dormi une heure ; dormi et rêvé. Éveillé l’autre heure en pensant comme j’avais rêvé. Une pensée unique et immuable dans une vie animée et variée.
Que d’espace j’ai parcouru, que de choses j’ai vues, et dites et faites depuis quinze jours ! Deux grands pays, deux châteaux royaux, trois rois dont une reine, la paix ou la guerre en Europe et en Asie. Et tout cela, c’est la surface. Il y a tout autre chose, au fond, une seule chose?
Mercredi 19 août. Midi. J’ai vu deux fois le Roi Léopold hier à 7 heures et tout à l’heure. Je suis content de ma conversation. J’espère qu’il m’aidera bien. Il comprend très bien la situation de la France. Il a plus d’esprit dans les grandes choses que dans les petites. Il devait partir demain 20 ; mais, il restera jusqu’à samedi 28 et plus longtemps s’il le faut. Je le laisse parler et agir. Je lui ai bien expliqué que mon attitude à moi, C’était l’attente, l’attente froide et tranquille. Nous sommes en dehors. Nous restons en dehors, jusqu’à ce qu’en dedans on sente et on nous dise qu’on a besoin de nous. Je ne change donc rien à mes premiers projets. Je retourne à Londres demain matin. L’affaire d’étiquette s’est passée hier comme nous l’avions prévue. On a coupé le différend par la moitié. J’ai donné le bras à la Princesse de Hohenlohe et je me suis placé à la gauche de la Reine, qui avait le Roi, Léopold à sa droite. Le Prince de Hohenlohe qui avait passé avant moi donnant le bras à la duchesse de Kent, était au dessous de moi à table. Mais au retour, j’ai repris la moitié que je n’avais pas eue en allant. Il n’y avait point de femme, personne ne donnait le bras à personne. Je me suis arrêté à la porte de sa salle à manger pour me faire présenter au Prince de Hohenlohe qui y arrivait en même temps que moi, et la présentation faite, j’ai passé devant lui en rentrant dans le salon. J’en ai fait autant en passant d’un salon dans l’autre. Ainse j’ai exercé tout mon droit. A dîner la Reine et la famille royale ont été, pour moi, particulièrement aimables. A glass of wine avec le prince Albert, le roi Léopold et la Reine elle-même, d’une façon marquée. Lord Melbourne et Lord Palmerston comme à l’ordinaire. Lady Palmerston gracieuse avec empressement ; tout à l’heure à déjeuner, elle se désolait du mauvais temps ; elle s’était promis de me faire faire une jolie promenade de me montrer Virginia-water.
- Mais le temps se lèvera, certainement il se levera.
- Prenez garde, Mylady ; je prends les promesses au sérieux. Lord Palmerston intervient, de l’autre côté de la table.
- Je donne ma garantie ; je suis sûr qu’il fera beau. Je me retourne vers sa femme.
- Lord Palmerston est bien heureux ; il est sûr avant. Moi, je ne le suis qu’après.
Adieu. J’attends Herbet, dans trois quarts d’heure. Je vous redirai adieu.
P. S. Voilà votre lettre. Je ne réponds à rien qu’à Adieu. A demain, entre midi et une heure.
401. Trouville, Lundi 10 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Je ne devrais plus vous écrire. Cette lettre-ci sera à Londres, Vendredi. Vous n’y serez pas. Et quand vous y serez, j’y serai. N’importe. Je vous écris. Je viens de recevoir votre lettre 409. J’ai oublié de numéroter les miennes. Il me semble que ceci doit être 405. Il y a trois jours, je ne me résignais pas aux lettres. Aujourd’hui une lettre vient de me charmer. Il fait très chaud, très beau. J’irai tout à l’heure promener ma mère et mes enfants, dans la forêt de Touques ; ma mère en calèche, mes enfants, sur des ânes. Ils sont bien heureux. Je les ai menés à la mer ce matin ; ils se sont baignés devant moi. Mad. de Meulan vient d’arriver. Elle retournera au Val-Richer demain. Ma mère et mes enfants samedi 15.
J’ai déjà parlé à Eu de mon congé en octobre. J’y compte. Toujours subordonné à l’état de cette malheureuse question d’Orient. Mais ou je me trompe fort ou elle sera immobile à cette époque. Le blocus durera sans aboutir. C’est, je vous jure un curieux spectacle que la complète opposition des conjectures sur le Pacha, les uns si sûrs qu’il cédera, les autres qu’il ne cédera pas. Très sincèrement sûrs. Il y a de quoi prendre en grande pitié les convictions diplomatiques. L’erreur sur l’insurrection de Syrie a été grossière ; elle n’a pas été un moment sérieuse, et Lord Alvanley est un badaud. Lord Francis Egerton a donné aux insurgés trois canons rouillés, et 800 fusils hors de service ; par ardeur chrétienne et pour affranchir les frontières de la Terre Sainte. Il n’y a eu personne pour se servir de ses fusils. Méhémet en profiterait s’ils étaient bons à quelque chose. Les Carlistes aussi ont eu la main dans l’insurrection ; par Catholicisme et par Carlisme. Tout cela a abouti à élever un nuage de poussière que Lord Palmerston a pris, pour un orage. De son erreur je conclus qu’il se trompe probablement sur Alexandrie comme sur Beyrout. M. Thiers est infiniment plus sceptique, plus modeste. Pourtant il ne doute pas de la résistance obstinée du Pacha.
Conseillez à Lady Clauricarde de retirer sa joie sur Louis Bonaparte. Elle a des joies un peu légères. Voilà les obsèques de Napoléon accomplies, tranquillement accomplies. Le Roi, ses ministres, le public, tout le monde est charmé. Le Bonapartiosme est tombé plus bas que l’insurrection de Syrie, le pauvre Louis Bonaparte ne voulait pas se coucher dans le château de Boulogne parce qu’il n’avait pas son valet de chambre pour le déshabiller. Et jeudi dernier, quand on l’a retiré de l’eau et conduit en prison, comme il ne voulait pas poser sur la pierre froide ses pieds nus (il venait d’ôter ses bas) un des gardes nationaux qui venaient de lui tirer des coups de fusil, l’a pris dans ses bras, et l’a porté sur son lit.
Vous avez bien fait de m’envoyer la lettre du duc de Poix. Il n’y a en effet rien à faire à présent. On a fait quelque objection à son fils, très haut. Cette nouvelle vilenie de Pétersbourg (pardonnez-le moi) m’a indigné comme si elle m’avait surpris. Je croyois que nous avions atteint le terme. Vous n’avez sans doute plus rien entendu dire de la prochaine arrivée. Vous m’en parleriez. Mais j’oublie que vous m’avez écrit vendredi, vingt, heures après m’avoir vu. Les heures sont bien longues.
Adieu. Ceci est pourtant ma dernière lettre. Mais non pas mon dernier adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Vie familiale (François)
400. Trouville, Dimanche 9 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Ce qui est vrai, c’est qu’à tout prendre je suis content de ce que j’ai vu à Eu, des deux partis. J’ai vu, d’une part de la révolution, de l’autre, de la modération. Les penchants, les désirs au fond ne sont pas, les mêmes ; mais les conduites pourront fort bien s’accorder. On travaillera sincèrement à maintenir la paix ; on fera hardiment la guerre si l’occasion l’exige. Et on prévoit des occasions qui pourraient l’exiger. On ne provoquera point ; on ne commencera point. Mais on n’éludera point. Le pays est dans la même disposition ; nulle envie de la guerre, tant s’en faut ; mais un grand parti pris de ne pas accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyiez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs. J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous accepter tel ou tel dégoût et d’accepter les sacrifices. C’est une démocratie fière sans exaltation et résigner à souffrir plutôt qu’ambitieuse et confiante. Vous verrez cette physionomie passer même dans la presse, malgré ses fanfaronnades, et ses colères. Je ne fais qu’entrevoir mon pays ; mais ce que j’en entrevois me convient. J’espère qu’il ne sera pas mis à de trop dures épreuves. Je crois qu’il s’y ferait honneur. Lord Palmerston m’a dit souvent : « Je ne comprends pas que vous ne soyez pas de mon avis. On me dit ici la même chose à son égard. Il y a bien peu d’esprits qui se comprennent les uns les autres. Chacun s’enferme dans son avis comme dans une prison, et agit du fond de cette prison-là. Cette complète préoccupation de son propre sens joue dans les affaires un infiniment plus grand rôle qu’on ne croit. Voici ce que je n’ai pas entendu, mais ce qui m’a été répété bien authentiquement : - " Que deviendrais-je aujourd’hui si j’avais Molé pour ministre ? " Louis Bonaparte, et son monde vont être traduits à la cour des Pairs.
J’ai peur que ceci ne vous arrive pas avant jeudi. Je suis hors des grandes routes. Vous serez déjà à la campagne. Je vous écrirai encore 400 demain, à tout hasard. Samedi, en revenant de West, vous trouverez une lettre et moi. Adieu. J’aspire à demain. Trois jours sans un signe de vie ! Cela m’est-il jamais arrivé ? Adieu Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Famille Guizot, Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Portrait
399. Eu, Samedi 8 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis arrivé hier au soir. Il est impossible d’être mieux reçu. Mais l’incident de Louis Bonaparte va déranger peut-être tous mes arrangements. Il se peut que le Roi, parte ce soir pour aller passer 36 heures à Paris, et tenir un Conseil qui convoquera la cour des Pairs, et règlera toutes les suites de cette ridicule affaire. On peut bien enterrer solennellement Napoléon. Le Bonapartisme est bien mort. Quel bizarre spectacle ! Louis-Napoléon se jetant à la nage pour regagner un misérable canot, au milieu des coups de fusil de la garde nationale de Boulogne, pendant que le fils du Roi et deux frégates françaises voguent à travers l’Océan, pour aller chercher ce qui reste de Napolèon ! Qu’il y a de comédie dans la tragédie du monde ? Si le Roi part ce soir pour Paris, je pars moi-même pour Trouville. J’y passe Lundi avec mes enfants, et je reviens ici, mardi soir pour y passer le Mercedi et me remettre le jeudi en route, pour Londres où j’arriverai toujours vendredi.
J’emploie tout ce que j’ai d’esprit pour que rien ne dérange ce dernier terme qui est mon point fixe. C’est bien bon et bien doux d’avoir un point fixe dans la vie, un point où l’on revient toujours, et où l’on ramène tout. Il y a des biens (j’ai tort de dire des) qu’on n’achète jamais trop cher. Je vis tout le jour, je pourrais dire la nuit avec M. Thiers. Nos appartements se tiennent ; nos chambres à coucher se touchent. Il a ouvert ma porte ce matin à 6 heures à moitié habillé, pour me trouver encore dans mon lit et presque endormi. Nous nous sommes promenés ensemble de 7 heures à 9. Puis, dans le cabinet du Roi, à déjeuner, sur la terrasse après-déjeuner, toujours ensemble jusqu’à midi et demi, heure où je vous écris. L’estafette part à une heure. Je les trouve tous très animés et très calmes, en grande confiance, sur l’avenir, convaincus qu’on s’est fort trompé dans ce qu’on a fait et qu’on le verra bientôt. Le Pacha ne cédera point, et ne fera point de folie. La coërcition maritime ne signifiera rien. La coërcition par terre, ne s’entreprendra pas. Le Roi et son Cabinet, sont très unis. On n’exagère rien dans ce qu’on dit de l’animation du pays. Adieu. J’ai tout juste le temps, de vous dire adieu, ce qui est bien court, trop court, infiniment trop court.
Je m’aperçois que j’ai oublié de vous dire que le Roi reviendrait de Paris à Eu mardi avec M. Thiers. C’est ce qui me fera répasser par Eu. Adieu. Depuis avant-hier je n'ai rien vu, rien entendu de vous. Encore Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Histoire (France), Louis-Philippe 1er, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Turquie)
391. Londres, Mardi 9 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
A mon tour, j’ai une lettre bien courte ce matin. Mais je ne m’en plains pas. Je ne me plaindrai de rien cette semaine, ni la semaine prochaine, à moins que je ne me plaigne de vous ce qui ne sera pas. Je voudrais bien vous trouver quelqu’un pour vous accompagner. Pour calmer votre imagination sur du danger, il n’y en a point ; et la fatigue, un compagnon ne vous l’épargnerait pas. J’espère qu’elle ne sera pas grande. Le temps est beau. Quel dommage que je ne puisse pas aller vous prendre à Boulogne ? Ce serait si facile, si ce n’était pas impossible ? J’ai peine à voir d’où viennent vos pronostics de guerre. Je ne m’attends pas à ce qu’on fasse grand chose ici sur l’Orient. Et quand même on ferait quelque chose, je ne crois pas que la guerre en sortît. Je vous attends pour causer de cela, comme de tout. Quand nous pourrons causer que nous mépriserons ce qui s’écrit. Pendant qu’on hésite en Occident, Méhêmet Ali s’affermit et s’anime en Orient. Il agit partout où il y a des Musulmans ; il les rallie, il les échauffe. Il gagne chaque jour plus de crédit à Constantinople. Si on le pousse à bout nous aurons quelque étrange spectacle. C’est là du moins ce que promettent les apparences. Mais j’ai appris à me méfier des apparences et des promesses. Que la part de la charlatanerie est immense en ce monde ! Il y en a moins ici qu’ailleurs, et pourtant le humbug est grand ici !
Le Prince Esterhazy n’arrive pas. On dit qu’il ne se soucie pas de venir tant que l’affaire d’Orient durera. Et M. de Metternich non plus n’est pas pressé qu’il vienne. Il trouve que Neumann convient mieux à l’insignifiance, et à la tergiversation. Je n’ai point de nouvelles. On est encore aujourd’hui en vacances. Lord Palmerston ne revient que demain de Broadlands.
Le bruit court de nouveau que lady Palmerston est grosse ; bruit très général. On en parlait hier chez les Berry comme d’une chose que tout le monde savait. Il y avait hier chez les Berry, cette grande Miss Trotter qui a failli épouser M. de la Rochéfoucauld et qui ne l’a pas épousé parce qu’il n’a pas voulu lui permettre une femme de chambre protestante. Vrai type anglais grande, blonde, riche, belle avec de grands et gros traits, teint éclatant et sans finesse ; avide d’esprit, prompte à l’enthousiasme ; quelque chose de très sincère, et de très factice, l’air noble sans rien de distingué. En revenant de chez les Berry, j’ai passé un quart d’heure chez lady Jersey qui avait un petit rout. J’y ai vu vingt Miss Troller.
Dites-moi donc ce qui en est de Stafford house, et si on le met réellement à votre disposition. Je le voudrais bien pour que vous n’eussiez, point d’embarras. J’aime bien vos idées d’arrangement. Out pour tout le monde à des heures déterminées. Ne trouvez vous pas que, dans la jeunesse on aime l’imprévu et, quand on n’est plus jeune, le réglé ? Il y aura bien aussi de l’imprévu, et qui sera charmant. Mais le réglé fera le fond. de la vie. Je reçois ce matin une invitation du marquis de Hertford pour dîner à sa villa de Regent’s Park, qui paraît très jolie. Connaissez-vous beaucoup le marquis de Hertford ? Vous devriez dîner là. Adieu.
Je vous quitte pour écrire des dépêches. J’envoie un courrier ce soir. Il me semble que cette manie de voyage de la Reine d’Espagne fait assez de bruit. Le mouvement des journaux est vif pour envoyer M. de la Redorte à Madrid ! Ils montent à l’assaut. On me dit qu’il est bien trist’ le pauvre M. de la Redorte. Il ne se trouve pas tout le crèdit qu’il se croyait. Adieu. Adieu.
390. Londres, Dimanche 7 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je vous écris avec une pensée charmante, dans le cœur. Plus que trois fois. demain, mardi et mercredi. Car sans doute vous partirez samedi matin. Vous me direz. Ma course à Epsom ne m’a pas paru si drôle qu’à lord Granville. J’ai peu ri. Ce qui me fait sourire, c’est l’importance qu’on attache quelquefois, dans le monde, à certaines choses, et tout ce qu’on y voit. J’ai été à Epsom. Epsoms est frivole. Tous les gens frivoles y vont. Donc, je deviens frivole, donc, je ferai ce que font, les gens frivoles. Donc, donc, .... Il y a bien du factice et bien de la servilité en cela d’agir plus simplement et plus librement. On me dit qu’Epsom est un spectacle curieux. Ellice me propose d’aller dîner à la campagne, tout près, avec sa famille et lord Spencer, et d’aller de là, voir ce spectacle. Je vais dîner avec Ellice et lord Spencer. Je vais avec eux me promener à Epsom. Je trouve que c’est long, et je reviens me coucher à onze heures. Si le monde voit dans ma promenade quelque chose de plus, et s’en promet, sur moi quelque empire de plus, le monde se trompe et le verra bien. Epsom m’a laissé comme il m’a pris, sans embarras d’y aller et sans envie d’y retourner.
Je vous en prie ; ne soyez pas un peu malade, dans vos lettres ni ailleurs, pour ces misères. Ayez foi. Vraiment ceci ne vaut pas la peine de douter. Et dites moi toujours tout à chaque occasion, petite ou grande, je vous en aime davantage. Même quand ce que vous me dîtes, me fait sourire.
J’ai beaucoup causé hier avec la Reine, à dîner surtout, causé de je ne sais quoi mais assez agréablement. Soyez sure qu’elle a de l’esprit, et pas mal de sérieux et de fermeté dans son jeune esprit. Elle est bien jeune. Elle rit toujours. Et on voit qu’elle a envie de rire encore plus qu’elle ne rit. Peu de monde, lord Melbourne et lord Palmerston, le Maréchal Saldanha, le comte de Hartig, M. et Mad. Van de Weyer qui sont revenus de Bruxelles, la maison. J’avais à ma droite lady Mary Howard, fille du comte de Surrey, enfoncée dans sa shyness et ses beaux cheveux blonds. Après le dîner, quelques uns ont joué au Whist, d’autres aux échecs. Nous nous sommes assis, autour d’une table. Conversation froide et languissante. La Reine va à Windsor, dans deux ou trois jours, je crois. La Duchesse de Sutherland est partie ; mais Charles Greville m’a dit qu’elle vous donnait Stafford-House, et que vous seriez là, en son absence. Cela me paraît très bien. Vous ne le saviez donc pas encore. Vous me l’auriez dit.
6 heures
Je viens de faire le tour complet de Regent’s park. J’ai marché une heure et demie, seul, lentement, pensant à vous. Quand vous serez ici, je ne ferai plus guère ces grandes promenades solitaires. Je vous donnerai mon loisir. Le beau temps dure. Je le regarde. Je lui demande, s’il durera dans huit jours. Alava a été assez malade. Il est bien bon enfant et pas mal au courant ; mais personne ne compte avec lui. Est-il vrai que M. Van de Weyer est un peu remuant et commère ? Que de choses j’ai encore à vous demander, quoique je commence à être établi ! N’est-ce pas, vous aurez la bonté avant de partir, de faire demander à Génie s’il n’a rien à m’envoyer. Décidément, il y aurait, à ce qu’il vint dans ce moment, assez d’inconvénients.
Lundi une heure
Je suis charmé que nous ne veniez à Londres qu’à cause de moi, et je veux que vous y trouviez infiniment plus de plaisir que de tracas. Je n’aime pas du tout le tracas. J’ose dire qu’il n’y a personne à la nature de qui il soit plus antipathique qu’à la mienne. Mais quand au bout du tracas, il y a un plaisir, un vrai plaisir, le tracas disparaît, je l’oublie absolument, je le traverse indifféremment. C’est si beau d’être heureux ! Si charmant ! Peu importe le prix du bonheur. Vous n’êtes pas si bien douce que moi. Vous avez le bonheur, très vif, mais la contrariété très-vive aussi, et au moment ou vous payez le bonheur, vous pensez à ce qu’il coûte. Moi, je ne pense jamais qu’à ce qu’il vaut. On m’a apporté hier le petit portrait d’Henriette, très ressemblant et très joli. Je viens de recevoir des nouvelles de leur arrivée à Lisieux. Les voilà établis à la campagne. J’espère qu’ils y seront bien. Vers le 15 suillet. ils iront aux bains de mer, à Trouville sur cette côté où je me suis promené en m’efforçant de traverser des yeux l’Océan pour alles vous chercher en Angleterre où vous étiez alors. C’est moi qui suis en Angleterre, et c’est vous qui venez m’y chercher. Mais pas des yeux seulement.
Adieu. Cet adieu est très à sa place.
Je ne crois pas à la guerre. Vous savez qu’en général je n’y crois pas. Mais pas en particulier non plus. Thiers s’amuse à en parler. cela lui plaît ; et cela lui sert aussi. Un peu de fièvre dans le présent, en perspective d’un peu de bruit dans l’avenir ; sa position s’arrange de cela. Il le croit du moins. Je ne connais personne ici qui accepte la pensée de la guerre. On est déjà assez préoccupé de celle de Chine qui sera probablement plus sérieuse qu’on n’a prévu. Je n’ai pas grande estime pour le nombre ; pourtant c’est quelque chose et en Chine ce quelque chose est immense. Adieu décidément. Plus que deux lettres. Adieu. Adieu. En attendant.
385. Londres, Mardi 2 juin 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
2 heures
On ne dira jamais assez de mal de l’absence. On s’écrit tous les jours. On se dit tout ce qui s’écrit. Tout cela n’est rien ; un grain de sable jeté dans l’océan qui nous sépare. Vendredi dernier, j’attendais mon gros Monsieur avec une impatience inexprimable. Il arrive. J’attends trois ou quatre heures ce qu’il m’apporte. Il me l’apporte. J’ouvre, bien seul, dans ma chambre. Les premières lignes me ravissent ; ces lignes où sont ces paroles qui dissiperaient tous les brouillards de la Néva comme de la Tamise. Je poursuis. La Chambre, le Rois de Prusse, Thiers, Lamartine, Sébastiani. Qu’est-ce que cela me fait ? Je saute par dessus cela. Je cours à la fin. Encore quelques lignes, quelques paroles charmantes. Il y manquait quelque chose, quelque chose de bien petit mais qui surpasse tout. Pourtant. la fin était charmante ; la fin et le commencement. Je voulais d’avantage ; j’attendais davantage. J’avais tort ; je comprends parfaitement que vous n’ayez pas tout dit. Mais que m’importe ce que je comprends à côté de ce que je désire ? Je vous réponds, au moment même. Je ne vous dis pas ce qui m’a manqué ; non, j’aurais cru être injuste; je ne vous reprochais rien. Mais je ne vous dis pas non plus ce qui m’a charmé. Je vous réponds avec mon impression, pas triste, mais pas transporté ; pas mécontent mais pas satisfait. Ma reponse vous arrive. Vous aussi, vous trouvez qu’il vous manque quelque chose. Et vous avez raison, encore plus raison que moi ; car moi, j’avais trouvé quelque chose de charmant. Vous vous plaignez de ce qui manque ; je vous remercie de votre plainte ; elle m’enchante. Mais du regret de vos paroles, de celles qui m’ont charmé ! Non, non, je ne vous le permets pas ; si j’ai eu tort, vous n’avez pas le droit de vous plaindre de mon tort. Vous plaindrez vous que je ne sois jamais satisfait, qu’il me faille toujours plus, toujours tout ? Moi, je me plains d’une chose, c’est que vous n’ayez pas deviné tout ce que je vous dis là. Mais je ne me plains pas bien fort, car vous êtes charmante ; je vous aime et vous allez venir. savez, vous ce que cela prouve ? C’est qu’à cent lieues l’un de l’autre, l’océan entre nous rien ne nous échappe, rien n’est inaperçu ; nous voyons tout ce qu’il y a ; tout ce qu’il n’y a pas, comme si nous nous voyions, si nous nous parlions. On s’aime beaucoup quand on en est là; et quand on s’aime beaucoup, on a tort d’être séparés.
C’est bien pour le 13. A présent le départ est sûr. Un beau temps et pas beaucoup de fatigue le premier jour pour que l’arrivée le soit aussi. Hier, le temps était admirable. Ce matin un orage. Je viens de faire quelques visites par la pluie. Le soleil revient. J’en suis bien aise pour demain, pour le peuple qui va à Epsom. C’est Ellice qui m’y fait aller. Je n’y pensais pas. Je ne suis pas fâché de voir cela une fois. Nous dinons dans une petite maison de M. Metteux, près d’Epsom. M. Motteux n’y est pas et lord spencer y vient. Il a désiré dîner là avec moi. Nous dînerons à nous trois Lord Spencer, Ellice et moi, plus un quatrième curieux que je ne connais pas et dont j’ai oublié, le nom.
Lady Normanby a donné hier à la Reine, un concert de famille. En fait d’artistes Rubini et Lablache seuls. En fait d’amateurs, lady Barrington, lady Williamson et lady Hardwicke. C’était beaucoup mieux que mon attente. Lady Williamson a une belle voix infatigable et Lady Hardwicke une voix très expressive. Pas beaucoup de monde, très choisi. La Reine ne s’en est allée qu’après la dernière note, à une heure et demie. Je viens de chez le duc de Cambridge. Mon dîner Tory est dérangé et rarrangé. Le vendredi, 12 juin, il y a un grand débat à la Chambre des lords sur les corporations municipales d’Irlande. Le duc de Wellington, lord Lyndhurst, lord Aberdeen, lord Ellenborough & & ne pourraient probablement pas venir dîner. Il a fallu trouver un nouveau jour. Presque tous étaient pris. La Duchesse de Cambridge y a mis beaucoup de bonne grâce. Enfin c’est pour le vendredi 26 juin. Je vais désinviter et rinviter tout le monde. Vous serez à Londres ce jour-là ? Serez vous chez moi à dîner ? Ce que vous voudrez comme de raison. Je le voudrais bien et il me semble que ce serait fort naturel. Ce sont tous vos amis.
La mort du Roi de Prusse est en suspens. M. de Bülow n’a rien reçu. Je ne crois pas que Paris et Pétersbourg en soient beaucoup plus près. D’ailleurs il n’y a plus de pièces de porcelaine ; tout est balles de coton. Lisez; je vous en prie attentivement le petit débat d’hier soir aux Communes sur les affaires d’orient et dites-moi si Lord Palmerston vous fait l’effet d’un peu d’embarras et d’un léger mouvement de retraite. Il y a au moins le désir et le dessein de rester très bien avec la France quand même on s’en séparerait en Orient. La question va traverser dans quelques jours une petite bouffée de flamme. Mon instinct est que la souscription Bonapartiste échouera. C’était bien la peine de faire tant de bruit. L’affaire avait grand air en passant le détroit. Soyez sure qu’il y a les deux choses, l’étourderie et la prémédi tation. Je suis de votre avis sur les funérailles. Adieu. Mille adieux en retour du pauvre petit adieu qui est tout seul dans la dernière page du 390, ce qui prouve que vous aviez encore en finissant quelque regret des douces paroles que j’ai trouvées si charmantes et si courtes. Plus de regret et beaucoup plus d’adieux. Adieu.
384. Londres, Dimanche 31 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure et demie
Le voilà ce prétendu 388 qui est le 387. Où est-il allé ? Qui l’a arrêté en route? Je n’en sais rien. Je n’y comprends rien. Enfin le voilà, avec le vrai 388. J’ai passé une très mauvaise journée. J’avais l’imagination très noire. J’ai promèné mon mal partout, chez Lady Kinnout à Holland-House, chez Lady Jersey. Vous m’avez suivie partout, malade, mourante, je ne sais quoi. En rentrant, j’ai monté l’escalier quatre à quatre ; j’ai regardé sur ma table, s’il n’y avait pas une lettre quelque oubli de la poste, quelque voyageur. En ne voyant, rien, j’ai eu un mécompte comme si j’avais attendu quelque chose. Par moments, des moments bien courts, je m’en voulais de tant d’anxiète que les spectateurs, s’il y en avait eu, auraient à coup sûr, appelée tant de faiblesse. Ah, que les spectateurs sont sots ! Pour comprendre le chagrin, il faut sentir l’affection ; et l’affection, le chagrin, tout cela est personnel ; on ne le sent que pour soi-même. On passerait pour fou si on laissait entrevoir la millième partie de ces suppositions, de ces émotions innombrables, ingouvernables, qui obsèdent le cœur.
Il y avait dans la lettre du gros Monsieur, 386 une phrase dont je ne pouvais me délivrer : " Je me sens si malade ? " Je lisais cela partout, dans les yeux de mes voisins, dans les journaux du soir. Je n’y veux plus penser. Non, je ne veux pas vous faire courir la poste comme un courrier, ni vous forcer à traverser un jour de gros temps. Mais voulez-vous bien sérieusement que je ne sois pas trop impatient pour le 15 ? Voyons dites ; voulez-vous ? Convenez que j’ai un bon caractère. Rappelez- vous vos colères, vos reproches quand j’ai tardé d’un jour, quand je n’ai pas été parfaitement sûr. J’ai bien envie, pour me venger, de vous conter toutes les coquetteries que m’a faites hier Lady Kinnoul. Je voudrais bien savoir de quel droit lady Kinnoul me fait des coquetteries. Mais droit ou non, elles étaient bien coquettes.
Lord & lady Hatherton, lord et lady Manvers, lord et lady Cadogan, lord et lady Poltiemore, lord Liverpool, M. Leshington. Voilà le dîner. Personne, le soir à Holland house, Si ce n’est au bout de la bibliothèque, lady Essex, l’actrice Miss Stephens, assise au piano et chantant très agréablement pour Lord Holland et M. Allen. 3 heures J’ai été interrompu par la visite de Chekib. Effendi. Celui-là est intelligent. Il est pressant. aussi. Il a raison. Son Empire s’en va. Et si on fait naître là une guerre, quelle qu’elle soit il s’en ira encore plus vite. L’immobilité de l’Orient, l’accord général de l’Occident, à ces deux conditions la Porte peut encore durer. Si l’une ou l’autre manqur, si nous nous divisons ici et si on se bat en Asie, c’est le commencement du grand inconnu. Je dis cela beaucoup, et tout le monde est de mon avis, presque tout le monde. Mais les avis sont peu de chose ; c’est la volonté qui fait.
Ce cabinet-ci est dans une situation bien critique pour élever dans ses chambres et dans le monde, une si grande question. Et je doute que sa situation critique soit de celles dont en sort en élevant une grande question. Je ne crois pas qu’il y ait à s’abstenir définitivement, beaucoup de jugement, ni de prévoyance. Et j’attendrais sans beaucoup de crainte la démonstration des évènements. Votre conversation avecT hiers est charmante. Je suis quelque fois tené de croire qu’il est embarrassé et se déchargerait volontiers de son embarras, pour un temps, sur les épaules d’autrui. Nous verrons jusqu’à quel point la fécondité de l’esprit, la dextérité de la conduite et le talent de la parole suffisent au gouvernemen t! En attendant, il est absurde de se plaindre qu’il ne s’occupe pas des petites affaires. Je suis sûr qu’il s’en occupe plus qu’on n’a le droit de l’exiger dans sa situation. C’est précisément une de ses qualités de pouvoir penser à la fois à beaucoup de choses, grandes et petites, et porter rapidement de l’une sur l’autre son activité et son savoir faire.
Lundi 1 juin
Je trouve en m’éveillant le Roi de Prusse mort de plus grands que lui sont morts. Je le regrette. C’est toujours beaucoup qu’un Roi honnête et sensé. Je me suis intéressé à lui dans ses temps de malheur. La façon dont ils étaient traités lui, sa femme, son pays, m’indignait. Je n‘ai pas à me reprocher d’avoir pris plaisir à à Mexico et à Calcutta comme dans un écho. La place manquera à l’ambition et à la puissance des hommes. Priez Dieu qu’ils ne deviennent pas fous.
2 heures
Je reviens d’un meeting on the slave trade, où le Prince Albert a fait son début in the chair. et je trouve le 389, votre départ pour le 13. Vous ne m’avez jamais donné de si principale nouvelle. J’ai quelques doutes sur un congé à demander à Thiers pour Génie. Sans cela, rien de plus simple que de le faire venir ici pour huit jours en vous accompagnant. Il faut que j’y pense, et que je lui en écrive à lui-même. Cela se pourra peut-être sans inconvénient. Je serais charmé de vous donner ce gardien là. Mais je ne veux pas que Thiers suppose je ne sais quoi. C’est bien intime de faire ainsi passer mon intérêt avant votre agrément. Mais je suis sûr que vous le trouvez bon. Le meeting était très nombreux et intéresant. Le Prince a été fort bien reçu. O’Connell et Sir Robert Peel également bien reçus, également applaudis. Public très impartial, et prenant. plaisir à se séparer de la politique. Grand applaudissement aussi à mon nom et à ma l’arrogance brutale et déréglée que j’ai vu régner. Elle était pleine de grandeur ; mais la grandeur à son tour était pleine de grossiéreté et de folie.
Le rappel de Ste Hélène, c’est juste. Les Invalides c’est juste, St Denis aussi serait juste, quoique moins convenable. L’apothéose serait une impièté. Et aussi une demence. La Prusse elle-même m’intéresse. Il y a en Europe trois pays que j’aime après le mien : l’Angleterre, la Hollande et la Prusse. Je suis très protestant par là. C’est la Réforme qui a fait ces trois pays, qui a fait leur caractère, et en bonne partie leur grandeur. Et l’Europe leur doit une bonne partie de la sienne, sans compter l’avenir. Il n’y en a plus pour la Hollande. Les petits pays sont morts. Deux choses aujourd’hui sont trop grandes pour eux, les idées et les évènements. Ni l’esprit, ni l’activité des hommes ne peut plus se contenir dans un étroit espace sur notre terre, le plus grand espace sera bientôt si étroit ! De Londres à New York, douze jours ; bientôt six jours ; on construit en ce moment à Bristol une machine qui double la force de la vapeur. On se promènera autour du monde. Les paroles dites à Paris retentiront. personne, mentionnés assez éloquemment par le sir Lushington. Mais puisque, vous ne devez ignorer aucune de mes vanités, voici mon plaisir de ce matin. Je suis arrivé un peu tard à Exeter hall. Le Prince était déjà in the chair. On se pressait pour entrer. Sur l’escalier, à la porte de la salle dans la salle, la foule était immense. En abordant la foule, j’ai dit the french ambassador, pour m’aider à avancer. Le premier venu à qui je l’avais dit, a dit à ses voisins. Mr Guizot. Tout le monde, a répété mon nom, personne ma qualité, et tout le monde m’a fait place. Un fils de M. Wilberforce, archidiacre dans l’ile de Wight, a parlé supérieurement avec beaucoup d’éloquence, naturelle et spirituelle. Sir Robert Peel a bien parlé, éternellement bien. Je vous dis que vous ne connaissiez pas M. de Brünnow. Savez-vous comment il était vendredi dernier, à une heure du matin, dans le vestibule de Buckingham Palace, sortant du concert de la Reine et attendant sa voiture au milieu de la très bonne compagnie qui attendait comme lui ? Une sale casquette de voyage sur la tête pour ne pas s’enrhumer. Je suis un peu choqué que vous m’ayez dit que je lui plairais. Du reste, je crois que vous avez eu raison. Il parle très bien de moi Il me semble que l’approche de notre rencontre me rend bien bavard. Vous ne vous plaindrez pas que cette lettre soit courte. J’en ai bien plus long à vous dire. Adieu. Adieu. Quand vous serez ici, il me semble impossible que nous n’arrangions pas tout vous, moi, Londres, et la campagne. Il y a deux choses avec lesquelles on peut tout. La seconde, c’est de l’esprit. Devinez la première. Adieu. Ma mère vous priera peut-être de m’apporter le portrait d’Henriette, dans une boite. J’espère qu’il ne vous embarrassera pas trop. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Gouvernement Adolphe Thiers, Politique, Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Progrès, Relation François-Dorothée, Religion, Séjour à Londres (Dorothée)
381. Londres, Jeudi 28 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je ne comprends pas pourquoi vous avez de l’orage et un ciel triste. Il fait beau ici depuis plusieurs jours, beau et calme. Aujourd’hui, il fait même chaud. Vous vous porteriez bien par ce temps là. Nous chercherons de l’air pour vous. Cela ne me paraît pas impossible à arranger. Nous trouverons bien quelque chose d’agréable à Norwood. Putney & Vous avez besoin de rouler en voiture ouverte. Vous viendrez à Londres, le matin voir qui vous voudrez, dîner où vous voudrez. Et moi j’en serai quitte pour fatiguer une paire de chevaux de plus pendant que vous serez là. Sachez bien que de mémoire d’anglais, me dit-on, on n’a vu à Londres un aussi beau printemps. Et au fait, je trouve l’air moins lourd qu’on ne me l’avait annoncé. Avez-vous un peu d’appétit ? Quand on a la bile en mouvement, je crois qu’il faut bien peu manger. Si je vous mettais à mon régime, je vous dirais, de la diéte et du sommeil. Ce sont mes seuls remèdes. J’ai vu hier on me promenant, deux ou trois jolies maisons à louer, garnies, à l’extrémité de Regent’s Park du côté de Primerose. Je vous assure que là l’air est agréable. Et vraiment la portion fermée de Regent’s park, le jardin, est charmante. Depuis que Lord Duncannon m’a donné, des clefs, j’y vais quelques fois, m’asseoir seul. C’est bien frais bien tenu, assez grand pour y marcher, pas d’isolement et pas beaucoup de monde. Il me semble que vous seriez bien près de là. Savez-vous décidément dans quel hôtel vous descendrez ?
Le duc de Cambridge, qui ne pouvait venir dîner chez moi le samedi 13, m’a offert le Vendredi, 12 ou le lundi 15. J’ai pris le 12. Je garderai le 15 bien libre. Je viens de déjeuner chez M. Milnes, conservateur modéré de la Chambre des Communes avec quelques radicaux modèrés Charles Buller & et Sir Stratfort. Canning. Conversation assez animée et variée. Il y avait là un homme d’esprit un Rev. M. Thirlwall le premier scholar, dit-on, de l’Angleterre. et prédicateur très éloquent. On voudrait le faire evêque. Mais, lord Melbourne s’y oppose, ne le trouvant pas assez orthodoxe.
Je me suis laissé imposer hier par lord Burghersh une seconde séance de l’ancient concert. C’était la dernière et cela lui faisait tant de plaisir! Au fait, j’aimais autant finir ma soirée là qu’ailleurs. La musique était bonne, très bonne même une ou deux fois. J’ai causé avec lady Burghersh. J’ai trouvé son esprit dont vous m’avez parlé. Bien artiste, fin et sensé. Quand je dis sensé, je ne sais pas, mais clairvoyant.
J’ai arrangé mon petit dîner pour mes Françaises. Elles partent le 3 Juin et je les ai le 2 avec lord Elliot, lord Leveson, lord et lady Lovelace et Sir Robert Cherter que j’ai mis là parce qu’il faut qu’une fois je le mette quelque part. Les invitations me pleuvent. Voilà lord Haddington, le duc de Bucclaugh, le duc d’Argyll. Il faudra rendre tout cela. Il me faudra plus de grands dîners que je ne comptais. Vous me règlerez Point de nouvelles. Chekib. Effendi vient d’arriver.
L’affaire d’Orient remuera de nouveau probablement sans avancer. Entre nous, je crois pouvoir dire que tout le monde ici, corps diplomatique ou Anglais, Whigs ou Torys, est de mon avis dans cette question, comme on est de l’avis d’un autre. On trouve que j’ai raison. On serait bien aise que quelque circonstance rendit ma raison nécessaire. Mais il faut lutter, refuser, dire non. C’est bien difficile. Aussi je ne réponds de rien. Je ne me décourage pas non plus. J’établis chaque jour, un peu plus fortement et dans quelques esprits de plus, que j’ai raison. Je pense des hommes dans les affaires comme des enfants dans l’éducation, il faut faire leur atmosphère et les laisser respirer. Adieu. J’attends la lettre de demain avec une double, une triple impatience. Mais je vous veux point agitée, point abattue. Les vrais adieux veulent la santé. Adieu. Adieu.
379. Londres, Mardi 26 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous aviez raison. Lady Palmerston ne dînait pas hier avec nous. Elle me l’avait dit Dimanche. Grand dîner ennuyeux, pas énormement long. J’ai porté la santé de la Reine. Pourquoi Lord Palmerston n’a-t-il pas fait comme j’ai fait chez moi le 1er mai, où j’ai répondu à la santé du Roi, par celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe ! Est-ce l’usage Anglais? Le nôtre est plus poli. De chez Lord Palmerston chez Lord Lansdowne. Rout immense. Le Drawing room du matin transporté à Berkeley-square. Du temps et des embarras sans fin pour arriver. J’ai eu du bonheur pour sortir. Ma voiture était tout près. J’étais chez moi à minuit et demi. Lady Lansdowne me convient. J’ai beaucoup causé avec elle samedi, chez moi. Elle a l’esprit droit et le cœur haut et vraiment du cœur. Elle aspire ardemment à Bowood. La plupart des Anglais et Anglaises me paraissent avoir peu de goût pour cette vie de bals et de routs, qu’il mènent avec fureur.
Je lis à l’instant même dans le Morning Chronicle : " The duke and dutchess of Sutherland leave Stafford House shortly for Trentham, whence they purpose going to Dunrobin Castle, Sutherland shire." Est-ce vra i? Qu’en savez vous ? Et dans ce cas, quel hôtel choisissez-vous ? Nous approchons beaucoup. Donnez moi de charmants détails. Vous aurez votre fils à la fin de la semaine. Vous pourrez tout règler alors.
Je vais déjeuner ce matin à Kensington, chez M. Senior avec lord Lansdowne, l’archevêque de Dublin, M. et Mad. Grote que décidément on veut prendre. Je dîne chez moi avec Bacourt, Dedel, Sir Edouard Disbroule et Frédérie Byng. Voilà tout le menu de ma vie.
Parlons d’autre chose : Thiers a raison de riposter à Ancone par Cracovie. La réponse est sans réplique, sans propagande, sans guerre, sans évènement, il nous serait facile de susciter aux Puissances, moins amies que d’autres, bien des embarras, des ennuis, d’élever ou d’entretenir en Europe, à leur sujet, ce bourdonnement de plaintes, de griefs, de réclamations, de prétentions, qui est fort incommode pour des gouvernements peu exercés au bruit. Nous ne le faisons pas ; mon avis est qu’il ne faut pas le faire ; mais il faut, dans l’occasion, nous prévaloir de ce que nous ne le faisons pas, et indiquer que nous voyons très bien toutes ces petites plaies auxquelles nous ne voulons pas toucher.
Je vous répète ce que je crois vous avoir déjà dit. Le Cabinet ne prend pas son échec au sérieux ; ni lui, ni personne. C’est à dire qu’ils restent très décidément et que personne n’en est surpris et ne s’attendait au contraire. Mais les Torys prétendent sérieusement au pouvoir et renouvellerons souvent l’assaut. Les Whigs s’attendaient à perdre les élections de Ludlow et de Cambridge, Pourtant ils en sont tristes. Et ils craignent un peu de perdre aussi celle de Cockermouth où M. Horsman pourrait bien n’être pas réélu. Ceci serait pire. Je ne crois à rien d’imminent ; mais je crois à une situation aggravée.
4 heures
Pour Dieu, ne soyez pas malade. Je suis, en ce qui vous touche votre santé, dans une disposition intolérable et toujours près de devenir douloureuse. Je ne me fie pas à vos impressions ; je vous crois portée à l’exagération mais si je me trompais ! Ne soyez pas malade, je vous en conjure. Mes Françaises sont contentes de moi. Je leur donnerais probablement encore un petit dîné comme vous dîtes. Pas de lady Jersey ; elle est pour mon grand dîner Tory du 10 juin et c’est assez. Mesdames de Chastenay et de St Priest partent de demain en huit pour leur tournée, in the country, et puis pour Paris. Mad de St. Priest, fait bâtir une maison sur le terrain de l’hôtel d’havré. Elle veut retourner à ses ouvriers. Adieu. Corrigez le numero de vos lettres Vous êtes d’1 en avant. Adieu. Adieu. Je vais à mes dépêches. Adieu. J’ai besoin de finir par adieu.
375. Londres, Jeudi 21 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
On est venu m’éveiller cette nuit à 3 heures, pour m’apporter la division de la Chambre des Communes, et j’ai expédié sur le champ un courrier à Calais pour qu’on le sût à Paris par le télégraphe. Non qu’il doive, je crois, en résulter ici aucun evènement. C’est pourtant un gros fait. On me dit que Peel a très bien parlé et O’Connell médiocrement. Il a voulu être modèré. On l’avait fort sermoné à ce sujet. C’est Lord Duncannon qui est son prédicateur. Et O’Connell répond toujours : " you are right ; I won’t do it again." Il a trop bien obéi hier. On prévoyait ce résultat, même à Holland House où j’ai été hier soir au lieu d’aller à la chambre. Devinez qui j’y ai trouvé? Mr Mrs Grote qui y avaient dîné. C’était un coup monté. Peut-être vous en ai-je déjà parlé quand ils ont été partis, j’ai demandé à lady Holland si elle avait un privilège contre les poursuites, for treating and bribery.
2 heures
Je viens de chez Lord Aberdeen. J’aime sa conversation, et je crois qu’il aime la mienne. Il y a beaucoup de shyness dans sa froideur. Et aussi de sadness. Il est préoccupé de cette affaire Napoléon. On commence à l’être ici, beaucoup plus qu’au premier moment & plus que moi. Je suis accoutumé aux apparences, et aux démonstrations bruyantes. Cependant, il est sûr que des embarras viendront de là. Ce qu’il y avait de bien est déjà recueilli ; il faudra subir le mal. Mais je ne crois pas au danger. Pourvu qu’il y ait un pouvoir qui s’en défende. En tout cas, la question est lointaine. Le retour n’est pas possible avant le mois de Novembre.
L’Orient est stationnaire. Je reste toujours sur mon terrain. On n’y vient pas. Mais on n’ose pas avancer sur le sien. Je m’applaudis du parti que j’ai pris de dire dès le premier moment, ce que je devais dire à la fin. Plus j’y pense, plus je suis convaincu que notre politique est la seule sensée. Rallumer la guerre entre les Musulmans, et courir le risque de l’allumer entre les Chrétiens pour la question de savoir si quatre ou seulement deux Pachalih de la Syrie appartiendront au vieillard qui règne à Alexandrie ou à l’enfant qui dort à Constantinople, en vérité c’est bien léger. Et je tiens pour certain qu’ici il n’y a pas trois personnes qui ne soient au fond de mon avis. De celles qui y ont pensé, s’entend. Il n’y en a pas beaucoup.
Les Affaires Etrangères occupent bien peu le public anglais. Je dis beaucoup sur cette question d’Orient ce qui est parfaitement vrai ; la politique que nous soutenons ne nous causera aucun embarras, à l’intérieur, car tout le monde, en France en est d’avis ; aucun embarras à l’extérieur, car le jour où l’on voudra agir sans nous, les embarras seront pour ceux qui entreprendront de faire, et non pour nous qui regarderons faire. L’hypothèse la plus défavorable ne nous met donc pas dans une position redoutable.
M. de Metternich a eu certainement beaucoup d’humeur pour Naples ; et dans son humeur, il s’est montré plus disposé à faire ce que voudrait Lord Palmerston en Orient. Mais sa disposition est vague, comme tout dans l’affaire. Quant au Pacha, il dit que si on le bloque dans Alexandrie, il sautera par dessus le blocus, c’est-à-dire pas dessus le Taurus. Je connais ces petites biographies, les premiers cahiers, le mien compris, qui était très bienveillant, et assez spirituel. Je connais Thiers, aussi ; mais non pas, le Duc de Broglie, ni Berryer, ni Dupin, ni Lamartine, vous serez bien aimable de m’envoyer ceux-là. L’ouvrage m'a paru écrit à bonne intention. Sait-on par qui?
Certainement, je porterai la santé de la Reine, le 25. Je suis en pension chez lady Palmerston. Elle dine samedi chez moi ; moi dimanche chez elle en petit comité, et lundi en full house. Je l’ai beaucoup vue depuis quelque temps et plus je la vois, plus je la trouve aimable. Elle dit qu’à présent je plais beaucoup à M. de Brünnow et qu’il parle de moi tendrement. Adieu.
J’ai le cœur à l’aise depuis hier à votre sujet. Je voudrais que ma grande lettre vous fût arrivée avant la petite. Je ne l’espère pas. Adieu.
Vous devriez vous arranger pour être ici le samedi 13 Juin. Au plus tard le Dimanche 14. Vous ne vous faites pas scrupule, je pense, de voyager le dimanche. Je ne trouve pas qu’on soit aussi austère ici à ce sujet, qu’on me l’avait dit. Le gros Monsieur vient passer quelques jours à Londres et vous en avertira. Ce que vous pourriez lui remettre passera de sa main dans la mienne. Que j’ai de choses à vous dire ! Et que de choses à entendre, que j’aime mille fois mieux !
Adieu, encore ; jamais pour la dernière fois.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Posture politique, Pratique politique, Salon, Séjour à Londres (Dorothée)
364. Londres, Dimanche 10 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les accidents de la semaine ne tournent pas mal. Mon petit Banneville est presque sur pied. Je viens de Blackheath. J’ai mieux aimé aller regarder moi-même. Vous ne pouvez pas être là. Il n’y a qu’un hôtel the Green-man, trop petit et pas convenable pour vous. Le Park-hotel de Norwood est infiniment mieux. Il m’a paru vraiment bien et très agréablement situé. Si les Sutherland vous reçoivent chez eux le 1er juin, vous viendrez si peu de jours auparavant que la distance de Norwvood importe assez peu. Et s’ils ne vous reçoivent pas, vous viendrez à Londres.
Je viens de conclure en trois jours une petite négociation qui fera grand bruit. J’ai redemandé les restes de Napoléon et on nous les rend. Ils seront déposés aux Invalides. Il y a plaisir à faire des Affaires avec Lord Palmerston quand il est de votre avis. Il les mène simplement et rondement. Ne parlez de ceci que quand on en parlera. Probablement on en parle déjà. Mais en tout cas, je désire que la publicité ne vienne pas de vous. On m’a promis de Paris une immense poputarité si je réussissais. Encore une fois, attendez qu’on en parle. Je ne sais pourquoi je vous répète cela.
J’ai dîné hier chez Sir Robert Peel, un dîner de Royal academy. Il y en avait un aussi chez Lord Lansdowne où j’aurais dû être aussi. Mais Peel avait eu la priorité. Je ne dînerai point chez les Philips. Je commence à supprimer quelques ennuis. Je me suis promené dans le parc de Greenwich. Je voulais retourner à Richmond. Mais je n’ai pas eu le temps.
Lundi 3 heures
Voici les renseignements les plus exacts et les plus complets. Alexandre continue d’aller bien. Chez lui, on dit et il dit lui-même, ce matin, qu’il partira dans huit jours pour Paris. J’ai envoyé Herbet, chez Brodie. Il l’a vu et à causé avec lui. Brodie trouve Alexandre bien, si bien a-t-il dit, qu’il n’ira pas le voir aujourd’hui. Mais à cette question d’Herbet: " Croyez-vous que le Prince Alexandre puisse partir dans huit jours ? " Brodie a répondu positivement; " He cannot. - Et dans quinze jours? Brodie a dit que c’était probable ; mais qu’en homme sensé, il ne voulait pas en répondre. Vous savez à présent le véritable état des choses. Il n’y a absolument aucun danger ; mais il faut du temps. Je n’ajoute rien. Décidez.
Je viens d’un grand meeting que devait présider Lord John Russel et où il a été remplacé pas Sir George Grey. Il a fallu comme de raison, y prendre la parole to second a motion. Il me semble que m’a popularité ne faiblit pas. J’ai reçu pour ce mois-ci quinze ou vingt invitations, à des meetings semblables. J’ai choisi les deux les plus considérables. Je n’irai qu’à ceux là.
J’irai peut-être dans deux heures à la Chambre des Lords où le Chancelier doit proposer un bill sur lequel parlera Lord Lyndhurst. On dit qu’on attend Lord Brougham le 23.
Votre "il ne peut pas" serait donc faux. No news. Si ce n’est que Palmella s’oppose à la demande Anglaise à Lisbonne. Mais on dit que ce pourrait bien être pour renverser le Cabinet portugais, et prendre sa place. Adieu.
J’approuve les changement à la lettre. Que j’ai de choses à vous dire ! Adieu. Adieu.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Inquiétude, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Parcours politique, Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Santé (enfant Benckendorff), Séjour à Londres (Dorothée)
363. Londres, Samedi 9 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai reçu d’Henriette, sur l’abandon de leur voyage ici, une lettre d’une tendresse charmante, et aussi pieuse que tendre. Elle a le caractère fort tourné à la piété avec un petit esprit, fort indépendant, et même un peu entier, elle aime à regarder en haut et à respecter. Elles partiront pour le Val Richer le 20 mai. On m’écrit que la Normandie est charmante ; un immmense verger en fleurs. Les champs sont couverts de pommiers.
Vous vous êtes donc décidée à vendre vos diamants. Vous ne me l’aviez pas dit. Que de choses on ne se dit pas en s’écrivant tous les jours !
3 heures
J’ai été interrompu par Alava et M. de Pollon. Je crois que je suis assez bien dans la petite diplomatie. Vous me le direz quand vous aurez passé quinze jours ici., Ma porte leur est toujours ouverte ; ma table souvent. Ils ont l’air de trouver que je fais honneur au corps.
Ils s’ennuyent beaucoup. Le départ de Mad. de Blome leur a été une de leurs ressources. Elle restait chez elle presque tous les soirs. On m’a amené hier un petit secrétaire de Suède, un baron de Manderstrome, qui a de l’esprit. Il a beaucoup vécu chez vous et vous connait bien. On dit qu’à la place de l’affaire de Naples qui s’arrange, Lord Palmerston va avoir une petite affaire avec le Portugal. Il s’agit d’une réclamation de quelques 350 000 livres Sterling
qu’on demande au Portugal et qu’il voudrait bien ne pas payer. Le Maréchal Bérerford y est compris pour 85 000 livres, et le duc de Wellington pour 17 000. Si le Portugal ne consent pas dans quinze jours, on parle de mesures coërcitives, comme l’occupation de quelque colonie, Goa ou d’une des Açores, ou l’une des Îles du Cap Vert. Ce sont les bruits de la petite diplomatie. Il ne faut pas. Le général Cordova est mourant à Lisbonne. Il était sur le point de partir pour se rendre en France.
Adieu. Je cherche si j’ai encore quelque chose à vous dire avant de me mettre à je ne sais combien de petites affaires qu’il faut que je règle aujourd’hui. J’ai beaucoup de petites affaires. Quel ennui d’être seul. Il est double ; le vide et le tracas. Adieu. Adieu.
361. Londres, Jeudi 7 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous quitte pour aller déjeuner chez un chanoine de Westminster Abbey, avec Lord Mahon, Lord Littleton et M. Macaulay. Ils prennent plaisir à me montrer les tombeaux de leurs grands hommes et à m’en parler.
3 heures
Ellice sort d’ici, arrivé tout à l’heure. J’avais deviné juste. Il paraît qu’un grand Empire et trois royaumes ont peur que nous n’ayons, à nous deux, plus d’esprit qu’il ne leur faut. Je ne peux pas imaginer une autre raison.
Vous deviez venir ici bien avant qu’il fût question que j’y vinsse. Vous aviez amorcé votre voyage pour les premiers jours de juin. Vous ne l’avez pas avancé parce que je suis venu ; au contraire, vous le retardez plutôt de quelques jours. Je suis ici depuis trois mois. Ma position est prise avec tout le monde. Elle est aujourd’hui avec M. de Brünnow, ce qu’elle restera, parfaitement convenable, polie, régulière. Quelle différence y aura-t-il entre le mois de Juin et le mois de Juillet ? C’est puérile, si ce n’est pas fin. Et si c’est fin, ce n’est pas assez fin. Je dis donc comme vous, et j’espère que vous ferez comme vous dites. En vérité, les grandes entraves de la vie sont déja bien lourdes ; si on se charge encore des petites, il n’y a pas moyen.
Je viens de causer un moment avec Ellice ; bien court. Bülow est entré. Nous ous reprendrons. Certainement, il est très bon homme et très spirituel ; un peu affairé, un peu important, un peu remuant, comme les oisifs actifs. Mais on n’a qu’à ne pas se laisser faire par lui. J’admire toujours les gens qui ne veulent pas qu’on sente les mérites, et qu’on en profite, et qu’on en jouisse, parce qu’il y a quelques inconvénients dont il faut prendre la peine de se garder.
4 heures 1/4
Encore une interruption de M. Murray pour la cuisine de la Reine. On me porte une grande confiance, en ce genre. J’ai encore deux lettres à écrire. Adieu. Comme dans le 363 ; toute la page. Je suis charmé que vous approuviez ce que vous avez vu. J’y comptais. Mais j’ai bien peur que ma situation ne devienne pressante. Et je n’ai pas envie d’être pressé. Adieu. La page n’est pas pleine.
357. Londres, Samedi 2 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon dîner s’est très bien passé. De 8 heures 1/4 à 10 heures à table dans l’ordre que vous savez et qui m’a paru approuvé de tous. Le debut froid et embarrassé comme toujours et partout. Passé la première demi-heure de l’animation et de la bonne humeur. Le cuisinier et la cave ont eu grand succès. Lord Melbourne a bu du vin de Bourgogne avec un contentement réfléchi. C’est Lord Lansdowne qui a porté la santé du Roi, d’après l’avis de Lord Palmerston. J’ai porté celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe. La Parisienne s’est mariée au God save the Queen. Le service a bien marché un peu précipitamment. Ils étaient trop pressés de bien faire. J’avais prodigué l’éclairage ; il était brillant. Cela manque toujours ici. L’illumination était belle, mais un triste accident s’y est mêlé et me désole. La voiture du baron de Moncorvo a accroché une échelle sur laquelle était monté un pauvre charpentier qui allumait les lampions. Il est tombé et il en mourra. Il a le crâne fracassé à la base. Il n’était pas marié, mais il allait se marier. Je lui ai fait donner tous les secours possibles. Mon médecin, qui est allé le voir ce matin à Middlesex-Hospital où je l’ai fait transporter me dit qu’il n’y a pointl’avait fait de chance de guérison. J’avais pris toutes sortes de précautions contre les accidents. Comment prévenir la maladresse d’un cocher? J’ai beaucoup causé avec le duc de Wellington qui y prenait plaisir, quoique la conversation doive lui donner assez de peine. Il cherche ses idées et ses mots comme un aveugle son chemin. Il m’a raconté Charles X, et comment il avait lui toujours prèvu sa fin. Bien aise de me tenir le même langage que Lord Aberdeen qui m’a déjà dit deux fois : " Je me glorifie d’avoir été en Europe le premier ministre qui ait reconnu le Roi Louis-Philippe."
Une heure
356. Londres, Vendredi 1er mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
356 et 357 en un jour ! C’est charmant. Et un jour où vous n’aviez rien eu ? Je ne comprends pas cela. Mon troisième commissionnaire n’aura pas reçu la lettre à temps avant de sortir de chez lui. J’espère que vous l’aurez eue plus tard. Vos mécomptes me déplaisent autant que les miens. Je ne peux pas dire mieux, ni plus. Je suis de votre avis sur le speech à l’academie royale. Et je crois que bien décidément j’agirai selon notre avis. Mais quelques phrases seulement; pas un vrai speech. Parlant français surtout, si je parle un peu longuement, il faut que ce soit assez pour faire de l’effet. Et l’effet en pareille occassion dans ma situation d’aujourd’hui, c’est une prétention. J’en ai fait assez depuis quelque temps. Je serai donc très court et très simple. Il y aura quelques personnes attrapées. On est curieux de mon éloquence. On ne l’aura pas là. C’est un peu dommage. Je pourrais dire de bien bonnes choses. Mais j’y ai pensé ; soyez sûre qu’un vrai speech aurait en ce moment un air de prétention et de bruit qui même avec le succès, me diminuerait au lieu de me grandir.
Mots-clés : Ambassade à Londres, Diplomatie, Politique (Internationale)
355. Londres, Jeudi 30 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vais déjeuner aujourd’hui à Battertea chez un des favoris de la Duchesse de Sutherland, le Dr. Khay. On veut me faire voir là et à Norwood, de grandes écoles populaires en attendant que j’aille à Eton et à Oxford voir les écoles aristocratiques. A Norwood, je m’enquerrais aussi d’autre chose. Le soleil est décidé à ne pas quitter Londres. Il y fait pourtant une pauvre figure, dans son plus grand éclat. Hier, à dîner, chez Lady Lovelace, l’évêque de Norvich, bon homme un peu ridicule, un M. Villiers, frère de Lord Clarendon. Tous ses frères ont de l’esprit. Vous savez que Lady Lovelace est la fille de Lord Byron, cette petite Oda sur laquelle il a fait des vers charmants. Elle a de très jolis yeux et l’air spirituel naturel et affecté à la fois. Vous arrangerez cela, car cela est, et même, je trouve cela assez comme en Angleterre. Ils sont naturels et point à l’aise dans leur naturel ; d’où leur vient l’affectation. Je me suis ennuyé. J’ai été finir ma soirée chez Mad. Grote au milieu des radicaux. Mad. Grote, devient un personnage. Lady Palmerston l’a invitée à une soirée. J’ai entendu avant-hier Lady Holland faire un petit complot pour l’avoir à dîner la semaine prochaine à Holland, house, et bien recommander à Lord John Russell d’y venir et de plaire à Mad. Grote. Ils ne lui plairont pas, et elle ne leur plaira pas. Elle a de la hauteur et prend de la place. Ils ne lui en feront pas assez ; elle aimera mieux être reçue des radicaux chez elle qu’une étrangère poliment accueillie, à Holland house. Les complaisances aristocratiques ne peuvent plus se mettre au niveau des fiertés démocratiques. Il peut y avoir là des rapprochements sérieux et sincères, par nécessité, par bon sens, par esprit de justice. Tout ce qui est factice, superficiel, momentané ne signifie plus grand chose. On n’aura pas le vote de M. Grote comme Don Juan a eu l’argent de M. Dimanche.
J’ai été voir hier Lady Palmerston, fort contente de son petit séjour à Broadlands, pas rajeunie pourtant ; je lui trouve l’air fatigué. Elle a besoin de toilette. Le négligé du matin ne lui va plus. Elle est préoccupée des Affaires de Naples. A part l’intérêt du moment, cela lui déplaît qu’on dise que les révolutions naissent sous la main de Lord Palmerston et de le craindre elle-même un peu. Nous attendons des nouvelles. Je pense que j’aurai un courrier ce matin. Voilà mon courrier. Il m’apporte : 1° de de longues dépêches sur Naples et l’Orient avec de curieuses conversations de Méhémet Ali ; mais point de réponse encore du Roi de Naples. Cela m’impatiente. 2°des lettres et des livres des Etats-Unis d’Amérique où l’on me reproche d’avoir dit trop de bien de Jefferson. 3° l’ouvrage de M. de Tocqueville sur la démocratie en Amerique. 4° Le grand cordon de la légion d’honneur, pour que je le porte demain.
10 heures et demie
354. Londres, Mercredi 29 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le petit comité de Holland house s’est transformé hier en 14 ou 15 personnes. Toujours au grand déplaisir de Lady Holland dit-elle ! Elle continue de me soigner comme un enfant favori. J’avais Lord Melbourne et Lord John Russell. Nous avons causé. La conversation est difficile avec Lord John ; elle est très courte. Je vois que M. de Metternich est extrêmement préoccupé de Naples de notre médiation autant que de ce qui a fait notre médiation. L’Angleterre et la France sont bien remuantes. Il n’y aura jamais de repos, en Europe tant qu’elles y seront. En sortant de Holland house, j’ai été un moment chez Lady Tankerville. Elle avait déjà vu Lady Palmerston arrivée à 5 heures. Leur intimité est grande. Elle croit au mariage de Lord Leveson et de lady Acton. En savez-vous quelque chose ?
Une heure
349. Londres, Jeudi 23 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
On m’assure qu’en passant à Berlin les comtes Pahlen et Orloff ont tenu, l’un et l’autre, un langage très modéré, et qu’ils ont dit notamment qu’il fallait que les affaires d’Orient fussent reglées de concert entre les cinq cours, et sans se séparer de la France.
3 heures
348. Londres, Mercredi 22 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai le cœur bien soulagé depuis que je suis tranquille sur ma fille. Je me surprends toujours à me dire tranquille. Il est vrai que je le suis comparativement. Mon courrier m’a apporté ce matin la lettre de Lady Clanricarde, plus spirituelle que nouvelle mais très spirituelle, comme vous dites et écrite d’un ton ferme quoiqu’un peu verbeux. Ses idées marchent mieux que ses phrases. Evidemment elle ne se plaît pas à Pétersbourg et je le comprends. Je serai bien aise quelle revienne à Londres et de faire un peu connaissance avec elle. Entre nous, je rencontre ici, comme ailleurs du reste bien peu de femmes d’esprit. Je ne m’en plains pas. J’aime que ce que j’aime soit rare. J’aime encore mieux que ce soit unique. Le premier, le plus fort de tous les orgueils, c’est l’orgueil tendre. J’ai celui-là au plus haut degré. Je suis content de mon courrier de ce matin. Il m’a apporté des lettres qui me mettent en mesure de faire faire, si je ne m’abuse un pas à ma grande question. On est fort content de la façon dont j’ai arrangé la médiation de Naples. J’espère que, de son côté, le Roi de Naples entendra raison. J’en serais sûr s’il n’y avait pas là une question d’argent. Son avarice sert merveilleusement sa dignité. En tout cas, les hostilités vont être suspendues ; et j’en suis fort aise. Les mécontents Italiens étaient déjà à l’œuvre. Du reste il n’y a rien à faire pour moi cette semaine. Lord Palmerston est à Broadland et n’en reviendra très probablement que Lundi.
4 heures
346. Londres, Dimanche 19 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
345. Londres, Samedi 18 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de réussir dans une petite négociation qui a quelque valeur en elle-même et quelque importance pour moi. A la première nouvelle des vivacités de l’Angleterre à Naples, en causant avec Lord Palmerston et le voyant un peu préoccupé des conséquences possibles, une insurrection en Sicile, des embarras en Italie et, je dis quelques paroles des bons offices de la France et du parti que l’Angleterre en pourrait tirer. Elles furent bien accueillies. Elles le furent très bien à Paris. J’ai mené l’affaire vivement, et un courrier vient de partir hier soir pour Lord Granville qui acceptera la médiation de la France entre l’Angleterre, et Naples chargera la France de négocier au nom de l’Angleterre et lui donnera le pouvoir de suspendre les hostilités contre le pavillon Napolitain. Cela sera bon dans le cas particulier et d’un bon effet général. On verra que la France et l’Angleterre ne sont pas si près de se brouiller, ni si dénuées de confiance l’une dans l’autre. Lord Granville vous aura peut-être déjà parlé de ceci quand ma lettre vous arrivera. Ayez soin seulement de n’en pas parler la première. Du reste, je suppose que l’affaire une fois conclue, on n’aura rien de plus pressé que d’en parler. Je crois avoir bien saisi et bien poussé l’à propos.
3 heures
4 heures 3/4
339. Londres, Vendredi 10 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures et demie
Quelques mots aujourd’hui pour vous remercier du 339 si tendre, et puisque les jours sans lettre sont si tristes. Par malheur j’ai très peu de temps. J’ai été chez Lord Palmerston. En en sortant, j’ai eu à écrire une dépêche sur ces affaires de Naples. Je viens de finir. Que c’est commode d’être dans une île avec l’océan pour frontière ! On fait de la politique, extérieure, sans responsabeilité comme les journaux anonymes. Je l’ai dit en riant à Lord Palmerston. Quand l’Italie sera en feu, pour qui sera l’embarras. Je l’ai trouvé raisonnable, c’est-à-dire ne demandant pas mieux que de l’être pour finir ce qu’il a si vivement commencé. Au fait, l’Angleterre profite des avantages de sa position. Ils étaient hier assez inquiets sur le vote de la Chine. Ils ont eu quatre voix de plus qu’ils n’espéraient une heure avant. Je suis resté à la Chambre jusqu’à 1 heure et demie. J’ai entendu la moitié du discours de Peel. Excellente manière de parler, simple et point familière, naturelle, et point froide ; très bien posé de sa personne ; de l’autorité, comme on en a avec ses égaux quand on leur est supérieur sans être un homme supérieur. J’ai été plus frappé de la forme que du fond. Le début à été très bien. Mais quand il est entreé en Chine, le chemin a été si long que le désespoir m’a pris et je suis sorti. Je regrette de n’avoir pas entendu Lord Palmerston. Mais il n’a pris la parole qu’à 2 heures et demie. Il a eu un vrai succès. Ce qui est excellent, c’est l’énergie et l’intelligence avec lesquelles chaque parti soutient Son chef. Les hear et les loud cheers sont pour moitié dans l’éloquence anglaise. Il n’y a rien de tel pour avancer que d’être ainsi poussé. De quoi vous parle-je là quand votre lettre m’a été si avant-dans le cœur ? Vous avez bien raison de me dire de si douces paroles. N’est-ce pas que c’est charmant ? c’est un droit divin, d’envoyer au delà des mers, dans un petit chiffon de papier du bonheur du vrai bonheur? Mais je vous en veux de votre inquiétude vague, et de votre silence. Sur votre inquiétude vague, vous n’avez droit de rien penser, de me rien dire, en pareil sujet ; mais quand vous avez le tort de penser quelque chose au moins faut-il me le dire. Et que ce soit un dîner chez Mad. Maberly qui ait transformé votre inquiétude vague en une conviction si forte en un chagrin si réel! Cela ne serait pas pardonnable si vous aviez jamais besoin de pardon, et j’en serais très offensé si je ne vous connaissais pas comme je vous aime. Vous me dites d’être fier, très fier. Je le suis mille fois plus que vous ne l’êtes pour moi, car le rouge me monte au visage en pensant à la cause de votre inquiétude. Vous ne savez pas ce qu’est pournmoi que de dire les paroles que je vous dis et à quelle hauteur je cherche et je place celle à qui je les dis.
338. Londres, Jeudi 9 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures et demie
Hier, à dîner chez Lord Clarendon, Lord et Lady Landsdowne, Lord et Lady Holland, Lord et Lady Tankerville, Lord John Russell, Ellice, deux ou trois inconnus. Nous avons eu une petite scène. Lord Clarendon a fait monter dans le salon un tableau qui lui arrivait de Madrid et dans lequel une figure de Moine ressemblait vraiment beaucoup à Lord Holland, à ce point qu’à Madrid Charles Fox s’était recrié en la voyant. Lady Holland s’est fâchée, d’abord tout haut, puis tout bas avec Lord Clarendon. "I’m angry, truly angry take away that picture so ugly, so disgusting a friar."
Midi et demie
Voilà une Hypothése. L’autre, celle d’un accommodement entre les cinq, par des concessions réciproques du Sultan et du Pacha me paraît toujours la plus probable. Mais la solution n’est pas mûre. Le temps y conduit. J’aime donc le temps. Je ne fais rien cependant pour le gagner. Je le laisse venir. J’ai vu aussi entrer hier Charles de Mornay qui passe par Londres en retournant à Stockholm. Il est devenu bien lourd. Je le mènerai demain à Lord Palmerston. Je suis dans une grande incertitude. Il faut que je vous quitte pour faire ma toilette. Fermerai-je ma lettre et la donnerai-je à M. Herbet pour la poste avant de monter, en voiture ? Ou bien attendrai-je que je sois revenu du Drawing- room. On me parle de trois grandes heures. Je ne serais donc ici qu’à 5 heures et demie. C’est trop tard. Je ne veux pas risquer qu’une lettre attendue vous manque.
Adieu. Adieu. Vérity a-t-il vraiment commencé à vous droguer ? J’espère que non. Je déteste les drogues. On ne sait jamais ce quelles feront. Adieu.
334. Londres, Jeudi 2 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures
J’ai dîné hier chez le colonel Maberly dans la petite maison de Londres la plus magnifiquement arrangée ; un luxe prodigieux en dorures, vieux sèvres, laque & On dit que lord Lichfield est pour beaucoup dans cette magnificence là ! Mad. Maberly est une grande femme, un beau teint, des yeux très animés du mouvement d’esprit, qui a été fraiche et qui passe pour belle. Le premier jockey de l’Angleterre and an author of novels. A dîner, Sir John Shelley, un ancien ami de George 4, lady Shelley, Lord Cantalupe, l’un des rivaux de Lord Chesterfield (à propos, lundi dernier pour le bal de la Reine, Lord Chesterfield a mis sept heures à sa toilette ; il a fait son luncheon dans l’intervalle) Lord Burghersh, Sir Hussey Vivian et sa femme. Après dîner, un improvisateur Anglais M. Hook, qui avait dîné aussi, s’est mis au piano, et cherchant ça et là quelques accords, a emprovisé sur tous les sujets qu’il a plu de lui donner. Je ne sais combien de chansons en vers, rimées, quelquefois assez originales et pleines de humour. Vous n’avez pas d’idée des rires; ils sont rares ici ; on rit les dents serrées. Mais hier ils étaient tous charmés; les corn laws et Lady Kinnoul, les deux affaires de la soirée revenaient à chaque instant dans les chansons et à chaque fois les rires redoublaient. L’improvisation a fini par une chanson en mon honneur, et nous nous sommes séparés à 11 heures pour aller en effet, les uns au débat des Corn laws, les autres au bal de Lady Kinnoul. J’ai été de ceux-ci, quoiqu’infiniment plus propre au débat qu’au bal.
Office (épicerie &) 90
Gages des gens 100
Mes chevaux 20, (ils sont beaux)
3 heures
4 heures
333. Londres, Mardi 31 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures et demie
C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.
Mercredi, 9 heures
J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.
2 heures
J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu
151. Val-Richer, Samedi 6 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous eu une raison pour me chercher avant-hier avec plus de tendresse que de coutume ? Avez-vous pensé que j’étais né ce jour-là, il y a 51 ans ? car nous sommes du même age. Quand mes enfants sont venus m’embrasser avec leurs gros bouquets et leurs petits ouvrages, vous m’avez manqué, je vous ai cherchée aussi. Nous sommes, nous rencontrés à ce moment ? Je ne suis pas [?] du tout, et je n’aime pas les gens qui le sont, je ne puis souffrir qu’il entre dans le cœur ou qu’il en sorte quelque chose d’affecté et de ridicule. Mais je trouve le monde si froid, si sec ! Vous avez bien raison ; il n’y a point de joie solitaire. Ces mêmes émotions qui, partagées, seraient douces et charmantes retombent sur le cœur isolé et l’oppressent. N’ayez pas mal aux nerfs deares ; que vos genoux ne tremblent pas, que votre vue ne se trouble pas ; mais aimez-moi toujours comme hier et avant-hier.
C’est par courtoisie sans doute que M. Molé destine au Turc, l’hôtel de Pahlen. Il veut que cette maison soit encore un peu Russe. Vous la reprendrez avec Constantinople. Pourquoi M. de Pahlen n’achèterait-il pas l’hôtel d’Hauré ou de Lille ! C’est grand et beau, & toujours à vendre, si je ne me trompe. Quand le comte Appony sera-t-il établi dans sa nouvelle maison ? Voilà une affaire traitée de bonne grâce. A partir de ce matin, je suis tout à fait seul. Mon dernier cousin s’en va et je n’attends plus personne, M. et Mad. Villemain devaient venir, mais ils ne viendront par.
Lisez donc la Littérature de M. Villemain. Il y a vraiment beaucoup d’esprit, de l’esprit sensé et gracieux, ce qui prouve bien, à coup sûr, la distinction de l’âme et du corps. Mais j’oublie que vous n’aimez guère la littérature, même spirituelle. Il vous faut la vie réelle, les personnes. Moi aussi, j’aime infiniment mieux les personnes qui me plaisent que les livres qui me plaisent. Mais beaucoup de personnes ne me plaisent pas, et les livres me distraient de celles-là. Henriette aime beaucoup les livres et j’en suis charmé. C’est une immense ressource pour une femme que le goût de l’étude. Elle lit avec le même ravissement le Voyage du jeune Anacharsis et Macbeth. C’est un esprit bien sain, en qui toutes les facultés, tous les goûts se développent dans une rare harmonie. Si vous aviez été ici à la campagne, avec moi, en mesure de jouir ensemble des œuvres de l’art comme de celles de la nature, je vous aurais montré avant-hier sa traduction, à elle seule, bien réellement seule, d’un fragment du Lay of the last Minstrel, et vous auriez trouvé que pour un enfant de neuf ans, l’intelligence était assez vive et l’expression heureuse. A propos de mes enfants, je vous conte mes propres enfantillages. Je ne les conte à nul autre.
M. de Broglie était encore avant-hier sans nouvelles de sa fille. Je suis impatient qu’elle l’ait rejoint. Il ne faut pas toucher souvent aux plaies. Dites-moi, s’il a vu les Granville. Je suppose que non, puisque Lord Granville ne peut pas sortir. Il me tarde que vous soyez rentrée en possession de Lady Granville. Sans elle vous me faites l’effet d’une personne à qui son dîner manque. J’espère que vous garderez Alexandre au moins quelques jours. 9 h. 1/2 Non, vous ne serez plus seule. J’en ai besoin pour moi, encore plus que pour vous. Adieu, adieu. Je vais marquer des place où je veux plantés des arbres. Le mélèze que vous savez, qui voulait me suivre, se porte à merveille. J’en vais planter d’autres. Aucun ne le vaudra. Adieu. Adieu. G.
Au château de Broglie, Jeudi 20 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’en lire bien long, la lettre de M. Xavier Raymond, et le manifeste de Raschid Pacha. C'est bien du bruit. Jamais les hommes ne font plus de bruit que lorsqu’ils n'ont pas envie de faire autre chose. Quand on regarde au fond et de ce manifeste et de toutes les pièces de cette affaire depuis l'origine, on trouve le bruit bien ridicule, car au fond, il n’y a rien. Vous demandez qu’on vous redonne ce que vous avez. On refuse de vous le redonner, mais on reconnaît que vous l'avez. Voilà pourquoi on vous déclare la guerre. Vous dites que vous ne l'acceptez pas, et vous avez raison, et je crois qu’on ne vous la fera pas. Pourtant, il y a là un grand secret un secret de Dieu. A-t-il décidé que le moment de la mort de la Turquie est venue, et par conséquent le moment du remaniement, c'est-à-dire du bouleversement territorial de l'Europe au sujet de l'héritage ? C'est possible ; et moins je vois de motifs assignables, de motifs humains à la guerre, plus j'ai peur quelquefois, qu’il n’y ait là une volonté divine, et que ce ne soit bien lui même qui pousse à la guerre, les hommes qui n'en veulent pas. Nous verrons bien.
En attendant, je cause ici, de cela et de tout. J’irai après demain passer 24 heures au Val Richer pour dire adieu à ma fille Pauline qui en par lundi pour le midi. Je reviendrai, après son départ, passer encore ici la semaine prochaine, et je retournerai au Val Richer, le samedi 29 pour le quitter définitivement le 15 ou 16 Novembre. C'est bien des courses, et mon Cromwell, qui touche à sa fin, en est un peu dérangé. Je serais fâché quand j'aurai fini ; c'était une société dans ma solitude, et un but dans mon oisiveté. Il faudra que je m'en fasse un autre.
9 heures
On m’apporte votre lettre, et le duc de Broglie m'en envoie une du Prince de Joinville qui est en effet très inquiet pour la Reine sa mère. La pleurésie allait mieux ; mais le matin même, une inflammation d’entrailles venait de se déclarer et paraissait grave. On attendait le Duc de Nemours qui venait de Vienne avec sa soeur la Princesse Clémentine. Le duc d'Aumale est en Savoie. Ils ont évité de se trouver tous réunis à Genève, de peur de quelque ennui politique. Je crains beaucoup pour la Reine ; elle est prête, fatiguée ; elle a 71 ans. Il y a de bon médecin à Genève. Ecrivez-moi demain à Broglie. Je n'en partirai samedi qu'après déjeuner. Mais dimanche, je vous prie de m'écrire au Val Richer. J'y passerai toute la journée de lundi. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 20 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis charmé que les Danois soient victorieux. Les premiers bruits m’avaient inquiété. Si j'étais à portée, je voudrais savoir le fond des causes de l'obstination des Holsteinois. D'ici elle paraît si absurde qu'on ne la comprend pas. Car ils ne se font certainement pas tuer pour le seul plaisir d’Arnds et de Grimm et de tous ces unitaires Allemands qui ne leur envoient que de très minces secours. Cet acharnement d'un petit pays à ne pas vouloir de la paix, que veulent pour lui tous les grands états, a quelque chose qui n’est pas de notre temps. Je sais assez de l'affaire pour savoir qu'européennement les Danois ont raison. Je voudrais être aussi sûr que localement et selon les traditions et les lois des duchés, ils ont aussi tout-à-fait raison. Quand on n’est que spectateur, on a besoin d'avoir tout-à-fait raison, quand on est acteur, la lutte entraîne. Je trouve ces pauvres paysans Holsteinois plus entraînés qu’ils ne devraient l'être s'ils n’étaient poussés que par les intrigues des Augustenbourg ou par les chimères germaniques. Vous ne lèverez pas pour moi ce doute là, vous n’avez pas assez de goût pour la science.
Si j'étais à Paris, je vous montrerais huit ou dix pages que je viens d'écrire comme préface à la réimpression de Monk. Pas l'ombre de science, mais un peu de politique actuelle, et assez nette. Vous verrez cela avant la publication.
C'est grand dommage que vous ne soyez pas à Bade, entre toutes ces Princesses et Thiers. Cela vaudrait la peine d'être vu et décrit par vous. A coup sûr comme amusement, et peut-être aussi comme utilité. Il a précisément la quantité et la qualité d’esprit qu’il faut pour plaire en quatre ou cinq endroits à la fois. Je doute qu’il fasse rien de bien important ; il est trop indécis pour cela ; mais je ne crois pas non plus qu’il se tienne tranquille. Il est en même temps mobile et obstiné, et il change sans cesse de chemin, mais pas beaucoup de but. Je parierais qu'on ne vous a pas dit vrai au pavillon Breteuil quand on vous a dit qu’il était venu et qu’on l’avait vu. On tient beaucoup là à faire croire que les menées contraires pour les deux branches sont très actives. On vit de la dissidence.
Onze heures
Je vois que j’ai raison de ne pas croire au dire du pavillon Breteuil. J’aurais été fort aise de voir Tolstoy au Val Richer ; mais j’aime bien mieux qu’il soit retourné plutôt à Paris. Il est affectueux pour vous, et il vous est commode. Je vous quitte pour deux visiteurs qui viennent me demander à déjeuner ; M. Elie de Beaumont et M. Emmanuel Dupaty, la géologie et le Vaudeville, l'Académie des sciences et l'Académie française. Ce sont deux hommes d’esprit et deux très honnêtes gens, qui m’aiment et que j’aime. Adieu, adieu, adieu. G.
Broglie, le 17 septembre 1868, Ximénès Doudan à François Guizot
[Bourdic], le 21 août [,], Paradès de Daunant à François Guizot
Paris, le 18 juin 1862, Hugues-Iéna Darcy à François Guizot
Saint-Donain, le 25 août 1860, Hugues-Iéna Darcy à François Guizot
68. Paris, Lundi 3 octobre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Marion m’a dit que ses parents désiraient qu’elle passat Noël, avec eux ; j’ai trouvé naturel, j’ai dit tout ce que je m'étais proposé de dire sur mon remord du passé. J’ai été très affectueuse & résignée à cette séparation m'en remettant à elle de l'abréger. C’est tout en moi dont elle parle ! Je n’ai pas capitulé. Je remets à mes amis de faire comprendre que c’est bien long ! Vous y pourrez beaucoup. Il y a du temps jusqu'à l’événement. Merci de vous occuper de Monod. Les affaires se brouillent beaucoup. Je crois qu'il est venu une note austro prussienne adressée à Paris & à Londres. Elle a dû être remise hier. J’ignore encore l'accueil. Ici on ne fera que ce que voudra Londres, et là on est très monté & je crois décidé à la guerre. Les Anglais se croient trompés par nous & veulent se venger. Le pays tout entier est monté sur ce ton. Lansdowne d’abord très doux a changé de manière après avoir appris par Lord Cowley tout ce qui s’était passé.
J'espère encore que L'Empereur ici tâchera d'agir à Londres, il désire la paix vivement, mais il ne se séparera pas de l'Angleterre cela est certain, & si elle veut la guerre il la fera avec elle.
De notre côté nous ne comprenons pas cette nouvelle vivacité anglaise. Nous persistons dans notre dire, nos conditions pour évacuer les Principautés. Nous n’avons pas dit un mot encore des flottes à Constantinople.
Les trois souverains sont réunis à Varsovie, je crois du moins que le roi de Prusse y est allé aussi. L'entente est intime. Les Clauricarde sont venus me voir spontanément. Les anciennes relations très cordiales. ils sont très opposition au Ministère, ce qui fait qu'ils le sont moins à la Russie. Ils repartent pour Londres demain.
Mad. Kalerdgi est arrivée, elle m'explique un peu Pétersbourg. Au fond toute cette affaire est de l’invention de l’Empereur & pas du tout du goût de Nesselrode. C’est ce qui explique la marche boiteuse. Molé, Heeckeren , Noailles, beaucoup de monde hier soir. La rencontre de Kalerdgi & Molé touchante. C'était drôle. Tout le monde agité & croyant à la guerre. Savez-vous qu'une bonne lettre de vous à Lord Aberdeen ferait beaucoup d’effet dans ce moment de ces réflexions générales que vous savez rendre si frappantes. Lui aussi est ébranlé et penche pour la guerre, enfin je vous dis vrai, tout le monde y est en Angleterre & c’est imminent. Ecrivez, je n’ai pas revu Fould depuis la folie de son frère. Morny est de retour depuis hier. Il travaillera à St Cloud. Son Empereur est très sensé et très bon. Tous les autres détestables. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Amis et relations, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (diplomatie), France (1852-1870, Second Empire), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale)
66. Paris, Jeudi 29 septembre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Marion est malade, & moi trop fatiguée pour copier Greville. Voici le résumé grande agitation, impuissance de découvrir un nouveau moyen de négociation. Nous avons tout gâté par notre seconde dépêche explicative qui veut dire que nous entendons la note de Vienne dans le sens de l’Ultimatum Menchikoff. Il ne fallait pas dire, il fallait ne rien dire. Mais enfin c’est fait & on ne sait plus à quel Saint se vouer. Il paraît donc qu'il ne reste que la guerre. cependant la saison fait obstacle aux coups. Mais encore une fois comment renouer ? Voulez-vous bien le dire. Vous vous ferez difficilement une idée de la consternation de Hubner, Hatzfeld & &. Ils nous envoient à tous les D. C’est naturel. Mais nous n'y allons pas. Constantin me mande du 24 que l’Empereur est de très bonne humeur. J’ai vu hier chez moi le soir Molé, Berryer, Brougham, & Fould. Celui-ci très gai. Je n’ai pas pu causer avec lui. Il a dit à Marion que cela s’arrangerait comment ?
L’Empereur revient aujourd’hui. Lansdowne qu'on avait convoqué pour un Cabinet conseil reste pour faire sa cour. Le voyage n’a pas été favorisé par le temps. La reine Amélie renonce à tout. La tempête l’a rejetée à Plymouth, elle est revenue à Clarmont malade. On dit que la Pcesse de Joinville l’est très sérieusement depuis longtemps & qu’elle mourra si elle ne retrouve par le soleil. Le duc de Noailles est venu aussi hier. Il a longuement. vu Fould l’autre jour que lui avait tenu le même langage qu'à moi. Belliqueux & révo lutionnaire par nécessité, parce qu’il ne voyait pas d’autre ressource. Olmentz a dû finir avant hier. Bual y a été mandé. Voilà Hubner plus tranquille au moins sur ce point. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conversation, Diplomatie (Russie), Enfants (Benckendorff), Famille royale (France), Femme (politique), Femme (santé), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
65. Paris, Mardi 27 septembre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voilà bien du bruit ici. De tous côtés on vient m'effrayer. Me rassurer, personne. M. Fould est enchanté de l’entrée des vaisseaux. " C’est plus net. La capitulation sera plus facile. (Joliment !) ou la guerre. plus tranchée, car ce sera. La guerre révolutionnaire. L’Autriche y perdra de suite l’Italie & la Hongrie. L’Allemagne ne demande pas mieux que d'appartenir à l'Emp. Napoléon. Il tient en mains les révolutionnaires de tous les pays, il peut les contenir où les cacher. Chez lui il n’a pas peur, ils sont soumis. Il peut donc bouleverser le monde sans courir lui-même le moindre danger." Lord Cowley est au plus noir ; il ne voit plus un moyen quelconque pour éviter la guerre générale, et des malheurs af freux. Cependant son instinct se révolte et il doute, en dépit de tous les raisonnements qui tous concluent à la guerre. Hübner est dans un état violent. Bual n’est pas à [Olmetz]. Cela l'offense avec quelque raison. C'est mon [Empereur] qui n’aurait pas voulu. Kisseleff conserve sa tranquillité apparente. Hatzfeld est à la campagne. Lord Lansdowne écoute, Brougham bavarde et rit, il n'a jamais été aussi en train et aussi agréable. Le premier revient de Suisse et retourne en Angleterre. Il attendra ici l’Empereur à moins d'une convocation du Cabinet. Son dire est comme celui de tout le monde avec les formes réservées & polies que vous lui connaissez. Mais la guerre est au bout. On dit ici aux aff. étrangères que le traité des détroits a toujours été respecté jusqu'au moment où la vie des Nationaux est menacée (Je me trompe c’est Cowley qui me dit cela mais qu'il n’y a pas de traité qui tienne devant le devoir de la sauver.) Drouin de Lhuys dit aux petits diplomates que c’est dans l’intérêt de la paix encore qu'on fait cela et pour donner au Sultan la force de négocier à Paris et à Londres on croit qu'avec la parité de situation, occupation pour occupation. Il sera plus aisé de les faire cesser simultanément. C'est un grand gâchis que tout cela. Et jamais on n’a été aussi près de la catastrophe.
Aberdeen est très ferme dit Cowley dans le parti qui vient d’être pris. Lansdowne ne croit pas du tout à la retraite. Midi. Dans ce moment, une lettre de Greville très longue, je vous en enverrai copie demain, très desponding, ne voyant pas jour à sortir de la difficulté et à éviter la guerre. Il désire bien connaître votre opinion, et si vous voyez une solution possible. Pensez-y. Il me demande déjà où j' irais. C’est jolie d’avoir à songer à cela. Adieu. Adieu.
51. Schlangenbad, Lundi 22 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le N°50 est allé à Paris, je vous en préviens, votre lettre du 19 m’apprend votre changement d’époque pour votre séjour-là. Meyendorff me mande l'acceptation de la Porte de l’ultimatum reste à coordonner l’évacuation des principautés avec la retraite des flottes. Il pense qu'il y aura quelques courses de courrier, et que cela se fera sans beaucoup de diffi cultée, mais plus ou moins de temps.
Au fond nous sortions de mauvaise affaire très bien. Les [?] seront de notre côté. Il ne seront pas du côté de Lord Redcliffe. La Russie n’a pas été effrayée de l’Europe. Je pars demain matin avec regret, mais mon fils s'ennuie, il n’y a plus personne que des royautés qui l'incom modent. Je répugne à un nouvel établissement à Bade, je n’ai de ressource qu’en m’en retournant à Paris, et là personne, ce n’est pas brillant. Adieu. Adieu.
50. Schlangenbad, Dimanche 21 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je ne partage point du tout votre opinion sur la conduite des Anglais dans l’affaire d'Orient et je suis bien plus de l’avis de Duchatel qui m'écrivait ceci : " le gouvernement Français sort de l’épreuve à son honneur, pour lui c’est du côté de la sagesse et de la modération qu’il gagne. Je ne ferai pas le même compliment à l'Angleterre, aveuglément confiante au début. Absurdement colère dans la crise, devient la paix et ne recevant le dénouement qu’en grognant tout cela me parait une triste politique. "
La séance de 16 à la Chambre basse n’est pas brillante pour le ministère, et le Times même l'abandonne & se moque de lui. Hier est venu la nouvelle que l'Empereur d'Autriche est fiancé à une princesse de Bavière. Son père est duc en Bavière. Elles sont six soeurs pas jolies. J'ai été enfin rendre visite hier à la D. de Nassau à Wiesbade. Je lui devais cela pour l’année dernière et celle-ci. Un établissement ravissant. Palais Moresque dans le meilleur goût. Le temps est superbe. Je crains que l’été n’arrive tout juste lorsque je rentre dans un quartier d’hiver. Je pars après demain, mais je ne sais pas quelle route ni combien de temps je me trainerai en chemin. Adieu. Adieu.
48. Schlangenbad, Mercredi 17 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier lady Jersey arrivant de Londres. Très opposition, mais disant que le Ministère se soutiendra. Prévoyant la chute de l'Angleterre. Elle ne reste debout que pas l’amour et le respect qu’on a pour la Reine.
La G. D. Olga fait furrore. C'est une admiration extraordinaire. Voilà tout Lady Jersey. Mme Rothschild me mande de Paris que Lord Cowley se plaint du gouvernement français qu'il trouve trop russe, ou plutôt trop pressé de la paix. Il me semble que l'Angleterre ne l’est pas moins. On ne sait rien encore de sûr de Constantinople, et il y a encore bien des difficultés à vaincre. Il pleut ici, j'en suis bien fâchée, cela gâte mes derniers moments. C’est mardi le 23 que je quitterai ceci. Adieu. Adieu.
44. Schlangenbad, Mardi 9 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Ma cour a consenti à l’Ultima tum que l’Autriche adresse à la Porte. Voilà une bonne affaire, très bonne pour Aberdeen. Il faut maintenant que la Porte accepte. Si elle le fait nous recevons son ambassadeur. Meyendorff qui me mande cela espère que la France & l'[Angleterre] soutiendront leur oeuvre et retireront tout appui à la Turquie si elle refuse cette dernière planche de salut. Comme démonstration de cette menace il faudrait rappeler les flottes et nous évacuerons les principautés ; il est en bonne espérance et content de lui même car ceci est son œuvre.
Pardonnez moi, mais votre critique des manoeuvres de notre flotte de la Baltique aussi bien que du camps de Chobane est singulière. Mais de tous temps on exerce des troupes. Et depuis que nous avons un vaisseau il fait des promenades. dans la saison d’été pour exercer les matelots à la manœuvre. Est-ce que vous n'envoyez pas les vôtres à droite et à gauche en été pour la même raison ? Nous restons dans notre coin la Baltique ; dans d’autres années ils viennent dans la mer du nord, voilà la différence pour cette année. Et les régimes Anglais ? Mais c’est un camps d’exercices comme Satory, comme St Omer, comme Krasno Selo où mon empereur. fait manoeuvrer tous les ans 100 m hommes. Le chiffre n’y fait rien.
Voilà qui est trop long pour la question militaire. Mon fils n’est pas arrivé encore, ce qui me surprend. Il y a depuis quelques jours un vent glacial, abominable. Mon rhume est plus fort que jamais. La duchesse de Nassau est venue me voir ; bien gentille et bonne. Mes impolitesses sont acceptées, je ne rends visite à personne. Adieu. Adieu.
43. Schlangenbad, Samedi 6 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous envoie copie de deux lettres. Tout cela a très mauvais air, & la réponse de Clarendon à la chambre haute complète et compliquée. Je ne vois plus le moyen d'éviter la guerre et je reste plus triste que jamais. Le roi de Wurtemberg vient sans cesse causer avec moi, il s’étonne et s’afflige car on ne voit pas le bout. Ce serait une grande surprise, aujourd’hui de voir l’affaire s’arranger. Je crains que nous ne voyions pas cela.
Ma santé me tracasse, rien de mieux et presque du pire. Je suis cependant si docile. Tous les Croy sont partis ce matin, c’est une petite très petite diminution pour mon salon, car ils n'ont point d’esprit. Je garde deux hommes de la suite de roi de [Wurtemberg]. Et le comte de Brie Belge qui a cloué les princes & qui est très agréable. Jeune et de bonne mine. Ma nièce reste toujours avec moi. Madame Oudinoff est ici. La Princesse Charles de Prusse est la plus ennuyeuse des femmes, Dieu merci elle ne vient pas. Elle avait voulu le faire mais elle a compris que le deuil de son père devait la retenir chez elle. Je n'ai rien à vous dire du tout qu’adieu.
Les lettres de Meyendorff sont pour vous seul.
41. Schlangenbad (Allemagne), Mardi 2 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
39. Schlangenbad (Allemagne), Samedi 30 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le silence de Meyendorff m'inquiète. Constantin en rentrant à Berlin a trouvé Budberg parfaitement ignorant. Il n’avait pas reçu une ligne cependant de tous côtés on croit à la paix. J’ai été assez frappée dans les deux dernières lettres de Greville de ce qu'il dit que l’obstination de Lord Aberdeen à crier la paix sur les toits a dû encourager mon Empereur, & qu’on trouve qu'[Aberdeen] en a fait & dit assez et trop dans ce sens. Malgré cela, il est évident que le pays aussi ne veut de la paix.
James Rothschild va venir ici compléter le congrés de famille. Je suis furieuse et tout le monde ici avec moi de la porte de ce petit endroit. Les lettres & journaux y viennent tard & une fois le jour seulement. On vient hier de faire un nouvel essai par d’autres routes, cela a si bien réussi qu’il n’est rien venu du tout. Il faut attendre ce soir.
J’ai tous les soirs quelque personnes que je renvoie à 9 heures. Rien d’intéressant et pas mal bigarré. Une comtesse Sacy charmante, jolie & spirituelle. Le prince de Croy bête. Le comte de Brie qui [?] les princes Belges fort distingués, un général autrichien Lochi, un peu bouffe italien. Ma nièce dîne toujours avec moi et y est le soir aussi. Marion dîne souvent chez les Rothschild, cela l’amuse. Le temps est toujours variable. Je fais peu de chose de la princesse Charles de Prusse. Elle m’invite chez elle, je n’y vais pas, elle est trop ennuyeuse. Sa cousine la reine de Hollande l’a complètement oubliée l’autre jour elle en est furieuse.
Adieu. Adieu, car je n’ai plus rien à dire.
38. Schlangenbad, Jeudi 28 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu quelques surprises ces jours ci. Le Prince Emile est venu ici avant hier pour quelques heures. Nous avons beaucoup et agréablement. bavardé. Hier la reine des Pays-Bas pour deux heures seulement, elle est venue les passer presque en entier chez moi. Je n’avais pas l'honneur de la connaître. Elle n’est plus belle ; très réservée, donnant peu son opinion, mais curieuse, contant bien et me laissant d'elle une impression très agréable. Le peu qu’elle dit est très spirituel. On voit que son père l’adore. Et puis imaginez Mad. jeune Rothschild tombant. ici avec le [général] Changarnier, les vieux sont ici. Ils lui font visite pour quelques jours. Changarnier est venu me voir. Engraissé, tranquile, sensé, non seule ment aucune aigreur, mais des bonnes paroles, rendant justice. Fort occupé de la question d'Orient. Trouvant que son empereur se conduit bien là dedans. Blâmant un peu le mien. Nous n’avons pas parlé de la France.
Madame jeune ne se gène pas, qu’est-ce que dira le [Paron] ? Marion est très amusée. Elle est allé dîner chez eux pour avoir le plaisir de se disputer avec [Changarnier] mais il n'y a pas sur quoi, il est ou très discret, ou un peu converti. En tout cas très patient.
Lord Greville m'écrit très tristement. On s’impatiente en Angleterre. On veut un dénouement immédiat, ou bien la guerre. On commence à avoir de grands soupçons. Moi je reprends toutes mes inquiétudes. Au fait elles ne m'avaient jamais tout à fait quittée. Le temps est toujours orageux ma santé la même, je n'ai pas à m'en vanter. Adieu. Adieu.
36. Schlangenbad, Samedi 23 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je n’ai rien au monde à vous dire, mais je suis curieuse de savoir ce que vous avez dit de la circulaire de Drouyn de Lhuys. Moi je l’ai trouvé très bien faite simple, claire, et sans réplique. Très supérieur à Nesselrode. Est-ce de la rédaction de Thomanel ou du chef ?
Le roi de [Wurtemberg] a passé ici deux jours en courses pour faire visite à ses filles. Je ne l’ai pas vu. Mon fils Alexandre a été malade à Naples. Cela retarde son arrivée. Il ne sera à Paris que la semaine prochaine, & ici sans doute quand je voudrai. Ce sera alors que je déciderai où aller. Je n’ai pas grande envie de me remuer pour autre chose que pour rentrer dans mon home. Je ne crois pas qu’à tout prendre mon voyage n’aura fait beaucoup de bien ; il me donne avant tout le goût du repos. Adieu, voici une pauvre lettre. Du Val Richer il y a au moins les commentaires, mais que voulez vous qui vienne de Schlangenbad. Adieu. Adieu.
35. Schlangenbad, Jeudi 21 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
D'abord ma santé. Elle est comme vous l'avez vue. Ems m'a laissée comme j'étais. Attendons Schlangenbad.
J'ai eu deux longues lettres de C. Greville la dernière du 18. On avait reçu à Pétersbourg, les propositions de la France, et nous en étions contents. On voulait seulement encore l’aboucher avec l’Autriche, mais cela était fait et convenu avec elle entre temps. La proposition anglaise qu'on dit meilleure encore pour nous aura par conséquent été mieux reçu encore. Les projets pleuvent de tous les côtés. La paix ne peut pas manquer de sortir de tout cela. La réponse de Drouin de Lhuys arrivera après coup et ne dérangera rien. Voilà le point de vue de Londres et je le crois exact. Je trouve cette réponse très bien faite, on ne pouvait pas se dispenser de la faire.
Le roi de [Wurtemberg] m’a fait encore hier une longue visite, trop longue, car même avec beaucoup d’esprit Il ne faut pas me tenir trop longtemps. Je ne puis pas le renvoyer comme un autre et voilà que les impolies angoisses me gagnent. Il y a perdu son dîner et moi ma promenade. Nous arrangerons cela mieux à l'avenir. Il sait beaucoup de choses & moi je lui en apprends quelque unes. Le 22 Constantin m’est arrivé hier inopinément. Il a déserté pour deux jours. Les nouvelles sont bonnes. On va à la paix seulement cette avalanche de projets fait de l'embarras. Il faudra donner la préférence à l’un d’entre eux. Votre Empereur est très bien, tout le monde se loue de lui, Cowley aussi bien que Kisseleff. Menchikoff reste à Sébastopol chef apparent de l’armée de mer & de terre, mais au fond en disgrâce. Il voulait renverser Nesselrode. Beaucoup de petites nouvelles curieuses. Le Prince Emile de Darmstadt est venu de Wisbade hier pour me voir. Toujours charmant le plus charmant Prince que je connaisse.
Adieu. Adieu. Je me baigne tous les jours, malgré ce mauvais temps.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (Russie), Empire (France), Enfants (Benckendorff), Femme (diplomatie), Politique (France), Politique (Internationale), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée)
30. Ems, Dimanche 10 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu vraiment un grand plaisir à apprendre le succès de votre fils. Je vous prie de lui en faire mon compliment très sincères. Je comprends la joie que cela vous aura donnée.
Voici la dernière proposition comme à Paris je crois, comme par nous et appuyé par l'Autriche à Constantinople. La Turquie nous enverrait un ambassadeur muni de la certaine note signée. Il nous la remettrait & recevrait en échange l’assurance écrite que nous ne ferons usage de notre protectorat du culte orthodoxe que dans un but religieux, & jamais politique On me demande le secret sur ce projet. Je vous prie donc de le garder. Il doit réussir à moins que Stratford rascal ne s’y oppose.
Je suis charmée de la remise du débat au Parlement. Tout cela à l’air pacifique. à juger par tout ce qui me revient votre gouvernement a une conduite très sage. Aberdeen. est plus gêné que lui, mais au total j’espère aussi que là on ira bien.
La chaleur a été étouffante ici. Aujourd’hui c’est mieux. Ma nièce est partie hier, elle me précède à Schlangenbad, J'y vais samedi le 16. C’est donc là toujours duché de Nassau que vous m’adresserez vos lettres. Je commence à avoir un peu de société ici. D'abord les deux princes de Prusse, le futur roi, & le Prince George, les [Panin], Platen, les de l'Aigle elle est insupportable, une princesse Carolath assez animée. On vient chez moi le soir, à 9 1/2 je chasse tout le monde. Avant 10 heures je suis dans mon lit. A 7 1/2 debout et à la promenade. Je dîne à 3 1/2. Vous avez ma journée avec le bain & les courses en voiture de plus. Adieu. Adieu.
28. Ems, Vendredi 8 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
L'impératrice m'écrit en date du 2. " J’espère en Dieu qu'il bénira les intentions droites & simples de mon empereur, & que la guerre. sera évitée. " Bonnes paroles, les dernières.
Le manifeste va exalter le sentiment religieux, mais il laisse encore ouverture à la négociation. Nous allons savoir tout à l’heure si Constantinople regarde l’entrée dans les principautés comme cas de guerre.
Je suis inquiète de tous ces complots à Paris. Que Dieu nous préserve d'un malheur là. Le comte [?] est arrivé. De l’esprit, beaucoup de connaissances, pas trop versé dans la diplomatie. Fort disposé à causer. Cherchant à apprendre. Défendant notre cause très bien, mais ne me persuadant pas. Toujours en doute de l'Angleterre c.a.d. ne croyant pas qu’elle puisse en venir aux extrémités.
Quant à nous pas l'ombre d'un doute que nous aurons Constantinople, & que personne ne peut nous en empêcher. Des préparatifs sur la plus grande échelle et les Turcs impuissants & appauvris. Le temps est à la chaleur, mais excessive. Je suis fondue. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Circulation épistolaire, Conversation, Femme (politique), Mariâ Aleksandrovna (1824-1880 ; impératrice de Russie), Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Portrait, Réseau social et politique, Socialisme