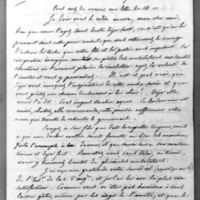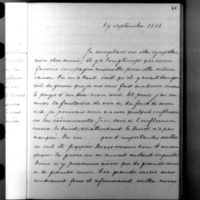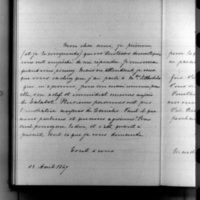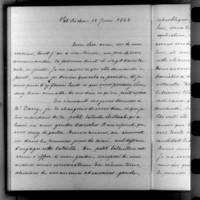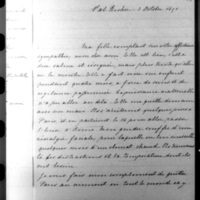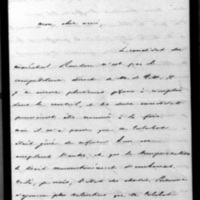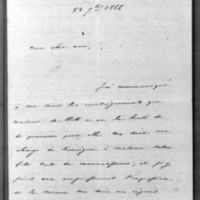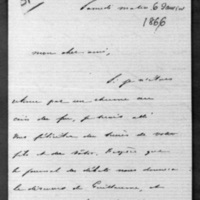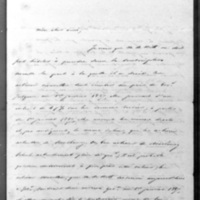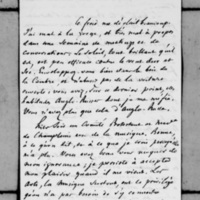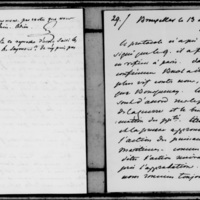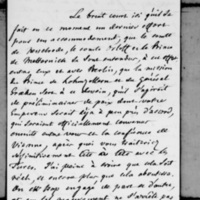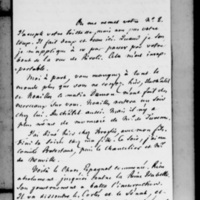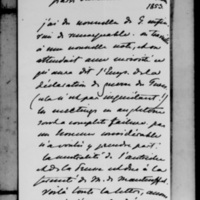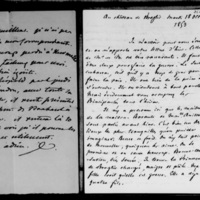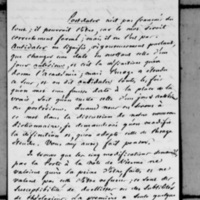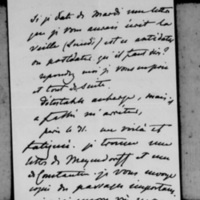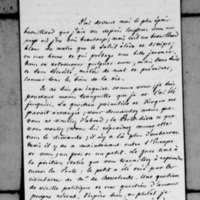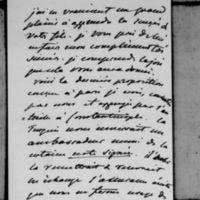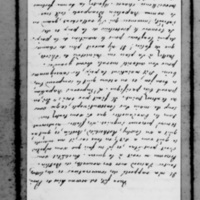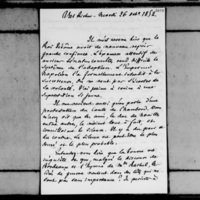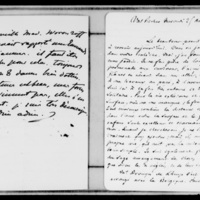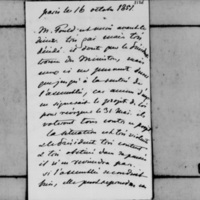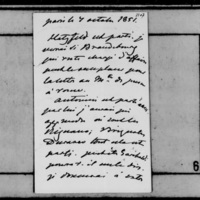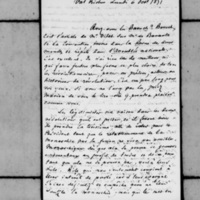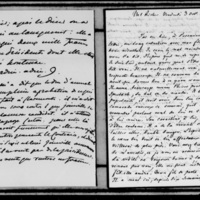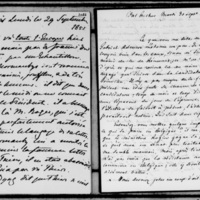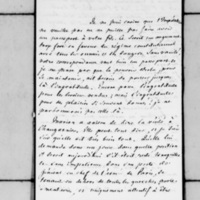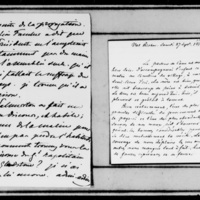Votre recherche dans le corpus : 538 résultats dans 5770 notices du site.
Versailles, le 4 juin 1871, Eloi Mallac à François Guizot
Changy, le 15 août 1857, Eloi Mallac à François Guizot
Paris, le 3 octobre 1851, Eloi Mallac à François Guizot
Nîmes, le 14 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot
Nîmes, le 23 août 1827, Joseph Madier de Montjau à François Guizot
Val-Richer, le 29 septembre 1867, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Paris, le 12 avril 1867, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Val-Richer, le 14 septembre 1866, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Val-Richer, le 18 janvier 1866, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Val-Richer, le 8 janvier 1866, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Val-Richer, le 12 juin 1863, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Val-Richer, le 5 octobre 1851, François Guizot à Pierre-Sylvain Dumon
Paris, le 28 mai 1867, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Castels, le 23 septembre 1866, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Paris, le 17 février 1866, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Paris, le 6 janvier 1866, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Paris, le 18 octobre 1853, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
Paris, le 30 septembre 1851, Pierre-Sylvain Dumon à François Guizot
49. Paris, Mardi 25 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce froid me déplait beaucoup. J’ai mal à la gorge, et très mal à propos dans une semaine de meetings et de conversations. Le soleil tout brillant qu’il est, est peu efficace contre le vent dur et sec. Enveloppez-vous bien dans le bois de La Cambre, et n'abusez pas de la voiture ouverte ; vous avez, sur ce dernier point, des habitudes Anglo-russes dont je me méfie. Vous n’avez plus que cela d' Anglo-Russe.
Hier soir, un Comité Protestant et Mad. de Champlouis avec de la musique. Bonne à ce qu’on dit, et à ce que je crois parce qu'elle m’a plu. Vous avez beau vous moquez de mon ignorance ; je persiste à accepter. mon plaisir quand il me vient. Les arts, la musique surtout ont le privilège qu’on n'a pas besoin de s'y connaître pour en jouir. Ils trouvent toujours, dans les plus inexpérimentés, des fibres qu’ils remuent, et qui à leur tour, remuent toute l'âme.
Le traité de la Prusse et de l’Autriche fait de l'effet. On dit qu’il sera communiqué à la Diète de Francfort qui l’approuvera, et qu'alors, c’est-à-dire vers l'automne, au nom de toute l'Allemagne, on demandera aux Puissances belligérantes de mettre fin, par une transaction, à une situation interminable par la guerre. On parle même déjà des bases de la transaction ; on dirait que votre Empereur a eu tort dans les deux moyens qu’il a pris pour imposer à la Porte ses demandes, sa mission du Prince Mentchikoff et l’occupation des Principautés ; mais il avait réellement quelque chose à demander, et la Porte a eu tort de lui refuser toute satisfaction, et les Puissances occidentales ont eu tort de ne pas engager sérieusement la Porte à lui en accorder une. Tous ces torts admis, on en viendrait à l’évacuation des Principautés, et à un congrès, si mieux n’aimaient votre Empereur et la Porte en finir tout de suite par quelque chose d’analogue à la Note de Vienne un peu modifiée et sans commentaire. Voilà les prédictions. Je n’ai pas trouvé Andral hier quand j’ai passé chez lui. Je lui écrivais ce matin pour le presser, si vous ne me dites pas qu’il a répondu.
Les départs commencent. Henriette part lundi prochain pour le Val Richer, avec son mari et son enfant. Pauline et les siens resteront avec moi jusqu’au 19 Mai. Nous ferons les élections de l' Académie Française le 18, et celles de l'Académie des inscriptions le 19 et le soir même je partirai, à ma grande satisfaction. Les Broglie seront retenus un peu plus longtemps à Paris à cause des couches de la belle-fille qui va très bien. Les Ste Aulaire et les Duchâtel seront partis.
Adieu, Adieu. Avez-vous repensé à Mlle de Chériny ou à quelque autre ? Je dois dire que M. de Chériny n'a pas du tout l’air d’une grande dame Allemande à qui il faut apporter sa chaise. Adieu, G
Mots-clés : Académies, Diplomatie, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Femme (maternité), Femme (portrait), Guerre de Crimée (1853-1856), Musique, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Allemagne), Politique (Autriche), Politique (Prusse), Portrait (Dorothée), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Santé (François)
29. Bruxelles, Jeudi 13 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le protocole n’a pu être signé que le 9. Il a fallu en référer à Paris. Dans la conférence, Bual a été le plus vif contre nous, plus que Bourguenay. Les quatre sont d’accord sur le principe de la guerre, et le but l'évacuation des principautés. L'Autriche et la Prusse approuvent l’action des puissances maritimes. Comme vous dites l’action suivra de près l’approbation. Cependant nous sommes toujours contents de la Prusse, c’est-ce que me dit encore une lettre reçue ce matin.
Meyendorff dit qu’aujourd’hui que Canning a obtenu ce qu'il voulait à Constantinople, il est très possible qu’il veuille la paix et qu'il la fasse. Redshid veut garder les étrangers il n'y a de sûreté pour ses oeuvres et pour lui- même que dans leur présence. Le pauvre Meyendorff est dans son lit et très malade. Il n’a pas pu m'écrire ici, à Brunnow à qui il a cependant envoyé un courrier.
Savez-vous comment s’arrange le commandement de l’armée entre St Arnaud & Raglan ? Ni moi je ne puis croire à la saisie des meubles de Seymour. Ils peuvent ne pas lui être arrivés encore mais les prendre, c’est impossible. Quel article dans le Times sur cela ! Quel grossier langage, bon pour l'écurie. Je pense avec plaisir au plaisir que vous donnent vos enfants et petits enfants. Je ne suis pas selfish. Adieu. Adieu.
Mots-clés : Diplomatie, Enfants (Guizot), Guerre de Crimée (1853-1856), Presse
27. Bruxelles, Mardi 11 avril 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Oui, tout est bien triste, ce que vous me dites de la lettre de l'[Empereur] d’Autriche c’est le protocole. Approbation de la guerre. Entente pour la paix, si elle est possible. Aucun engagement actuel de la part des Allemands. Ce qui est sûr c’est qu'ils se mettront du côté du plus fort si on les force à se prononcer. On dit couramment que la Prusse nous a déserté. On travaille la Suède maintenant. Il sera facile de l'entraîner, elle aura cédé à la force, cela ne gâtera pas son avenir. Et voilà comment nous aurons tout le monde sur les bras.
Marcellus aspire à l’Académie et m'écrit une lettre fort bien tournée pour obtenir vos bonnes grâces. Pourquoi pas lui, si l'Evêque d’Orléans n'en veut pas ? Que dois-je lui répondre ? Hier M. Barrot, Labensky, Mad. Pourtalis revenant de Paris, qui m’a conté toute la partie frivole. Mad. Chreptovitch a fait avec moi le bois de la Cambre. Le soir le beau (on dit que je lui plais beaucoup. Je m'étonne, il m’endort.) Van Praet et voilà tout. Vous allez être bien content au jourd'hui du retour de votre fille et de vos petits-enfants. Vous êtes bien heureux. Si j’avais cela et la campagne comme vous ! Mais je n'ai rien. Brunnow vient aussi se loger à Bellevue. Adieu, le beau temps continue pour narguer ma tristesse. Adieu. Adieu.
Barrot m’a dit sur vous d’excellentes paroles, & cité de très bonnes choses que vous lui avez dites, et à d’autres aussi. Le [gouvernement] français aurait à se féliciter de vos bons propos.
32. Paris, Samedi 8 avril 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous savez un peu précisément quand les Ellice doivent venir à Paris, avertissez moi. Je dirai à Marion tout ce qu’il y a à lui dire. Sans être sûr du succès. J’ai dit à Montebello qu’il devrait bien aller vous voir, et ce qu’il faut pour l’y engager votre désir, votre château &. Il en a bien envie ; mais il doute et je doute. Ses affaires, ses enfants, leurs études, leurs examens & & Il a ici son fils le marin, pour quelques jours. Ce n'est pas sur le Tilit, mais sur l'Inflexible, le vaisseau de l’amiral Parseval, que s’embarque ce jeune homme. Il vient d'avoir à Brest une quasi pleurésie, et il tonne encore beaucoup. Le père est inquiet, et je trouve qu’il a raison.
Hier matin, l'Académie des inscriptions. Rien que de la science sur l'Orient, le grand Orient, l'Inde, la Chine, celui où la guerre n’est pas encore.
Dîner chez moi, tête à tête avec mon fils. Le soir chez Montalembert. Assez de monde pour sa satisfaction, pas trop. Ste Aulaire, Flavigny, Janvier, Mortemart, Chasseloup Laubat. Les honneurs du Débat, pour l'opposition, sont à ce dernier. Il a vraiment très bien parlé, modérément, habilement, et chaudement.
Montalembert est appelé aujourd’hui devant le juge d'instruction pour être interrogé sur la publication de sa lettre. Il maintiendra pleinement son dire que la publication n'a été, ni son intention, ni son fait. On m’a paru content dans la maison, le ménage et les amis. Tout le monde dit que l'Empereur dit que Montalembert n'ira point en prison. On tient surtout à ce qu’il perde ses droits civiques, ce qui le mettra hors du Corps législatif. Quelques personnes s'engagent à donner sa démission, il n’en fera rien ; il veut être chassé.
De chez Montalembert, chez Broglie. Personne que l’intérieur et Piscatory qui ne fait que traverser Paris. Il mène sa femme et ses enfans s'amuser six semaines en Italie. Le Duc de Broglie aussi pacifique que jamais souhaitant vivement que la lettre le Berlin ait quelque vertu, mais voulant beaucoup, et de l’intention, et de l'efficacité. Adieu. Adieu.
Je n'ai rien de vous ce matin. Je sors de bonne heure. On commence à se lamenter du beau temps. Adieu. G.
Mots-clés : Académies, Enfants (Guizot), Politique (France), Réseau social et politique, Salon
18. Paris, Mercredi 15 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier, un dîner agréable chez Mad. de Caraman ; Broglie, et son fils, Montalembert, et sa femme, Berryer, George d'Harcourt, et Lady William Russell. Spirituelle, et étonnée de découvrir qu'elle ne savait pas bien l’histoire de la mort de César. Je lui ai appris l’existence du récit le plus détaillé, le plus contemporain et le plus politique au fait. Il est vrai que la publication en est récente. Elle prend à l'érudition beaucoup plus d’intérêt qu’à la politique.
On parlait assez du Prince de Hohenzollern, et on ne croyait pas que l’attitude de la Prusse eût été aussi bien prise ici que vous le présumez.
2 heures
J’ai été dérangé par trois visites ; mais elles ne m'ont rien apporté. L'emprunt réussit beaucoup ; il y avait hier grand concours de prêteurs. On dit que Fould n’a pas été d’avis de cette démocratie financière. Je n'ai point entendu dire que le maréchal St Arnaud passât par Vienne. Mais on disait hier qu’il allait passer huit ou dix jours à la campagne pour se reposer avant d’entrer en campagne. Je vous enverrai mon Cromwell qui paraît demain. Si vos yeux s'en accommodent, cela vous amusera. Adieu.
Il faut que je sorte pour affaires. Je vais lundi soir passer trois jours au Val Richer, pour affaires aussi. J'y mène un jardinier. J’irai m'y établir complètement du 1er au 15 mai. Ma fille Pauline sera ici, le 15 avril. Adieu. G.
17. Paris, Mardi 14 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le bruit court ici qu’il se fait en ce moment un dernier effort pour un accommodement, que le comte de Nesselrode, le comte Orloff et le Prince de Metternich se sont entendus, à cet effet, entre eux et avec Berlin, que la mission du Prince de Hohenzollern et du général Groeben sont à ce dessein, qu’il s’agirait de préliminaires de paix dont votre Empereur serait déjà à peu près d'accord, qui seraient officiellement convenus ensuite entre vous et la conférence de Vienne, après quoi vous traiteriez définitivement tête-à-tête avec les Turcs. J’ai peine à croire que cela soit réel, et encore plus que cela aboutisse. On est trop engagé de part et d’autre, et un tel mouvement ne s'arrête pas devant un travail si incertain et si obscur.
Je ne suis pas sorti hier soir. Je suis resté chez ma fille, à jouer au whist et à causer domestiquement. Vous ai-je dit qu'avant hier, dans la matinée, j’ai rencontré Thiers chez Mad. de Rémusat ? Quand je suis entré, il était assis à côté d'elle sur un canapé, avec deux autres visiteurs dans le salon ; il s'est levé en m'offrant sa place. " Non, lui ai je dit, je ne me mettrai sur ce canapé que si vous y restez. - bien volontiers. " Nous nous sommes assis à côté l’un de l'autre, et Mad. de Rémusat est allée se mettre sur un fauteuil. Une heure de conversation animée, et amusante.
Thiers, très partisan de la guerre ; vous croyant très puissants et très redoutables mais mon pas invincibles ; tôt ou tard, il aurait fallu en découdre avec vous ; l'occasion est bonne pour l'alliance, mauvaise pour vous. Inquiet de l’avenir cependant ; parlant bien du Maréchal Vaillant comme ministre de la guerre, homme capable, honnête et homme d’ordre, du reste, très bon enfant et visiblement caressant, non sans un peu d’embarras, en commençant. Mais tout embarras disparaît vite entre gens d’esprit. Cette heure là m'a plu, sans ne rien apprendre, ni rien changer.
On m’a dit positivement que Castelbajac avait été reçu. Je tâcherai de savoir comment. Je remarque que les diplomates ne viennent presque pas chez Molé. J’y suis allé les deux derniers mardi ; Hatzfeld lui-même n’y était pas. J’ai rencontré Hübner samedi sur l'escalier des Rothschild. Il descendait je montais. Nous nous sommes arrêtés deux minutes à causer, pour rien. Il n’a paru plutôt pas content. Adieu, Adieu. Je dîne aujourd’hui chez Madame de Caraman. G.
4. Paris, Lundi 27 février 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
On me remet votre N°2. J'accepte votre tristesse, mais non pas votre toux. Il fait doux et beau ici. Quand je sors, je m’applique à ne pas passer par votre bout de la rue de Rivoli. Cela m'est insup portable. Moi à part, vous manquez à tout le monde plus que vous ne croyez. Hier, Duchâtel et Noailles, ce matin Dumon m'ont fait des morceaux sur vous. Noailles restera un soir chez lui. Duchâtel aussi. Mais il n’y a plus même de monnaie de M. de Turenne. J’ai dîné hier chez Broglie avec mon fils. Fini la soirée chez ma fille. Ce soir, j’ai un comité Protestant, puis le chancelier et M. de Neuville.
Voilà le chaos Espagnol commencé. Rien absolument jusqu'ici contre la Reine Isabelle. Son gouvernement a battu l'insurrection. Il va dissoudre les Cortès et le Sénat, et convoquer des Cortès constituantes qui feront une constitution nouvelle, plus monarchique. A Saragosse, le colonel Horé, chefs des insurgés, a été tué à la tête de son régiment, le régiment de Cordoue. Le capitaine général, avec les Grenadiers de la Reine, l’a chassé de la ville. 150 hommes sont restés sur la place, parmi lesquels quelques bourgeois. A Madrid, beaucoup d'hommes considérables ont été arrêtés, Gonzales Bravo, le général Serrano &. On s'attend à une guerre civile où reparaîtront tous les partis, Carlistes, Espartéristes, Républicains & &. Une dépêche télégraphique courait hier soir disant que la République avait été proclamée à Madrid. On n'y croyait pas.
Le Prince Napoléon commandera un corps de réserve, à Constantinople. Duchâtel avait hier une lettre d’Ellice inquiet pour le cabinet anglais, à l'occasion du bill de réforme de Lord John. On croit qu’entre l'opposition, quelques radicaux mécontents et les députés des bourgs que son bill dépouille de leur privilège électoral, il pourrait bien se former une majorité qui lui infligeât un échec qu’il n'accepterait pas. L'échec serait au profit de Lord Palmerston. Je n'y crois pas. Le Parlement ne dérangera pas aujourd’hui le gouvernement. Lord John a du guignon. J’ai une lettre de Croker qui a fait réimprimer en une petite brochure, toute leur correspondance à propos de Moore avec des additions assez piquantes. Il me dit : All the world here of all parties, as Brougham writes to me, agree that I have had a complete victory.
Rothschild ne fait pas l'emprunt. On dit qu’on le mettra en adjudication quand le corps législatif sera réuni. Si vous ne savez pas bien ce que cela veut dire, demandez-le au premier venu qui vous l'expliquera. Le bœuf gras se promène très paisiblement. Il s’appelle M. d'Artagnan, et non plus le Prince Mentchikoff. Adieu, Adieu. G
La fin du discours de Clarendon est remarquable d’un ton plus élevé que de coutume et ouvrant, sur l'avenir, une longue perspective pleine de guerre et aussi de réserves. On prévoit beaucoup, et on ne veut. s’engager sur rien.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Enfants (Guizot), Femme (politique), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Réseau social et politique, Salon, Tristesse
1. Paris, Vendredi 24 février 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J'avais résolu de ne pas vous dire un mot de mon chagrin et de mon vide. Cela ne se peut pas. Il y aurait trop de mensonge dans le silence. Mais je ne vous en dirais pas plus long qu'hier matin, en vous quittant. Que Dieu vous garde et vous ramène. Je reste à Paris et vous êtes à Bruxelles. Sans vous, Paris, pour moi, c’est Bruxelles pour vous.
Hier matin, l’Académie. Tout le monde y était, sauf le Duc de Noailles. Dupin m'a demandé si vous étiez partie, avec des paroles de regret et s'excusant de n'être pas allé vous voir ces derniers jours. Je le soupçonne, un peu de n'avoir pas voulu être classé parmi les complices de la Russie. Peu de conversation politique. L’Académie commence à s'occuper du jugement des prix qu’elle a à donner cette année. C'est son coup de feu. Cela la distrait des autres.
Le soir quelques personnes chez moi, entre autres, le Duc de Broglie et son fils. Broglie était venu me voir la veille, et m’avait touché. Après m'avoir parlé de toutes choses, il m'avait dit, d’un bon d’amitié aussi vraie qu’embarrassée " Vous allez vous trouver bien seul ; venez nous voir plus souvent ; nous sommes chez nous tous les jours, les dimanche et lundi chez moi, les mardi, jeudi et samedi chez Mad. d'Haussonville la mère, les mercredi et vendredi chez ma fille et chez Mad. de Stael ; vous aurez toujours là de quoi causer avec des amis. Et puis, venez dîner toutes les fois que vous voudrez, avec Guillaume." Je lui ai serré la main de bon cœur.
On ne parlait que de deux choses l’entrée de l’Autriche dans l'alliance et le soulèvement des Chrétiens de Turquie. Deux grosses choses. On ne sait précisément et certainement ni l’une ni l’autre ; mais on les accueille l’une et l’autre avec faveur, comme des espérances ou des moyens de retour à la paix qui est toujours l'idée fixe de ce pays-ci. Je me trompe ; on parlait un peu d’une deux jours. Moins nombreuses qu’on ne l’avait dit ; mais on en annonçait d'autres. On dit, aussi que quelques personnes seront engagées à aller à la campagne. " à quelle compagne ? - Oh,à leur propre campagne, chez elles, hors de Paris seulement. "
Je ne suppose elle serait bien superflue ; je n'attends que le retour de ma fille Pauline pour m'en aller au Val Richer.
A onze heures, je suis allé signer le contrat de la petite La Redorte. Une cohue immense ; 1700 personnes invitées ; l’ennui de la queue m’a pris ; il faisait sec et pas froid ; j'ai laissé là ma voiture et j’ai été à pied. En arrivant, sur l'escalier, 2 ou 300 personnes montant, 2 ou 300 descendant ; tout le monde de connaissance, étrangers et Français ; quelques rares légitimistes. J’ai vu la Maréchale et La Redorte qui donnait le bras à sa fille ; très jolie. Il m’avait rencontré dans le premier salon ; il est revenu sur ses pas avec sa fille : " Ma fille veut vous bien voir et vous remercier d'être venu."
J’ai mis dix minutes à redescendre l'escalier. Au bas, j’ai rencontré Thiers qui attendait : " N'est-ce pas, lui ai-je dit, que la patience est la plus difficile des vertus ? - Oui ; pourtant, on l’apprend avec l’âge. - Comme on apprend ce qu’on subit." J'étais dans mon lit à minuit. J'espère que vous étiez depuis longtemps dans le vôtre. J’ai joui pour vous du beau temps de la journée. Adieu, adieu. Pour combien de temps ? Adieu. G.
Paris, Dimanche 23 octobre 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai des nouvelles de [Greville] enfin rien de remarquable. On travaille à une nouvelle note, et on attendait avec curiosité ce qu’aura dit l’[Empereur] de la déclaration de guerre des Turcs. (cela n’est pas inquiétant !) Les meeting en Angleterre sont a complete failure. Pas un homme considérable n’a voulu y prendre part.
La neutralité de l’Autriche et de la Prusse est due à la fermeté de M. de Manteuffel. Voilà toute la lettre, accompagnée d’assez de dégoût de toute cette affaire. Le Cabinet devait se réunir la semaine prochaine. On me mande de Berlin que nous resterons sur la défense tout l'hiver, et que nous accueillerons toute proposition venant de Constantinople ayant pour but de finir à l'amiable. Cela n’est pas fier! Quelle sotte affaire !
Je vous ferai réponse après demain sur M. Monod. Je ne sais point de nouvelle de Compiègne. Marie [Meiringen] y est. On passera quelques jours de la semaine à St Cloud, et puis Fontainebleau. Les Hatzfeld sont revenus contents & pas bavards. Hübner est toujours aigre. Dumon est réparti. Viel Castel aussi de sorte que je suis assez abandonnée. Adieu. Adieu.
Offrez je vous prie mille voeux de ma part à votre fille. J’espère que ce voyage réussira. Adieu.
Au château de Broglie, Mardi 18 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je m'assois pour vous écrire et on m’apporte votre lettre d’hier. Celle de M. de Meyendorff est très rassurante. Il faut être deux pour faire la guerre. Le seul embarras, c’est qu’il y a trop de gens pour faire la paix. Ils ont bien de la peine à s'entendre. Ils en viendront à bout pourtant. Mais évidemment vous occuperez les principautés tout l'hiver.
Il n’y a personne ici que les maîtres de la maison. Barante, et Mad. Anisson sont partis avant hier. C’est bien un des lieux les plus tranquilles qu’on puisse imaginer. Beau et froid. On n’y sait point de nouvelles, quoiqu'on les aime. On se promène et on cause beaucoup. Bonne conversation, très sensée. Je trouve la princesse de Broglie changée, maigre et pâle. Ma fille croit qu’elle est grosse. Elle a déjà quatre fils.
J'écrirai demain à M. Monod ; mais sa lettre me fait, comme à vous l'impression qu’il n’a, quant à présent, point de pensionnaires, et je suis tout-à-fait de votre avis, il faut des camarades. M. Meyer, dont il parle est un excellent homme, pasteur luthérien, collègue de M. Morny. Je sais qu’il a en effet plusieurs fils jeunes peut-être à défaut de M. Monod cela conviendrait-il ?
Il est très bon que le Roi Léopold aille en Angleterre. La Reine Marie Amélie s’est arrêtée à Genève assez malade d’un rhume violent. En arrivant, elle avait fait dire à Mad. de Staël, qui est à Coppet de venir la voir, et quand Mad. de Staël est venue, elle n’a pas pu la recevoir. Elle restera à Genève jusqu'à ce que son rhume soit tout-à-fait passé. On n’avait cependant point d'inquiétude sur son compte.
Je suis bien aise que vous ayez retrouvé Dumon, et que du monde vous arrive. Je crois que vous en aurez beaucoup cet hiver. On sera agité sans vrai malheur, ni même vraie inquiétude. On court alors, on voyage.
Je trouve excessif que Kisseleff et Hübner ne soient pas invités à Compiègne. Il n’y a pas de raison pour cela. C'est trop d'empressement à couper l'Europe en deux, sans compter qu’on ne la coupe pas réellement en deux. Tant qu'Aberdeen sera au pouvoir, il ménagera l’Autriche, et la Prusse fera toujours plus que vous ménager. Adieu.
J’irai samedi prochain 22 au Val Richer dire adieu à ma fille Pauline qui part le lundi 24 pour Hières, je reviendrai ici Mardi 25 pour toute la semaine prochaine. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Amis et relations, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Description, Diplomatie, Diplomatie (Russie), Education, Enfants (Guizot), Europe, Famille royale (France), Femme (maternité), Femme (portrait), Femme (santé), Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Internationale), Portrait, Réseau social et politique, Salon, Voyage
55. Val Richer, Samedi 2 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Postdater n’est pas français du tout ; il pourrait l'être, car le mot serait correctement formé ; mais il ne l'est pas. Antidater ne signifie, rigoureusement parlant, que changer une date en mettant celle d’un jour antérieur, et c’est la définition qu’en donne l'Académie ; mais l’usage a étendu ce sens, et on dit antidater toutes les fois qu’on met une fausse date à la place de la vraie, soit qu'on mette celle d’un jour antérieur ou postérieur. Quand nous en serons à ce mot dans la discussion de notre nouveau dictionnaire, je demanderai qu’on modifie la définition et qu’on adopte celle de l'usage étendu. Vous m’y aurez fait penser.
Je trouve que les cinq modifications demandées par la Porte à la note de Vienne ne valaient guère la peine d'être faites, et ne valent pas celle d'être refusées ; ce sont des susceptibilités de Duellistes ou des subtilités de théologiens. La première a seule quelque intérêt pour vous ; il peut convenir à votre Empereur, pour la Russie, que le Sultan lui-même reconnaisse la vive sollicitude que les Empereurs de Russie ont de tout temps témoigné pour l'Eglise grecque, et le Sultan à mon avis, peut très bien reconnaître ce fait sans déroger. J’aurais été plus difficile que le sultan pour la troisième modification, j’aurais demandé le changement de ces mots : restera fidèle à la lettre et à l’esprit &, car ils impliquent un peu qu’il ne l’a pas toujours été, et il peut moins convenir de cela que de votre vive sollicitude pour l'Eglise grecque. Mais en vérité, il n’y a pas là de quoi fournir à une demi heure de conversation sérieuse entre hommes sensés ; et que ces modifications soient acceptées ou refusées, la situation des parties, comme on dit, restera en droit et en fait, absolument la même. Acceptez-les donc et n’en parlons plus.
Je suis très touché de l’intérêt que M. de Meyendorff veut bien porter au succès de mon fils, et je l'en remercie. Ma part dans l’éducation de mes enfants a été de m’arranger pour les faire vivre avec moi et pour causer avec eux. Je les ai eus tous les jours, de très bonne heure, à déjeuner et à dîner avec moi, heure d’intimité et de conversation. L'affection et le développement intellectuel y ont également gagné. Mon fils, a du reste suivi les classes et mené la vie de collège ; mais sans se détacher de la famille. Je suis un grand partisan de la famille, en pratique quotidienne comme un principe politique. En fait d’arrangements de famille, je vois avec une vive contrariété qu’on se décide au prolongement du boulevard de la Madeleine et qu’on va se mettre à l'œuvre. On me prendra donc ma maison. Grand déplaisir, outre l'ennui d’un déménagement. J’avais bien compté mourir dans ce nid-là.
Onze heures
Votre lettre de Bar m'était arrivée tard, et je voulais faire une petite recherche sur postdater, avant de vous répondre. Voilà la cause de mon retard, volontaire et non étourdi. Adieu, Adieu. Je répondrai à Marion. Adieu. G.
53. Bar le Duc, Mardi 30 août 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Si je date de Mardi une lettre que je vous aurais écrit la veille (Lundi) est-ce antidater on postdater qu'il faut dire ? Répondez-moi je vous en prie et tout de suite. Détestable auberge, mais il a fallu m’arrêter.
Paris le 31. Me voilà et fatiguée. Je trouve une lettre de Meyendorff et une de Constantin. Je vous envoie copie des passages importants. Je n’ai encore vu personne ici et ma lettre partira avant toute visite, mais ces deux lettres me semblent renfermer ce qui est essentiel. Greville me mandait si les Turcs ne font pas what we prescribe nous ne pouvons plus les soutenir. Voyons comment tout cela ira, maintenant, notre partie est la belle. Heeckeren m’a dit que jamais les vaisseaux. Français ne reculeraient tant que nous resterons dans les principautés. Nous verrons. Comment pourraient-ils entrer dans les Dardanelles sans provoquer le guerre, et ils ne peuvent pas rester à Besika. Adieu. Adieu.
Je copie un autre passage de la lettre de Meyendorff. " je voudrais vous dire tout le plaisir avec un peu d'envie que j’ai éprouvé ici apprenant le beau sens du fils de M. Guizot. Comme j’admire le père d’avoir eu le temps de bien élever ses enfants ! "
42. Val Richer, Jeudi 4 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai devant moi le plus épais brouillard que j'ai vu depuis longtemps dans un pays où j'en vois beaucoup ; mais c’est un brouillard blanc du matin que le soleil élève et dissipe en une heure, et qui présage une belle journée. Nous en retrouvons quelques unes, mais sans suite et sans sécurité mêlées de mal et précaires, comme tous les biens de la vie.
Je ne suis pas inquiet comme vous ; je suis pourtant moins tranquille que je ne l’ai été jusqu'ici. La question primitive et turque me paraît arrangée ; vous demandez moins que vous ne vouliez d'abord ; la Porte dira ce que vous voulez ; vous lui répondrez comme elle vous le demande ; il n’y a là plus d’embarras. Mais il y en a maintenant entre l'Europe et vous ; un gros et un petit. Le gros tient à la position isolée que vous travaillez à reprendre envers la Porte ; le petit a été créé par les circulaires de M. de Nesselrode. Une question de vieille politique et une question d’amour propre récent. J'espère bien, ou plutôt je compte que ni l’une, ni l’autre n’amènera la guerre ; mais je ne vois pas encore comment on les arrangera l’une et l'autre, à la quasi satisfaction des partis intéressés, condition nécessaire de tout arrangement. Il faudra bien qu’on en vienne à bout. Quand ce sera fait, je me donnerai le plaisir de vous dire ce que, depuis longtemps, j’ai à vous dire, et je ne vous dis pas.
Je vois que vous aussi vous faites parader vos flottes dans la Baltique comme dans la mer noire. Est-ce bien utile et de bien bon goût ? Cela me fait un peu le même effet que le camp de Chobham en Angleterre, un joujou rare et fragile dont on s'amuse. En général, il ne faut pas se mettre beaucoup en avant par le côté où l’on n'est pas le premier. Il paraît que notre ami Aberdeen a couru un véritable danger. Les cabs font bien du bruit à Londres. Je ne leur aurais jamais pardonné s'ils lui avaient fait vraiment mal, car je l’aime toujours beaucoup malgré son silence que je comprends. Plus on aurait envie de causer à coeur ouvert, moins on parle quand on ne le peut pas.
Avez-vous fait quelque attention, dans le Galignani, aux articles tirés d’un nouveau journal Anglais, the Press, qui me paraît se consacrer à la cause de l'Aristocratie territoriale, intelligente et libérale, de l'Angleterre ? Je viens d'en lire un, sur l’Angleterre, la Russie et les Etats-Unis, qui est très spirituel et très politique. Je voudrais bien que cette cause-là, qui est la bonne, fût bien défendue ; elle l'est bien faiblement depuis longtemps.
Je vous quitte pour faire ma toilette. Je pars ce matin à 10 heures, pour une course de campagne qui me prendra la journée. Je fais plus de ces courses-là que je ne voudrais. Mon gendre Conrad cherche à acheter une petite terre dans ce pays-ci, et il me demande d'aller voir tout ce qu’on lui propose. J’espère que ce sera bientôt fini. Pauline est encore un peu souffrante, plus de fièvre, mais une névralgie douloureuse, et qui l'abat.
10 heures
Adieu, adieu. Je pars sans que mon facteur soit arrivé, ce qui est toujours un grand ennui. G.
36. Val Richer, Vendredi 22 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Je vais demain à Trouville, rendre les visites qui me sont venues de là depuis un mois. Je partirai à 7 heures du matin. J’écris donc aujourd’hui, très ennuyé de n'avoir que demain soir, en revenant, votre lettre qui m’arrivera à onze heures. Je suis frappé de la haine que vous portent les catholiques ardents. L’Univers de ce matin dit en propres termes : " N'oublions jamais que la Russie est la pire ennemie de notre civilisation et de notre foi. " Il a presque oublié sa haine pour l’Angleterre depuis qu’elle vous fait de l'opposition. Autrefois l'hérésie passait pour pire que le schisme. La paix déplaira beaucoup à ce monde là. Elle déplaira à ceux qui souhaitent la chute de l'Empire Ottoman et à ceux qui seraient bien aises de vous voir un peu battus et affaiblis. Ce sont deux petites minorités. L'immense majorité veut la paix et y compte. Si votre Empereur trompait son attente, s’il repoussait les moyens d'accommodement qu’on lui propose, il n’y aurait pas assez de malédictions pour lui. Mais cela ne sera pas. Je me suis étonné de trouver dans une de vos dernières lettres. " Je commence à croire que l'Empereur veut la guerre ; tout est si mûr pour cela ! " Il n’y a rien de mûr du tout. La question Turque ne sera mûre, pour vous, que lorsque vous aurez avec vous, pour la résoudre, toute l'Europe ou au moins une moitié de l'Europe. Avec toute l'Europe contre vous, c’est un fruit vert bien loin d'être mûr. Il est très vrai qu’on ne vous empêcherait pas d'aller à Constantinople. Mais après ? Vous auriez toute l'Europe sur les bras, ou à l'écart de vous. Et comme vous ne pouvez pas plus venir, chez nous que nous chez vous à moins d'avoir l'Allemagne avec vous, la guerre resterait maritime, mauvais jeu pour vous. Si vous avez le concert Européen, ou si vous voulez la révolution Européenne, à la bonne heure, vous pouvez jeter bas la Turquie, sans l’une ou l'autre de ces deux hypothèses, c’est insensé. Vous êtes très puissants pas assez pour avoir toute l’Europe contre vous, les uns par les armes, les autres par la neutralité armée et malveillante. Faites la paix ; cela vaut infiniment mieux pour vous, comme pour tout le monde.
Voilà une pluie énorme. Nous avons eu hier quelques heures de beau temps. On recommence à s'inquiéter un peu de la récolte. Le renchérissement du pain fait grogner Paris. Je doute que les immenses fêtes qu’on prépare pour le 15 août suffisent à le consoler. J’irai y passer deux jours, non pas le 15 août et pour les fêtes, mais le 25, pour la séance de l'Académie où mon fils va recevoir son prix. Et puis, quand vous serez de retour. Avez-vous fixé l’époque ? Combien de temps passerez-vous à Baden. J’ai reçu ce matin une lettre de M. Molé qui me demande si je n’irai pas à Paris, et me presse pour Champlâtreux. Je n'en ferai rien. Je suis trop pressé de ce que je veux finir ici. C’est assez d'être souvent dérangé chez soi et sans en bouger.
Molé ne me dit du reste pas un mot de rien.
Samedi 6 heures
Je me lève, et je vais faire ma toilette. Adieu. Adieu. Il fait un temps superbe. G.
30. Ems, Dimanche 10 juillet 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J'ai eu vraiment un grand plaisir à apprendre le succès de votre fils. Je vous prie de lui en faire mon compliment très sincères. Je comprends la joie que cela vous aura donnée.
Voici la dernière proposition comme à Paris je crois, comme par nous et appuyé par l'Autriche à Constantinople. La Turquie nous enverrait un ambassadeur muni de la certaine note signée. Il nous la remettrait & recevrait en échange l’assurance écrite que nous ne ferons usage de notre protectorat du culte orthodoxe que dans un but religieux, & jamais politique On me demande le secret sur ce projet. Je vous prie donc de le garder. Il doit réussir à moins que Stratford rascal ne s’y oppose.
Je suis charmée de la remise du débat au Parlement. Tout cela à l’air pacifique. à juger par tout ce qui me revient votre gouvernement a une conduite très sage. Aberdeen. est plus gêné que lui, mais au total j’espère aussi que là on ira bien.
La chaleur a été étouffante ici. Aujourd’hui c’est mieux. Ma nièce est partie hier, elle me précède à Schlangenbad, J'y vais samedi le 16. C’est donc là toujours duché de Nassau que vous m’adresserez vos lettres. Je commence à avoir un peu de société ici. D'abord les deux princes de Prusse, le futur roi, & le Prince George, les [Panin], Platen, les de l'Aigle elle est insupportable, une princesse Carolath assez animée. On vient chez moi le soir, à 9 1/2 je chasse tout le monde. Avant 10 heures je suis dans mon lit. A 7 1/2 debout et à la promenade. Je dîne à 3 1/2. Vous avez ma journée avec le bain & les courses en voiture de plus. Adieu. Adieu.
28. Val Richer, Jeudi 7 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon fils est revenu hier de Paris. Il m’a rapporté des conversations et des lettres, toutes d'accord avec vos nouvelles de Berlin. Personne ne croit à la guerre. Duchâtel vous écrit peut-être, et je ne fais que vous répéter ce qu’il vous a dit ; en tous cas, il me mande qu’il a vu Cowley, Rothschild, Bertin, et qu’il n’a trouvé personne inquiet. Les flottes n'entreront dans les Dardanelles que si vous tentez un coup de main sur Constantinople, ce que vous ne tenterez point. Il finit par ceci : " Ici, on paraît très pacifique. L'Empereur Napoléon a beau jeu, et on assure qu’il le comprend très bien. S’il maintient la paix, les conséquences pour son autorité morale seront grandes. Mettez à sa place un ministère de Thiers, que de folies ! Il n’y aurait plus de chances depuis longtemps pour le maintien de la paix. Se trouver le protecteur de la paix et des intérêts immenses qui s'y rattachent, quand on se nomme Napoléon Bonaparte, c’est une merveilleuse chance. Ajouter la bonne fortune de voir l'Empereur Nicolas se conduire en aventurier fantasque ! Il est vraiment né coiffé."
Pardon de vous envoyer les paroles textuelles Une autre bonne main m'écrit : " En Angleterre, les craintes qu'inspire la récolte ont beaucoup refroidi l'humeur guerrière ; les dispositions pacifiques de la cité viendront en aide à l'influence modératrice de Lord Aberdeen. Ici, on est très calme et très satisfait d'avoir conquis l'alliance anglaise ; on ne désire pas la guerre, et on fera tout ce qu’il faudra faire pour l'éviter. "
Résignez vous à croire à la paix sans savoir comment on s'y prendra pour la rétablir. La prétention de savoir comment est la source de toutes les incrédulités. Les philosophes du siècle dernier ne croyaient pas en Dieu ni en l'autre vie parce qu’ils ne parvenaient pas à savoir comment Dieu est fait et comment, nous, nous serons faits. Que de choses même dans ce monde-ci, qu’il faut croire sans en savoir le comment ! Du reste les termes de votre manifeste du 5 fait entrevoir un comment ; le mot s'obliger sans dire envers qui semble admettre ces combinaisons qui résoudraient la difficulté. Nous verrons.
Le Ministre des Etats-Unis à Pétersbourg serait-il admis à la cour dans le costume du [?] Franklin, comme le président M. Pierre vient de le recommander à tous ses agents ? Ce serait là une pauvreté bien ridicule s’il n’y avait pas derrière la recommandation, une fierté et une puissance démocratique très réelles.
Onze heures et demie
Mon facteur arrive tard. Il ne m’apporte rien de nouveau. Adieu, adieu. G.
27. Val Richer, Mardi 5 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous me donnez l’esprit des grandes choses d’une façon qui me refuse celui des petites. J’ai envie d'être choqué. La première fois que vous me consulterez sur les comptes de votre maître d'hôtel, je n'aurai pas d’avis.
J’ai les journaux du gouvernement dans les feuilles d'Havas qui me donnent des extraits du Constitutionnel et du pays, et aussi de petits articles originaux qui sont ce que le Gouvernement veut dire à ses fonctionnaires. Votre politique y est de plus en plus sévèrement jugée, mais toujours pacifiquement. Deux choses me semblent certaines, l’une qu’on vous donnera toutes les facilités possibles pour couvrir votre honneur l'autre, que si vous voulez pousser les choses très loin, vous trouverez tout le monde uni contre vous ; les uns vous feront la guerre, les autres ne vous soutiendront pas. Je parle très tranquillement de cette extrémité parce que je n'y crois point. Mais je serai charmé le jour où il ne sera même plus possible d’un parler. Je veux vous savoir tranquille aussi, et ne songeant qu'à profiter des eaux et à revenir à Paris. Je suis bien aise qu’on négocie entre Londres et Pétersbourg. Il ne se fera rien, et rien de bon à Constantinople. La transaction doit se faire là où est la puissance, je ne crois point que le Cabinet anglais ait abdiqué entre les mains de Lord Stratford. Il soutiendra son agent, mais sans se laisser mener par lui. J’espère que votre Empereur, en fera autant. La visite au général Ogareff à Portsmouth m’a fait plaisir à lire. C’est un petit symptôme des dispositions pacifiques et un beau symptôme des moeurs douces et libérales de notre temps.
J’ai eu ces jours-ci un plaisir d’une autre sorte. L’Académie Française avait mis au concours une étude historique et littéraire sur le poète Ménandre, et la comédie chez les Grecs. Elle a partagé le prix entre mon fils et un savant homme d’esprit de 40 ans Guillaume en a vingt. Son mémoire est vraiment spirituel et mérite, je crois, cette distinction.
18 heures et demie.
Voilà le Pruth passé. Quand vous serez établi dans les provinces, et que vous aurez ainsi fait acte de puissance, ferez-vous acte de modération ? Si les Turcs ou les Grecs ne font pas de folie, je l’espère. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Mardi 26 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il m’est revenu hier que le roi Jérôme avait de nouveau repris grande confiance. L'examen attentif des anciens Senatus consultes rend difficile, le système de l'adoption. L'Empereur Napoléon l’a formellement interdit à ses successeurs. On ne veut pas s'écarter de sa volonté. J’ai peine à croire à une superstition si jeune.
Il me revient aussi qu’on parle d’une protestation du comte de Chambord. Vous m’avez dit que ses amis, le Duc de Noailles entre autres, le niaient tout-à-fait, et conseillaient le silence. Il y a du pour et du contre. Le silence est peut-être le plus sensé et le plus probable.
Entendez-vous dire que la bourse est inquiète et que malgré le discours de Bordeaux et l'hymne de Mlle Rachel, les idées de guerre roulent dans des têtes qui ne sont pas sans importance ?
Je persiste à croire à la paix prochaine. Je suis convaincu que l’Europe y aidera jusqu'à la dernière limite de la possibilité.
Mes hôtes Anglais sont partis hier. J’ai fini des visites. J'en ai eu cette année au moins autant que j'en désirai. Certainement si je n'étais pas pressé d'aller vous voir je resterais ici plus tard. J’ai peu de curiosité pour les petites choses, et peu d’espérance, pour les grandes.
Le mouvement et le bruit de Paris ne conviennent guère à cette disposition. Mais je veux vous voir. Je compte décidément partir le 12 et vous voir le 13. Ma fille aînée part le 2.
Onze heures
J’ai toujours un peu craint, je vous l'avoue, que votre faveur n'allât pas beaucoup au delà de l'amusement que vous donnez. L’égoïsme, tantôt sérieux, tantôt frivole, est la vice d'en haut. Quand on a obtenu ce qu’on veut, ou ce qui plaît, on ne pense plus à rien ni à personne.
On pouvait prédire l'apoplexie d’Appony. Ce serait plus singulier si c’était sa femme. Adieu, Adieu.
Il fait bien vilain. Je crois qu’il est certain qu’à propos de l'Empire, on ne fera et ne dira rien à Claremont. La Duchesse d'Orléans avait quelque envie de parler, au nom de la monarchie constitutionnelle. Les Princes sont décidés à se taire.
Val Richer, Mardi 31 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ma maison est fort tranquille aujourd’hui. J’y suis seul avec mes filles et mes petites filles. Tous les hommes sont partis pour la chasse qui s'ouvre ce matin. Pauline n’est pas du tout malade, elle a eu quelques soins à prendre pour se remettre de ses couches et un commencement de mal de gorge qui l’a fait rester, 24 heures dans son lit, mais ce n'était rien et elle va bien, comme une personne délicate.
Il y a longtemps que Génie ne m’a écrit. Dans ce que dit le Moniteur sur Constantinople, il n’est pas du tout question des Lieux Saints. Je suppose que cette affaire-là, en est resté où elle était, et qu’on parle des petites affaires arrangées pour éviter de parler de la grosse qui ne l'est pas.
10 heures et demie.
Il ne fait pas chaud du tout ici. Je voudrais bien vous envoyer un peu de ma fraîcheur et de ma verdure normande. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Mercredi 25 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le beau temps paraît décidé à revenir aujourd’hui. Vous en jouirez dans votre calèche. Moi, j'en jouis dans mon jardin. Je ne fais guère de longue promenade aux environs. J’aime mieux flâner en rêvant dans mes allées. Je rêve à mes travaux, au passé, à l'avenir. Je suis ici à la fois très entouré et très solitaire. Pour la vie extérieure et à la surface, rien ne me manque ; le fond est vide. C'est curieux combien la distance est grande dans l’âme entre la surface et le fond.
Mes enfants sont excellents et charmants pour moi. Quand je chercherais, je ne saurais vraiment qu’y ajouter ; mais ils ont leur propre vie, qui n’est pas la mienne. C’est tout simple. Je suis également frapper du sage arrangement des choses telles que Dieu les a réglées, et de leur imperfection.
M. Drouyn de Lhuys s'est donc arrangé avec la Belgique. Pour des affaires de cette sorte et de cette taille, il en sait plus que M. Turgot. Il vient de faire une bonne et juste nomination en envoyant à Londres, mon ami Herbet que vous connaissez, comme consul Général. J’ai vu avec plaisir que mon amitié ne lui faisait pas tort. Il m’est resté très attaché. Il servira très fidèlement et très capablement. Je regrette que ce mot-là ne soit pas français.
Ably, nous manque. Je trouve que les petits jeux et les bijoux qu’on gagne toujours sont des appâts un peu vulgaires. Je conviens qu’il en faut de ceux là, et quand ils réussissent, on a bien fait de les employer.
Avez-vous remarqué que M. de Radowitz vient d'être nommé inspecteur général de tous les établissements militaires de Prusse ? Est-ce un simple manque de faveur personnelle, ou bien y a-t-il là quelque politique ? Ceci me paraît peu probable.
La Suisse est vraiment une honte pour l'Europe. Je viens de lire, dans l'Assemblée nationale, une longue lettre sur l'état intérieur du canton de Neuchâtel qui fait vraiment dégoût et pitié. Les protocoles de Londres pour le maintien des droits du Roi de Prusse n’ont abouti qu'à un redoublement de tyrannie radicale. Les radicaux ont raison de se moquer des rois.
Onze heures
Demandez à votre médecin, Olliffe ou Chomel, si l’usage habituel de quelque boisson amère, comme la chicorée, ne serait pas bon pour votre estomac. Vous avez besoin de quelque tonique pas fort, mais constant. Avez-vous renoncé aux eaux de Bussang ? Prenez-vous un peu souvent de la gelée de viande ? Je voudrais bien vous trouver un peu de force.
Si la petite Princesse a moins d’esprit qu’il y a douze ans, ce n’est pas assez. Adieu. Adieu. G.
55. Val-Richer, Vendredi 6 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne m’avez pas dit si Velpeau, en vous condamnant à quinze jours d'immobilité, vous avait prescrit quelque chose de particulier, ou s’il s'était simplement borné à approuver les prescriptions de M. Brantel.
Mon fils arrive ce matin, et m’apporte, non pas des nouvelles, mais quelques détails, sur les faits connus.
On trouve en général que M. Fould a payé un peu cher sa rentrée au pouvoir en contresignant, les décrets de révocation des Conseillers d'Etat renvoyés à cause des décrets d'Orléans. Le Président, dit-on, l’a formellement exigé et il exigera aussi de M. Magne, quelque acte d’adhésion analogue. Il veut que tous ceux qui le servent, adhérent. Morny se donne comme ayant beaucoup contribué à la rentrée de Fould, et on annonce que MM. de Persigny et de Maupas ne sont pas bien fermes sur leurs étriers. Je n'en crois rien, et je crois que Fould s’arrangera avec eux.
L'avènement de Drouyn de Lhuys trouble Brenier qui n’a jamais été bien avec lui, et qui ne se promet pas d'être mieux. Waleski aussi est trouble ; Drouyn de Lhuys parle légèrement de lui, et le Président. n’a pas été content de ses pronostics sur les élections Anglaises.
On croit que les difficultés pour le mariage du Président avec la Princesse Wasa ne sont pas toutes levés, et que le père et la mère, pour la première fois du même avis, s'accordent à s'y opposer. Ce sera le Cabinet de Vienne qui lèvera, s’il veut, les difficultés là. Voudra-t-il ? Je vous répète les commérages tels quels.
On dit que les révocations dans le Conseil d'Etat, ne sont pas finies, on en voulait faire plusieurs autres, pour la même cause. Il reste cinq conseillers d'Etat qui ont voté contre les décrets. C'est Fould qui a obtenu l'abandon, ou l’ajournement de la rigueur complète.
C'est bien dommage que la bonne occasion manque à Stockhausen. Faites moi la grâce, je vous prie, si vous lui écrivez de lui dire combien je regrette son départ ; il était très bien informé de très bonne conversation, et aussi agréable que sûr.
Comptez-vous toujours retourner à Paris le 14 ? Vos fenêtres seront bien recherchées pour les fêtes. Adieu. Adieu.
Je ne serai content que quand vous me direz : " Je marche. " G.
P.S. Je m'impatiente aussi que vous n'en finissez pas. Mais j’ai vu plusieurs fois de tels accidents, pas graves et supportables. Ecrivez-moi toujours que vous ayez quelque chose à me dire, ou non. Adieu.
54. Val-Richer, Mercredi 4 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis très contrarié des quinze jours d'immobilité auxquels Velpeau vous condamne ; il a probablement raison. Mais c’est bien ennuyeux. J’aurais mieux fait de ne pas aller vous voir ; vous ne seriez pas montée dans ma chambre, et vous ne seriez pas tombée. C'est là tout ce que j'ai de mieux à vous dire.
L'insignifiance des journaux est complète. Ceux qui ne peuvent pas critiquer ne veulent pas louer. Pour surcroît le Journal des Débats, m'a manqué hier. Quand on supprime ainsi à l’esprit son aliment, on devrait supprimer aussi l'esprit lui-même. Cela se fera peu à peu.
J’ai eu hier une longue lettre de Barante qui prévoit ce résultat, car il me dit : " Lorsqu'on ne s’intéresse pas à soi-même on est indifférent à tout ; l’esprit s'éteint quand les sentiments sont glacés ! "
Il m’écrit du Mont Dore, où il est allé pour ne pas être repris l’hiver prochain de son extinction de voix.
Jeudi 5 Août
Je n’ai pas fait partir hier cette page qui n'en valait pas la peine. Vous ne m’avez pas écrit non plus. J’espère bien que ce n’est pas quelque mauvaise raison, accident ou autre. Je n'ai pas plus de nouvelles aujourd’hui qu’hier.
Mon fils, m'en apportera peut-être quelqu’une demain il est allé passer 48 heures à Paris pour un examen. Mes Anglais arrivent aussi demain.
Je vois que les élections des conseils généraux sont ce que j’attendais, ou immense majorité ministérielle c’est-à-dire présidentielle. Il me semble aussi que les pétitions impériales commencent à circuler. On m'écrit que les exilés espèrent quelque chose, du 15 Août. Ceux d’entre eux qui sont petits et modestes accepteraient volontiers l'Empire, s’il devait les faire rentrer. Que feraient les autres, Thiers, Rémusat, les généraux ? Il ne serait pas glorieux, pour eux de rentrer au milieu des Vive l'Empereur ! Ils rentreraient pourtant, s’il le leur permettait.
Avez-vous lu, dans le Galignani du 3 un article curieux du correspondant américain du Times sur Kossuth ? Il fera plaisir à Hübner.
11 heures
Voilà une lettre qui ne me plaît pas. Vous vous faites vous-même bien plus de mal que vous n'en avez. C'est singulier d'avoir l’esprit si juste, si ferme sur toutes choses, excepté sur soi-même. Je suis bien fâché de n'être plus là. Adieu, adieu. Merci de la lettre de Beauvale. Merci pour vous et pour Aggy. G.
Paris, Jeudi 16 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
M. Fould est venu avant le dîner. Très gai mais très décidé. Il doute que le Président trouve des Ministres, mais ceux-ci ne peuvent durer que jusqu’à la rentrée de l'Assemblée, car aucun d'eux ne signerait le projet de loi pour révoquer le 31 Mai. Ils voteront tous contre ce projet. La situation est très violente & le Président très content & très obstiné dans sa pensée. Il n’en reviendra pas. Si l’Assemblée se conduit bien, elle peut reprendre une grande autorité & popularité. Cela est très vrai, si elle est bien conduite. Mais où est le chef ?
Les nouvelles des départements sont mauvaises. Les paysans armés contre les châteaux. Quel moment pour un changement complet de Ministère & de politique. On persiste à dire cependant que ce Président veut rester fidèle à la politique conservatrice & qu’il en donnera des gages. Cela a l’air d’un puzzle !
[Helkerm] était chez moi hier soir. Il avait eu lundi un tête-à-tête de 2 heures avec le Président. Il prétend lui avoir dit toute la vérité & très fortement, & avoir complètement échoué. Le Président s’est plaint avec une grande amertume de Thiers & [?].
Il est 2 heures, je n’ai pas de lettres de vous. Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà Aberdeen que je vous enverrai demain. Constantin après avoir lu ma lettre à l’Empereur [?] mon procès gagné. Puisse-t-il avoir raison ! Cette affaire m'a bien détraquée. Je me sens vraiment malade. Oliffe me traite.
Je vois beaucoup de monde cela me fatigue, l’opinion est bien unanime que le Président a fait une grande faute. On dit qu’il restera à St Cloud. Il a là beaucoup de troupes. Adieu, j’ai donné mes lettres à votre fille, je l'ai manquée. Marion l’a vue & lui a trouvé bonne mine. Adieu.
Je viens de voir Vitet. La commission après avoir entendu les ministres a résolu de ne point convoquer encore l’Assemblée. Cette commission se réunira dimanche. Faucher avait dit qu’ils n'étaient en dissidence avec le Président que sur la loi du 31 Mai. Mais que cela ne lui avait pas permis de rester.
Mots-clés : Asssemblée nationale, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Femme (politique), Loi du 31 mai 1850, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (France), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée), Santé (enfants Guizot)
Paris, Mardi 7 octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
Hatzfeld est parti. Je verrai si Brandebourg qui reste chargé d’affaire peut le remplacer pour la lettre au [Ministre] de Prusse à Rome. Antonini est parti aussi, par lui j’aurais pu apprendre où sont les [Rignano ; Brignoles, Durazo, tout cela est, parti. Peut-être Garibaldi pourra-t-il me le dire. Je donnerai à votre fille une lettre pour mon ministre & pour ma nièce Wolkonsky. Je vous écris en croisant Molé un supplice, tant de venir causer que je vais ce matin à Champlatreux. J’emmène Dumon. Je reviens dîner. Pas de nouvelle. J’ai vu Bulwer, ami intime de Narvaez. Mollé a dîné ces jours-ci chez le Président à St Cloud il l'a trouvé très gai. Le Kossuth fait bien de bruit.
Votre refus de passage, & les ovations à Londres, font un grand contraste fort louable pour vous Adieu. Adieu. Une longue lettre d’Ellice que je vous enverrai quand je l'aurai lue. Lord John viendra probablement, à Paris en Novembre. L’assemblée Nationale a un pauvre article sur Abdel Kader. & où a-t-il pris la mission de Londonderry à St Pétersbourg ?
Val-Richer, Lundi 6 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous lu Baruch ? Baruch c'est l'article de M. Vitet sur M. de Barante et la Convention, inséré dans la Revue des deux mondes et répété dans l'Assemblée nationale. C'est excellent. Je n’ai rien lu de meilleur ni qui fasse justice plus ferme et plus claire de tous les révolutionnaires, passés ou présents, acteurs ou historiens de révolutions. C'est un peu long pour vos yeux. si vous ne l’avez pas lu, priez Marion de vous le lire ; elle y prendra plaisir comme vous.
Les légitimistes ont raison dans les deux résolutions qu'ils ont prises et ils feront bien de prendre la troisième, celle de voter pour le président tant que le rétablissement de la monarchie par la fusion ne sera pas possible. Monarchiques dès que cela se pourra, et gouvernementaux au profit de l’ordre, et de la paix tant que cela ne se pourra pas, voilà leur rôle. Rôle qui non seulement convient à leur intérêt de parti, car il leur épargne l’échec définitif et empêche qu'on ne leur souffle la Monarchie ; mais qui les met en sympathie et en bons termes avec la masse de la population, ce dont ils ont grand besoin. La France est monarchique au fond, et gouvernementale en attendant ; que les légitimistes soient comme elle, c'est, pour eux, le meilleur; moyen d'amener la France à être un peu comme eux ; ce qu’il faut absolument pour que la fusion et la Monarchie deviennent possibles. Que dit-on de la reculade de Thiers dans l'ordre ? Ce n'est pas lui qui a eu la pensée de la candidature du Prince de Joinville ; il ne l'a pas conseillée ; il n'en accepte pas la responsabilité. Je le reconnais bien là ; étourdi et irrésolu, téméraire et timide, ne poursuivant jamais, dans les mauvais pas les lièvres qu’il a levés. Reste à savoir si cette reculade est une manœuvre calculée ou un mouvement de retraite par embarras.
Henriette me quitte aujourd'hui et partira le 16 de Paris pour Rome. Seriez- vous assez bonne pour demander, de ma part, à M. de Hatzfeldt, s'il pourrait donner à M. de Witt quelques mots de recommandation pour M. d'Usedom qui est toujours, je crois Ministre de Prusse à Rome, et qu’on dit homme d’esprit. Ma fille, très bonne Protestante comme vous savez, désire avoir à Rome quelques connaissances protestantes surtout dans la légation de Prusse qui a à Rome une chapelle. Je donnerai à M. de Witt une lettre pour Garibaldi qu’il ira lui porter lui-même pour en avoir quelque appui auprès de la douane de Civita Vecchia, qui est, dit-on, assez difficile. Ils comptent vivre à Rome très retirés ; mais encore faut-il faire entrer ses malles et y pratiquer sa religion sans embarras. Vous serait-il possible de savoir où sont à présent, le Duc et la Duchesse de Mignano ? S'ils étaient à Rome, la Duchesse serait pour ma fille une ressource. Mais j’en doute. Onze heures Je n’ai rien de plus à vous dire qu'adieu, en attendant mieux. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 3 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai eu hier à l'occasion de votre lettre un long entretien avec mon fils. Deux bons résultats. Je crois le mal moindre qu'on ne vous l'a dit. J'espère qu’il ne se reproduira pas. Je suis sûr, autant qu'on peut l'être, qu’il m'a dit vrai. Il est naturellement vrai, et il me respecte beaucoup. Il est convenu de ce qui avait pu donner lieu à ce qu'on vous a dit. Il usera beaucoup moins l’hiver prochain du spectacle, du bal et du monde. A travers sa popularité, il croit avoir dans son collège, un camarade envieux et ennemi, qu’il a déjà rencontré parlant mal de lui et s'appliquant à lui nuire. Son caractère à lui a besoin d'être contenu. Il a de la vivacité et du laisser aller. Double danger. L’esprit est juste, le cœur très droit et très affectueux. J'y veillerai de plus près. Vous avez très bien fait de m'avertir et je vous en remercie encore. La vérité est toujours bonne à savoir, et venant par vous, elle ne peut m'être déplaisante, fût-elle amère.
Mon fils se porte très bien. Il a mené ici, depuis six semaines, une vie de mouvement physique, et de repos domestique qui lui a parfaitement réussi. Il retourne lundi à Paris, en même temps qu'Henriette, pour rentrer au Collège. Il logera chez son Professeur jusqu'à mon retour. Henriette partira de Paris le 16 ou le 17, pour s'embarquer à Marseille par le bateau du 21.
Avez-vous lu dans les Débats la note française du 19 Juillet à la Diète sur l'incorporation de tous les états autrichiens dans la confédération ? Elle est solide au fond ; quoique confuse et tronquée. Je suis curieux de savoir. Si cette question sera bientôt reprise à Francfort et si le Prince de Metternich, exprimera un avis.
Mon journal jaune dit que la candidature du Prince de Joinville, en remplacement du général Magnan est complètement abandonnée. En avez-vous entendu parler ? A en juger par l'impression que je vois se répandre et grandir autour de moi, Fould a raison. Plus on approche de la crise, plus le désir du Statu quo se prononce. Toutes les peurs et tous les doutes sont au profit du Président. Il a là une puissante armée. Si la baisse des fonds, la langueur des travaux, tout le malaise public vont croissant, cette disposition ira aussi croissant. Ce qu’il est difficile de prévoir, c’est l'effet que produiront les débats prochains, de l’Assemblée ; ils peuvent troubler beaucoup le sentiment public et le jeter momentanément hors de sa propre pente. Ce pays-ci ne sait pas de défendre; il se retrouve quand il a été perdu ; mais on peut toujours le perdre. Je me méfie du mois de novembre.
Onze heures
Je reçois une foule de petites lettres, et il est tard. Adieu, Adieu. Je vais lire l'article du Constitutionnel. G.
Val-Richer, Jeudi 2 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai jamais voulu aller revoir Neuilly. J’y aurais éprouvé le plus désagréable des sentiments, celui de la colère impuissante. Je ne connais rien de plus hideux que cette fureur destructive de la canaille contre les demeures d’un pauvre roi qui n’avait jamais fait de mal à personne, et qui parmi ses défauts n’avait certainement pas celui d'être dur et hautain envers le petit peuple.
Vous ai-je jamais dit que, pendant que j'étais encore en Angleterre du printemps de 1849, si je ne me trompe des habitants de Neuilly avaient fait une souscription pour contribuer à la reconstruction du château, et que l’un d'entre eux me l'avait envoyée en me priant d’en parler au Roi ? Je lui en parlai, et il me répondait avec le sentiment le plus amer que je lui aie peut-être jamais vu : " Non, tant que je vivrai et que Neuilly sera à moi, il restera détruit. Je trouvai qu’il avait raison.
Thiers est ce qu’il était. Il veut que Henri V et la fusion soient impossibles. La difficulté est assez grande pour qu'un peu de bon vouloir en fasse une impossibilité. Mais il serait bien fâché qu'elle fût moins grande ; et si elle l’était moins en effet, il travaillerait à l’aggraver. Toutes les fois qu’il faudra se classer définitivement, Thiers rentrera dans le camp révolutionnaire. Il n'y a en pareille conversation, qu'une réponse à lui faire, c'est d'opposer impossibilité à impossibilité, impossibilité de durée à impossibilité d'arrivée, et de lui bien mettre sur les épaules la responsabilité de celle dont il se fera le champion. Il n'y a pas moyen de ramener Thiers ; mais on peut aisément le troubler. Il faut avoir son indécision à défaut de sa conversion.
J’ai enfin des nouvelles de Piscatory, à propos de la mort de ma petite-fille. Il me dit en finissant : " Encore un mois de repos avant la lutte où il m'est impossible d’être avec qui que ce soit ; et cependant je prendrai parti. Quoi que je fasse conservez-moi votre amitié ; la quantité de la mienne compense un peu la qualité." Je n’entrevois pas quelle est la monstruosité qu’il médite de faire, et qui peut compromettre mon amitié. Il sera tout bonnement Joinvilliste.
J’ai reçu hier une longue lettre de Dumon. Noire en effet, et très spirituelle. Je ne vous en redis rien. Il vous a sûrement dit tout cela. Que dit-on du résultat définitif des élections belges ? Si le ministère n'a gagné en effet qu'une voix dans le nouveau sénat cela me suffirait pas pour faire passer sa loi, et le ministre des finances, M. Frère, qui est le révolutionnaire par excellence, pourrait bien être forcé de se retirer. Ce ne serait pas mauvais, comme exemple.
Les quatre tableaux qui terminent le manifeste napolitain sont concluants et utiles. Vous intéressez-vous au télégraphe sous-marin ? Vous ne vous doutez pas à quel point le public provincial en est occupé ; il attendait la nouvelle du succès comme celle d’une victoire. L'imagination des hommes est tournée vers ces choses là.
11 heures
Merci de votre lettre de ce matin très bonne, et qui sera utile. Je vous en parlerai demain. Merci et adieu. G.
Paris, Mercredi 1er octobre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu M. Fould hier soir, très confiant et très sérieux. Je lui ai dit mon inquiétude il s’en est fort diverti. Certainement il y aura un message. On en est occupé déjà. Les intrigues n'inquiètent pas. Quand on verra le travail [?], les fonds baisser, l’agitation & la peur gagner tout le monde, on viendra à [rescipi ?] & on sera trop heureux de se rallier autour du président. Les légitimistes doivent l’aider à refaire des institutions monarchiques. Voilà le langage. En attendant le Prince s'amuse à St Cloud & son entourage s’y ennuie, avant hier gand dîner dans le salon de la Reine. La belle Mademoiselle Montejo & sa mère la duchesse. Un grand concert de 30 personnes. Fould y va à ce qu’il me semble tous les jours.
J’ai vu Dumon hier matin ; il me dit qu'il vous a écrit ; quand il partira, ce qui sera dans 10 jours, je n’aurai plus de causerie française du tout. Kisselef est malade. Hubner & Hatzfeld en voyage. Vous voyez que je suis très délaissée. Je voulais aller à Champlatreux mais c’est fatigant.
J’ai entendu ces jours-ci parler de votre fils avec les plus grands éloges. Il a une grande popularité dans son collège et dans le monde, mais je dois vous dire qu'on vous blâme de permettre qu'il prenne si jeune encore et sans frein aucun, des plaisirs qui ruinent sa santé. Outre que c’est d'une morale un peu relâchée qui étonne de votre part, c’est d'une imprévoyance qui étonne encore plus. Il est dans l'âge où la constitution se forme & s'endurcit. L'ébranler à présent c’est un immense risque. Pensez au malheur que vous avez eu ! Je vous dis là des choses dures mais vraies. Personne n'ose vous dire la vérité, je crois que c’est parce que personne ne vous aime autant que je vous aime. Veillez sur votre fils & retenez le.
Constantin a un nouveau petit garçon. Personne ne m’a parlé de la Belgique, mais il me semble que le ministère n'y est pas en triomphe. Les Ligue ont marié hier leur fils à M. de Talleyrand. Il va célébrer cela très pompeusement et magnifiquement à [Bélocil]. Don Magnifico tout-à-fait. Il est de l'opposition au Sénat. Adieu, car je ne vois pas de nouvelle à vous dire. Adieu. Adieu.
Paris, Lundi 29 septembre 1851, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu toute l’Europe hier soir mais pas de France du tout. Pas un échantillon. Les Normanby sont revenus engraissés, joufflus & de très belle humeur. Il dit que dans tout le midi on ne connaît que le Président. Il a beaucoup vu là M. Royer, qui s’est dit parfaitement autorisé à tenir le langage de sa lettre. Normanby lui a montré le premier la fameuse lettre de Thiers, il en été abasourdi. [Noailles] n'a pas vu Thiers. Byng dit que Thiers se croit menacé d’être mis à Vincennes. Aujourd’hui le Président vient en ville pour un conseil de ministres. Il fait cela une fois la semaine, une autre fois c’est les Ministres qui vont à St Cloud. Il voit Normanby aujourd’hui.
La Princesse Menschikoff qui voit Thiers, beaucoup, me dit qu’il était, il y a quatre jours encore très inquiet d'un coup d’État. Personne n'y croit aujourd’hui. Je n'ai rien absolument à vous dire. Je suis bien aise que votre fille aille à Rome. C'est une idée heureuse. Elle y aura l’esprit bien agréablement occupé & quant à l'air, il n y a rien de mieux. Adieu.
Val-Richer, Dimanche 28 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne puis croire que l'Impératrice ne veuille pas ou ne puisse pas faire avoir un passeport à votre fils. Ce serait un argument trop fort en faveur du régime constitutionnel avec tous ses ennuis et ses dangers. Sans vanité, votre correspondance vaut bien un passeport, et je ne pense pas que le pouvoir absolu, pour se maintenir, ait besoin de pousser jusque là l’ingratitude. Encore passe l’ingratitude pour les services rendus ; mais l’ingratitude pour des plaisirs si souvent donnés ! Je ne pardonnerais pas celle-là.
Marion a raison de dire la vérité à Changarnier. Elle peut tout dire, et je suis sûr qu’elle dit très bien tout. Qu'elle lui demande donc un jour dans quelle position il serait aujourd’hui, s’il était resté tranquille et sans impatience, dans son poste de Général en Chef de l’armée de Paris, se tenant en dehors de toutes les querelles parlementaires, et uniquement attentif à être toujours le représentant et le défenseur de l’ordre, soit à l'Elysée, soit à l'Assemblée. Il serait. aujourd’hui, entre Louis Napoléon et le Prince de Joinville le candidat naturel et obligé du parti de l’ordre à la présidence, la seule et assurée ressource de la majorité et du public dans leur perplexité. Pour moi je ne me console pas qu'il ne se soit pas ménagé cette chance simple infaillible, et je n'espère pas qu'en glanant de tous côtes des débris de partis, il s'en refasse une qui en approche, de bien loin. Personne n'est plus noir que moi, dans ce moment-ci.
La déclaration du Général Magnan au Président ne m'étonne pas. La peur gagnera tout le monde. Mais le lendemain du jour où tout le monde a eu peur ne vaut pas mieux que la veille, et nous ne serons pas tirés d'embarras parce que le président y sera tombé.
La Duchesse de Marmier n'a pas le moindre crédit à Claremont, et ses paroles ne signifient absolument rien. Mais elle remplacera là Mad. Mollien qui en dit quelques fois de bonnes. Pas beaucoup plus efficaces, il est vrai. Cependant, je persiste à croire que les bonnes paroles valent mieux que les mauvaises. Je regrette donc Mad. Mollien à Claremont.
Ma fille est assez bien. Elle a un peu dormi. Il iront son mari et elle, passer l'hiver à Rome. La santé de son mari a besoin du midi, et les raisons qui venaient de l'enfant ne subsistant plus. Rome vaut mieux qu' Hyères. Ils partiront vers le milieu d'octobre.
10 heures et demie
Henriette vous remercie de vos paroles qui lui ont été au cœur. Et moi aussi. Elle supportera comme il faut les épreuves et j'espère que Dieu lui enverra encore des joies. Adieu, Adieu. Je reçois ce matin beaucoup de lettres et on m'attend pour la prière. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 27 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le pasteur de Caen est arrivé hier soir. J'accompagnerai l'enfant ce matin au cimetière du village, à une demi-lieue d’ici. La mère est bien, quoique elle ait beaucoup de peine à dormir Le temps est beau aujourd’hui. Hier, il pleuvait et grêlait à torrents.
Bien certainement, l’une des plus grandes difficultés du Gouvernement dans ce pays-ci et l'une des plus abondantes sources de nos maux, c'est l’horreur qu’ont les hommes considérables pour se dire mutuellement la vérité. Le courage de nous déplaire, les uns aux autres nous manque tout-à-fait. Que de fausses espérances et de fausses démarches on supprimerait si on supprimait la moitié seulement des réticences et des silences ! Presque tous nos embarras avec Changarnier, et une bonne partie de ses embarras à lui viennent de là. On ne les fera pas disparaître, en se traitant de grand capitaine et grand orateur. Je suppose qu’entre les légitimistes et dans le comité des douze, on n’est pas plus courageux que dans votre salon et que les embarras, les chimères et les hésitations continueront dans cet interview-là comme par le passé et comme ailleurs.
Faites-moi la grâce de demander à M. de Hatzfeldt s’il sait quel est l’auteur d’une brochure intitulée. France et Europe ; six lettres tirées du portefeuille d’un homme politique, imprimée à Berlin en 1849, et qui m’est venue de là. Brochure très monarchique et très Prussienne, assez spirituelle quoique très confuse. Quatre des lettres sont adressées à moi, à M. Thiers, à M. de Nesselrode et au Ministère Manteuffel ; elles finissent par demander un congrés de souverains.
10 heures
Je n'ai que le temps de vous dire adieu. On se réunit dans mon Cabinet pour la prière commune. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 25 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Ma petite fille est morte ce matin, deux heures après que je vous avais écrit. Sans souffrance ; elle s'est éteinte, plutôt par impossibilité de vivre que par maladie, à force de soins, on lui a donné quelques mois de vie ; mais les soins n'ont pas pu davantage. Sa mère est résignée, par soumission à Dieu et par courage naturel, mais très triste ; elle soignait son enfant avec une vigilance passionnée. Je ne crois pas que cela change rien à leur projet de passer l’hiver dans le midi. C’est surtout son mari qui en a besoin.
J’ai eu ce matin vos deux lettres. Certainement tout cela est de la pitoyable conduite. Les légitimistes n'avaient pas et n'ont pas autre chose à faire que de soutenir le président tant qu'ils ne peuvent pas avoir la Monarchie par la fusion, et non seulement de le faire, mais de dire tout haut pourquoi ils le font. Mais ils veulent suivre leurs fantaisies comme s'ils étaient assez forts pour les faire réussir. Tous les partis en France sont à la fois impuissants et intraitables. C’est un spectacle ridicule. Quelque grosse sottise passera à travers tout cela, et elle aura son temps même son temps de triomphe comme toutes les sottises. Puis elle tombera, en ayant aggravé le mal général.
Je suis très triste et très décidé à ne mettre la main dans aucune sottise. Je suis tombé. Si je ne puis pas me relever à ma satisfaction, je resterai à la place où je suis tombé.
Vous ne lisez pas le Messager. Celui qui m'est arrivé ce matin contient un grand article évidemment inspiré par Thiers sur les conférences de Champlâtreux. J'en suis toujours. L'article a l’air fait pour la présidence de Changarnier. Au fond, il laisse le choix entre le Prince de Joinville et Changarnier. Et ce choix restera ouvert jusqu'au dernier moment. Changarnier a son parti pris de n'en prendre aucun et d'être, soit en premier, soit en second, le restaurateur de n'importe laquelle des deux monarchies.
Le propos de M. Carlier, sur de nouvelles élections m'étonne. Ils ont, ce me semble plus à redouter la proposition Créton, et le vote des lois pénales contre la réélection que des élections nouvelles. Mais ils savent sans doute mieux que moi où ils en sont.
Vendredi 26 7 heures
Je me lève. La plus petite et la plus obscure mort est solennelle. Tant que cette pauvre enfant est là, toute la maison lui appartient, et n'est que son tombeau. J’ai écrit à Caen pour faire venir le Pasteur Prostestant qui réside là. Nous n'en avons pas de plus rapproché. Il arrivera ce soir ou demain matin. L’enterrement se fera demain. C’est un grand isolement, et quelques fois un grand embarras, que de n'être pas de la religion générale du pays qu'on habite. Je n’ai nul embarras ; tout mon village, y compris le Curé, est très bienveillant pour moi et se prête avec coeur à tout. Mais l'isolement subsiste toujours.
Onze heures
Votre lettre est intéressante. Et le trio a dû l'être. Vous avez bien raison de dire tout haut votre sentiment. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Amis et relations, Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, Enfants (Guizot), Femme (maternité), Femme (politique), Mort, Pensée politique et sociale, Politique (Analyse), Politique (France), Portrait, Posture politique, Presse, Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Religion, Réseau social et politique, Santé (enfants Guizot)