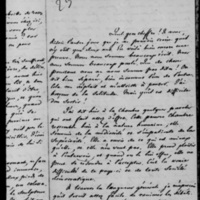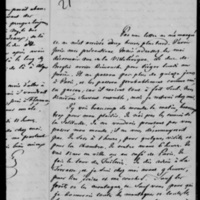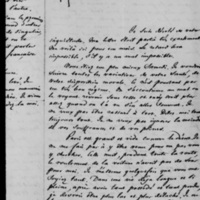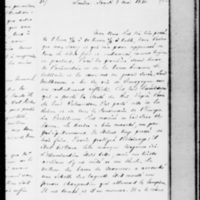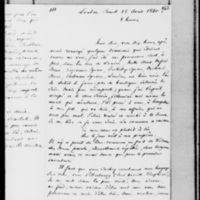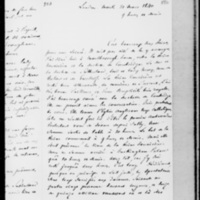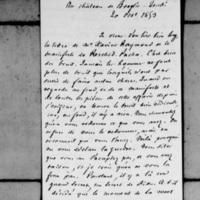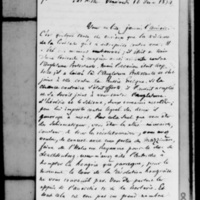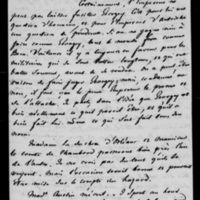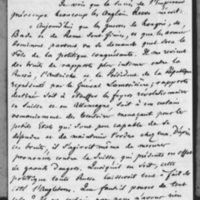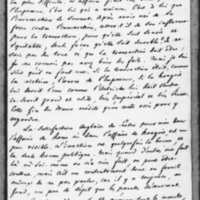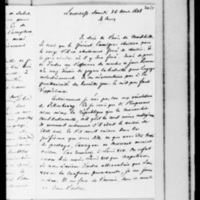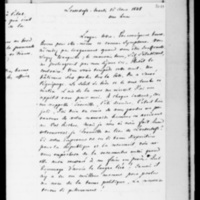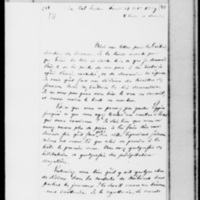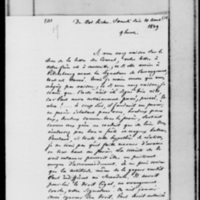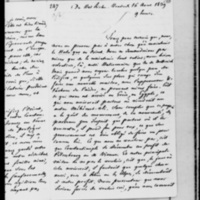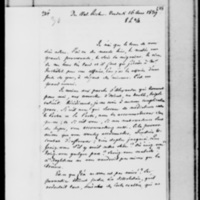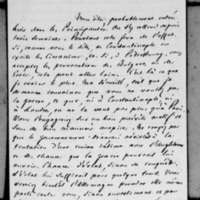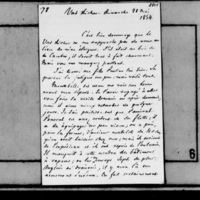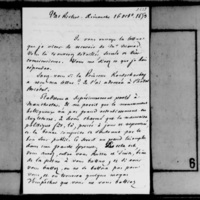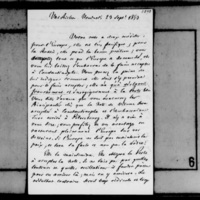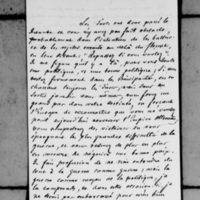Votre recherche dans le corpus : 304 résultats dans 3296 notices du site.
200. Paris, Samedi 22 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
200 Quel gros chiffre ! Je vous disais l’autre jour, que je ne pouvais croire qu’il n’y eût que deux ans. En voilà bien encore une preuve. Nous nous sommes beaucoup écrit. Nous nous sommes beaucoup parlé. Que de choses pourtant nous ne nous sommes pas dîtes ! On vit bien séparés bien inconnus l’un de l'autre. Cela me déplaît et m'attriste à penser. J’ai horreur de la solitude. Mais qu’il est difficile d'en sortir !
J’ai dit hier à la Chambre quelques paroles qui ont fait assez d'effet. Cette pauvre chambre ressemble bien à la nature humaine, elle s'ennuie de la médiocrité et s’impatiente de la supériorité. Elle a envie de ce qui est mieux qu’elle et elle n'en veut pas. Elle prend plaisir à l'entrevoir; et quand on le lui offre, elle ne peut se résoudre à l'accepter. C’est la vraie difficulté de ce pays-ci et de toute société démocratique. A travers la langueur générale, je m'aperçois qu’il serait assez facile de ranimer les débats. On me promet, sur l'Orient, un discours fantastique de M. de Lamartine et un discours russe de M. de Carné.
A propos de Russe, savez-vous que l'Empereur vient de fonder ici un journal Russe, le Capitole ? C’est un M. Charles Durand, naguères journaliste à Francfort, & journaliste à votre solde, qui a transporté ici ses Pénates. Il avait épousé une fort jolie personne de mon pays de Nîmes, qu’il a fait mourir de chagrin. Cela n'empêche pas de faire un journal Russe.
M. Delessert a arrêté la nuit dernière un des quatre généraux de la République, M. Martin Bernard. C’est une capture assez grosse. Le procès en sera retardé de quelques jours. Il faut que ce nouveau venu y prenne place. Pour le moment même, cela est très bon. On s'attendait à quelque tentative nouvelle, à quelque sauvage prise d'armes de ces gens-là, pendant le procès. Il est vraisemblable que cet enlèvement d’un de leurs généraux les troublera un peu.
5 heures
Je passe d’indignation en indignation. Ces mensonges répandus à Pétersbourg, d'où viennent-ils ?
Sans nul doute, Mad. de Nesselrode est une bonne fortune. Il vous faut bien du monde pour vous défendre. Vous avez besoin d’une sentinelle à toutes les portes. Cependant je suis plus tranquille que je ne l'étais et vous devez aussi l'être plus. Il me paraît certain que vos intérêts seront protégés, et les mensonges démentis. Quand une fois cela sera fini, quand vous aurez quelque chose d'assuré, j'aurai le sentiment d'une vraie délivrance. Des Affaires pareilles, à 600 lieues, dans un tel pays avec votre santé... Moi aussi, souvent je n'en dors pas. Vous dormirez après, n’est-ce pas ? Vous me le promettez ?
Je rentre de la Chambre. Séance insignifiante. Les intimes de Thiers sont enragés mais enragés en dedans comme des officiers abandonnés de leurs soldats. Le Cabinet n’a pas gagné ce qu’ils ont perdu ; mais ils l’ont perdu. Thiers est allé prendre congé du Roi qui a causé longtemps avec lui. Ils se sont séparés en bons termes. Thiers en partant a recommandé à ses journaux de ménager le Roi. Et le Roi a dit à un ami de Thiers. Dites lui que je lui suis nécessaire et qu’il m’est agréable ; mais, qu’il faut qu’il renonce aux affaires étrangères — Vous voyez que le raccommodement n’est pas bien avancée. Thiers de loin et les siens de près sont en grande coquetterie avec moi. J’ai été chercher ce matin Lord Granville. Je ne l’ai pas trouvé. J’irai faire une visite à votre ambassadeur, s’il n’est pas parti.
Dimanche 6 heures et demie
Je suis dans une corbeille de roses. Mon petit jardin en est couvert. Si vous étiez ici, je vous les enverrais. Pourquoi n'aviez-vous plus de fleurs ? Est-ce santé ? Est-ce économie ? car j'ai vu poindre en vous cette vertu, ou pour mieux dire cette sagesse. Madame de Boigne vient d’être très souffrante, mais très souffrante, beaucoup de fièvre, du délire. Madame Récamier qui est allée dîner avant-hier avec elle, l’a trouvée encore dans son lit, et dans un grand découragement. Elle se plaint d'être fort seule, et que la société la fatigue et qu’on arrive chez elle trop tard, après 10 heures, quand elle est épuisée et ne demande plus qu’à se coucher. Elle parle de se retirer en province ou de rester à la campagne. Lord Grey n’est pas le seul qui ne puisse se résoudre à vieillir. J’irai demain voir le Chancelier, et savoir de lui si on peut aller dîner à Chatenay. J’ai dîné hier chez Mad. Lenormant, en face d’un buste de M. de Châteaubriand immense, monstrueux, quatre pieds de tête, deux pieds de cou, long, large, épais, un taureau, un colosse. Etrange façon de se grandir. C'est le sculpteur David qui met cela à la mode. Il a fait un buste de Goethe, un de Cuvier dans les mêmes proportions. Notre temps est bien enclin à croire qu'avec beaucoup, beaucoup de matière, on peut faire des âmes. C'est le système de la quantité.
On a eu hier une dépêche télégraphique d'Orient. Rien de décisif. Toujours point d'hostilités ; mais toujours à la veille. Le rapport se fait après demain à la Chambre. Nos armements maritimes se poursuivent très activement. Ils pourront bien ne pas être purement temporaires, et si la situation se prolonge, elle aboutira à nous faire tenir une grande flotte en permanence dans la méditerranée, comme vous en avez une dans la mer noire.
Adieu. Je vais faire ma toilette & recevoir du monde. Avez-vous décidément abandonné le lait d’ânesse ? Quel mal vous faisait-il ? Est-ce que vous ne le digériez pas bien. Où en est votre appétit ? Ah, on ne sait rien de loin. Adieu. Adieu.
Onze heures Les nouvelles d'Orient sont moins pacifiques que je ne vous disais. Il y a eu de petites rencontres entre des détachements isolés. On parait croire ce matin que cela deviendra sérieux.
199. Paris, Jeudi 20 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Pas une lettre ne m'a manqué et ne m'est arrivée deux heures plus tard. J’avais pris mes précautions. Mais adressez-les moi désormais rue de la Ville l'évêque.
Le Duc de Broglie arrive dimanche pour siéger lundi au procès. Il ne passera pas plus de quinze jours à Paris, et les passera probablement, comme moi en garçon ; car il revient tout à fait seul. Nous dinerons souvent ensemble, mais je resterai chez moi. J’y vois beaucoup de monde le matin beaucoup trop pour mon plaisir. Je n’ai pas les ennuis de la solitude. Je ne voudrais pourtant pas vous passer mon monde ; il ne vous désennuierait pas. Je sors à 1 heure, pour quelques visites et pour la chambre. Je rentre avant 6 heures. Je vais dîner en ville ou au café de Paris. Je fais le tour des Tuileries. Je dis adieu à la Terrasse; et je suis chez moi avant 9 heures pour lire, écrire et me coucher. Sauf les forêts et les montagnes, et sauf vous pour qui je donnerais toutes les montagnes et toutes les forêts du monde, cette vie ressemble un peu à la vôtre. J’en ai jusque vers la fin de juillet, du 20 au 25. La Chambre est endormie et pressée, partagée entre la précipitation et l’apathie. J’espère pourtant la réveiller et la ralentir un peu sur l'Orient. Le rapport se fait attendre. M. Jouffroy est malade. M. de Castillon sort de chez moi, bien content. Il partira pour Pétersbourg dans quinze jours. Il aurait pu partir hier et le marquis de Dalmatie me l’avait dit à la Chambre. Mais par un arrangement intérieur du département, on a mieux aimé, et il a mieux aimé lui-même ne partir que dans quinze jours. L’envoi des courriers est fréquent. Nous sommes contents des dépêches qui nous viennent de chez vous. Vous avez trouvé que nous nous étions bien pressés de demander des millions, que cela avait un peu trop ému l’Europe. Mais au fond, vous savez que nous serons raisonnables, et vous le serez vous-mêmes. L’Autriche l’est beaucoup, la Prusse beaucoup. L'Angleterre est fort contente de nous. L'hérédité du Pacha en Egypte est à peu près convenue entre quatre. Mais il lui faut l'hérédité de la Syrie, ou d'une portion de la Syrie. Sur cela, on négociera et on enverra à Constantinople des négociations conclues. Voulez-vous que j'aille à Constantinople ? J'ai lieu de croire que d'autres que vous m’y verraient avec plaisir. Passons en Occident. Ce pauvre Zéa doit être désolé. Les Cortès espagnoles dissoutes et le baron de Meer destitué du gouvernement de la Catalogne. C'est le renversement de sa politique et de toutes ses espérances. J’ai tort de dire toutes. Il retrouvera de l’espérance, car il a de la foi.
5 heures et demie
Je suis bien aise que vous ayez Madame de Nesselrode et qu’elle soit bonne. Quiconque a de l’esprit devrait être bon, et toujours bon. La méchanceté, pour dire le plus gros mot, même quand elle réussit ne donne que des plaisirs tristes comme sont tous les plaisirs solitaires. Ce serait une chose charmante que de se promener dans ce beau pays dont vous me parlez avec Madame de Talleyrand et vous. Puisque je n’y suis pas, parlez-lui de moi, je vous prie. J’ai cru quelques fois que pour n'être pas oublié d'elle, j’avais besoin que quelqu'un prit soin de l'en empêcher. Mauvaise condition, qu'il ne faut jamais accepter, n’est-ce pas ? Mais il me semble que son bon souvenir m'est revenu, et j'en jouis beaucoup. J'en jouirai encore mieux si vous voulez bien veiller à ce qu’il me reste.
Toute idée de voyage du Roi me parait abandonnée. Il ne faut pas aller au devant des velléités d'assassinat qui succèdent presque toujours aux tentatives d’insurrection. Mais Mgr le duc d'Orléans pourra bien aller à Bordeaux ; de la à Bayonne au devant de Mgr, le Duc de Nemours qui viendra y débarquer après avoir visite le Tage et Lisbonne ; de là le long des Pyrénées où nous avons des troupes ; de là à Alger pour voit l’armée d'Afrique. J’ai vu hier Montrond qui a envie d'aller à Baden. Je l’y ai fort encouragé. Mais il voudrait aller auparavant aux eaux d'Aix, puis à Florence, puis à Palerme. C'est beaucoup pour un été. Vendredi 11 heures.
Voilà Montrond qui sort encore de chez moi. C'est beaucoup. Adieu. Quelques uns me parlent. & d'autres m'attendent. J’aimerais bien mieux être à Baden. Adieu Adieu. G.
198. Paris, Mardi 18 juin 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis désolé de votre inquiétude. Ma lettre était partie très exactement. Me voilà ici pour un mois. Le retard sera impossible, s'il y a un mal impossible. Vous étiez un peu mieux samedi. Je voudrais suivre toutes les variations de votre santé, de votre disposition morale. Ce n'est pourtant pas un très bon régime. On s'accoutume au mal en le voyant revenir sans cesse, et on n'y croit plus assez quand on l’a vu s’en aller souvent. Je ne veux pas être rassuré à tort. Dites-moi tout, toujours tout. Je ne veux pas ignorer la moindre de vos souffrances et de vos peines.
Paris est grand et vide comme le désert. Je ne me fais pas à y être venu pour ne pas vous y chercher. Cette nuit, pendant toute la route le roulement de la voiture n’avait pas de sens pour moi. Je m'étonne quelquefois que vous me soyez tant. Dans une vie déjà longue et si pleine, après avoir tant possédé et tant perdu, je devrais être plus las et plus détaché. Je ne le suis pas du tout quant à vous. J’ai, quant à vous, cette ambition vive, indomptable et pleine d'espoir de la jeunesse. Je ne renonce à rien, je ne me résigne à rien. Je veux tout et que tout soit parfait. Je ne sais quelles années Dieu me réserve, ni quelles épreuves encore dans ces années. Mais il y a en moi un côté, un point que la vie la plus longue n'usera pas, et qui descendra jeune dans le tombeau.
8 h. 1/2
Je rentre. Je viens de traverser la place Louis XV par le plus magnifique spectacle. Sur ma tête, le ciel noir, parfaitement noir, le déluge près de tomber, et ce voile noir jeté tout autour de la place, entr'autres sur les deux colonnades. Au bout des Champs-Elysées, derrière les Champs-Elysées, le soleil couchant dans un cercle de feu, sur un bûcher embrasé, comme pour braver au moment de s'étendre, la nuit et l'orage. Et la moitié supérieure de l'obélisque brillante, rouge des derniers rayons du soleil, un jet de flammes suspendu au milieu des ténèbres, et les hiéroglyphes visibles et inintelligibles, comme des caractères cabalistiques. Effet étrange et grand qui ne se reproduira peut-être jamais. Je regrette que nous ne l’ayions pas vu ensemble. Je vous ai désirée au moment où il a frappé mes yeux. J’ai passé ma matinée à la Chambre, le seul lieu de Paris où il n’y ait point d'orage. Tout le monde repart de la session comme finie. Ministres et députés ont l’air de s'entendre pour ne rien faire et ne rien dire. Le Cabinet a perdu ce qu'il n’avait pas. Le Maréchal a été la risée de la Chambre des Pairs à propos des fonds secrets. M. Villemain y a été battu avec gloire à propos de la légion d’honneur. Le Ministre de la guerre ne se bat nulle part. M. Duchâtel est ce qu’il était. M. Dufaure ne devient rien, M. Passy paraît le plus sérieux ; c’est lui qui cause de l’Europe dans les couloirs. Tout va cependant, et tout ira cla se, comme le monde. Convenez qu'il est plaisant d'entendre un Russe dire dédaigneusement que " tout cela finira par un bon petit despotisme, le seul gouvernement possible avec les Français. " Du fait, ce ne sont là que les petits moments d'une grande histoire. Et il y a beaucoup de petit dans le plus grand. Le petit s’en va & le grand seul demeure. Nous ne supporterions pas la lecture du passé s’il nous était arrivé chargé de tout son bagage. L'Assemblée constituante, l'Empire, la Charte, la Révolution de 1830, c’est un manteau assez large pour couvrir bien des misères.
On me dit que M. Molé s’est beaucoup remué contre le Cabinet dans l'affaire de la Légion d’honneur tandis que M. de Montalivet se faisait très ministériel. Aussi ils se renient l’un l’autre. M. Molé part pour Plombières dans les premiers jours de Juillet. La fantaisie lui reprend d'entrer à l'Académie française. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu'elle lui reprend sans qu’il y ait en ce moment aucune vacance. On m'en fait parler par avance. Est-ce bien de l'Académie française qu’on veut me parler ?
Mercredi 1 heure
J’ai eu du monde depuis que je suis levé. Je vais à la Chambre. C’est aujourd'hui mon mauvais jour. Je n’ai pas de lettre. Adieu. Adieu. Je viens de revoir la mine de M. Saint. Rendez-la moi. Adieu. G.
175. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Que l’hiver est une laide saison ! Il fait noir, il pleut, il gèle. Il n'y a pas moyen de se passer d’intimité. En hiver on en a besoin parce qu'il ne vient point de plaisir du dehors ; en été, pour partager le plaisir qui vient du dehors. L’intimité est infiniment plus douce que l’hiver n’est laid. Je suis charmé de voir venir l’hiver. Bientôt nous ne serons plus seuls. Je regrette que votre fils soit parti. J’aurais été bien aise de le voir. Est-il toujours préoccupé de ses projets de mariage ? Si Mlle de T. est toujours en Italie, entre les mains des Jésuites, elle ne cédera pas. Il me revient, qu’on est préoccupé, dans le monde catholique, de ce qu’on appelle les progrès de l’esprit protestant, et qu'on me fait l'honneur de s'en prendre à moi. Je le veux bien quoique ce soit plaisant. Un nouveau journal paraît, intitulé L’ Europe protestante, très animé et très prosélytique, dit-on. Je n'en ai encore reçu que le prospectus. Les patrons de l’entreprise sont en Angleterre, Lord Teignmouth, Lord Bexley, l’évêque de Landaff, &, &
Ma mère a été mieux hier. Je suis convaincu que ses lourdeurs de tête tiennent à l'état de son estomac. Elle mange extrêmement peu mais à sa fantaisie et souvent des choses peu saines, la cuisine méridionale qu'elle préfère par habitude. Je crains l'immobilité de Paris. A tout prendre la campagne lui a été bonne, et sans cette malheureuse secousse, elle serait retournée à Paris très bien.
Il est vrai que votre politique vous à conduits à un grand isolement. Mais ne vous en prenez pas à sa faiblesse seule. Vous vous êtes faits les champions d'une cause extrême de l'absolutisme. Champions, non seulement en fait, mais en principe, avec passion et étalage encore plus qu'avec effet. Le temps des causes extrêmes n’est plus. En Angleterre et en France, le juste milieu libéral. En Prusse le juste milieu monarchique. En Autriche le juste milieu silencieux et immobile. Vous êtes des doctrinaires fastueux. Et votre destiné a peu de cours, même chez vous. De là votre isolement. On ne vous aime pas parce que vous êtes non seulement forts mais compromettants. On vous craint comme adversaires et comme alliés. Vous aviez une bien meilleure position à prendre. Vous pouviez rester étrangers et libres dans la lutte des principes. Mais la passion, et la Pologne vous ont jetés dans un camp, où vous serez seuls, excepté dans les jours de crise violente et générale, qui ne reviendront probablement pas de sitôt.
J’ai reçu ces jours-ci un singulier présent. Un homme, que je ne connais pas, dont je n’avais jamais entendu parler, qui vient, dit-il, du côté droit, m'a envoyé un volume manuscrit, intitulé : M. Guizot -1838, et qui n’est autre chose qu'une étude politique de mon caractère, de ce que j’ai fait ou dit de ma position passée et actuelle, avec des conseils sur toutes choses ; le tout spirituel, sensé, écrit quelque fois avec verve, et dans un sentiment dont je ne puis qu'être fort touché. Il s’appelle M. Des Landes, est d'une famille de marins bretons, doit être d'après quelques indications, déjà assez âgé, ne demande et n'attend évidemment rien de moi, pas plus dans l'avenir que dans le présent, et n'a voulu que me dire son avis en me témoignant son estime.
Si vos yeux vous le permettent, je vous le donnerai à parcourir. C’est écrit assez gros.
10 heures
Vous me reprochez de croire que j’ai toujours raison, et je vous ai dit hier qu'envers vous j'étais infaillible. N’avais-je pas bien pressenti et bien répondu ? Tant mieux, si je ne sais pas combien vous m'aimez. Vous me l'apprendrez, en novembre malgré votre incrédulité. L'incrédulité est de l'impiété. sur ce, Adieu, le meilleur des adieux. Le dernier vaudra encore mieux, car après le dernier viendra le premier, le premier depuis bien longtemps ! Adieu. Je vous disais des bêtises. G.
165. Val-Richer, Samedi 20 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je penche fort à croire avec votre nouvelle que toute l’affaire de Belgique sera terminée à Londres, en une séance de la conférence. Je ne crois pas qu’il y ait deux avis réellement et sérieusement opposés. On fera quelque petite concession à la Belgique sur l’argent je ne sais quoi et les 21 articles seront exécutés, si le roi de Hollande n’a voulu qu’avoir l’air d’en finir, il pourrait y être pris. J’aimerais assez de persévérance dans le mot insurgés si la Belgique eût été pour lui une ancienne possession, le trône de sa race depuis des siècles. Mais pour une acquisition d’hier, pas même faite par lui, et à le sueur de son front due à des arrangements Européens, évidemment mal assise, mal unie, c’est l’un entêtement plus près du ridicule que de la grandeur. Pour que l’entêtement même déraisonnable, soit grand et beau, il faut qu’il ait dans le temps de longues racines. Je dis cela à contrecœur et pour parler vrai, car sans le connaitre, j’ai du goût pour le Roi de Hollande à cause de son pays, de son nom, de ses ancêtres vrais grands hommes, que j’admire extrêmement, et qui dans les plus mauvais jours, ont été en Europe les soutiens de la bonne cause. M. de Montalivet a donc eu comme Thiers sa grosse mésaventure de police. On dit la Princesse de Beira assez énergique, mais la plus méchante femme qui se puisse voir. Elle poussera Don Carlos aux grands partis, et aux excès, s’il peut y avoir là de grands partis et des excès nouveaux. Je regrette bien qu’on ne nous ait pas donné Alava au lieu de Miraflores.
Je vous ai dit hier que le résultat de vos conversations avec Matonchewitz, en ce qui vous touche ne m’étonne pas du tout. Ce ne sont pas ces gens-là qui en bien ou en mal régleront jamais votre destinée. Le bien ne peut vous venir que de plus haut, comme est venu le mal. Si vous étiez resté bien avec l’Empereur, vous les auriez eus dociles, faciles, empressés, quoi que vous voulussiez. L’Empereur est mal pour vous ; eux se livrent envers vous à toutes leurs fantaisies, à leur jalousie subalterne, à leurs anciennes petites humeurs, à leur égoïsme, à toute la médiocrité de leur natures pour parler poliment. Même vaincu, même détrôné quand on a vécu réellement et longtemps, à une certaine hauteur, on y reste, là se décide toujours ce qui vous regarde. On n’est plus armé contre le bas, on en souffre. mais on n’y descend pas ; on n’y reprend pas une place incontestée et tranquille. Dearest, la supériorité est belle, mais elle coûte cher, et quand on l’a une fois acquise, il n’y a pas moyen de s’en défaire. Vienne quelque circonstance, quelque motif qui vous ramène l’Empereur, vous verrez. J’espère toujours que ce motif, cette circonstance, quelconque, viendra. J’espère plus de ce côté-là que de tout autre si vous pouviez traiter là vous-même vos affaires !
M. Villemain a écrit dans le Journal général quelques pages, belles et vraies, sur Mad. de Broglie. Il y a cette phrase : " La douleur sent qu’elle a perdu la personne même qui consolait. Vous auriez besoin de quelqu’un qui influât, & vous étiez la personne même qui influait.
9 h. 1/2
Vous êtes tombée au milieu de ma leçon d’arithmétique qui en a un peu souffert. Je vais à mes affaires de ferme et de jardins. Je les expédie vite. Adieu. Adieu. A ce soir. G.
157. Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait comme vous. Je me suis couché hier à 9 heures et demie. J’avais beaucoup travaillé dans mon Cabinet et beaucoup couru dans mes champs ; deux choses que je puis très bien faire séparément mais pas bien ensemble. J’ai toujours éprouvé cela ; de l’activité d’esprit ou de corps, tant qu’on voudra ; mais l’une ou l’autre. Dans mes moments de grande préoccupation morale une course à pied d’une demi heure me fatiguait.
Vous verrez que Mad. de Talleyrand viendra chez vous cet hiver chercher des nouvelles. Je ne lui vois que M. Royer-Collard qui puisse lui en apporter un peu. Encore est-il lui-même fort en dehors de tout. Mais il vit à la Chambre et il voit quelque fois les Ministres. Je trouve ce que vous me dîtes à propos de sa visite fort naturel. Vous réagissez, et elle non. Elle a l’air embarrassé et vous non. Cela est dans l’ordre.
L’article des Débats d’hier sur l’Angleterre, l’Inde et la Russie est curieux. Est-ce qu’il y a vraiment chez vous quelque projet semblable ? Je ne dis pas projet lointain. général, politique d’ensemble; rien de plus simple, mais projet prochain, actuel. Ce serait étrange. Du reste cela s’est vu : beaucoup de prudence, de timidité même pour ce qu’on a sous la main à sa porte ; et des intentions, des combinaisons, même des préparatifs gigantesques pour ce qui est loin, bien loin. On satisfait ainsi, à la fois son imagination et sa raison. Et l’imagination se passe d’apparences et de paroles. à la bonne heure.
Lisez vous quelques fois le petit journal de Thiers, le Nouvelliste? Il est bien vif contre le Cabinet. Thiers n’a plus tout le Constitutionnel. M. Molé s’y est glissé ; non pas de manière à l’ôter à d’autres, mais pour y avoir; un petit coin à lui. C’est sa façon de procéder. Il n’en est pas d’un journal comme d’un cœur ; on n’est pas obligé à tout ou rien. Je vous quitte pour aller voir si on plante mes arbres. Vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que c’est que de surveiller des ouvriers. Mais pardonnez moi de vous trouver, quant à la température, un peu inconséquente. Vous me dites, page 1, Il fait très froid. et page 2, Comment, vous avez du feu dans votre chambre ! Cela me paraît incroyable. Quand Dieu fait très froid, moi, je fais du feu. Vous êtes à ce qu’il me semble, beaucoup plus résignée.
9 heures
Mes plantations se font bien. Je me prête, je crois, de très bonne grâce aux affaires et aux plaisirs de la Campagne. Et j’en jouirais très vivement si je les partageais. Mais je ne les partage pas. Aussi ne fais-je que m’y prêter. Voilà le facteur et une bonne lettre. N’oubliez rien, je vous prie de ce que vous avez eu une fois et un moment le projet de me dire. C’est là le mal cruel de l’absence entre tant d’autres ; on perd une infinité de choses, qui étaient bonnes, charmantes, mais qui passent avant qu’on se retrouve. Même quand je vous aurai retrouvée j’aurai beaucoup, beaucoup à regretter. N’oubliez donc pas. Je ne sais ce que feront mes amis, rien de déplacé j’espère. Pour moi, je n’irai certainement pas ailleurs que la où j’ai toujours été, depuis huit ans entr’autres. Je suis plus que jamais convaincu que c’est d’idées et de pratiques gouvernementales que la France a besoin. Et ce qui me fâche c’est qu’on l’en éloigne au lieu de l’y conduire. Si je me plains, ce sera de ce qu’on pousse ce pays-ci vers M. Odilon Barrot. Adieu. Adieu. Que c’est long ? G.
37. Val-Richer, Vendredi 15 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu’Adam dut avoir de peine à s’accoutumer, à vivre hors du Paradis ! Là, il ne pensait qu’à jouir de la vie. Il n’y pensait même pas. La vie était pour lui parfaitement pleine, et légère, douce et animée. Pas un moment séparé d’Eve. Punit de solitude et toujours seule. Des entretiens charmants, des silences charmants. Un amour serein comme le ciel, chaud comme le soleil, inaltérable et inépuisable. La prière pour repos, comme l’amour pour bonheur. Tout le jour, tous les jours passés à goûter, avec Elle, les dons de Dieu, à remercier, avec Elle, Dieu de ses dons. Quand on a connu un état si beau, comment en supporter un autre ? Pauvre Adam ? Il n’est pas besoin de l’avoir connu ; c’est assez de l’avoir entrevu. Je ne suis pas de ceux, vous le savez qui méprisent la vie réelle et croient qu’il n’y a de vrai bonheur, que dans les rêves de l’imagination. Une heure de bonheur réel, et il y a de telles heures, vaut mille fois mieux que les plus beaux rêves de l’imagination la plus divine. Mais le bonheur se montre en passant ; c’est là son vice. Et quand il s’est montré, quand il s’est laissé saisir un moment, c’est alors que l’imagination est toute puissante à nous enchanter de l’image de sa durée, à le rappeler, à le retenir devant notre âme sous toutes ses formes, avec toutes ses joies, grandes, petites, sérieuses, gaies, innombrables, infinies. Voilà le rêve légitime, le rêve irrésistible Madame. Je pourrais passer des journées des années à m’y livrer, à me figurer, à goûter en idée tous les ravissements d’une vie qui serait tout entière ce qu’a été un jour, une heure. Rien n’égale alors l’allégresse la fertilité de ma pensée. Le monde avec tous ses intérêts la destinée humaine avec toutes ses chances, comparaissent devant moi. J’aborde toutes les situations, toutes les suppositions. Je deviens Roi, obscur, riche, pauvre, puissant, proscrit. Je travaille sans relâche ; la goutte me cloue oisif, sur mon fauteuil. Je mets mon bonheur aux prises avec les fortunes les plus diverses, favorables ou contraires. Et je le contemple avec délice toujours le même au sein de tant de vicissitudes supérieures à tous les triomphes, à toutes les épreuves répandant tantôt son charme sur les plus frivoles incidents. tantôt son baume sur les plus cruelles blessures. Et je contemple avec plus de délice encore la créature, à qui je le dois et mon cœur se gonfle de reconnaissance au moins autant que de plaisir. Et j’ai beaucoup de peine à revenir à moi, à me persuader que tout cela, n’est qu’un rêve ; car en vérité ce bonheur là est si conforme, à ma nature, j’y espère avec tant d’ardeur, je me sens tant de puissance pour en jouir, qu’il me faut tout ce que j’ai dans l’âme de raison et de fermeté pour me résigner à ne le connaitre que par des apparitions, et à l’entrevoir sans le posséder ! Je ne rêve que pour vous Madame.
Je vous conte mes rêves comme toute chose mais à vous seule. Si le monde s’en doutait, il me croirait fou, et ne voudrait plus jamais me confier ses affaires. J’ai pourtant bien raison, et le monde a bien tort quand il ne croit ses affaires bien faites que par ceux qui ne se soucient pas d’autre chose. Je connais les plus habiles en ce genre. Leur habilité est si courte, si légère, elle oublie et laisse en souffrance tant d’instincts puissants, tant de grands intérêts de la nature humaine qu’en vérité, si le monde n’était pas aujourd’hui bien petit d’esprit et de cœur il ne s’en contenterait pas.
Samedi 8 heures
Je suis très fâché du redoublement de froideur dont vous me parlez ; mais je n’en saurais craindre rien de grave. A moins qu’on ne veuille la guerre chez vous ce que je ne crois pas, nous n’aurons point de guerre. Si nous étions très voisins, si nos toits se touchaient, je ne serais pas si sûr de mon fait. Entre un Prince qui fait ce qu’il veut et un peuple qui dit ce qu’il veut, une parole peut amener bien vite un coup de canon. Mais à la distance où nous sommes avec de si épais matelas entre nous, il faut, pour que la guerre commence, ou la folie et la puissance de Napoléon ou de bons et solides motifs. Ni l’une ni l’autre cause n’existe et n’existera de longtemps. Je comprends toutes les préventions, toutes les humeurs. Ce que je ne comprends pas, c’est que lorsqu’on est placé si haut lorsqu’on voit par conséquent, si loin on accorde aux préventions et aux humeurs un tel empire. L’Empereur ne peut avoir que deux pensées politiques, la lutte contre l’esprit révolutionnaire et la grandeur de la Russie. Pour la première, la Russie comme toute l’Europe a besoin, absolument besoin de la France. La France aujourd’hui peut lutter avec plus de crédit et de succès que personne contre l’esprit révolutionnaire, elle l’a éprouvé jusqu’au bout ; elle n’a plus rien à en apprendre et plus rien à en attendre. Mal conseillé, à tout risque elle pourrait le déchaîner encore ; elle sait mieux que tout autre comment on peut le réprimer. Je dis le réprimer, non seulement matériellement, dans les rues, pour un jour, mais moralement dans les esprits, pour l’avenir. L’Europe orientale qui redoute et combat ce mal avec tant d’ardeur ne sait pas Elle même à quel point il est profond, général, là où il se cache comme là où il éclate, et combien notre concours, notre concours sincère et prudent est indispensable pour le guérir partout. Et je n’hésite pas à dire que la France a déjà donné à cet égard, des preuves de savoir faire comme de bon vouloir ; et elle en donnerait bien davantage, si elle recueillait partout, le juste fruit de sa résistance.
Quant à l’avenir diplomatique et territorial de l’Europe, je n’en sais rien, personne n’en sait rien. Je n’y pense pas, personne n’y peut penser activement aujourd’hui. Mais il est évident que des Puissances européennes la France est celle dont les intérêts permanents, les désirs possibles sont le moins opposés, le plus aisément conciliables avec les intérêts et les désirs Russes. Il n’y a point là, dans l’état actuel de l’Europe, de quoi fonder dès aujourd’hui, et pour le présent, un système une politique. Il y a à coup sur motif puissant, motif de rester en mesure pour l’avenir. Rester en mesure, se trouver toujours libre, toujours prêt, ne pas se créer soi-même et d’avance, des embarras, des obstacles, c’est je crois, la première sagesse celle dont on recueille le plus sûrement les fruits, que tôt ou tard on regrette le plus d’avoir oubliée, celle qui convient surtout à un gouvernement qui se vante et avec raison de la persévérance et de l’esprit de suite qu’il apporte dans ses desseins. Voilà de bien sages paroles n’est-ce pas ? Ce n’est pas sur celles-là que je veux rester avec vous. J’attends votre lettre dans deux heures. Je ne vous dirai adieu qu’alors.
10 h. 1/2 Ah, remplissez quatre pages d’Adieu ; il n’y en aura jamais autant que j’en veux. Et vous avez bien raison. Vos paroles valent mille fois mieux que tous mes raisonnements. Mais aussi je m’ennuie infiniment de mes raisonnements. Je les prends quand je n’ose pas me livrer à autre chose. Adieu, adieu. Adieu. G.
229. Val-Richer, Lundi 29 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rattraperai aisément la mesure, car l’air me plaît. Je voulais ménager votre force et vos yeux. Donnez m'en tout ce que vous voudrez. J’ai de quoi vous rendre. C'est, je crois le défenseur de l’archevêque Land qui a dit le premier qu'avec cent lapins blancs ou ne fait pas un cheval blanc. Avec cent lettres de Baden et du Val-Richer, on ne fait pas une conversation de la Terrasse. Mais j’aime mieux cent lettres que cinquante. Pourtant je ne redeviendrai quotidien qu’à partir de Jeudi 1er août.
Je mène demain mes deux filles à Caen, chez leur dentiste de province. Il faut leur ôter deux dents de lait que Brewster a voulu ajourner quand elles ont quitté Paris. Il y a un bon dentiste à Caen. J'en reviendrai après demain soir. Cette course me dérange ; mais je suis mère.
J’attends avec grande curiosité la confirmation des nouvelles d'Orient. On dit que le capitan Pacha est un homme à vous, qui avait beaucoup contribué au traité d'Unkiar-Skelessi et vous fut, aussitôt après, envoyé comme Ambassadeur. Les habiles soutiennent que tout cela n’est pas clair. Pour moi, je me suis décidément retranché les prophéties. Je veux voir.
Avez-vous entendu dire que le comte de Pahlen remplacerait Pozzo à Londres ? J’en serais fâché et pour vous et pour nous. A moins qu'on ne nous redonnât Pozzo mourant. Mais cela ne se peut guère. Votre pauvre ami de Hanovre commence à prendre peur. Il s’est chargé de plus qu’il ne peut porter. Ç'a toujours été un grand métier que celui de despote. De nos jours, il y faut Napoléon. Encore s’y est-il cassé le nez. Est-ce qu’il ne vous vient plus de lettres de là ? Du reste, il me semble qu’il vous parle toujours plus des Affaires d’autrui que des siennes. Il me semble que j'ai vu autrefois. M. de Malzahn à Paris, en 1820 et 1821. N’a-t-il pas été Ministre de Prusse à Munich, ou à Stuttgart ? Je le confonds peut-être avec un M. de Maltzen qui était aussi dans la diplomatie Prussienne ; homme d’esprit, un peu solennel.
L'humeur de la Chambre des Pairs porte ses petits fruits. On aurait voulu qu’elle fit sur le champ un second procès, pour en finir de ces gens du 12 mai, comme on en finit. Il n'y a pas du moyen. Les Pairs n’ont pas voulu en entendre parler. Leur commission d’instruction va en mettre en liberté tant qu’elle pourra, et ceux qui resteront attendront en prison que la Chambre ait un peu repris cœur aux procès. C'est encore un excellent instrument de gouvernement qu’on a bien vite usé. Les fêtes ont été on ne peut plus paisibles. Fort tièdes. Les hommes ne se réjouissent pas par commémoration. Il n'y a de solennité durable, en l’honneur d’un grand événement, que celles qui portent un caractère religieux. On ne puise un peu de durée que dans l'éternité. Notre temps a étrangement perdu l’intelligence de la durée et de ses conditions. Jamais les hommes n’ont vécu concentrés à ce point dans le présent. Petite vie, et qui fait toutes choses, à sa mesure. Et pourtant, il y a dans les idées, dans les sentiments, dans les institutions de notre temps, le germe de grandes choses très grandes. Mais pour que les grandes, choses viennent, il faut extirper les petites. On ne peut pas avoir de taillis sous les hautes futaies. Et de notre temps, les petites choses sont innombrables, petits intérêts, petits conforts, petits désirs, petit plaisirs. Il y a des facilités infinies pour dépenser sa vie et son âme en monnaie. C'est mon désespoir de voir de quoi on se contente aujourd'hui. Parmi vos raisons de me plaire, celle-ci m’a beaucoup touché, vous avez l’esprit et le cœur superbe. Cela coûte cher ; mais n’y ayez pas regret. Cela vaut encore davantage, n’est-ce pas ? Adieu pour aujourd’hui. Je vous dirai encore adieu demain avant de partir. J’oubliais de vous dire que Madane d'Haussonville est fort heureusement accouchée d’une fille. C'est ce qu'elle désirait. J’en suis charmé pour son père. Sa première couche avait été fort pénible et le tourmentait.
Mardi 9 heures 1/2
Bonjour et adieu. C'est la même chose, toujours la même et et toujours charmante. Je vous écrirai demain. Je ne vais à Caen que samedi. Encore adieu. G.
429. Londres, Samedi 3 octobre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
J’attends tous les jours votre lettre avec une vive impatience. Mais aujourd’hui ! Et mon impatience de tous les jours est une impatience de plaisir d’espérance. J’espère bien qu’aujourd’hui aussi j’aurai un immense plaisir. Vous me direz que vous êtes mieux, que ce n’est rien. Que de trouble dans l’âme sous la surface tranquille et monotone de la vie ? J’avais du monde hier soir. J’ai joué au Whist, j’ai causé ; je crois que j’ai ri.
Je faisais cas du Roi de Hollande. Je l’aime. Il a eu deux fois raison, en renonçant à sa volonté, il y a trois mois en la reprenant aujourd’hui. Que dira son peuple ? Son fils est bien loin de le valoir.
Une heure
Me voilà, tranquille ; comme on peut l’être pas inquiet enfin. C’est du bonheur. Comme on en a de loin. S’il était possible. d’avoir plusieurs lettres par jour? Je veux que vous ne mouriez de rien, surtout pas d’impatience et d’inquiétude à cause de ma prudence. Il y a encore eu Conseil hier. Trois dans une semaine, et dans cette saison. Cela seul est quelque chose. Pas de résultat actuel, précis. Un parti de la paix et de l’amitié avec la France, plus nombreux, plus fort, plus déclaré, appuyé par quelques uns ou quelqu’un des hommes, les plus importants du cabinet, ayant soutenu et fait reconnaître la nécessité de saisir, de chercher toutes les occasions de se rapprocher, de transiger. La politique contraire entravée, un peu intimidée. Des choses qu’on regardait comme résolues, remises en question. C’est cela ; ni plus, ni moins.
Je persiste à ne pas croire à la guerre. Je crois à une situation toujours critique, rasant toujours le bord. Pour le moment, la question est en Syrie. Si le Pacha cède ou succombe vite, l’affaire sera finie. Si la résistance en sérieuse et prolongée, la question reviendra en occident, et il y aura transaction. Le Cabinet sort de ces trois conseils profondement agité, divisé, méfiant de part et d’autre, travaillant à se paralyser les uns les autres, ce ne voulant pas de disloquer. Je ne vous répète pas que ceci est entre nous. C’est bien convenu. Il ne m’étonne pas. L’amour pur du mensonge. Mentir sans nécessité et sans succès. Je suis toujours surpris cependant qu’on puisse tant manquer d’esprit en en ayant tant. Ce n’est pas le seul exemple. 14 a raison d’avoir de l’humeur contre 74. Et 2 aussi a raison d’attaquer, le maréchal Soult encore plus que Thiers. Il pressent bien le danger futur. Je viens de lire Berryer. J’en pense comme vous. Il n’y a de bon que ce que vous m’indiquez. Mais cela est beau. J’aime vos impressions si vives dans votre jugement si sûr à coup sûr, M. Molé n’a pas pu être content. Savez-vous ce qui manque à Berryer ? Du sérieux. Il se joue, et cela se sent. Au premier moment cela réussit ; les hommes trouvent bon qu’on leur plaise sans leur rien demander, sans leur demander de croire ou d’agir. A la longue cela décrie. On va le soir, et quelquefois, au spectacle. On ne s’accommode pas du spectacle, même du meilleur, tous les jours et tout le jour. La vie et ses affaires sont sérieuses. Il y faut des personnes, non des acteurs et le public lui-même à ce sentiment , on y revient bientôt. Il ne vient pas de flotte russe. L’Empereur a seulement ordonné qu’elle se mettrait en état de venir. C’est du moins ce qu’on dit ici, et ce qu’on croit, et ce qu’on veut.
Je suis bien aise que Sébastiani soit maréchal. Il n’en aura peut-être pas moins d’humeur contre moi. Mais j’aurai le droit de le trouver mauvais. Quand le Cabinet s’est formé, j’ai fortement insisté auprès de mes amis pour qu’ils le fissent maréchal à la première occasion, et ils me l’ont promis. Depuis que je suis ici, le Roi m’a fait demander d’écrire dans ce sens à le M. de Rémusat, et je l’ai fait. J’aime que justice soit rendu aux bons services. Sébastiani, en a rendu de grands de 1830 à 1832. Je croyais que vous auriez le bis avant-hier. Vous l’aurez eu hier. Je voudrais bien que vous l’eussiez plus souvent. J’ai le cœur bien plus gros depuis le 30, et tout ceci est bien plus insuffisant. Adieu même est insuffisant. Je le prends, mais je ne m’en contente pas. Adieu
401. Trouville, Lundi 10 août 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Je ne devrais plus vous écrire. Cette lettre-ci sera à Londres, Vendredi. Vous n’y serez pas. Et quand vous y serez, j’y serai. N’importe. Je vous écris. Je viens de recevoir votre lettre 409. J’ai oublié de numéroter les miennes. Il me semble que ceci doit être 405. Il y a trois jours, je ne me résignais pas aux lettres. Aujourd’hui une lettre vient de me charmer. Il fait très chaud, très beau. J’irai tout à l’heure promener ma mère et mes enfants, dans la forêt de Touques ; ma mère en calèche, mes enfants, sur des ânes. Ils sont bien heureux. Je les ai menés à la mer ce matin ; ils se sont baignés devant moi. Mad. de Meulan vient d’arriver. Elle retournera au Val-Richer demain. Ma mère et mes enfants samedi 15.
J’ai déjà parlé à Eu de mon congé en octobre. J’y compte. Toujours subordonné à l’état de cette malheureuse question d’Orient. Mais ou je me trompe fort ou elle sera immobile à cette époque. Le blocus durera sans aboutir. C’est, je vous jure un curieux spectacle que la complète opposition des conjectures sur le Pacha, les uns si sûrs qu’il cédera, les autres qu’il ne cédera pas. Très sincèrement sûrs. Il y a de quoi prendre en grande pitié les convictions diplomatiques. L’erreur sur l’insurrection de Syrie a été grossière ; elle n’a pas été un moment sérieuse, et Lord Alvanley est un badaud. Lord Francis Egerton a donné aux insurgés trois canons rouillés, et 800 fusils hors de service ; par ardeur chrétienne et pour affranchir les frontières de la Terre Sainte. Il n’y a eu personne pour se servir de ses fusils. Méhémet en profiterait s’ils étaient bons à quelque chose. Les Carlistes aussi ont eu la main dans l’insurrection ; par Catholicisme et par Carlisme. Tout cela a abouti à élever un nuage de poussière que Lord Palmerston a pris, pour un orage. De son erreur je conclus qu’il se trompe probablement sur Alexandrie comme sur Beyrout. M. Thiers est infiniment plus sceptique, plus modeste. Pourtant il ne doute pas de la résistance obstinée du Pacha.
Conseillez à Lady Clauricarde de retirer sa joie sur Louis Bonaparte. Elle a des joies un peu légères. Voilà les obsèques de Napoléon accomplies, tranquillement accomplies. Le Roi, ses ministres, le public, tout le monde est charmé. Le Bonapartiosme est tombé plus bas que l’insurrection de Syrie, le pauvre Louis Bonaparte ne voulait pas se coucher dans le château de Boulogne parce qu’il n’avait pas son valet de chambre pour le déshabiller. Et jeudi dernier, quand on l’a retiré de l’eau et conduit en prison, comme il ne voulait pas poser sur la pierre froide ses pieds nus (il venait d’ôter ses bas) un des gardes nationaux qui venaient de lui tirer des coups de fusil, l’a pris dans ses bras, et l’a porté sur son lit.
Vous avez bien fait de m’envoyer la lettre du duc de Poix. Il n’y a en effet rien à faire à présent. On a fait quelque objection à son fils, très haut. Cette nouvelle vilenie de Pétersbourg (pardonnez-le moi) m’a indigné comme si elle m’avait surpris. Je croyois que nous avions atteint le terme. Vous n’avez sans doute plus rien entendu dire de la prochaine arrivée. Vous m’en parleriez. Mais j’oublie que vous m’avez écrit vendredi, vingt, heures après m’avoir vu. Les heures sont bien longues.
Adieu. Ceci est pourtant ma dernière lettre. Mais non pas mon dernier adieu. Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Ambassade à Londres, Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie, Enfants (Guizot), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), Gouvernement Adolphe Thiers, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Internationale), Politique (Russie), Vie familiale (François)
357. Londres, Samedi 2 mai 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon dîner s’est très bien passé. De 8 heures 1/4 à 10 heures à table dans l’ordre que vous savez et qui m’a paru approuvé de tous. Le debut froid et embarrassé comme toujours et partout. Passé la première demi-heure de l’animation et de la bonne humeur. Le cuisinier et la cave ont eu grand succès. Lord Melbourne a bu du vin de Bourgogne avec un contentement réfléchi. C’est Lord Lansdowne qui a porté la santé du Roi, d’après l’avis de Lord Palmerston. J’ai porté celle de la Reine et de tous les souverains de l’Europe. La Parisienne s’est mariée au God save the Queen. Le service a bien marché un peu précipitamment. Ils étaient trop pressés de bien faire. J’avais prodigué l’éclairage ; il était brillant. Cela manque toujours ici. L’illumination était belle, mais un triste accident s’y est mêlé et me désole. La voiture du baron de Moncorvo a accroché une échelle sur laquelle était monté un pauvre charpentier qui allumait les lampions. Il est tombé et il en mourra. Il a le crâne fracassé à la base. Il n’était pas marié, mais il allait se marier. Je lui ai fait donner tous les secours possibles. Mon médecin, qui est allé le voir ce matin à Middlesex-Hospital où je l’ai fait transporter me dit qu’il n’y a pointl’avait fait de chance de guérison. J’avais pris toutes sortes de précautions contre les accidents. Comment prévenir la maladresse d’un cocher? J’ai beaucoup causé avec le duc de Wellington qui y prenait plaisir, quoique la conversation doive lui donner assez de peine. Il cherche ses idées et ses mots comme un aveugle son chemin. Il m’a raconté Charles X, et comment il avait lui toujours prèvu sa fin. Bien aise de me tenir le même langage que Lord Aberdeen qui m’a déjà dit deux fois : " Je me glorifie d’avoir été en Europe le premier ministre qui ait reconnu le Roi Louis-Philippe."
Une heure
351. Londres, Samedi 25 avril 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir, vers dix heures, après avoir renvoyé quelques français qui étaient venus me voir, j’ai été me promener seul à pied dans les rues de Londres. Duke street, Oxford Street, Grosvenor-square, Berkeley square, Orchard Street, Postman square. Londres est bien noir. Pas de soleil le jour ; pas de boutiques éclairées le soir. Mais peu m’importe ; quand j’ai l’esprit occupé et le cœur serein j’illumine moi-même le monde qui m’entoure. J’ai pensé à vous à Hampstead à ma fille qui va bien à mes affaires qui ne vont pas mal. J’étais rentré et couché à 11 heures.
Je me lève et je vous écris. La romance a raison.
3 heures
4 heures et demie
333. Londres, Mardi 31 mars 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures et demie
C’est beaucoup deux Reines pour une soirée. Il n’est pas aisé de les y arranger. J’ai dîné hier à Marlborough House entre la Reine douairière et la Duchesse de Cambridge. Le Duc et la Duchesse de Sutherland, Lord et Lady Jersey, Mm. de Bülow et de Gersdorf. La Reine douainière est restée bien allemande de manières et d’accent. L’air très bonne d’ailleurs et d’une simplicité bien royale. J’ai beaucoup causé avec la Duchesse de Cambridge. Elle me paraît aîmer la conversation. Bien protestante de cœur. Elle trouve l’Eglise Anglicane trop catholique. Cela me réussit fort ici d’être le premier Ambassadeur protestant venu de France depuis Sully. Nous sommes sortis de table à 10 heures. Le bal de la Reine commençait à 9 heures et demie. Mais elle était prévenue du dîner de la Reine douairière. Nous ne sommes arrivés à Buckingham-Palace qu’à 10 heures et demie. Assez tôt, car j’y suis resté jusqu’à deux heures. C’est long. Décidément quoique en principe ce soit juste, les spectateurs sont trop sacrifiés aux danseurs. Soixante ou quatre vingt personnes dansant toujours, et douze ou quinze assistants ramassant çà et là des lambeaux de conversation décousue. Lord Clarendon a été m’a principale ressource. Un peu Lady Palmerston, Lady Normanby, Lady Fitz-Harris. Je trouve la manière de Lady Palmerston avec son mari et sa fille très aimable. Elle est sans cesse occupée d’eux, et visiblement. Elle doit leur plaire beaucoup. J’ai eu hier une longue visite de M. de Kissélef, évidemment charmé d’aller à Paris, quoiqu’il y aille par Pétersbourg. Je lui ai parlé de bien des choses et bien. De deux surtout, votre conduite envers la France et notre coalition de l’an dernier. Je crois qu’il a été assez frappé. J’étais en veine de paroles très libres et point amères, comme le jour où j’ai parlé chez vous devant la Princesse Soltykoff et Nicolas Pahlen de la façon dont vous récompensiez Pozzo. Vous vous rappelez. 3 heures Il n’est bruit ici que du mauvais succès de votre expédition de Khiva. J’ai tort de dire votre et cela me déplait. Eh bien, vous savez surement que l’expédition de Khiva, n’a pas réussi. Le corps expéditionnaire est rentré dans les frontières russes après avoir perdu la moitié de ses hommes et presque tous ses moyens de transport, chameaux, charrettes etc. Je ne vois que des gens à qui cela fait plaisir. M. de Brünnow a du malheur. Invité à dîner chez la Reine, il a répondu pour dire qu’il acceptait. Du reste, depuis quelques jours il s’excuse de n’être pas venu chez moi. Il n’avait, dit-il, point de caractère bien règlé, il était si peu de chose ; il a cru qu’il devait se conduire sans prétentions. Dès qu’il aura présenté ses lettres de créance demain au lever, il viendra mettre sa carte chez moi, et il m’expliquera pourquoi il n’est pas venu plutôt. Il a tenu ce langage à plusieurs personnes entr’autre à M. de Bülow qui me l’a dit, et ne doute pas qu’il ne vienne. Je l’attends. N’en parlez à personne jusqu’à ce qu’il soit venu. Le corps Diplomatique de Londres va se renouveler beaucoup. M. de Blome retourne en Danemark. M. de Hummelauer à Vienne, quand il se sera marié à Milan ce qu’il fait par ordonnance de son médecin. Bourquenoy me quitte la sémaine prochaine. Je le regretterai. Il est de très bon conseil et d’un aimable caractére ; vraiment estimé ici. Mon ambassade vous plairait à voir. Les deux secretaires, les deux attachés et mon petit herber vivent dans la meilleure intelligence, et tous de fort bon air. L’un des attachés, M. de Vandeul est un jeune homme distingué. Je ne sais pourquoi ceci me revient à l’esprit, Lord Douro, était hier au soir au bal. Oh vraiment vraiment! J’aime mieux Lord Brougham.
Mercredi, 9 heures
J’ai causé longtemps hier après dîner avec Lady Carlisle qui m’a parlé de vous simplement; affectueusement, comme il me convient. Il y avait à dîner dix du douze personnes invitées, pour me voir. Un M. Grenville, de 84 ans frère ainé du feu lord Grenville, homme fort, lettré, dit-on et qui a l’une des plus belles, bibliothèques de l’Angleterre. Je lui ai promis d’aller la voir. Je suis d’une coquetterie infatigable. Ne croyez pas pourtant que je prodigue mes promesses. J’oublie les noms des autres. On a ici une façon de prononcer les noms propres qui les rend très difficiles à comprendre et à retenir. C’est un de mo ennuis. On me présente les gens, J’entends mal ou je n’entends pas leur nom. Et quand je les retrouve je ne m’en souviens pas. Le vieux poète Rogers est un de mes proneurs. Je le soigne. Au moment du dîner, la Duchesse de Sutherland à reçu l’avis que le lèver, qui devait avoir lieu ce matin était remis. Je viens de le recevoir aussi de Sir Robert Chester. La Reine est un peu souffrante. Elle a pourtant dansé avant-hier jusqu’à une heure et demie. On se demande toujours, si elle a raison ou tort de danser. Personne ne répond positivement. si elle a tort elle a grand tort, car elle danse beaucoup, et personne, en dansant ne saute si vivement et ne parcourt autant d’espace qu’elle J’ai fini chez Lady Minto. J’y ai découvert un parent de bien loin, un M. Boileau de Castelnau issu d’une famille de refugiés protestans Geva une branche existe encore à Rismes, et tient à la mienne. Il est beau frère de Lord Minto et a été charmé de la découverte. Précisément, par grand hazard ma mère venait de m’annoncer, le mariage d’une jeune fille de la branche Nimoise, qui a épousé à Paris un anglais un M. Grant. De là des conversations, très amicales un nouveau gage de l’alliance anglaise. J’étais rentré à minuit. C’est ma limite ordinaire.
2 heures
J’ai le 333. Au moment où je revenais à vous on est venu m’annoncer le rev. M. Sidney smith. Je l’ai reçu. Il vante fort Lord John Russell et le regarde comme l’âme du Cabinet. Il dit que Lord Melbourne est un homme de beaucoup d’esprit et un beau garçon, beaucoup plutôt qu’un politician. Mais bien moins insouciant qu’il n’en a l’air Les radicaux sont en déclin dans la Chambre deCommunes, décourages et ne comptant plus sur lEur avenir ; ils s’étaient figurés qu’ils changeraient toutes choses. Le bon sens public les paralyse. La plupart se fondront dans les Whigs. S’il y avait une de dissolution. Peel aurait, six à sept voix de majorité. Voilà notre conversation. Conversation où j’ai beaucoup plus écouté que dit ; comme je fais toujours quand je suis avec un homme qui à une reputation d’homme d’esprit un peu littéraire. Il y a des gens à qui on plaît en leur parlant ; à d’autres, en les écoutant. On distingue bien vite. Je crois tout à fait que Barante restera à Pétersbourg comme Ste Aulaire à Vienne Soyez sûre que Thiers remuera peu, le moins possible M. de Rémusat est des amis particuliers de M. de Barante et le défendra. Il y aura beaucoup de petits combats intérieurs sur les personnes Quelques nominations feront du bruit. Mais en somme, la conservation prévaudra. Je suis charmé que Pahlen revienne et vous revienne. De part et d’autre on n’est pas si méchant qu’on se fait Voilà qui est dit : le 1er juin, car bien certainement votre nièce tardera. On part toujours plus tard qu’on ne dit, excepté.... Je ne comprends pas comment Lady Palmerston a parlé d’avril, à Lady Clauricard. Juin est établi. Votre description du Duc de Br. est très vraie mais l’intérieur est très supérieur à l’extérieur. Vous trouveriez la même chose pour plusieurs de mes amis M. Piscatory et M. de Rémusat par exemple. Les défauts sont très apparens; les qualités sont essentielles et quelquefois des plus rares. Je dis cela de l’esprit comme du caractére. J’ai fort appris et j’apprends tous les jours à suspendre beaucoup mon jugement. Je crois à mon premier instinct et à ma longue réflexion. Mais cette vue superficielle, passagére qui n’est ni de l’instinet, ni de la réflexion, je m’en méfie beaucoup ; rien n’est plus trompeur. Voilà un billet de Lord Palmerston qui me dit qu’il sera au Foreign, office à 4 heures. J’ai encore deux ou trois lettres à écrire dont ma mère est une. Adieu. Je ne puis pas me plaindre de la prudence, de mes gens. Je l’ai recommandée. Adieu, adieu
Du Val-Richer, le 22 août 1839, François Guizot au général Baudrand
151. Val-Richer, Samedi 6 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Avez-vous eu une raison pour me chercher avant-hier avec plus de tendresse que de coutume ? Avez-vous pensé que j’étais né ce jour-là, il y a 51 ans ? car nous sommes du même age. Quand mes enfants sont venus m’embrasser avec leurs gros bouquets et leurs petits ouvrages, vous m’avez manqué, je vous ai cherchée aussi. Nous sommes, nous rencontrés à ce moment ? Je ne suis pas [?] du tout, et je n’aime pas les gens qui le sont, je ne puis souffrir qu’il entre dans le cœur ou qu’il en sorte quelque chose d’affecté et de ridicule. Mais je trouve le monde si froid, si sec ! Vous avez bien raison ; il n’y a point de joie solitaire. Ces mêmes émotions qui, partagées, seraient douces et charmantes retombent sur le cœur isolé et l’oppressent. N’ayez pas mal aux nerfs deares ; que vos genoux ne tremblent pas, que votre vue ne se trouble pas ; mais aimez-moi toujours comme hier et avant-hier.
C’est par courtoisie sans doute que M. Molé destine au Turc, l’hôtel de Pahlen. Il veut que cette maison soit encore un peu Russe. Vous la reprendrez avec Constantinople. Pourquoi M. de Pahlen n’achèterait-il pas l’hôtel d’Hauré ou de Lille ! C’est grand et beau, & toujours à vendre, si je ne me trompe. Quand le comte Appony sera-t-il établi dans sa nouvelle maison ? Voilà une affaire traitée de bonne grâce. A partir de ce matin, je suis tout à fait seul. Mon dernier cousin s’en va et je n’attends plus personne, M. et Mad. Villemain devaient venir, mais ils ne viendront par.
Lisez donc la Littérature de M. Villemain. Il y a vraiment beaucoup d’esprit, de l’esprit sensé et gracieux, ce qui prouve bien, à coup sûr, la distinction de l’âme et du corps. Mais j’oublie que vous n’aimez guère la littérature, même spirituelle. Il vous faut la vie réelle, les personnes. Moi aussi, j’aime infiniment mieux les personnes qui me plaisent que les livres qui me plaisent. Mais beaucoup de personnes ne me plaisent pas, et les livres me distraient de celles-là. Henriette aime beaucoup les livres et j’en suis charmé. C’est une immense ressource pour une femme que le goût de l’étude. Elle lit avec le même ravissement le Voyage du jeune Anacharsis et Macbeth. C’est un esprit bien sain, en qui toutes les facultés, tous les goûts se développent dans une rare harmonie. Si vous aviez été ici à la campagne, avec moi, en mesure de jouir ensemble des œuvres de l’art comme de celles de la nature, je vous aurais montré avant-hier sa traduction, à elle seule, bien réellement seule, d’un fragment du Lay of the last Minstrel, et vous auriez trouvé que pour un enfant de neuf ans, l’intelligence était assez vive et l’expression heureuse. A propos de mes enfants, je vous conte mes propres enfantillages. Je ne les conte à nul autre.
M. de Broglie était encore avant-hier sans nouvelles de sa fille. Je suis impatient qu’elle l’ait rejoint. Il ne faut pas toucher souvent aux plaies. Dites-moi, s’il a vu les Granville. Je suppose que non, puisque Lord Granville ne peut pas sortir. Il me tarde que vous soyez rentrée en possession de Lady Granville. Sans elle vous me faites l’effet d’une personne à qui son dîner manque. J’espère que vous garderez Alexandre au moins quelques jours. 9 h. 1/2 Non, vous ne serez plus seule. J’en ai besoin pour moi, encore plus que pour vous. Adieu, adieu. Je vais marquer des place où je veux plantés des arbres. Le mélèze que vous savez, qui voulait me suivre, se porte à merveille. J’en vais planter d’autres. Aucun ne le vaudra. Adieu. Adieu. G.
Au château de Broglie, Jeudi 20 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d’en lire bien long, la lettre de M. Xavier Raymond, et le manifeste de Raschid Pacha. C'est bien du bruit. Jamais les hommes ne font plus de bruit que lorsqu’ils n'ont pas envie de faire autre chose. Quand on regarde au fond et de ce manifeste et de toutes les pièces de cette affaire depuis l'origine, on trouve le bruit bien ridicule, car au fond, il n’y a rien. Vous demandez qu’on vous redonne ce que vous avez. On refuse de vous le redonner, mais on reconnaît que vous l'avez. Voilà pourquoi on vous déclare la guerre. Vous dites que vous ne l'acceptez pas, et vous avez raison, et je crois qu’on ne vous la fera pas. Pourtant, il y a là un grand secret un secret de Dieu. A-t-il décidé que le moment de la mort de la Turquie est venue, et par conséquent le moment du remaniement, c'est-à-dire du bouleversement territorial de l'Europe au sujet de l'héritage ? C'est possible ; et moins je vois de motifs assignables, de motifs humains à la guerre, plus j'ai peur quelquefois, qu’il n’y ait là une volonté divine, et que ce ne soit bien lui même qui pousse à la guerre, les hommes qui n'en veulent pas. Nous verrons bien.
En attendant, je cause ici, de cela et de tout. J’irai après demain passer 24 heures au Val Richer pour dire adieu à ma fille Pauline qui en par lundi pour le midi. Je reviendrai, après son départ, passer encore ici la semaine prochaine, et je retournerai au Val Richer, le samedi 29 pour le quitter définitivement le 15 ou 16 Novembre. C'est bien des courses, et mon Cromwell, qui touche à sa fin, en est un peu dérangé. Je serais fâché quand j'aurai fini ; c'était une société dans ma solitude, et un but dans mon oisiveté. Il faudra que je m'en fasse un autre.
9 heures
On m’apporte votre lettre, et le duc de Broglie m'en envoie une du Prince de Joinville qui est en effet très inquiet pour la Reine sa mère. La pleurésie allait mieux ; mais le matin même, une inflammation d’entrailles venait de se déclarer et paraissait grave. On attendait le Duc de Nemours qui venait de Vienne avec sa soeur la Princesse Clémentine. Le duc d'Aumale est en Savoie. Ils ont évité de se trouver tous réunis à Genève, de peur de quelque ennui politique. Je crains beaucoup pour la Reine ; elle est prête, fatiguée ; elle a 71 ans. Il y a de bon médecin à Genève. Ecrivez-moi demain à Broglie. Je n'en partirai samedi qu'après déjeuner. Mais dimanche, je vous prie de m'écrire au Val Richer. J'y passerai toute la journée de lundi. Adieu, Adieu. G.
95. Val Richer, Vendredi 16 juin 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous ne lisez jamais L'Univers. C'est quelque chose de curieux que la violence et la croisade qu’il a entreprise contre vous. Il a été un moment embarrassé ; il était, en train d’une croisade à peu près aussi violente contre l'Angleterre protestante. Mais l'occasion était trop belle ; il a laissé là l'Angleterre protestante et s'est joint à elle contre la Russie Grecque. Si la chance contraire s'était offerte, il l’aurait acceptée et se serait joint à vous contre l'Angleterre. L'hérésie et le schisme, deux ennemis mortels ; peu lui importe contre lequel des deux, il guerroie à mort. Par cela seul que vous êtes des schismatiques, vous êtes les alliés nécessaires, constants de tous les révolutionnaires ; vous avez voulu, de concert avec une partie des Mazziniens, faire de l'Italie un Royaume pour le duc de Leuchtemberg, vous n'avez aidé l’Autriche à dompter la Hongrie que parce que, pour le moment, le tour de la révolution hongroise ne vous convenait pas. Vous êtes partout les appuis de l'Anarchie et de la Barbarie. Et tout cela est cru par un grand nombre de Catholiques, de Prêtres, d'Évêques qui, avec l'Univers croiraient et disaient exactement les mêmes choses du Protestantisme et de l'Angleterre si c'était de ce côté qu’ils avaient affaire. Je n’ai jamais vu tant de passion dans tant de bêtise. C'est une grande pitié de voir une grande croyance, une grande église Chrétienne poussée, si bas par ses plus bruyants défenseurs. Quand je vois, d’un côté cet état d’esprit de l'Univers, de l'autre la Papauté ne pouvant vivre huit jours à Rome sans le secours d’une armée étrangère, il me prend de vives inquiétudes que le Catholicisme ne soit réellement bien malade, et j'en serais désolé, car, dans la moitié de l'Europe, où il a encore l’air de régner, il ne serait remplacé que par le socialisme et l'impiété.
Qu'est-ce que ce M. Ivan Tourgueniev dont le Journal des Débats raconte le livre qui paraît assez piquant ? J’ai connu deux Tourgueniev, man ils s'appelaient Alexandre et Nicolas ; l’un est mort, l'autre était un ancien conspi rateur, condamné à mort chez vous, homme d'esprit et honnête rêveur. Le livre des Débats a été écrit et circule librement en Russie ; c’est une satire nationale des mœurs nationales. J’ai entendu dire que l'Empereur Nicolas pratiquait assez ces satires là, Nicolas Gogol et autres, par espoir de réformer ses moeurs, la vénalité, l'ivrognerie, l'oisiveté. Il aurait mieux fait de pousser dans cette voie que d'envoyer le Prince Mentchikoff à Constantinople.
Je vois que Lord Palmerston a eu un petit échec dans la Chambre des Communes à propos des aumôniers catholiques, dans les prisons ; c'est le pendant de celui de Lord John à propos des Juifs. Le Parlement en donne la liberté d'être aussi Protestant qu’il lui plaît, bien sûr que cela ne renversera pas le Ministère. Je suis bien aise et un peu triste que vous soyez si contente de la Princesse Kotschoubey. Vous ne la garderez pas toujours. Est-elle donc bien décidée à retourner en Russie après Ems ? C’est certainement une très bonne, très sensée, très noble et très aimable personne.
Midi
Je suis très convaincu que mon esprit ne peut rien au mal dont nous souffrons. Adieu, Adieu. G.
224. Val-Richer, Dimanche 21 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens de passer deux heures bien ennuyeuses. J’ai écrit treize lettres, en arrière depuis je ne sais quel temps. Quand on rentre dans la solitude, il faut rentrer en paix avec sa conscience. Mais, j'ai besoin de me délasser du travail de cette paix-là. Décidément je suis content de vos arrangements. Pur contentement matériel ; mais je n’espérais pas si bien ni si vite. J’ai toujours vu ces affaires-là fort en noir. Je suis de l’avis de M. de Pahlen. Il faut se contenter de la garantie de vos fils, stipulée dans l’acte et sans hypothèque. Pour jour l’hypothèque aurait peu de valeur, car une hypothèque, le jour où on a besoin de l’invoquer, c’est un procès, et vous êtes propre à tout plus qu'aux procès. Malgré mon noir, il me paraît impossible que dans leur situation, la garantie de vos fils ne soit pas suffisante.
Vous avez deviné l'expédient. On ne traitera à Vienne que de l’arrangement à conclure entre les deux Chefs Barbares ; et alors vous pouvez y venir. Et probablement vous y viendrez. Le point de départ de la question sera la restitution de la Syrie à la Porte et la reconnaissance de l'hérédité en Egypte pour le Pacha. Mais il ne se dessaisira pas de tant, et il sera appuyé. On finira par trancher le différend et par lui donner héréditairement aussi deux des quatre Pachalik de la Syrie, St Jean d’Acre et Jérusalem. On dit que vous préparez dans la mer noire sous le manteau de la Circassie, une expédition qui suffirait à la conquête de la moitié de l'Asie. On dit aussi qu’on s’occupe sérieusement à Vienne de la Diète de Hongrie, et qu’une dissolution. pourrait bien avoir lieu. Espartero a écrit à Madrid que le 24, jour de la fête de la Reine, il tenterait une attaque décisive. Je suis décidé à ne croire à rien de décisif au delà des Pyrénées. Mais ce que je vous ai mandé des dires de M. Sampayo sur l’Espagne revient de plusieurs côtés. C’est une anarchie prospère partout où la guerre n’est pas, et elle n’est que sur bien peu de points.
Lundi 7 heures et demie
Je ne suis pas comme vous. J’aimerais mieux qu’on eût fait pour vous plus que le droit. Bien moins pour quelques mille livres de rente de plus que pour trouver là une bonne occasion de rapprochement. Plus qu’une bonne occasion une bonne raison ; car c'eût été un bon procédé, une preuve qu’il y avait dans la conduite passée plus d'humeur que de froideur, plus d'emportement barbare que de sécheresse. Vous avez tort dédire tant mieux de ce que vous ne devrez rien à personne. J'aimerais mieux que vous dussiez quelque chose à vos fils. J’aimerais mieux que leur tort ne fût pas complet ; et que vous fussiez provoquée à pardonner il faut tant pardonner en ce monde ! Jamais oublier, ce qui est absurde puisque c’est se tromper soi-même ; mais pardonner, pardonner sincèrement, en se résignant à l’imperfection des hommes et de la vie. Vous savez qu’il n’y a qu’une seule imperfection à laquelle je ne me résigne pas.
10 heures
Je vous ai parlé hier ou avant-hier de la situation du Cabinet. Je vous parlerai demain de la commutation de Barbés. Je me suis imposé à Paris une grande réserve de langage à ce sujet. Il y avait un parti pris d'user et d'abuser de mes paroles. Adieu. Vous avez très bien fait de ne pas envoyer votre lettre à Orloff. Laissez ces gens-là, vous voilà hors de leurs main. Vous n'aurez plus besoin d’eux. C’est tout ce que je souhaitais, et plus que je n'espérais. Adieu. Adieu à demain. G.
240. Val -Richer, Samedi 10 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait hier ma visite de jardins, d’un côté que je ne connaissais pas. Le pays est très joli une succession de vallées toujours fraîches et riantes. J’ai admiré les ressources, les expédients de l'activité humaine. Evidemment les deux voisins que j’ai été voir s'ennuient beaucoup ; personne à voir et rien à faire. Ils ont reporté sur les fleurs toutes les passions de la vie. Ils sont ambitieux, avares curieux, jaloux. Il réussissent à remplir leur temps, et je crois, en vérité leur âme. Cependant il y en a un qui emprunte à ma bibliothèque des livres de chimie. Les fleurs ne lui suffisent pas. Il joindra un laboratoire à sa serre
L'Empereur me paraît bien prononcé contre les grands mariages. Au fait, il a raison. C’est encore du pouvoir absolu. Mais si cette petite Princesse a de l’esprit, voilà une seconde grande Duchesse Hélène. Pour vivre là, il faut être Catherine. C’est bien le moins. Est-il vrai que le jour du mariage Leuchtenberg, il y ait eu sur la Baltique une grande tempête ou beaucoup de gens aient péri ?
Il me semble que Baden devient brillant. Je suis bien aise que vous y ayez Montrond. Ce sera bien une demi-heure par jour. Le Roi dit qu’il n’aura jamais Thiers qu'avec moi, pour avoir un contrepoids. Il dit aussi que si jamais il a Thiers aux Affaires étrangères, il l'aura tout seul, pour qu’il soit bien clair qu’il lui est imposé, et pour travailler librement à s'en défaire. Le Roi parle de tout et ne dit rien. Il a raison, comme votre Empereur. Il faut garder le rôle qu’on a pris.
La mesure qu'on vient de prendre à Pétersbourg sur le cours de l'argent me paraît bonne pour vous. Le crédit de la Russie doit y gagner ; donc le cours du rouble doit s'améliorer, et vous ferez venir votre argent, en France ou en Angleterre à de meilleures conditions. Du reste il y a, dans la mesure même, quelque chose que je ne comprends pas bien. Le retrait absolu et soudain d'un papier monnaie est une opération bien difficile et bien longue. Vous auriez dû consulter à ce sujet le Rothschield auquel vous avez donné vos commissions. Il en sait plus que moi.
La bizarre saison ! Quand je me suis levé tout à l'heure, le ciel était pur et le soleil brillant. Voilà un ciel tout noir, et dans cinq minutes la pluie. Avant qu’elle arrive je vais respirer l’air du matin. Quel dommage que nous ne respirions pas le même ? Vous promenez-vous en ce moment ?
9 h 1/2
Je reçois votre n° 234. J'y répondrai demain. Il faut absolument que j'aie mal compris la note du consul car je vois que tous les gens qui vous entourent la comprennent comme vous. Je ne veux pas me résoudre à croire que votre fils savait tout cela. Pourtant ! Adieu Adieu. Je vous dirai demain tout mon avis. G.
Val-Richer, Vendredi 7 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai déjeuné hier avec dix huit personnes, quelques une venues de Rouen, de Trouville et de Paris. J’ai été frappé de l’uniformité de leur langage. Elles disent que, dans les villes, dans la bourgeoisie, Henri V et le comte de Paris ensemble gagnent beaucoup de terrain ; dans les campagnes, l’Empereur. Les paysans ne veulent de la légitimité, ni de la République. Je parie toujours, d’ici à assez longtemps, pour le statu quo, ou à peu près. Mais le sentiment de l’instabilité domine évidemment toujours dans les esprits. Il renait pourtant une peu de prospérité. Rouen, Le Havre, Lyon, sont contents. Quand l’Assemblée se réunira, le cabinet pourra se targuer de la tranquillité publique pendant l’entracte, du silence des Conseils généraux et de la renaissance des Affaires. C’est assez, ce me semble, pour ralentir l’attaque. Il y avait là hier, deux membres de l’Assemblée qui disaient tout haut : " Si nos gros bonnets veulent prendre le pouvoir, nous renverserons le cabinet sur le champ ; sinon, ce n’est pas la peine. " Il ne me revient sur les dispositions de Molé et de Thiers, que ce que je vous ai déjà dit. On évalue, dans l’Assemblée, les rouges à 200 ; le tiers-parti, amis de Dufaure à 150 ; décidés, légitimistes ou Orléanistes à 400. Je n’ai rien de plus dans mon sac pour l’intérieur. Au dehors, je sais que Georgey est déjà gracié. J’en suis charmé. J’ai peu de confiance dans la magnanimité par habilité. Au reste, les affaires de l’Autriche en Italie, bien que plus simples et plus finies en apparence que les affaires en Hongrie, me semblent, au fond, plus mauvaises et moins finissables. Je comprends une vraie pacification entre l’Autriche et la Hongrie ; il y a là des bases d’arrangement, une semi-indépendance, une constitution ancienne et reconnue, et qui peut être rajeunie. Entre l’Autriche et la Haute Italie, il n’y a que de la force ; point de passé autre que la conquête ; point de droits naturellement acceptés. La force est probablement très suffisante pour rester. Mais rester, ce n’est pas pousser des racines ; et il faut des racines, surtout de notre temps où les orages sont toujours à prévoir. Il y assez de mauvaise humeur en effet dans le billet de lord John. Je crois, comme vous, qu’on ne s’épargnera pas pour vous brouiller, et qu’on n’y réussira pas. Ce serait trop bête. Pour vous, vous avez beau jeu à être patient. Et pour l’Autriche, elle ne peut se rétablir que par la patience. Je ne la connais pas assez bien pour savoir. Quelles sont les ressources de régénération intérieure. Je suis porté à croire qu’elle en a, qu’elle se relèvera. Mais il faut qu’elle se relève. Sans quoi, ce sera lord John qui aura raison, et vous serez vis à vis de l’Autriche, comme vis-à-vis de la Turquie et de la Perse, des protecteurs-héritiers. Le monde sera curieux à voir dans un siècle ou deux. Il aura résolu bien des problèmes.
Je rentre dans le Val Richer. J’y attends demain D’Haussonville. J’y ai aujourd’hui Lady Anna Maria Domkin qui me raconte des commérages de Richmond, Madame de Caraman cherchant un mari anglais et disant aux personnes qui lui demandent pourquoi elle n’en prend pas un : « Ma vie est voué aux arts. » Elle (Lady Anna-Maria) s’étonne que vous vous plaisiez à Richmond, entre Lady Alice Peel, Madame de Metternich et les Berry. J’ai défendu vos sociétés et dit du bien de Lady John. Votre lettre à lord John est très bien tournée. Vous avez le don de la malice dans la franchise.
Samedi 8 Sept heures
Je relis votre lettre. Je voudrais précisément vous demander des nouvelles de Marion. Faites-lui, je vous prie, toutes mes tendresses, mes anciennes et constantes tendresses. Je ne puis souffrir ces longs silences, ne point parler et ne rien entendre des personnes qu’on aime, comme si l’amitié n’était plus ou si la mort était déjà là. Interrompez cela pour moi, de temps en temps, avec Marion. C’est vraiment bien triste que ses parents ne veuillent plus de Paris. Est-ce qu’elle ne pourrait pas, elle, y venir passer six semaines ou deux mois avec vous, quand vous y serez, pour sa santé ? Comment va Aggy ? Je suis sûr que vous ne faites pas attention au concile provincial qui va se tenir à Paris. Vous avez tort. C’est un événement. Soyez sûr que les questions religieuses reprendront en France une grande place, ne fût-ce que parce qu’on n’en a pas parlé depuis longtemps. Les libertés politiques pourront souffrir de tout ceci ; les libertés religieuses, non. Celles-là seront nouvelles, et sacrées. Et elles fourniront, autant que les autres, de quoi parler et se quereller.
Avez-vous remarqué ces dernières paroles de Manin quittant Venise : « Quoiqu’il arrive, dites : cet homme s’est trompé ; mais ne dites jamais cet homme nous a trompés. Je n’ai jamais trompé personne ; je n’ai jamais donné des illusions que je n’avais point ; je n’ai jamais dit que j’espérais lorsque je n’espérais pas. » C’est bien beau. Je m’intéresse à cet homme-là.
Onze heures
Votre lettre arrive, plein d’intérêt. Si ce que vous dit Marny est vrai, le changement de cabinet sera un événement. Adieu, adieu. Adieu, G.
283. Val-Richer, Mardi 1er octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mon médecin me trouve bien. Il a examiné avec grand soin l'état de ma poitrine. Il n’y a rien. C’est un rhume, qui tient bien à une mauvaise disposition des bronches. (c'est le mot savant ) et qu’il faut soigner, mais qui n’a rien du tout de grave. Il pense comme vous, que l’humidité ne me vaut rien et que je ferai bien de ne pas rester ici trop tard. Ma maison n'a pas l'ombre d'humidité ; mais l'atmosphère en a beaucoup, rien n’est plus sûr. Il va passer ici deux jours et me regardera bien. Je me sens beaucoup mieux. J’ai peu toussé aujourd'hui. L’appétit, qui m’avait quitté, me revient.
Pourquoi ne voulez-vous pas que je pense à votre intérêt ? Est ce que ce n’est pas le mien ? Je ne puis m’y donner tout entier à mon regret infini ; mais tout ce que j’y puis donner, j'en jouis autant que vous. D'ailleurs, je ne veux pas arriver enrhumé à la session. Je vais m’arranger en conséquence. Je ne puis vous en dire davantage aujourd'hui. Je tiens trop à la vérité avec vous à la vérité précise. Mais vous pouvez vous fier à moi.
Il y a des gens d’esprit qui ont pensé au troisième parti dont je vous parlais. Ils disent que la coalition de l'Empereur et de Lord Palmerston est très facile à condition que Méhémet ne se défendra pas, car s'il se défend, et fait marcher son fils sur Constantinople jamais Lord Palmerston ne fera trouver bon à l'Angleterre que les Russes soient appelés pour l'arrêter. Du reste le peuple de Paris même celui qui pense à quelque chose, pense bien peu, me dit-on, à l'Orient et au cabinet.
La grande préoccupation, c’est la perspective d’un mauvais hiver, la cherté, la disette, la Banque de Londres chancelante. On dit que la saison vous a maltraités aussi, et que la Russie méridionale est menacée d’une grande disette.
Charlotte me revient à l'esprit. Voulez-vous que je fasse chercher une femme de chambre de Suisse ? Mad. Delessert en a toujours sous la main. Je suis entouré d’un monde très protestant, très pieux, et qui, sous ce rapport là, ne vous donnerait rien que de bon. Ce bon Génie est fort troublé de me craindre malade. Il m'écrit que si je le suis, il viendra s'établir au Val-Richer. Mon médecin lui a écrit ce matin même pour le rassurer.
Mercredi, 9 heures
J’ai très bien dormi. Le sentiment de chaleur et de fatigue que j’avais dans la gorge et la poitrine disparaît dans trois ou quatre jours, il ne restera rien du mal que la nécessité de prévenir ce qui pourrait en amener le retour. Savez-vous si Mad. de Boigne est de retour à Paris, et sinon où elle est ?
9 h. 1/2
Je n’ai pas la moindre rancune de votre oubli de Lord Chatam. J'en avais une vieille à cause de la vôtre pour mon oubli de Berryer. Je me la suis passée dans cette occasion-ci. Et elle est passée. Mon troisième parti vous voyez n’était par aussi terne que celui que vous avez imaginé. Du reste vos présomptions sont justes ; on a beaucoup d'humeur et on espère que les collègues de Lord Palmerston ne seront pas tous de son avis. Adieu. Adieu. Oui au revoir.
Val-Richer, Mercredi 5 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement, l'Empereur ne peut pas laisser fusiller Georgey. C'est pour lui une question d’honneur, et pour l'Empereur d’Autriche une question de prudence. Si on ne gagne rien à faire comme Georgey, tout le monde fera comme Bem. D'ailleurs, il y a toujours eu faveur pour les militaires qui se sont battus longtemps, et qui ont battu souvent, avant de se rendre. On a peut-être raison de faire juger Georgey ; mais condamné ou non, il faut que le jeune Empereur le prenne et se l’attache. Je parle dans l’idée que Georgey est bien réellement ce qu’il paraît être, et qu’il a bien fait lui-même ce qui s’est fait sous son nom.
Madame la Duchesse d'Orléans et Monsieur le comte de Chambord passeront bien près, l’un de l'autre. Je ne crois pas du tout qu’ils se voient. Mais l’occasion serait bonne et pourrait être mise sur le compte du hasard. Mad. Austin m'écrit : " I spent an hour tête à tête with the Duchers ef Orleans, and found her admirable, at all points, even beyond my expectation. I think I never came near a more perfectly balanced mind, one in which every sentiment had so exactly its just measure. Our people are firmly persuaded thatt her son will neign ; why they can hardly tell ; but so it is. " Je serais assez curieux de savoir pourquoi la bouderie avec la Duchesse de Cambridge, et par qui les marques de mauvais vouloir ont commencé.
Il y a eu conflit à Paris, entre les deux nuances du parti légitimiste. Réunion, solennelle et nombreuse. Les modérés ont lavé la tête aux emportés. On a lu des lettres des Provinces, qui se plaignaient amèrement de l’amertume étalée contre la monarchie de 1830, disant que cela aliénait partout les conservateurs, et qu’on n'entendait pas se laisser gouverner par de telles folies. Les emportés de sont défendus, même assez vivement mais sortis de là, ils ont mis de l’eau dans leur vin, et il y a évidemment une oscillation dans le sens de la modération et de la fusion. Tout cela pour passetemps d'oisifs. Il n'y a de sérieux que le travail lent qui se fait dans tous les esprits, et qui est bien loin du but vers lequel il marche.
Jeudi 6
7 heures Je vous ai quittée hier pour recevoir une visite puis deux autres de Lisieux et des environs. Je suis un peu frappé de l'effet que produit la bonne réception du président à Epernay. L'Empire était hier à l'ordre du jour, dans toutes les conversations. Mettez cela d'accord avec le silence presque absolu des conseils généraux qui ne demandent ni l'Empire, ni seulement la révision de la Constitution, et qui se contentant de discuter leurs affaires locales comme si la France était depuis cent ans en République et bien tranquille en république. Il ne faut jamais se fier aux mouvements superficiels et soudains de ce pays-ci ; ils ne prouvent rien. Il ne faut-pas se fier davantage à ses plus sérieuses et plus calmes démonstrations ; elles ne garantissent rien. Tout est ici également vain, ce qui dure comme ce qui passe et il n’y a pas plus de racines au fond qu'à la surface. Et pourtant quand on vit au milieu de ce pays-ci, quand on y regarde attentivement, il est impossible de croire à sa décadence, de ne pas croire à son avenir. On voit clairement que la prospérité, le bien être, l'activité, la confiance, l'ordre, le bon sens, l'honnêteté tout cela ne demande qu'à venir à s’établer à se développer. Mais il ne suffit pas de demander en ce monde ; il faut vouloir. On ne sait pas vouloir ici ; les honnêtes gens et les gens d’ordre moins que d'autres. Ils cherchent, ils hésitent, ils doutent, ils tâtonnent, ils changent. Et puis ils s'étonnent que tout soit bouleversé autour d’eux ils s’étonnent que leur société ne soit pas forte et stable quand ils sont eux-mêmes, si mobiles et chancelants ! Je suis toujours sur le point de dire à tous les gens là, en causant avec eux : " Mais, malheureux, c’est votre faute ! " Beaucoup en conviendraient, mais du bout des lèvres sans cette conviction forte qui détermine la longue. prévoyance, et le travail soutenu. Un tempérament excellent, un mal très grave, un remède certain, et un malade qui ne sait pas, ou n’ose pas, ou ne veut pas l'avaler ; voilà où nous en sommes. Connaissez-vous rien de plus désespérant ? Pourtant, je me désespère pas Onze heures La poste n’arrive pas, et je suis obligé de partir pour aller déjeuner à Lisieux. Je rencontrerai le facteur en route, et je prendrai votre lettre. Mais il faut que je ferme celle-ci. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 4 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait comme je vous ai dit. J’ai travaillé et je me suis promené. Mon travail m'intéresse. C’est dommage que la vie soit si courte. Le vase est trop petit pour ce que j’y voudrais mettre.
Il paraît que le Président a été extrêmement bien reçu en Champagne, mieux que partout ailleurs. Montebello nous dira si les journaux disent vrai. Je les trouve bien vides. Ils ne savent que mettre à la place des scandales de l'assemblée. Les légitimistes, ce me semble. baissent un peu de ton. Ils se résignent d’assez mauvaise grâce à répéter le mot de M. le comte de Chambord sur M. le comte de Paris. Voilà vraiment un grand effort de raison. Cela coupe un peu l'herbe sous le pied au comte de Montemolin. Collaredo m’avait étonné. Il a bien fait de s'en excuser. J’ai des lettres de Genève. On y est inquiet des menées des réfugiés. On craint qu'elles ne forcent les Puissances à une intervention. Vous verrez que la République française ira mettre à la raison, celle de Berne comme celle de Rome et qu’elle remettra le Sonderbund sur pied.
Mercredi, 5 huit heures
Je me suis levé de bonne heure, malgré un accès, ou plutôt à cause d’un accès d’éternuement qui m'a empêché de me rendormir. Cette disposition a pourtant plutôt diminué qu’augmenté depuis quelque temps. J’attends la poste avec mon impatience du mercredi. J’irai chez le Duc de Broglie, pour dix ou douze jours, vers le milieu de la semaine prochaine. Vous m'adresserez alors vos lettres : chez M. de Broglie, à Broglie. Eure. Je vous dirai le jour précis. Vous avez surement remarqué, le petit article du Globe en réponse au Times à propos de la réponse du Prince de Schwartzemberg à Lord Ponsonby. C'est à mon avis, la meilleure preuve que la réponse a vraiment été faite. Il y a, dans l'article, une violence d'humeur contre Schwartzemberg et un dessein de le blesser qui ne peuvent venir que de Lord Palmerston et qui ne se rencontreraient pas, même dans Lord Palmerston. Si Schwartzemberg ne les y avait pas soulevés. Je regrette de voir que le grand Duc Michel est encore bien malade. Je n’ai rien fait dire au Journal des Débats sur l’attitude à prendre envers le Cabinet. C’est de lui-même qu’il prend celle que vous aurez vue dans son article d’hier. Il a raison. Ce n’est pas la peine de faire un grand effort pour amener les hommes qu'on amènerait à la place de ceux-là, et pour ce que feraient, aujourd’hui les hommes même qu'on amènerait. Il est peut-être bon que M. Dufaure soit vivement attaqué et même renversé. Il ne faut pas que ce soit par les mains de mes amis. Ils ont encore bien des choses à tirer de lui, et autre chose à faire après lui.
Onze heures
Voilà votre lettre. J'en aime tout, et surtout la fin. Votre disposition est toujours de venir à Paris à la fin du mois, malgré le choléra. La peur me prend quelquefois à la gorge, pour vous. Et dans d’autres moments, la conscience. Je me fais un devoir de vous tout dire. Mais j'aime mille fois mieux que vous veniez. Et certainement M. Gueneau de Mussy est une excellente occasion. Adieu, adieu. Je suis bien content d'avoir atteint le mercredi. J’ai six bons jours devant moi. Adieu G.
Val-Richer, Lundi 27 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
3 heures
Je vois que le succès de l'Empereur préoccupe beaucoup les Anglais. Reeve m'écrit : " Aujourd’hui que les guerres de Hongrie, de Bade et de Rome sont finies, et que les armées dominent partout on se demande quel sera le rôle de la politique conquérante. Il me revient des bruits de rapports plus intimes, entre la Russie, l’Autriche et le président de la République représenté par le général Lamoricière ; rapports destinés soit à étouffer les foyers révolutionnaires en Suisse et en Allemagne soit à un certain remaniement des territoires menaçant pour les petits états qui sont peu capables de se défendre et de maintenir l’ordre chez eux. D'après ces bruits, il s’agirait même de mesures prononcées contre la Suisse qui présente en effet de grands dangers. Quoiqu’il en soit, cette politique toute Russe, laisserait tout-à-fait de côté l’Angleterre. Que faut-il penser de tout cela ? Il est certain que nous n'avons rien fait pour nous attirer la confiance de l’Europe ; et personnellement il n'est pas impossible que les yeux de Louis Napoléon se tournent du côté de St Pétersbourg. Mais le sol de l’Europe est peu affermi pour tenter de pareilles expériences."
Vous voyez qu’ils prennent bien vite l'alarme. Les hommes sont toujours, beaucoup plus prompts qu’il ne faut à l'espérance et à la crainte. Que d'agitations perdues? Ici, dans le gros du public on n'a pas l’esprit si éveillé. Les idées sont plus courtes, et les sentiments plus vagues. On n’était pas sans quelque intérêt de routine pour les Hongrois. Cependant votre succès ne déplait pas ; c’est un gage d’ordre et de paix. Cependant on n’est pas sans quelque inquiétude de votre puissance. Aurez-vous envie de vous mêler d'autres affaires ? On espère que non ; mais on n’est pas sûr ; si votre armée rentre tranquillement, en Pologne, vous serez presque populaires, comme puissants et comme modérés. Le mouvement de reprise des Affaires commerciales continue. Rouen, Le Havre, Lisieux, Elbeuf, Lyon sont assez contents. Paris souffre toujours, et les villes de province n’en sont pas fâchés. Il y a vraiment un sentiment de rancune profonde contre Paris. Mais de rancune plutôt que d'émancipation. Il me parait impossible que ce soit par bêtise que Lord & Lady Palmerston prennent si publiquement le deuil de la Hongrie. Il y a là un parti pris, un parti politique. Ils croient qu’il leur vaut mieux d'être populaires parmi les vaincus qu'agréables aux vainqueurs. Et puis la routine, les engagements, les relations personnelles. En tout cas, je conviens que fermer sa porte ce jour-là, c’est bien fort.
Mardi 20 août. 9 heures
Pour la première fois, je me souviens aujourd’hui que je n'aurai rien et j'attends la poste avec indifférence. Je vais dîner chez un de mes amis à six lieues d’ici. Il y aura beaucoup de monde ; un seul homme notable de la société de Lisieux est exclu, le gendre de M. Duvergier de Hauranne M. Target. Il s'est mal conduit envers moi, et j'ai déclaré en arrivant, que je ne le verrais pas. Il me fallait un bouc émissaire, un seul, pour les lâchetés et les trahisons. J’ai pris celui-là à l'approbation générale du pays. Je suis le plus amnistiant des hommes ; si peu d’entre eux peuvent me blesser ! Mais il y a un sentiment public de justice et de convenance auquel il faut donner une certaine mesure de satisfaction.
Onze heures
Adieu. Adieu. Je n'ai que cela à vous dire, et j’aimerais mieux vous le dire de près. Adieu. G. J’ai mes deux lettres aujourd’hui. Certainement je ferai comme vous ; j'irai les demander et me plaindre si cette irrégularité se renouvelle. Vous avez raison sur Milner. C’est un bon homme et intelligent. Cela m'amuse toujours de voir comme nous nous rencontrons, toujours dans le même avis. Je vous disais cela de Milnes, il y a quelques jours. Adieu, adieu, dearest. Je suis charmé de mes deux lettres. Il pleut. Je ne me promènerai pas autant qu’hier. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 24 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc les affaires de Hongrie terminées. J'en suis fort aise. Terminer pour la part Russe, non pour la part Autrichienne qui commence, et qui sera la plus difficile. L'affaire finit très bien pour l'Empereur. C'est lui qui a vaincu. C’est à lui que l’insurrection se soumet. Après avoir usé de sa force contre l’insurrection, usera-t-il de son influence pour la transaction, pour qu’elle soit sensée, et équitable, seule façon qu’elle soit durable ? Je ne sais pas du tout ce que la transaction doit être ; je ne connais pas assez bien les faits. Mais je suis sûr qu’il en faut une. Si la transaction était, comme la victoire, l'œuvre de l'Empereur, si la Hongrie lui devait l’une comme l’Autriche lui doit l'autre, ce serait grand et utile très impérial et très Russe. Cette fin du drame mérite qu'on reste assis pour y regarder. La satisfaction anglaise de n'être pour rien dans l'affaire de Rome ni dans l'affaire de Hongrie est un peu risible. L’inaction est quelquefois la bonne et la seule bonne politique. Mais quand d'autres ont fait là où soi-même on n'a rien fait, on peut être content, mais c’est un contentement dont en ferait. mieux de ne pas parler car il y a toujours, au fond, un peu de dépit que les paroles découvrent. En tout, il me semble qu'avec tout le monde, vous comprise, Lord & Lady Palmerston se remuent et parlent beaucoup. Cela n'est pas très digne, et cela n'indique pas des gens très satisfaits, ni très assurés dans leur situation.
3 heures et demie
Encore du monde. M. Janvier m’arrive pour 24 heures. Amusant ; rien de plus. Confirmant tout ce que nous pensons. Pas d'Empire. On n'en veut plus parce que cela aurait un air définitif sans l'être. On aime mieux le provisoire avoué. Peu m'importe que M. de Metternich voie dans ma lettre sur Rome qu'il s'est trompé une fois. Je ne serai même pas fâché qu’il voie que je le pense. Si c’est là la raison qui vous empêche de lui montrer ma lettre je suis d’avis que vous la lui montriez. Je serai charmé que Madame de Caraman fasse votre portrait, à condition qu’il sera pour moi. Elle y réussira peut-être mieux que Madame D. [?]. Essayez, je vous prie. Décidément il paraît que les voyages ne réussissent pas au président. Ses amis lui conseillent de n'en plus faire. Une bonne réception, dans une ville ne compense pas une mauvaise réception dans une autre. Il ne lui vaut rien qu'on le voie ainsi maltraité alternativement. Et quoi qu’il ne fasse pas de fautes, il ne fait pas non plus de conquêtes.
Samedi 25 onze heures
Pas de lettre ce matin. Evidemment on les trouve très intéressantes quelque part. Je ne suppose pas au rebond d'autre cause. C'est bien ennuyeux. Ma journée est gâtée quand ma lettre me manque. Adieu. Adieu. Adieu. Vous êtes bien heureuse. Vous n’avez pas encore eu cet ennui. Adieu, dearest. G.
Lowestoft, Samedi 26 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Je suis de l'avis de Montebello. Je crois que le gouvernement Cavaignac choisira pour le rouge s'il est absolument forcé de choisir. Et le jour viendra où il y sera forcé. Mais de part et d’autre on s'efforcera de reculer ce jour. Personne n'a assez d'envie de gagner la bataille pour l’engager volontairement. Je ne m'accoutume pas à la pusillanimité des honnêtes gens. Ce n’est pas faute d'expérience. Certainement je n'ai pas cru aux révolutions de Pétersbourg. Et je crois que si l'Empereur aime mieux la république que la Monarchie constitutionnelle, c’est qu’il la croit moins contagieuse. Il penserait autrement s’il était le voisin des Etats-Unis. Et s’il avait raison dans la préférence que vous dites, et que vous êtes tentée de partager Cavaignac et Marrast auraient raison. Car renoncez à Louis XIV. On refait encore bien moins Louis XIV que Napoléon. Si nous n'avions d'autre alternative que Louis XIV ou la confusion permanente, je me ferais moine. Il me faut de l'avenir, dans ce monde et dans l'autre.
Dimanche 27
8 heures
J’ai eu hier au soir quelques mots de Paris qui me prouvent qu’on y est de nouveau et sérieusement inquiet. Inquiet d’une nouvelle bataille dans les rues. La république rouge ne veut pas accepter sans mot dire la politique qui accepte la déroute Italienne, ni l'ordre du jour motivé, quel qu’il soit, qui terminera le débat de l’enquête. Elle veut protester et sa protestation, c'est l’insurrection. Cavaignac la battra, nul doute et la victoire l'affermira pour aujourd’hui, mais l’usera pour demain. Le voilà engagé dans le défilé où la Monarchie de Juillet a péri, entre deux feux et deux feux bien plus étendus, bien plus ardents qu’ils n'étaient contre elle. Et il n’a pas comme elle, de qui se défendre longtemps. La Monarchie de Juillet s’est défendu avec deux armes ; par la prospérité du pays, par l'opinion, généralement accréditée, qu’elle était réellement la fin des révolutions. La république n’a ni l’une ni l'autre. Je persiste dans mon avis. Ce sera plus long que ne croient les badauds et moins long que les gens d’esprit, comme vous et moi, ne sont quelques fois tentés de craindre. Je vous envoie les impressions qui m’arrivent de Paris et mes raisonnements sur les impressions en attendant samedi.
Tempête hier, mauvais temps aujourd’hui. Je vais faire ma toilette pour aller au sermon. Je suis correct ici. Je vais au sermon tous les dimanches. Une heure Je suis désolé que vous ayez eu deux mauvaises heures. Ce n'est pas ma faute. Il est impossible d'être, en fait d’exactitude, plus minutieusement soigneux que je ne suis. Comment ne le serais-je pas ? J'ai tant besoin de votre exactitude à vous ? Elle est parfaite aussi. Je trouve que nous ne nous remercions pas assez de nos vertus mutuelles. Nous souffririons tant de nos défauts ! Enfin samedi prochain, nous n'aurons, ni à nous remercier, ni à nous plaindre.
C'est le lundi qui est mon blank day à moi. On distribue ici les lettres le dimanche. La lettre de Sabine est drôle et aimable. Je commence à être assez frappé de ces rumeurs sur Henri V. Non pas que je croie à aucun résultat prochain. Si l'explosion est prochaine. Henri V y périra, comme Louis Bonaparte a péri. Le produire aujourd’hui, c’est le détruire. Mais si on continue à parler de lui sans le lancer dans l’arène, s’il apparait de plus en plus, mais dans le lointain, il prendra du corps et grandira. Et la fusion, aujourd’hui chimérique pourrait bien devenir possible. Elle sera possible le jour où tout ce qu’il y a de monarchique en France verra là, la seule chance de salut. Ce jour-là, tout le monde se réunira pour imposer la fusion à qui de droit et de bonne ou de mauvaise humeur, on l'acceptera sans grande résistance. On y verra aussi son salut.
Avez-vous écrit dernièrement au voyageur pour la fusion ? Je pense très bien de Montebello et je suis bien aise que vous en pensiez très bien, le connaissant comme vous le connaissez à présent. Faites-lui je vous prie, mes amitiés savez-vous pourquoi Morny est revenu à Londres ? Savez-vous aussi, ou pourriez-vous savoir, si Lord Palmerston connait un M. Rothery, dont vous m’avez peut-être entendu parler, et avec qui M. Dumon est très lié ? C’est un proctor que le foreign office a quelques fois employé, du temps de Lord Aberdeen. Il vient de m’écrire qu’il partait subitement pour Madrid, m’offrant de se charger de mes commissions pour Paris. Il me dit : you will doubtless be surprised et my suddon determination to start for so turbulous a country as Spain, et ne me dit pas du tout pourquoi. Je serais curieux de savoir si c’est Lord Palmerston qui l'envoie. Il fait faire assez souvent sa diplomatie incorrecte par des voyageurs, et celui-ci est intelligent. Vous avez vu que M. d’Haussonville m’avait demandé un programme de ce qu’il devait dire, voulant écrire sur notre politique extérieure. Voici ce que je lui ai répondu. Gardez-moi cette copie que j'ai gardée pour moi. Je crois qu'il est maintenant possible et utile de dire en France ces choses-là. Ne faites usage de ceci que pour vous, à cause de M. d’Haussonville. Adieu. Adieu.
Je suis bien aise que vous n’ayez pas eu besoin de m'envoyer votre homme pour savoir si j'étais vivant. Mais s’il était venu, je l’aurais embrassé. Adieu. G.
Lowestoft, Mardi 15 août 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Une heure
Longue lettre. Par conséquent bonne. Bonne pour elle-même, et comme symptôme. Vous n'écrivez pas longuement quand vous êtes souffrante. Soyez tranquille ; le mauvais temps, s’il s’établissait ne prolongerait pas mon séjour ici. Plutôt le contraire. Une vraie tempête cette nuit. Un bâtiment s’est perdu sur la côte. On a sauvé l'équipage. Le soleil se lève et le vent tombe ce matin. L’air de la mer me réussit. J’ai un appétit rare pour moi. A chaque instant, ceci me rappelle Trouville, l’été dernier. C’était bien joli. J'ai bien eu envie de vous garder un peu rancune de votre mauvaise humeur en arrivant au Val Richer. Mais je n'en ai rien fait. Quand retrouverai-je Trouville au lieu de Lowestoft ?
Si votre Empereur est en si bonne disposition pour la République et la reconnaît, rien ne vous empêchera de la reconnaître aussi quand elle aura renoncé à me faire un procès. Quel dommage d'avoir la langue liée ! Jamais il n’y a eu un meilleur moment pour parler au nom de la bonne politique. La mauvaise tourne si piteusement. Je commence à ne plus comprendre pourquoi ni comment on donnerait la Lombardie à Charles-Albert. Après ce qui s’est passé à Milan, ce ne serait pas même un mariage de raison. Le divorce viendrait bientôt. Deux Toscanes, comme dit le Roi, ou la Toscane doublée, comme vous dites aujourd’hui. Quoiqu'on fasse, il y aura au bout de tout ceci, un mort, l’unité italienne et un bien malade, le Roi Charles-Albert. Et un autre qui aura bien de la peine à ressusciter quoique vainqueur, l’Autriche. Pour que l’ordre se rétablisse réellement en Italie, il faut qu’il se rétablisse en France, en Allemagne, partout. A chaque nouvelle crise la question devient de plus en plus générale et unique, et toute l’Europe solidaire. Je suis de votre avis sur l’unité allemande. C’est la plus chimérique, et la plus folle de toutes. Elle ne s’établira pas. Mais la fermentation allemande durera longtemps, plus longtemps que les autres. (On veut faire à Francfort une nation et on ne veut détrôner pas un de tant de souverains.) On prétend à l'unité, et on ne veut sacrifier aucune indépendance. Il y a dans ce double dessein une inépuisable anarchie. Mais l’Allemagne ne se lassera pas tout de suite de cette anarchie. Elle y est moins pesante. et moins ruineuse qu'ailleurs précisément à cause de tous ces petits états qui après tout, au milieu de ce chaos, se gouvernent à peu près comme auparavant.
Je lirai ce soir le Prince de Linange. Je suis un peu curieux de ce qu'en dira le spectateur de Londres. Il a d’illustres souscripteurs qu’il voudra peut-être ménager. Ce dont je suis bien plus curieux, c’est de la bataille dans l’Assemblée nationale à propos du rapport de la Commission d’enquête. Si ce débat a lieu, et je ne comprends guère aujourd’hui comment il n'aurait pas lieu, ce sera à coup sûr un événement, le début d’une situation nouvelle. A moins que la mollesse des hommes n’annule les résultats naturels de la situation. Nous voyons cela, souvent.
J’aime mieux que vous restiez à Richmond. Et je crois qu’à l’épreuve vous l’aimerez mieux aussi. Vous vous feriez difficilement à Tunbridge des commencements d'habitudes. Je ne comprends pas ce que Barante peut écrire, ni qu’il écrive. Je n’ai pas de ses nouvelles depuis longtemps. A la vérité je lui dois une réponse. Je doute qu’il écrive rien qui fasse beaucoup d'effet. Son esprit ne va guère à l'état actuel des esprits. Je vais demander ce qu’a écrit Albert de Broglie sur la diplomatie de la République. Adieu. Adieu.
Je vais me promener au bord de la mer. Seul. J’ai toujours aimé la promenade solitaire, faute de mieux. Je n’ai rien de France. Adieu. Adieu. G. J’oubliais de vous dire que je trouve très bonne la dépêche de M. de Nesselrode sur les Affaires de Valachie. Conduite et langage.
7. Val-Richer, Samedi 18 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Où êtes-vous à St Germain ? Je suppose au Pavillon de Henri 4. Vous ne me l’avez pas dit. J'espère que vous y avez plus beau temps qu’il ne fait ici ce matin. Ma vallée est sous un voile de pluie. C'est ennuyeux pour aller à Trouville. J’y vais pourtant. Je pars à onze heures. Le soleil percera peut-être d’ici-là. Le temps est très variable depuis deux jours. Je vous dirai demain matin ce que j'aurai trouvé pour vous à Trouville. On dit que la maison où ma fille, et Mlle Wislez vont s’établir est la meilleure de l’endroit, la plus confortable, par la vue, et au dedans. Elles ont le projet de s’établir au second étage et de laisser le premier disponible. Je vous dirai quand j'aurai vu. L’aide de Guillet y sera. Facilité de plus.
Le Roi fait venir du château d’Eu son portrait en pied par Winterhalter, et le donnera à Lord Cowley. A propos de portrait, il a fait faire, en porcelaine, à Sèvres, d’après Winterhalter, deux très beaux portraits de la Reine Victoria et du Prince Albert, pour Windsor. Mais à la dernière cuisson, une crevasse s’est déclarée dans celui du Prince Albert, ce qui sera difficile à réparer. Peut-être faudra-t-il recommencer ? En attendant. celui de la Reine est parti. On dit que c’est un chef d’œuvre.
Le Roi a été frappé de la dépêche de M. de Nesselrode sur les croix. Voici sa phrase : " Cela est gracieux. Il y a quelque progrès ; mais je doute fort que cela aille plus loin. " L’idée de l’initiative franche avec Londres pour l’un des fils de D. François de Paule est fort approuvée. Je vais la mettre à exécution, lundi probablement. J'en écrirai en même temps à Madrid et à Naples. La Reine Christine m’a mis bien à l'aise à Naples en faisant attaquer elle-même dans ses journaux, par son secrétaire Rubio, la candidature de son frère Trapani, et en en rejetant sur nous la responsabilité. C'est bien elle qui l'abandonne et la tue. Je réserverai pour cette combinaison-là, comme pour celle de Montemolin, les chances de retour, toujours possibles avec un tel monde. Je maintiendrai notre principe tous les descendants de Philippe V si seulement, nous nous portons selon les termes, vers celui qui peut réussir, favorable à celui-là sans en abandonner aucun. Rien encore de Londres qui indique avec un peu de précision ni sur cette question-là, ni sur aucune autre, le tour que va prendre Palmerston. La réserve des Whigs est extrême. En tout, la situation donnée, je ne trouve pas leur début malhabile. Ni de mauvais air. C’est assez tranquille, et sensé. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article du Morning Chronicle qui n'aura pas fait plaisir à Thiers ? On lui donne poliment son congé, comme War-party. N’avez-vous rien reçu de Lady Palmerston ? Avez-vous écrit à Byng ? Mad. Danicau sait-elle vous lire le Galignani ? Le Prince de Joinville et sa flotte, et sa rencontre là, avec le Duc d’Aumale, ont fait grand effet à Tunis. Nos affaires sont bonnes à l'est et à l’ouest de l'Algérie. Après son apparition devant Tripoli, il (Joinville) ira à Malte, de là à Syracuse, de là une visite au Roi de Naples, puis une au grand Duc à Florence, puis une au Pape à Rome. Tout sauvages qu’ils sont, ces Princes là se montrent volontiers quand il y a quelque effet à faire. Ils se regardent bien comme les serviteurs du pays et obligés de soigner ses intérets et sa grandeur. Le comte de Syracuse passera, dit-il, l’hiver prochain à Paris. Il va parcourir la France, en attendant. Voilà mon sac vidé. Mon cœur reste plein. Loin de vous, il se remplit de plus en plus. Nous nous croyons bien nécessaires l’un à l'autre. Nous le sommes plus que nous ne croyons.
9 heures Je vais déjeuner et partir pour Trouville. Bon petit billet de St. Germain. Je suis content de vos yeux et de Mad. Danicau. Bonnes nouvelles de Londres même sur l’Espagne. Ce demain les détails. Je suis pressé. Soyez tranquille. Rien à craindre que la pluie. Adieu. Adieu. Adieu. G.
302. Val-Richer,Mardi 29 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je me lève tard. Décidément le froid s’établit. Je fais des feux énormes, qui ne me réchauffent pas autant que le plus petit feu au coin de votre cheminée. Votre appartement sera très chaud. Sous le règne de M. de Talleyrand c'était une étuve. Mais vous êtes une Reine du Nord. Vous ouvrez les fenêtres.
Est-ce le frère de Bulwer qui vient à Paris à titre de commissaire pour les négociations commerciales ? Il me semble que toute la famille le pousse. Je n’ai pas lu un seul des romans qu’ils ont faits car ils en ont fait tous deux, si je ne me trompe. Les connaissez-vous ? L'Empereur devrait bien ne pas perdre son argent aux sottises du Capitole. Si peu qu’il en donne, elles ne le valent pas. Il y a une région où les souverains font très bien de semer l'argent ; il y fructifie. Mais trop bas, il ne sert absolument à rien. Que de pauvretés je vous dis là ! J’ai pourtant beaucoup mieux à vous dire.
10 heures
Comment ? Votre aigreur pour votre appartement avait été jusqu'à Lady Granville. Je suis ravi qu’elle soit ravie. Je veux que vous soyez très bien. Je me plais à penser que vous resterez là toujours, que je vous y soignerai toujours, que vous y mènerez une vie douce, agréable. J’arrange l’agrément de cette vie. Je cherche ce qui pourra s’y ajouter. Vous n’avez pas d’idée de l'activité de mon imagination sur les gens que j'aime. J’ai tort de dire sur les gens. Il n'y a pas de pluriel en ceci.
Les mêmes nouvelles que vous avez sur l'Impératrice, me viennent par notre gouvernement. On s'attend à une fin, très prochaine. J’ai une immense pitié pour un tel malheur, n'importe sur quelle tête.
Ma mère est décidément beaucoup mieux. C’est une affaire que de lui faire quitter la campagne où elle se plaît beaucoup, et où elle se persuade qu'elle est mieux pour sa santé parce qu'elle marche et se promène. Cependant il est déjà convenu que nous serons à Paris pour le milieu de Novembre. A présent, je prépare la fixation et l'avancement du jour. Ce que je dis là n’est guère français. Mais peu importe. Vous parlez des tracas de votre intérieur. Ce n’est rien du tout que les tracas de meubles. J’aimerai mieux avoir à arranger trente salons que trois personnes. Henriette m’aide déjà en cela. Elle est pleine de tact sur ce qui peut plaire ou déplaire, embarrasser ou faciliter. Elle a l’instinct de la conciliation.
Adieu. Adieu. Je suis au coin du feu, j’ai les doigt gelés. Mais seulement les doigts. G.
288. Val-Richer, Lundi 14 octobre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici une lettre pour M. Gréterin, directeur des douanes. Je la laisse ouverte pour que Génie la lise et sache bien ce que je demande. Priez-le de la porter de ma part à M. Gréterin après l'avoir cachetée, et de demander la réponse. Je crois qu’il faut une décision du Ministre des finances. Mais M. Gréterin la lui demandera. Je ne veux pas qu'on vous brise le vase en vermeil, et encore moins le buste, en marbre. Est-ce que vous ne pouvez-pas garder Pippin jusqu'à ce que vous ayez trouvé un maître d'hôtel qui vous convienne ? Je sais bien que vous en aurez encore plus de peine à lui faire dire une seconde fois qu’il faut qu'il s'en aille. Cependant j'aimerais mieux cet ennui-là que celui de prendre à la hâte le premier venu. Vous avez quelques fois des hésitations, et quelquefois des précipitations singulières. Entendez-vous dire qu’il y ait quelque chose de sérieux, dans la maladie de Méhémet dont parlent les journaux ? Ce serait encore un dénoue. ment inattendu. Je le regretterais. Le monde n'a pas de gens d’esprit à perdre.
Mardi, 7 heures et demie
Dites moi pourquoi je viens de passer une nuit très agitée, de revoir en rêve toute ma vie, ce qu'elle a eu de plus doux et de plus cruel, vingt cinq ans en quelques heures ! La même Puissance dispose donc de nous, sans nous, la nuit comme le jour, et des chimères comme des réalités. Elle devrait bien laisser la nuit au repos. Je suis brisé ce matin. Quelque confiance qu’on ait dans sa propre vie, si on avait dit au général Sébastiani que son maître d’hôtel, que je connais bien et qui le servait depuis très longtemps serait frappé d’apoplexie avant lui dans Hertford-House, on l'aurait, je crois, bien étonné. Je vous voudrais un maître d’hôtel comme celui-là de fort bonne mine, quoique trop petit, très entendu et très attaché.
Est-il vrai que l'Empereur (il ne me plaît pas de dire votre Empereur) entreprend de miner en Pologne la religion catholique, qu’il a déjà enlevé la moitié des Eglises polonaises au culte catholique pour les donner au culte grec &&. La liberté religieuse était la seule en Russie. C’était même un singulier spectacle que de voir deux états nouveaux, aux deux extrémités du monde, le plus despotique et le plus républicain que le monde ait encore vus, la Russie et les Etats-Unis commencent l'un et l'autre leur carrière, par cette tolérance, qu'au bout de six mille ans le monde civilisé a commencé à peine à entrevoir.
9 h. 1/2
J’aime bien le N°285. Il me rend compte des moindres détails de votre vie, personnes et choses. à cette condition seulement, la séparation est supportable ce qu’elle n'est jamais. Je suis charmé que vous ayez un maître d’hôtel. Mais il faut que le hasard couvre le mal de a précipitation. Cela arrive. Adieu.,Adieu. Non pas mille fois, mais mille vies. G.
J'adresse ma lettre rue Florentin, vous m'auriez averti si quelque chose était changé dans vos projets.
282. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n’est bruit que de la nouvelle coalition, votre Empereur, Palmerston et les radicaux. Aurait-elle la majorité à Londres ? On en doute fort. Palmerston trouvant bon que vous entriez, vous dans le Bosphore et l'Asie mineure, tandis qu'il ira lui sans nous à Alexandrie, cela sera-t-il bien reçu du Parlement ? On croit que cela ne s’y présentera pas. Même avec le correctif d'un corps d’armée Autrichien pour faire le siège de St Jean d’Acre, où il n’ira pas. Tout cela a un peu l’air des mille et une nuits. Il n’y a guère, dans chaque affaire, qu’une ou deux grandes politiques. Quand on n'en veut pas, on tombe dans les politiques petites et arbitraires. De celles-là, il y en a mille.
En attendant, vous parait-il vrai, comme on me le dit, que le Cabinet anglais est plus sérieusement menacé que jamais ? On l'a dit si souvent que cela finira pas arriver sans que je le croie. Voilà Zéa décidément rentré en scène. Si les Cortes dont dissoutes comme tout l’annonce, un parti bien voisin de lui dominera dans les nouvelles. J’en suis bien aise, même politique à part. Je lui souhaite du contentement. Je ne sais pourquoi le bruit se répand dans notre Province que Don Carlos doit y venir habiter et qu’on y cherche un château pour lui. Ce qu’il y a de sûr c’est qu’on a fait visiter deux grands châteaux à peu près abandonnés, et très convenables pour un Prince abandonné.
N’allez pas vous ruiner en curiosités. Quand vous aurez vos affaires signées, vous ferez tout ce qui vous plaira. Je n’ai de ma vie été si méfiant.
Mardi, 8 heures 1/2
Avez-vous décidément adopté la bibliothèque de l'entresol pour votre chambre à coucher ? Je suis bien impatient de vous voir là. Où seront nos habitudes? Vous trouverez votre maison peuplée. Jaubert est arrivé ; fort peu préoccupé de la politique de l'Orient, à ce qu'on me dit ; il n'y a pas moyen d’en rien tirer à ce sujet. Ce n'est pas du tout un esprit de politique étrangère. Il a rapporté de Constantinople une grande préoccupation des conspirations de l’extrême gauche. Elles continuent de plus en plus basses, comme on dit les eaux sont basses. Singulière société qui ne veut ni du haut, ni du bas, ni du soleil, ni de la boue ! Comment viendra-t-elle à bout de s'organiser et de suffire à ses affaires ? Je ne pense pas à autre chose, en fait de choses, depuis deux mois que je vis en Amérique.
9 heures et demie
J’attends mon médecin aujourd'hui. Je voudrais bien qu’il fût de votre avis qu’il en fût positivement. Quoique ce qu’on appelle la raison me dise que j’ai tort de désirer cela. Je suis désolé du mariage de votre femme de chambre. Mad. de Mentzingen ne pourrait-elle vous envoyer sa pareille ? Vous avez confiance aux allemandes. Il vous faut une femme de chambre qui vous convienne beaucoup, et vous plaise un peu. La petite lectrice que Génie vous a donnée vous convient-elle, dans son état, et vous en servez-vous ? Adieu. Adieu.
241. Val -Richer, Samedi 10 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous avez raison sur le sens de la lettre du Consul, votre lettre à votre frère est à merveille ; et si elle arrive à Pétersbourg avant la signature de l’arrangement tout est sauvé. Mais je crains encore que vous n'ayez pas raison ; et si vous avez raison, je crains que l’acte n'ait été signé bien vite, car Paul aura certainement pressé, pressé. Et alors ? A coup sûr il faudrait un procès, un procès éclatant pour vous, honteux pour eux, douteux comme tous les procès, surtout comme ceux qu’on ne conduit que de loin. Vous n'entrerez pas dans ce frêle et orageux bateau. Pourtant, si toute cette hypothèse se réalise, je ne crois pas qu’il faille renoncer d'avance et tout haut au procès. La crainte de le voir entamer pourrait être un puissant moyen d'accommodement. Je ne puis croire que la certitude même de le gagner rendit Paul indifférent au scandale. Il aurait pour lui, le droit légal, un arrangement conclu, votre signature. On n’est jamais sensé ignorer son droit. Paul serait autorisé à vous dire : Pourquoi n'avez-vous pas demandé à Londres des letters ef administration ? Tout cela est vrai devant les juges. Mais devant le monde, cette vérité là ne suffit pas, et Paul est du monde. Il voudrait donc probablement éviter le procès, et vous pourriez transiger. Voilà, ce me semble le plus probable et le plus raisonnable dans l’hypothèse qu’en effet la propriété de ce capital vous revient. Et si cette hypothèse est fondée, quelle odieuse réticence. qu’elle déplorable complication ! J’en suis depuis deux jours constamment préoccupé. Je ne veux pas écrire tout ce que je vous dirais à ce sujet. Et qui sait si je vous le dirais ? En tout cas soyez sûre que votre lettre à votre frère est très bien. Le rappel que vous y faites des intentions de votre mari à votre égard est frappant. C'est même la circonstance qui me porte le plus à vous donner raison, contre ma raison, dans votre interprétation de la note du Consul ; car c’est celle qui explique le mieux le défaut de testament. Je pense que vous avez écrit sur le champ à Londres pour demander des renseignements plus clairs et plus complets. A la vérité, il ne me parait pas que le sens que moi, j’attribue à la note du consul, vous soit seulement venu à l'esprit.
Dimanche, 8 heures
Vous aviez raison, et M. de Metternich, se flattait ou se vantait. L'Empereur se refuse aux conférences de Vienne. Mais en revanche, l'article qu’il a fait mettre dans la gazette d’Augsbourg est bien fanfaron ; les fanfaronnades, ces gasconnades ces espérances affichées quand on ne les a pas, tout cela, est-il bien nécessaire au Gouvernement du monde ? Ne sont-ce pas plutôt des satisfactions un peu puériles que se donnent les gouvernants eux-mêmes en s'abandonnant à toutes leurs boutades de vanité ou de fantaisie ? C’est bien peu digne et il ne vient point de pouvoir de là. Avez-vous jamais lu les historiens romains Salluste, Tacite, César ? Ce qui m'en plaît surtout, c’est la simplicité, l'absence de charlatanerie et de vanterie. C’est le grand côté du caractère romain. Les Anglais en ont quelque chose. Mais le gouvernement représentatif est très charlatan, très fanfaron à sa manière.
9 h 1/2
Le n° 235 vaut très fort la peine d'être envoyé Vous savez que j'aime tout ce qui vous passe par l'esprit. Vous avez raison sur les dents. Mais ne croyez pas que je fasse de la douleur physique une grande affaire pour mes enfants. Henriette y est assez forte. Sa sœur moins parce qu'elle a les nerfs très irritables. Je crois les douleurs très inégales selon les personnes. Adieu. Adieu. Comme le vôtre souligné ! G.
281. Val-Richer, Lundi 30 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me sens beaucoup mieux ce matin. C’est une singulière chose que la rapidité avec laquelle ce mal de gorge m’envahit s’établit, semble près de devenir une maladie et s'en va. Je suis persuadé qu’en y prenant un peu garde, dans trois ou quatre jours, il n’en sera plus question. Mais c’est bien décidément mon mal.
Je sais peut-être moins de détails que vous sur l'Orient. Quand les affaires ne vont pas à leur satisfaction, ils m'en instruisent plus laconiquement surtout quand l’événement confirme mes avis. J’ai reçu cependant ces jours-ci deux lettres qui sont d'accord avec ce que vous me dites. Mais vous aussi vous êtes trop loin. Deux heures de conversation toutes les semaines nous seraient bien nécessaires. A vous dire vrai, je ne me préoccupe pas beaucoup de cette affaire là quant à présent. Deux choses seules m'importent ; la paix pour le moment, le fond de la question pour l'avenir ; la paix ne sera pas troublée, ni la question au fond résolue. Je tiens l’un et l’autre pour certain. Il ne sortira de tout ceci qu’un ajournement pacifique. Que l’ajournement soit plus ou moins digne, plus ou moins habile, qu’il en résulte plus ou moins de gloire pour les manipulateurs, il m'importe assez peu. Je ne m'étonne pas que Mad. de Castellane vous choque. Elle n'a point de mesure dans la flatterie. Là est la limite de son esprit et le côté subalterne de sa nature. Du reste, rien n'est plus rare aujourd'hui parmi nous que le tact des limites. En toutes choses, nous sommes toujours en deçà ou au delà. C’est le défaut des sociétés renouvelées par les révolutions ; il reste longtemps dans leurs mœurs quelque chose d’informe et de gros, je ne veux pas dire grossier. Il n'y a de fini et d'achevé que ce qui a duré ; ou ce que Dieu lui-même a pris la peine de faire parfait. Mais il ne prend jamais cette peine là pour les peuples.
Voilà votre N°277 et en même temps des détails sur l’orient qui m’arrivent très circonstanciés trop pour la distance où nous sommes.
Vous menez bien votre barque. Vous travaillez à vendre le plus cher possible l'abandon, c’est-à-dire le non renouvellement du traite d'Unkiar-Skelessy. Vous avez tout un plan, dans lequel tout le monde, a son poste assigné contre Méhémet Je ne crois pas à l’exécution. C’est trop artistement arrangé. Je ne suis point invité à Fontainebleau. Je ne sais pas si je le serai. Je suis bien loin. On le sait officiellement. Pour peu qu’on trouve d'embarras à m'inviter moi, et non pas, tel autre, on a prétexte pour s’en dispenser. Adieu. Adieu. Moi aussi, j’attends l'hiver. Je vous en réponds. A propos, je ne sais de quoi, je ferai comme vous avez fait quand j’ai oublié votre commission auprès de Berryer. J’attendrai que je voie Bulwer pour lui demander moi-même des renseignements sur Lord Chatam.
Adieu, quand-même. G.
280. Val-Richer, Samedi 28 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne veux pas faire comme ces deux derniers jours, ne vous écrire que le matin quand je ne le puis plus. Je m'ennuie d'être si peu avec vous. Votre conversation me serait si agréable ! Je suis fatigué, mal à l'aise. Il faut que je me mette à la diète, car quand j’ai mangé, j’ai toujours plus de toux et d'oppression.
Pour une fois, Démion a raison. Quand on entre le 15, on paye à partir du 1er. Ayez en effet le moins d'affaires que vous pourrez. Vous n’y êtes. pas propre. J'attends toujours avec impatience que tout soit revenu de Pétersbourg, vraiment fini, signé. J’ai de tout votre monde, une défiance sans mesure. Les meilleurs sont si indifférents et si légers. C’est sitôt fait d'oublier. Ne trouvez-vous pas qu’il y a dans tous nos journaux un concert de modération pour l'Espagne. Ils semblent tous tremblants que les Cortes ne fassent quelque sottise. La Reine d’Espagne est bien puissante, en ce moment. Quelles vicissitudes !
Bolingbroke, qui venait de chasser du conseil de la Reine son rival le comte d'Oxford et d'être chassé lui même par les Whigs ses ennemis, écrivait à Swift : " Oxford a été renvoyé mardi ; la Reine est morte Dimanche. Quel monde est celui-ci, et comme la fortune se moque de nous ! " On l’oublie toujours.
8 heures
Je voudrais en avoir fini de la journée de demain. Quand je suis en bonne disposition, je m’arrange avec l'ennui ; je m’y prête et cela va. Mais il faut avoir sa voix, ses jambes ; il faut parler et marcher tant qu'on veut.
Est-ce sincèrement ou par diplomatie que Lady Cooper trouve toujours que tout va bien ? Il faut une foi aussi robuste que la vôtre de la mienne dans la bonne constitution de l'Angleterre pour n'être pas inquiet de ce mouvement continue et accéléré sur la pente radicale. Au fond, je ne le suis pas. Je crois toujours qu’on se ravisera & se ralliera à temps. Ce sera un bien grand honneur pour les gouvernements libres, car l’épreuve est forte. Si elle finit bien, il n’y aura pas eu dans le monde, depuis qu’il y a un monde, une plus belle histoire que celle de l’Angleterre depuis cinquante ans. Mais il ne suffit pas qu'elle se tire de là sans révolution. Il faut qu’elle garde un grand gouvernement. C'est là le point le plus difficile du problème.
Dimanche, 9 heures
Je me lève ayant très bien dormi, selon ma coutume, mais toussant toujours et avec de l'oppression. Je vais voir mon médecin qui me dira que c’est un rhume, qu’il faut me tenir chaudement et attendre. Et j'attendrai. Voilà le 276.
Il y a un mois que j’ai écrit à M. Duchâtel d’y bien regarder, que nous finirions par nous trouver seule, et vous avec tous les autres notamment avec l'Angleterre. Encore une des moqueries de la fortune.
Moi aussi, je voudrais bien causer avec vous. Il y aurait bien un troisième parti à prendre. Mais on ne le prendra pas. Vous avez agi habilement. Vous vous êtes faits les plus fermes champions de l’intégrité de l'Empire Ottoman, non plus à vous seuls, mais en commun avec tous ceux qui la voudraient comme vous. N'allant pas à Constantinople, personne n’ira, et vous restez toujours avec le droit d’y aller quand la Porte vous le demandera ! Cette affaire-ci se règle en dehors de vos habitudes. Vous avez plié devant la nécessité, mais sans changer de position. Vous pouvez vous redresser quand le jour viendra.
Adieu. Adieu. J’attends vingt personnes, et j'ai ma toilette à faire. Adieu G.
260. Val-Richer, Samedi 31 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes nouveaux hôtes me sont arrivés hier. Je les quitterai Lundi matin pour aller dîner à Evreux. De là, je puis faire, dans la journée de mardi ce que vous préférerez, aller vous retrouver à Paris au à Rouen. Mais il faudrait que vous fussiez mardi à Rouen. Voyez ce qui vous convient décidément et dites-le moi en réponse à cette lettre. Je prendrai la vôtre Lundi matin en passant à Lisieux. Si vous préférez Rouen, dites-moi où vous descendrez, car nous pourrions passer plus d’une heure à nous chercher dans cette grande et obscure ville. Il y a sur le port un grand hôtel, fort accrédité qui s’appelle je crois hôtel de France ou de l’Europe. Vous pourriez y descendre. Nous irions de là à Dieppe. Si vous restez à Paris, je serai à La Terrasse mardi dans la journée. Je ne sais pas bien à quelle heure. Il fait très beau depuis deux jours. Paris ou Rouen, je prie pour le soleil. Vous en avez besoin et j'y prends plaisir.
J’entends bien que vous ne voudrez pas la paix à tout prix. Mais il faudrait que vous voulussiez la guerre à tout prix pour qu'elle arrivât. Vous en êtes loin. Je persiste donc, grâce à Dieu. Pourtant Dieu en sait plus que nous et s’il lui plaisait de brouiller, les choses à un certain point, toute notre bonne volonté ne les débrouillerait pas. Ce n'est ni la prévoyance, ni le désir des hommes qui réglera cet avenir-là. C’est le sort commun de l'avenir. On peut y être prêt, et c'est le comble de la sagesse humaine. On ne le fait guère.
9 h. 1/2
Vous voyez que je suis à votre disposition pour Rouen ou pour Paris. Tout à fait à votre disposition. Décidez comme vous préféreriez. Il m’est tout aussi aisé tout aussi agréable d’aller mardi d’Evreux à Rouen que d’Evreux à Paris. Pensez de plus que je n'arriverai à Paris que mardi dans la journée et qu’il m'est impossible de n’y pas rester 48 heures. Enfin, as you please. Pour moi, Rouen et Dieppe me plaisent. Adieu. Adieu.
256. Val -Richer, Lundi 26 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voyons un peu nos affaires. Je ne saurais fixer aujourd’hui le jour où je pourrai aller vous voir. J'attends après-demain M. Devaines, son fils et une autre personne. Il faut que je les aie vus pour régler ma marche. Quel ennui que tous ces arrangements quand je n'ai d'autre envie que d'être près de vous, de vos voir, de vous entendre, de vous parler, de vous retrouver vous, changée ou non, et mon bonheur qui ne peut changer. Mais répétez-moi en attendant que le Dr Chemside ne vous trouve pas aussi changée que vous l’imaginez. Si vous allez, ou si vous pouvez aller à Dieppe, il est probable que je l'aimerai mieux que Paris. Sauf vous, je n'irais pas à Paris en ce moment. Il n’y a rien à faire, et on dira que j’y viens faire quelque chose. Mon absence, ma parfaite tranquillité sont d’un bon effet; je le sais, les gens d'esprit me le disent. Cela ne signifie rien si je ne puis vous voir qu'à Paris, et au fait cela ne signifie pas grand chose ; peu importe quelques lignes de journaux et quelques conversations de badauds. Mais toutes choses égales d'ailleurs, je crois que je préférerai Dieppe, ne fût-ce que pour ce que vous m'en dites. Dieppe ou Boulogne, cela se ressemble, n’est-ce pas ? D'ici là reposez-vous bien. Il faut être bien reposée.
Vous trouvez l'Orient en voie de pacification. Nous sommes tous d'accord, d'accord du moins de nous mettre d'accord et d’en traiter ensemble. Nous avons failli faire tout le contraire. Nous avons dit que si vous alliez à Constantinople, nous irions dans la mer de Marmara ; et que de façon ou d'autre, nous serions tous où vous seriez. Vous avez pensé que puisqu’il fallait se résigner à être tous ensemble mieux valait l'être sans embarras qu'avec embarras. Nous sommes contents. Les difficultés commencent mais nous croyons les périls passés.
J’attends des nouvelles de mon pauvre ami Baudraud. Il est malade et ne pourra probablement pas aller à Constantinople. Nous nous sommes beaucoup écrit. Mais que de choses nous aurons à nous dire !
Mardi matin 7 heures
Le plaisir de vous sentir plus près de moi ne s’use pas. Qu’on devient modeste dans ses prétentions ! J’ai appris hier que je n'aurais pas ici, dans le mois de septembre, deux personnes qui auraient pu y venir. M. & Mad. de Rémusat. Ils étaient dans leur terre, près de Toulouse, quand ils ont appris que leur fils aîné, qui a tout juste l’âge d’Henriette, était malade, très malade dans son Collège, d’une fluxion de poitrine mêlée d’accès de fièvre typhoïde. Ils sont accourus à Paris la mort dans l'âme. Ils ont trouvé leur fils hors de danger et à présent il va très bien. Quand je les ai sus à Paris, je les ai engagés à venir passer quelques jours ici avec l'enfant rétabli qui aurait sans doute besoin de la campagne. Ils font mieux que cela ; ils l’emmènent en Languedoc, où ils retournent jusqu'à la session. M. de Rémusat veut se trouver à Toulouse au passage de M. le Duc d'Orléans.
Il y a vraiment quelque tentative d'accommodement en Espagne. La situation de D. Carlos devient toujours plus mauvaise. Celle de la reine Christine pas meilleure. Marote a été assez féroce pour avoir le droit d'être un peu complaisant. Les oscaltados qui reviennent en majorité dans les Cortes témoignent quelque envie d’essayer de la faiblesse après la folie. L’Angleterre s’ennuie d’entretenir, un désordre d’où elle n’a pas même pu tiré un traité de commerce. On essaiera peut-être là aussi d’une conférence.
9 heures
Au nom de Dieu, que vos nerfs se reposent ! Je ne puis vous dire le chagrin qu'ils me font. Que sert de vous le dire ? C'est ma prétention de n'avoir plus besoin de vous dire combien je vous aime. Ai-je tort ? Plaisir oui, grand plaisir. Besoin non, plus du tout. Rouen vaudra certainement mieux que Dieppe. C'est plus près. Mais vous ne pouvez pas prendre de bains de mer à Rouen. J’apprends à l’instant même que M. de Metternich est fort malade, dangereusement me dit-on, vous le savez sans doute. Cela n'aiderait pas aux affaires d'Orient. Adieu Adieu. G.
253. Val -Richer, Vendredi 23 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
On dirait depuis hier que je vais être pris d’un rhumatisme à l’épaule gauche. J’y ai une douleur assez vive, et j’ai quelque peine à élever le bras. J’ai déjà ressenti quelque atteinte de cette douleur-là. Il faut se frictionner, se couvrir l’épaule de laine et attendre.
J’ai eu hier des nouvelles de St Pétersbourg. Voici en quels termes. " Ma besogne d’observation et de discernement est devenue plus curieuse depuis la crise d'Orient. Je ne lui vois aucune autre solution que de faire de l’Empire ottoman un théâtre pour le commerce européen un territoire administré tant bien que mal vous le patronage commun. Quant à l'existence politique, il n’y faut plus penser. Je n’ai pas eu un moment d’inquiétude sur le maintien de la paix. Il eût fallu, pour la mettre en péril, que Constantinople fût menacé comme en 1833. Le pays où je suis est vivement blessé dans son amour propre ; ses intérêts réels, ses projets positifs ne sont pas en péril. " C’est du 10 août.
J’ai parlé à ma mère de ce que vous désirez. Elle cherchera. Elle n'a personne sous la main Elle m'a demandé si vous étiez facile a vivre. J’ai répondu oui, très facile pour qui lui plaira ; sinon, impossible. Mad. de Telleyrand écrit qu'elle s'ennuie à Baden, que tout le monde s'y ennuie, et que plus il y vient de monde, plus il y vient d’ennui. J’ai peur que Mad. de Talleyrand ne soit destinée à s'ennuyer beaucoup dans l'avenir. Elle le supportera plus fortement que vous. Elle se fera de petites affaires et de petits passe-temps qui ne sont pas à votre usage. Mais le mal sera là.
9 heures
Je suis charmé de vous écrire à Paris, en attendant que je vous y voie, nous arrangerons le moment de ma course Ne me laissez pas sans nouvelle pendant tout votre voyage. Un mot, si deux vous fatiguent. Vous savez qu’il y en a un qui est toujours excellent. Adieu. G.
250. Val -Richer, Mardi 20 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quand nous sommes ensemble je veux bien vous parler de vous-même, vous reprocher vos défauts, vous quereller. De loin, non. tout est si sec de loin, si absolu ! Il ne faut se dire de loin que de bonnes et douces paroles. Il n'y a pas moyen de donner aux autres leur vrai sens et qui sait à quel moment elles arrivent ? Toutes les fois que je me suis laissé aller à vous gronder de loin, j’y ai eu regret. Quand vous voudrez que je vous gâte, allez vous en. Je ne serai tranquille à présent que lorsque je vous saurai quelqu'un pour vous ramener. J’aimerais mieux Mlle Henriette que tout autre. Quel âge a-t-elle ? Est-elle d’une bonne santé ? Je demande tout cela pour chercher à me persuader qu'elle ira vous rejoindre.
Je suis quant à l'Orient, dans une disposition désagréable. Je suis convaincu que si la question ne s’arrange pas, c’est-à-dire ne s’ajourne pas, c'est bêtise, inaction, défaut de savoir dire et faire. Mettez quatre hommes d’esprit en Europe, à Pétersbourg, à Vienne, à Paris et à Londres, avec celui qui est à Alexandrie Faites que ces quatre hommes d’esprit voient l'affaire comme elle est réellement et se voient eux-mêmes comme ils sont réellement, il est impossible qu’ils ne prennent pas le parti, gardant chacun sa position, réservant chacun son avenir, d'agir au fond de concert. Nous avons tous un intérêt dominant, le même, et auquel longtemps encore tous les autres doivent être subordonnés. Vous Europe orientale, qui n’avez point fait de révolutions votre intérêt dominant est qu'elles ne commencent pas. Nous, Europe occidentale, qui en avons fait notre intérêt dominant est qu'elle ne recommencent pas. Nous avons tous à nous reposer, et à nous affermir, vous dans votre ancienne situation, nous dans notre nouvelle. Et territorialement, le fait est le même.
Vous avez gagné en 1815 ; nous ne demandons rien. Nous avons accepté et maintenu en 1830, à la sueur de notre front le statu quo que vous aviez acheté, contre nous en 1815, de tant de votre sang. Le moment est-il venu de le remettre en question ? Et si l'affaire d'Orient ne s’ajourne pas, il sera remis en question, et bien autre chose avec. De quoi s’agit-il au fait ? D'imposer à la Porte l’indépendance réelle du Pacha, au Pacha la paix stable avec la Porte et d'attendre. Si on se met d'accord sur ce but, on y arrivera infailliblement à quelles conditions ? Qui en aura l'honneur? Qui restera à Constantinople avec le plus d'influence ? Qui en aura à Alexandrie ? Questions secondaires, très secondaires, quelque grandes qu'elles soient.
Il faut avoir une idée simple et la placer bien haut au dessus de toutes les autres. On ne se dirige que vers un fanal très élevé et on ne marche réellement que quand on se dirige, vers un but. La révolution française à eu une idée simple ; elle a voulu se faire. La Ste alliance a eu une idée simple ; elle n’a pas voulu de révolution. L’une et l'autre a réussi : réussi quinze ans, vingt ans, comme on réussit en ce monde ; réussi pour son compte et dans ses limites, le seul succès qu’on puisse sensément prétendre. La folie de la révolution française était de vouloir se faire partout. La folie de la Ste Alliance était de vouloir empêcher la révolution française de s'accomplir. L’une et l’autre a échoué dans sa folie et réussi dans sa propre et vraie cause. La leçon est claire car elle est complète, aujourd'hui encore, pour je ne sais combien de temps, l’idée simple de l’Europe doit être la paix. Et si la paix est troublée à cause de l'Orient, ce ne sera pas à causé de l'Orient, mais à cause de la bêtise de l’occident et de l'orient chrétien. Il y a une chose dont je ne me corrigerai jamais, c’est de croire que, quand on a raison on peut réussir.
Mon honnête Washington, qui avait plus d’esprit que bien des coquins, ne se faisait aucune illusion sur les sottises de ses concitoyens ; mais je trouve à chaque pas dans ses lettres cette phrase. I cannot but hope and believe that the good sense of the people will ultimately get the better of their prejudices. Aux mots the people j'ajoute les mots and the governments, et je dis comme Washington. Je me donne pourtant deux sottises à surmonter au lieu d’une.
9 h. 1/2
J’attends chaque matin votre lettre avec bien plus que de l’impatience. Quand n'en attendrai-je plus ? Quand serons-nous réunis ? Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Conditions matérielles de la correspondance, Discours du for intérieur, Histoire (Etats-Unis), Histoire (France), Politique, Politique (Europe), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Relation François-Dorothée, Révolution française, Santé (Dorothée)
249. Val -Richer, Dimanche 18 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nos promenades ne se ressemblent pas. Vous avez été voir un vieux château que nous habiterions fort convenablement. Moi, j’ai mené mes hôtes ce matin à travers des chemins, où j’ai beaucoup pensé à vous pour me féliciter de ce que vous n’y étiez pas. Il a plu hier, avant-hier. On travaille à réparer ces chemins. On y a entassé des pierres. La pluie a plongé les pierres dans la boue. Ce n’était pas praticable. C’est dommage. Le pays est charmant. Rien de grand pourtant, ni de la main de Dieu, ni de celle des hommes. Les châteaux y sont aussi petits que les coteaux. Je me suis félicité de ce que vous n’y étiez pas, et j’ai eu tort. Pour vous faire traverser les mauvais endroits, j'aurais été obligé de vous porter souvent, toujours. Cela aurait bien valu le manteau de Raleigh.
Notre Cabinet me paraît fort inquiet de vous. Vous vous êtes tout-à-coup mis en mouvement. Vous avez parlé de guerre. Est-ce sérieux ? Irez-vous réellement à Constantinople pour y soutenir Khosrer-Pacha contre Méhémet Ali qui n'en veut pas du tout au Sultan, et ne fait pas un pas vers Constantinople ? Vous chargerez-vous ainsi de faire durer tous les grands vizirs, et de ramener à la subordination tous les Pachas qui auront envie de se rendre indépendants ? Vous avez très bien fait de faire le traité d'Unkiar-Skélessy, si tout cela y est, et si tout le monde trouve tout simple que tout cela y soit.
Lundi matin, 6 h. 1/2
Il me parait impossible que le Dr Gurckardt (n'est ce pas son nom ? ) ne vous trouve pas un jeune médecin bon pour vous accompagner, assez bon pour que vous acceptiez sa société pendant quatre jours. Je regrette de ne pouvoir vous envoyer le mien, qui a de l’esprit, un caractère doux et une figure agréable. M. Molé me l’a emmené à Plombières.
On me dit qu'à Plombières, il ( M. Molé) parle beaucoup d'adopter une politique téméraire, & que cela convient peu à St Cloud. M. Molé ne sait arriver, comme se maintenir, qu'en flattant ; et comme le maître qu’il faut flatter pour arriver n’est pas toujours le même qu’on flatte ensuite pour se maintenir cette contradiction peut lui devenir très embarrassante. Il a pu se maintenir en flattant le Roi, au nom de la politique de résistance ; mais il n’arrivera jamais que comme il est arrivé le 15 avril, en flattant la gauche, et au nom d'une politique de concession. Si nous sommes emportés dans ce sens là, il sera dépassé ; si nous marchons dans l’autre sens, il ne suivra même pas. Il était sorti du Cabinet avec Casimir Périer et moi le 3 nov. 1830. Quant vint le moment de la grande résistance, au 13 mars, il disparut.
9 heures
Que ne suis-je Melle Henriette ! Je ne ferais pas quinze jours pour aller à Baden. Et je vous soignerais si bien ! Je vous ramènerais si doucement à Paris ! Vous ne rencontreriez pas un caillou une ornière sur la route. Mais les désirs sont vains. Je méprise les désirs, je méprise les paroles. Dearest, les vôtres me vont au cœur ce matin. Elles y vont toujours. Mais ce matin, elles sont si profondes, si tristes ! Je sais un gré infini à Madame de la Redorte de ses soins pour vous. Je serai très aimable pour elle l’hiver prochain. Je serai très aimable l’hiver prochain. Adieu. Adieu. Si je pouvais mettre dans cet Adieu tout ce qu’il y a en moi ! Adieu. G.
247. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Tenez pour certain que nous nous ne pensons pas à autre chose, qu’à maintenir le statu quo en Orient. Nous ne demanderions pas mieux que de le maintenir tout entier : nous serions volontiers, là, aussi stationnaires que M. de Metternich. Mais quand nous voyons tomber quelque part de l’édifice, et quelqu'un sur place qui essaye d’en faire une nouvelle maison, nous l'approuvons, et tâchons de l’aider, ne pouvant mieux faire. C’est ce qui nous est arrivé en Grèce, en Egypte ; ce qui nous arriverait partout où viendrait un autre Méhémet Ali. Sans compter que ce pays-ci a le goût du mouvement de la nouveauté des parvenus gens d’esprit que partout où il les rencontre, il prend feu pour eux, et que son Gouvernement est bien obligé de faire un peu comme lui. Ce que nous ne voulons pas, c’est que Constantinople se démembre au profit de Pétersbourg ou de Vienne. Et notre principale raison de ne pas le vouloir, c’est que le jour où cela arriverait, il faudrait que quelque chose aussi, vers le Rhin ou les Alpes se démembrât à notre profit. Nous pressentons que nous sérions forcés de vouloir ceci, qu'on nous casserait aux oreilles qu’il faut le vouloir, et nous n'avons nulle envie d'être mis au défi de courir cette grande aventure ou de passer pour des poltrons si nous ne la courons pas. Nous sommes pacifiques, très pacifiques, et nous ne voulons pas être poltrons.
Je dis nous, le pays. Voilà toute notre politique sur l'Orient. Et pour soutenir cette politique là, on pourrait nous faire faire beaucoup de choses. Nous regarderions comme un acte de prudence des combats sur mer, au loin, pour éviter une guerre continentale et à nos portes. Nous souhaitons, le statu quo en Orient parce qu'il nous convient en Occident. Le démembrement de l'Empire turc, c'est pour nous le remaniement de l’Europe. Le remaniement de l’Europe personne ne sait ce que c’est. Et nous sommes un pays prudent, très prudent, quoiqu'il ne soit pas impossible de nous rendre fous encore une fois, nous le sentons, et n'en voulons pas d'occasion. En tout ceci l'Angleterre pense comme nous et nous nous entendons très bien. Mais elle a une autre pensée qui n’est qu'à elle, et qui nous gêne dans notre concert. Elle ne veut. pas qu’il se forme dans la Méditerranée aucune Puissance nouvelle ; ayant des chances de force maritime et d'importance commerciale Elle ne le veut pas, et pour la Méditerranée elle-même, et pour l'Inde. De là son inimitié contre la Grèce et contre l’Egypte ; inimitié qu'elle voudrait nous faire partager, ce dont nous ne voulons pas n'ayant point d'Inde à garder, et ne craignant rien pour notre commerce dans la Méditerranée. L'Angleterre voudrait s’enchaîner, et nous enchaîner avec elle au statu quo entier, absolu, de l'Empire Ottoman. Nous ne voulons pas. parce que nous ne le croyons pas possible, parce que nous n'y avons pas un intérêt aussi grand, aussi vital que l’Angleterre ; parce que l'entreprise si nous nous en chargions ensemble pèserait bientôt sur nos épaules plus que sur les siennes et nous compromettrait, bien davantage en Europe. Voilà par où nous nous tenons et par où nous ne nous tenons pas l'Angleterre et nous. En ce moment l'Angleterre nous cède ; elle renonce à poursuivre son mauvais vouloir contre l’Egypte. Elle y renoncerait, je crois très complètement, si elle était bien convaincue que de notre côté nous tiendrons bon avec elle pour protéger contre vous soit le vieux tronc, soit les membres détachés et rajeunis de l'empire Ottoman. Elle doute ; elle nous observe. Il dépend de nous de la rassurer tout-à-fait, et en la rassurant de lui faire adopter à peu près toute notre politique.
Vous savez l’Autriche. Jamais je crois, nous n'avons été si bien avec elle. Elle est bien timide ; elle est si peu libre de ses mouvements que la perspective de la moindre collision, même dans l'Orient et pour l'Orient seul, l’épouvante presque autant que celle du remaniement de l’Europe. Cela se ressemble en effet un peu pour elle car elle tient à l'Orient et à l’Occident ; ses racines s'étendent des sources du Pô, bouches du Danube, et l’ébranlement va vite de l’une à l'autre extrémité. Cependant je crois que si elle y était forcée, si les habilités dilatoires perdaient toute leur vertu, elle agirait avec nous, et qu'elle l’a à peu près dit. Si c’est vous-même qui pacifiez l'Orient, qui présidez à la transaction entre Constantinople et Alexandrie, qui donnez un trône au Pacha pour ne pas cesser de protéger vous-même le Sultan sur le sien, il n’y a rien à dire. Vous aurez bien fait, et nous n'en serons pas très fâchés. Vous aurez gardé votre influence ; nous aurons obtenu notre résultat.
N'est-il pas très possible que tout finisse ainsi du moins en ce moment, et que sous les mensonges des journaux, sous les fanfaronnades des Gouvernements, au fond nous agissions tous à peu près dans le même sens, n'ayant pas plus d'envie les uns que les autres de rengager les grands combats ? Je suis bien tenté de le croire. Samedi 9 heures Pas de lettre ce matin. Cela me déplaît toujours beaucoup et m'inquiète un peu. Adieu. Adieu à demain. G.
246. Val -Richer, Vendredi 16 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai que le temps de vous dire adieu. J’ai eu du monde hier le matin une grande promenade le soir la migraine. Je viens de me lever très tard, et il faut que j'écrive à M. Duchâtel pour une affaire. Car j'ai les affaires d’une foule de gens à défaut des miennes. C’est un grand ennui.
Je reviens aux paroles d'Alexandre qui donnent pour moi, aux nouvelles d'Orient, un double, triple intérêt. Décidément, je ne crois à aucune complication grave. Si c’est nous qui servons de médiateurs entre le Pacha et la Porte nous les accommoderons sans guerre ; et si c’est vous, si nos ambassadeurs sont des dupes, vous accommoderez aussi. Cela prouve même que vous voulez accommoder. Question et combat d'influences ; rien de plus jusqu'ici.
Que feriez-vous, s’il y avait autre chose ? Où iriez-vous ? Iriez-vous quelque part ? Seriez-vous malade ? L'Angleterre ne vous vaudrait pas mieux que la France. Est-ce que Zéa ne vous est pas arrivé ? Ses pronostics étaient justes. La dissolution, qu’il redoutait tant, amène des cortes exaltées qui ne feront rien, mais qui empêcheront qu'on ne fasse s’il y a quelque chose à faire pour qui que ce soit. Du reste, ils peuvent faire en Espagne ce qui leur plaira. Nous nous en mêlerons moins que jamais. L'Orient a tué l’intervention.
9 h. 1/2
Voilà votre N°240. Je voudrais bien que vous eussiez Melle Henriette, dont je ne connais guère pourtant que sa réputation qui est bonne. Je vous dirai demain, avec détail ce que je pense de notre situation à tous en Orient. Adieu. Adieu. Je vais écrire pour l’hôtel Crillon. Adieu. G.
26. Val Richer, Dimanche 3 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes probablement entrée hier dans les Principautés. On s'y attend depuis trois semaines. Pourtant cela fera de l'effet. Si, comme vous le dites, de Constantinople, on excite les Circassiens, et si à Pétersbourg, vous acceptez les provocations des Bulgares ou des grecs, cela peut aller loin. C'est là ce que je crains le plus. Ma sécurité, c’est que je demeure convaincu que vous ne voulez pas la guerre, et que, ni à Constantinople, ni à Londres, on ne la veut pas plus qu'à Paris. Vous l’engageriez sur un bien puérile motif et sous de bien mauvais auspices. Ne croyez pas que le gouvernement Français résistât à la tentation d’une union intime avec l’Angleterre et des chances que la guerre pourrait lui ouvrir. Chances d'éclat, sinon de conquête. L'éclat lui suffirait pour quelque temps. Vous verriez bientôt l'Allemagne prendre elle-même parti contre vous, sinon ouvertement et par ses armes, du moins par ses voeux les peuples allemands pousseraient fortement dans le sens et les gouvernements, quelque crainte, et quelque besoin qu’ils aient de vous, ne se compromettraient pas, pour vous soutenir, avec la France et l'Angleterre, et avec leurs peuples.
Vous ne pouvez entreprendre, à vous seuls, la solution définitive de la question Turque, c’est à dire la conquête de Constantinople ; il vous faut, de toute nécessité, l’entente préalable et l'accord soit avec l’Autriche et la France, soit avec l’Autriche et l'Angleterre. Vous ne l’avez pas et vous ne l'aurez pas aujourd’hui. Vous jetteriez l’Europe dans le chaos, en l'ayant au début, presque tout entière contre vous, et en ne pouvant attendre de chances favorables que des séductions et des bouleversements du chaos. Je persiste à croire que vous ne voulez pas cela. Le ferez vous sans le vouloir, par entraînement. et par pique ? Je ne puis le croire. D'autant que si vous voulez vraiment l’éviter de toutes parts certainement on vous y aidera. Conclusion votre entrée dans les Principautés ne sera pas la guerre ; on recommencera à négocier, et on finira par trouver un biais dont vous vous contenterez. Je vous le répète, je ne crains que les folies Turques et grecques, et vos faiblesses, à vous, en présence de ces folies, faiblesses de colère ou faiblesses de sympathie. Vos hommes de sens et d’esprit, qui veulent la paix, ont bien à regarder et à se garder de ce côté.
L’amiral Hamelin, qui remplace La Susse est un officier plus jeune, très bon marin, point mauvaise tête, homme d’exécution au besoin, mais qui va pas au devant des aventures. Je suppose que le vrai motif du rappel de La Susse, c’est qu’il était détesté de sa flotte, officiers et matelots. On fait sur toutes nos côtes, une levée de marins considérable, dans mon petit port de Trouville, où il y en a 400, on en a appelé 100 qui ont été envoyés à Brest, pour l'escadre de l'Océan, que commande l’amiral Bruat.
Onze heures
Vous devez avoir en mon avis sur votre circulaire mardi, ou mercredi dernier, le 28 ou le 29. Il est vrai que nous pour parlons de bien loin et bien tard. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Europe, Guerre de Crimée (1853-1856), Politique (Analyse), Politique (Russie), Portrait
Val-Richer, Vendredi 2 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Mon impatience de savoir est extrême. Ce Cabinet s’est-il fait de concert entre le président, et la majorité, ou est-ce qu'un coup de tête du président ? Sera-t-il soutenu ou désavoué par la majorité et ses chefs ? Mon bon sens me porte à croire à la première chance. Deux ou trois billets que j'ai reçus hier m'indiquent plutôt l'autre. Cela importe infiniment pour la suite. si la majorité est consentante, si ce sont là des doublures mises en avant- pour faire ce que ne veulent pas faire les premiers acteurs, il n’y a rien de grave à craindre prochainement, la situation actuelle avancera sans se bouleverser. Dans le cas contraire, le chaos peut être imminent. Mon instinct me dit bien que même dans le chaos, il est impossible que les honnêtes gens avertis, et armés, et postés comme ils le sont se laissent battre et chasser. Mais j’ai appris à me défier de mon instinct. Vous me préoccupez avant tout par-dessus tout. Le monde s’arrange comme il pourra, quand il pourra. Il a de la force pour supporter et du temps pour attendre. Mais vous ! Je ne crois pas au danger. Je ne crois pas que votre seconde impression vous trompe, et que vous ayez tort d'avoir moins peur depuis que vous êtes dans la mêlée. Mais qu'importe ce que je crois ou ne crois pas ? Et j’attends et je ne puis faire qu'attendre. Je compte que le courrier, m'apportera tout à l'heure, le sens et la direction de l'incident. Vous avez toute raison ; si le gouvernement a le sens commun, il rappellera d'Orient sa flotte. Toute prolongation de démonstration serait parfaitement déplacée et sotte. Et l'Angleterre devrait en faire sur le champ autant. On vous doit, non seulement le fond, mais toutes les apparences possibles d'égards et de bons procédés. Les questions qui peuvent subsister encore entre vous et la Porte, l'expulsion effective des réfugiés, le lieu de leur retraite, les provinces du Danube, tout cela se réglera, d’autant mieux que l'occident s'en mêlera moins et surtout aura moins l’air de s'en mêler. Je ne puis croire que Sir Stratford Canning s'oppose formellement à ce que la Porte envoie les réfugiés vers tel point plutôt que vers tel autre. Qu'ils aillent en Angleterre ou en Amérique, rien n’est plus indifférent. Une fois sortis de Turquie, ils finiront toujours par aller à peu près où ils voudront en occident. Je ne comprends par Normanby poussant à l'Empire à tort et à travers, sans s’inquiéter de savoir si la majorité en veut, ou n'en veut pas, et uniquement pour maintenir son influence sur le président. Cela me paraît de la part de l'Angleterre, un jeu bien sot et bien inutile. Le joue-t-elle réellement ? Mad. Austin a traduit jusqu'ici, et traduit encore. Elle aura traduit demain tout ce qui est prêt, et elle part Lundi pour aller passer quinze jours à Paris où elle a affaire et d’où elle retournera à Londres. J’aurais ri de votre remarque si je pouvais rire. Je vais faire ma toilette. Vous connaissez cette impossibilité de tenir en place, ce besoin d'aller et de venir ; et de faire quelque chose, quand on ne fait rien et qu’on attend.
Onze heures et demie
C’est évidemment du bien nouveau qui commence. Plus curieux d'abord que menaçant. Il faut attendre pour penser. Adieu, adieu, Adieu.
78. Val Richer, Dimanche 28 mai 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai trouvé ma fille Pauline très bien. Sa grossesse la fatigue un peu ; mais voilà tout. Montebello est venu me voir une heure avant mon départ. Je l’avais engagé à aller vous faire sa visite demain, ou après demain ; mais il aime mieux retarder de quelques jours.
Je sais positivement que l’amiral Parseval est assez content de sa flotte ; il a des équipages un peu vieux ; on a pris, pour les former d’anciens matelots de 40 ans qu’on avait laissés chez eux ; mais ils avaient de l'expérience, et ils ont repris de l’entrain. Il manquait à cette escadre des bâtiments à vapeur ; on lui en a envoyé sept de plus Anglais ou Français, il y aura là un armement énorme. On fait certainement de grands efforts pour développer notre marine. On veut remplacer celle qu’on va détruire chez vous.
Sur terre, on est très frappé de votre peu d'efficacité. Le Duc de Noailles m'en parlait avant hier avec une surprise qui s'accroît de jour en jour. Vous êtes, depuis six mois, en face des Turcs sans leur avoir fait éprouver un seul grand échec. Ni le système de la guerre défensive, ni la lenteur des premiers préparatifs ne devraient, ce semble, vous empêcher aujourd’hui de déployer la supériorité de vos forces. Quoiqu’il arrive plus tard, il y a là un déclin.
Mad. de Sebach vous a sûrement raconté son impétuosité en dînant, un de ces jours, je ne sais plus lequel, chez je ne sais plus qui, quoiqu'on me l'ait dit ; la Prusse et la fille de M. de Nesselrode n’a pu se contenir ; elle a éclaté en reproches, et a fini par dire qu’elle voyait bien qu’elle ne pourrait plus rester longtemps à Paris. Est-ce à cause de cela qu'elle est allée passer huit jours à Bruxelles ?
On parlait aussi des vivacités populaires de Pétersbourg, telles que M. de Nesselrode aurait été sifflé dans la rue, et tout le parti allemand ou de la paix, dans sa personne.
Midi
Voici votre 67. Je suis charmé d'avoir si bien parlé de M. de Stahl. Je ne me rappelle pas un mot de ce que je vous ai dit. Adieu, Adieu. G.
54. Val Richer, Jeudi 1er Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Merci de vos quelques lignes de Strasbourg. J’espère en avoir quelques unes ce matin de Paris. Vous devez y être arrivée avant hier soir. Vous n'y trouverez pas plus de soleil qu’à Schlangenbad je n’ai jamais vu un plus affreux été. Mais vous vous reposerez chez vous. A mon avis on n'est bien que là où on doit rester. Grand signe de vieillesse.
Je n’aime pas ces petites modifications demandées à Constantinople. J’espère qu’elle sont aussi insignifiantes qu’on le dit. Les reproches du Times à la Porte, m'en font un peu douter. Du reste, j'en reviens toujours à mon dire ; si vous ne désirez pas, en secret, que la question dure, elle finira. Bien des gens à Londres, et à Paris, croient que vous ne voulez pas qu'elle finisse, et que vous comptez sur les objections de la Porte. Si cela est, petites ou non, elles sont graves.
Faites-vous attention aux actes et au langage des agents des Etats-Unis, chez eux et en Europe, le Président Pierce, le ministre Soulé, le chargé d'affaires Brown ? Il y a là du nouveau. Tenez pour certain que le nouveau monde se mêlera bientôt, et bien activement, des affaires de l'ancien, et avec toute l’arrogance et l'hypocrisie démocratiques.
Onze heures
Je suis charmé de vous savoir arrivée et hors des auberges. Merci de deux copies. La vivacité de Constantin m'amuse. La paix ne s'en fera pas moins. Adieu, adieu. G.
Val Richer, Dimanche 16 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous envoie la lettre que je viens de recevoir de M. Monod. Vous la trouverez détaillée sensée et très consciencieuse. Vous me direz ce que je dois répondre.
Savez-vous si la Princesse Koutschoubey a reçu ma lettre. Je l’ai adressée à l'hôtel Bristol.
Gladstone a supérieurement parlé à Manchester. Il me paraît que le mouvement belliqueux n’a pas grand retentissement en Angleterre. Je serais charmé que la mauvaise politique fût, là, percée à jour et repoussée, et la bonne comprise et soutenue par le bon sens public. Ce serait un grand triomphe. dans une grande épreuve. Si cela est vous aurez, entre vous Russes et Turcs, bien de la peine à vous battre, et si vous vous battez, on ne se battra pas pour vous et on trouvera quelque moyens d'empêcher que vous ne vous battiez longtemps. A travers toutes nos oscillations et vos agitations, cela me paraît le résultat le plus probable. Si ce n'était vous, je crois que je n'y penserais plus guère.. Je suis à la veille d’un assez grand dérangement, pour l'hiver prochain, dans mon intérieur. Ma fille Pauline, sans être malade, est toujours fatiguée et faible. Elle n’a pas repris ses forces depuis sa dernière couche. Son médecin, qui est venu ici, lui conseille positive ment d'aller passer l'hiver dans le midi, à Hières, ou à Nice. Son mari en est d’avis, et moi aussi. On prévient beaucoup de malheur en prenant tout de suite ces précautions- là. Elle partira donc bientôt, et mon ménage de l'hiver se réduira à Guillaume et moi, avec ma fille Henriette à côté. C’est une contrariété ; mais quand on a ressenti les grandes joies et les grandes peines de la vie, les contrariétés sont peu de chose. Je n'ai pas de vraie inquiétude sur ma fille mais je crois tout-à-fait bon pour elle. qu'elle aille passer l'hiver sous un ciel doux et dans un complet repos. Je remercie Marion de m'avoir tiré d’embarras sur Pianezza.
Onze heures
Voilà votre lettre qui ne m’apprend rien, comme je m’y attendais. Vous m'écriviez le 24 septembre : " Hélène est bien touchée de vous voir vous occuper d'elle. Elle prendra à genoux le précepteur que vous lui recommanderiez. Je vous prie donc d'essayer de trouver et de lui adresser directement votre trouvaille. " Je ne sais pas une autre manière d'adresser directement que d’écrire.
Je crois que là le Duc de Nemours a dû voir, M. le comte de Chambord. Mais je n'en sais rien de positif. Adieu, adieu. G.
Val Richer, Vendredi 23 Septembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Votre note a deux mérites pour l'Europe, elle est très pacifique ; pour la Russie, elle prend la bonne position ; vous acceptez tout ce que l'Europe a demandé, et vous lui laissez l’embarras de le faire accepter à Constantinople. Vous prenez la peine de lui indiquer comment elle doit s’y prendre pour le faire accepter ; elle n'a qu'à déclarer franchement et énergiquement à la Porte & & Vous dites d'avance que vous évacuerez les Principautés dès que la note de Vienne sera acceptée à Constantinople et l’ambassadeur Turc arrive à Pétersbourg. Il n’y a rien à vous dire, vous profitez de vos avantages, en rassurant pleinement l’Europe sur vos desseins. Si l'Europe ne sait pas maintenir la paix, ce sera sa faute et non pas la vôtre. Elle la maintiendra. Elle obligera la Porte à accepter la note. Je ne sais pas par quelles lenteurs et qu’elles oscillations, il faudra passer pour en arriver là ; mais on y arrivera. Le résultat contraire serait trop ridicule et trop périlleux. En attendant le discours de Lord John ne me plaît pas du tout ; il admet beaucoup trop la chance de la guerre. Si c'est de la part de cette fraction du Cabinet une disposition à céder à l'opinion belliqueuse anglaise, c’est grave ; si ce n'est que ménagement pour cette opinion, avec l’intention au fond, de lui résister, je crois les ménagements plus dangereux qu'utile. Le cabinet anglais me paraît avoir deux peurs ; pour de la guerre, et peur d’un débat, en faveur de la paix dans le Parlement. Il voudrait la paix, sans débat. C’est une utopie. Il faut toujours se battre quelque part, et il vaut mieux se battre au dedans pour faire triompher la bonne politique qu'en dehors en l'abandonnant.
Je vois que votre grande Duchesse Marie, quitte l’Angleterre, malgré le goût qu’elle y a pris. Elle a raison de la quitter ; mais son goût me donne bonne opinion d'elle. Je dis de l’Angleterre ce qu’on a dit des ouvrages des grands maîtres.
C'est avoir profité que de savoir s'y plaire. Je suis de votre avis sur les paroles de l'Empereur au camp de Satory ; elles sont bonnes et bien dîtes à la fois militaires et pacifiques, agréables pour le dedans et pour le dehors ; et d’une flatterie noble, de celle qui relève ceux à qui elle s'adresse au lieu de les corrompre.
Avez-vous vu le maréchal Narvaez ? Ce sont ses amis qui rentrent au pouvoir à Madrid. Ils ne se suffiront pas longtemps à eux seuls. Ils auront besoin de lui. Dit-on que la Reine Christine retourne en Espagne ? Je suis en train de questions. Barante est-il à Paris ? Sa fille devait accoucher dans le cours de ce mois. S'il y est, vous seriez bien bonne de me dire son adresse. J’ai à lui répondre et je ne sais où le prendre. Il doit venir me voir au commencement d'Octobre. J’ai reçu hier une lettre de Piscatory qui veut aussi venir vers cette époque. Mes enfants remplissent presque ma maison, et j’ai besoin d’espacer mes hôtes pour ne pas les faire coucher à la belle étoile.
Adieu, Adieu. Le beau temps continue. J'en jouis autant au bois de Boulogne qu’au Val Richer. Adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Europe, Politique (Analyse), Politique (Russie), Politique (Turquie)
48. Val Richer, Mardi 16 août 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Puisque votre fils trouve Schlangenbad charmant et que votre santé s'en trouve, sinon beaucoup mieux, du moins pas plus mal. Vous avez raison d'y rester encore. Le changement sans rien savoir pourquoi, est un grand ennui. Nous aurons, sans doute avant la clôture, un grand exposé de l'affaire Turque dans le Parlement ; Lord John l’a promis. Il n’y sera pas embarrassé ; le cabinet Anglais a bien conduit sa barque ; il a maintenu la paix, en se montrant prêt à faire la guerre ; il a protégé efficacement la Turquie et rallié à lui la France sans se mettre à leur disposition. C'est de la bonne politique de temporisation et d’ajournement des questions. Personne aujourd’hui n'est en état, ni en goût d'avoir une politique qui les décida. Vous me dites que les Russes de Paris trouvent qu'après tout, et au prix de votre bonne réputation en Europe, vous avez fort avancé vous affaires ; je ne connais pas assez bien les faits pour en bien juger ; mais si cela est, soyez contents aussi ; tout le monde le sera. La Turquie l'est certainement autant que peut l'être un mourant qui n’est n'est pas mort, et pour la France, on dit qu’elle l'est beaucoup. Le public l'est car il voulait la paix, et il sait gré au gouvernement de l'avoir maintenue. Le gouvernement a de quoi l'être, car il a sa part dans le succès pacifique, et il s'est mis fort bien avec l'Angleterre. L’est-il bien réellement, au fond de l'âme ? J'en doute un peu. Mon instinct est que l'Empereur Napoléon aurait préféré l’union belligérante avec l’Angleterre, le Ministère de Lord Palmerston et toutes les chances de cet avenir-là. Je penche à croire que c’est là le but que, de loin et sans bruit, il poursuivait. Mais il ne s'y est pas compromis ; et ce n’est pas un échec pour lui de ne l'avoir pas atteint. Il peut donc se féliciter aussi. J’ai rarement vu une affaire où tout le monde ait été si embarrassé pour être, à la fin, si satisfait.
Je ne pense pas que l'Empereur Napoléon, se soit fait, dans le public, le même bien par le Rapport qu’il s’est fait faire pour montrer en perspective huit ou dix millions à payer en vertu du testament de son oncle. C'est se donner un gros embarras pour une nécessité bien peu pressante. Il y a assez de questions vivantes ; pourquoi exhumer les mortes ?
10 heures
Voilà votre N°46. Je ne partage pas du tout les soupçons de lord Greville à l'endroit des Principautés. Vous êtes entrés nécessairement. pour couvrir vos concessions sur vos premières demandes à Constantinople ; vous vous en irez loyalement. Question d’honneur dans l’un et l'autre cas. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Benckendorff), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Opinion publique, Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Internationale), Politique (Russie), Politique (Turquie), Santé (Dorothée)
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis décidé à croire que votre Empereur ne veut pas la guerre, et par conséquent à croire qu’il saisira la première occasion de sortir d’un mauvais pas qui mène à la guerre à la guerre révolutionnaire générale, au chaos Européen.
Si malgré cette perspective, vous aviez votre parti pris de pousser la botte à fond et de jeter bas l'Empire Ottoman pour mettre la main sur les gros morceaux, je comprendrais l'obstination et je n'aurais rien à dire, sinon que le moment est mal choisi pour un si grand coup. Mais je suis convaincu que vous ne voulez pas porter ce coup et alors je ne comprendrais pas que vous ne missiez pas fin, le plutôt possible, à la situation actuelle. Vous n’avez qu'à y perdre. Vous y avez déjà pas mal perdu ; vous y avez perdu votre grand caractère de pacificateur général, de conservateur suprême de l'ordre Européen ; vous avez reveillé les méfiances des autres puissances ; vous vous êtes séparés de l'Angleterre ; vous l’avez unie à la France ; vous avez placé votre plus sûr allié, l'Autriche, dans la situation la plus périlleuse. Vous avez fait autre chose encore ; vous avez fourni à la Turquie une nouvelle occasion de s'établir dans le droit public Européen.
Taxez moi de rancune si vous voulez ; mais ce fût là, en 1840, votre faute capitale, pour isoler, pour affaiblir le gouvernement du Roi Louis Philippe, vous avez alors mis de côté votre politique traditionnelle qui était de traiter les affaires de Turquie pour votre propre compte, à vous seuls sans concert avec personne, vous avez vous-mêmes porté ces affaires à Londres par le traité du 15 Juillet 1840 vous en avez fait de vos propres mains, l'affaire commune de l’Europe. Vous avez été obligés l’année suivante, de faire encore un pas dans cette voie, et la convention des détroits du 13 Juillet 1841, et, de votre aveu, confirmée, pour la Turquie, l’intervention et le concert de l'Europe. Ce n’est pas là, je pense, ce qui vous convient toujours et au fond, et vous deviez être pressés de rentrer avec la Turquie dans vos habitudes de tête à tête. L'affaire des Lieux Saints vous en fournissait, il y a quelques mois une bonne occasion ; après y avoir essuyé, par surprise, à ce qu’il paraît un petit échec, vous y aviez repris vos avantages ; vous l'aviez réglée comme il vous convenait, sans vous brouiller avec la France, et de façon à être fort approuver de l'Angleterre. Pourquoi n'en êtes vous pas restés là ? Tout ce que vous avez fait depuis vous a mal réussi, vous avez eu l’air de vouloir plus que vous ne disiez ; vous n'avez pas fait ce que vous vouliez ; vous vous êtes bientôt trouvés engagés plus avant que vous ne vouliez ; vous avez rallié l'Europe contre vous et jeté la Turquie dans les bras de l’Europe. Pourquoi ? Encore un coup, je ne le comprends pas. Je ne le comprendrais que si je vous croyais décidés à jouer, en ce moment, la grande et dernière partie de cette question, et à mettre, à tout risque, la main sur Constantinople. Et comme je ne crois pas cela, je persiste à penser qu’une seule chose vous importe ; c’est de mettre fin promptement à une situation qui a le triple effet de vous isoler en Europe, d’unir l'Europe contre vous et de placer de plus en plus la Turquie sous la sauvegarde du concert Européen. Vous pouvez sortir de ce mauvais pas, sinon sans quelque déplaisir momentané, du moins sans aucun inconvénient sérieux pour votre politique nationale, et son avenir ; la géographie et le cours naturel des choses vous donnent, dans la question Turque, des forces et des avantages que rien ne peut vous enlever. Pourquoi susciter contre soi un orage quand il suffit de laisser couler l'eau ? Adieu.
J'en dirais bien plus si nous causions. G.
Val-Richer, Jeudi 3 novembre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les Turcs ont donc passé le Danube, et vous n’y avez pas fait obstacle, probablement dans l’intention de les battre et de les rejeter ensuite au delà du fleuve, en leur disant : " Repassez si vous voulez. " Je me figure qu’il y a là, pour vous toute une politique, et une bonne politique ; si vous restez fermement dans les principautés, en en chassant toujours les Turcs, mais sans en sortir jamais vous-mêmes, vous ferez un grand pas dans votre destinée, en forçant l’Europe de reconnaître que vous ne voulez point aujourd’hui renverser l'Empire Ottoman ; vous remporterez des victoires en vous épargnant les plus grandes difficultés de la guerre, et vous resterez de plus en plus en mesure de négocier, une bonne paix. Je fais profession de ne rien entendre du tout à la guerre comme guerre ; mais la guerre comme moyen de la politique, je la comprends, et dans cette occasion-ci, je ne serais pas embarrassé pour m'en bien servir.
Onze heures et demie
Vos nouvelles valent mieux que mes plans de politique. Comme vous dites, il faut encore tout que ce soit fini ; mais quand ce sera fini, je ne serai guère plus sûr de la paix que je ne l’ai toujours été. Adieu, adieu. On sonne le déjeuner, et ma toilette n’est pas encore achevée. G.