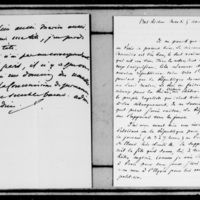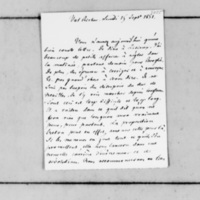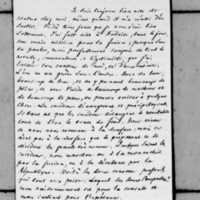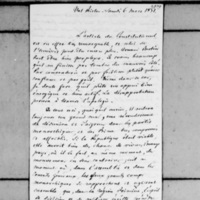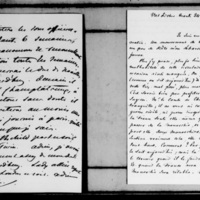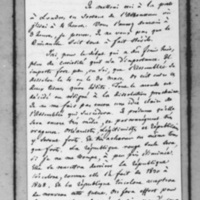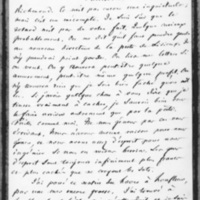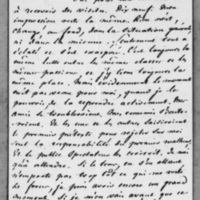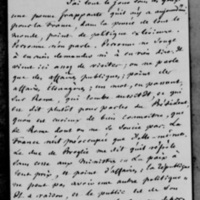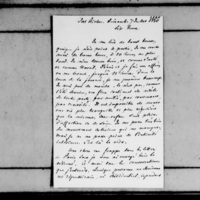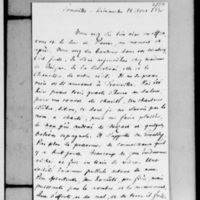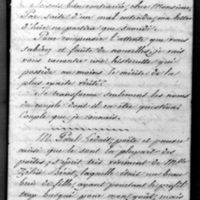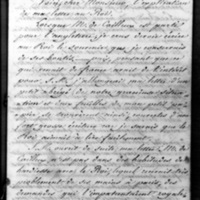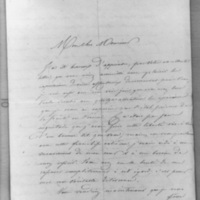Votre recherche dans le corpus : 83 résultats dans 3296 notices du site.
Trier par :
Val-Richer, Samedi 19 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 19 Juillet 1851
7 heures
Le grand effet du discours de Berryer est très mérité. C’est un talent admira blement abondant expansif communicatif, sympathique. Il plaît à ses adversaires presque autant qu'à ses amis. Amusez-vous de la mobilité des esprits et des situations. Nous avons tous dit d’abord qu’il fallait que ce débat fût un grand duel entre la République et la Monarchie, c'était aux hommes monarchiques à l'exiger, à en prendre l'initiative. Puis, nous avons renoncé au duel ; c'était une folie ; le pays n'en voulait pas ; il fallait baisser la voix, se tenir bien tranquille, bien modeste. Le débat commencé, et le duel entre la monarchie et la République éclate ; et il n’y a pas d'autres acteurs en scène que les républicains et les monarchiques, Cavaignac et Michel de Bourges, Falloux et Berryer. Seulement ce sont les républicains qui ont pris l'initiative, ce qui a rendu la position des monarchiques plus commode. Variez tant qu’il vous plaira c’est presque toujours la première idée qui est la bonne ; seulement, il ne faut pas la suivre au premier moment ; elle devient plus sage et plus pratique quand elle a passé par un peu de contradiction et de temps.
Voici un petit incident. On m’écrit : “ Depuis deux jours, M. Thiers et ses amis font grand bruit d’une lettre du Prince de Joinville qui serait arrivée à l'amiral Hernoux, et qui contiendrait un récit burlesque de l’entrevue de Claremont. Le Prince s’attacherait, dit-on, à tourner en ridicule tout ce qu'aurait dit Berryer. Il parle avec une amère ironie des larmes que l'avocat avait mises dans sa voix du Duvergier de Hauranne et Thiers, qui colportent les phrases de cette lettre sur tous les bancs de l'assemblée, ont eu soin que Berryer, et St Priest en fussent avertis. Ils en paraissent très blessés et c’est peut-être à cause de cet incident que Berryer s'est abstenu de parler de la fusion. M. de Montalivet, va faire tous ses efforts pour savoir la vérité sur cette lettre. " Je vous dirai ce qu'aura appris Montalivet, s'il apprend quelque chose. Toute sottise est possible. Cependant, dans ce cas-ci, je suis plus porté à croire au mensonge qu'à la sottise.”
J’ai une longue lettre de Croker. Sinistre sur l'Angleterre ; croyant au triomphe des radicaux et à tout ce qui s'en suit. Les Whigs ne tiendront pas. Les Torys ne reviendront pas. Il ne sort pas de ce qu’il a prédit en 1832 au moment du bill de réforme : " It is true, dit-il pourtant, that it has not gone so fast as I expected. " Quant à la France, voici son résumé : " I am afraid that some of the good folks in my neighbourhood (West-Molesey est près de Claremont vous savez) as was said of their cousins, n’ont rien appris, and are Still Thinking of rebuilding the temple of July, as if it could be hoped that a child and a woman were to succeed, not only where the wise old man failed, but with the additional and incalculable disadvantage of his fall and all its consequences. I see by the Assemblée nationale that you, the conservatives are greatly perplexed what to do. My humble advice would be to give the republic a fair trial. You are not ripe for Henry V. An Orleans usurpation would be still less possible. An unconstitutional reelection of Louis Napoleon will lead to immediate bloodshed ; and for the sake of France her character as well as her peace and happiness, I think the had better not attempt to revise the Constitution, but to endeavor to execute it, as it stands. The best thing France could do in every view, could be to elect you président. " Vous ne vous attendiez pas à cette conclusion. 10 heures et demie Voilà le Diable rentré dans le débat. Il le fallait bien. Adieu, Adieu.
Je ne reçois, rien qui vaille la peine de vous être redit. Adieu. G.
7 heures
Le grand effet du discours de Berryer est très mérité. C’est un talent admira blement abondant expansif communicatif, sympathique. Il plaît à ses adversaires presque autant qu'à ses amis. Amusez-vous de la mobilité des esprits et des situations. Nous avons tous dit d’abord qu’il fallait que ce débat fût un grand duel entre la République et la Monarchie, c'était aux hommes monarchiques à l'exiger, à en prendre l'initiative. Puis, nous avons renoncé au duel ; c'était une folie ; le pays n'en voulait pas ; il fallait baisser la voix, se tenir bien tranquille, bien modeste. Le débat commencé, et le duel entre la monarchie et la République éclate ; et il n’y a pas d'autres acteurs en scène que les républicains et les monarchiques, Cavaignac et Michel de Bourges, Falloux et Berryer. Seulement ce sont les républicains qui ont pris l'initiative, ce qui a rendu la position des monarchiques plus commode. Variez tant qu’il vous plaira c’est presque toujours la première idée qui est la bonne ; seulement, il ne faut pas la suivre au premier moment ; elle devient plus sage et plus pratique quand elle a passé par un peu de contradiction et de temps.
Voici un petit incident. On m’écrit : “ Depuis deux jours, M. Thiers et ses amis font grand bruit d’une lettre du Prince de Joinville qui serait arrivée à l'amiral Hernoux, et qui contiendrait un récit burlesque de l’entrevue de Claremont. Le Prince s’attacherait, dit-on, à tourner en ridicule tout ce qu'aurait dit Berryer. Il parle avec une amère ironie des larmes que l'avocat avait mises dans sa voix du Duvergier de Hauranne et Thiers, qui colportent les phrases de cette lettre sur tous les bancs de l'assemblée, ont eu soin que Berryer, et St Priest en fussent avertis. Ils en paraissent très blessés et c’est peut-être à cause de cet incident que Berryer s'est abstenu de parler de la fusion. M. de Montalivet, va faire tous ses efforts pour savoir la vérité sur cette lettre. " Je vous dirai ce qu'aura appris Montalivet, s'il apprend quelque chose. Toute sottise est possible. Cependant, dans ce cas-ci, je suis plus porté à croire au mensonge qu'à la sottise.”
J’ai une longue lettre de Croker. Sinistre sur l'Angleterre ; croyant au triomphe des radicaux et à tout ce qui s'en suit. Les Whigs ne tiendront pas. Les Torys ne reviendront pas. Il ne sort pas de ce qu’il a prédit en 1832 au moment du bill de réforme : " It is true, dit-il pourtant, that it has not gone so fast as I expected. " Quant à la France, voici son résumé : " I am afraid that some of the good folks in my neighbourhood (West-Molesey est près de Claremont vous savez) as was said of their cousins, n’ont rien appris, and are Still Thinking of rebuilding the temple of July, as if it could be hoped that a child and a woman were to succeed, not only where the wise old man failed, but with the additional and incalculable disadvantage of his fall and all its consequences. I see by the Assemblée nationale that you, the conservatives are greatly perplexed what to do. My humble advice would be to give the republic a fair trial. You are not ripe for Henry V. An Orleans usurpation would be still less possible. An unconstitutional reelection of Louis Napoleon will lead to immediate bloodshed ; and for the sake of France her character as well as her peace and happiness, I think the had better not attempt to revise the Constitution, but to endeavor to execute it, as it stands. The best thing France could do in every view, could be to elect you président. " Vous ne vous attendiez pas à cette conclusion. 10 heures et demie Voilà le Diable rentré dans le débat. Il le fallait bien. Adieu, Adieu.
Je ne reçois, rien qui vaille la peine de vous être redit. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 24 Juillet 1851
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 5 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 5 oct. 1850
Votre trouble me désole. Je vous assure qu'il est excessif. Que peut dire cette femme ? Des choses désagréables ; rien de plus car il n’y a rien. En mettant donc les choses au pis, ce pourrait être un grand ennui, un vif déplaisir ; mais voilà tout. Je sais trop que des paroles ne remettent pas des nerfs ébranlés, pourtant vous avez l'esprit si juste et si ferme, quand vous oubliez vos nerfs, que ce qui est, ce qui est réellement ne peut pas ne pas finir par vous frapper et par vous calmer. Il n’y a vraiment pas, dans ceci de quoi être agitée comme je vous vois. J’ai bien quelque droit de vous le dire, car j'y suis intéressé aussi. Voyez la chose comme elle est dans sa juste mesure. elle ne vous empêchera plus de dormir. D'ailleurs j'ai la confiance qu'on réussira à prévenir le désagrément. Il importe peu qu’on fasse exactement ce que j'ai indiqué. Vos conseillers sont très intelligents ; ils trouveront ce qu’il y a de mieux à faire. Et plus j'y pense, plus je me persuade que cette femme ne veut, après tout, que ce qu’elle demande et qu’elle serait bien fâchée d’être refusée. C’est un acte de mendicité infâme. J’espère que vous m’apprendrez bientôt que tout est réglé et que vous êtes plus calme. Moi aussi, cela m'a empêché de dormir cette nuit, pour vous.
Je ne lis pas l'Opinion publique, mais j'ai vu dans l'Estafette la citation dont vous parle M. Molé. Je me suis bien rappelé le passage. Je crois qu'il est dans un de mes cours. J’y ai traité plusieurs fois cette question-là. Je reçois une lettre curieuse de M. Moulin. Plus curieuse que d'autres parce que ce qu'il me dit est en contradiction avec ce qu’on me dit d'ailleurs et avec ce que j'observe moi-même ici. " La lassitude et l'impatience du pays, me dit-il, sont extrêmes. Il veut en finir à tout prix. Il acceptera, il sollicitera, il exigera un mauvais expédient si on ne lui fait pas entrevoir comme prochaine une grande et définitive solution. Dans nos départements du centre, le socialisme a conservé presque toutes ses forces ; ce qu’il paraît en avoir perdu se retrouverait dans une crise d’élections générales. La loi électorale ne lui ferait obstacle que sous cette condition, difficile à réaliser, que toutes les fractions du parti modéré, Napoléoniens, Orléanistes, Légitimistes, Clergé, Républicains paisibles, s’il en est encore, seraient, comme aux élections du 13 mai 1849, parfaitement unies, et disciplinées.
Si l’on convoque jamais une Constituante, chaque parti arborant son drapeau, l'accord ne sera plus possible et le socialisme aura beau jeu. Aussi, dans nos départements, le parti modéré n’a qu’un vœu, qu’un cri. Pas de Constituante ! Plus d’élections par le suffrage universel, ou quasi-universel ! Que l’Assemblée législative en finisse comme elle voudra le mieux qu’elle pourra avec le président, ou le général Changarnier, ou tout autre, par la Monarchie, ou, si la Monarchie n’est pas encore possible, pas la république autrement constituée ! Voilà ce que j’entends dire, répéter depuis bientôt deux mois par nos anciens amis. Ce n’est pas seulement un désir véhément, c'est une idée fixe. Je n'ai pas été peu surpris de trouver cette disposition tout aussi vive, tout aussi manquée dans les légitimistes malgré leurs journaux et le mot d’ordre de leurs chefs, que dans les anciens conservateurs. Quant au Président il a sensiblement perdu dans les masses ; il gagne faute d'autres, dans la bourgeoisie propriétaire et il a conquis jusqu'à nouveau changement, la plus grande partie du monde officiel. Le pays que j'habite n’est pas si pressé, et verrait le mauvais oeil quiconque prendrait l’initiative d’une seconde nouvelle.
Montebello est-il à Paris ? Ou savez-vous quand il y revient ? Adieu, Adieu.
Je n’ai pas encore ouvert mes journaux. Je suis bien plus préoccupé de votre agitation que de celle de la Hesse. Je persiste à ne pas croire à la guerre. Adieu. G.
Votre trouble me désole. Je vous assure qu'il est excessif. Que peut dire cette femme ? Des choses désagréables ; rien de plus car il n’y a rien. En mettant donc les choses au pis, ce pourrait être un grand ennui, un vif déplaisir ; mais voilà tout. Je sais trop que des paroles ne remettent pas des nerfs ébranlés, pourtant vous avez l'esprit si juste et si ferme, quand vous oubliez vos nerfs, que ce qui est, ce qui est réellement ne peut pas ne pas finir par vous frapper et par vous calmer. Il n’y a vraiment pas, dans ceci de quoi être agitée comme je vous vois. J’ai bien quelque droit de vous le dire, car j'y suis intéressé aussi. Voyez la chose comme elle est dans sa juste mesure. elle ne vous empêchera plus de dormir. D'ailleurs j'ai la confiance qu'on réussira à prévenir le désagrément. Il importe peu qu’on fasse exactement ce que j'ai indiqué. Vos conseillers sont très intelligents ; ils trouveront ce qu’il y a de mieux à faire. Et plus j'y pense, plus je me persuade que cette femme ne veut, après tout, que ce qu’elle demande et qu’elle serait bien fâchée d’être refusée. C’est un acte de mendicité infâme. J’espère que vous m’apprendrez bientôt que tout est réglé et que vous êtes plus calme. Moi aussi, cela m'a empêché de dormir cette nuit, pour vous.
Je ne lis pas l'Opinion publique, mais j'ai vu dans l'Estafette la citation dont vous parle M. Molé. Je me suis bien rappelé le passage. Je crois qu'il est dans un de mes cours. J’y ai traité plusieurs fois cette question-là. Je reçois une lettre curieuse de M. Moulin. Plus curieuse que d'autres parce que ce qu'il me dit est en contradiction avec ce qu’on me dit d'ailleurs et avec ce que j'observe moi-même ici. " La lassitude et l'impatience du pays, me dit-il, sont extrêmes. Il veut en finir à tout prix. Il acceptera, il sollicitera, il exigera un mauvais expédient si on ne lui fait pas entrevoir comme prochaine une grande et définitive solution. Dans nos départements du centre, le socialisme a conservé presque toutes ses forces ; ce qu’il paraît en avoir perdu se retrouverait dans une crise d’élections générales. La loi électorale ne lui ferait obstacle que sous cette condition, difficile à réaliser, que toutes les fractions du parti modéré, Napoléoniens, Orléanistes, Légitimistes, Clergé, Républicains paisibles, s’il en est encore, seraient, comme aux élections du 13 mai 1849, parfaitement unies, et disciplinées.
Si l’on convoque jamais une Constituante, chaque parti arborant son drapeau, l'accord ne sera plus possible et le socialisme aura beau jeu. Aussi, dans nos départements, le parti modéré n’a qu’un vœu, qu’un cri. Pas de Constituante ! Plus d’élections par le suffrage universel, ou quasi-universel ! Que l’Assemblée législative en finisse comme elle voudra le mieux qu’elle pourra avec le président, ou le général Changarnier, ou tout autre, par la Monarchie, ou, si la Monarchie n’est pas encore possible, pas la république autrement constituée ! Voilà ce que j’entends dire, répéter depuis bientôt deux mois par nos anciens amis. Ce n’est pas seulement un désir véhément, c'est une idée fixe. Je n'ai pas été peu surpris de trouver cette disposition tout aussi vive, tout aussi manquée dans les légitimistes malgré leurs journaux et le mot d’ordre de leurs chefs, que dans les anciens conservateurs. Quant au Président il a sensiblement perdu dans les masses ; il gagne faute d'autres, dans la bourgeoisie propriétaire et il a conquis jusqu'à nouveau changement, la plus grande partie du monde officiel. Le pays que j'habite n’est pas si pressé, et verrait le mauvais oeil quiconque prendrait l’initiative d’une seconde nouvelle.
Montebello est-il à Paris ? Ou savez-vous quand il y revient ? Adieu, Adieu.
Je n’ai pas encore ouvert mes journaux. Je suis bien plus préoccupé de votre agitation que de celle de la Hesse. Je persiste à ne pas croire à la guerre. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 4 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 4 août 1851
C’est un grand fait que la composition de la Commission permanente. C’est la preuve que le parti monarchique sensé a, quand il le veut, la majorité contre la République, les pointus légitimistes le tiers-parti et le parti Thiers coalisé. Berryer, 402 voix, Dufaure 210 ; voilà les deux vrais termes de comparaison. Qu'il en pût être ainsi, si on le voulait, je le savais ; mais qu’on l'ait voulu et fait, je n'y comptais pas. C’est un grand pas vers l'organisation d'un parti d'avenir. Avancera-t-on dans cette voie ? Nous verrons.
Les pointus Légitimistes et les Régentistes sont furieux. Ils ont raison. On a très bien fait d'admettre Changarnier. On a eu tort d'exclure M. de St Priest. Sa présence dans la commission n'eût rien fait. Son exclusion le repousse parmi les pointus légitimistes, et il a de l'influence dans tout le parti. On prétend que le Duc de Lévis parle assez mal de la visite à Claremont, et dit qu’il n’en savait rien lui avant qu'on l'ait faite. Je ne crois pas cela.
Avez-vous remarqué la réponse de la Diète de Francfort, à la protestation de la France et de l’Angleterre contre l'entrée de l’Autriche, avec tous des États dans la confédération ? C’est bien médiocre. Pourquoi se borner au point de droit, qui est évidemment le côte faible, et ne rien dire de la nécessité anti-révolutionnaire qui est la grande raison ? Vieille routine de bureau. En général, la rédaction diplomatique allemande est faible et bien inférieure à la rédaction Française, Russe ou Anglaise.
Je vous quitte pour aller faire un tour de jardin. Le temps est superbe aujourd’hui et chaud ; ce qui fera grand plaisir à mes orangers, à mes œillets, et à moi.
10 heures
Le facteur m’arrive au milieu de ma toilette et je l’interromps pour fermer mes lettres. Adieu, Adieu.
J’espère que vous n'aurez pas souvent de pareils orages pour troubler vos nuits, et je suis charmé que ma lettre sur la démocratie vous convienne. Adieu. G.
C’est un grand fait que la composition de la Commission permanente. C’est la preuve que le parti monarchique sensé a, quand il le veut, la majorité contre la République, les pointus légitimistes le tiers-parti et le parti Thiers coalisé. Berryer, 402 voix, Dufaure 210 ; voilà les deux vrais termes de comparaison. Qu'il en pût être ainsi, si on le voulait, je le savais ; mais qu’on l'ait voulu et fait, je n'y comptais pas. C’est un grand pas vers l'organisation d'un parti d'avenir. Avancera-t-on dans cette voie ? Nous verrons.
Les pointus Légitimistes et les Régentistes sont furieux. Ils ont raison. On a très bien fait d'admettre Changarnier. On a eu tort d'exclure M. de St Priest. Sa présence dans la commission n'eût rien fait. Son exclusion le repousse parmi les pointus légitimistes, et il a de l'influence dans tout le parti. On prétend que le Duc de Lévis parle assez mal de la visite à Claremont, et dit qu’il n’en savait rien lui avant qu'on l'ait faite. Je ne crois pas cela.
Avez-vous remarqué la réponse de la Diète de Francfort, à la protestation de la France et de l’Angleterre contre l'entrée de l’Autriche, avec tous des États dans la confédération ? C’est bien médiocre. Pourquoi se borner au point de droit, qui est évidemment le côte faible, et ne rien dire de la nécessité anti-révolutionnaire qui est la grande raison ? Vieille routine de bureau. En général, la rédaction diplomatique allemande est faible et bien inférieure à la rédaction Française, Russe ou Anglaise.
Je vous quitte pour aller faire un tour de jardin. Le temps est superbe aujourd’hui et chaud ; ce qui fera grand plaisir à mes orangers, à mes œillets, et à moi.
10 heures
Le facteur m’arrive au milieu de ma toilette et je l’interromps pour fermer mes lettres. Adieu, Adieu.
J’espère que vous n'aurez pas souvent de pareils orages pour troubler vos nuits, et je suis charmé que ma lettre sur la démocratie vous convienne. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 5 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, mardi 5 août 1851
Il me paraît que les fêtes de Paris se passent bien. Le discours de Lord Granville est très bon, le seul vraiment bon et qui ait un sens. Tous les autres sont un peu trop insignifiants. Cela m'amuse de voir les ouvriers républicains crier vive l'Angleterre, pendant que la République donne à dîner au Lord Maire. Le Roi ne faisait pas mieux pour la Reine Victoria, au château d’Eu, ni le peuple royaliste qui criait vive la Reine à son débarquement. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. La République me l'apprend tous les jours. J'ai reçu avant-hier une invitation du Président de la République pour aller passer la journée ( de 3 à 7 heures) au Palais de St. Cloud, hier Lundi 4. Je suppose que c’est la fête qu’il donne lui à tous ces hôtes anglais. Comme je vais samedi soir à Paris pour deux jours, j'irai écrire mon nom à l'Elysée pour lui rendre sa politesse.
Autre visite qui m'amuse, c’est celle du Bey de Tunis à Vienne. Il va chercher là aujourd'hui contre la Porte soutenue par l'Angleterre la protection qu'en 1844, il venait chercher, et qu’il trouvait à Paris. Si on laisse Lord Palmerston s'établir à Tunis comme en Egypte, nous ne tarderons pas à avoir, pour l'Algérie, quelque gros embarras. Je doute que l’Autriche prenne efficacement le Bey de Tunis sous sa protection. Elle n'y a que bien peu d’intérêt et elle en a bien plus à être bien avec la Porte. Il y aurait, pour nous, si on savait s'y prendre quelque chose de bon à trier de cette situation, ce serait la reconnaissance, par la Porte de notre établissement en Algérie. Je ne doute pas que l’impertinence de Lord Palmerston au comte Buol ne soit préméditée. Il veut qu'on s'accoutume à le voir mettre sur le même rang les gouvernements et les insurrections, si cela convient à l'Angleterre. Pourquoi se le refuserait-il ? Les insurrections lui en savent gré et les gouvernements le lui passant. Vous savez que c’est dans la baie de Torquay qu'a débarqué Guillaume 3 arrivant en Angleterre. Je suppose que la baie est aussi bonne pour l'embarquement que pour le débarquement.
Le journal l'Ordre annonçait hier bien qu'avec un peu de réserve et d’embarras, la candidature de M. le Prince de Joinville. Pour le parti, cela me paraît une grosse faute ; si cette candidature est jetée dans le public et débattue longtemps d'avance, elle sera usée avant d’être sérieuse. Il me semble que la formation de la Commission permanente et la majorité qui l’a formée jettent un grand désarroi dans les coteries des impatients. Leurs journaux sont non seulement irrités, mais troublés.
10 heures
Je suis fâché qu'Ems ne vous réussisse pas aussi bien que l'an dernier. Le duc de Noailles aura vu qu’il avait tort de se plaindre. Je crois en effet que l’Elysée est content de la majorité ; mais je ne crois pas que la seconde discussion amène un résultat différent. Adieu et Adieu. G.
Il me paraît que les fêtes de Paris se passent bien. Le discours de Lord Granville est très bon, le seul vraiment bon et qui ait un sens. Tous les autres sont un peu trop insignifiants. Cela m'amuse de voir les ouvriers républicains crier vive l'Angleterre, pendant que la République donne à dîner au Lord Maire. Le Roi ne faisait pas mieux pour la Reine Victoria, au château d’Eu, ni le peuple royaliste qui criait vive la Reine à son débarquement. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. La République me l'apprend tous les jours. J'ai reçu avant-hier une invitation du Président de la République pour aller passer la journée ( de 3 à 7 heures) au Palais de St. Cloud, hier Lundi 4. Je suppose que c’est la fête qu’il donne lui à tous ces hôtes anglais. Comme je vais samedi soir à Paris pour deux jours, j'irai écrire mon nom à l'Elysée pour lui rendre sa politesse.
Autre visite qui m'amuse, c’est celle du Bey de Tunis à Vienne. Il va chercher là aujourd'hui contre la Porte soutenue par l'Angleterre la protection qu'en 1844, il venait chercher, et qu’il trouvait à Paris. Si on laisse Lord Palmerston s'établir à Tunis comme en Egypte, nous ne tarderons pas à avoir, pour l'Algérie, quelque gros embarras. Je doute que l’Autriche prenne efficacement le Bey de Tunis sous sa protection. Elle n'y a que bien peu d’intérêt et elle en a bien plus à être bien avec la Porte. Il y aurait, pour nous, si on savait s'y prendre quelque chose de bon à trier de cette situation, ce serait la reconnaissance, par la Porte de notre établissement en Algérie. Je ne doute pas que l’impertinence de Lord Palmerston au comte Buol ne soit préméditée. Il veut qu'on s'accoutume à le voir mettre sur le même rang les gouvernements et les insurrections, si cela convient à l'Angleterre. Pourquoi se le refuserait-il ? Les insurrections lui en savent gré et les gouvernements le lui passant. Vous savez que c’est dans la baie de Torquay qu'a débarqué Guillaume 3 arrivant en Angleterre. Je suppose que la baie est aussi bonne pour l'embarquement que pour le débarquement.
Le journal l'Ordre annonçait hier bien qu'avec un peu de réserve et d’embarras, la candidature de M. le Prince de Joinville. Pour le parti, cela me paraît une grosse faute ; si cette candidature est jetée dans le public et débattue longtemps d'avance, elle sera usée avant d’être sérieuse. Il me semble que la formation de la Commission permanente et la majorité qui l’a formée jettent un grand désarroi dans les coteries des impatients. Leurs journaux sont non seulement irrités, mais troublés.
10 heures
Je suis fâché qu'Ems ne vous réussisse pas aussi bien que l'an dernier. Le duc de Noailles aura vu qu’il avait tort de se plaindre. Je crois en effet que l’Elysée est content de la majorité ; mais je ne crois pas que la seconde discussion amène un résultat différent. Adieu et Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 8 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, vendredi 8 août 1851
Pardonnez-moi ce petit papier ; j'ai été hier tout le jour et je suis encore aujourd’hui parfaitement stupide. Rien absolument qu’un rhume de cerveau doublé hier soir d’une migraine que m'a donnée un violent orage. Je n’ai jamais vu le ciel tout à coup si noir. Mais cette noirceur a avorté, comme tant d'autres de nos jours : nous avons eu peu de bruit, peu de pluie, et j’ai été me coucher à 9 heures après avoir perdu deux robbers de whist, seule occupation et seul plaisir dont je fusse capable. Je serai encore lourd toute la journée ; demain matin, il n’y paraîtra plus et demain soir je vais à Paris où je resterai jusqu'à mardi soir.
Je lis dans les journaux que le luncheon du Président aux Anglais a été très brillant. On m'écrit le contraire. " Une affreuse mêlée ; 250 couverts et 3000 affamés. Je me suis arrangé pour être du petit nombre des élus ; mais les élus étaient, si serrés qu'ils ne se croyaient pas du tout en Paradis. "
Je crois que vous me recevez plus le National. Je suis frappé de sa phrase pour recommander, le désintéressement à toutes les nuances de l'opinion républicaine en fait de candidature à la Présidence de la République et pour les engager toutes à accepter celui qui aura le plus de chances d'être élu, " quel qu’il soit " Rapprochez ceci de l'accord qui s'est établi à Londres, entre M. Emile de Girardin et M. Ledru Rollin : " Nous sommes d'accord sur tous les points ".
N'entrevoyez-vous pas là le travail qui se fait de ce côté pour la candidature de Prince de Joinville ? Renverser ce qui existe aujourd’hui, et amener une tempête ; n'importe à quel prix, et à quel profit ; tous se promettent le gros lot au sein du grand bruit. Quel spectacle et quelle honte s'ils vont jusqu'au bout ! Je n’y puis croire ; mais j'y regarde très attentivement.
Onze heures
J’attendais impatiemment si votre tête serait guérie. Il faut encore attendre. C'est ennuyeux Adieu, adieu, la seconde cloche sonne pour le déjeuner. Adieu. G.
Pardonnez-moi ce petit papier ; j'ai été hier tout le jour et je suis encore aujourd’hui parfaitement stupide. Rien absolument qu’un rhume de cerveau doublé hier soir d’une migraine que m'a donnée un violent orage. Je n’ai jamais vu le ciel tout à coup si noir. Mais cette noirceur a avorté, comme tant d'autres de nos jours : nous avons eu peu de bruit, peu de pluie, et j’ai été me coucher à 9 heures après avoir perdu deux robbers de whist, seule occupation et seul plaisir dont je fusse capable. Je serai encore lourd toute la journée ; demain matin, il n’y paraîtra plus et demain soir je vais à Paris où je resterai jusqu'à mardi soir.
Je lis dans les journaux que le luncheon du Président aux Anglais a été très brillant. On m'écrit le contraire. " Une affreuse mêlée ; 250 couverts et 3000 affamés. Je me suis arrangé pour être du petit nombre des élus ; mais les élus étaient, si serrés qu'ils ne se croyaient pas du tout en Paradis. "
Je crois que vous me recevez plus le National. Je suis frappé de sa phrase pour recommander, le désintéressement à toutes les nuances de l'opinion républicaine en fait de candidature à la Présidence de la République et pour les engager toutes à accepter celui qui aura le plus de chances d'être élu, " quel qu’il soit " Rapprochez ceci de l'accord qui s'est établi à Londres, entre M. Emile de Girardin et M. Ledru Rollin : " Nous sommes d'accord sur tous les points ".
N'entrevoyez-vous pas là le travail qui se fait de ce côté pour la candidature de Prince de Joinville ? Renverser ce qui existe aujourd’hui, et amener une tempête ; n'importe à quel prix, et à quel profit ; tous se promettent le gros lot au sein du grand bruit. Quel spectacle et quelle honte s'ils vont jusqu'au bout ! Je n’y puis croire ; mais j'y regarde très attentivement.
Onze heures
J’attendais impatiemment si votre tête serait guérie. Il faut encore attendre. C'est ennuyeux Adieu, adieu, la seconde cloche sonne pour le déjeuner. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 15 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Vendredi 15 Août 1851
Je suis charmé que vous ayez eu le plaisir de revoir votre grande Duchesse. Vous y avez eu évidemment un grand plaisir. Les Princes ont bien tort quand ils ne sont pas charmants ; ils gagnent tant à l'être, et si vite, et si aisément ! J’espère que la Grande Duchesse vous aidera à faire à Pétersbourg, les affaires de votre fils Alexandre.
Je ne comprends pas bien en ce moment les motifs du dernier Ukase ; l'état de l’occident n’a rien de tentant pour ceux qui viennent y regarder. Si c'était vos paysans qui y vinssent, ou vos petits marchands, je verrais le péril, et je comprendrais la rigueur des précautions ; mais ses riches, des grands seigneurs, je ne vois pas où est pour eux, parmi nous la séduction.
Que dites-vous de l’incendie des Invalides pendant les obsèques du Maréchal Sebastiani ? Et que n'aurait-on pas dit si pareille chose fût arrivée sous la Monarchie ? La République n’a pas de bonheur ; mais elle s'en passe. Le spectacle a dû être très frappant. Ce qui m’en a le plus frappé, c’est le curé éperdu et criant avec passion " Le Maréchal, Messieurs ; sauvez le maréchal ! " La cérémonie profane par la destruction prématurée et violente de ce corps. C'était là son idée fixe. Bel empire des sentiments et des devoirs d'État !
// Vous ai-je dit que j’ai eu à Paris de nouvelles du Général Changarnier ? Il est parti brusquement avant le dernier jour sans voir personne ; il est chez lui, à Autun, inquiet et triste, très blessé du travail pour la candidature du Prince de Joinville, entrevoyant qu’il a fait fausse route, et qu’il n’arrivera pas, mais ne faisant encore qu'entrevoir. Il n’a pas assez d'esprit pour tant de passion. Son journal, le Messager de l'Assemblée, reste toujours dans la même ligne, malveillant pour Berryer, et impuissant à faire, de M. de St Priest, le chef des légitimistes mais y poussant toujours. Le Duc de Lévis et M. de St Priest ont été fort troublés de l'explosion de la guerre civile dans le parti ; mais le résultat est excellent ; les dissidents sentent la nécessité d’un mouvement de retraite et commencent à l'exécuter. Ils sont trop peu nombreux et trop peu considérables pour faire prospérer la séparation. Berryer, et M. de Falloux ont fait là un coup de partie ; ils en recueilleront le fruit, eux et leur monde, dans les élections prochaines. //
Les journaux deviennent plus curieux à lire. Ils se dessinent tous plus nettement ; pour qui sait les comprendre du moins, car ils n'ont jamais été plus artificieux, ni plus menteurs. L’Ordre en particulier, le journal Régentiste, est dans une activité et une anxiété singulière ; il a pour la candidature du Prince de Joinville ; les ardeurs, les impatiences, les méfiances, les tours et détours du Messager pour celle du général Changarnier, et du Pays pour celle de M. de Lamartine. Une vraie Steeple- chase.
10 heures
Vous ne me donnez point de nouvelle instruction, en retournant à Schlangenbad. Je continue donc à adresser mes lettres à Francfort. Je ne me rappelle pas du tout ce qu’il y avait dans les deux qui se sont perdues. Lire les lettre c’est déjà quelque chose ; mais les voler après les avoir lues. Cela ne se fait jamais en France. Adieu, adieu. G.
Je suis charmé que vous ayez eu le plaisir de revoir votre grande Duchesse. Vous y avez eu évidemment un grand plaisir. Les Princes ont bien tort quand ils ne sont pas charmants ; ils gagnent tant à l'être, et si vite, et si aisément ! J’espère que la Grande Duchesse vous aidera à faire à Pétersbourg, les affaires de votre fils Alexandre.
Je ne comprends pas bien en ce moment les motifs du dernier Ukase ; l'état de l’occident n’a rien de tentant pour ceux qui viennent y regarder. Si c'était vos paysans qui y vinssent, ou vos petits marchands, je verrais le péril, et je comprendrais la rigueur des précautions ; mais ses riches, des grands seigneurs, je ne vois pas où est pour eux, parmi nous la séduction.
Que dites-vous de l’incendie des Invalides pendant les obsèques du Maréchal Sebastiani ? Et que n'aurait-on pas dit si pareille chose fût arrivée sous la Monarchie ? La République n’a pas de bonheur ; mais elle s'en passe. Le spectacle a dû être très frappant. Ce qui m’en a le plus frappé, c’est le curé éperdu et criant avec passion " Le Maréchal, Messieurs ; sauvez le maréchal ! " La cérémonie profane par la destruction prématurée et violente de ce corps. C'était là son idée fixe. Bel empire des sentiments et des devoirs d'État !
// Vous ai-je dit que j’ai eu à Paris de nouvelles du Général Changarnier ? Il est parti brusquement avant le dernier jour sans voir personne ; il est chez lui, à Autun, inquiet et triste, très blessé du travail pour la candidature du Prince de Joinville, entrevoyant qu’il a fait fausse route, et qu’il n’arrivera pas, mais ne faisant encore qu'entrevoir. Il n’a pas assez d'esprit pour tant de passion. Son journal, le Messager de l'Assemblée, reste toujours dans la même ligne, malveillant pour Berryer, et impuissant à faire, de M. de St Priest, le chef des légitimistes mais y poussant toujours. Le Duc de Lévis et M. de St Priest ont été fort troublés de l'explosion de la guerre civile dans le parti ; mais le résultat est excellent ; les dissidents sentent la nécessité d’un mouvement de retraite et commencent à l'exécuter. Ils sont trop peu nombreux et trop peu considérables pour faire prospérer la séparation. Berryer, et M. de Falloux ont fait là un coup de partie ; ils en recueilleront le fruit, eux et leur monde, dans les élections prochaines. //
Les journaux deviennent plus curieux à lire. Ils se dessinent tous plus nettement ; pour qui sait les comprendre du moins, car ils n'ont jamais été plus artificieux, ni plus menteurs. L’Ordre en particulier, le journal Régentiste, est dans une activité et une anxiété singulière ; il a pour la candidature du Prince de Joinville ; les ardeurs, les impatiences, les méfiances, les tours et détours du Messager pour celle du général Changarnier, et du Pays pour celle de M. de Lamartine. Une vraie Steeple- chase.
10 heures
Vous ne me donnez point de nouvelle instruction, en retournant à Schlangenbad. Je continue donc à adresser mes lettres à Francfort. Je ne me rappelle pas du tout ce qu’il y avait dans les deux qui se sont perdues. Lire les lettre c’est déjà quelque chose ; mais les voler après les avoir lues. Cela ne se fait jamais en France. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Lundi 15 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Lundi 15 sept 1851
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 27 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Lundi 27 octobre 1851
4 heures
Je suis toujours bien aise de rentrer chez moi même quand il m'a réussi d'en sortir. Voilà trois jours que je vous écris bien sottement. J’ai fait hier à Falaise, tout le jour une vraie mission pour la fusion ; presque sans en parler, mais parfaitement compris de tout le monde ; conservateurs et légitimistes que j'ai laissés tout contents de moi, et d’eux-mêmes. L’un ne va guère sans d'autre. Avec du temps, beaucoup de temps, et en y prenant beaucoup de peine ; et avec l'aide de beaucoup de malheur et de beaucoup de peur, on pourra arriver à quelque chose. Les incidents dérangeront et précipiteront. Si tant est que les incidents dérangent le véritable cours de l'eau, le cours du fond. Nous vivons et nous nous remuons à la surface ; mais ce n'est pas à surface que se préparent et se décident les grands événements. Quels que soient les incidents, nous marchons à la monarchie par la fusion ou à la décadence par la République. Voilà les deux courants profonds qui sont, aux prises. Lequel des deux l'emportera ? Mon raisonnement est pour la crainte et mon instinct pour l'espérance.
Dans tout le monde que j'ai vu depuis les plus considérables jusqu'aux moindres, et soit bienveillants, soit malveillants, la situation du Président est mauvaise. On a porté sa santé au banquet, le maire de la ville, mon hôte. Un silence universel lui a répondu à la lettre. Le Préfet qui était là, s’en est tiré en homme d’esprit, et en répondant au toast qui lui était porté à lui-même ; il a parlé du Président, de l'appui qu’il avait donné au parti de l'ordre et qu'il avait trouvé dans le parti de l'ordre, en termes trés convenables qui ont été applaudis. Beaucoup de blâme, point de rancune, voilà la disposition. Jusqu'au dernier moment la transaction sera toujours possible et j'y crois toujours. Je n'ai jamais été plus applaudi. Les ennemis n’applaudissaient pas, mais ils approuvaient du geste les amis qui applaudissaient. Les Conservateurs, pris en masse, m'aiment vraiment ; et ceux-là même, qui n'ont nul goût pour la fusion me sont, au fond, gré de la vouloir et trouvant que j'ai raison.
J’attends toujours la lettre du duc de Noailles. Pour mon langage à quelques personnes, il m'importe un peu de savoir jusqu'à quel point M. de St Priest, M. Nettement et tout ce côté du parti, désavouent ou ne désavouent pas les bruits dont je vous ai parlé. Comme il n’y a plus aujourd'hui rien d'étrange ni de ridicule, il ne faut pas laisser passer. Sans y regarder ce qui paraît le plus étrange et le plus ridicule.
Je répète que je ne puis pas ne pas croire qu'on fera à Claremont ce qui convient. On aura bien pesé que M. le comte de Chambord n’en tire trop de parti et ne les mette dans un grand embarras. Mais je tiens pour impossible que cette peur arrête. Je crois que Montebello a bien fait de n'y pas aller. On ne fait pas ce qui déplaît sans déplaire ; surtout quand on veut le faire efficacement, et de manière à empêcher ce qui plairait.
Voici ce que j'ai écrit au sujet de cet incident du Times, au général Trézel, après lui avoir parlé de mes raisons contre la candidature du Prince ; je suis bien aise que vous le connaissiez textuellement. " Je suis absolument étranger, indirectement comme directement, à la correspondance du Times qui a raconté, bien ou mal, ma conversation avec M. le duc de Nemours. Je ne me permettrais jamais une telle inconvenance. Ce qui est vrai, c'est que, soit à Londres, soit à Paris, j'ai redit moi-même à plusieurs personnes le fond de cette conversation. A dessein, et par plusieurs motifs. D'abord, parce qu'opposé comme je le suis à la candidature de M. le Prince de Joinville, j'ai désiré que mon opinion fût connue, et qu’il fût connu aussi que je l'avais exprimée à la famille royale ; nous ne pouvons et ne devons agir librement qu'après avoir dit aux Princes ce que nous pensons et quand on sait que nous le leur avons dit. J'espérais de plus que la publicité de notre opinion rendrait peut-être un peu plus incertaine la publicité de cette candidature elle-même et comme je désire qu’elle ne le produise pas décidément je n'hésite point à faire ce qui peut y jeter quelque hésitation. Enfin, quoique je trouve que les Princes ont tout-à-fait raison de se tenir et de se montrer très unis, je ne regrette point qu’on sache, et je crois même qu’il est bon pour leur avenir qu’on sache qu’au fond ils ne sont pas tous du même avis, ni sur la même pente. Je trouve fort simple que parmi eux, quelques uns dressent leur tente au milieu de l'ancienne opposition au gouvernement du Roi leur père ; mais je ne pense pas que les chances de leur cause aient à souffrir si, parmi eux aussi, il y a encore les alliés fidèles de l'ancien parti conservateur, et si les conservateurs en sont convaincus. Voilà, mon cher général, pourquoi j’ai parlé assez ouvertement de la conversation que j’ai eu l'honneur d'avoir avec M. le Duc de Nemours. Je n’ai pas le droit de m'étonner qu’il en soit revenu quelque chose aux correspondants du Times, à Paris, et qu’ils l’aient racontée confusément et inexactement comme ils l'ont fait. Je le regrette puisqu’on l’a regretté à Claremont ; mais je ne puis pas ne pas penser que, pour la bonne politique de la bonne cause la candidature de M. le Prince de Joinville serait infiniment plus nuisible qu’il ne peut l'être qu'on entrevoie que M. le Duc de Nemours n'en est pas tout-à-fait d'avis."
Adieu jusqu'à demain.
J’ai trouvé vos deux lettres en arrivant ici Onze heures Le cabinet n’a rien d'effrayant, Tout ceci finira par une transaction. Mais j'attends Pétersbourg. Je ne peux croire ni au refus, ni au silence. Si cela arrive ! Adieu, Adieu. G.
4 heures
Je suis toujours bien aise de rentrer chez moi même quand il m'a réussi d'en sortir. Voilà trois jours que je vous écris bien sottement. J’ai fait hier à Falaise, tout le jour une vraie mission pour la fusion ; presque sans en parler, mais parfaitement compris de tout le monde ; conservateurs et légitimistes que j'ai laissés tout contents de moi, et d’eux-mêmes. L’un ne va guère sans d'autre. Avec du temps, beaucoup de temps, et en y prenant beaucoup de peine ; et avec l'aide de beaucoup de malheur et de beaucoup de peur, on pourra arriver à quelque chose. Les incidents dérangeront et précipiteront. Si tant est que les incidents dérangent le véritable cours de l'eau, le cours du fond. Nous vivons et nous nous remuons à la surface ; mais ce n'est pas à surface que se préparent et se décident les grands événements. Quels que soient les incidents, nous marchons à la monarchie par la fusion ou à la décadence par la République. Voilà les deux courants profonds qui sont, aux prises. Lequel des deux l'emportera ? Mon raisonnement est pour la crainte et mon instinct pour l'espérance.
Dans tout le monde que j'ai vu depuis les plus considérables jusqu'aux moindres, et soit bienveillants, soit malveillants, la situation du Président est mauvaise. On a porté sa santé au banquet, le maire de la ville, mon hôte. Un silence universel lui a répondu à la lettre. Le Préfet qui était là, s’en est tiré en homme d’esprit, et en répondant au toast qui lui était porté à lui-même ; il a parlé du Président, de l'appui qu’il avait donné au parti de l'ordre et qu'il avait trouvé dans le parti de l'ordre, en termes trés convenables qui ont été applaudis. Beaucoup de blâme, point de rancune, voilà la disposition. Jusqu'au dernier moment la transaction sera toujours possible et j'y crois toujours. Je n'ai jamais été plus applaudi. Les ennemis n’applaudissaient pas, mais ils approuvaient du geste les amis qui applaudissaient. Les Conservateurs, pris en masse, m'aiment vraiment ; et ceux-là même, qui n'ont nul goût pour la fusion me sont, au fond, gré de la vouloir et trouvant que j'ai raison.
J’attends toujours la lettre du duc de Noailles. Pour mon langage à quelques personnes, il m'importe un peu de savoir jusqu'à quel point M. de St Priest, M. Nettement et tout ce côté du parti, désavouent ou ne désavouent pas les bruits dont je vous ai parlé. Comme il n’y a plus aujourd'hui rien d'étrange ni de ridicule, il ne faut pas laisser passer. Sans y regarder ce qui paraît le plus étrange et le plus ridicule.
Je répète que je ne puis pas ne pas croire qu'on fera à Claremont ce qui convient. On aura bien pesé que M. le comte de Chambord n’en tire trop de parti et ne les mette dans un grand embarras. Mais je tiens pour impossible que cette peur arrête. Je crois que Montebello a bien fait de n'y pas aller. On ne fait pas ce qui déplaît sans déplaire ; surtout quand on veut le faire efficacement, et de manière à empêcher ce qui plairait.
Voici ce que j'ai écrit au sujet de cet incident du Times, au général Trézel, après lui avoir parlé de mes raisons contre la candidature du Prince ; je suis bien aise que vous le connaissiez textuellement. " Je suis absolument étranger, indirectement comme directement, à la correspondance du Times qui a raconté, bien ou mal, ma conversation avec M. le duc de Nemours. Je ne me permettrais jamais une telle inconvenance. Ce qui est vrai, c'est que, soit à Londres, soit à Paris, j'ai redit moi-même à plusieurs personnes le fond de cette conversation. A dessein, et par plusieurs motifs. D'abord, parce qu'opposé comme je le suis à la candidature de M. le Prince de Joinville, j'ai désiré que mon opinion fût connue, et qu’il fût connu aussi que je l'avais exprimée à la famille royale ; nous ne pouvons et ne devons agir librement qu'après avoir dit aux Princes ce que nous pensons et quand on sait que nous le leur avons dit. J'espérais de plus que la publicité de notre opinion rendrait peut-être un peu plus incertaine la publicité de cette candidature elle-même et comme je désire qu’elle ne le produise pas décidément je n'hésite point à faire ce qui peut y jeter quelque hésitation. Enfin, quoique je trouve que les Princes ont tout-à-fait raison de se tenir et de se montrer très unis, je ne regrette point qu’on sache, et je crois même qu’il est bon pour leur avenir qu’on sache qu’au fond ils ne sont pas tous du même avis, ni sur la même pente. Je trouve fort simple que parmi eux, quelques uns dressent leur tente au milieu de l'ancienne opposition au gouvernement du Roi leur père ; mais je ne pense pas que les chances de leur cause aient à souffrir si, parmi eux aussi, il y a encore les alliés fidèles de l'ancien parti conservateur, et si les conservateurs en sont convaincus. Voilà, mon cher général, pourquoi j’ai parlé assez ouvertement de la conversation que j’ai eu l'honneur d'avoir avec M. le Duc de Nemours. Je n’ai pas le droit de m'étonner qu’il en soit revenu quelque chose aux correspondants du Times, à Paris, et qu’ils l’aient racontée confusément et inexactement comme ils l'ont fait. Je le regrette puisqu’on l’a regretté à Claremont ; mais je ne puis pas ne pas penser que, pour la bonne politique de la bonne cause la candidature de M. le Prince de Joinville serait infiniment plus nuisible qu’il ne peut l'être qu'on entrevoie que M. le Duc de Nemours n'en est pas tout-à-fait d'avis."
Adieu jusqu'à demain.
J’ai trouvé vos deux lettres en arrivant ici Onze heures Le cabinet n’a rien d'effrayant, Tout ceci finira par une transaction. Mais j'attends Pétersbourg. Je ne peux croire ni au refus, ni au silence. Si cela arrive ! Adieu, Adieu. G.
Brompton, Samedi 11 novembre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Samedi 11 nov. 1848
7 heures
Je me lève. Le jour commence. Je viens d'allumer mon feu. Puis à vous. Je vais déjeuner ce matin chez Macaulay, avec Lord Mahon et quelques oiseaux de passage à Londres. Avez-vous froid à Brighton ? Il faisait froid hier ici, par un beau soleil. J'espère qu’il ne faisait pas froid à Brighton.
J’ai vu du monde hier chez moi, car je ne sors point. M. Vitet, très longtemps. Il était venu la première fois avec Duchâtel, son ami d’enfance, et son patron politique spécial. On ne cause librement que tête à tête. Je l'ai trouvé hier très intelligent et très sensé. Convaincu qu’il n’y a de bon et d'efficace que la fusion. Parce que cela seul peut être fort, et que cela seul est nouveau. Il n’y a pas moyen, de part ni d'autre, de ne faire autre chose que recommencer. Mais la fusion est horriblement difficile. Les nôtres y sont les plus récalcitrants. Ils croient plus que les autres qu'ils peuvent s’en passer. Quoiqu'on ne parle pas des Princes, ni des Orléanistes, au fond, c’est là ce qui est dans la pensée de la grande majorité. Il faut plus de temps et plus de mal pour leur faire accepter la raison. Elle n’a pas encore la figure de la nécessité.
Les derniers venus d'Eisenach rapportent un mauvais langage. Sémiramis ne veut pas partager ses grandes destinées. D'un autre côté, le duc de Noailles a parlé à Mad. Lenormant en homme assez découragé, qui rencontrait parmi les siens, bien peu d’intelligence et beaucoup d'obstacles. Vous avez vu que sa lettre est pourtant pressante. Evidemment tout est encore loin, par conséquent vague et obscur. L'avenir le plus prochain et le plus pratique est l’élection d’une nouvelle Assemblée. C'est à cela qu’il faut penser et travailler dès aujourd’hui. Elle videra la question. Pour ces élections-là, les deux partis monarchiques sont très décidés à agir de concert. Je vous envoie là pêle-mêle ce qu’on me dit et mes réflexions.
Hier soir, Lavalette et sa femme qui repartent aujourd'hui pour Paris, et de là pour une terre qu'ils ont près de Bordeaux. Et près de Bugeaud chez qui ils vont passer deux jours. Lavalette revenait de Richmond. Il avait trouvé le Roi bien, la Reine mieux, le Prince de Joinville, malade, le Duc d’Aumale repris et dans son lit. Il avait été content du dernier. Le Roi triste parce qu'on ne lui envoie pas d’argent de Paris. On ne veut lui donner de l'argent ni sa vaisselle, que lorsqu’il aura fait son emprunt pour payer ses dettes. Et l’emprunt n’est pas encore fait. Un brave amiral, que le Roi a connu jadis et dont Lavalette avait oublié le nom, était venu le matin à Richmond, offrir au Roi dix mille louis, avec toute la franchise et la shyness anglaises.
Je n'ai point eu de lettres. Merci de celle que vous avez pris la peine de copier pour moi. Amusantes. Quels subalternes ! Je ne les ai montrées à personne. Montebello m’a écrit hier matin. Il me donnera tous les jours des nouvelles du Roi, tant qu'ils seront là. Vous n'aurez peut-être pas remarqué dans les Débats d’hier un petit article sur les élections du Calvados, emprunté à un Journal de Caen. Ce que j’ai écrit a fait son effet. On ne me portera point. On portera un légitimiste que je connais un peu, honnête homme et assez distingué.
J’ai eu des nouvelles de Turin et de Florence. Charles Albert persiste à regarder un conflit entre lui et les Autrichiens comme inévitable. La république le talonne plus que jamais. Gênes est de plus en plus menaçant. Il est tout seul. On le laissera tout seul. Mais on le poussera sur le champ de bataille. Tout son désir, c’est que le premier boulet y soit pour lui. Il disait tout cela il y a huit jours. A Florence, le grand Duc a été sur le point de s'enfuir, et n'y a pas renoncé. L’anarchie est au comble. On a de la peine à écrire d’une ville à l'autre. Il faut des occasions. Adieu. Adieu.
C'est mardi que j'espère aller vous voir. Pour revenir mercredi matin. J'attends une lettre de Sir Robert Peel. Mais je compte toujours aller vendredi à Drayton. Adieu, Adieu.
7 heures
Je me lève. Le jour commence. Je viens d'allumer mon feu. Puis à vous. Je vais déjeuner ce matin chez Macaulay, avec Lord Mahon et quelques oiseaux de passage à Londres. Avez-vous froid à Brighton ? Il faisait froid hier ici, par un beau soleil. J'espère qu’il ne faisait pas froid à Brighton.
J’ai vu du monde hier chez moi, car je ne sors point. M. Vitet, très longtemps. Il était venu la première fois avec Duchâtel, son ami d’enfance, et son patron politique spécial. On ne cause librement que tête à tête. Je l'ai trouvé hier très intelligent et très sensé. Convaincu qu’il n’y a de bon et d'efficace que la fusion. Parce que cela seul peut être fort, et que cela seul est nouveau. Il n’y a pas moyen, de part ni d'autre, de ne faire autre chose que recommencer. Mais la fusion est horriblement difficile. Les nôtres y sont les plus récalcitrants. Ils croient plus que les autres qu'ils peuvent s’en passer. Quoiqu'on ne parle pas des Princes, ni des Orléanistes, au fond, c’est là ce qui est dans la pensée de la grande majorité. Il faut plus de temps et plus de mal pour leur faire accepter la raison. Elle n’a pas encore la figure de la nécessité.
Les derniers venus d'Eisenach rapportent un mauvais langage. Sémiramis ne veut pas partager ses grandes destinées. D'un autre côté, le duc de Noailles a parlé à Mad. Lenormant en homme assez découragé, qui rencontrait parmi les siens, bien peu d’intelligence et beaucoup d'obstacles. Vous avez vu que sa lettre est pourtant pressante. Evidemment tout est encore loin, par conséquent vague et obscur. L'avenir le plus prochain et le plus pratique est l’élection d’une nouvelle Assemblée. C'est à cela qu’il faut penser et travailler dès aujourd’hui. Elle videra la question. Pour ces élections-là, les deux partis monarchiques sont très décidés à agir de concert. Je vous envoie là pêle-mêle ce qu’on me dit et mes réflexions.
Hier soir, Lavalette et sa femme qui repartent aujourd'hui pour Paris, et de là pour une terre qu'ils ont près de Bordeaux. Et près de Bugeaud chez qui ils vont passer deux jours. Lavalette revenait de Richmond. Il avait trouvé le Roi bien, la Reine mieux, le Prince de Joinville, malade, le Duc d’Aumale repris et dans son lit. Il avait été content du dernier. Le Roi triste parce qu'on ne lui envoie pas d’argent de Paris. On ne veut lui donner de l'argent ni sa vaisselle, que lorsqu’il aura fait son emprunt pour payer ses dettes. Et l’emprunt n’est pas encore fait. Un brave amiral, que le Roi a connu jadis et dont Lavalette avait oublié le nom, était venu le matin à Richmond, offrir au Roi dix mille louis, avec toute la franchise et la shyness anglaises.
Je n'ai point eu de lettres. Merci de celle que vous avez pris la peine de copier pour moi. Amusantes. Quels subalternes ! Je ne les ai montrées à personne. Montebello m’a écrit hier matin. Il me donnera tous les jours des nouvelles du Roi, tant qu'ils seront là. Vous n'aurez peut-être pas remarqué dans les Débats d’hier un petit article sur les élections du Calvados, emprunté à un Journal de Caen. Ce que j’ai écrit a fait son effet. On ne me portera point. On portera un légitimiste que je connais un peu, honnête homme et assez distingué.
J’ai eu des nouvelles de Turin et de Florence. Charles Albert persiste à regarder un conflit entre lui et les Autrichiens comme inévitable. La république le talonne plus que jamais. Gênes est de plus en plus menaçant. Il est tout seul. On le laissera tout seul. Mais on le poussera sur le champ de bataille. Tout son désir, c’est que le premier boulet y soit pour lui. Il disait tout cela il y a huit jours. A Florence, le grand Duc a été sur le point de s'enfuir, et n'y a pas renoncé. L’anarchie est au comble. On a de la peine à écrire d’une ville à l'autre. Il faut des occasions. Adieu. Adieu.
C'est mardi que j'espère aller vous voir. Pour revenir mercredi matin. J'attends une lettre de Sir Robert Peel. Mais je compte toujours aller vendredi à Drayton. Adieu, Adieu.
Val-Richer, Samedi 6 mars 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 6 mars 1851
L’article du Constitutionnel est en effet très remarquable, et celui de l’Univers peut-être encore plus. Armand Bertin doit être bien perplexe. Je crains beaucoup qu’il ne finisse par tomber du mauvais côté. Par camaraderie et par faiblesse plutôt qu'avec confiance et par goût. Même dans ce cas, je doute fort qu’il prête un appui bien énergique et bien actif. La désapprobation percera à travers l'apologie. De tout ceci, quoi qu’il arrive il restera toujours un grand mal ; une recrudescence de désunion et d'aigreur dans les partis monarchiques, et des Princes très compromis et affaiblis. Si la République était viable, elle aurait bien des chances de vivre. Étrange pays où il se fait au même moment des mouvements en sens contraires ; c’est au moment où, dans l’Assemblée et dans les Conseils Généraux, les deux grands camps monarchiques, se rapprochent, et agissent ensemble, que dans la région princière, l’esprit de division et de politique égoïste pénètre et prévaut. M. Royer Collard disait souvent, en parlant de Thiers : " Ce sera l'homme fatal de la Monarchie de Juillet, et si on le laisse faire de la France ! Nous verrons si la seconde moitié de la prédiction s'accomplira. J'espère toujours que non.
Est-ce que vous n'avez pas revu le Général Changarnier. A part l’intérêt positif, qui est grand, il y a, dans cet homme, un problème qui excite vivement ma curiosité. S’il était vraiment sincère et décidé dans ce qu’il nous dit, il y aurait un grand parti à tirer de lui, précisément dans le trouble actuel.
Qu’entendez-vous dire de la Belgique depuis que la loi sur les successions directes a été rejetée par le Sénat ?
J'irai le 16 ou le 17 passer huit ou dix jours à Broglie. Tout ce qui me revient de la disposition du duc en bon ; s’il n'est pas décidé pour le bon côté, il l’est tout-à-fait contre le mauvais.
Je viens de lire les deux volumes d'Histoire de la Restauration de M. de Lamartine. Grand pamphlet politique comme l'histoire des Girondins. D'abord pour gagner de l'argent, puis pour faire de l'effet théâtral, puis, pour servir à la situation personnelle de l’auteur, puis pour nuire à la Restauration comparée à la République, puis pour nuire surtout à la Monarchie de Juillet comparée à la République et à la Restauration. Grande profusion d’esprit et de talent sur un chaos continu de vrai et de faux. C'est certainement un homme très remarquable. Il a l'abondance et l'éclat. Il se promène magnifiquement à la surface des choses. Au fond, artisan de désordre. Je crois pourtant qu’à tout prendre ce livre-ci fera plutôt du bien que du mal. Mais s’il le continue sur ces dimensions là, il fera vingt volumes.
10 heures
L’article de ce matin dans les Débats me plaît fort. Il éluderont la polémique, au lieu de l'y enfoncer, et je suis charmé que ma conversation y soit répétée. J'étais bien sûr que j’avais raison de parler. Je ne concevais pas mon silence. Adieu. Adieu. Je vous dirai ce que j'écrirai à Lord Aberdeen. Mais le Prince de Schwartzenberg à tort de dire de lui ce qu’il en dit ; il ne faut pas jeter ainsi le manche après la cognée à la tête de ses amis. Adieu G.
L’article du Constitutionnel est en effet très remarquable, et celui de l’Univers peut-être encore plus. Armand Bertin doit être bien perplexe. Je crains beaucoup qu’il ne finisse par tomber du mauvais côté. Par camaraderie et par faiblesse plutôt qu'avec confiance et par goût. Même dans ce cas, je doute fort qu’il prête un appui bien énergique et bien actif. La désapprobation percera à travers l'apologie. De tout ceci, quoi qu’il arrive il restera toujours un grand mal ; une recrudescence de désunion et d'aigreur dans les partis monarchiques, et des Princes très compromis et affaiblis. Si la République était viable, elle aurait bien des chances de vivre. Étrange pays où il se fait au même moment des mouvements en sens contraires ; c’est au moment où, dans l’Assemblée et dans les Conseils Généraux, les deux grands camps monarchiques, se rapprochent, et agissent ensemble, que dans la région princière, l’esprit de division et de politique égoïste pénètre et prévaut. M. Royer Collard disait souvent, en parlant de Thiers : " Ce sera l'homme fatal de la Monarchie de Juillet, et si on le laisse faire de la France ! Nous verrons si la seconde moitié de la prédiction s'accomplira. J'espère toujours que non.
Est-ce que vous n'avez pas revu le Général Changarnier. A part l’intérêt positif, qui est grand, il y a, dans cet homme, un problème qui excite vivement ma curiosité. S’il était vraiment sincère et décidé dans ce qu’il nous dit, il y aurait un grand parti à tirer de lui, précisément dans le trouble actuel.
Qu’entendez-vous dire de la Belgique depuis que la loi sur les successions directes a été rejetée par le Sénat ?
J'irai le 16 ou le 17 passer huit ou dix jours à Broglie. Tout ce qui me revient de la disposition du duc en bon ; s’il n'est pas décidé pour le bon côté, il l’est tout-à-fait contre le mauvais.
Je viens de lire les deux volumes d'Histoire de la Restauration de M. de Lamartine. Grand pamphlet politique comme l'histoire des Girondins. D'abord pour gagner de l'argent, puis pour faire de l'effet théâtral, puis, pour servir à la situation personnelle de l’auteur, puis pour nuire à la Restauration comparée à la République, puis pour nuire surtout à la Monarchie de Juillet comparée à la République et à la Restauration. Grande profusion d’esprit et de talent sur un chaos continu de vrai et de faux. C'est certainement un homme très remarquable. Il a l'abondance et l'éclat. Il se promène magnifiquement à la surface des choses. Au fond, artisan de désordre. Je crois pourtant qu’à tout prendre ce livre-ci fera plutôt du bien que du mal. Mais s’il le continue sur ces dimensions là, il fera vingt volumes.
10 heures
L’article de ce matin dans les Débats me plaît fort. Il éluderont la polémique, au lieu de l'y enfoncer, et je suis charmé que ma conversation y soit répétée. J'étais bien sûr que j’avais raison de parler. Je ne concevais pas mon silence. Adieu. Adieu. Je vous dirai ce que j'écrirai à Lord Aberdeen. Mais le Prince de Schwartzenberg à tort de dire de lui ce qu’il en dit ; il ne faut pas jeter ainsi le manche après la cognée à la tête de ses amis. Adieu G.
Mots-clés : Histoire (France), Lecture, Politique (France), Portrait, République, Réseau social et politique
Val-Richer, Mardi 24 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 24 sept. 1850
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Je suis un peu fatigué ce matin. Un mouvement de bile. Mon repos et un peu de diète m'en débarrasseront en deux jours. Plus j’y pense, plus je suis frappé de l'énorme malhabileté de cette circulaire et de l’excellente occasion ainsi manquée. On pouvait se poser (comme on dit aujourd’hui) à merveille, et on reste très mal posé, plus mal qu’auparavant. C'est savoir bien peu profiter de sa propre sagesse. M. le comte de Chambord se tient tranquille ; il ne veut ni conspiration, ni guerre civile, ni guerre Européenne. Il attend que la France sente elle-même qu’elle ne peut se passer de la Monarchie, et qu’il n’y a pas pour elle deux Monarchies. Quand la France sentira vraiment cela, elle le reconnaitra, tout haut. Comment ? Par qui ? Personne ne le sait aujourd’hui ; mais la France saura bien le trouver quand il le faudra absolument. Et quand la France aura reconnu cela, la monarchie sera rétablie. Voilà ce que dit la conduite qu'on tient. Il n’y avait rien de si aisé que de l’écrire; rien de si aisé que de repousser ainsi l’appel au peuple de M. de La Rochejaquelein, et de maintenir le droit monarchique sans offenser le droit national, bien mieux en le respectant et en agréant au sentiment public. On pouvait faire cela, et on fait ce que vous voyez ! J’ai peur que cette maladresse particulière ne soit le symptôme de la maladresse générale de cette intelligence politique de cette ignorance de l'état et de l’esprit du pays qui depuis si longtemps caractérisent et perdent le parti. C'est fort triste. Tout ce qu'on peut espérer c’est que cette sottise se perde dans la foule avec tant d'autres. Il en vient tant de tous les côtés.
Vous voyez que je ne me gêne guère ; je vous écris tout ce que je pense. Et ce que je vous écris, je le dis aux gens que je vois et à qui il peut être de quelque utilité que je le dise. Pourquoi me gênerais-je? J’ai un avis très décidé sur la situation; je crois qu'il y a un moyen, et qu’il n’y a qu’un moyen de sauver mon pays. Et en même je suis tout-à-fait hors de la mêlée simple spectateur et juge des coups. Je dis tout haut mon jugement C'est là aujourd’hui ma seule action. Je n'en cherche point d'autre. J’ai bien acquis le droit. d'exercer celle-là.
Midi
Je vois, par mes journaux, qu'on est aussi occupé à Paris, de la circulaire que je le suis moi-même dans mon nid. Plutôt on l'oubliera mieux ce sera. Les Débats sont en effet bien vifs contre la République. Ils prennent leurs avantages. Je veux m’arranger pour lire l'Union. Je ne vois pas d'ailleurs la moindre nouvelle qui mérite qu'on en parle. On annonce que la cour de Vienne a pris le deuil pour douze jours, pour le Roi Louis-Philippe. On y sera sensible à Claremont. Il n’y avait point eu de notification là, quand je suis parti. Adieu. Adieu.
Je ne me promènerai pas aujourd'hui. Je resterai tranquille dans mon Cabinet. Adieu. G.
Si vous revoyez Madame de Ste Aulaire, ou lui, faites leur, je vous prie, mes plus tendres amitiés.
Val-Richer, Vendredi 27 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 27 Juillet 1849 6 heures
Ma journée d'hier a été une conversation continue. D’abord avec Salvandy, arrivé à 9 heures et demie, parti à une heure. Puis, avec Bertin et Génie, partis après dîner à 8 heures et demie. Presque toujours dans la maison, à cause de la pluie, vent, orage, grêle. Pourtant quelques intervalles lucides pour se promener en causant. Mon sol est promptement sec.
Salvandy très vieilli. Sa loupe presque doublée. Ses cheveux très longs, pour la couvrir, et très éclaircis, ce qui fait qu’ils la couvrent mal. Toujours en train, mais d’un entrain aussi un peu vieux. Il m'a dit qu’il réimprimait une ancienne brochure de lui, de 1831. Il fait de ses conversations comme de ses brochures. Il est à Paris depuis trois semaines, et y retourne aujourd’hui pour y rester jusqu'aux premiers jours d’août. Après quoi, il revient dans sa terre, à Graveron à 18 lieues de chez moi. Il viendra me voir souvent. A Paris il a vu et il voit tout le monde, excepté Thiers qui ne l'a pas cherché et qu’il n'a pas rencontré. Il raconte Molé, Berryer, Changarnier, le pauvre Bugeaud.
Molé plus animé, plus actif, écrivant plus de billets, faisant plus de visites donnant plus d’aparté que jamais. Président universel et perpétuel, de la réunion du Conseil d'état, de la société pour la propagande, anti-socialiste, de son bureau à l'Assemblée de je ne sais combien de commissions, de tout, excepté de la République. On a fait de lui une caricature très ressemblante, mais où on l'a vieilli de dix ans, avec cette devise : Espoir de notre jeune République.
Il était vendredi dernier à un dîner du Président, faisant les honneurs du salon à MM. S Marc Girardin, Véron, Jules Janin, Janvier & & C'est le dîner où Bertin a refusé d'aller. Le Président, en habit noir cravate blanche, bas de soie, tenue très correcte. M Molé en habit marron, cravate noire, et pantalon gris. Le plus heureux des hommes d’aujourd’hui fort sensé, fort écouté, fort compté, satisfait dans ses prétentions pour lui-même, espérant peu, se contentant de peu, et peu puissant pour le fond des choses. Laissant tomber l'idée de la fusion et s’attachant de plus en plus à la combinaison actuelle n'importe quelle forme nouvelle elle prenne tôt ou tard, car tout le monde croit à une forme nouvelle.
Les voyages du Président préoccupent beaucoup, en espérance ou en crainte. Il est très bien reçu. Il est très vrai qu'on lui crie : Vive l'Empereur et pas de bêtises ! M. Dufaure était un peu troublé à Amiens, et disait : "Je ne croyais pas ce pays-ci tant de goût pour l'autorité. " On se demande ce qui arrivera à Tours, à Angers, à Saumur, à Nantes, surtout à Strasbourg, où il ira ensuite, et qui paraît le principal foyer des espérances impériales. Je suis porté à croire qu’il n’arrivera rien. Tout le monde me paraît s'attendre à un changement et attendre que le voisin prenne l'initiative du mouvement. Point de désir vif, grande défiance du résultat, grande crainte de la responsabilité. Ni fois, ni ambition, ni amour, ni haine. On se trouve mal ; mais on pourrait être plus mal et il faudrait un effort pour être mieux. Et quel mieux ? Un mieux obscur, peut-être pas sûr, qui durerait combien ? Voilà le vrai état des esprits. Le Président ne pousse lui-même à rien. Ceux qui le connaissent le plus le croient ambitieux. Mais personne ne le connait. Il n’a un peu d'abandon. que pour faire sa confession de son passé. Le sang hollandais domine en lui. Il fera comme tout le monde ; il attendra. En attendant ses voyages et ses dîners le ruinent. Il ne peut pas aller. On va redemander de l'argent pour lui. Douze cent mille francs de plus. L'assemblée les donnera. Tristement, car l'état des finances est fort triste. M. Passy tarde à présenter son budget parce qu’il se sent forcé d'avouer, pour 1849, un déficit de 250 millions, & d’en prévoir un de 320 millions pour 1850. On espère ressaisir 90 à 100 millions de l'impôt sur les boissons. Mais comment faire un emprunt pour le reste ? Les habiles sont très perplexes.
La Hongrie n'est pas si populaire à Paris qu'à Londres. Toute l’Europe est impopulaire à Paris les révolutions et les gouvernements. On craint Kessuth et votre Empereur. On croit que c’est l’Autriche qui ne veut pas en finir avec le Piémont afin de tenir en occident une question ouverte qui puisse motiver l’intervention en Italie quand on en aura fini avec la Hongrie.
Il y a eu un temps, déjà ancien de 1789 à 1814, qui était le temps des confiances aveugles. C’est aujourd’hui le temps des méfiances aveugles, suite naturelle de tant de déceptions et de revers. Et la suite naturelle de la méfiance, c'est l'inertie. La France ne demande qu’à se tenir tranquille en Europe. Elle ne se mêlera des affaires de l'Europe qu'à la dernière extrémité, par force et toujours plutôt dans le bon sens, à travers toutes les indécisions et toutes les hypocrisies, comme à Rome. Le gouvernement de Juillet, qui n’a pas su se fonder lui-même, a fondé bien des choses, et on commence à s'en apercevoir. Sa politique extérieure surtout est un fait acquis que tout le monde veut maintenir. Et non seulement on la maintient, mais on en convient et bientôt en s'en vanterai. On m'assure, et je vois bien que comme Ministre des Affaires Etrangères, je suis déjà plus que réhabilité, même auprès des sots. Je vous quitte pour répondre autour Préfet du Havre qui m’a écrit la lettre la plus respectueuse et la plus heureuse que j'aie approuvé sa conduite. Il me dit : " En conformité du désir que vous en avez exprimé, j'ai l’honneur de vous apprendre que les individus qui avaient été arrêtés vendredi dernier ont déjà été relâchés à l'exception de deux que la justice revendique comme habitués de la police correctionnelle, et comme étant d'ailleurs coupables d'avoir joint à leurs cris stupides une tentative d’escroquerie chez un boucher de la rue de Paris. Votre approbation m’a été précieuse et m’a prouvé que j’avais eu raison de ne pas donner à cette ridicule gaminerie les proportions d’une émeute en l’honorant de la présence des baïonnettes citoyennes ou militaires. "
Je reçois beaucoup de lettres, des connus et des inconnus, des fidèles, et des revenants Bourqueney, de qui je n’avais pas entendu parler depuis le 21 février m’écrit avec une tendresse de Marivaux embarrassé : « Dites-vous bien, en recevant cette tardive expression de mon dévouement, que les cœurs les moins pleins ne sont pas ceux dont il n’était encore rien sorti. " Il a voulu dire : " que les cœurs dont il n'était encore rien sorti ne sont pas les moins pleins " Mettez cela à côté de ce billet que m’écrit Aberdeen : " It has been a great satisfaction to me, to see the universal respect and esteem with which you have been regarded in this country. At the same time, it has been to me a cause of sincere regret that I have been so little able to afford you any proofs of m’y cordial friendship during your stay among us. " Je ne le reverrais jamais, je l’aimerai toujours de tout mon cœur.
Merci de m'avoir envoyé le Morning Chronicle J’oublie mon sous Préfet du Havre. Je cause comme si j'étais dans mon fauteuil du Royal Hotel. Pauvre illusion ! Adieu. Adieu. Je vous redirai adieu après la poste. Que de choses j’aurais encore à vous dire.
Onze heures
Voilà votre lettre. Mais mon papier et mon temps sont pleins. Adieu, adieu. à demain. Que l’ancien demain était charmant. Adieu. G.
Ma journée d'hier a été une conversation continue. D’abord avec Salvandy, arrivé à 9 heures et demie, parti à une heure. Puis, avec Bertin et Génie, partis après dîner à 8 heures et demie. Presque toujours dans la maison, à cause de la pluie, vent, orage, grêle. Pourtant quelques intervalles lucides pour se promener en causant. Mon sol est promptement sec.
Salvandy très vieilli. Sa loupe presque doublée. Ses cheveux très longs, pour la couvrir, et très éclaircis, ce qui fait qu’ils la couvrent mal. Toujours en train, mais d’un entrain aussi un peu vieux. Il m'a dit qu’il réimprimait une ancienne brochure de lui, de 1831. Il fait de ses conversations comme de ses brochures. Il est à Paris depuis trois semaines, et y retourne aujourd’hui pour y rester jusqu'aux premiers jours d’août. Après quoi, il revient dans sa terre, à Graveron à 18 lieues de chez moi. Il viendra me voir souvent. A Paris il a vu et il voit tout le monde, excepté Thiers qui ne l'a pas cherché et qu’il n'a pas rencontré. Il raconte Molé, Berryer, Changarnier, le pauvre Bugeaud.
Molé plus animé, plus actif, écrivant plus de billets, faisant plus de visites donnant plus d’aparté que jamais. Président universel et perpétuel, de la réunion du Conseil d'état, de la société pour la propagande, anti-socialiste, de son bureau à l'Assemblée de je ne sais combien de commissions, de tout, excepté de la République. On a fait de lui une caricature très ressemblante, mais où on l'a vieilli de dix ans, avec cette devise : Espoir de notre jeune République.
Il était vendredi dernier à un dîner du Président, faisant les honneurs du salon à MM. S Marc Girardin, Véron, Jules Janin, Janvier & & C'est le dîner où Bertin a refusé d'aller. Le Président, en habit noir cravate blanche, bas de soie, tenue très correcte. M Molé en habit marron, cravate noire, et pantalon gris. Le plus heureux des hommes d’aujourd’hui fort sensé, fort écouté, fort compté, satisfait dans ses prétentions pour lui-même, espérant peu, se contentant de peu, et peu puissant pour le fond des choses. Laissant tomber l'idée de la fusion et s’attachant de plus en plus à la combinaison actuelle n'importe quelle forme nouvelle elle prenne tôt ou tard, car tout le monde croit à une forme nouvelle.
Les voyages du Président préoccupent beaucoup, en espérance ou en crainte. Il est très bien reçu. Il est très vrai qu'on lui crie : Vive l'Empereur et pas de bêtises ! M. Dufaure était un peu troublé à Amiens, et disait : "Je ne croyais pas ce pays-ci tant de goût pour l'autorité. " On se demande ce qui arrivera à Tours, à Angers, à Saumur, à Nantes, surtout à Strasbourg, où il ira ensuite, et qui paraît le principal foyer des espérances impériales. Je suis porté à croire qu’il n’arrivera rien. Tout le monde me paraît s'attendre à un changement et attendre que le voisin prenne l'initiative du mouvement. Point de désir vif, grande défiance du résultat, grande crainte de la responsabilité. Ni fois, ni ambition, ni amour, ni haine. On se trouve mal ; mais on pourrait être plus mal et il faudrait un effort pour être mieux. Et quel mieux ? Un mieux obscur, peut-être pas sûr, qui durerait combien ? Voilà le vrai état des esprits. Le Président ne pousse lui-même à rien. Ceux qui le connaissent le plus le croient ambitieux. Mais personne ne le connait. Il n’a un peu d'abandon. que pour faire sa confession de son passé. Le sang hollandais domine en lui. Il fera comme tout le monde ; il attendra. En attendant ses voyages et ses dîners le ruinent. Il ne peut pas aller. On va redemander de l'argent pour lui. Douze cent mille francs de plus. L'assemblée les donnera. Tristement, car l'état des finances est fort triste. M. Passy tarde à présenter son budget parce qu’il se sent forcé d'avouer, pour 1849, un déficit de 250 millions, & d’en prévoir un de 320 millions pour 1850. On espère ressaisir 90 à 100 millions de l'impôt sur les boissons. Mais comment faire un emprunt pour le reste ? Les habiles sont très perplexes.
La Hongrie n'est pas si populaire à Paris qu'à Londres. Toute l’Europe est impopulaire à Paris les révolutions et les gouvernements. On craint Kessuth et votre Empereur. On croit que c’est l’Autriche qui ne veut pas en finir avec le Piémont afin de tenir en occident une question ouverte qui puisse motiver l’intervention en Italie quand on en aura fini avec la Hongrie.
Il y a eu un temps, déjà ancien de 1789 à 1814, qui était le temps des confiances aveugles. C’est aujourd’hui le temps des méfiances aveugles, suite naturelle de tant de déceptions et de revers. Et la suite naturelle de la méfiance, c'est l'inertie. La France ne demande qu’à se tenir tranquille en Europe. Elle ne se mêlera des affaires de l'Europe qu'à la dernière extrémité, par force et toujours plutôt dans le bon sens, à travers toutes les indécisions et toutes les hypocrisies, comme à Rome. Le gouvernement de Juillet, qui n’a pas su se fonder lui-même, a fondé bien des choses, et on commence à s'en apercevoir. Sa politique extérieure surtout est un fait acquis que tout le monde veut maintenir. Et non seulement on la maintient, mais on en convient et bientôt en s'en vanterai. On m'assure, et je vois bien que comme Ministre des Affaires Etrangères, je suis déjà plus que réhabilité, même auprès des sots. Je vous quitte pour répondre autour Préfet du Havre qui m’a écrit la lettre la plus respectueuse et la plus heureuse que j'aie approuvé sa conduite. Il me dit : " En conformité du désir que vous en avez exprimé, j'ai l’honneur de vous apprendre que les individus qui avaient été arrêtés vendredi dernier ont déjà été relâchés à l'exception de deux que la justice revendique comme habitués de la police correctionnelle, et comme étant d'ailleurs coupables d'avoir joint à leurs cris stupides une tentative d’escroquerie chez un boucher de la rue de Paris. Votre approbation m’a été précieuse et m’a prouvé que j’avais eu raison de ne pas donner à cette ridicule gaminerie les proportions d’une émeute en l’honorant de la présence des baïonnettes citoyennes ou militaires. "
Je reçois beaucoup de lettres, des connus et des inconnus, des fidèles, et des revenants Bourqueney, de qui je n’avais pas entendu parler depuis le 21 février m’écrit avec une tendresse de Marivaux embarrassé : « Dites-vous bien, en recevant cette tardive expression de mon dévouement, que les cœurs les moins pleins ne sont pas ceux dont il n’était encore rien sorti. " Il a voulu dire : " que les cœurs dont il n'était encore rien sorti ne sont pas les moins pleins " Mettez cela à côté de ce billet que m’écrit Aberdeen : " It has been a great satisfaction to me, to see the universal respect and esteem with which you have been regarded in this country. At the same time, it has been to me a cause of sincere regret that I have been so little able to afford you any proofs of m’y cordial friendship during your stay among us. " Je ne le reverrais jamais, je l’aimerai toujours de tout mon cœur.
Merci de m'avoir envoyé le Morning Chronicle J’oublie mon sous Préfet du Havre. Je cause comme si j'étais dans mon fauteuil du Royal Hotel. Pauvre illusion ! Adieu. Adieu. Je vous redirai adieu après la poste. Que de choses j’aurais encore à vous dire.
Onze heures
Voilà votre lettre. Mais mon papier et mon temps sont pleins. Adieu, adieu. à demain. Que l’ancien demain était charmant. Adieu. G.
Brompton, Lundi 2 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Lundi 2 oct. 1848
2 heures
J'espère bien que cette indisposition ne sera rien. Vous avez raison de vous tenir tranquille et de manger très peu. Le repos et la diète. Moi aussi, j’ai été un peu incommodé cette nuit. Mais ce n’est rien du tout. Je viens de me promener une heure par un joli temps. Le voilà qui se gâte. Quel déplaisir que la distance !
Je suis allé hier voir Dumon. Il y a dans ce quartier bien des maisons à louer. Même deux ou trois. Grosvenor Place qui me paraît un très bon emplacement. Dumon restera seul lundi prochain. Sa femme et sa fille retournent à Paris. Il quittera sa maison de Wilton-Street, et se rapprochera de l'Athenaeum, sa ressource contre la solitude. Mais il sera toujours fort à portée de ce quartier-là. Duchâtel revient à la fin d’octobre, et passera l’hiver à Londres. Si on ne peut pas le passer en France. Presque toutes les lettres de France croient à une crise prochaine qui nous y fera rentrer. Personne ne dit bien pourquoi ni comment. Mais tout le monde le dit, les simples comme les gens d’esprit, à mon profond regret, ce n’est pas mon impression. Voici la nouvelle qu’on m’apporte ce matin, tout bien examiné, tous calculs faits, Cavaignac et ses amis en sont venus à penser que si on tentait de le faire nommer Président maintenant il ne serait pas nommé, et que tout croulerait. Ils se sont rejetés alors dans l’expédient contraire qui serait d’ajourner la nomination du président de la République jusqu'au moment de la dissolution de l'Assemblée elle-même, c’est-à-dire après les lois organiques. Jusque-là, on resterait et exactement comme on est, sans toucher à cette machine qu'on ne peut pas toucher, sans la briser. On m'assure que c’est là ce qui sera proposé ces jours-ci. La réunion de la rue de Poitiers s'y opposera. Mais on croit qu’elle sera battue, toutes les autres portions de l'Assemblée, y compris les Montagnards, désirant éviter une crise dont elles ne se promettent rien de bon pour elles-mêmes. C’est un gouvernement de plus en plus convaincu qu'il ne peut pas vivre, et décidé à ne pas remuer pour ne pas mourir. En définitive, il n'en mourra pas moins. Mais cela peut durer encore quelque temps.
Les Italiens affluent ici, en colère croissante contre la France et la République. Cavaignac ne sait pas la valeur des moindres paroles en Affaires étrangères. Il a, lui-même tout récemment encore, donné aux gens de Milan, aux gens de Venise, aux gens de Sicile, des espérances qui sont tombées le lendemain après une séance du Conseil. On les renvoie à Londres, en disant : " Nous ferons comme Londres. " Et Londres ne dit rien du tout. Le Roi de Naples n'attaquera, pas Palerme. Il prendra, ou se conciliera successivement toutes les autres villes, laissant Palerme vivre comme elle pourra dans son anarchie. Le temps est pour lui. A Rome on augure très mal du Cabinet Rossi. On dit que le Pape l’usera et le laissera tomber comme les autres. Et s’il veut résister plus réellement que les autres, les Républicains demain le feront tomber. Les fantaisies républicaines sont en progrès dans tous les coins. L'avocat Guerazzi reste le maître à Livourne et se promet de devenir le président de la République Toscane. Le cabinet du grand Duc va se dissoudre. Son président, le marquis Capponi, capable et honnête, aveugle et impotent, déclare qu’il ne peut plus continuer, par impotence et par honnêteté. La fermentation républicaine gagne Gênes de plus en plus ; à ce point que l’idée y circule de s'annexer à la Lombardie autrichienne. Si l’Autriche doit consentir à accepter Gênes comme ville libre et port franc. L'Empereur d’Autriche protecteur du Hambourg de la Méditerranée. Vous voyez que tout n’est pas près de finir là. Adieu. Adieu.
J’ai trouvé l'adresse de Salvo. Il part cette semaine pour aller passer quinze jours à Paris. Adieu, j'espère que demain matin, je vous saurai bien. G.
2 heures
J'espère bien que cette indisposition ne sera rien. Vous avez raison de vous tenir tranquille et de manger très peu. Le repos et la diète. Moi aussi, j’ai été un peu incommodé cette nuit. Mais ce n’est rien du tout. Je viens de me promener une heure par un joli temps. Le voilà qui se gâte. Quel déplaisir que la distance !
Je suis allé hier voir Dumon. Il y a dans ce quartier bien des maisons à louer. Même deux ou trois. Grosvenor Place qui me paraît un très bon emplacement. Dumon restera seul lundi prochain. Sa femme et sa fille retournent à Paris. Il quittera sa maison de Wilton-Street, et se rapprochera de l'Athenaeum, sa ressource contre la solitude. Mais il sera toujours fort à portée de ce quartier-là. Duchâtel revient à la fin d’octobre, et passera l’hiver à Londres. Si on ne peut pas le passer en France. Presque toutes les lettres de France croient à une crise prochaine qui nous y fera rentrer. Personne ne dit bien pourquoi ni comment. Mais tout le monde le dit, les simples comme les gens d’esprit, à mon profond regret, ce n’est pas mon impression. Voici la nouvelle qu’on m’apporte ce matin, tout bien examiné, tous calculs faits, Cavaignac et ses amis en sont venus à penser que si on tentait de le faire nommer Président maintenant il ne serait pas nommé, et que tout croulerait. Ils se sont rejetés alors dans l’expédient contraire qui serait d’ajourner la nomination du président de la République jusqu'au moment de la dissolution de l'Assemblée elle-même, c’est-à-dire après les lois organiques. Jusque-là, on resterait et exactement comme on est, sans toucher à cette machine qu'on ne peut pas toucher, sans la briser. On m'assure que c’est là ce qui sera proposé ces jours-ci. La réunion de la rue de Poitiers s'y opposera. Mais on croit qu’elle sera battue, toutes les autres portions de l'Assemblée, y compris les Montagnards, désirant éviter une crise dont elles ne se promettent rien de bon pour elles-mêmes. C’est un gouvernement de plus en plus convaincu qu'il ne peut pas vivre, et décidé à ne pas remuer pour ne pas mourir. En définitive, il n'en mourra pas moins. Mais cela peut durer encore quelque temps.
Les Italiens affluent ici, en colère croissante contre la France et la République. Cavaignac ne sait pas la valeur des moindres paroles en Affaires étrangères. Il a, lui-même tout récemment encore, donné aux gens de Milan, aux gens de Venise, aux gens de Sicile, des espérances qui sont tombées le lendemain après une séance du Conseil. On les renvoie à Londres, en disant : " Nous ferons comme Londres. " Et Londres ne dit rien du tout. Le Roi de Naples n'attaquera, pas Palerme. Il prendra, ou se conciliera successivement toutes les autres villes, laissant Palerme vivre comme elle pourra dans son anarchie. Le temps est pour lui. A Rome on augure très mal du Cabinet Rossi. On dit que le Pape l’usera et le laissera tomber comme les autres. Et s’il veut résister plus réellement que les autres, les Républicains demain le feront tomber. Les fantaisies républicaines sont en progrès dans tous les coins. L'avocat Guerazzi reste le maître à Livourne et se promet de devenir le président de la République Toscane. Le cabinet du grand Duc va se dissoudre. Son président, le marquis Capponi, capable et honnête, aveugle et impotent, déclare qu’il ne peut plus continuer, par impotence et par honnêteté. La fermentation républicaine gagne Gênes de plus en plus ; à ce point que l’idée y circule de s'annexer à la Lombardie autrichienne. Si l’Autriche doit consentir à accepter Gênes comme ville libre et port franc. L'Empereur d’Autriche protecteur du Hambourg de la Méditerranée. Vous voyez que tout n’est pas près de finir là. Adieu. Adieu.
J’ai trouvé l'adresse de Salvo. Il part cette semaine pour aller passer quinze jours à Paris. Adieu, j'espère que demain matin, je vous saurai bien. G.
Brompton, Mardi 3 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Mardi 3 oct. 1848
3 heures
Je reviens d'Albany où j'étais allé voir Macaulay. " Vous êtes, m’a-t-il dit la première personne que j’aie vue à Londres depuis huit jours." Il vit dans une complète solitude, imprimant son histoire de la Révolution de 1688 qu’il publiera en décembre. Il ne savait absolument rien.
La Rosière est venu ce matin. Amusant sur le passé, car il a quitté Paris il y a plus de six semaines. Des détails sur les premiers temps de la Révolution, Lamartine, Rémusat, Thiers. Croyant à Thiers une assez bonne position dans la Garde nationale de Paris. Attendant la fin prochaine, sans en savoir plus que nous. Il quitte Mad. la Duchesse d'Orléans dont il parle très bien. Situation matérielle déplorable, portée avec une parfaite simplicité et dignité. Plus disposée qu’on me dit à accueillir les combinaisons qui rendraient l'avenir de ses fils plus sûr. M. le comte de Paris avait le visage un peu meurtri d’une chute sans gravité. Très bien du reste, et le duc de Chartre très aimable. Décidé à rester en Allemagne, et à se conduire comme si elle était à Claremont. Point d’intelligence directe ni séparée avec Paris. La Rosière convaincu que la République rouge est plus forte en Allemagne qu'en France, et que, si elle prévalait un moment en France, l'explosion en Allemagne serait très forte. Je n'ai point d’autre nouvelle.
Vous me direz demain où je dois aller vous voir demain soir à quel numéro de Mivart, car il y en a quatre ou cinq. Passerez-vous là quelques jours ? Les jours passent si vite ! Adieu. Adieu.
Il fait bien beau. Le parc de Richmond est encore bon. Où vous promènerez-vous à Brighton ? Adieu. J’espère que vous ne vous êtes plus ressentie de votre estomac. G.
3 heures
Je reviens d'Albany où j'étais allé voir Macaulay. " Vous êtes, m’a-t-il dit la première personne que j’aie vue à Londres depuis huit jours." Il vit dans une complète solitude, imprimant son histoire de la Révolution de 1688 qu’il publiera en décembre. Il ne savait absolument rien.
La Rosière est venu ce matin. Amusant sur le passé, car il a quitté Paris il y a plus de six semaines. Des détails sur les premiers temps de la Révolution, Lamartine, Rémusat, Thiers. Croyant à Thiers une assez bonne position dans la Garde nationale de Paris. Attendant la fin prochaine, sans en savoir plus que nous. Il quitte Mad. la Duchesse d'Orléans dont il parle très bien. Situation matérielle déplorable, portée avec une parfaite simplicité et dignité. Plus disposée qu’on me dit à accueillir les combinaisons qui rendraient l'avenir de ses fils plus sûr. M. le comte de Paris avait le visage un peu meurtri d’une chute sans gravité. Très bien du reste, et le duc de Chartre très aimable. Décidé à rester en Allemagne, et à se conduire comme si elle était à Claremont. Point d’intelligence directe ni séparée avec Paris. La Rosière convaincu que la République rouge est plus forte en Allemagne qu'en France, et que, si elle prévalait un moment en France, l'explosion en Allemagne serait très forte. Je n'ai point d’autre nouvelle.
Vous me direz demain où je dois aller vous voir demain soir à quel numéro de Mivart, car il y en a quatre ou cinq. Passerez-vous là quelques jours ? Les jours passent si vite ! Adieu. Adieu.
Il fait bien beau. Le parc de Richmond est encore bon. Où vous promènerez-vous à Brighton ? Adieu. J’espère que vous ne vous êtes plus ressentie de votre estomac. G.
Claremont, Mardi 17 octobre 1848, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1848 ( 1er août -24 novembre) : Le silence de l'exil
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Mardi 17 oct. 1848
8 heures
Mon rhumatisme ne m’a pas tout-à-fait quitte. Cependant, il va mieux assez mieux pour que j'aille à Claremont. Il ne pleut pas, plutôt froid, ce que je préfère. Je me couvrirai bien. Je ne veux pas que le Roi m'attende pour rien, puisque je puis aller. Et vous comment êtes-vous ce matin ? Comment a été la nuit ? J'en veux à Emilie de ne vous avoir pas mieux soignée. Je lui en dirai un mot.
Le Lord Holland est venu me voir hier. Revenu samedi de Paris. Il l’a trouvé très gloumy. Dans les dix jours qu’il y a passés il n'a pas rencontré une seule personne, pas une qui ne maudit tout haut la République et ne prédit sa chute. Lord Ashburton et tous les Anglais qui sont à Paris lui ont dit qu'eux aussi n'en avaient pas rencontré une seule. Il a vu Arago qu’il connait, beaucoup abattu, noir mélancolique au-delà de toute expression. Arago lui a raconté le gouvernement provisoire avec une haine ardente, pour Lamartine, Ledru Rollin, Barrot, etc. Ils se haïssent ardemment les uns les autres et se racontent en conséquence. Arago lui a dit : " Il y aura encore des conflits sanglants dans Paris. J’irai au plus épais et je me ferai tuer. Je ne puis supporter le spectacle de cette misère et de cette dégradation de la France. Comment va M. Guizot ? Parlez-lui de moi, je vous prie. Je désire que vous lui parliez de moi. Je désire qu’il sache que je suis bien malheureux." Je vous répète le propre récit du Lord Holland.
Il a vu aussi Thiers. Uniquement occupé, à ce moment-là, de son discours contre le papier monnaie et de sa haine contre Lamartine dont les derniers succès oratoires l'ont blessé. Il en parlait avec passion à ceux qui l’entouraient, traitant les discours de Lamartine comme des assignats. Il a demandé au Lord Holland de mes nouvelles. Pour Emilie Holland, sa fille, qui n’avait jamais vu Paris, elle l’a trouvé charmant, gai, animé, quoique c'est une jolie, et intelligente personne. Dumon est venu dîner avec moi. Point d'autres nouvelles que les miennes. Pensant comme moi que Thiers accepte c’est-à-dire prend Louis Bonaparte se disant : "S’il réussit, je serai le maître, s’il ne réussit pas, je serai le Monk." Dumon est convaincu que Dufaure et Vivien vont se faire très républicains pour se faire pardonner l'ancienne Monarchie, et qu’ils n'en ont que pour très peu de semaines.
M. Gervais de Caen, que Dufaure vient de nommer préfet de Police à la place de M. Ducoux est un mauvais choix, un homme du National. La Réforme, en attaquant vivement les nouveaux ministres, ménage Cavaignac. J'essaye de remplacer la conversation que rien ne remplace. Adieu. J’attends Jean. J’irai donc dîner avec vous en revenant de Claremont.
10 h. et demie
Voilà Jean qui me dit que vous êtes encore souffrante et dans votre lit. Et je ne vous verrai qu'à 5 heures. Il faut que je sois au railway à midi 1/4. Au moins ce n’est rien de plus que ce que vous aviez hier. Adieu Adieu.
8 heures
Mon rhumatisme ne m’a pas tout-à-fait quitte. Cependant, il va mieux assez mieux pour que j'aille à Claremont. Il ne pleut pas, plutôt froid, ce que je préfère. Je me couvrirai bien. Je ne veux pas que le Roi m'attende pour rien, puisque je puis aller. Et vous comment êtes-vous ce matin ? Comment a été la nuit ? J'en veux à Emilie de ne vous avoir pas mieux soignée. Je lui en dirai un mot.
Le Lord Holland est venu me voir hier. Revenu samedi de Paris. Il l’a trouvé très gloumy. Dans les dix jours qu’il y a passés il n'a pas rencontré une seule personne, pas une qui ne maudit tout haut la République et ne prédit sa chute. Lord Ashburton et tous les Anglais qui sont à Paris lui ont dit qu'eux aussi n'en avaient pas rencontré une seule. Il a vu Arago qu’il connait, beaucoup abattu, noir mélancolique au-delà de toute expression. Arago lui a raconté le gouvernement provisoire avec une haine ardente, pour Lamartine, Ledru Rollin, Barrot, etc. Ils se haïssent ardemment les uns les autres et se racontent en conséquence. Arago lui a dit : " Il y aura encore des conflits sanglants dans Paris. J’irai au plus épais et je me ferai tuer. Je ne puis supporter le spectacle de cette misère et de cette dégradation de la France. Comment va M. Guizot ? Parlez-lui de moi, je vous prie. Je désire que vous lui parliez de moi. Je désire qu’il sache que je suis bien malheureux." Je vous répète le propre récit du Lord Holland.
Il a vu aussi Thiers. Uniquement occupé, à ce moment-là, de son discours contre le papier monnaie et de sa haine contre Lamartine dont les derniers succès oratoires l'ont blessé. Il en parlait avec passion à ceux qui l’entouraient, traitant les discours de Lamartine comme des assignats. Il a demandé au Lord Holland de mes nouvelles. Pour Emilie Holland, sa fille, qui n’avait jamais vu Paris, elle l’a trouvé charmant, gai, animé, quoique c'est une jolie, et intelligente personne. Dumon est venu dîner avec moi. Point d'autres nouvelles que les miennes. Pensant comme moi que Thiers accepte c’est-à-dire prend Louis Bonaparte se disant : "S’il réussit, je serai le maître, s’il ne réussit pas, je serai le Monk." Dumon est convaincu que Dufaure et Vivien vont se faire très républicains pour se faire pardonner l'ancienne Monarchie, et qu’ils n'en ont que pour très peu de semaines.
M. Gervais de Caen, que Dufaure vient de nommer préfet de Police à la place de M. Ducoux est un mauvais choix, un homme du National. La Réforme, en attaquant vivement les nouveaux ministres, ménage Cavaignac. J'essaye de remplacer la conversation que rien ne remplace. Adieu. J’attends Jean. J’irai donc dîner avec vous en revenant de Claremont.
10 h. et demie
Voilà Jean qui me dit que vous êtes encore souffrante et dans votre lit. Et je ne vous verrai qu'à 5 heures. Il faut que je sois au railway à midi 1/4. Au moins ce n’est rien de plus que ce que vous aviez hier. Adieu Adieu.
Brompton, Dimanche 14 janvier 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Dimanche 14 Janv. 1849
Je mettrai ceci à la poste à Londres en sortant de l’Athenaeum où j'irai à 4 heures. Vous l'aurez demain à 3 heures, je pense. Je ne veux pas que le Dimanche soit tout à fait stérile. J'ai pour le débat qui a dû finir hier plus de curiosité qu’il n’a d’importance. Il importe fort peu, en soi, que l'assemblée se dissolve le 4 ou le 30 mars. Or c'est entre ces deux temps qu’on hésite. Tout le monde est décidé ou résigné à la dissolution prochaine. Je ne me fais pas encore une idée claire de l'assemblée qui succédera. Je présume qu’elle sera encore très mêlée, et par conséquent, très orageuse. Orléanistes, légitimistes et républicains y seront forts. Et très acharnés en même temps que forts. La république rouge seule sera si je ne me trompe à peu près éliminée. Elle se remettra derrière la République tricolore, comme elle l’a fait de 1830 à 1848. Et la République tricolore acceptera de nouveau cette queue. On fera effort pour sortir du chaos. On n'en sortira pas d'un coup. Je vous assure qu’il y a bien à examiner s'il me convient de redescendre déjà dans la mêlée; car entrer dans l’Assemblée, c’est redescendre dans la mêlée. Peut-être vaudrait-il mieux, pour moi-même, et pour le moment décisif quand il viendra me tenir encore quelque temps à l'écart, sur la hauteur, disant mon avis aux combattants et sur les combattants. Nous en causerons. Je n'ai aucune lettre importante de Paris. Rien que des détails sur le succès de ma brochure. Je regarde la réconciliation et l’intimité active de Girardin et de Lamartine, comme un fait assez grave. Ce sont peut-être les deux hommes les plus mischievous parce que ce sont eux qui savent faire le plus de dupes parmi les honnêtes gens et les gens d'esprit badauds. J’ai une longue lettre de Brougham. En grands compliments sur ma brochure. Quelques observations, peu fondées, je crois. Evidemment décidé à être bien avec moi. Il compte quitter Cannes du 18 au 20. Il ne me dit pas s'il s’arrêtera à Paris en revenant. La tentative de conciliation du Roi Léopold entre l'Angleterre et l’Espagne a décidément échoué. Palmerston veut toujours un retour de Bulwer à Madrid. Narvaez ne veut pas. Et on ne veut pas à Madrid, renverser Narvaez. J’ai pourtant trouvé le Roi l’autre jour, peu en bienveillance et en confiance pour la Reine Christine. J’ai entrevu qu’elle insistait comme la Reine sa fille, pour que la Duchesse de Montpensier vint à Madrid, et qu'elle aussi ne serait peut-être pas fâchée que la Duchesse suivit les bons exemples. On est très susceptible à cet endroit. Vous n'avez pas d’idée du sentiment d'aversion et de dégoût que la corruption des cours de Madrid et de Naples a laissé dans le ménage qui y a assisté sans y prendre part. Adieu. Je ne vous écrirai pas demain. Mardi, à 2 heures J’espère qu’il fera aussi doux qu'aujourd’hui, et que je pourrai rester aussi frais qu’il vous conviendra. Adieu. Adieu G. Vous ne saurez qu’elles sont les quatre pages qui plaisent tant au Prince de Metternich. Si j'apprends quelque chose à l'Athenoeum je l’ajouterai à ma lettre.
Je mettrai ceci à la poste à Londres en sortant de l’Athenaeum où j'irai à 4 heures. Vous l'aurez demain à 3 heures, je pense. Je ne veux pas que le Dimanche soit tout à fait stérile. J'ai pour le débat qui a dû finir hier plus de curiosité qu’il n’a d’importance. Il importe fort peu, en soi, que l'assemblée se dissolve le 4 ou le 30 mars. Or c'est entre ces deux temps qu’on hésite. Tout le monde est décidé ou résigné à la dissolution prochaine. Je ne me fais pas encore une idée claire de l'assemblée qui succédera. Je présume qu’elle sera encore très mêlée, et par conséquent, très orageuse. Orléanistes, légitimistes et républicains y seront forts. Et très acharnés en même temps que forts. La république rouge seule sera si je ne me trompe à peu près éliminée. Elle se remettra derrière la République tricolore, comme elle l’a fait de 1830 à 1848. Et la République tricolore acceptera de nouveau cette queue. On fera effort pour sortir du chaos. On n'en sortira pas d'un coup. Je vous assure qu’il y a bien à examiner s'il me convient de redescendre déjà dans la mêlée; car entrer dans l’Assemblée, c’est redescendre dans la mêlée. Peut-être vaudrait-il mieux, pour moi-même, et pour le moment décisif quand il viendra me tenir encore quelque temps à l'écart, sur la hauteur, disant mon avis aux combattants et sur les combattants. Nous en causerons. Je n'ai aucune lettre importante de Paris. Rien que des détails sur le succès de ma brochure. Je regarde la réconciliation et l’intimité active de Girardin et de Lamartine, comme un fait assez grave. Ce sont peut-être les deux hommes les plus mischievous parce que ce sont eux qui savent faire le plus de dupes parmi les honnêtes gens et les gens d'esprit badauds. J’ai une longue lettre de Brougham. En grands compliments sur ma brochure. Quelques observations, peu fondées, je crois. Evidemment décidé à être bien avec moi. Il compte quitter Cannes du 18 au 20. Il ne me dit pas s'il s’arrêtera à Paris en revenant. La tentative de conciliation du Roi Léopold entre l'Angleterre et l’Espagne a décidément échoué. Palmerston veut toujours un retour de Bulwer à Madrid. Narvaez ne veut pas. Et on ne veut pas à Madrid, renverser Narvaez. J’ai pourtant trouvé le Roi l’autre jour, peu en bienveillance et en confiance pour la Reine Christine. J’ai entrevu qu’elle insistait comme la Reine sa fille, pour que la Duchesse de Montpensier vint à Madrid, et qu'elle aussi ne serait peut-être pas fâchée que la Duchesse suivit les bons exemples. On est très susceptible à cet endroit. Vous n'avez pas d’idée du sentiment d'aversion et de dégoût que la corruption des cours de Madrid et de Naples a laissé dans le ménage qui y a assisté sans y prendre part. Adieu. Je ne vous écrirai pas demain. Mardi, à 2 heures J’espère qu’il fera aussi doux qu'aujourd’hui, et que je pourrai rester aussi frais qu’il vous conviendra. Adieu. Adieu G. Vous ne saurez qu’elles sont les quatre pages qui plaisent tant au Prince de Metternich. Si j'apprends quelque chose à l'Athenoeum je l’ajouterai à ma lettre.
Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 20 Juillet 1849
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 15 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer dimanche 15 sept 1850
Je suis frappé de ce que vous me dîtes de l’intimité de Changarnier et de Lamoricière. Cela coïncide avec ce qui m'est revenu d'ailleurs, ces jours-ci. Lamoricière dans des conversations intimes, s’est déclaré inconciliable, absolument inconciliable avec les rouges et l'Empire, ou toute combinaison bonapartiste analogue à l'Empire ; du reste prêt à accepter toute autre solution, l'une ou l'autre des deux branches, n'importe laquelle, ou mieux encore toutes deux ensemble ceci dans l’hypothèse où la république régulière ne pourrait pas durer, ce qu’il ne regarde point comme sûr, mais comme très possible. Je vous donne ces ouï dire pour ce qu'ils valent ; ils viennent de bon lieu. Ils peuvent être vrais aujourd’hui et point demain ; Lamoricière est si mobile ?
Les nouvelles de Bruxelles m'affligent beaucoup. La Reine, toute cette famille royale quittant le cercueil du Roi et traversant la mer pour venir s'asseoir auprès du lit de mort de leur fille, de leur sœur ! Quelle épreuve ! quel spectacle ! Les douleurs s’appellent et s'attirent. Je ne sais rien que par les journaux ; mais j’ai le cœur serré à l'idée de ce deuil sur deuil pour la Reine dont la personne, et le cœur, semblaient ne laisser plus de place à un deuil nouveau. Je voulais écrire ces jours-ci à la Reine et à M. le Duc de Nemours. Je n'ose pas. J’attends.
J'espère que vous me donnerez aujourd’hui d'un peu meilleures nouvelles de votre rhume. Décidément enrhumée ou non, et encore plus enrhumée, je vous aime mieux à Paris qu'ailleurs. Vous y avez à la fois plus de repos et plus de mouvement. Je compare ce que vous voyez là, avec votre solitude de Schlangenbad. Et pour avoir cela vous n'avez d'autre peine à prendre que de ne pas sortir de chez vous.
Je suis curieux de ce que vous me direz sur M. de Meyendorff. La nouvelle de Berlin est répétée dans tous les journaux. Je ne puis croire à cette retraite, et encore moins au motif. Mad. Swebach (est-ce bien son nom ? ) doit savoir le vrai. Midi Je regrette de n'avoir pas vu l'article du Times, sur Salvandy. Je suis frappé de la réserve des journaux de toute opinion sur ce sujet. Ils sentent tous que c’est sérieux, et ne veulent ni s’engager ni se compromettre. Je vois ce matin un article du Siècle qui pose, entre la Monarchie et la République, je ne sais combien de questions pleines d'embarras et qui admettent les réponses contraires.
Je suis bien aise d'avoir valu à Constantin les remerciements qu’il a reçus. Vous savez que je lui ai trouvé, sous sa tranquillité modeste et un peu stérile, l’esprit plus ouvert et plus sérieux que je ne supposais. Adieu, adieu. Vous aurez reçu ce matin une réponse sur Fleischmann. Adieu. G.
Je suis frappé de ce que vous me dîtes de l’intimité de Changarnier et de Lamoricière. Cela coïncide avec ce qui m'est revenu d'ailleurs, ces jours-ci. Lamoricière dans des conversations intimes, s’est déclaré inconciliable, absolument inconciliable avec les rouges et l'Empire, ou toute combinaison bonapartiste analogue à l'Empire ; du reste prêt à accepter toute autre solution, l'une ou l'autre des deux branches, n'importe laquelle, ou mieux encore toutes deux ensemble ceci dans l’hypothèse où la république régulière ne pourrait pas durer, ce qu’il ne regarde point comme sûr, mais comme très possible. Je vous donne ces ouï dire pour ce qu'ils valent ; ils viennent de bon lieu. Ils peuvent être vrais aujourd’hui et point demain ; Lamoricière est si mobile ?
Les nouvelles de Bruxelles m'affligent beaucoup. La Reine, toute cette famille royale quittant le cercueil du Roi et traversant la mer pour venir s'asseoir auprès du lit de mort de leur fille, de leur sœur ! Quelle épreuve ! quel spectacle ! Les douleurs s’appellent et s'attirent. Je ne sais rien que par les journaux ; mais j’ai le cœur serré à l'idée de ce deuil sur deuil pour la Reine dont la personne, et le cœur, semblaient ne laisser plus de place à un deuil nouveau. Je voulais écrire ces jours-ci à la Reine et à M. le Duc de Nemours. Je n'ose pas. J’attends.
J'espère que vous me donnerez aujourd’hui d'un peu meilleures nouvelles de votre rhume. Décidément enrhumée ou non, et encore plus enrhumée, je vous aime mieux à Paris qu'ailleurs. Vous y avez à la fois plus de repos et plus de mouvement. Je compare ce que vous voyez là, avec votre solitude de Schlangenbad. Et pour avoir cela vous n'avez d'autre peine à prendre que de ne pas sortir de chez vous.
Je suis curieux de ce que vous me direz sur M. de Meyendorff. La nouvelle de Berlin est répétée dans tous les journaux. Je ne puis croire à cette retraite, et encore moins au motif. Mad. Swebach (est-ce bien son nom ? ) doit savoir le vrai. Midi Je regrette de n'avoir pas vu l'article du Times, sur Salvandy. Je suis frappé de la réserve des journaux de toute opinion sur ce sujet. Ils sentent tous que c’est sérieux, et ne veulent ni s’engager ni se compromettre. Je vois ce matin un article du Siècle qui pose, entre la Monarchie et la République, je ne sais combien de questions pleines d'embarras et qui admettent les réponses contraires.
Je suis bien aise d'avoir valu à Constantin les remerciements qu’il a reçus. Vous savez que je lui ai trouvé, sous sa tranquillité modeste et un peu stérile, l’esprit plus ouvert et plus sérieux que je ne supposais. Adieu, adieu. Vous aurez reçu ce matin une réponse sur Fleischmann. Adieu. G.
Val-Richer, Lundi 23 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 23 Juillet 1849 8 heures
J’ai passé ma matinée hier à recevoir des visites. Dix-neuf. Mon impression reste la même. Rien n’est changé au fond, dans la situation générale, ni dans la mienne. Seulement tout a éclaté et s'est exaspéré. C’est toujours la même lutte entre les mêmes classes et les mêmes passions, et j'y tiens toujours la même place. Mais évidemment le moment n'est pas venu pour moi, quand je le pourrais de la reprendre activement. Mes amis se troubleraient. Mes ennemis s’irriteraient. Et les uns et les autres saisiraient le premier prétexte pour rejeter sur moi seul la responsabilité du premier malheur. Et le public spectateur les croirait. Je n’ai qu'à attendre, si le temps, en s'en allant, n'emporte pas trop tôt ce qui me reste de forces, je puis avoir encore un grand moment. Si je m'en vais avant que ce moment n’arrive, j'ai lieu d'espérer aujourd’hui que justice sera faite à mon nom. Fait général. Les honnêtes gens ont moins peur des coquins que je ne m’y attendais. Ils prévoient de nouvelles luttes, sont très décidés à les soutenir, et comptent sur la victoire. Ceci je le vois. Les coquins que je ne vois pas, sont à ce qu'on me dit, assez découragés et sans confiance dans l'avenir. Ce qui ne les empêchera pas de recommencer. L’esprit manque aux uns et aux autres. Ils sont tous de très petite taille et de vue très courte. C’est une guerre entre des nains aveugles. Il y a dans les deux camps, plus de force et de courage qu’il n'en faut pour se livrer de bien autres combats que ceux qu’ils se livrent des combats au bout desquels viendrait nécessairement la grande défaite ou la grande victoire. Mais ils ont, les uns et les autres, si peu d'intelligence et de portée d'esprit, ils sont tellement au-dessous des questions et des événements qu’ils remuent, qu’il pourra fort bien leur arriver de s’agiter longtemps et misérablement sans rien finir. Il ne serait pas, je crois, bien difficile de faire agir efficacement les honnêtes gens si on pouvait leur faire réellement voir ce dont il s’agit. Ils ne voient pas. Je vous envoie mes réflexions, n'ayant point de faits. La prorogation de l'assemblée sera probablement plus courte qu’on ne l’avait dit. Le sentiment général, dans le parti de l'ordre, est contre. On craint de laisser tout seul un pouvoir si faible et un cabinet si douteux. Ce n'est plus la république seule, c’est la Montagne elle-même qui est l’objet des moqueries populaires. Autrefois, dit-on, la montagne accouchait ; aujourd’hui elle découche.
Onze heures et demie
Je regrette que Brougham et Aberdeen aient perdu leur bataille à 12 voix. Je vais les lire. Je me suis abonné, au Galignani pour rester au courant de l’Angleterre. C'est pourtant le lieu où vous êtes ! Vous ne me dites rien de votre santé. J’en conclus que ce n'est pas mal. Je vous le redemande en grâce ; n'oubliez pas ce que vous m'aurez promis. Adieu, Adieu. Le facteur et le déjeuner m'attendent. G.
J’ai passé ma matinée hier à recevoir des visites. Dix-neuf. Mon impression reste la même. Rien n’est changé au fond, dans la situation générale, ni dans la mienne. Seulement tout a éclaté et s'est exaspéré. C’est toujours la même lutte entre les mêmes classes et les mêmes passions, et j'y tiens toujours la même place. Mais évidemment le moment n'est pas venu pour moi, quand je le pourrais de la reprendre activement. Mes amis se troubleraient. Mes ennemis s’irriteraient. Et les uns et les autres saisiraient le premier prétexte pour rejeter sur moi seul la responsabilité du premier malheur. Et le public spectateur les croirait. Je n’ai qu'à attendre, si le temps, en s'en allant, n'emporte pas trop tôt ce qui me reste de forces, je puis avoir encore un grand moment. Si je m'en vais avant que ce moment n’arrive, j'ai lieu d'espérer aujourd’hui que justice sera faite à mon nom. Fait général. Les honnêtes gens ont moins peur des coquins que je ne m’y attendais. Ils prévoient de nouvelles luttes, sont très décidés à les soutenir, et comptent sur la victoire. Ceci je le vois. Les coquins que je ne vois pas, sont à ce qu'on me dit, assez découragés et sans confiance dans l'avenir. Ce qui ne les empêchera pas de recommencer. L’esprit manque aux uns et aux autres. Ils sont tous de très petite taille et de vue très courte. C’est une guerre entre des nains aveugles. Il y a dans les deux camps, plus de force et de courage qu’il n'en faut pour se livrer de bien autres combats que ceux qu’ils se livrent des combats au bout desquels viendrait nécessairement la grande défaite ou la grande victoire. Mais ils ont, les uns et les autres, si peu d'intelligence et de portée d'esprit, ils sont tellement au-dessous des questions et des événements qu’ils remuent, qu’il pourra fort bien leur arriver de s’agiter longtemps et misérablement sans rien finir. Il ne serait pas, je crois, bien difficile de faire agir efficacement les honnêtes gens si on pouvait leur faire réellement voir ce dont il s’agit. Ils ne voient pas. Je vous envoie mes réflexions, n'ayant point de faits. La prorogation de l'assemblée sera probablement plus courte qu’on ne l’avait dit. Le sentiment général, dans le parti de l'ordre, est contre. On craint de laisser tout seul un pouvoir si faible et un cabinet si douteux. Ce n'est plus la république seule, c’est la Montagne elle-même qui est l’objet des moqueries populaires. Autrefois, dit-on, la montagne accouchait ; aujourd’hui elle découche.
Onze heures et demie
Je regrette que Brougham et Aberdeen aient perdu leur bataille à 12 voix. Je vais les lire. Je me suis abonné, au Galignani pour rester au courant de l’Angleterre. C'est pourtant le lieu où vous êtes ! Vous ne me dites rien de votre santé. J’en conclus que ce n'est pas mal. Je vous le redemande en grâce ; n'oubliez pas ce que vous m'aurez promis. Adieu, Adieu. Le facteur et le déjeuner m'attendent. G.
Val-Richer, Dimanche 5 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche, 5 août 1849
7 heures
J'allume mon feu, en me levant. André le prépare la veille ; un bon petit fagot ; je n'ai qu’une allumette à y mettre. J’ai toujours avec plaisir du feu pendant deux heures le matin pour ma toilette. Il fait très beau, mais point chaud. Décidément du moins jusqu’à ce que l’automne se fasse sentir, je garde l’appartement que j’avais ; je le préfère beaucoup ; il m'est plus commode mes deux cabinets de toilette sont beaucoup plus grands ; j'ai beaucoup plus de place pour mes papiers. Il est plus loin du service de la maison ; c'est de l'autre côté que se font les affaires de ménage, qu'on va et vient. D'ailleurs pas la moindre trace d’humidité pas plus de mon côté que de l'autre. Enfin j'aime mieux, pour moi, rester où je suis si je m’aperçois plus tard que l'exposition à quelque inconvénient ; je changerai. Jusqu'à présent, à mon goûts je perdrais au change.
Vous voyez que les bruits de 18 Brumaire et d'Empire s'en vont en fumée. Je vous l'ai dit ; personne ne croit que la durée du régime actuel sait possible ; mais personne n'a et n'aura le courage de prendre l'initiative d’un changement. La République et la Constitution seront, non pas respectées, mais pas touchées, parce qu'elles sont ce qu'on appelle le fait établi et l’ordre légal et parce que personne n'a bien envie de ni bien confiance sans ce qui viendront après. On attendra la nécessité de changer, la nécessité évidente, urgente, absolue. Et cette nécessité ne viendra si elle vient que lorsqu'on approchera d’une nouvelle élection du président et de l'Assemblée ; jamais une société n'a été plus résignée à l'état horrible et précaire, au pain et à l'eau, ce qu’il faut strictement pour vous aujourd’hui, sans certitude de l'avoir demain. Cela même ne peut pas durer j’en suis bien sûr. Mais combien de jours, de mois, d'années Pour la vie des grands états, nous m'avons pas la mesure du temps. La honte est immense ; le danger matériel et personnel peu de chose. A la condition d'abaisser à ce point leurs prétentions, les honnêtes gens sont les maîtres du terrain. Restent les évènements imprévus, les nécessités inattendues les coups du sort, qui sont les décrets de Dieu. Pour ceci, la France actuelle, n'est pas en état d’y pourvoir, et si elle y est forcée, il faudra bien quelle change. Je n’entrevois, pour le moment, rien de semblable à l'horizon. Il n’y a plus en Italie que des embarras. Le Pape bataillera plus ou moins longtemps pour avoir dans son gouvernement plus ou moins de laïques ; le Roi de Sardaigne luttera comme il pourra contre sa nouvelle chambre quasi-belliqueuse et républicaine mais l’un et l'autre vivront sous la tutelle du trio Français, Autrichien et Anglais qui sera plus ou moins d'accord, mais qui le sera assez pour maintenir ce qui vient de se rétablir. La Hongrie traine, malgré les prédictions de Lord Ponsonby. Les élections Prussiennes, à ce qu’il paraît modérées. L'Allemagne, qui a un avenir bien plus gros que l'Italie, semble faire une halte après une orgie. Les deux états sont Londres et Pétersbourg, ne demandent qu'à se tenir tranquilles en veillant auprès des Etats malades. Mes pronostics sont donc à l'immobilité pour demain, après-demain. Nous verrons plus tard. Je ne vois personne qui ait la moindre inquiétude pour la tranquillité de Paris.
Onze heures
Je suis bien aise que vous ayez revu M. Guéneau de Mussy. Je désire que même bien portante, il vous voie de temps en temps. Adieu. Adieu. J’ai reçu je ne sais combien de lettres insignifiantes deux ou trois exigent une réponse sur le champ. Adieu, dearest. G.
7 heures
J'allume mon feu, en me levant. André le prépare la veille ; un bon petit fagot ; je n'ai qu’une allumette à y mettre. J’ai toujours avec plaisir du feu pendant deux heures le matin pour ma toilette. Il fait très beau, mais point chaud. Décidément du moins jusqu’à ce que l’automne se fasse sentir, je garde l’appartement que j’avais ; je le préfère beaucoup ; il m'est plus commode mes deux cabinets de toilette sont beaucoup plus grands ; j'ai beaucoup plus de place pour mes papiers. Il est plus loin du service de la maison ; c'est de l'autre côté que se font les affaires de ménage, qu'on va et vient. D'ailleurs pas la moindre trace d’humidité pas plus de mon côté que de l'autre. Enfin j'aime mieux, pour moi, rester où je suis si je m’aperçois plus tard que l'exposition à quelque inconvénient ; je changerai. Jusqu'à présent, à mon goûts je perdrais au change.
Vous voyez que les bruits de 18 Brumaire et d'Empire s'en vont en fumée. Je vous l'ai dit ; personne ne croit que la durée du régime actuel sait possible ; mais personne n'a et n'aura le courage de prendre l'initiative d’un changement. La République et la Constitution seront, non pas respectées, mais pas touchées, parce qu'elles sont ce qu'on appelle le fait établi et l’ordre légal et parce que personne n'a bien envie de ni bien confiance sans ce qui viendront après. On attendra la nécessité de changer, la nécessité évidente, urgente, absolue. Et cette nécessité ne viendra si elle vient que lorsqu'on approchera d’une nouvelle élection du président et de l'Assemblée ; jamais une société n'a été plus résignée à l'état horrible et précaire, au pain et à l'eau, ce qu’il faut strictement pour vous aujourd’hui, sans certitude de l'avoir demain. Cela même ne peut pas durer j’en suis bien sûr. Mais combien de jours, de mois, d'années Pour la vie des grands états, nous m'avons pas la mesure du temps. La honte est immense ; le danger matériel et personnel peu de chose. A la condition d'abaisser à ce point leurs prétentions, les honnêtes gens sont les maîtres du terrain. Restent les évènements imprévus, les nécessités inattendues les coups du sort, qui sont les décrets de Dieu. Pour ceci, la France actuelle, n'est pas en état d’y pourvoir, et si elle y est forcée, il faudra bien quelle change. Je n’entrevois, pour le moment, rien de semblable à l'horizon. Il n’y a plus en Italie que des embarras. Le Pape bataillera plus ou moins longtemps pour avoir dans son gouvernement plus ou moins de laïques ; le Roi de Sardaigne luttera comme il pourra contre sa nouvelle chambre quasi-belliqueuse et républicaine mais l’un et l'autre vivront sous la tutelle du trio Français, Autrichien et Anglais qui sera plus ou moins d'accord, mais qui le sera assez pour maintenir ce qui vient de se rétablir. La Hongrie traine, malgré les prédictions de Lord Ponsonby. Les élections Prussiennes, à ce qu’il paraît modérées. L'Allemagne, qui a un avenir bien plus gros que l'Italie, semble faire une halte après une orgie. Les deux états sont Londres et Pétersbourg, ne demandent qu'à se tenir tranquilles en veillant auprès des Etats malades. Mes pronostics sont donc à l'immobilité pour demain, après-demain. Nous verrons plus tard. Je ne vois personne qui ait la moindre inquiétude pour la tranquillité de Paris.
Onze heures
Je suis bien aise que vous ayez revu M. Guéneau de Mussy. Je désire que même bien portante, il vous voie de temps en temps. Adieu. Adieu. J’ai reçu je ne sais combien de lettres insignifiantes deux ou trois exigent une réponse sur le champ. Adieu, dearest. G.
Broglie, Vendredi 14 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie, Vendredi 14 Sept 1849 4 heures
Nous revenons d’une longue promenade, tous ensemble sauf Melle Chabaud qui ne peut marcher ni vite, ni longtemps. Nous causons beaucoup. Je crois que ma visite leur est très agréable. C’est du mouvement porté chez les gens qui l’aiment et qui ne savent pas s’en donner. Nous connaissons, vous et moi, ce genre de succès.
Samedi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier par des visites qui m'ont retenu jusqu'à l’heure du dîner. Je m’aperçois ce matin que c’est samedi et que j'ai mis hier ma lettre à la poste comme si vous pouviez l'avoir demain. Peu importe du reste. Le Duc de Broglie ne désespère pas au fond, autant qu’il le dit et qu’il le croit. Une idée le préoccupe constamment, et c’est une idée d'avenir. Comment faudrait-il reconstituer le Gouvernement si on avait à le reconstituer, mettant de côté la question du nom propre de ce gouvernement. Faire un bon lit, n'importe qui doive y coucher. Son avis est qu'on obtiendra beaucoup plus avant qu’on ne ferait après, en fait de garanties d’ordre, et de pouvoir. Parce que tant qu’il ne sera pas question de nom propre, tout le parti conservateur sera uni. Parce que, sous le manteau de la République on ira plus loin que sous aucun autre en fait de conservation. Parce qu'il faut que le gouvernement qui devra durer, trouve, quand il viendra, ses affaires essentielles toutes faites, faites par la France elle-même, sous sa responsabilité nationale, et ne soit pas obligé de les faire lui-même, et de répondre de la solution des questions. Le Duc de Broglie cherche donc la solution de toutes les questions constitutionnelles, la meilleure solution possible. Il ne croit pas qu'on révise la Constitution bientôt, ni par des coups d'Etat ; mais il ne croit pas non plus qu’on s’expose à une nouvelle épreuve de la constitution actuelle à la réélection d’une assemblée et d'un président par le suffrage universel, tel qu’il est établi aujourd’hui. Aux approches de cette épreuve-là, on prendra son parti de sauter le fossé plutôt que d’y tomber. 10 heures Je ne m'étonne pas que la malle ne soit pas arrivée en Angleterre. Nous avons vécu quatre jours au milieu des orages. Cela se calme.
Si les Holland sont en Angleterre, pourriez vous éclairer ceci ? Le Duc de Broglie était très lié avec eux et allait sans cesse à Holland House pendant son dernier séjour à Londres. Dés qu’il les a sus à Paris, il est allé les chercher et ne les a pas trouvés. Ils ont mis simplement une carte chez lui et il n’en a plus entendu parler du tout. Il ne comprend pas. Ils ne vivent, dit-il, que sur la frontière la plus rapprochée des rouges, et avec Jérôme Bonaparte. Il suppose que la froideur vient de là. La rigueur envers Gilberti est en effet un peu drôle. Pendant qu’Albert de Broglie, était encore à Rome, Gilberti y est venu. Le Pape l’a reçu, complimenté, embrassé, comblé. Et son livre avait paru. Les gouvernements oublient trop qu'aujourd’hui on n'oublie rien sur leur compte du moins. Ils sont condamnés à plus de prévoyance, et de conséquence que n’en comporte peut-être la faiblesse humaine.
A cela près du contraste trop choquant, je trouve fort simple que le Pape mette à l’Index, les livres, qu’il trouve mauvais et dangereux. C’est de sa part une simple déclaration de son jugement qui ne coûte pas un cheveu aux auteurs, et un avertisse ment à la conscience des Catholiques qu'il a charge de diriger. Quand on interdit au Pape l'index, et qu'on lui commande un gouvernement libéral, on lui interdit tout simplement d'être le Pape. Adieu. Adieu. Je suis préoccupé du Choléra de Londres. Celui de Paris est stationnaire. Adieu. G. Je n’ai pas su lire le nom de Lord .... avec qui vous avez dîné chez Lady Alice. Je trouve pourtant votre écriture meilleure que vos yeux ne se comportent.
Nous revenons d’une longue promenade, tous ensemble sauf Melle Chabaud qui ne peut marcher ni vite, ni longtemps. Nous causons beaucoup. Je crois que ma visite leur est très agréable. C’est du mouvement porté chez les gens qui l’aiment et qui ne savent pas s’en donner. Nous connaissons, vous et moi, ce genre de succès.
Samedi 15, 7 heures
J’ai été interrompu hier par des visites qui m'ont retenu jusqu'à l’heure du dîner. Je m’aperçois ce matin que c’est samedi et que j'ai mis hier ma lettre à la poste comme si vous pouviez l'avoir demain. Peu importe du reste. Le Duc de Broglie ne désespère pas au fond, autant qu’il le dit et qu’il le croit. Une idée le préoccupe constamment, et c’est une idée d'avenir. Comment faudrait-il reconstituer le Gouvernement si on avait à le reconstituer, mettant de côté la question du nom propre de ce gouvernement. Faire un bon lit, n'importe qui doive y coucher. Son avis est qu'on obtiendra beaucoup plus avant qu’on ne ferait après, en fait de garanties d’ordre, et de pouvoir. Parce que tant qu’il ne sera pas question de nom propre, tout le parti conservateur sera uni. Parce que, sous le manteau de la République on ira plus loin que sous aucun autre en fait de conservation. Parce qu'il faut que le gouvernement qui devra durer, trouve, quand il viendra, ses affaires essentielles toutes faites, faites par la France elle-même, sous sa responsabilité nationale, et ne soit pas obligé de les faire lui-même, et de répondre de la solution des questions. Le Duc de Broglie cherche donc la solution de toutes les questions constitutionnelles, la meilleure solution possible. Il ne croit pas qu'on révise la Constitution bientôt, ni par des coups d'Etat ; mais il ne croit pas non plus qu’on s’expose à une nouvelle épreuve de la constitution actuelle à la réélection d’une assemblée et d'un président par le suffrage universel, tel qu’il est établi aujourd’hui. Aux approches de cette épreuve-là, on prendra son parti de sauter le fossé plutôt que d’y tomber. 10 heures Je ne m'étonne pas que la malle ne soit pas arrivée en Angleterre. Nous avons vécu quatre jours au milieu des orages. Cela se calme.
Si les Holland sont en Angleterre, pourriez vous éclairer ceci ? Le Duc de Broglie était très lié avec eux et allait sans cesse à Holland House pendant son dernier séjour à Londres. Dés qu’il les a sus à Paris, il est allé les chercher et ne les a pas trouvés. Ils ont mis simplement une carte chez lui et il n’en a plus entendu parler du tout. Il ne comprend pas. Ils ne vivent, dit-il, que sur la frontière la plus rapprochée des rouges, et avec Jérôme Bonaparte. Il suppose que la froideur vient de là. La rigueur envers Gilberti est en effet un peu drôle. Pendant qu’Albert de Broglie, était encore à Rome, Gilberti y est venu. Le Pape l’a reçu, complimenté, embrassé, comblé. Et son livre avait paru. Les gouvernements oublient trop qu'aujourd’hui on n'oublie rien sur leur compte du moins. Ils sont condamnés à plus de prévoyance, et de conséquence que n’en comporte peut-être la faiblesse humaine.
A cela près du contraste trop choquant, je trouve fort simple que le Pape mette à l’Index, les livres, qu’il trouve mauvais et dangereux. C’est de sa part une simple déclaration de son jugement qui ne coûte pas un cheveu aux auteurs, et un avertisse ment à la conscience des Catholiques qu'il a charge de diriger. Quand on interdit au Pape l'index, et qu'on lui commande un gouvernement libéral, on lui interdit tout simplement d'être le Pape. Adieu. Adieu. Je suis préoccupé du Choléra de Londres. Celui de Paris est stationnaire. Adieu. G. Je n’ai pas su lire le nom de Lord .... avec qui vous avez dîné chez Lady Alice. Je trouve pourtant votre écriture meilleure que vos yeux ne se comportent.
Broglie, Jeudi 20 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie jeudi 20 Sept 1849 Sept heures
J’ai tout le jour sous les yeux une preuve frappante qu’il n’y a aujourd’hui pour la France, dans la pensée de tout le monde, point de politique extérieure. Personne n'en parle. Personne ne songe à en rien demander ni à en rien dire. Il vient ici assez de visites ; on ne parle que des affaires publiques ; point des Affaires étrangères ; un mot, en passant, sur Rome, qui tombe aussitôt et qui est dit plutôt pour parler du Président. qu'on est curieux de bien connaître, que de Rome dont on ne se soucie pas. La France n’est préoccupée que d'elle-même. Le Duc de Broglie me dit qu’il répète sans cesse aux Ministres : " La paix à tout prix, et point d'affaires ; la République ne peut pas avoir une autre politique. " Il a raison, et le public, est de son avis. Les journaux seuls sont en dehors de cette disposition du public, et raisonnent à perte de vue sur l'Europe. Et leurs lecteurs se plaisent assez à cela. Mais comment on se plaît à un moment de badauderie et d'oisiveté. Personne ne prend les journaux au sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'à la longue ils n'agissent. Un jour viendra où le pays sortira de cette insouciance forcée sur sa politique et sa position au dehors, et s’en vengera sur le gouvernement qui lui en fait une nécessité. Etrange chaos que l'état des esprits et ce qu'ils ont à la fois d'activité et d’apathie de passion et d’indifférence de bon sens et d’inintelligence. Plus j'y regarde, plus je me persuade que c’est bien un état de transition, non une chute définitive. C'est ma seule consolation, et je crois que c’est la vérité.
Transition à quoi. Je n’en sais pas plus que je n’en savais quand nous avions le bonheur de causer ensemble de tout cela. Pourtant je suis plutôt confirmé qu’ébranlé dans l’idée à laquelle j'aboutissais en définitive quand nous voulions absolument voir à ceci une issue.
Onze heures
Je vous reviens après être allé entendre une homélie de l'évêque d'Evreux dans l’Eglise de Broglie. Hélas oui, il y a deux grands mois que nous nous sommes quittés ! Je n'essaie pas de vous dire combien vous me manquez. Vous me manquez non seulement pour les choses que je ne dis qu'à vous et que je n’entends que de vous, là où le vide est complet quand vous n’y êtes pas. Vous me manquez même dans les moments où il n’y a pas de vide, ou ce que j’entends et dis me plait et m'intéresse. Je suis toujours sur le point de me retourner pour voir si vous êtes là et pour vous mettre de part dans tout. Que de choses je ne dis pas que je vous dirais, et que de choses je vous dirais que je ne vous ai jamais dîtes ! Et la vie s’écoule dans cette impatience d’une affection qui ne donne et ne reçoit pas, tout ce qu'elle pourrait recevoir et donner dans le sentiment d’un grand bonheur possible et manqué.
Paris sera tranquille. Et si les rouges essayaient de le troubler la tranquillité serait pleinement rétablie en quelques heures comme au 13 Juin. La force et la volonté de faire cela y sont également. Certainement le choléra diminue. Pourtant il y en a encore, et presque toujours grave. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'à cause du Choléra, on retardait de quinze jours la rentrée des écoliers aux collèges ?
La lettre de Marion est charmante et très originale, si cette aimable fille était heureuse, elle aurait tout le bon sens hors duquel elle se jette quelquefois pour répandre et animer son âme. Elle a naturellement beaucoup de bon sens. Mais il faut aux femmes même aux plus distinguées, du bonheur personnel, et de cœur, pour être dans cet équilibre intérieur qui met en état de voir les choses du dehors comme elles sont réellement, parce qu'on n'a rien à leur demander. Je parlais un jour à la Duchesse de Broglie d’une jeune femme de sa connaissance, et de la mienne qui avant son mariage avait un amour propre assez agité et exigeant, et qui depuis son mariage, était devenue parfaitement calme et modeste : " Je le crois bien, me dit-elle, elle a ce qui apaise et satisfait le plus grand amour propre possible d’une femme : elle est aimée et heureuse. " J'ai bien souvent reconnu la vérité de cela. J’ai peur que notre bonne Marion reste toujours républicaine, tantôt pour Cavaignac, tantôt pour Manin, faute d'avoir son roi à elle, un mari qu'elle adore, et qui l'adore. Adieu. Adieu.
Je ne vois rien dans mes journaux de ce matin. Je pars toujours le 28 pour retourner au Val Richer le Duc de Broglie, le 29 pour Paris. Il veut être au premier jour de l’assemblée aussi à la réunion du Conseil d'Etat qui aura probablement, lieu la veille. Adieu, Adieu, Adieu. G.
J’ai tout le jour sous les yeux une preuve frappante qu’il n’y a aujourd’hui pour la France, dans la pensée de tout le monde, point de politique extérieure. Personne n'en parle. Personne ne songe à en rien demander ni à en rien dire. Il vient ici assez de visites ; on ne parle que des affaires publiques ; point des Affaires étrangères ; un mot, en passant, sur Rome, qui tombe aussitôt et qui est dit plutôt pour parler du Président. qu'on est curieux de bien connaître, que de Rome dont on ne se soucie pas. La France n’est préoccupée que d'elle-même. Le Duc de Broglie me dit qu’il répète sans cesse aux Ministres : " La paix à tout prix, et point d'affaires ; la République ne peut pas avoir une autre politique. " Il a raison, et le public, est de son avis. Les journaux seuls sont en dehors de cette disposition du public, et raisonnent à perte de vue sur l'Europe. Et leurs lecteurs se plaisent assez à cela. Mais comment on se plaît à un moment de badauderie et d'oisiveté. Personne ne prend les journaux au sérieux. Ce qui n'empêche pas qu'à la longue ils n'agissent. Un jour viendra où le pays sortira de cette insouciance forcée sur sa politique et sa position au dehors, et s’en vengera sur le gouvernement qui lui en fait une nécessité. Etrange chaos que l'état des esprits et ce qu'ils ont à la fois d'activité et d’apathie de passion et d’indifférence de bon sens et d’inintelligence. Plus j'y regarde, plus je me persuade que c’est bien un état de transition, non une chute définitive. C'est ma seule consolation, et je crois que c’est la vérité.
Transition à quoi. Je n’en sais pas plus que je n’en savais quand nous avions le bonheur de causer ensemble de tout cela. Pourtant je suis plutôt confirmé qu’ébranlé dans l’idée à laquelle j'aboutissais en définitive quand nous voulions absolument voir à ceci une issue.
Onze heures
Je vous reviens après être allé entendre une homélie de l'évêque d'Evreux dans l’Eglise de Broglie. Hélas oui, il y a deux grands mois que nous nous sommes quittés ! Je n'essaie pas de vous dire combien vous me manquez. Vous me manquez non seulement pour les choses que je ne dis qu'à vous et que je n’entends que de vous, là où le vide est complet quand vous n’y êtes pas. Vous me manquez même dans les moments où il n’y a pas de vide, ou ce que j’entends et dis me plait et m'intéresse. Je suis toujours sur le point de me retourner pour voir si vous êtes là et pour vous mettre de part dans tout. Que de choses je ne dis pas que je vous dirais, et que de choses je vous dirais que je ne vous ai jamais dîtes ! Et la vie s’écoule dans cette impatience d’une affection qui ne donne et ne reçoit pas, tout ce qu'elle pourrait recevoir et donner dans le sentiment d’un grand bonheur possible et manqué.
Paris sera tranquille. Et si les rouges essayaient de le troubler la tranquillité serait pleinement rétablie en quelques heures comme au 13 Juin. La force et la volonté de faire cela y sont également. Certainement le choléra diminue. Pourtant il y en a encore, et presque toujours grave. Ne vous ai-je pas déjà dit hier qu'à cause du Choléra, on retardait de quinze jours la rentrée des écoliers aux collèges ?
La lettre de Marion est charmante et très originale, si cette aimable fille était heureuse, elle aurait tout le bon sens hors duquel elle se jette quelquefois pour répandre et animer son âme. Elle a naturellement beaucoup de bon sens. Mais il faut aux femmes même aux plus distinguées, du bonheur personnel, et de cœur, pour être dans cet équilibre intérieur qui met en état de voir les choses du dehors comme elles sont réellement, parce qu'on n'a rien à leur demander. Je parlais un jour à la Duchesse de Broglie d’une jeune femme de sa connaissance, et de la mienne qui avant son mariage avait un amour propre assez agité et exigeant, et qui depuis son mariage, était devenue parfaitement calme et modeste : " Je le crois bien, me dit-elle, elle a ce qui apaise et satisfait le plus grand amour propre possible d’une femme : elle est aimée et heureuse. " J'ai bien souvent reconnu la vérité de cela. J’ai peur que notre bonne Marion reste toujours républicaine, tantôt pour Cavaignac, tantôt pour Manin, faute d'avoir son roi à elle, un mari qu'elle adore, et qui l'adore. Adieu. Adieu.
Je ne vois rien dans mes journaux de ce matin. Je pars toujours le 28 pour retourner au Val Richer le Duc de Broglie, le 29 pour Paris. Il veut être au premier jour de l’assemblée aussi à la réunion du Conseil d'Etat qui aura probablement, lieu la veille. Adieu, Adieu, Adieu. G.
Broglie, Vendredi 21 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie. Vendredi 21 sept 1849 5 heures
Je vois ici bien du monde. Presque autant qu’au Val Richer. En gens du pays du moins. Tous les conservateurs des environs, anciens ou nouveaux viennent me voir. Je suis frappé de ce qu’il y a en même temps, de résolution et de timidité dans leur langage. Ils sont très réactionnaires ; ils demandent de l'ordre du pouvoir, tant qu’on voudra tant qu'on pourra leur en donner mais sous le régime actuel avec les noms actuels. Ils n'abordent pas l'idée, d'un changement au fond. La république peut devenir conservatrice, despotique, aristocratique même ; ou lui en saura gré. Mais la République, je ne vois presque personne qui pense, qui veuille dire du moins qu’il pense à autre chose. Les plus hardis disent que la République pourrait bien n'être qu'une expérience, et une expérience qui ne réussira pas. Mais ils admettent tous l'expérience, et ne la regardent que comme déjà faite. Ils attendent et blâmeraient ceux qui ne voudraient pas attendre. Pour trouver des gens qui maudissent tout haut la République, qui n’en attendent rien et qui demandent pourquoi on attend ; il faut descendre beaucoup plus bas que les gens qui viennent me voir. Il faut aller parmi le peuple chez les paysans. La point de gêne, point de retenue. Et très généralement. L'Empire serait très bien reçu. Le comte de Paris serait très bien reçu. Henri V, c’est plus douteux. La Monarchie est populaire, la légitimité non. Mais pas plus pour le comte de Paris ou pour l'Empereur que pour Henri V, aucun de ceux qui maudissent la République ne remuerait le doigt. Les paysans qui demandent pourquoi on attend attendant aussi tranquillement que les bourgeois. A dire vrai depuis que les rouges ont été bien battus et qu’on croit qu'ils le seraient encore, s'ils remuaient, l’ordre règne partout, l'administration marche, les affaires se font, les intérêts privés s'arrangent, à peu près comme en temps ordinaire. Il est facile ici de renverser les gouvernement très difficile de bouleverser la société ; elle reprend très vite, son aplomb. A très courte échéance, il est vrai ; personne ne fait ni projets, ni longues affaires ; personne ne bâtit une grande maison ; personne ne prête son argent pour plus de deux ans jusqu'aux approches de la prochaine élection du Président et de l'Assemblée. Combien de temps un grand pays peut-il se passer absolument d’avenir ? Pas toujours j’en suis sûr. Mais ce pays-ci assez longtemps, j'en ai peur. S'il est grand, les hommes qui l'habitent sont si petits qu’ils ont bien moins besoin d'avenir. Ce qui est petit se résigne bien plus aisément à être court. Il est vrai qu'on en devient plus Petit, et qu’on souffre de ce rapetissement forcé de toutes les Affaires, de toutes les transactions, de toutes les entreprises, de toutes les existences. Je crois même que cette souffrance ira croissant, et finira par devenir insupportable Mais, pour le moment elle est encore assez limité ; et on la supporte assez bien. Singulier état ! Très triste à voir, mais très nouveau et très curieux à observer. Jamais certainement pays si malade au fond n'a eu si peu l’air, d'être malade, pour quelqu'un qui me ferait que le voir en passant. M de Falloux, dit très malade. Sa mort serait presque un évènement. Les légitimistes comptent sur lui, non seulement pour l'avenir, Mais pour prendre une part chaque jour un peu plu grosse en attendant. Il n'ont personne pour le remplacer.
Samedi 22- sept heures
Pouvez-vous me dire que les portraits de Mad. de Caraman sont d’une ressemblance frappante, et que vous ne voulez pas poser parce que cela vous ennuie trop ? Vous ne savez pas quel plaisir me ferait un portrait de vous vraiment ressemblant, ou bien vous n’avez pas le courage de vous donner cet ennui pour me donner ce plaisir. Si j'étais là, je vous gronderais beaucoup. De loin, il faut être court. Depuis que vous n’avez plus d’yeux, je ne sais plus que m'affliger de votre ennui. Je ne peux plus vous dire : lisez, écrivez. Vous devriez trouver une lectrice qui pût vous lire du français. Cela doit se trouver, même à Richmond. Elle vous lirait une heure ou deux dans la journée, la Revue des deux mondes, Mad. de Krudener. Quoiqu'on ne publie plus grand chose de bon à Paris, il y aurait cependant de quoi vous désennuyer un peu. Vous n'aurez plus besoin de cela à Paris. Il y aura assez de conversation pour remplir votre temps. Barante, Ste Aulaire, Duchâtel y passeront l’hiver. Tout ce qui me revient me persuade de plus en plus qu’il n’y aura point de gros événement ; rien dans les rues. Il n’y aurait que la dislocation de la majorité dans l’Assemblée qui pût amener quelque chose de gros. Mais elle me paraît bien décidée à ne pas le disloquer. Il y a, dans la masse honnête des légitimistes, beaucoup d'humeur contre leurs journaux qui les poussent, et les compromettent.
9 heures
Merci de votre longue lettre, et de cette de Lord Beauvale. Très intéressantes. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. J'ai là des épreuves de mon livre qu’il faut que je corrige et que je renvoie sur le champ à Paris. Je n'ai rien de là ce matin. Adieu, adieu, adieu. G.
Je vois ici bien du monde. Presque autant qu’au Val Richer. En gens du pays du moins. Tous les conservateurs des environs, anciens ou nouveaux viennent me voir. Je suis frappé de ce qu’il y a en même temps, de résolution et de timidité dans leur langage. Ils sont très réactionnaires ; ils demandent de l'ordre du pouvoir, tant qu’on voudra tant qu'on pourra leur en donner mais sous le régime actuel avec les noms actuels. Ils n'abordent pas l'idée, d'un changement au fond. La république peut devenir conservatrice, despotique, aristocratique même ; ou lui en saura gré. Mais la République, je ne vois presque personne qui pense, qui veuille dire du moins qu’il pense à autre chose. Les plus hardis disent que la République pourrait bien n'être qu'une expérience, et une expérience qui ne réussira pas. Mais ils admettent tous l'expérience, et ne la regardent que comme déjà faite. Ils attendent et blâmeraient ceux qui ne voudraient pas attendre. Pour trouver des gens qui maudissent tout haut la République, qui n’en attendent rien et qui demandent pourquoi on attend ; il faut descendre beaucoup plus bas que les gens qui viennent me voir. Il faut aller parmi le peuple chez les paysans. La point de gêne, point de retenue. Et très généralement. L'Empire serait très bien reçu. Le comte de Paris serait très bien reçu. Henri V, c’est plus douteux. La Monarchie est populaire, la légitimité non. Mais pas plus pour le comte de Paris ou pour l'Empereur que pour Henri V, aucun de ceux qui maudissent la République ne remuerait le doigt. Les paysans qui demandent pourquoi on attend attendant aussi tranquillement que les bourgeois. A dire vrai depuis que les rouges ont été bien battus et qu’on croit qu'ils le seraient encore, s'ils remuaient, l’ordre règne partout, l'administration marche, les affaires se font, les intérêts privés s'arrangent, à peu près comme en temps ordinaire. Il est facile ici de renverser les gouvernement très difficile de bouleverser la société ; elle reprend très vite, son aplomb. A très courte échéance, il est vrai ; personne ne fait ni projets, ni longues affaires ; personne ne bâtit une grande maison ; personne ne prête son argent pour plus de deux ans jusqu'aux approches de la prochaine élection du Président et de l'Assemblée. Combien de temps un grand pays peut-il se passer absolument d’avenir ? Pas toujours j’en suis sûr. Mais ce pays-ci assez longtemps, j'en ai peur. S'il est grand, les hommes qui l'habitent sont si petits qu’ils ont bien moins besoin d'avenir. Ce qui est petit se résigne bien plus aisément à être court. Il est vrai qu'on en devient plus Petit, et qu’on souffre de ce rapetissement forcé de toutes les Affaires, de toutes les transactions, de toutes les entreprises, de toutes les existences. Je crois même que cette souffrance ira croissant, et finira par devenir insupportable Mais, pour le moment elle est encore assez limité ; et on la supporte assez bien. Singulier état ! Très triste à voir, mais très nouveau et très curieux à observer. Jamais certainement pays si malade au fond n'a eu si peu l’air, d'être malade, pour quelqu'un qui me ferait que le voir en passant. M de Falloux, dit très malade. Sa mort serait presque un évènement. Les légitimistes comptent sur lui, non seulement pour l'avenir, Mais pour prendre une part chaque jour un peu plu grosse en attendant. Il n'ont personne pour le remplacer.
Samedi 22- sept heures
Pouvez-vous me dire que les portraits de Mad. de Caraman sont d’une ressemblance frappante, et que vous ne voulez pas poser parce que cela vous ennuie trop ? Vous ne savez pas quel plaisir me ferait un portrait de vous vraiment ressemblant, ou bien vous n’avez pas le courage de vous donner cet ennui pour me donner ce plaisir. Si j'étais là, je vous gronderais beaucoup. De loin, il faut être court. Depuis que vous n’avez plus d’yeux, je ne sais plus que m'affliger de votre ennui. Je ne peux plus vous dire : lisez, écrivez. Vous devriez trouver une lectrice qui pût vous lire du français. Cela doit se trouver, même à Richmond. Elle vous lirait une heure ou deux dans la journée, la Revue des deux mondes, Mad. de Krudener. Quoiqu'on ne publie plus grand chose de bon à Paris, il y aurait cependant de quoi vous désennuyer un peu. Vous n'aurez plus besoin de cela à Paris. Il y aura assez de conversation pour remplir votre temps. Barante, Ste Aulaire, Duchâtel y passeront l’hiver. Tout ce qui me revient me persuade de plus en plus qu’il n’y aura point de gros événement ; rien dans les rues. Il n’y aurait que la dislocation de la majorité dans l’Assemblée qui pût amener quelque chose de gros. Mais elle me paraît bien décidée à ne pas le disloquer. Il y a, dans la masse honnête des légitimistes, beaucoup d'humeur contre leurs journaux qui les poussent, et les compromettent.
9 heures
Merci de votre longue lettre, et de cette de Lord Beauvale. Très intéressantes. Je n'ai que le temps de vous dire adieu. J'ai là des épreuves de mon livre qu’il faut que je corrige et que je renvoie sur le champ à Paris. Je n'ai rien de là ce matin. Adieu, adieu, adieu. G.
Broglie, Lundi 24 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie Lundi 24 sept 1849 5 heures
Je vais demain passer la journée à six lieues d’ici, chez M. Lenormant. Je partirai après l’arrivée de la poste, ce qui m'importe peu puisqu'elle ne m’apportera rien de vous. Je reviendrai dîner ici. J’ai promis cette visite depuis longtemps, et j’ai quelque chose à arranger avec Mad. Lenormant pour que les lettres de Mad. de Staël à Mad. Récamier ne courent pas le risque d'être publiées un de ces jours. Le Duc de Broglie y tient beaucoup.
On bat le rappel très vivement pour que tous les représentants soient à leur poste le 1er octobre. C’est un singulier état d’esprit de tout le monde, on s'attend à quelque chose et on ne s'attend à rien. On veut et on ne veut pas quelque chose de nouveau. On a fait une machine qui exige, et qui entraine le mouvement perpétuel ; elle l'impose a tout le pays malgré qu’il en ait. Les 99/100 du pays voudraient bien s’arrêter ; il n'y a pas moyen; ils sont dans le treadmill de la République. Voici comment on explique, la république et le suffrage universel à ceux qui demandent ce que ce régime là leur donnera à faire : " Vous aurez à travailler six jours pour faire toutes les élections, et on en vous laissera votre dimanche pour monter votre garde. " Mettant de côté tous les grands événements, le danger inévitable de la situation tranquille est celui-ci. Pour prévenir la banqueroute, il faut que l'assemblée actuelle rétablisse les impôts. Elle le fera, mais au grand mécontentement du peuple du suffrage universel qui s'en vengera le jour des élections. C’est la maintenant l’espérance des socialistes. Ils se promettent que le peuple aura plus de mauvaise humeur que de bon sens si on se laisse acculer au pied du mur, il y a bien à parier qu’ils auront raison. On dit qu'on ne se laissera pas acculer.
Mardi 25 sept. Sept heures J’ai devant moi un brouillard, tout semblable à ceux qui couvrent la vallée de Richmond. Précurseur assuré, ici, du beau temps pour la journée. La vallée de la Charentonne n’est pas si large, ni d'aussi riche aspect que celle de la Tamise, mais la forêt qui s'élève en amphithéâtre devant le château et les mouvements du terrain la rendent plus pittoresque. C'est bien dommage que nous ne nous y promenions pas aujourd'hui. Je n'ai rien de mieux à vous dire ceci pourtant. Quelques journaux de province qui reçoivent souvent des confidences de Paris disent depuis trois jours que si le pouvoir est offert à M. Molé il le prendra décidément. L'Impartial de Rouen, par ex. L'Emancipation de Bruxelles redit cela aujourd'hui. Ces bruits ont quelque valeur. Nous verrons bientôt. Adieu, adieu. G.
Je vais demain passer la journée à six lieues d’ici, chez M. Lenormant. Je partirai après l’arrivée de la poste, ce qui m'importe peu puisqu'elle ne m’apportera rien de vous. Je reviendrai dîner ici. J’ai promis cette visite depuis longtemps, et j’ai quelque chose à arranger avec Mad. Lenormant pour que les lettres de Mad. de Staël à Mad. Récamier ne courent pas le risque d'être publiées un de ces jours. Le Duc de Broglie y tient beaucoup.
On bat le rappel très vivement pour que tous les représentants soient à leur poste le 1er octobre. C’est un singulier état d’esprit de tout le monde, on s'attend à quelque chose et on ne s'attend à rien. On veut et on ne veut pas quelque chose de nouveau. On a fait une machine qui exige, et qui entraine le mouvement perpétuel ; elle l'impose a tout le pays malgré qu’il en ait. Les 99/100 du pays voudraient bien s’arrêter ; il n'y a pas moyen; ils sont dans le treadmill de la République. Voici comment on explique, la république et le suffrage universel à ceux qui demandent ce que ce régime là leur donnera à faire : " Vous aurez à travailler six jours pour faire toutes les élections, et on en vous laissera votre dimanche pour monter votre garde. " Mettant de côté tous les grands événements, le danger inévitable de la situation tranquille est celui-ci. Pour prévenir la banqueroute, il faut que l'assemblée actuelle rétablisse les impôts. Elle le fera, mais au grand mécontentement du peuple du suffrage universel qui s'en vengera le jour des élections. C’est la maintenant l’espérance des socialistes. Ils se promettent que le peuple aura plus de mauvaise humeur que de bon sens si on se laisse acculer au pied du mur, il y a bien à parier qu’ils auront raison. On dit qu'on ne se laissera pas acculer.
Mardi 25 sept. Sept heures J’ai devant moi un brouillard, tout semblable à ceux qui couvrent la vallée de Richmond. Précurseur assuré, ici, du beau temps pour la journée. La vallée de la Charentonne n’est pas si large, ni d'aussi riche aspect que celle de la Tamise, mais la forêt qui s'élève en amphithéâtre devant le château et les mouvements du terrain la rendent plus pittoresque. C'est bien dommage que nous ne nous y promenions pas aujourd'hui. Je n'ai rien de mieux à vous dire ceci pourtant. Quelques journaux de province qui reçoivent souvent des confidences de Paris disent depuis trois jours que si le pouvoir est offert à M. Molé il le prendra décidément. L'Impartial de Rouen, par ex. L'Emancipation de Bruxelles redit cela aujourd'hui. Ces bruits ont quelque valeur. Nous verrons bientôt. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Nature, Politique (France), Presse, République, Réseau social et politique
Val-Richer, Dimanche 7 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Dimanche 7 Juillet 1850
Six heures
Je me lève de bonne heure quoique je n'aie point à partir. Je me couche aussi de bonne heure, à 10 heures au plus tard. Je m’en trouve bien et comme santé et comme travail. J'écris et je fais mes affaires en me levant jusqu'à 11 heures. Dans le cours de la journée, je me promène beaucoup. Je vois peu de monde. Ce n'est pas, comme l'été dernier, un flux continu de visites de toutes parts, par amitié, par convenance, par curiosité. Il est impossible de mener une vie plus tranquille et plus régulière que la mienne. Mes enfants sont pleins d'affection et de soin. Je me passe très bien du mouvement extérieur qui me manque. Mais je ne me passe point de l’intimité intérieure. C'est là le vide.
Une chose me frappe dans les lettres de Paris dont je vous ai envoyé hier le résumé, et aussi dans les conversations que j'entends. Quoique personne ne devienne ni républicain, ni présidentiel, cependant la République et le président gagnent. Les légitimistes déplaisent de plus en plus. La monarchie sans les légitimistes paraît de plus en plus impossible. Point d'avenir donc hors de ce qui est; et qui n’a pas d'avenir non plus, mais qui est et que personne n'entreprend sérieusement de renverser n'étant pas sûr de le renverser à son profit. C’est un arbre qui ne grandit pas, qui ne s'enracine pas, qui ne pousse ni sur terre ni sous terre, mais qui reste debout. A quel point la nécessité, et l'habitude sont-elles suffisantes pour fonder un gouvernement ; voilà la question qui est en train de se résoudre. Je ne crois pas qu'elles soient suffisantes pour fonder, mais elles le sont, à coup sûr, pour faire durer longtemps. J’ai écrit cela hier à S Léonard avec détail, à la Reine. Mes nouvelles du Roi continuent d’être bonnes.
10 heures
Pas de lettre aujourd'hui. Cela ne m'étonne pas. Vous serez arrivée avant hier à Ems trop tard pour la poste. Je vois dans les journaux une crue subite du Rhin qui me déplaît. Vous avez dû aller de Cologne à Ems par le Rhin. J'espère que vous n'aurez eu ni sujet, ni seulement prétexte d'avoir peur. II ne me vient rien du tout de Paris ce matin. Je trouve que le ministère à l’air bien étourdi et bien impuissant. La loi sur la presse que tout le monde repousse, sa loi sur les maires qu’il voudrait et n'ose remettre à flot. Il semble que les esprits soient à bout comme les forces, et qu’on ne sache plus rien inventer qu'on puisse mener à bien. Adieu, Adieu. Vous me direz comment vous êtes établie à Ems. Adieu. G.
Six heures
Je me lève de bonne heure quoique je n'aie point à partir. Je me couche aussi de bonne heure, à 10 heures au plus tard. Je m’en trouve bien et comme santé et comme travail. J'écris et je fais mes affaires en me levant jusqu'à 11 heures. Dans le cours de la journée, je me promène beaucoup. Je vois peu de monde. Ce n'est pas, comme l'été dernier, un flux continu de visites de toutes parts, par amitié, par convenance, par curiosité. Il est impossible de mener une vie plus tranquille et plus régulière que la mienne. Mes enfants sont pleins d'affection et de soin. Je me passe très bien du mouvement extérieur qui me manque. Mais je ne me passe point de l’intimité intérieure. C'est là le vide.
Une chose me frappe dans les lettres de Paris dont je vous ai envoyé hier le résumé, et aussi dans les conversations que j'entends. Quoique personne ne devienne ni républicain, ni présidentiel, cependant la République et le président gagnent. Les légitimistes déplaisent de plus en plus. La monarchie sans les légitimistes paraît de plus en plus impossible. Point d'avenir donc hors de ce qui est; et qui n’a pas d'avenir non plus, mais qui est et que personne n'entreprend sérieusement de renverser n'étant pas sûr de le renverser à son profit. C’est un arbre qui ne grandit pas, qui ne s'enracine pas, qui ne pousse ni sur terre ni sous terre, mais qui reste debout. A quel point la nécessité, et l'habitude sont-elles suffisantes pour fonder un gouvernement ; voilà la question qui est en train de se résoudre. Je ne crois pas qu'elles soient suffisantes pour fonder, mais elles le sont, à coup sûr, pour faire durer longtemps. J’ai écrit cela hier à S Léonard avec détail, à la Reine. Mes nouvelles du Roi continuent d’être bonnes.
10 heures
Pas de lettre aujourd'hui. Cela ne m'étonne pas. Vous serez arrivée avant hier à Ems trop tard pour la poste. Je vois dans les journaux une crue subite du Rhin qui me déplaît. Vous avez dû aller de Cologne à Ems par le Rhin. J'espère que vous n'aurez eu ni sujet, ni seulement prétexte d'avoir peur. II ne me vient rien du tout de Paris ce matin. Je trouve que le ministère à l’air bien étourdi et bien impuissant. La loi sur la presse que tout le monde repousse, sa loi sur les maires qu’il voudrait et n'ose remettre à flot. Il semble que les esprits soient à bout comme les forces, et qu’on ne sache plus rien inventer qu'on puisse mener à bien. Adieu, Adieu. Vous me direz comment vous êtes établie à Ems. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 19 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 19 Juillet 1850
Je suis de l’avis de votre Princesse de Lippe-Schaumburg, (n'est-ce pas de la Lippe ?) ; il me semble que tout le monde se retire de l’union, et que le faiseur de l'Union est bien près lui-même d'y renoncer. Je saurai ces affaires-là avec précision d’ici à peu de jours ; mon gros, petit factotum a été de nouveau sollicité de faire en Allemagne le voyage que vous savez ; il est parti mardi, et il reviendra la semaine prochaine.
On tient beaucoup là, à ce qu’il me paraît, à établir avec les Débats de bonnes et un peu intimes relations. On a raison. Quand le jour de la bonne politique reviendra, car il reviendra, il importe que les Débats y soient engagés d'avance et la soutiennent pour leur propre compte, seule manière d'avoir un peu de zèle et d’autorité. C'est ce qui fait que je ne suis pas du tout fâché du ton qu’ils ont pris sur la nouvelle loi de la presse. Cela leur donnera crédit pour approuver et défendre le régime, plus sensé, qui sera fait un jour à la presse, quelque sévère qu'il soit. La République a cela de bon qu’elle tente toutes sortes de rigueurs inefficaces qui feront plus tard, passer et presque trouver douces de justes et efficaces de vérités. Vous voyez ; je ne me guéris pas de croire à l'avenir et d’en parler comme s’il était à moi. Au fait j'y crois; il s'est fait et il se fera bien des absurdités dans le monde ; mais l'absurdité petite et basse ne l’a jamais gouverné longtemps. Ce qui n’est pas sûr du tout, c’est que le meilleur avenir vienne assez tôt pour que j'en aie encore ma part. Je suis tout résigné à cela, mais je ne vois pas pourquoi je m'imposerais, à chaque minute, la fatigue et l’ennui de parler, ou de me taire, comme si j'étais mort, pendant que je suis encore vivant. Je me laisse aller à ma pente ; Dieu disposera de moi comme il lui plaira.
9 heures
C’est bien bête, en effet de manquer d'eau faute de machine. J’ai en idée que ces eaux d'Ems vous font du bien. Ma conjecture se fonde sur votre silence.
Je reçois ceci du meilleur des Burgraves : " Nous venons de terminer une loi qui n'a pas trop bonne mine, mais qui contient cependant plusieurs dispositions efficaces. Elle a été faite à peu près comme tout ce qu’on fait avec les légitimistes, c'est-à-dire comme une distribution de prix et une table de proscription, chacun récompensant les siens et poursuivant ses adversaires. Elle est très sévère, ridiculement et un peu bêtement sévère quant à la presse de Paris, indulgente sans choix et sans mesure pour la presse des départements. Somme toute, il en résultera du bien. Nous allons nous séparer ; nous en avons grand besoin ; la place n'est plus guère tenable, et la session prochaine ne sera possible qu’autant qu’il se formera, une majorité nouvelle composée des gens de bon sens de tous les partis ; la majorité actuelle est à bout de voie."
Vous ai-je dit que Saint Marc Girardin avait offert à Armand Bertin, d’écrire et de signer (Saint Marc Girardin, membre de l’Institut) le premier article politique que publieraient les Débats sous l'empire de la loi nouvelle ? Adieu, Adieu.
J’ai la pluie depuis deux jours ; à mon grand déplaisir. J’aime de plus en plus le soleil. Adieu. G.
Je suis de l’avis de votre Princesse de Lippe-Schaumburg, (n'est-ce pas de la Lippe ?) ; il me semble que tout le monde se retire de l’union, et que le faiseur de l'Union est bien près lui-même d'y renoncer. Je saurai ces affaires-là avec précision d’ici à peu de jours ; mon gros, petit factotum a été de nouveau sollicité de faire en Allemagne le voyage que vous savez ; il est parti mardi, et il reviendra la semaine prochaine.
On tient beaucoup là, à ce qu’il me paraît, à établir avec les Débats de bonnes et un peu intimes relations. On a raison. Quand le jour de la bonne politique reviendra, car il reviendra, il importe que les Débats y soient engagés d'avance et la soutiennent pour leur propre compte, seule manière d'avoir un peu de zèle et d’autorité. C'est ce qui fait que je ne suis pas du tout fâché du ton qu’ils ont pris sur la nouvelle loi de la presse. Cela leur donnera crédit pour approuver et défendre le régime, plus sensé, qui sera fait un jour à la presse, quelque sévère qu'il soit. La République a cela de bon qu’elle tente toutes sortes de rigueurs inefficaces qui feront plus tard, passer et presque trouver douces de justes et efficaces de vérités. Vous voyez ; je ne me guéris pas de croire à l'avenir et d’en parler comme s’il était à moi. Au fait j'y crois; il s'est fait et il se fera bien des absurdités dans le monde ; mais l'absurdité petite et basse ne l’a jamais gouverné longtemps. Ce qui n’est pas sûr du tout, c’est que le meilleur avenir vienne assez tôt pour que j'en aie encore ma part. Je suis tout résigné à cela, mais je ne vois pas pourquoi je m'imposerais, à chaque minute, la fatigue et l’ennui de parler, ou de me taire, comme si j'étais mort, pendant que je suis encore vivant. Je me laisse aller à ma pente ; Dieu disposera de moi comme il lui plaira.
9 heures
C’est bien bête, en effet de manquer d'eau faute de machine. J’ai en idée que ces eaux d'Ems vous font du bien. Ma conjecture se fonde sur votre silence.
Je reçois ceci du meilleur des Burgraves : " Nous venons de terminer une loi qui n'a pas trop bonne mine, mais qui contient cependant plusieurs dispositions efficaces. Elle a été faite à peu près comme tout ce qu’on fait avec les légitimistes, c'est-à-dire comme une distribution de prix et une table de proscription, chacun récompensant les siens et poursuivant ses adversaires. Elle est très sévère, ridiculement et un peu bêtement sévère quant à la presse de Paris, indulgente sans choix et sans mesure pour la presse des départements. Somme toute, il en résultera du bien. Nous allons nous séparer ; nous en avons grand besoin ; la place n'est plus guère tenable, et la session prochaine ne sera possible qu’autant qu’il se formera, une majorité nouvelle composée des gens de bon sens de tous les partis ; la majorité actuelle est à bout de voie."
Vous ai-je dit que Saint Marc Girardin avait offert à Armand Bertin, d’écrire et de signer (Saint Marc Girardin, membre de l’Institut) le premier article politique que publieraient les Débats sous l'empire de la loi nouvelle ? Adieu, Adieu.
J’ai la pluie depuis deux jours ; à mon grand déplaisir. J’aime de plus en plus le soleil. Adieu. G.
Trouville, Dimanche 18 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Trouville. Dimanche 18 août 1850
Vous avez dû bien rire, en effet, vous et le duc de Parme, au moment et après. Vous avez du bonheur, dans vos aventures. C'est juste.
Je dîne aujourd’hui chez Madame de Boigne. Je la divertirai, elle et le Chancelier de votre récit. Il ne se passe rien de si amusant à Trouville. J’ai été hier passer trois quarts d'heure au salon, pour un concert de charité. Un chanteur célèbre, dit-on, et dont je ne savais pas le nom a chanté, pour me faire plaisir le non pui andrai de Mozart, et quelques boléros espagnols. Il s’appelle M. Geraldy. Pas plus de personnes de connaissance qu’il y a huit jours. Beaucoup de gens évidemment riches et fort en train de vivre. Une société inconnue pullule autour de nous. Peu spirituelle, peu honnête, peu fière mais puissante par le nombre et le mouvement. Que d'efforts, et de mal et de temps il faudra pour la faire rentrer dans les bonnes règles, si elle y rentre ! Quelle produise du moins ses propres chefs, des hommes à elle, capables de la conduire. Jusqu'ici elle est aussi stérile que forte.
Le voyage du Président tourne à un assez grand effet. On m’a toujours dit que Lyon serait le lieu de son plus brillant triomphe, malgré les efforts contraires. Je ne vois encore de clair que ce résultat ci, un coup de fouet donné à tous les partis, un accès de fièvre au milieu de l’apathie générale. Les Conseils généraux, qui vont se réunir dans le feu de ce mouvement en seront peut-être un peu excités. Cependant ce qui me revient de ceux de la Normandie n’annonce pas grande ardeur. Ils se disposent à demander la révision de la constitution, sans s'expliquer sur la prolongation des pouvoirs du Président. Ce n’est pas la peine. Wiesbaden et Lyon en même temps. Si bizarre spectacle !
Une personne d’esprit m'écrit : " Rien n'empêchera que le public ne répète et ne croie que vous avez vu le comte de Chambord. Je sais des gens que cette idée console fort. " Ils sont bien bons. Peu m'importe du reste, J'ai besoin que dix ou douze personnes sachent positivement ce qui en est et elles le savent. Le surplus m'est, et est réellement indifférent.
Voici qui est bien loin de Wiesbaden. Notre consul en Californie homme intelligent, m’écrit de Panama, après avoir traversé les Etats-Unis : " M. Bulwer a gagné beaucoup de terrain à Washington. Avec son esprit et ses bons dîners, il mène le sénat. Il serait difficile de placer maintenant les relations entre la France et les Etats-Unis sur l'ancienne base d’une hostilité commune ou d'une méfiance commune à l'égard de l'Angleterre. Personne en Amérique ne croit à la république française. C'est, aux yeux des démocrates comme des Whigs, une expérience faite et manquée. Les Américains se sont sentis humiliés des hommes qu'on leur a envoyés. "
Midi.
Moi aussi, je suis bien contrarié de votre lit. C’est bien dommage que je ne sois pas là, nous nous soignerions mutuellement, car je ne suis pas non plus tout-à-fait en bon état. L'humidité paraît vouloir cesser ici. Adieu Adieu. Lisez dans la Revue des deux mondes (15 août) un article intéressant sur la première campagne du Maréchal Radetzki Adieu. G.
Vous avez dû bien rire, en effet, vous et le duc de Parme, au moment et après. Vous avez du bonheur, dans vos aventures. C'est juste.
Je dîne aujourd’hui chez Madame de Boigne. Je la divertirai, elle et le Chancelier de votre récit. Il ne se passe rien de si amusant à Trouville. J’ai été hier passer trois quarts d'heure au salon, pour un concert de charité. Un chanteur célèbre, dit-on, et dont je ne savais pas le nom a chanté, pour me faire plaisir le non pui andrai de Mozart, et quelques boléros espagnols. Il s’appelle M. Geraldy. Pas plus de personnes de connaissance qu’il y a huit jours. Beaucoup de gens évidemment riches et fort en train de vivre. Une société inconnue pullule autour de nous. Peu spirituelle, peu honnête, peu fière mais puissante par le nombre et le mouvement. Que d'efforts, et de mal et de temps il faudra pour la faire rentrer dans les bonnes règles, si elle y rentre ! Quelle produise du moins ses propres chefs, des hommes à elle, capables de la conduire. Jusqu'ici elle est aussi stérile que forte.
Le voyage du Président tourne à un assez grand effet. On m’a toujours dit que Lyon serait le lieu de son plus brillant triomphe, malgré les efforts contraires. Je ne vois encore de clair que ce résultat ci, un coup de fouet donné à tous les partis, un accès de fièvre au milieu de l’apathie générale. Les Conseils généraux, qui vont se réunir dans le feu de ce mouvement en seront peut-être un peu excités. Cependant ce qui me revient de ceux de la Normandie n’annonce pas grande ardeur. Ils se disposent à demander la révision de la constitution, sans s'expliquer sur la prolongation des pouvoirs du Président. Ce n’est pas la peine. Wiesbaden et Lyon en même temps. Si bizarre spectacle !
Une personne d’esprit m'écrit : " Rien n'empêchera que le public ne répète et ne croie que vous avez vu le comte de Chambord. Je sais des gens que cette idée console fort. " Ils sont bien bons. Peu m'importe du reste, J'ai besoin que dix ou douze personnes sachent positivement ce qui en est et elles le savent. Le surplus m'est, et est réellement indifférent.
Voici qui est bien loin de Wiesbaden. Notre consul en Californie homme intelligent, m’écrit de Panama, après avoir traversé les Etats-Unis : " M. Bulwer a gagné beaucoup de terrain à Washington. Avec son esprit et ses bons dîners, il mène le sénat. Il serait difficile de placer maintenant les relations entre la France et les Etats-Unis sur l'ancienne base d’une hostilité commune ou d'une méfiance commune à l'égard de l'Angleterre. Personne en Amérique ne croit à la république française. C'est, aux yeux des démocrates comme des Whigs, une expérience faite et manquée. Les Américains se sont sentis humiliés des hommes qu'on leur a envoyés. "
Midi.
Moi aussi, je suis bien contrarié de votre lit. C’est bien dommage que je ne sois pas là, nous nous soignerions mutuellement, car je ne suis pas non plus tout-à-fait en bon état. L'humidité paraît vouloir cesser ici. Adieu Adieu. Lisez dans la Revue des deux mondes (15 août) un article intéressant sur la première campagne du Maréchal Radetzki Adieu. G.
Paris, 14 octobre 1848, Eloi Mallac à François Guizot
Auteur : Mallac, Eloi (1809-1876)
Paris, le 6 décembre 1848, Madame de Mirbel à François Guizot
Collection : 143_Correspondance de Madame de Mirbel : 1848-1849
Auteur : Mirbel, Lizinska Aimée Zoé de (1796-1849)
Paris, le 5 décembre 1848, Madame de Mirbel à François Guizot
Collection : 143_Correspondance de Madame de Mirbel : 1848-1849
Auteur : Mirbel, Lizinska Aimée Zoé de (1796-1849)
Paris, le 18 mai 1849, Hippolyte Royer-Collard à François Guizot
Auteur : Royer-Collard, Hippolyte (1802-1850)
Paris, le 22 avril 1849, Hippolyte Royer-Collard à François Guizot
Auteur : Royer-Collard, Hippolyte (1802-1850)
Maintenant que votre voix vient de se faire entendre jusqu'au milieu de nous, et que vous nous avez parlé, non plus comme la première fois en philosophe et en publiciste, mais en citoyen actif, peut à venir combattre comme nous et avec nous, avec l'éloquence de votre parole et l'autorité de vos conseils pour la cause de la civilisation attaquée de toute part [...] Nous avons été heureux d'y retrouver cette élévation de vues, ce beau langage, qui nous semblaient perdus en France depuis plus d'un an. La netteté de votre position et votre courageuse franchise, ressortent avec éclat, à côté des ambages de M. Duchatel, de ses hésitations, de ses déclarations à double sens, & j'ajouterai, de son style inqualifiable. Si vous deviez rester à Londres, et du haut de votre exil volontaire, juger publiquement l'état présent de notre pays, lui expliquer les causes et les résultats de cette situation & enseigner au monde les moyens d'arriver à la solution d'un problème qui semble insoluble, je ne trouverai jamais assez d'approbation, assez d'éloges, assez d'admiration, pour ce noble rôle que vous vous feriez au milieu de cette tristesse des temps. [...]
Je crois, peut-être je me trompe, mais enfin je crois fermement que l'état de la France n'est pas précisément celui que vous supposez. Quelqu'un qui n'a pas vécu depuis un an au milieu de nous, et qui n'a pas vu de près et par lui-même ce qui s'est passé, ne saurait imaginer que le prodigieux changement se sont accomplis en si peu de temps dans ses esprits. Tout ce que vous dites de l'aversion générale pour la République et de l'impossibilité de s'établir en France et de prendre au sérieux ce mode de gouvernement a été vrai pendant les premiers mois qui ont suivi la Révolution de février ; mais il n'en est plsu de même aujourd'hui. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucun goût pour la République mais en m'arrêtant avec une impartialité à l'observation sérieuse des faits, je me permettrai de dire que l'immense majorité de la France, (c'est Paris que j'appelle la France, parce que Paris est tout ; le reste se soumet) ne voudrait maintenant accepter aucune autre forme de gouvernement que la République. La Monarchie, il faut le reconnaître, est tombée dans le mépris ; quelle sécurité peut inspirer un gouvernement qui s'écroule devant un banquet qu'on ne peut pas même s'exécuter, qui ne peut compter ni sur la population, ni sur la Garde Nationale dont l'existence est peut-être incompatible avec la sienne, ni sur l'armée qui est travaillée par les fausses doctrines, qui vit nécessairement avec le peuple, & qui, chaque jour, devient de plus en plus, sinon ennemie du moins incertaine et hésitante ?
Ce n'est point la République qu'on ne redoute maintenant, c'est les Républicains, c'est à dire les faubourgs et une centaine d'hommes.
[...]
Je crois, peut-être je me trompe, mais enfin je crois fermement que l'état de la France n'est pas précisément celui que vous supposez. Quelqu'un qui n'a pas vécu depuis un an au milieu de nous, et qui n'a pas vu de près et par lui-même ce qui s'est passé, ne saurait imaginer que le prodigieux changement se sont accomplis en si peu de temps dans ses esprits. Tout ce que vous dites de l'aversion générale pour la République et de l'impossibilité de s'établir en France et de prendre au sérieux ce mode de gouvernement a été vrai pendant les premiers mois qui ont suivi la Révolution de février ; mais il n'en est plsu de même aujourd'hui. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucun goût pour la République mais en m'arrêtant avec une impartialité à l'observation sérieuse des faits, je me permettrai de dire que l'immense majorité de la France, (c'est Paris que j'appelle la France, parce que Paris est tout ; le reste se soumet) ne voudrait maintenant accepter aucune autre forme de gouvernement que la République. La Monarchie, il faut le reconnaître, est tombée dans le mépris ; quelle sécurité peut inspirer un gouvernement qui s'écroule devant un banquet qu'on ne peut pas même s'exécuter, qui ne peut compter ni sur la population, ni sur la Garde Nationale dont l'existence est peut-être incompatible avec la sienne, ni sur l'armée qui est travaillée par les fausses doctrines, qui vit nécessairement avec le peuple, & qui, chaque jour, devient de plus en plus, sinon ennemie du moins incertaine et hésitante ?
Ce n'est point la République qu'on ne redoute maintenant, c'est les Républicains, c'est à dire les faubourgs et une centaine d'hommes.
[...]