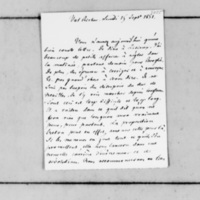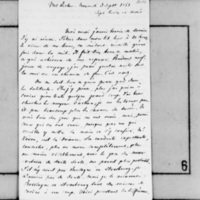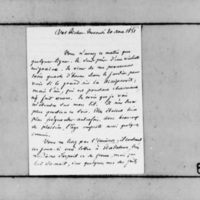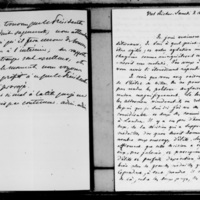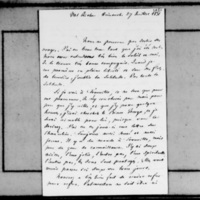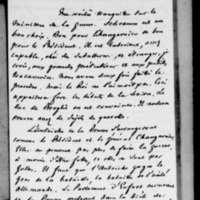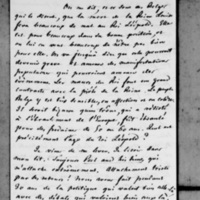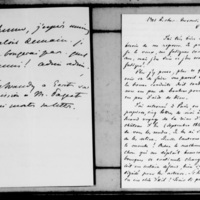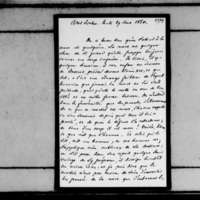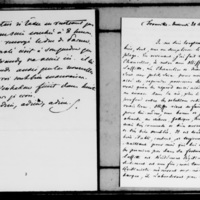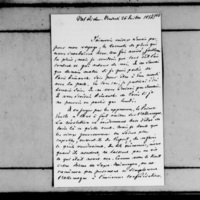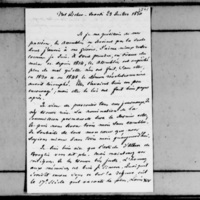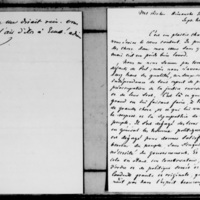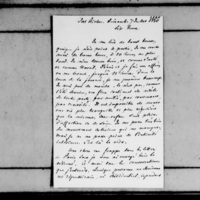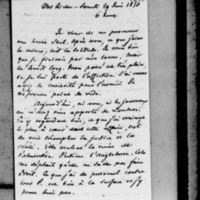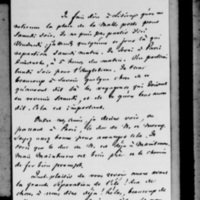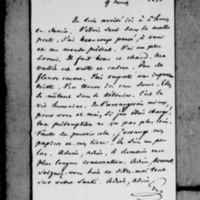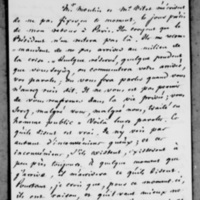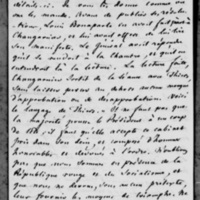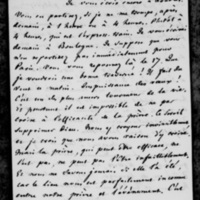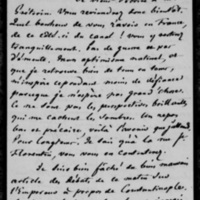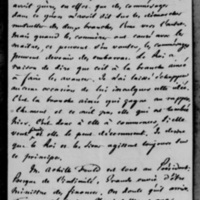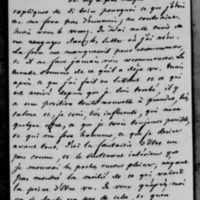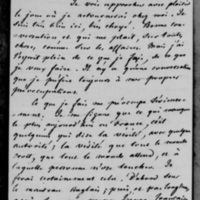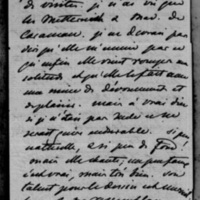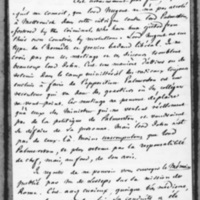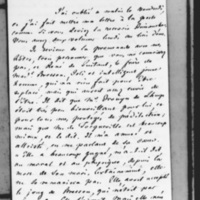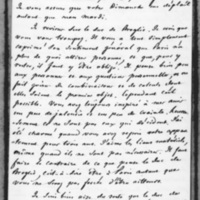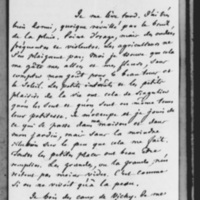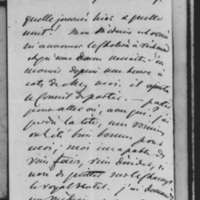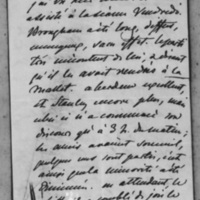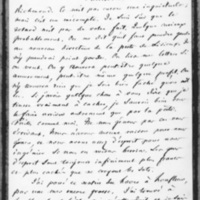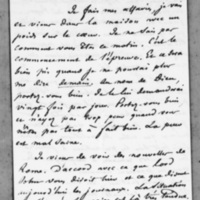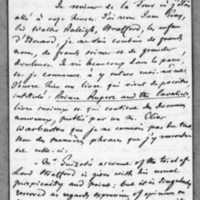Votre recherche dans le corpus : 450 résultats dans 3515 notices du site.
Trier par :
Val-Richer, Lundi 15 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Lundi 15 sept 1851
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Vous n'aurez aujourd’hui qu’une bien courte lettre. Je dîne à Lisieux. J’ai beaucoup de petites affaires à régler dans la matinée, partant demain pour Broglie. De plus, des épreuves à corriger et à renvoyer. Et pas grand chose à vous dire.
Je ne suis pas surpris du désespoir du duc de Noailles. Je l’y vois marcher depuis longtemps. Tout ceci est trop difficile et trop long. Il a raison dans ce qu’il dit qu'on ne fera rien que lorsqu'on aura vraiment peur, peur partout. La proposition Creton peut en effet amener cette peur-là. Si les meneurs en font tout ce qu’ils s’en promettent, elle nous lancera dans une nouvelle carrière d'événements et de révolutions. Nous recommencerons au lieu de finir. Aussi j’ai peur de cette affaire-là.
Vous ne lisez pas le journal le Pays. La République modérée est exactement dans la même situation, vis-à-vis du président, que les légitimistes. Elle se prépare à aller à lui pour échapper au Prince de Joinville. M. de Lamartine emploie tout ce qu’il a d’esprit à se préparer et à protester que non. Il cherche, à travers ce gâchis, une chance personnelle à poursuivre. Il ne la trouve pas ; la peur de l'Orléanisme le prend. Il revient autour du Président puis il recommence. Voilà la République ; Lamartine, Changarnier, qui sais-je ? Tous rêvent pour eux-mêmes le pouvoir souverain. Une alternative continuelle de rêve et d'impuissance.
L'article du Journal des Débats d'avant hier fera plaisir au Prince de Metternich. J’oublie ceci depuis quatre jours. Pouvez-vous me savoir l'adresse actuelle de M. de Montalembert ? J'ai besoin de lui écrire, et je ne sais où. M. de Mérode n’est probablement pas à Paris ; mais j’espère que Montebello pourra vous dire cette adresse.
11 heures
Puisque vous allez à Champlâtreux, vous y aurez vérifié ce qu’on m’écrit ce matin : " que M. Molé est fort inquiet de sa santé et qu’il a raison de l'être car M. Cloquet s'en inquiète aussi. " Adieu, Adieu. A demain une lettre moins courte. Adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 14 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 14 sept. 1851
Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.
Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.
Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance
Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.
11 heures
Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.
Ce que vous me dîtes du petit orage contre les Lettres du Times ne me surprend pas du tout. On veut le but ; mais on ne veut ni prendre la peine, ni courir le risque des moyens. Et dès qu’on découvre dans les moyens quelque imperfection un côté faible, on s'y rue et on s'enfuit par là, pour échapper à toute responsabilité. Les hommes ne sont ni plus conséquents, ni plus braves que cela ; je le sais depuis longtemps. Avant d'aller à Claremont, j'ai dit tout haut à bien des gens ce que j’y voulais dire. Quand je me suis trouvé dans le salon de la Reine, j'ai dit en grande partie, tout haut ce que j’avais dit que j’y dirais. Après en être sorti, j'ai redit tout haut, à bien des gens, ce que j'y avais dit. Quoi d'étonnant que tout cela se retrouve dans les lettres du correspondant du Times ? Je ne réponds pas des erreurs des confusions et des inconvenances qui s’y trouvent mêlées, et je ne regrette pas la publicité que reçoit ainsi ce qu’il y a de vrai, car je l'ai voulue. Pour mon propre honneur et pour le succès de la bonne cause qui a besoin qu'on fasse échouer la mauvaise. Voilà mon langage. Je n'en sortirai pas.
Je m'étonne aussi que le Duc de Noailles ne soit pas venu vous voir. On a raison de faire venir M. de Falloux. Soit dans l’intérieur du parti, soit dans ses relations extérieures, on ne peut pas se passer de lui. C’est bien dommage qu’il soit d’une si mauvaise santé.
Autre étonnement, c’est le gouvernement anglais donnant raison aux Américains à propos de Cuba. Valdegamas en est-il bien sûr ? La lettre d'Isturitz au Times m’a tout l’air au contraire d'être concertée avec Lord Palmerston. Si Valdegamas a raison, c’est certainement une grande hypocrisie et une grande platitude de Palmerston envers les Américains. Il ne veut pas contrarier là, le sentiment populaire et il n'agira en faveur de l’Espagne, que sous main. Les Etats-Unis sont une bien grande Puissance
Il faut que la garçonnade soit bien inhérente aux Français, car tous les partis en France, grands ou petits ont leur Gascon, qui même est quelquefois leur héros. M. de La Rochejaquelein est certainement le premier de tous. On me dit ici que sa réélection comme député, dans son département du Morbihan, n'est pas du tout certaine. Je serais bien surpris si, pour être président, il avait dans toute la France, 50,000 voix. Je ne sais rien d'une entrevue de Morny avec Mallac. Je n’y crois pas.
11 heures
Je suis charmé que vous ayez un peu mieux dormi. Adieu, Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 3 septembre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 3 sept. 1351
Sept heures et demie
Moi aussi j’avais besoin de dormir. J’y ai réussi. J’étais dans mon lit hier à 10 heures. Je viens de me lever, ne m'étant réveillé qu’une fois dans la nuit. Il fait très beau ce matin, ce qui achèvera de me reposer. Pendant neuf jours de voyage, j’ai passé quatre nuits sur la mer ou en chemin de fer. C’est assez.
On ne sait bien ce qu'on pense que dans la solitude. Plus, j'y pense, plus j’ai peine à croire qu’on tente quelque grand coup. J'ai beau chercher les moyens d'action ; je ne les trouve pas. Et pas beaucoup plus les chances de succès. Je vois bien des gens qui en ont envie, mais, parmi ceux qui en ont envie, presque pas un qui veuille y mettre la main et s'y confier, M. Véron, c’est la France. La conduite expectante, concertée, plus ou moins complètement, plus ou moins visiblement avec le gros des conservateurs de toute sorte me paraît plus probable. S’il n’y avait pas Boulogne et Strasbourg, je n’aurais pas de doute. Mais je le reconnais. Boulogne et Strasbourg sont des raisons de croire à un coup. Voici pourtant la différence. Quand le Président a fait Strasbourg et Boulogne, il n’avait pas de choix ; c'était cela, ou rien du tout. Certainement, s’il était réduit à la même extrémité, il tiendrait la même conduite ; il ferait un coup, n'importe lequel, plutôt que de se laisser tomber à plat. Mais se croit-il réduit à cette extrémité, sans choix aucun à faire ? Je ne trouve pas que jusqu'ici il ait paru bien pressé de le croire, et je ne vois pas pourquoi, il le croirait. A mon avis, il lui est plus aisé de rallier le gros des conservateurs à la perspective de sa réélection que de trouver des instruments et des chances pour un coup d'Etat. Nous verrons, en attendant, je vous envoie mes raisonnements n'ayant pas autre chose à vous envoyer.
10 heures
J'espérais en effet un peu mieux que l'article des Débats qui comme vous dites est très bien fait. J'espérais un long silence. On espère toujours trop. Ils n'ont pas résisté au besoin de faire de la polémique. Je l'avais bien un peu craint en lisant les vives attaques du Constitutionnel.
Moi aussi, je m'attriste de n'être pas avec vous. Mais ce n'est ni pour le coup d'Etat, ni pour aucune candidature. Politiquement nous n'avons, quant à présent, rien à faire, et pas grand chose à dire. Mauvaise condition pour être au milieu du feu. Nous n'avons ni à l'allumer, ni à l'éteindre.
Vous ne me dites pas si vous avez dormi et comment vous êtes. N'y manquez jamais, je vous prie. C'est ma première question à votre lettre quand elle arrive. Adieu. Adieu. Tout est triste. G.
Sept heures et demie
Moi aussi j’avais besoin de dormir. J’y ai réussi. J’étais dans mon lit hier à 10 heures. Je viens de me lever, ne m'étant réveillé qu’une fois dans la nuit. Il fait très beau ce matin, ce qui achèvera de me reposer. Pendant neuf jours de voyage, j’ai passé quatre nuits sur la mer ou en chemin de fer. C’est assez.
On ne sait bien ce qu'on pense que dans la solitude. Plus, j'y pense, plus j’ai peine à croire qu’on tente quelque grand coup. J'ai beau chercher les moyens d'action ; je ne les trouve pas. Et pas beaucoup plus les chances de succès. Je vois bien des gens qui en ont envie, mais, parmi ceux qui en ont envie, presque pas un qui veuille y mettre la main et s'y confier, M. Véron, c’est la France. La conduite expectante, concertée, plus ou moins complètement, plus ou moins visiblement avec le gros des conservateurs de toute sorte me paraît plus probable. S’il n’y avait pas Boulogne et Strasbourg, je n’aurais pas de doute. Mais je le reconnais. Boulogne et Strasbourg sont des raisons de croire à un coup. Voici pourtant la différence. Quand le Président a fait Strasbourg et Boulogne, il n’avait pas de choix ; c'était cela, ou rien du tout. Certainement, s’il était réduit à la même extrémité, il tiendrait la même conduite ; il ferait un coup, n'importe lequel, plutôt que de se laisser tomber à plat. Mais se croit-il réduit à cette extrémité, sans choix aucun à faire ? Je ne trouve pas que jusqu'ici il ait paru bien pressé de le croire, et je ne vois pas pourquoi, il le croirait. A mon avis, il lui est plus aisé de rallier le gros des conservateurs à la perspective de sa réélection que de trouver des instruments et des chances pour un coup d'Etat. Nous verrons, en attendant, je vous envoie mes raisonnements n'ayant pas autre chose à vous envoyer.
10 heures
J'espérais en effet un peu mieux que l'article des Débats qui comme vous dites est très bien fait. J'espérais un long silence. On espère toujours trop. Ils n'ont pas résisté au besoin de faire de la polémique. Je l'avais bien un peu craint en lisant les vives attaques du Constitutionnel.
Moi aussi, je m'attriste de n'être pas avec vous. Mais ce n'est ni pour le coup d'Etat, ni pour aucune candidature. Politiquement nous n'avons, quant à présent, rien à faire, et pas grand chose à dire. Mauvaise condition pour être au milieu du feu. Nous n'avons ni à l'allumer, ni à l'éteindre.
Vous ne me dites pas si vous avez dormi et comment vous êtes. N'y manquez jamais, je vous prie. C'est ma première question à votre lettre quand elle arrive. Adieu. Adieu. Tout est triste. G.
Val-Richer, Vendredi 22 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 22 Août 1851
Je puis répondre à votre question de poste. Vous êtes arriérée d'un jour parce qu'on a retenu ma lettre 24 heures à Francfort pour la lire et la copier à son aise. Précisément celle-là contenait, sur ce que j’avais vu à Paris, quelques détails qui pouvaient intéresser. On n’est, en Allemagne ni expéditif, ni soigneux de voiler ce qu’on fait.
Ma course en Angleterre ne me plait pas. Je n'ai personne à y voir qui me plaise. C’est un devoir que j'accomplis. On m'écrit que la Reine ne recevra personne le 25, la veille, je m’y attendais, personne non plus le lendemain le 27. Je ne pourrai donc la voir que le 28. Je compte bien m’arranger en tous cas, pour repartir le 29. Je saurai d’ici là le jour précis de votre retour à Paris.
C’est vraiment bien dommage qu'Ems ne vous ait pas aussi bien réussi, cette année que l’an dernier. Je me répète encore que peut-être le bien viendra plus tard.
Je vois que l’amiral Parker est arrivé devant Tunis avec son escadre et a signifié au Bey qu’il eût à publier la Hatti-Schériff du Sultan qui règle les relations avec la Porte. C'est précisément là ce que notre flotte est allée empêcher quatre fois de mon temps. Ce n'était pas parfaitement correct ; mais on verra quels embarras renaîtront en Algérie, quand la Porte aura repris l'ascendant à Tunis. J'ai reçu hier une nouvelle lettre d'Alexandrie, trés longue sur les progrès du travail anglais en Egypte. S'il continue sans plus d'obstacle, l'Angleterre sera bientôt établie solidement en Egypte. Lord Palmerston a raison de souhaiter ce maintien pur et simple de ce qui existe aujourd’hui.
Mon pauvre ami Rossi a enfin son monument dans l’Eglise de San Lorenzo. Voici un petit rapprochement assez frappant. C’est Tenerani qui a fait ce monument de Rossi. J’ai une lettre de Rossi qui me demandait que Tenerani près de venir à Paris, fit mon buste. Je vous quitte pour faire ma toilette.
Onze heures
Il me revient, par une source pas très élevée, mais trés rapprochée, qu'on parle assez légèrement, autour de Madame la Duchesse d'Orléans de la candidature du Prince de Joinville. On ne croit pas au succès ; mais on se dit qu'il enlèvera, un million de voix, au Président qui ne sera pas nommé d'emblée et qui ne le sera pas non plus alors, par l'Assemblée. On joue toujours au hasard et pour amener une crise. La Duchesse d'Orléans ira, dit-on, en Allemagne, presque aussitôt après l'anniversaire.
Décidément donc vous serez à Paris le 28 ou le 29 au plus tard. Je hâterai mon départ de Londres, en dépit des amis, car il y a toujours des amis. Granville a certainement eu tort de ne faire visite à aucun Ministre. Quoi, pas même à M. Baroche, ni au Ministre du commerce avec qui il avait été en rapport à Londres ? C'est singulier. Adieu, Adieu.
Je voudrais bien que Paris vous guérit d'Ems. Adieu. Vous ai-je dit qu'à Londres, je serais chez Grillon ? Je crois que oui. G.
Je puis répondre à votre question de poste. Vous êtes arriérée d'un jour parce qu'on a retenu ma lettre 24 heures à Francfort pour la lire et la copier à son aise. Précisément celle-là contenait, sur ce que j’avais vu à Paris, quelques détails qui pouvaient intéresser. On n’est, en Allemagne ni expéditif, ni soigneux de voiler ce qu’on fait.
Ma course en Angleterre ne me plait pas. Je n'ai personne à y voir qui me plaise. C’est un devoir que j'accomplis. On m'écrit que la Reine ne recevra personne le 25, la veille, je m’y attendais, personne non plus le lendemain le 27. Je ne pourrai donc la voir que le 28. Je compte bien m’arranger en tous cas, pour repartir le 29. Je saurai d’ici là le jour précis de votre retour à Paris.
C’est vraiment bien dommage qu'Ems ne vous ait pas aussi bien réussi, cette année que l’an dernier. Je me répète encore que peut-être le bien viendra plus tard.
Je vois que l’amiral Parker est arrivé devant Tunis avec son escadre et a signifié au Bey qu’il eût à publier la Hatti-Schériff du Sultan qui règle les relations avec la Porte. C'est précisément là ce que notre flotte est allée empêcher quatre fois de mon temps. Ce n'était pas parfaitement correct ; mais on verra quels embarras renaîtront en Algérie, quand la Porte aura repris l'ascendant à Tunis. J'ai reçu hier une nouvelle lettre d'Alexandrie, trés longue sur les progrès du travail anglais en Egypte. S'il continue sans plus d'obstacle, l'Angleterre sera bientôt établie solidement en Egypte. Lord Palmerston a raison de souhaiter ce maintien pur et simple de ce qui existe aujourd’hui.
Mon pauvre ami Rossi a enfin son monument dans l’Eglise de San Lorenzo. Voici un petit rapprochement assez frappant. C’est Tenerani qui a fait ce monument de Rossi. J’ai une lettre de Rossi qui me demandait que Tenerani près de venir à Paris, fit mon buste. Je vous quitte pour faire ma toilette.
Onze heures
Il me revient, par une source pas très élevée, mais trés rapprochée, qu'on parle assez légèrement, autour de Madame la Duchesse d'Orléans de la candidature du Prince de Joinville. On ne croit pas au succès ; mais on se dit qu'il enlèvera, un million de voix, au Président qui ne sera pas nommé d'emblée et qui ne le sera pas non plus alors, par l'Assemblée. On joue toujours au hasard et pour amener une crise. La Duchesse d'Orléans ira, dit-on, en Allemagne, presque aussitôt après l'anniversaire.
Décidément donc vous serez à Paris le 28 ou le 29 au plus tard. Je hâterai mon départ de Londres, en dépit des amis, car il y a toujours des amis. Granville a certainement eu tort de ne faire visite à aucun Ministre. Quoi, pas même à M. Baroche, ni au Ministre du commerce avec qui il avait été en rapport à Londres ? C'est singulier. Adieu, Adieu.
Je voudrais bien que Paris vous guérit d'Ems. Adieu. Vous ai-je dit qu'à Londres, je serais chez Grillon ? Je crois que oui. G.
Val-Richer, Mercredi 20 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Mercredi 20 août 1851
Vous n'aurez ce matin que quelques lignes. Je suis pris d'une violente, migraine. Je viens de me promener trois quarts d'heure dans le jardin pour voir si le grand air la dissiperait ; mais l’air, qui est pourtant charmant, n’y fait œuvre. Je crois que je vais m'étendre sur mon lit. Il n’en sera plus question ce soir. Elles étaient bien plus fréquentes autrefois. Avec beaucoup de plaisirs l’âge emporte aussi quelques ennuis.
Vous ne lisez pas l’Univers ; il conterait ces jours-ci une lettre à Gladstone, très médiocre d’esprit et de forme, mais qui lui donnait, sur quelques uns des faits qu’il a affirmés, des démentis précis et frappants ; par exemple 1800 prisonniers dans les prisons de tout le Royaume de Naples, au lieu de 20 à 30, 000. Et le nom de chaque prison, et le nombre des détenus dans chaque prison, y sont énoncés. Le Roi de Naples et les agents ont grande raison de multiplier les renseignements. Il devrait faire offrir à M. Gladstone de revenir les vérifier lui- même.
Vous vous étiez promis des merveilles de mes lettres écrites de Paris. Vous n'y aurez pas trouvé grand chose. Je n’avais trouvé moi-même à Paris que bien peu de chose. Je n’ai eu rien de mieux à vous envoyer. Je crains bien que ma course en Angleterre ne jette, pour vous comme pour moi, un peu de trouble dans notre correspondance. C’est très ennuyeux. Je ferai tout ce que je pourrai pour l’éviter. Adieu, Adieu.
Je vais réellement me mettre sur mon lit. J’ai la tête lourde, et le cœur barbouillé. Adieu. Je ne fermerai pourtant ceci qu'après avoir reçu mon courrier.
10 heures
Je vous ai écrit mardi matin une longue lettre. Je ne comprends pas ce retard. Votre poste de Francfort est insupportable, et je ne mérite aucun reproche. Je ne vous ai pas écrit le dimanche 10, en arrivant à Paris, parce que ma lettre écrite au Val Richer la veille 9, partait de Paris pour Francfort précisément ce même jour Dimanche 10. C'était donc deux lettres qui vous seraient arrivées le même jour. Peu aurait importe si j’avais eu quelque chose de nouveau à vous dire. Mais je n'avais rien. Je suis très contrarié de votre ennui. Vous aurez certainement eu ma lettre du mardi 12, écrite en partie le lundi, tard en partie le mardi matin. Adieu, adieu.
Adieu, dearest. G.
Vous n'aurez ce matin que quelques lignes. Je suis pris d'une violente, migraine. Je viens de me promener trois quarts d'heure dans le jardin pour voir si le grand air la dissiperait ; mais l’air, qui est pourtant charmant, n’y fait œuvre. Je crois que je vais m'étendre sur mon lit. Il n’en sera plus question ce soir. Elles étaient bien plus fréquentes autrefois. Avec beaucoup de plaisirs l’âge emporte aussi quelques ennuis.
Vous ne lisez pas l’Univers ; il conterait ces jours-ci une lettre à Gladstone, très médiocre d’esprit et de forme, mais qui lui donnait, sur quelques uns des faits qu’il a affirmés, des démentis précis et frappants ; par exemple 1800 prisonniers dans les prisons de tout le Royaume de Naples, au lieu de 20 à 30, 000. Et le nom de chaque prison, et le nombre des détenus dans chaque prison, y sont énoncés. Le Roi de Naples et les agents ont grande raison de multiplier les renseignements. Il devrait faire offrir à M. Gladstone de revenir les vérifier lui- même.
Vous vous étiez promis des merveilles de mes lettres écrites de Paris. Vous n'y aurez pas trouvé grand chose. Je n’avais trouvé moi-même à Paris que bien peu de chose. Je n’ai eu rien de mieux à vous envoyer. Je crains bien que ma course en Angleterre ne jette, pour vous comme pour moi, un peu de trouble dans notre correspondance. C’est très ennuyeux. Je ferai tout ce que je pourrai pour l’éviter. Adieu, Adieu.
Je vais réellement me mettre sur mon lit. J’ai la tête lourde, et le cœur barbouillé. Adieu. Je ne fermerai pourtant ceci qu'après avoir reçu mon courrier.
10 heures
Je vous ai écrit mardi matin une longue lettre. Je ne comprends pas ce retard. Votre poste de Francfort est insupportable, et je ne mérite aucun reproche. Je ne vous ai pas écrit le dimanche 10, en arrivant à Paris, parce que ma lettre écrite au Val Richer la veille 9, partait de Paris pour Francfort précisément ce même jour Dimanche 10. C'était donc deux lettres qui vous seraient arrivées le même jour. Peu aurait importe si j’avais eu quelque chose de nouveau à vous dire. Mais je n'avais rien. Je suis très contrarié de votre ennui. Vous aurez certainement eu ma lettre du mardi 12, écrite en partie le lundi, tard en partie le mardi matin. Adieu, adieu.
Adieu, dearest. G.
Val-Richer, Dimanche 17 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer 17 août 1851
J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.
Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.
J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !
11 heures
Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.
J'espère bien avoir une lettre ce matin. Je ne reçois pas celles de Francfort plutôt que celles d’Ems, ni celles de Schlangenbad plus tard. Je suis fâché de ne pas connaître Schlangenbad. Jamais le calme n'a été plus profond qu'en ce moment. Le mouvement de l'Assemblée est fini. Celui des conseils généraux n'est pas encore commencé. Les journaux n'excitent plus aucun mouvement. A peine dit-on quelques mots de la candidature du Prince de Joinville. La réserve du Journal des Débats déplaît évidemment beaucoup à ceux qui y poussent. Quelle leçon, si cela finissait par un coup d'épée dans l’eau ! Ce sera le point délicat de ma visite à Claremont. Mais je m'en tirerai comme Dugueselin se tira de la ville de Rennes, où il était assiégé par les Anglais. Grand stratagème du Connétable. Il met son Chroniqueur en tête de ce chapitre ; et ce stratagème fut de rassembler sa garnison, de sortir de la place bannières déployées et de se faire jour, à grands coups de lance et d’épée, à travers le camp des Anglais. Je parlerai comme Dugueslin marchait bannières déployées et en disant tout ce que je pense. Je ne connais, ni dans mon devoir, ni dans leur intérêt, aucune raison de m'en gêner.
Ce qui m'amuserait, ce serait comme je le vois dans les journaux, que Thiers, Rémusat, Lasteyrie, Piscatory & vinssent là aussi pour le 26 août. La réunion autour du cercueil du Roi serait frappante. La mort change peu de chose.
J'étais inquiet, il y a quelques jours, pour la petite fille de ma fille Henriette. L'affection vient vite en regardant une pauvre petite créature muette qui souffre et qui vous regarde avec des yeux suppliants, où il n’y a rien encore que l’instinct confiant de la faiblesse qui implore secours. L'enfant va mieux. Je ne sais si on viendra à bout de l'élever ; elle est bien chétive. Il y a aussi quelque chose qui saisit et attache dans ce problème de la vie à son début ; une flamme qui vacille ; durera-t-elle ? S'éteindra- t-elle ? C'est le mot de mort à propos du Roi, qui m'a reporté vers ma petite-fille. Qu'il y a loin de l’un à l'autre !
11 heures
Voilà ma lettre, et vous êtes rétablie à Schlangenbad. J'en suis bien aise pour votre repos. La fatigue un peu prolongée, même agréable ne vous va pas. Adieu, adieu. Point de journaux ce matin. Montalivet m'écrit. " La Reine et les Princes vont quitter l’Ecosse. Le Prince et la Princesse de Joinville, retournent directement à Claremont. La Reine et le duc de Nemours feront un détour qui leur prendra plusieurs jours. Je ne crois pas qu’ils soient à Claremont avant le 24. Mad. la Duchesse d'Orléans habitera Claremont et y arrivera de son côté le 22 ou le 24. " Mon plan, à moi, est toujours le même. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 2 août 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 2 août 1851
Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.
Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.
Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.
Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.
Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.
Je jouis vraiment de votre délivrance. Je sais à quel point vous avez dû être agitée ; et votre agitation m'inquiète et me chagrine comme m'inquiéterait et me chagrinerait une maladie. J'en veux à Couth de vous avoir si étourdiment répondu.
Je crois que vous avez raison sur les fêtes de l’hôtel de ville. On ne pouvait guère ne pas rendre les politesses anglaises et on les rendra magnifiquement. Le Lord maire et les Aldermen viendront-ils en robes et en perruques ? Depuis que je suis ici, j'ai vu des industriels considérables et deux des commissaires Français à Londres. Il y a un peu d'humeur, parmi eux, de la décision qui a supprimé, les grandes médailles d’or qu’on devait donner, en petit nombre aux ouvrages d'élite. Les Français affirment que cette décision a été prise contre eux, par jalousie, et parce qu'en fait d'ouvrages d’élite et parfaits d'exécution ils auraient eu bien plus de grandes médailles que les Anglais cependant, à tout prendre, il restera plutôt de là, entre les deux pays, des impressions bienveillantes et de bonnes relations. Je ne sais si le gouvernement Anglais a fait de la bonne politique intérieure ; mais il a certainement fait de la bonne politique étrangère. On a vu sa puissance, et on lui sait gré de cette façon de la montrer.
Mad. de Ste Aulaire m'écrit que ses visiteurs du Dimanche (à Etiolles) sont très découragés et décourageants. Le Duc de Broglie, Viel Castel & Broglie, ne m’écrit guères ; il est vrai que je ne lui ai pas écrit du tout. Mais il a chargé ma fille de me dire qu’on ne faisait et qu’on ne préparait que des bêtises. L'impression générale est triste et morne, plus que sombre et agitée. Je ne vois pas dans le pays que j'habite, grande ardeur à recommencer, le pétitionnement pour la révision. Il est vrai que déjà ce département-ci a peu pétitionné.
Voilà un fauteuil vacant à l'Académie française. Je ne vois pas à qui nous le donnerons. Il sera très vivement et très petitement disputé. Je perds, dans M. Dupaty un ami très dévoué, très actif, et assez influent dans la sphère académique comme parfaitement étranger à l'arène politique. Galant homme d'ailleurs, d'un esprit aussi sensé dans la vie que léger dans la littérature, et d’un cœur très steady. On est très ému ..., à Alexandrie, du chemin de fer que le Pacha d’Egypte vient enfin de concéder aux Anglais. Je reçois de là une lettre, non signée mais dont je reconnais l'auteur, riche négociant Français établi depuis longtemps en Egypte. " C'est le 12 de ce mois que les signatures ont été échangées. C'est donc à partir de ce moment qu'Abba-Pacha est officiellement le gouverneur du pays pour le compte de l'Angleterre. Ainsi, à moins que l’Europe ne s'y oppose, MM les Anglais vont disposer librement de 90 mille hommes, de 80 à 100 millions, des mines de charbon nouvellement découvertes, des produits inépuisables de la vallée du Nil, de l’Abyssinie & Et cela entre Malte et Aden, au point le plus stratégique du Globe commercialement et militairement parlant ; au point par conséquent le plus favorable pour prélever une dîme sur tous les produits agricoles et industriels du globe & & Et il m'invoque comme si j’y pouvais quelque chose. C'est certainement un grand pas vers la possession du Nord-Est de l'Afrique et de la clef européenne de l'Orient.
Onze heures Vous voilà parfaitement calme. Cela me plaît beaucoup. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 27 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 27 Juillet 1851
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
Nous ne pouvons pas sortir des orages. J’ai eu beau temps tant que j’ai été seul. nous nous entendons très bien le soleil et moi. Je le trouve très bonne compagnie. Quand je me promène en pleine liberté, et sous des flots de lumière, j'oublie la solitude. Pas toute la solitude. Si je vais à Trouville, ce ne sera que pour me promener. Je n'y coucherai pas. Mais pour peu que j’y aille et que je passe quelques heures, j’irai chercher le Prince George, et je serai aimable pour lui, puisque vous le désirez. J’ai eu ces jours-ci une lettre du chancelier. Toujours aussi sensé et aussi jeune.
Il y a du monde à Trouville, mais peu de gens de connaissance. J’y ai deux nièces, l’une jolie, l'autre pas, l’une spirituelle, l’autre pas, les dons sont partagés. Elles vont venir passer ici deux ou trois jours.
Narvaez a très bien fait de rendre refus pour refus. Palmerston ne sait être ni gracieux ni fier. Un homme de mes amis, que j’avais fait entrer aux Affaires Etrangères, et qui en est sorti avec moi, M de Lavergne (son nom ne vous est pas inconnu) va passer quelque temps en Angleterre. C’est un grand agriculteur, très curieux de voir des agriculteurs anglais et écossais. Je le recommanderai à quelques personnes. Il est bon à connaître, si vous avez Ellice sous la main, faites-moi la grâce de lui dire que M. de Lavergne lui portera probablement une lettre de moi.
Quand Ellice, sera-t-il de retour en Ecosse ? Vous avez raison de regretter d’Haubersaert. Il n'y a pas un plus galant homme, ni plus sensé malgré son langage excessif. Il se plaît à choquer. Cela le fait détester de beaucoup de gens. Puisque vous parlez d'éclipse, il ne faut que de bien petits défauts pour éclipser de bien grandes qualités. N’ayez donc pas peur de l'éclipse. Le monde physique restera dans l’ordre jusqu'au jour où il finira ; et ce jour-là, ce n’est pas du monde physique qu’il conviendra d'avoir peur. Ceci soit dit sans vouloir vous faire peur de l'autre. Je trouve naturel que vous vous inquiétez de ce reçu de [Couth]. Vous le retrouverez. Vous êtes trop soigneuse pour l'avoir perdu. Vous l'aurez trop bien soigné. Vous avez moins de mémoire que d’ordre. Et puis, mention de vos actions et du reçu qu’il vous en avait donné, existe sûrement dans les livres de Couth. Il vous donnera un nouveau reçu si vous ne retrouvez pas le premier.
Voici mes seules nouvelles de Paris. " Il me semble que la démolition du Président suit son cours et qu’elle a fait de grands progrès depuis quelque temps. A Paris, l’opinion commence à se déclarer ouvertement contre lui. Ce dernier fantôme d'autorité s'en va, sans qu’il y ait rien, bien entendu, de prêt ni de possible à mettre à la place. Pour le moment tout le monde désarme ; la prochaine prorogation se fait déjà sentir. Mais tout le monde dit qu’au retour de l'assemblée, la guerre s’engagera très vivement. Nous aurons eu dans l’intervalle la campagne des Conseils Généraux où la lutte va recommencer sous une autre forme. "
Adieu, adieu. Je suis charmé que vous ayez eu un dîner bon et gai. Vous êtes sensible aux deux plaisirs. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 24 juillet 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1851 (1er janvier-10 novembre) : Guizot observateur des jeux de tensions entre le Président et l'Assemblée
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 24 Juillet 1851
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
8 heures
Je viens d'écrire une longue lettre à Croker. Il faut payer ses dettes, surtout à ses vieux amis. Je serais bien triste si je parvenais à être réellement inquiet sur l’Angleterre. Je persiste à ne pas l'être. Il y a là une digue de bon sens et de vertu assez forte pour résister même à un gros torrent qui viendrait l'assaillir, et je ne vois pas encore le torrent.
J’ai eu hier des visites qui m’ont assez frappé ; deux des hommes les plus intelligents, et les plus froids du pays ; sans passion et sans parti pris sur rien. Ils m’ont parlé du débat sur la révision comme ayant été très favorable à la monarchie, et pas très favorable au Président. Ils trouvent que République et Président ont fait là assez pauvre figure. Ils examinent ce qu’ils ne faisaient pas du tout, il y a un mois, comment la monarchie pourrait revenir, l'an prochain, ou quel autre président pourrait être élu. Cependant ils concluent que la République et le président. actuel sont encore ce qui a le plus de chances.
J'envie à Marion et à Duchâtel leur course à Stolzenfels. Je pense à Ems avec plaisir, et regret. A cause de vous d'abord, ce qui va sans dire, mais un peu aussi à cause d'Ems même. Le pays est plus pittoresque que celui-ci, et au milieu de ce pays pittoresque il y a des restes du passé un peu de vieille histoire, Stolzenfels restauré et les ruines de Nassau. Il n'y a point du tout de passé autour de moi, à dix lieues à la ronde, point du tout. On prend de plus en plus le goût du passé en vieillissant, comme les ombres s'allongent le soir. Pardon de l'incohérence.
Que dites-vous du souffle que l'assemblée vient de donner à ce pauvre Léon Faucher ? C’est la seconde fois que cela lui arrive. Il y a des gens qui auront voulu se dédommager de l'effort qu'ils avaient fait en votant pour la révision. Cela amènera-t-il une crise de cabinet ? M. Od. Barrot est là, prêt à recevoir l'héritage et à servir de couverture pour la réélection du Président. Je soupçonne que quelques uns des collègues de M. Léon Faucher auront été, sous main, pour quelque chose dans son échec. C'est aussi ce qui lui arriva, à sa première chute. Il est déplaisant, et embarrassant.
Onze heures
On m'écrit de Paris : " Les ministres restent. Ce n'est pas qu'à l’Elysée, on n'ait un grand désir de profiter de l'occasion pour renvoyer Faucher qui est odieux à ses Collègues et au Président ; mais ce serait donner une victoire à l'Assemblée, et on se décide à laisser les choses comme elles sont. Il faudrait d'ailleurs prendre Barrot qui n’est pas plus aimé que Faucher. " " Berryer, a reçu une longue lettre du duc de Noailles, dont il est très content. Le Duc aussi est content." Ce pauvre Maréchal Sebastiani aurait mieux fait de mourir il y a quatre ans. Il en avait une admirable occasion. C'était un esprit politique remarquablement sûr, fin sans subtilité, et presque grand avec une pesanteur et une lenteur assommantes, et une extrême stérilité. Propre à l'action, quoique sans invention. Je ne l'ai pas revu depuis la révolution de Février.
Je suis bien aise que Mad d'Hulot vous plaise. C’est une honorable personne, et je l’ai toujours trouvée aimable. Adieu, Adieu. Nous sommes depuis hier, sous le déluge d’un orage continu. Adieu. G.
Broglie, Jeudi 24 octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie, Jeudi 24 octobre 1850
Me voilà tranquille sur le Ministre de la guerre. Schramm est un bon choix. Bon pour Changarnier, et bon pour le président. Il est laborieux, assez capable, obéi des subalternes, et étranger, je crois, aux grandes prétentions, et aux petites tracasseries. Nous avons deux fois failli le prendre. Mais le Roi ne l'aimait pas. Ceci apaisera fort les débuts de la session. Le duc de Broglie, en est convaincu. Il restera encore assez de sujets de querelle.
L’Autriche et la Prusse s’arrangeront comme le Président et le Général Changarnier. Elles ne peuvent pas plus se faire la guerre, à moins d'être folles, et elles ne sont pas Folles. Il faut que l’Autriche gagne le gros de la bataille, la bataille de l’unité allemande. Le Parlement d'Enfurt mourant et la Prusse rentrant dans la diète de Francfort, c’est la grosse bataille gagnée pour l’Autriche. L'affaire de Hesse est l’escarmouche, la rencontre par occasion. Là, il faut donner à la Prusse quelque satisfaction une couverture pour sa retraite. On la trouvera à Varsovie d’ici, il me semble qu’elle peut se trouver aisément. Il suffit de donner, un peu sur les doigts au grand Duc et de le contraindre à s’arranger avec ses sujets qui après tout, ne se sont point soulevés. On peut faire quelque chose pour eux sans céder à l’insurrection. Tout n'est-il pas bien réglé ?
Je pars dans deux heures. Je suis fort aise d'être venu. Il y a deux mérites qui surnagent toujours et surmontent tout le reste, d'être homme d’esprit et honnête homme. Là où ces deux mérites se rencontrent, il est bien rare qu’il my ait pas moyen de s’entendre et rien de bon à faire.
Je ne vois rien de plus dans les journaux. Mais Schramm est assez pour un jour. Il neige ici. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets tout était blanc. Adieu Adieu.
J’aurais tant aimé que Lady Jersey fût partie avant mon arrivée. Adieu. G.
Me voilà tranquille sur le Ministre de la guerre. Schramm est un bon choix. Bon pour Changarnier, et bon pour le président. Il est laborieux, assez capable, obéi des subalternes, et étranger, je crois, aux grandes prétentions, et aux petites tracasseries. Nous avons deux fois failli le prendre. Mais le Roi ne l'aimait pas. Ceci apaisera fort les débuts de la session. Le duc de Broglie, en est convaincu. Il restera encore assez de sujets de querelle.
L’Autriche et la Prusse s’arrangeront comme le Président et le Général Changarnier. Elles ne peuvent pas plus se faire la guerre, à moins d'être folles, et elles ne sont pas Folles. Il faut que l’Autriche gagne le gros de la bataille, la bataille de l’unité allemande. Le Parlement d'Enfurt mourant et la Prusse rentrant dans la diète de Francfort, c’est la grosse bataille gagnée pour l’Autriche. L'affaire de Hesse est l’escarmouche, la rencontre par occasion. Là, il faut donner à la Prusse quelque satisfaction une couverture pour sa retraite. On la trouvera à Varsovie d’ici, il me semble qu’elle peut se trouver aisément. Il suffit de donner, un peu sur les doigts au grand Duc et de le contraindre à s’arranger avec ses sujets qui après tout, ne se sont point soulevés. On peut faire quelque chose pour eux sans céder à l’insurrection. Tout n'est-il pas bien réglé ?
Je pars dans deux heures. Je suis fort aise d'être venu. Il y a deux mérites qui surnagent toujours et surmontent tout le reste, d'être homme d’esprit et honnête homme. Là où ces deux mérites se rencontrent, il est bien rare qu’il my ait pas moyen de s’entendre et rien de bon à faire.
Je ne vois rien de plus dans les journaux. Mais Schramm est assez pour un jour. Il neige ici. Ce matin, quand j'ai ouvert mes volets tout était blanc. Adieu Adieu.
J’aurais tant aimé que Lady Jersey fût partie avant mon arrivée. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 1er octobre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 1er octobre 1850
8 heures
On me dit et ce sont des Belges qui le disent, que la mort de la Reine Louise. fera beaucoup de mal au Roi Léopold. Elle est pour beaucoup dans sa bonne position, et on lui en veut beaucoup de n’être pas bien pour elle. On va jusqu’à dire que cela pourrait devenir grave et amener des manifestations populaires qui pourraient amener des événements. Les mœurs du Roi font un grand contraste avec la piété de la Reine. Le peuple Belge y est très sensible, en affection et en colère. Il serait bizarre qu’un trône, qui a résisté à l'ébranlement de l’Europe, fût ébranlé pour des fredaines de 50 ou 60 ans. Quel est précisément l’âge du roi Léopold ?
Je viens de me lever. Je lisais dans mon lit. Toujours Peel and his times qui m’attache extrêmement. Attachement triste par ses retours ! Nous avons fait pendant 30 ans de la politique qui valait bien celle-là avec des débats qui valaient bien ceux-là. M. Royer Collard revenu à son amitié pour moi, me disait peu avant sa mort : “ Vous vous faites beaucoup d’honneur; vous êtes le premier de votre temps et entre les premiers de tous les temps. “ Gardez-moi le secret de mes secrets plaisirs d'orgueil. Est-ce que tout cela doit aboutir au régime d’aujourd’hui. Est-ce là la fin ? Je ne le crois pas, mais quelques fois, je le crains. Je ne pense pas que je devienne superstitieux ; mais en tout cas, il y a de quoi devenir modeste ; on fait bien peu, même quand on fait bien, et il ne faut pas un bien grand vent pour tout emporter.
Onze heures
Les mêmes nouvelles nous arrivent en même temps. Votre lettre me dit ce que je viens de vous dire sur la Belgique. C'est triste et grave. Je pense sans cesse à la pauvre Reine de Claremont. J'espère qu'elle aura la satisfaction de voir encore sa fille. Pourquoi attend-elle ? Est-il vrai que la République ait témoigné à Bruxelles des craintes sur l’arrivée de la famille royale à Ostende ?
La joie à cause de la circulaire Barthelemy me paraît bien puérile. J’en doute un peu. Non pas qu'on l'ait manifestée, mais qu’on la sente réellement. On aura cru que la fusion devenait impossible, au moins que tout le public en France le croirait et le dirait. On aura voulu être de l'avis actuel du public ; sauf à avoir plus tard un autre avis si les évènements en suggèrent un autre. Suivre le vent, tous les souffles du vent, c'est l'habileté des habiles qui n’ont pas la grande ambition ni la grande habileté !
Voilà un horrible accident dans ma famille. Cette jolie petite Mad. de Vaines vient d'être horriblement brûlée. Son mari me donne les mêmes détails qui sont dans les débats. On espère la sauver mais sans certitude. On est à peu près sûr que, si elle est sauvée, elle ne sera pas défigurée. Pauvre jeune femme qui s'amusait de si bon cœur ! On est arrêté tout à coup dans le plaisir, comme dans la bonne politique. Adieu, Adieu.
Je vais aujourd' hui dîner à Lisieux malgré la pluie. Demain j'aurai du monde et de la conversation. Vendredi, 4, j'aurai 63 ans. Samedi 5 M. Hébert vient me voir avant d'aller à Claremont. Mercredi, 9, je vais à Broglie. Voilà mes affaires d’ici à huit jours. Adieu. adieu. G.
8 heures
On me dit et ce sont des Belges qui le disent, que la mort de la Reine Louise. fera beaucoup de mal au Roi Léopold. Elle est pour beaucoup dans sa bonne position, et on lui en veut beaucoup de n’être pas bien pour elle. On va jusqu’à dire que cela pourrait devenir grave et amener des manifestations populaires qui pourraient amener des événements. Les mœurs du Roi font un grand contraste avec la piété de la Reine. Le peuple Belge y est très sensible, en affection et en colère. Il serait bizarre qu’un trône, qui a résisté à l'ébranlement de l’Europe, fût ébranlé pour des fredaines de 50 ou 60 ans. Quel est précisément l’âge du roi Léopold ?
Je viens de me lever. Je lisais dans mon lit. Toujours Peel and his times qui m’attache extrêmement. Attachement triste par ses retours ! Nous avons fait pendant 30 ans de la politique qui valait bien celle-là avec des débats qui valaient bien ceux-là. M. Royer Collard revenu à son amitié pour moi, me disait peu avant sa mort : “ Vous vous faites beaucoup d’honneur; vous êtes le premier de votre temps et entre les premiers de tous les temps. “ Gardez-moi le secret de mes secrets plaisirs d'orgueil. Est-ce que tout cela doit aboutir au régime d’aujourd’hui. Est-ce là la fin ? Je ne le crois pas, mais quelques fois, je le crains. Je ne pense pas que je devienne superstitieux ; mais en tout cas, il y a de quoi devenir modeste ; on fait bien peu, même quand on fait bien, et il ne faut pas un bien grand vent pour tout emporter.
Onze heures
Les mêmes nouvelles nous arrivent en même temps. Votre lettre me dit ce que je viens de vous dire sur la Belgique. C'est triste et grave. Je pense sans cesse à la pauvre Reine de Claremont. J'espère qu'elle aura la satisfaction de voir encore sa fille. Pourquoi attend-elle ? Est-il vrai que la République ait témoigné à Bruxelles des craintes sur l’arrivée de la famille royale à Ostende ?
La joie à cause de la circulaire Barthelemy me paraît bien puérile. J’en doute un peu. Non pas qu'on l'ait manifestée, mais qu’on la sente réellement. On aura cru que la fusion devenait impossible, au moins que tout le public en France le croirait et le dirait. On aura voulu être de l'avis actuel du public ; sauf à avoir plus tard un autre avis si les évènements en suggèrent un autre. Suivre le vent, tous les souffles du vent, c'est l'habileté des habiles qui n’ont pas la grande ambition ni la grande habileté !
Voilà un horrible accident dans ma famille. Cette jolie petite Mad. de Vaines vient d'être horriblement brûlée. Son mari me donne les mêmes détails qui sont dans les débats. On espère la sauver mais sans certitude. On est à peu près sûr que, si elle est sauvée, elle ne sera pas défigurée. Pauvre jeune femme qui s'amusait de si bon cœur ! On est arrêté tout à coup dans le plaisir, comme dans la bonne politique. Adieu, Adieu.
Je vais aujourd' hui dîner à Lisieux malgré la pluie. Demain j'aurai du monde et de la conversation. Vendredi, 4, j'aurai 63 ans. Samedi 5 M. Hébert vient me voir avant d'aller à Claremont. Mercredi, 9, je vais à Broglie. Voilà mes affaires d’ici à huit jours. Adieu. adieu. G.
Val-Richer, Samedi 21 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 21 sept. 1850
Vous avez cent fois raison, il vaut mieux, pour un pays avoir des Liverpool pour ministres que des Canning. Et les Liverpool ont une vraie supériorité, car ils ont un meilleur jugement ; ils voient mieux les choses comme elles sont en effet, et ils se conduisent selon l’intérêt du pays, non selon la fantaisie de leur esprit ou le besoin de leur vanité. C'est pourquoi l’instinct public les regarde, et avec raison comme des hommes plus sérieux. Reste en même temps cet autre instinct qui n'accorde les honneurs de l'admiration publique et historique qu'aux hommes en qui éclate quelque supériorité du premier ordre qui les met, par quelque grand côté de la nature humaine tout-à-fait hors de pair. Les deux instincts sont également fondés et également indestructibles ; ils répondent à deux faits tout différents. Votre sentiment politique n'est donc point bourgeois du tout ; il n’y a rien de plus noble que le bon sens ; mais il n'exclut pas mon observation. Quant à honorer plus au moins les Liverpool ou les Canning, c'est une autre affaire. Question d'estime individuelle, non plus d’intérêt public. Si les Liverpool, avec leur esprit moins haut et moins rare, sont exempts de cet égoïsme vaniteux qui est le tort ordinaire des Canning ils sont infiniment plus honorables. Mais cela n’arrive pas toujours ; j'ai connu des Liverpool tout aussi égoïstes, et tout aussi vains que les Canning. La médiocrité ne met pas toujours à l'abri de la vanité, et la supériorité peut s'élever jusqu'au désintéressement modeste.
Puis, laissez-moi vous dire une autre chose, que je ne dirais pas à d'autres, de peur de passer pour un mystique, ce que je ne suis guère. Je ne sais pas du tout quels sont les desseins de Dieu sur le genre humain, mais certainement il en a car il ne nous laisse jamais tranquilles. Notre bonne et heureuse condition ici bas ne suffit point à ce qu’il veut faire de nous ou par nous. Il ne permet pas que nous nous y établissions. Il jette un levain caché, il frappe un coup imprévu pour nous tenir en fermentation continuelle. Il faut que nous marchions, que nous nous transformions. Quelquefois, nous nous précipitons nous-mêmes à tort et à travers, et Dieu punit notre fougue aveugle. Puis, nous voudrions nous arrêter vivre en repos, jouir de nos biens. Dieu n'y consent pas. Pour son œuvre à lui, le Gouvernement des Liverpool ne suffit pas ; il place à côté d’eux des esprits plus exigeants, plus remuants qui veulent du nouveau, font du bruit, poussent et entraînent les hommes. Vers quel but ? Selon quel plan ? Dieu seul le sait. Mais je crois en Dieu ; j’entrevois quelque chose de ses desseins, et du rôle qu’y jouent les Liverpool et les Canning, les Villèle et les Châteaubriand ; et cela m’aide à me soumettre à ce que j’ignore profondément. Vous avez touché une corde sensible. Aussi vous voyez comme elle résonne.
Onze heures
Je crois que vous pouvez vous dispenser de vous r'abonner au National et à la Presse. Ils ont assez d'abonnés pour oublier de se venger de votre abandon. Girardin est pourtant capable d’être piqué. Je m'étonne que votre ennui l'ait emporté sur votre poltronnerie. Les articles de l'Indépendance belge ne m'étonnent pas. Il y a et il y aura à Claremont une lutte intérieure qui se manifestera par des hésitations, des contradictions et des intermittences. Du reste l'Indépendance belge peut fort bien faire de tels articles, sans Claremont. Le Ministère actuel, dont ce journal est l'organe, est très hostile à la fusion et à tout ce qui de près ou de loin, sent la légitimité. Ce sont les Odilon Barrot de la Belgique. Adieu, Adieu. Ma fille doit arriver à Paris ce matin. Guillaume ira vous demander vos commissions.
Adieu. G.
Vous avez cent fois raison, il vaut mieux, pour un pays avoir des Liverpool pour ministres que des Canning. Et les Liverpool ont une vraie supériorité, car ils ont un meilleur jugement ; ils voient mieux les choses comme elles sont en effet, et ils se conduisent selon l’intérêt du pays, non selon la fantaisie de leur esprit ou le besoin de leur vanité. C'est pourquoi l’instinct public les regarde, et avec raison comme des hommes plus sérieux. Reste en même temps cet autre instinct qui n'accorde les honneurs de l'admiration publique et historique qu'aux hommes en qui éclate quelque supériorité du premier ordre qui les met, par quelque grand côté de la nature humaine tout-à-fait hors de pair. Les deux instincts sont également fondés et également indestructibles ; ils répondent à deux faits tout différents. Votre sentiment politique n'est donc point bourgeois du tout ; il n’y a rien de plus noble que le bon sens ; mais il n'exclut pas mon observation. Quant à honorer plus au moins les Liverpool ou les Canning, c'est une autre affaire. Question d'estime individuelle, non plus d’intérêt public. Si les Liverpool, avec leur esprit moins haut et moins rare, sont exempts de cet égoïsme vaniteux qui est le tort ordinaire des Canning ils sont infiniment plus honorables. Mais cela n’arrive pas toujours ; j'ai connu des Liverpool tout aussi égoïstes, et tout aussi vains que les Canning. La médiocrité ne met pas toujours à l'abri de la vanité, et la supériorité peut s'élever jusqu'au désintéressement modeste.
Puis, laissez-moi vous dire une autre chose, que je ne dirais pas à d'autres, de peur de passer pour un mystique, ce que je ne suis guère. Je ne sais pas du tout quels sont les desseins de Dieu sur le genre humain, mais certainement il en a car il ne nous laisse jamais tranquilles. Notre bonne et heureuse condition ici bas ne suffit point à ce qu’il veut faire de nous ou par nous. Il ne permet pas que nous nous y établissions. Il jette un levain caché, il frappe un coup imprévu pour nous tenir en fermentation continuelle. Il faut que nous marchions, que nous nous transformions. Quelquefois, nous nous précipitons nous-mêmes à tort et à travers, et Dieu punit notre fougue aveugle. Puis, nous voudrions nous arrêter vivre en repos, jouir de nos biens. Dieu n'y consent pas. Pour son œuvre à lui, le Gouvernement des Liverpool ne suffit pas ; il place à côté d’eux des esprits plus exigeants, plus remuants qui veulent du nouveau, font du bruit, poussent et entraînent les hommes. Vers quel but ? Selon quel plan ? Dieu seul le sait. Mais je crois en Dieu ; j’entrevois quelque chose de ses desseins, et du rôle qu’y jouent les Liverpool et les Canning, les Villèle et les Châteaubriand ; et cela m’aide à me soumettre à ce que j’ignore profondément. Vous avez touché une corde sensible. Aussi vous voyez comme elle résonne.
Onze heures
Je crois que vous pouvez vous dispenser de vous r'abonner au National et à la Presse. Ils ont assez d'abonnés pour oublier de se venger de votre abandon. Girardin est pourtant capable d’être piqué. Je m'étonne que votre ennui l'ait emporté sur votre poltronnerie. Les articles de l'Indépendance belge ne m'étonnent pas. Il y a et il y aura à Claremont une lutte intérieure qui se manifestera par des hésitations, des contradictions et des intermittences. Du reste l'Indépendance belge peut fort bien faire de tels articles, sans Claremont. Le Ministère actuel, dont ce journal est l'organe, est très hostile à la fusion et à tout ce qui de près ou de loin, sent la légitimité. Ce sont les Odilon Barrot de la Belgique. Adieu, Adieu. Ma fille doit arriver à Paris ce matin. Guillaume ira vous demander vos commissions.
Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 11 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mercredi 11 Sept 1850,
8 heures
J’ai très bien dormi. J’ai besoin de me reposer. Je puis encore, quand je le veux, me fatiguer comme il y a douze ans ; mais j’en suis et j'en reste quelque temps fatigué. Plus j’y pense, plus ce que je viens de voir, et de faire, me paraît bon. Maintenant la bonne conduite doit conduire au succès avec un peu de bonheur pourtant, c’est à dire un peu d'aide de Dieu.
J'ai retrouvé à Paris, en rangeant mes papiers cinq lettres de moi à vous, le second voyage de la reine d'Angleterre au château d'Eu (septembre 1845). J'ai oublié de vous les rendre. Je les ai ici. Je viens de les relire. Quelle lanterne magique que le monde. Outre le malheur, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup dans ces brusques et continuels changements de scène ; c’est un certain défaut bien involontaire de dignité pour les acteurs. Si haut et si bas en un clin d'œil ! Tenir si peu et pouvoir si peu ! Des marionnettes, sans cesse remuées par des fils invisibles ; des plumes, dans l’air flottant en tous sens, sous des souffles inconnus. J'ai bien envie de finir comme Massillon commence son oraison funèbre devant le catafalque de Louis XIV : " Dieu seul est grand. "
M. de Witt est revenu de Cherbourg. Le Président mieux traité le second jour que le premier, et le troisième que le second. A tout prendre, accueil médiocre. La flotté très exacte, dans ses houras. (sept) au coup de sifflet, mais très froide. Les matelots Joinvillistes. Les officiers partagés, les uns Joinvillistes, les autres républicains. La population amusée, et indifférente beaucoup plus occupée du spectacle que de l'acteur principal. Petit, très petit complot des rouges pour crier sans relâche, sur ses pas, " vive la république sociale ! " Le peuple haussant les épaules et repoussant les gamins, avec mépris mais sans colère, Très bonne tenue de la troupe, faisant son devoir avec calme. Concours immense. Grande difficulté de trouver à manger. Quatre dîners de table d’hôte par jour dans toutes les auberges, et bien des gens ne parvenant pas à dîner. La flottille anglaise bien reçue et charmée de sa visite. quand le Président a passé devant elle en visitant la flotte, il a été accueilli par des houras très vifs.
10 heures
Je suis bien fâché de votre mal de gorge. Je ne peux pourtant pas me résoudre encore à vous envoyer à Madère. J'espère que ce ne sera pas long. Ne manquez pas, je vous prie de me dire aussi quand ce sera passé. C'est bien dommage que nous n'ayons pas rencontré Thiers sur la route, entre Esher et Claremont comme Salvandy.
Je doute un peu de la nouvelle de la Princesse Mathilde ; elle aura parlé d’un projet comme d'un fait. Je reçois un mot de Marion qui me dit que décidément ils quittent Brighton du 16 au 20, et qu’ils seront à Paris au commencement d'octobre. Vous le savez sûrement déjà. Adieu, adieu, adieu. G.
8 heures
J’ai très bien dormi. J’ai besoin de me reposer. Je puis encore, quand je le veux, me fatiguer comme il y a douze ans ; mais j’en suis et j'en reste quelque temps fatigué. Plus j’y pense, plus ce que je viens de voir, et de faire, me paraît bon. Maintenant la bonne conduite doit conduire au succès avec un peu de bonheur pourtant, c’est à dire un peu d'aide de Dieu.
J'ai retrouvé à Paris, en rangeant mes papiers cinq lettres de moi à vous, le second voyage de la reine d'Angleterre au château d'Eu (septembre 1845). J'ai oublié de vous les rendre. Je les ai ici. Je viens de les relire. Quelle lanterne magique que le monde. Outre le malheur, il y a quelque chose qui me déplaît beaucoup dans ces brusques et continuels changements de scène ; c’est un certain défaut bien involontaire de dignité pour les acteurs. Si haut et si bas en un clin d'œil ! Tenir si peu et pouvoir si peu ! Des marionnettes, sans cesse remuées par des fils invisibles ; des plumes, dans l’air flottant en tous sens, sous des souffles inconnus. J'ai bien envie de finir comme Massillon commence son oraison funèbre devant le catafalque de Louis XIV : " Dieu seul est grand. "
M. de Witt est revenu de Cherbourg. Le Président mieux traité le second jour que le premier, et le troisième que le second. A tout prendre, accueil médiocre. La flotté très exacte, dans ses houras. (sept) au coup de sifflet, mais très froide. Les matelots Joinvillistes. Les officiers partagés, les uns Joinvillistes, les autres républicains. La population amusée, et indifférente beaucoup plus occupée du spectacle que de l'acteur principal. Petit, très petit complot des rouges pour crier sans relâche, sur ses pas, " vive la république sociale ! " Le peuple haussant les épaules et repoussant les gamins, avec mépris mais sans colère, Très bonne tenue de la troupe, faisant son devoir avec calme. Concours immense. Grande difficulté de trouver à manger. Quatre dîners de table d’hôte par jour dans toutes les auberges, et bien des gens ne parvenant pas à dîner. La flottille anglaise bien reçue et charmée de sa visite. quand le Président a passé devant elle en visitant la flotte, il a été accueilli par des houras très vifs.
10 heures
Je suis bien fâché de votre mal de gorge. Je ne peux pourtant pas me résoudre encore à vous envoyer à Madère. J'espère que ce ne sera pas long. Ne manquez pas, je vous prie de me dire aussi quand ce sera passé. C'est bien dommage que nous n'ayons pas rencontré Thiers sur la route, entre Esher et Claremont comme Salvandy.
Je doute un peu de la nouvelle de la Princesse Mathilde ; elle aura parlé d’un projet comme d'un fait. Je reçois un mot de Marion qui me dit que décidément ils quittent Brighton du 16 au 20, et qu’ils seront à Paris au commencement d'octobre. Vous le savez sûrement déjà. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 29 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 29 août 1850
On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.
Je lisais, il y a quelques semaines à mes enfants un sermon de Bossuet, prêché devant Louis XIV, et qui dit : " C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui à parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort ! Voilà dit-on ce que c’est que l'homme. Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée ; ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt les noires idées ; et je puis dire que les mortels n’ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. " Ce sont de bien belles paroles et bien vraies.
Que feront la Reine et ses enfants ? Je persiste à penser que le parti digne est de laisser le corps du Roi à Claremont, toujours le centre et le lieu de la famille royale, jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à Dreux, comme il y doit être ramené, sans désordre et sans indifférence. Aujourd’hui, il y aurait l'un ou l'autre spectacle. Et toujours quelques uns des Princes à Claremont pendant que les autres voyageraient à leur gré. C’est la conduite que nous avons indiquée à St Léonard le Duc de Broglie et moi. Je viens de lui écrire pour lui demander, s’il est toujours du même avis. Que de sottises seront dites d’ici à huit jours sur ce grand mort ! Sottises de haine et sottises de bêtise.
En France et aussi en Angleterre. J'espère qu’il y aura aussi des paroles convenables. Il y a droit, et il peut supporter la vérité. J’espère aussi avoir enfin des lettres de vous. Le silence dans l'absence est insupportable.
Dix heures
Voilà vos deux lettres. J'ai vraiment envie, pour vous, que vous puissiez aller à Bade. Vous y passeriez huit jours agréablement. Qu'avez-vous besoin du Duc de Noailles ? Plaisir, je comprends, mais besoin, non. Kolb suffit pour la sureté.. Les Débats sont très convenables sur le Roi. Les paroles sont justes et le sentiment vrai. Le Constitutionnel très inconvenant. Sec et petit. On dirait qu’il parle pour sa propre justification. Quand viendra le moment où la vérité pourra être dite ? Jamais peut-être de mon vivant. Adieu, adieu.
Vous ne me dites pas de ne plus vous écrire à Schlangenbad. Je continue donc. Je serai bien aise quand je vous en saurai dehors. Votre ennui me déplaît et le froid m'inquiète. Adieu, adieu.
Prendra-t-on à Wiesbaden le deuil du Roi ? Ce serait de bien bonne paroles convenables. Il y a droit, et il peut politique comme de bien bon goût.
On a beau dire qu’on s'attend à la mort de quelqu'un. La mort est quelque chose de si grand qu’elle frappe toujours comme un coup imprévu.
Je lisais, il y a quelques semaines à mes enfants un sermon de Bossuet, prêché devant Louis XIV, et qui dit : " C’est une étrange faiblesse de l’esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente, quoiqu’elle se mette en vue de tous côtés et en mille formes diverses. On n'entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui à parlé, et de quoi le défunt l’a entretenu ; et tout d’un coup, il est mort ! Voilà dit-on ce que c’est que l'homme. Et celui qui le dit, c’est un homme ; et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée ; ou s'il passe dans son esprit quelque désir volage de s'y préparer, il dissipe bientôt les noires idées ; et je puis dire que les mortels n’ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. " Ce sont de bien belles paroles et bien vraies.
Que feront la Reine et ses enfants ? Je persiste à penser que le parti digne est de laisser le corps du Roi à Claremont, toujours le centre et le lieu de la famille royale, jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à Dreux, comme il y doit être ramené, sans désordre et sans indifférence. Aujourd’hui, il y aurait l'un ou l'autre spectacle. Et toujours quelques uns des Princes à Claremont pendant que les autres voyageraient à leur gré. C’est la conduite que nous avons indiquée à St Léonard le Duc de Broglie et moi. Je viens de lui écrire pour lui demander, s’il est toujours du même avis. Que de sottises seront dites d’ici à huit jours sur ce grand mort ! Sottises de haine et sottises de bêtise.
En France et aussi en Angleterre. J'espère qu’il y aura aussi des paroles convenables. Il y a droit, et il peut supporter la vérité. J’espère aussi avoir enfin des lettres de vous. Le silence dans l'absence est insupportable.
Dix heures
Voilà vos deux lettres. J'ai vraiment envie, pour vous, que vous puissiez aller à Bade. Vous y passeriez huit jours agréablement. Qu'avez-vous besoin du Duc de Noailles ? Plaisir, je comprends, mais besoin, non. Kolb suffit pour la sureté.. Les Débats sont très convenables sur le Roi. Les paroles sont justes et le sentiment vrai. Le Constitutionnel très inconvenant. Sec et petit. On dirait qu’il parle pour sa propre justification. Quand viendra le moment où la vérité pourra être dite ? Jamais peut-être de mon vivant. Adieu, adieu.
Vous ne me dites pas de ne plus vous écrire à Schlangenbad. Je continue donc. Je serai bien aise quand je vous en saurai dehors. Votre ennui me déplaît et le froid m'inquiète. Adieu, adieu.
Prendra-t-on à Wiesbaden le deuil du Roi ? Ce serait de bien bonne paroles convenables. Il y a droit, et il peut politique comme de bien bon goût.
Trouville, Mercredi 21 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Trouville, Mercredi 21 août 1850
Je me suis longtemps promené hier seul une ou deux lieues le long de la plage. En revenant, j’ai fait visite au Chancelier, à notre ami Olliffe et à Charles Laffitte. Le Chancelier et Mad. de Boigne, sont aux petits soins pour moi. Il est bien aisé de reprendre possession des gens. Il est vrai qu'on les reperd aussi aisément. Plus on avance dans la vie, plus le fossé devient profond entre les relations ordinaires et les vrais liens.
Ollife vient de faire bâtir ici pour lui-même une bonne et jolie maison absurde au dehors, gothique, mauresque, italienne mais très commode et bien arrangée au dedans et très bien meublée. Il est tout à fait riche, bien établi, content, et toujours très reconnaissant pour moi qui lui ai fait faire les premiers pas dans sa fortune.
Charles Laffitte est décidément légitimiste. Cela seulement est une fin ; mais tant que les légitimistes mèneront aux-mêmes leur barque, ils n'aborderont pas. Le Président leur doit une belle chandelle. Ils lui donnent les trois quarts des Orléanistes.
Voilà ce que j’ai appris dans mes visites. Aujourd'hui je vais dîner à la campagne, prés de Honfleur chez Mad. Denoix, femme de notre consul général à Milan, grande ancienne armée du chancelier. Elle habite un cottage dans un site qu’on dit le plus beau du pays.
Pauline avec son mari, et Guillaume, part samedi pour l’Angleterre, et je retourne mardi prochain au Val Richer, avec Henriette. Il fait froid à Trouville, décidément le mois d’Août a été laid. Mes huit jours d'Ems sont le seul beau temps de l'été.
Vous m'apprenez que la Princesse Crasalcovitch est méchante. Mais cela ne m'étonne pas. Cela va à son air et à ses gestes. Est-ce pour lui donner à dîner que Thiers est venu à Baden ? Le Chancelier est convaincu qu'il est venu pour Wiesbaden. Je le croirais si je n'étais pas sûr que j'ai été à Ems et que je n'ai pas vu M. le comte de Chambord. Je voudrais que le Chancelier eût raison.
Est-ce Crasalcovitch, comme je dis, ou Grassalcovitch comme vous dites ? Je soupçonne que chez ces peuples encore un peu barbares personne ne sait bien quel est vraiment son nom. Shakespeare signait trois ou quatre orthographes différentes. Adieu jusqu'à l'heure de la poste. Je vais faire ma toilette. J’ai vu hier des nouvelles de Claremont. Toujours mauvaises. Le Roi n'a plus de jambes du tout. Il ne peut se soutenir d'un fauteuil à l'autre, dans sa chambre.
Midi
Voici votre lettre. Très intéressante. Je souhaite de tout mon coeur que tout cela soit vrai. Le départ brusque de M. de La Rochejaquelein est un bon symptôme. Adieu, Adieu. Je vais lire le séjour du président à Besançon. Adieu. G.
Je me suis longtemps promené hier seul une ou deux lieues le long de la plage. En revenant, j’ai fait visite au Chancelier, à notre ami Olliffe et à Charles Laffitte. Le Chancelier et Mad. de Boigne, sont aux petits soins pour moi. Il est bien aisé de reprendre possession des gens. Il est vrai qu'on les reperd aussi aisément. Plus on avance dans la vie, plus le fossé devient profond entre les relations ordinaires et les vrais liens.
Ollife vient de faire bâtir ici pour lui-même une bonne et jolie maison absurde au dehors, gothique, mauresque, italienne mais très commode et bien arrangée au dedans et très bien meublée. Il est tout à fait riche, bien établi, content, et toujours très reconnaissant pour moi qui lui ai fait faire les premiers pas dans sa fortune.
Charles Laffitte est décidément légitimiste. Cela seulement est une fin ; mais tant que les légitimistes mèneront aux-mêmes leur barque, ils n'aborderont pas. Le Président leur doit une belle chandelle. Ils lui donnent les trois quarts des Orléanistes.
Voilà ce que j’ai appris dans mes visites. Aujourd'hui je vais dîner à la campagne, prés de Honfleur chez Mad. Denoix, femme de notre consul général à Milan, grande ancienne armée du chancelier. Elle habite un cottage dans un site qu’on dit le plus beau du pays.
Pauline avec son mari, et Guillaume, part samedi pour l’Angleterre, et je retourne mardi prochain au Val Richer, avec Henriette. Il fait froid à Trouville, décidément le mois d’Août a été laid. Mes huit jours d'Ems sont le seul beau temps de l'été.
Vous m'apprenez que la Princesse Crasalcovitch est méchante. Mais cela ne m'étonne pas. Cela va à son air et à ses gestes. Est-ce pour lui donner à dîner que Thiers est venu à Baden ? Le Chancelier est convaincu qu'il est venu pour Wiesbaden. Je le croirais si je n'étais pas sûr que j'ai été à Ems et que je n'ai pas vu M. le comte de Chambord. Je voudrais que le Chancelier eût raison.
Est-ce Crasalcovitch, comme je dis, ou Grassalcovitch comme vous dites ? Je soupçonne que chez ces peuples encore un peu barbares personne ne sait bien quel est vraiment son nom. Shakespeare signait trois ou quatre orthographes différentes. Adieu jusqu'à l'heure de la poste. Je vais faire ma toilette. J’ai vu hier des nouvelles de Claremont. Toujours mauvaises. Le Roi n'a plus de jambes du tout. Il ne peut se soutenir d'un fauteuil à l'autre, dans sa chambre.
Midi
Voici votre lettre. Très intéressante. Je souhaite de tout mon coeur que tout cela soit vrai. Le départ brusque de M. de La Rochejaquelein est un bon symptôme. Adieu, Adieu. Je vais lire le séjour du président à Besançon. Adieu. G.
Bruxelles, Jeudi 8 août 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Bruxelles. Jeudi 8 août 1850
6 heures Je sors de mon lit. J'ai bien dormi. J'en avais besoin. Les lits allemands sont décidément bien mauvais. A Aix-la-Chapelle et ici, j’ai senti la différence d'avance, je suis encore jeune et indifférent au plus ou moins de comfort matériel. Au fait, il y a des comforts dont je ressens d'absence, car elle me cause une fatigue dont je ne me suis pas soucié, mais dont je ne peux plus me défendre. C'est l’âge.
Agréable descente du Rhin très beau temps, très chaud. Les beaux endroits m'ont moins frappé que la première fois, sauf le fleuve, j’aime mieux la vallée de la Lahn. J'ai assez causé avec Constantin. Vraiment très bon, très sensé et intelligent. Sa femme souffrait et s'impatientait de la chaleur. Il y avait avec eux deux ou trois Crony. A Cologne j'ai dîné, lu l'Indépen dance, et vu la Cathédrale. Ce qui est fait est admirable, prächtig ; mais ce n'est ni un monument, ni une ruine. Une grande œuvre inachevée, faute de foi, de constance et d'argent. Une preuve colossale de la faiblesse humaine. On y met aujourd’hui 180 ouvriers, et on y dépense 600 000 francs par an. A ce taux-là, il faudra 150 ans pour la finir. Cela ne vous fait rien ; mais cela m’a fait quelque chose quand on me l'a dit et je vous le redis. Thiers avait passé à Cologne, la veille à l'hôtel Royal dont le maître me l'a dit, et le Cicerone qui m’a conduit à la cathédrale m’a dit qu’il l’avait conduit, non pas à la Cathédrale, mais à une mine de cuivre et d'argent, située à quatre lieues de Cologne et dans laquelle il a des actions.
A Verviers, dans l'embarcadère, j’ai rencontré la Duchesse de Saxe-Cobourg venant de Cobourg avec ses quatre enfants, Mad. Angelet, son ancienne gouvernante, un précepteur et deux domestiques. Elle allait passer quinze jours à Bruxelles, et je l’ai retrouvée à 7 heures à Lacken où j’ai dîné. Cinq minutes après, mon arrivée à l'hôtel de Bellevue, Van Pract est venu me voir, et m’engager à dîner de la part du Roi. A six heures et demie, il est revenu me chercher. Très bon accueil : " Que de temps que nous nous sommes vus, et que de choses me rappelle votre voix !" J'ai dîné à côté de la Reine, à qui j'ai dit pas mal de choses qui l’ont, si je ne me trompe, un peu frappée. Après dîner, vingt, minutes de conversation avec le Roi, devant une fenêtre. Il m’a donné rendez-vous pour aujourd’hui à onze heures et demie Il veut causer et moi aussi. En le quittant, j’irai voir, le Prince de Metternich, et je pars ce soir à 6 heures.
Duchâtel m’écrit : " J'arriverai le 8 au soir (ce soir) à Creuznach. Voulez-vous présenter tous mes hommages à la Princesse de Lieven ? Si elle reste dans le voisinage du Rhin, elle serait bien aimable de me le faire savoir à Creuznach. J’irais la voir là où elle serait. " Point de nouvelles d'ailleurs sinon celle-ci : " Piscatory a renoncé à la République et au président ; il est tout régence. "
Adieu. J’ai quitté Ems content et triste. Jouir et regretter, c’est la vie humaine, si ce n’était que cela, ce serait trop peu pour l'élan donné à l'âme. On n'aspire pas si loin pour tomber si près. Adieu, adieu. Je vous écrirai demain de Paris. Adieu. G.
6 heures Je sors de mon lit. J'ai bien dormi. J'en avais besoin. Les lits allemands sont décidément bien mauvais. A Aix-la-Chapelle et ici, j’ai senti la différence d'avance, je suis encore jeune et indifférent au plus ou moins de comfort matériel. Au fait, il y a des comforts dont je ressens d'absence, car elle me cause une fatigue dont je ne me suis pas soucié, mais dont je ne peux plus me défendre. C'est l’âge.
Agréable descente du Rhin très beau temps, très chaud. Les beaux endroits m'ont moins frappé que la première fois, sauf le fleuve, j’aime mieux la vallée de la Lahn. J'ai assez causé avec Constantin. Vraiment très bon, très sensé et intelligent. Sa femme souffrait et s'impatientait de la chaleur. Il y avait avec eux deux ou trois Crony. A Cologne j'ai dîné, lu l'Indépen dance, et vu la Cathédrale. Ce qui est fait est admirable, prächtig ; mais ce n'est ni un monument, ni une ruine. Une grande œuvre inachevée, faute de foi, de constance et d'argent. Une preuve colossale de la faiblesse humaine. On y met aujourd’hui 180 ouvriers, et on y dépense 600 000 francs par an. A ce taux-là, il faudra 150 ans pour la finir. Cela ne vous fait rien ; mais cela m’a fait quelque chose quand on me l'a dit et je vous le redis. Thiers avait passé à Cologne, la veille à l'hôtel Royal dont le maître me l'a dit, et le Cicerone qui m’a conduit à la cathédrale m’a dit qu’il l’avait conduit, non pas à la Cathédrale, mais à une mine de cuivre et d'argent, située à quatre lieues de Cologne et dans laquelle il a des actions.
A Verviers, dans l'embarcadère, j’ai rencontré la Duchesse de Saxe-Cobourg venant de Cobourg avec ses quatre enfants, Mad. Angelet, son ancienne gouvernante, un précepteur et deux domestiques. Elle allait passer quinze jours à Bruxelles, et je l’ai retrouvée à 7 heures à Lacken où j’ai dîné. Cinq minutes après, mon arrivée à l'hôtel de Bellevue, Van Pract est venu me voir, et m’engager à dîner de la part du Roi. A six heures et demie, il est revenu me chercher. Très bon accueil : " Que de temps que nous nous sommes vus, et que de choses me rappelle votre voix !" J'ai dîné à côté de la Reine, à qui j'ai dit pas mal de choses qui l’ont, si je ne me trompe, un peu frappée. Après dîner, vingt, minutes de conversation avec le Roi, devant une fenêtre. Il m’a donné rendez-vous pour aujourd’hui à onze heures et demie Il veut causer et moi aussi. En le quittant, j’irai voir, le Prince de Metternich, et je pars ce soir à 6 heures.
Duchâtel m’écrit : " J'arriverai le 8 au soir (ce soir) à Creuznach. Voulez-vous présenter tous mes hommages à la Princesse de Lieven ? Si elle reste dans le voisinage du Rhin, elle serait bien aimable de me le faire savoir à Creuznach. J’irais la voir là où elle serait. " Point de nouvelles d'ailleurs sinon celle-ci : " Piscatory a renoncé à la République et au président ; il est tout régence. "
Adieu. J’ai quitté Ems content et triste. Jouir et regretter, c’est la vie humaine, si ce n’était que cela, ce serait trop peu pour l'élan donné à l'âme. On n'aspire pas si loin pour tomber si près. Adieu, adieu. Je vous écrirai demain de Paris. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 26 Juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer. Vendredi 26 Juillet 1850
J’aimerais mieux n'avoir pas pour mon voyage, les torrents de pluie qui nous inondaient hier. Une fois arrivé, j'oublierai la pluie ; mais je voudrais que tout eût l’air content et gai autour de moi. Je ne saurai que demain matin, si je suis partir de Paris dimanche soir pour être à Ems mardi avec la poste. En tous cas, je partirai d’ici demain soir. Je ne vous écrirai pas demain. Je vous écrirais dimanche de Paris si je ne pouvais en partir que lundi.
A en juger par les apparences, le Prince Emile a tout-à-fait raison sur l'Allemagne. La révolution est évidemment hors d'état de faire là ce qu’elle veut. Mais je doute que les vieux gouvernements en soient plus capables, eussent-ils de l’esprit de refaire ce qu'ils voudraient. De tels événements même quand ils avortent, ne laissent pas en vie ce qui était avant eux. Comme vous le disait votre Prince de Saxe-Meiningen, on ne ramènera pas purement et simplement l'Allemagne, à l'ancienne confédération. A la suite de tout ceci, il se fera, au-delà du Rhin, plus ou moins d'unité et de constitution, mais il s'en fera. Vous me dîtes que le Prince de Prusse est devenu plus libéral que son frère, qu’il n’y aura en Autriche que des États locaux à qui on dira un mot du budget. Des Etats locaux partout en Autriche, un mot du budget à tous ces états, et le Prince de Prusse libéral ; mais ce sont là des changements énormes. Et l’Empereur d’Autriche sur son trône et le Prince de Metternich dans sa retraite, et votre Empereur dans sa grandeur intacte et inaccessible, regarderont pourtant cela comme des victoires et ils auront raison. Le monde change ; il faut s'y résigner et changer soi-même autant qu'il le faut pour être en harmonie avec la grande métamorphose, au lieu d’y mourir.
On se sépare bien mal à Paris. Le Constitutionnel, le Pouvoir, tous les amis de l'Elysée prennent la nomination de la Commission permanente avec beaucoup d’amertume. Les Burgraves, si triomphants après le vote de la loi électorale n'ont pas que, ou n’ont pas voulu s'y faire nommer eux ou leurs amis déclarés. M. Molé figure là comme un portrait d'ancêtre. Piscatory s'est mis de côté soit pour échapper comme il me l'a dit, aux embarras de la situation dans l’intervalle, soit crainte de ne pas réussir. La majorité est en dissolution. L'Elysée ne peut rien. Je ne crois à aucun grand acte de personne. Mais il arrivera quelque évènement. Quand les hommes ne peuvent décidément plus rien, ni avancer, ni rester, Dieu s’en mêle.
9 heures
Voilà votre lettre. Je ne vous en dis pas d'avantage. La coalition n’a pas pu réussir à faire passer M. Grévy pour la Commission permanente. Adieu, adieu. Je suis charmé que vous partiez d’Ems le 8, puisque je n'y pourrais rester davantage. Adieu. G.
J’aimerais mieux n'avoir pas pour mon voyage, les torrents de pluie qui nous inondaient hier. Une fois arrivé, j'oublierai la pluie ; mais je voudrais que tout eût l’air content et gai autour de moi. Je ne saurai que demain matin, si je suis partir de Paris dimanche soir pour être à Ems mardi avec la poste. En tous cas, je partirai d’ici demain soir. Je ne vous écrirai pas demain. Je vous écrirais dimanche de Paris si je ne pouvais en partir que lundi.
A en juger par les apparences, le Prince Emile a tout-à-fait raison sur l'Allemagne. La révolution est évidemment hors d'état de faire là ce qu’elle veut. Mais je doute que les vieux gouvernements en soient plus capables, eussent-ils de l’esprit de refaire ce qu'ils voudraient. De tels événements même quand ils avortent, ne laissent pas en vie ce qui était avant eux. Comme vous le disait votre Prince de Saxe-Meiningen, on ne ramènera pas purement et simplement l'Allemagne, à l'ancienne confédération. A la suite de tout ceci, il se fera, au-delà du Rhin, plus ou moins d'unité et de constitution, mais il s'en fera. Vous me dîtes que le Prince de Prusse est devenu plus libéral que son frère, qu’il n’y aura en Autriche que des États locaux à qui on dira un mot du budget. Des Etats locaux partout en Autriche, un mot du budget à tous ces états, et le Prince de Prusse libéral ; mais ce sont là des changements énormes. Et l’Empereur d’Autriche sur son trône et le Prince de Metternich dans sa retraite, et votre Empereur dans sa grandeur intacte et inaccessible, regarderont pourtant cela comme des victoires et ils auront raison. Le monde change ; il faut s'y résigner et changer soi-même autant qu'il le faut pour être en harmonie avec la grande métamorphose, au lieu d’y mourir.
On se sépare bien mal à Paris. Le Constitutionnel, le Pouvoir, tous les amis de l'Elysée prennent la nomination de la Commission permanente avec beaucoup d’amertume. Les Burgraves, si triomphants après le vote de la loi électorale n'ont pas que, ou n’ont pas voulu s'y faire nommer eux ou leurs amis déclarés. M. Molé figure là comme un portrait d'ancêtre. Piscatory s'est mis de côté soit pour échapper comme il me l'a dit, aux embarras de la situation dans l’intervalle, soit crainte de ne pas réussir. La majorité est en dissolution. L'Elysée ne peut rien. Je ne crois à aucun grand acte de personne. Mais il arrivera quelque évènement. Quand les hommes ne peuvent décidément plus rien, ni avancer, ni rester, Dieu s’en mêle.
9 heures
Voilà votre lettre. Je ne vous en dis pas d'avantage. La coalition n’a pas pu réussir à faire passer M. Grévy pour la Commission permanente. Adieu, adieu. Je suis charmé que vous partiez d’Ems le 8, puisque je n'y pourrais rester davantage. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 23 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 23 Juillet 1850
Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.
L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.
J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.
Midi
Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.
Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.
Si je me guérissait de mes passions, les Assemblées, ne seraient pas la seule dont j’aurais à me guérir. J’aime mieux rester comme je suis. A tout prendre en France du moins, et depuis 1814, les Assemblées ont empêché plus de mal qu'elles n’en ont fait. Sans elles en 1830, et en 1848, le démon révolutionnaire aurait triomphé. Elles l'avaient bien un peu encouragé ; mais elles le lui ont fait bien payer après. Je viens de parcourir tous mes journaux. Je n’y trouve rien. La nomination de la commission permanente sera le dernier acte. Et puis nous serons trois mois sans assemblée. Je souhaite de tout mon cœur que nous soyons mieux dans trois mois qu'aujourd’hui. Je suis bien aise que l'article d’Albert de Broglie vous ait plu. Mais maintenez vos critiques. Je les trouve très justes.
L'homme aux mémoires est bien Saint-Simon. Quoiqu'il écrivit encore sous et sur la Régence, c’est le 17ème siècle qu’il raconte le plus. Louis XIV et sa cour. J'en lis tous les soirs 30 ou 40 pages, là et là à mes enfants. Cela les amuse parfaitement. Je n’ai pas lu les Sophismes en frustrade dont vous parle Marion. Si cela en valait la peine, je les ferais demander. J’ai demandé s'il y avait déjà quelque chose d'un peu complet sur Peel. On me répond qu'il y a un livre, publié, il y a deux ou trois ans par un Dr. Cooke Taylor " Sir Robert Peel and his Times." Vous n'avez surement par entendu parler de cela.
J’ai des nouvelles de Ste Aulaire. Il me dit qu’Horace Vernet, raconte que votre Empereur est toujours charmé de la République en France et surtout partisan zélé du général Cavaignac. C'est sa plus grande nouvelle. Vous voyez que je suis à peu près aussi stérile qu'Ems. Adieu. Adieu. Voilà enfin le soleil revenu. La pluie nous a accablés pendant quelques jours. Adieu. G.
Midi
Je rouvre ma lettre. Je viens d'avoir une visite qui me rend ma liberté pour le 6 août. J'irai donc vous voir à présent. Je partirai d’ici samedi prochain 27. Je serai dimanche matin, à Paris. J’en partirai le soir ou lundi matin pour Bruxelles et je serai à Ems mardi soir 30 ou mercredi Il. J’y passerai huit jours avec vous. Il faut que je sois à Paris, dans la journée du 11. Si Aberdeen vient à Ems, tant mieux. Sinon encore tant mieux. Grand plaisir que cette petite course. Adieu, adieu.
Soyez assez bonne pour m’assurer à Ems un petit logement. J’aurai avec moi un domestique, Adieu encore. G.
Val-Richer, Dimanche 14 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 14 Juillet 1850
Sept heures
C’est un plaisir charmant de vous écrire le cœur content. Je puis enfouir bien des choses dans mon cœur sans qu’il y paraisse mais c'est un poids bien lourd.
Nous ne nous sommes pas trompés sur les défauts de Peel ; mais nous n'avons pas prisé assez haut ses qualités, ces deux-ci surtout, son indépendance de tout esprit de parti, et sa préoccupation de la justice envers le masses et de leur sort. C'est là ce que l’a fait grand en lui faisant faire à tout risque, de grandes choses, et ce qui lui vaut aujourd’hui le respect et la sympathie de tout un peuple. Il s'est dégagé des liens qui enchaînent en général les hommes politiques, et il s’en est dégagé pour donner satisfaction aux besoins du peuple, sans s'inquiéter des nécessité du gouvernement. Et il a fait cela en étant un conservateur, un homme d’ordre et de politique sensée et régulière Conduite grande et originale, quoi qu’il n’eût pas dans l’esprit beaucoup d'originalité ni de grandeur.
10 heures
Votre lettre du 9 m’a interrompu. Je ne m’en plains pas. J’ai beaucoup à vous dire encore sur Peel. J'y reviendrai. Je reçois une longue lettre de Lord Aberdeen revenant de Drayton. « It was a sad ceremony ; and to witness the change in that happy résidence, in which I had experienced so much friendship, and had seen so much wisdom, prudence, and integrity of character, required more philosophy than I possessed. " Des détails sur le sentiment public envers Peel. Puis ceci : " His last speech was most important. It was made reluctanly and he greatly dreaded the defeat of tre Govern. ment. From his previous silence, had it not been delivered, the government could have maintained and the public would have believed that he approved of their foreign, as well as of their domestic policy. His manifest reluctance and the moderation of hir manner rendered his censure most effective. " Discussion toujours profonde, quoiqu'avec moins d’aigreur, dans le parti conservateur ; pas de conciliation sur les questions de free trade. Conclusion : " Radicalism is here in the ascendant ; but I am inclined to think that there will be more prudence than we have lately witnessed, abroad. "
Autre lettre intéressante de Mistriss Austin " Lord John's speech was far worse than Lord Palmerston's, and calcutated to do great mischief. Every body speaks of Lord Palmerston's as the most wonderful effort of oratory, considering his age, the heat, and all there was to [?] his difficulties. During five hours, he never faultered, never recalled a word never drank a drop of water, and left off with the very same intonation of voice as he began with. How lamentable that such powers are se employed ! People seem to think that in spite of the " triumph " of tne government, the system of foreign policy has received a severe and salutary, check and that even he will not risk another such struggle. If there were any bounds to human credulity, one might be amazed at hearing sensible men (as I did) talk of " all this being the result of a conspiracy. " I asked in vain what means you, and M. de Metternich, and Princess Lieven, possessed of influencing the mind and opinion of the English - for I maintain that the public was against the government. Nobody can answer. Yet they continue to assert it. We are very much ashamed of the vulgar blustering tone of the speacher en that side." Elle est liée avec Cobden, Sir W. Molesworth, tous ces chefs radicaux qui ont parlé et voté contre Lord Palmerston, malgré leur peuple. Voilà l'Angleterre. Demain, je vous enverrai de la France.
J’ai, ce matin, de Paris, de bonnes nouvelles de vous, par Kisseleff. Votre fils Alexandre était arrivé. Adieu, Adieu, Adieu. Vos lettres arrivent affranchies. G.
Sept heures
C’est un plaisir charmant de vous écrire le cœur content. Je puis enfouir bien des choses dans mon cœur sans qu’il y paraisse mais c'est un poids bien lourd.
Nous ne nous sommes pas trompés sur les défauts de Peel ; mais nous n'avons pas prisé assez haut ses qualités, ces deux-ci surtout, son indépendance de tout esprit de parti, et sa préoccupation de la justice envers le masses et de leur sort. C'est là ce que l’a fait grand en lui faisant faire à tout risque, de grandes choses, et ce qui lui vaut aujourd’hui le respect et la sympathie de tout un peuple. Il s'est dégagé des liens qui enchaînent en général les hommes politiques, et il s’en est dégagé pour donner satisfaction aux besoins du peuple, sans s'inquiéter des nécessité du gouvernement. Et il a fait cela en étant un conservateur, un homme d’ordre et de politique sensée et régulière Conduite grande et originale, quoi qu’il n’eût pas dans l’esprit beaucoup d'originalité ni de grandeur.
10 heures
Votre lettre du 9 m’a interrompu. Je ne m’en plains pas. J’ai beaucoup à vous dire encore sur Peel. J'y reviendrai. Je reçois une longue lettre de Lord Aberdeen revenant de Drayton. « It was a sad ceremony ; and to witness the change in that happy résidence, in which I had experienced so much friendship, and had seen so much wisdom, prudence, and integrity of character, required more philosophy than I possessed. " Des détails sur le sentiment public envers Peel. Puis ceci : " His last speech was most important. It was made reluctanly and he greatly dreaded the defeat of tre Govern. ment. From his previous silence, had it not been delivered, the government could have maintained and the public would have believed that he approved of their foreign, as well as of their domestic policy. His manifest reluctance and the moderation of hir manner rendered his censure most effective. " Discussion toujours profonde, quoiqu'avec moins d’aigreur, dans le parti conservateur ; pas de conciliation sur les questions de free trade. Conclusion : " Radicalism is here in the ascendant ; but I am inclined to think that there will be more prudence than we have lately witnessed, abroad. "
Autre lettre intéressante de Mistriss Austin " Lord John's speech was far worse than Lord Palmerston's, and calcutated to do great mischief. Every body speaks of Lord Palmerston's as the most wonderful effort of oratory, considering his age, the heat, and all there was to [?] his difficulties. During five hours, he never faultered, never recalled a word never drank a drop of water, and left off with the very same intonation of voice as he began with. How lamentable that such powers are se employed ! People seem to think that in spite of the " triumph " of tne government, the system of foreign policy has received a severe and salutary, check and that even he will not risk another such struggle. If there were any bounds to human credulity, one might be amazed at hearing sensible men (as I did) talk of " all this being the result of a conspiracy. " I asked in vain what means you, and M. de Metternich, and Princess Lieven, possessed of influencing the mind and opinion of the English - for I maintain that the public was against the government. Nobody can answer. Yet they continue to assert it. We are very much ashamed of the vulgar blustering tone of the speacher en that side." Elle est liée avec Cobden, Sir W. Molesworth, tous ces chefs radicaux qui ont parlé et voté contre Lord Palmerston, malgré leur peuple. Voilà l'Angleterre. Demain, je vous enverrai de la France.
J’ai, ce matin, de Paris, de bonnes nouvelles de vous, par Kisseleff. Votre fils Alexandre était arrivé. Adieu, Adieu, Adieu. Vos lettres arrivent affranchies. G.
Val-Richer, Dimanche 7 juillet 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Dimanche 7 Juillet 1850
Six heures
Je me lève de bonne heure quoique je n'aie point à partir. Je me couche aussi de bonne heure, à 10 heures au plus tard. Je m’en trouve bien et comme santé et comme travail. J'écris et je fais mes affaires en me levant jusqu'à 11 heures. Dans le cours de la journée, je me promène beaucoup. Je vois peu de monde. Ce n'est pas, comme l'été dernier, un flux continu de visites de toutes parts, par amitié, par convenance, par curiosité. Il est impossible de mener une vie plus tranquille et plus régulière que la mienne. Mes enfants sont pleins d'affection et de soin. Je me passe très bien du mouvement extérieur qui me manque. Mais je ne me passe point de l’intimité intérieure. C'est là le vide.
Une chose me frappe dans les lettres de Paris dont je vous ai envoyé hier le résumé, et aussi dans les conversations que j'entends. Quoique personne ne devienne ni républicain, ni présidentiel, cependant la République et le président gagnent. Les légitimistes déplaisent de plus en plus. La monarchie sans les légitimistes paraît de plus en plus impossible. Point d'avenir donc hors de ce qui est; et qui n’a pas d'avenir non plus, mais qui est et que personne n'entreprend sérieusement de renverser n'étant pas sûr de le renverser à son profit. C’est un arbre qui ne grandit pas, qui ne s'enracine pas, qui ne pousse ni sur terre ni sous terre, mais qui reste debout. A quel point la nécessité, et l'habitude sont-elles suffisantes pour fonder un gouvernement ; voilà la question qui est en train de se résoudre. Je ne crois pas qu'elles soient suffisantes pour fonder, mais elles le sont, à coup sûr, pour faire durer longtemps. J’ai écrit cela hier à S Léonard avec détail, à la Reine. Mes nouvelles du Roi continuent d’être bonnes.
10 heures
Pas de lettre aujourd'hui. Cela ne m'étonne pas. Vous serez arrivée avant hier à Ems trop tard pour la poste. Je vois dans les journaux une crue subite du Rhin qui me déplaît. Vous avez dû aller de Cologne à Ems par le Rhin. J'espère que vous n'aurez eu ni sujet, ni seulement prétexte d'avoir peur. II ne me vient rien du tout de Paris ce matin. Je trouve que le ministère à l’air bien étourdi et bien impuissant. La loi sur la presse que tout le monde repousse, sa loi sur les maires qu’il voudrait et n'ose remettre à flot. Il semble que les esprits soient à bout comme les forces, et qu’on ne sache plus rien inventer qu'on puisse mener à bien. Adieu, Adieu. Vous me direz comment vous êtes établie à Ems. Adieu. G.
Six heures
Je me lève de bonne heure quoique je n'aie point à partir. Je me couche aussi de bonne heure, à 10 heures au plus tard. Je m’en trouve bien et comme santé et comme travail. J'écris et je fais mes affaires en me levant jusqu'à 11 heures. Dans le cours de la journée, je me promène beaucoup. Je vois peu de monde. Ce n'est pas, comme l'été dernier, un flux continu de visites de toutes parts, par amitié, par convenance, par curiosité. Il est impossible de mener une vie plus tranquille et plus régulière que la mienne. Mes enfants sont pleins d'affection et de soin. Je me passe très bien du mouvement extérieur qui me manque. Mais je ne me passe point de l’intimité intérieure. C'est là le vide.
Une chose me frappe dans les lettres de Paris dont je vous ai envoyé hier le résumé, et aussi dans les conversations que j'entends. Quoique personne ne devienne ni républicain, ni présidentiel, cependant la République et le président gagnent. Les légitimistes déplaisent de plus en plus. La monarchie sans les légitimistes paraît de plus en plus impossible. Point d'avenir donc hors de ce qui est; et qui n’a pas d'avenir non plus, mais qui est et que personne n'entreprend sérieusement de renverser n'étant pas sûr de le renverser à son profit. C’est un arbre qui ne grandit pas, qui ne s'enracine pas, qui ne pousse ni sur terre ni sous terre, mais qui reste debout. A quel point la nécessité, et l'habitude sont-elles suffisantes pour fonder un gouvernement ; voilà la question qui est en train de se résoudre. Je ne crois pas qu'elles soient suffisantes pour fonder, mais elles le sont, à coup sûr, pour faire durer longtemps. J’ai écrit cela hier à S Léonard avec détail, à la Reine. Mes nouvelles du Roi continuent d’être bonnes.
10 heures
Pas de lettre aujourd'hui. Cela ne m'étonne pas. Vous serez arrivée avant hier à Ems trop tard pour la poste. Je vois dans les journaux une crue subite du Rhin qui me déplaît. Vous avez dû aller de Cologne à Ems par le Rhin. J'espère que vous n'aurez eu ni sujet, ni seulement prétexte d'avoir peur. II ne me vient rien du tout de Paris ce matin. Je trouve que le ministère à l’air bien étourdi et bien impuissant. La loi sur la presse que tout le monde repousse, sa loi sur les maires qu’il voudrait et n'ose remettre à flot. Il semble que les esprits soient à bout comme les forces, et qu’on ne sache plus rien inventer qu'on puisse mener à bien. Adieu, Adieu. Vous me direz comment vous êtes établie à Ems. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 29 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 29 Juin 1850
6 heures
Je viens de me promener une heure seul. Après vous, ce que j'aime le mieux, c’est la solitude. Je crois bien que je finirais par m'en lasser. Mais ce serait long. Mon passé est très plein, et je lui porte de l'affection. J’ai encore assez de curiosité pour l'avenir. Je ne prouve point de vide.
Aujourd’hui, ni vous, ni les journaux ne m’avez rien apporté de Londres. En y regardant bien, ce que j'ai vraiment le plus à coeur dans cette affaire c'est de voir triompher la justice et la vérité. Elles veulent la ruine de Palmerston. J'estime l'Angleterre. Cela me déplaît qu'elle ne sache pas faire droit. Ce que j’ai de personnel contre Lord Palmerston est bien à la surface et j'y pense bien peu.
Je viens de relire et de mettre tout à fait en ordre, cette étude sur Monk qu’on me demande de réimprimer. Elle n’a jamais été publiée que dans un recueil intitulé la Revue française, en 1837. Elle est enfouie là. C’est une scène de grande Comédie, un soldat, sensé, fin et taciturne, décidé à rétablir le Roi sans tirer un coup de fusil, et pendant plus de six mois trompant tous ceux qui n'en veulent pas et faisant taire tous ceux qui en veulent. C'est piquant à lire aujourd’hui, et amusant pour les gens d'esprit. Pas d'assez grosses couleurs pour le gros public. Aucune recherche d'allusions. D'ailleurs les temps et les pays sont très différents. On y cherchera des malices qu'on y trouvera pas ; et on ne verra pas toutes celles qui y sont.
Dimanche 30 Juin
J'ai des lettres de Londres d'une bonne source que vous connaissez et d'accord avec les vôtres. « C’est un débat sans exemple car il n'est dirigé par aucun esprit de parti, par aucun chef politique ; c'est le sentiment national du droit qui se fait jour avec une puissance irrésistible. Il a dicté le vote de la house of Lords ; il laissera le Ministère dans une bien faible majorité à l'autre chambre. On espérait hier 25 voix, aujourd'hui 15. Les discours de Gladstone et de Molesworth out surtout obtenu un grand succès. Le Gouvernement n'a le secours d’aucun membre indépendant. si ce n'est de gens comme Rocbuck et Bernal Osborne. Bref, on compte aujourd’hui sur une victoire morale complète sur l'ennemi, et sur un vote qui rendra à peu près impossible le maintien du Cabinet Rusell. Lord Stanley échouera s’il essaie de composer un Cabinet sans les free traders, et je crois qu’un remaniement Whig avec Graham & & aura plus de chances de succès. "
J’ai aussi de bonnes nouvelles, de St Léonard. Dumas m'écrit : " L'amélioration dans la santé du Roi s'est soutenue et progressivement développée. Le sommeil est revenu, la toux a disparu, les fonctions de l’estomac se font mieux ; les forces reviennent lentement mais elles reviennent surtout depuis trois jours. J'espère que le Roi reviendra sinon à un rétablissement complet, au moins à un état relativement bon et durable, avec les soins dont il est entouré. " Dumas était un des plus inquiets. C’est vraiment bien dommage que vous partiez dans ce moment. Mais vous avez raison de ne pas rester en l’air. Rien ne vous est plus contraire.
Les rois et les reines ont trop de malheur. Les coup de pistolet, encore passe ; mais des coups de canne ! Adieu, adieu. Je vous obéis ; j'écris toujours à Paris. J'en conclus que vous partirez au plutôt demain soir. Adieu.
6 heures
Je viens de me promener une heure seul. Après vous, ce que j'aime le mieux, c’est la solitude. Je crois bien que je finirais par m'en lasser. Mais ce serait long. Mon passé est très plein, et je lui porte de l'affection. J’ai encore assez de curiosité pour l'avenir. Je ne prouve point de vide.
Aujourd’hui, ni vous, ni les journaux ne m’avez rien apporté de Londres. En y regardant bien, ce que j'ai vraiment le plus à coeur dans cette affaire c'est de voir triompher la justice et la vérité. Elles veulent la ruine de Palmerston. J'estime l'Angleterre. Cela me déplaît qu'elle ne sache pas faire droit. Ce que j’ai de personnel contre Lord Palmerston est bien à la surface et j'y pense bien peu.
Je viens de relire et de mettre tout à fait en ordre, cette étude sur Monk qu’on me demande de réimprimer. Elle n’a jamais été publiée que dans un recueil intitulé la Revue française, en 1837. Elle est enfouie là. C’est une scène de grande Comédie, un soldat, sensé, fin et taciturne, décidé à rétablir le Roi sans tirer un coup de fusil, et pendant plus de six mois trompant tous ceux qui n'en veulent pas et faisant taire tous ceux qui en veulent. C'est piquant à lire aujourd’hui, et amusant pour les gens d'esprit. Pas d'assez grosses couleurs pour le gros public. Aucune recherche d'allusions. D'ailleurs les temps et les pays sont très différents. On y cherchera des malices qu'on y trouvera pas ; et on ne verra pas toutes celles qui y sont.
Dimanche 30 Juin
J'ai des lettres de Londres d'une bonne source que vous connaissez et d'accord avec les vôtres. « C’est un débat sans exemple car il n'est dirigé par aucun esprit de parti, par aucun chef politique ; c'est le sentiment national du droit qui se fait jour avec une puissance irrésistible. Il a dicté le vote de la house of Lords ; il laissera le Ministère dans une bien faible majorité à l'autre chambre. On espérait hier 25 voix, aujourd'hui 15. Les discours de Gladstone et de Molesworth out surtout obtenu un grand succès. Le Gouvernement n'a le secours d’aucun membre indépendant. si ce n'est de gens comme Rocbuck et Bernal Osborne. Bref, on compte aujourd’hui sur une victoire morale complète sur l'ennemi, et sur un vote qui rendra à peu près impossible le maintien du Cabinet Rusell. Lord Stanley échouera s’il essaie de composer un Cabinet sans les free traders, et je crois qu’un remaniement Whig avec Graham & & aura plus de chances de succès. "
J’ai aussi de bonnes nouvelles, de St Léonard. Dumas m'écrit : " L'amélioration dans la santé du Roi s'est soutenue et progressivement développée. Le sommeil est revenu, la toux a disparu, les fonctions de l’estomac se font mieux ; les forces reviennent lentement mais elles reviennent surtout depuis trois jours. J'espère que le Roi reviendra sinon à un rétablissement complet, au moins à un état relativement bon et durable, avec les soins dont il est entouré. " Dumas était un des plus inquiets. C’est vraiment bien dommage que vous partiez dans ce moment. Mais vous avez raison de ne pas rester en l’air. Rien ne vous est plus contraire.
Les rois et les reines ont trop de malheur. Les coup de pistolet, encore passe ; mais des coups de canne ! Adieu, adieu. Je vous obéis ; j'écris toujours à Paris. J'en conclus que vous partirez au plutôt demain soir. Adieu.
Val-Richer, Mardi 11 juin 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 11 juin 1850
10 heures
Je fais dire à Lisieux qu'on me retienne la place de la Malle poste pour samedi soir. Je ne puis pas partir d’ici Vendredi ; j’attends quelqu'un ce jour là qui repartira samedi matin. Je serai à Paris Dimanche à 5 heures du matin. J’en partirai lundi soir pour l'Angleterre. Je tiens beaucoup à savoir quelque chose de ce qu'auront dit là les voyageurs qui doivent en revenir samedi, et de ce qu’on leur aura dit. Cela est important.
Outre mes amis, je désire voir, en passant à Paris, le duc de Noailles et Morny. Soyez assez bonne pour arranger cela. Je crois que le duc de Noailles est déjà à Maintenon. Mais Maintenon est bien près, et le chemin de fer bien prompt.
Quel plaisir de vous revoir, encore avant la grande séparation de l’été ! Que de choses à nous dire déjà ! Hélas beaucoup de celles que nous nous serions dites, si nous ne nous étions pas quittés, sont déjà perdues, et ne se retrouveront pas! Quel gaspillage que la vie ! Je regrette d’aller à St Léonard sitôt après le voyage qui précédera le mien. Cela a trop l’air d’un fait exprès et ôtera un peu de l’efficacité des paroles. Mais il n'y a pas moyen. Mes nouvelles de Londres sont aussi mauvaises que celles que vous me transmettez. Le Roi peut encore traîner, mais il peut manquer d’un moment à l'autre.
Je voudrais bien le rappel de Brünnow. Je crois tout-à-fait à ce que vous dit Ch. Greville. La froideur polie et prolongée des grandes puissances du continent est ce qu’il y a de plus efficace. Mais je doute. Palmerston se rendra. Je le crois. Pourtant je suis frappé de son long marchandage et de son effort pour gagner du temps. De là, surtout mon soupçon de ses intrigues à Athènes. Je persiste à penser que l'argent du président passa. Les légitimistes, qui ne veulent pas le consolider ne peuvent pas le faire ou le laisser tomber. Ils doivent redouter toute crise, de vue [?] d’Elysée. Pour eux, dans l'état actuel des choses, il faut que le Président reste précaire ; mais il faut qu’il dure. Et en définitive, la masse des conservateurs votera pour lui. Adieu.
Je me suis levé tard, et j'ai beaucoup à écrire ce matin. Je suis horriblement enrhumé du cerveau. J'éternue comme vous savez. Adieu, adieu. Je le dis plus gaiement que de coutume, comme si j’allais vraiment vous retrouver. Adieu. G.
10 heures
Je fais dire à Lisieux qu'on me retienne la place de la Malle poste pour samedi soir. Je ne puis pas partir d’ici Vendredi ; j’attends quelqu'un ce jour là qui repartira samedi matin. Je serai à Paris Dimanche à 5 heures du matin. J’en partirai lundi soir pour l'Angleterre. Je tiens beaucoup à savoir quelque chose de ce qu'auront dit là les voyageurs qui doivent en revenir samedi, et de ce qu’on leur aura dit. Cela est important.
Outre mes amis, je désire voir, en passant à Paris, le duc de Noailles et Morny. Soyez assez bonne pour arranger cela. Je crois que le duc de Noailles est déjà à Maintenon. Mais Maintenon est bien près, et le chemin de fer bien prompt.
Quel plaisir de vous revoir, encore avant la grande séparation de l’été ! Que de choses à nous dire déjà ! Hélas beaucoup de celles que nous nous serions dites, si nous ne nous étions pas quittés, sont déjà perdues, et ne se retrouveront pas! Quel gaspillage que la vie ! Je regrette d’aller à St Léonard sitôt après le voyage qui précédera le mien. Cela a trop l’air d’un fait exprès et ôtera un peu de l’efficacité des paroles. Mais il n'y a pas moyen. Mes nouvelles de Londres sont aussi mauvaises que celles que vous me transmettez. Le Roi peut encore traîner, mais il peut manquer d’un moment à l'autre.
Je voudrais bien le rappel de Brünnow. Je crois tout-à-fait à ce que vous dit Ch. Greville. La froideur polie et prolongée des grandes puissances du continent est ce qu’il y a de plus efficace. Mais je doute. Palmerston se rendra. Je le crois. Pourtant je suis frappé de son long marchandage et de son effort pour gagner du temps. De là, surtout mon soupçon de ses intrigues à Athènes. Je persiste à penser que l'argent du président passa. Les légitimistes, qui ne veulent pas le consolider ne peuvent pas le faire ou le laisser tomber. Ils doivent redouter toute crise, de vue [?] d’Elysée. Pour eux, dans l'état actuel des choses, il faut que le Président reste précaire ; mais il faut qu’il dure. Et en définitive, la masse des conservateurs votera pour lui. Adieu.
Je me suis levé tard, et j'ai beaucoup à écrire ce matin. Je suis horriblement enrhumé du cerveau. J'éternue comme vous savez. Adieu, adieu. Je le dis plus gaiement que de coutume, comme si j’allais vraiment vous retrouver. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 31 mai 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 31 mai 1850
9 heures
e suis arrivé ici à 5 heures et demie. J'étais seul dans la malle poste. J’ai beaucoup pensé, à vous et au monde présent. J’ai un peu dormi. Il fait beau et chaud. Ma vallée est verte et calme. Peu de fleurs encore. J'ai emporté une impression triste. J’en trouve ici une douce. Elles se mêlent, sans se détruire. C’est la vie humaine. Je l’arrangerais mieux, pour vous et moi, si j'en étais chargé. Ma présomption ne va pas plus loin. Faute de pouvoir cela, j’arrange mes papiers et mes livres. Je suis un peu las. Adieu. Adieu, à demain une plus longue conversation. Adieu, Dearest. Soignez-vous bien et dites-moi tout sur votre santé. Adieu, adieu. G.
9 heures
e suis arrivé ici à 5 heures et demie. J'étais seul dans la malle poste. J’ai beaucoup pensé, à vous et au monde présent. J’ai un peu dormi. Il fait beau et chaud. Ma vallée est verte et calme. Peu de fleurs encore. J'ai emporté une impression triste. J’en trouve ici une douce. Elles se mêlent, sans se détruire. C’est la vie humaine. Je l’arrangerais mieux, pour vous et moi, si j'en étais chargé. Ma présomption ne va pas plus loin. Faute de pouvoir cela, j’arrange mes papiers et mes livres. Je suis un peu las. Adieu. Adieu, à demain une plus longue conversation. Adieu, Dearest. Soignez-vous bien et dites-moi tout sur votre santé. Adieu, adieu. G.
Mots-clés : Description, Discours du for intérieur, Santé (Dorothée)
Val-Richer, Lundi 5 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 5 Novembre 1849
9 Heures
M. Moulin et M. Vitet m’écrivent de ne pas fixer en ce moment le jour précis de mon retour à Paris. Ils croient que le président n'en restera pas là. Ils me recommandent de ne pas arriver au milieu de la crise : " Quelque réservé quelque prudent que vous soyez, on commentera votre arrivée vos paroles, en vous fera parler quand vous n'aurez rien dit. Il ne vous est pas permis, de vous renfermer dans la vie privée ; vous serez, malgré vous malgré nous, traité en homme public. " Voilà leurs paroles. Ce qu’ils disent est vrai. Je n’y vois pas autant d’inconvénients qu'eux ; et ces inconvénients, s'ils existent, existeront à peu près toujours, A quelque moment que j’arrive, il m’arrivera ce qu’ils disent. Pourtant, je crois que pour ce moment-ci, ils ont raison, et qu’il vaut mieux ne pas fixer de jour précis. Quel ennui, et quel prélude, d'ennemis ! Je suis dans une veine de tristesse profonde, pour vous, pour moi. Si j'étais là, je serais bien moins triste, bien moins inquiet. Votre inquiétude à vous me désole au delà de ce que je puis dire. J’espère qu'elle est exagérée ; mais je la trouve bien naturelle. Si j'étais là, vous seriez moins inquiète et moi probablement pas inquiet du tout. Ah, que le monde est mal arrangé ! Madame Austin vient de partir. Elle va à Rouen, et là elle verra si elle veut aller à Paris ou retourner directement en Angleterre. M. Cousin et M. Barthelemy, Ste Hilaire doivent venir l’attendre à Rouen. Elle a traduit tout ce que j'ai écrit. Je lui enverrai le reste. Voilà, par extraordinaire, votre lettre qui m’arrive deux heures plutôt. On a profité d’une occasion. Vous êtes plus tranquille, donc moi aussi. Que l'Empire se fasse ! Il ne serait pas trop sensé en effet d’aller tomber à Paris, en même temps que la bombe. J'attendrai. Mais qu’il se dépêche. Pourquoi tarder, puisqu'il veut tout, et que ceux qui ne s’en soucient pas veulent si faiblement ? Au fait, je trouve tout cela assez logique et naturel. Le plus pauvre rôle, c’est celui des Chefs de la majorité ne voulant rien faire, et ne pouvant rien empêcher. On m'écrit qu'ils en sont embarrassés. Je suis bien aise que vous ayez enfin vu Broglie. Si le vent souffle ainsi dans les voiles de l'Empire, il n’y aura pas de longs désordres, dans la rue. Les émeutiers auront peur et les soldats seront en train. J'espère que vous n'aurez pas même besoin de Kisseleff. Adieu, adieu. C’est absurde de n'avoir pas rappelé la flotte sur le champ. Adieu. G.
9 Heures
M. Moulin et M. Vitet m’écrivent de ne pas fixer en ce moment le jour précis de mon retour à Paris. Ils croient que le président n'en restera pas là. Ils me recommandent de ne pas arriver au milieu de la crise : " Quelque réservé quelque prudent que vous soyez, on commentera votre arrivée vos paroles, en vous fera parler quand vous n'aurez rien dit. Il ne vous est pas permis, de vous renfermer dans la vie privée ; vous serez, malgré vous malgré nous, traité en homme public. " Voilà leurs paroles. Ce qu’ils disent est vrai. Je n’y vois pas autant d’inconvénients qu'eux ; et ces inconvénients, s'ils existent, existeront à peu près toujours, A quelque moment que j’arrive, il m’arrivera ce qu’ils disent. Pourtant, je crois que pour ce moment-ci, ils ont raison, et qu’il vaut mieux ne pas fixer de jour précis. Quel ennui, et quel prélude, d'ennemis ! Je suis dans une veine de tristesse profonde, pour vous, pour moi. Si j'étais là, je serais bien moins triste, bien moins inquiet. Votre inquiétude à vous me désole au delà de ce que je puis dire. J’espère qu'elle est exagérée ; mais je la trouve bien naturelle. Si j'étais là, vous seriez moins inquiète et moi probablement pas inquiet du tout. Ah, que le monde est mal arrangé ! Madame Austin vient de partir. Elle va à Rouen, et là elle verra si elle veut aller à Paris ou retourner directement en Angleterre. M. Cousin et M. Barthelemy, Ste Hilaire doivent venir l’attendre à Rouen. Elle a traduit tout ce que j'ai écrit. Je lui enverrai le reste. Voilà, par extraordinaire, votre lettre qui m’arrive deux heures plutôt. On a profité d’une occasion. Vous êtes plus tranquille, donc moi aussi. Que l'Empire se fasse ! Il ne serait pas trop sensé en effet d’aller tomber à Paris, en même temps que la bombe. J'attendrai. Mais qu’il se dépêche. Pourquoi tarder, puisqu'il veut tout, et que ceux qui ne s’en soucient pas veulent si faiblement ? Au fait, je trouve tout cela assez logique et naturel. Le plus pauvre rôle, c’est celui des Chefs de la majorité ne voulant rien faire, et ne pouvant rien empêcher. On m'écrit qu'ils en sont embarrassés. Je suis bien aise que vous ayez enfin vu Broglie. Si le vent souffle ainsi dans les voiles de l'Empire, il n’y aura pas de longs désordres, dans la rue. Les émeutiers auront peur et les soldats seront en train. J'espère que vous n'aurez pas même besoin de Kisseleff. Adieu, adieu. C’est absurde de n'avoir pas rappelé la flotte sur le champ. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 3 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Samedi 3 nov. 1849
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Vous savez probablement ces détails-ci. Je vous les donne comme on me les mande, avant de publier ses résolutions Louis Bonaparte en avait fait part à Changarnier, et lui avait offert de lui lire son manifeste. Le général avait répondu qu'il se rendait à la Chambre, et qu’il en entendrait là, la lecture. La lecture faite, Changarnier sortit de la séance, avec Thiers sans laisser percer au dehors aucune marque d'approbation ou de désapprobation. Voici le langage de Thiers. « Il ne faut pas que la majorité pousse le président à un coup de tête ; il faut qu'elle accepte ce Cabinet pris dans son sein et composé d'hommes honorables et dévoués à l’ordre. N'oublions pas que nous sommes en présence de la République rouge et du socialisme, et que nous ne devons, sous aucun prétexte, leur fournir les moyens de triomphe. Ne faisons pas encore un 24 Février.» D'autres sont plus susceptibles, et disent que jamais assemblée n'a été plus indignement souffletée. Ils avouent néanmoins qu'elle ne peut guères se venger sans donner des armes à la Montagne et sans préparer son triomphe. Est-ce là ce qui vous revient ? Avez-vous entendu dire que sur le Boulevard, autour d’un café où se réunissent beaucoup d’officiers quelques uns, après avoir lu le manifeste, avaient crié : Vive Henri V et qu'ils avaient été sur le champ arrêtés ? Je ne fais pas de doute que la majorité ne doive accepter le cabinet pris dans son sein, et le contenir, et l’attirer à elle en le soutenant. Je crois même qu'elle pourrait tenir cette conduite avec beaucoup de dignité pour elle-même, et de profit pour son autorité sur le Pays et l'avenir. Mais je crains qu’on ne donne à une conduite qui pourrait prouver, et produire de la force, les apparences et par conséquent, les effets de la faiblesse. Je crains que mon pauvre pays ne soit défendu, contre les étourderies des enfants, que par les tâtonnements des vieillards. Gardez-moi le secret de ma crainte. Je pense à cela, et à vous. Je pense peut-être à des choses déjà surannées. Qui sait si le nouveau cabinet n’est pas mort ? Il n’avait pas encore été baptisé au Moniteur. Mes journaux me manqueront ce matin à cause de l'Assomption. Pas tous, j'espère. D'ailleurs j'aurai des lettres. C'est, je vous assure, une singulière impression que de vivre en même temps au milieu de tout cela, et au milieu du long Parlement, de Cromwell, de Richard Cromwell des Républicains, des Stuart & & & C'est une perpétuelle confusion de ressemblances et de différences, et de curiosités et de conjectures, qui tombent pêle-mêle sur la France et sur l’Angleterre, sur le passé et sur l'avenir. Je ne dirai pas cependant que je m’y perde. Mon impression est plutôt qu’il rejaillit bien de la lumière d'un pays et d’un temps sur l'autre. Mais soyez tranquille ; j'ai assez de bon sens pour ne pas me fier à mon impression et pour savoir que je n’y vois pas aussi clair que par moments, je le crois.
Midi
Merci, merci. Cela ne me paraît pas, à tout prendre, inquiétant pour le moment. Mes tendres amitiés à Ste. Aulaire quand vous le reverrez. Je crois plus que personne qu’il n’y a que les sots d'infaillibles, mais je suis très décidé à ne pas me laisser affubler du moindre tort prétendu pour épargner à d'autres la honte de leurs gros péchés. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 2 novembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Vendredi 2 Novembre 1849
8 heures
Mon impatience de savoir est extrême. Ce Cabinet s’est-il fait de concert entre le président, et la majorité, ou est-ce qu'un coup de tête du président ? Sera-t-il soutenu ou désavoué par la majorité et ses chefs ? Mon bon sens me porte à croire à la première chance. Deux ou trois billets que j'ai reçus hier m'indiquent plutôt l'autre. Cela importe infiniment pour la suite. si la majorité est consentante, si ce sont là des doublures mises en avant- pour faire ce que ne veulent pas faire les premiers acteurs, il n’y a rien de grave à craindre prochainement, la situation actuelle avancera sans se bouleverser. Dans le cas contraire, le chaos peut être imminent. Mon instinct me dit bien que même dans le chaos, il est impossible que les honnêtes gens avertis, et armés, et postés comme ils le sont se laissent battre et chasser. Mais j’ai appris à me défier de mon instinct. Vous me préoccupez avant tout par-dessus tout. Le monde s’arrange comme il pourra, quand il pourra. Il a de la force pour supporter et du temps pour attendre. Mais vous ! Je ne crois pas au danger. Je ne crois pas que votre seconde impression vous trompe, et que vous ayez tort d'avoir moins peur depuis que vous êtes dans la mêlée. Mais qu'importe ce que je crois ou ne crois pas ? Et j’attends et je ne puis faire qu'attendre. Je compte que le courrier, m'apportera tout à l'heure, le sens et la direction de l'incident. Vous avez toute raison ; si le gouvernement a le sens commun, il rappellera d'Orient sa flotte. Toute prolongation de démonstration serait parfaitement déplacée et sotte. Et l'Angleterre devrait en faire sur le champ autant. On vous doit, non seulement le fond, mais toutes les apparences possibles d'égards et de bons procédés. Les questions qui peuvent subsister encore entre vous et la Porte, l'expulsion effective des réfugiés, le lieu de leur retraite, les provinces du Danube, tout cela se réglera, d’autant mieux que l'occident s'en mêlera moins et surtout aura moins l’air de s'en mêler. Je ne puis croire que Sir Stratford Canning s'oppose formellement à ce que la Porte envoie les réfugiés vers tel point plutôt que vers tel autre. Qu'ils aillent en Angleterre ou en Amérique, rien n’est plus indifférent. Une fois sortis de Turquie, ils finiront toujours par aller à peu près où ils voudront en occident. Je ne comprends par Normanby poussant à l'Empire à tort et à travers, sans s’inquiéter de savoir si la majorité en veut, ou n'en veut pas, et uniquement pour maintenir son influence sur le président. Cela me paraît de la part de l'Angleterre, un jeu bien sot et bien inutile. Le joue-t-elle réellement ? Mad. Austin a traduit jusqu'ici, et traduit encore. Elle aura traduit demain tout ce qui est prêt, et elle part Lundi pour aller passer quinze jours à Paris où elle a affaire et d’où elle retournera à Londres. J’aurais ri de votre remarque si je pouvais rire. Je vais faire ma toilette. Vous connaissez cette impossibilité de tenir en place, ce besoin d'aller et de venir ; et de faire quelque chose, quand on ne fait rien et qu’on attend.
Onze heures et demie
C’est évidemment du bien nouveau qui commence. Plus curieux d'abord que menaçant. Il faut attendre pour penser. Adieu, adieu, Adieu.
8 heures
Mon impatience de savoir est extrême. Ce Cabinet s’est-il fait de concert entre le président, et la majorité, ou est-ce qu'un coup de tête du président ? Sera-t-il soutenu ou désavoué par la majorité et ses chefs ? Mon bon sens me porte à croire à la première chance. Deux ou trois billets que j'ai reçus hier m'indiquent plutôt l'autre. Cela importe infiniment pour la suite. si la majorité est consentante, si ce sont là des doublures mises en avant- pour faire ce que ne veulent pas faire les premiers acteurs, il n’y a rien de grave à craindre prochainement, la situation actuelle avancera sans se bouleverser. Dans le cas contraire, le chaos peut être imminent. Mon instinct me dit bien que même dans le chaos, il est impossible que les honnêtes gens avertis, et armés, et postés comme ils le sont se laissent battre et chasser. Mais j’ai appris à me défier de mon instinct. Vous me préoccupez avant tout par-dessus tout. Le monde s’arrange comme il pourra, quand il pourra. Il a de la force pour supporter et du temps pour attendre. Mais vous ! Je ne crois pas au danger. Je ne crois pas que votre seconde impression vous trompe, et que vous ayez tort d'avoir moins peur depuis que vous êtes dans la mêlée. Mais qu'importe ce que je crois ou ne crois pas ? Et j’attends et je ne puis faire qu'attendre. Je compte que le courrier, m'apportera tout à l'heure, le sens et la direction de l'incident. Vous avez toute raison ; si le gouvernement a le sens commun, il rappellera d'Orient sa flotte. Toute prolongation de démonstration serait parfaitement déplacée et sotte. Et l'Angleterre devrait en faire sur le champ autant. On vous doit, non seulement le fond, mais toutes les apparences possibles d'égards et de bons procédés. Les questions qui peuvent subsister encore entre vous et la Porte, l'expulsion effective des réfugiés, le lieu de leur retraite, les provinces du Danube, tout cela se réglera, d’autant mieux que l'occident s'en mêlera moins et surtout aura moins l’air de s'en mêler. Je ne puis croire que Sir Stratford Canning s'oppose formellement à ce que la Porte envoie les réfugiés vers tel point plutôt que vers tel autre. Qu'ils aillent en Angleterre ou en Amérique, rien n’est plus indifférent. Une fois sortis de Turquie, ils finiront toujours par aller à peu près où ils voudront en occident. Je ne comprends par Normanby poussant à l'Empire à tort et à travers, sans s’inquiéter de savoir si la majorité en veut, ou n'en veut pas, et uniquement pour maintenir son influence sur le président. Cela me paraît de la part de l'Angleterre, un jeu bien sot et bien inutile. Le joue-t-elle réellement ? Mad. Austin a traduit jusqu'ici, et traduit encore. Elle aura traduit demain tout ce qui est prêt, et elle part Lundi pour aller passer quinze jours à Paris où elle a affaire et d’où elle retournera à Londres. J’aurais ri de votre remarque si je pouvais rire. Je vais faire ma toilette. Vous connaissez cette impossibilité de tenir en place, ce besoin d'aller et de venir ; et de faire quelque chose, quand on ne fait rien et qu’on attend.
Onze heures et demie
C’est évidemment du bien nouveau qui commence. Plus curieux d'abord que menaçant. Il faut attendre pour penser. Adieu, adieu, Adieu.
Val-Richer, Dimanche 21 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Dimanche 21 oct. 1849
8 heures
Je suis d’avis de ces deux points ; la République rouge, ou la guerre à la Russie vous chassent de France ; c'est clair. Je nie celui-ci : pour toujours. Il n'y a point de toujours aujourd’hui. Vous ne retournerez pas vivre, c’est-à-dire mourir en Russie. Vous irez attendre quelque part en Europe. Attendre je ne sais pas quoi, mais certainement quelque chose qui mettra fin à votre toujours. Je suis corrigé de croire un malheur quelconque impossible ; mais je ne crois pas à la longue durée d’un état violent, et anarchiquement violent. Rien ne le prouve mieux que la triste épreuve que nous faisons depuis Février. Nous sommes certes bien loin de l’ordre, mais le désordre avorte partout. Tout le monde est un peu fou ; personne n’est plus, ou n’est longtemps fou furieux. Je repousse absolument votre sinistre parole. Il peut venir bien assez de mal sans ce dernier des maux. Mon instinct est toujours que nous n'irons pas même à ces maux déjà extrêmes que j’admets comme possibles. Je crois à du mauvais, très mauvais gouvernement, changeant sans se corriger ; je ne crois pas aux extrêmes. Je conviens que ce moment-ci est bien chargé et obscur. Thiers ne pouvait guère faire autrement qu’il n’a fait. Je suis curieux de savoir s’il ira vous voir. Je le crois, s’il n’y va pas, c’est qu’il a moins d’esprit que je ne lui en crois. La Rozière a fait vraiment un discours très distingué plein de vues, d’esprit politique et de courage. Peu importent les défauts. Ce sont des défauts qui passent. Il y a là les qualités qui ne s'acquerront point quand il n’a pas plu à Dieu de les donner. C’est un succès qui me fait plaisir. La Rozière s'est bien conduit. Il mérite de réussir. De plus, je le crois ambitieux. Grand titre à l'estime aujourd’hui. Notre temps est plein d'envieux et de paresseux. Il n’y a plus d’ambitieux. Le beau temps s’en va d’ici. Je désire bien que vous le gardiez à Paris. Ayez au moins le soleil du ciel. Pour votre rhume et pour votre sérénité. Je travaille et je me promène. Il me revient tous les jours quelque retentissement du mouvement légitimiste. Les gens de Bordeaux viennent d'avoir une bonne leçon électorale, s'il y a de bonnes leçons. Ce sont les conservateurs qui ont eu tort. Il paraît du reste que même unis, ils auraient été battus. Exemple assez frappant. Les élections qu’il y aura à faire après le procès de Versailles auront de l'importance. Tout démontrera de plus en plus que le suffrage universel, qui peut empêcher la société de mourir, ne peut. pas la faire vivre. Adieu.
Je vais faire ma toilette. J’ai un mélange de joie, et de tristesse à vous savoir en France, et si près de moi. Onze heures Cette situation me pèse et m'attriste, pour vous et pour moi. Je ne crois pas à la guerre. Mais tant d’incertitude et d’insécurité est un grand ennui, pour ne pas dire pis. N'oubliez pas pourtant qu'aujourd’hui, et en France personne ne veut mourir que de vieillesse. Les solutions violentes avortent. Adieu, adieu, adieu. G.
8 heures
Je suis d’avis de ces deux points ; la République rouge, ou la guerre à la Russie vous chassent de France ; c'est clair. Je nie celui-ci : pour toujours. Il n'y a point de toujours aujourd’hui. Vous ne retournerez pas vivre, c’est-à-dire mourir en Russie. Vous irez attendre quelque part en Europe. Attendre je ne sais pas quoi, mais certainement quelque chose qui mettra fin à votre toujours. Je suis corrigé de croire un malheur quelconque impossible ; mais je ne crois pas à la longue durée d’un état violent, et anarchiquement violent. Rien ne le prouve mieux que la triste épreuve que nous faisons depuis Février. Nous sommes certes bien loin de l’ordre, mais le désordre avorte partout. Tout le monde est un peu fou ; personne n’est plus, ou n’est longtemps fou furieux. Je repousse absolument votre sinistre parole. Il peut venir bien assez de mal sans ce dernier des maux. Mon instinct est toujours que nous n'irons pas même à ces maux déjà extrêmes que j’admets comme possibles. Je crois à du mauvais, très mauvais gouvernement, changeant sans se corriger ; je ne crois pas aux extrêmes. Je conviens que ce moment-ci est bien chargé et obscur. Thiers ne pouvait guère faire autrement qu’il n’a fait. Je suis curieux de savoir s’il ira vous voir. Je le crois, s’il n’y va pas, c’est qu’il a moins d’esprit que je ne lui en crois. La Rozière a fait vraiment un discours très distingué plein de vues, d’esprit politique et de courage. Peu importent les défauts. Ce sont des défauts qui passent. Il y a là les qualités qui ne s'acquerront point quand il n’a pas plu à Dieu de les donner. C’est un succès qui me fait plaisir. La Rozière s'est bien conduit. Il mérite de réussir. De plus, je le crois ambitieux. Grand titre à l'estime aujourd’hui. Notre temps est plein d'envieux et de paresseux. Il n’y a plus d’ambitieux. Le beau temps s’en va d’ici. Je désire bien que vous le gardiez à Paris. Ayez au moins le soleil du ciel. Pour votre rhume et pour votre sérénité. Je travaille et je me promène. Il me revient tous les jours quelque retentissement du mouvement légitimiste. Les gens de Bordeaux viennent d'avoir une bonne leçon électorale, s'il y a de bonnes leçons. Ce sont les conservateurs qui ont eu tort. Il paraît du reste que même unis, ils auraient été battus. Exemple assez frappant. Les élections qu’il y aura à faire après le procès de Versailles auront de l'importance. Tout démontrera de plus en plus que le suffrage universel, qui peut empêcher la société de mourir, ne peut. pas la faire vivre. Adieu.
Je vais faire ma toilette. J’ai un mélange de joie, et de tristesse à vous savoir en France, et si près de moi. Onze heures Cette situation me pèse et m'attriste, pour vous et pour moi. Je ne crois pas à la guerre. Mais tant d’incertitude et d’insécurité est un grand ennui, pour ne pas dire pis. N'oubliez pas pourtant qu'aujourd’hui, et en France personne ne veut mourir que de vieillesse. Les solutions violentes avortent. Adieu, adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 14 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val-Richer, Dimanche 14 oct. 1849
8 heures
Je vous écris encore à Londres. Vous en partirez si je ne me trompe après demain, à 1 heure où à 4 heures. Plutôt à 4 heures, qui est l'express-train. Je vous écrirai demain à Boulogne. Je suppose que vous n'en répartirez pas immédiatement pour Paris, vous vous reposerez là le 17. Que je voudrais une bonne traversée ! Il fait du vent ce matin. Impuissance des vœux ! C’est un des plus amers tourments de la vie. Et pourtant il est impossible de ne pas croire à l'efficacité de le prière. Ce serait. supprimer dieu. Nous y croyons invinciblement et je crois que nous avons raison d'y ardé Mais la prière, qui peut être efficace ne l'est pas, ne peut pas l'être infailliblement. Et nous ne savons jamais si elle l'a été, car le lien nous est parfaitement inconnu entre notre prière et l'événement. C’est là le tourment. J’attendais hier des nouvelles détaillées de Paris. Elles ne sont pas venues. Rien n’est venu hier ni les nouvelles, ni votre lettre. Je ne connais rien de plus insipide que les Débats de l'Assemblée. Tout-à-fait la physionomie d'un phtisique, pâle et se trainant. Être certain que ce qu'on fait me vaut rien, et ne savoir comment s’y prendre pour faire autre chose, c'est une triste condition. Je me félicite tous les jours plus de n'être pas là. Qu’avez-vous dit de la lettre de Kossuth à Palmerston ? Je l’ai trouvée pas remarquable et l’air sincère. Elle m'a donné l'idée d’un homme plutôt médiocre, et plutôt honnête. Ce n'est le ton ni d’un homme supérieur, ni d'un révolutionnaire. Elle sera bonne en Angleterre pour Palmerston. La lettre de Mazzini à M.M. de Tocqueville et Dufaure, bien autrement révolutionnaire que celle de Kossuth, est aussi bien supérieure d’idées, et de langage. Mazzini reste un home, et un homme redoutable.
Onze heures
Voilà une lettre, mais seulement celle de jeudi. Je devrais avoir aussi celle de Vendredi. Je n'y comprends rien. Peut-être le vent. S'il est aussi fort mercredi que ce matin, ne passez pas. Attendez, malgré l’ennui. Adieu Adieu. Adieu. J’ai continument au fond du cœur, la pensée de votre retour. Adieu. G.
8 heures
Je vous écris encore à Londres. Vous en partirez si je ne me trompe après demain, à 1 heure où à 4 heures. Plutôt à 4 heures, qui est l'express-train. Je vous écrirai demain à Boulogne. Je suppose que vous n'en répartirez pas immédiatement pour Paris, vous vous reposerez là le 17. Que je voudrais une bonne traversée ! Il fait du vent ce matin. Impuissance des vœux ! C’est un des plus amers tourments de la vie. Et pourtant il est impossible de ne pas croire à l'efficacité de le prière. Ce serait. supprimer dieu. Nous y croyons invinciblement et je crois que nous avons raison d'y ardé Mais la prière, qui peut être efficace ne l'est pas, ne peut pas l'être infailliblement. Et nous ne savons jamais si elle l'a été, car le lien nous est parfaitement inconnu entre notre prière et l'événement. C’est là le tourment. J’attendais hier des nouvelles détaillées de Paris. Elles ne sont pas venues. Rien n’est venu hier ni les nouvelles, ni votre lettre. Je ne connais rien de plus insipide que les Débats de l'Assemblée. Tout-à-fait la physionomie d'un phtisique, pâle et se trainant. Être certain que ce qu'on fait me vaut rien, et ne savoir comment s’y prendre pour faire autre chose, c'est une triste condition. Je me félicite tous les jours plus de n'être pas là. Qu’avez-vous dit de la lettre de Kossuth à Palmerston ? Je l’ai trouvée pas remarquable et l’air sincère. Elle m'a donné l'idée d’un homme plutôt médiocre, et plutôt honnête. Ce n'est le ton ni d’un homme supérieur, ni d'un révolutionnaire. Elle sera bonne en Angleterre pour Palmerston. La lettre de Mazzini à M.M. de Tocqueville et Dufaure, bien autrement révolutionnaire que celle de Kossuth, est aussi bien supérieure d’idées, et de langage. Mazzini reste un home, et un homme redoutable.
Onze heures
Voilà une lettre, mais seulement celle de jeudi. Je devrais avoir aussi celle de Vendredi. Je n'y comprends rien. Peut-être le vent. S'il est aussi fort mercredi que ce matin, ne passez pas. Attendez, malgré l’ennui. Adieu Adieu. Adieu. J’ai continument au fond du cœur, la pensée de votre retour. Adieu. G.
Val-Richer, Samedi 13 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer samedi 13 octobre 1849
8 heures
Vous arrivez aujourd'hui à Londres. Réglons notre avenir notre prochain avenir. Vous serez le 16 à Folkstone, le 17 à Boulogne, le 18 à Paris. Mad Austin m’arrive le 19 au Val Richer, pour traduire, mon ouvrage sous mes yeux. Il me faut 36 heures pour la mettre en train. Je ne puis partir que le dimanche 21 pour vous voir lundi 22. Je ne pourrai rester à Paris que deux jours. Il faudra que je revienne ici pour achever, mon travail et surveiller la traduction. Je comptais rester au Val Richer, jusqu'à la fin de Novembre, et quelques jours employés à une course à Paris me mettront en retard, par conséquent dans l'impossibilité d'y revenir plutôt. Si au contraire, je ne me détourne pas de mon travail, le 21 Octobre, je pourrai avancer mon retour définitif à Paris. J'y reviendrai alors décidément, le 15 ou le 16 novembre. Je prends le choix des deux jours à cause de l’incertitude des diligences où il me faut beaucoup de places. Il me semble que cela vaut mieux. Si vous étiez revenue à Paris vers le milieu de septembre, selon votre premier projet, il n’y avait pas à hésiter ; notre réunion définitive était trop loin ; j’allais vous voir sur le champ, ne fût-ce que pour deux jours. Vous ne revenez que le 18 octobre. Je puis, en ne m'interrompant pas dans mes affaires d’ici, travail et traduction, retourner définitivement à Paris, le 15 novembre. Ne vaut-il pas mieux faire cela que nous donner deux jours le 22 octobre pour retarder ensuite de quinze jours ou trois semaines notre réunion définitive ? Point de mauvais sentiment, point d'injuste méfiance, je vous en conjure. Le bonheur de vous retrouver de reprendre nos douces habitudes est ma première, ma constante pensée. Que vous y croyiez, ou que vous n'y croyiez pas absolument, que vous en jouissiez ou que vous n'en jouissiez pas parfaitement, il n’en sera pas moins vrai que vous êtes tout ce qui m'est le plus cher, et le plus nécessaire, qu'avec vous seule et auprès de vous seule je suis heureux. Je le sais, moi, je le sens ; et ni vos doutes, ni vos mauvais accès ne changeront rien ni à la réalité, ni à mon sentiment à moi. Laissez-les donc tout-à-fait, sans retour. Ayez confiance et jouissons ensemble de notre affection avec tout le bonheur que la confiance seule peut donner. Nous ne sommes que trop séparés ; trop de nécessités pèsent sur moi, et ne me laissent pas la pleine disposition de moi-même. N'y ajoutons rien dearest. Ne supposez pas que je renonce facilement à vous voir tout de suite après votre retour à Paris, que vous en êtes plus impatiente que moi. Je vous crie d’ici injustice ! Injustice ! Vous voyez ; je vais au devant des impressions qui, si j'étais près de vous me désoleraient et me charmeraient en même temps, car tout ce qui me montre votre affection me charme même votre injustice qui me désole. Mais point d'injustice ; pleine confiance. Cela est mille fois plus doux et il n’y a que cela qui ait raison. Je ne vous parle pas d’autre chose ce matin. Le beau temps est revenu, par un air presque froid. Je voudrais bien cela pour votre traversée. Et je vous voudrais bien Guéneau de Mussy. Je n’ai pas osé lui écrire pour le lui demander formellement. Il aurait été trop embarrassé à me le refuser, s'il ne l’avait pas pu. Mais je voudrais bien qu’il le pût.
Onze heures
Pas de lettre Pourquoi ? Je ne le saurai que demain. C'est bien déplaisant ; adieu, adieu. G.
8 heures
Vous arrivez aujourd'hui à Londres. Réglons notre avenir notre prochain avenir. Vous serez le 16 à Folkstone, le 17 à Boulogne, le 18 à Paris. Mad Austin m’arrive le 19 au Val Richer, pour traduire, mon ouvrage sous mes yeux. Il me faut 36 heures pour la mettre en train. Je ne puis partir que le dimanche 21 pour vous voir lundi 22. Je ne pourrai rester à Paris que deux jours. Il faudra que je revienne ici pour achever, mon travail et surveiller la traduction. Je comptais rester au Val Richer, jusqu'à la fin de Novembre, et quelques jours employés à une course à Paris me mettront en retard, par conséquent dans l'impossibilité d'y revenir plutôt. Si au contraire, je ne me détourne pas de mon travail, le 21 Octobre, je pourrai avancer mon retour définitif à Paris. J'y reviendrai alors décidément, le 15 ou le 16 novembre. Je prends le choix des deux jours à cause de l’incertitude des diligences où il me faut beaucoup de places. Il me semble que cela vaut mieux. Si vous étiez revenue à Paris vers le milieu de septembre, selon votre premier projet, il n’y avait pas à hésiter ; notre réunion définitive était trop loin ; j’allais vous voir sur le champ, ne fût-ce que pour deux jours. Vous ne revenez que le 18 octobre. Je puis, en ne m'interrompant pas dans mes affaires d’ici, travail et traduction, retourner définitivement à Paris, le 15 novembre. Ne vaut-il pas mieux faire cela que nous donner deux jours le 22 octobre pour retarder ensuite de quinze jours ou trois semaines notre réunion définitive ? Point de mauvais sentiment, point d'injuste méfiance, je vous en conjure. Le bonheur de vous retrouver de reprendre nos douces habitudes est ma première, ma constante pensée. Que vous y croyiez, ou que vous n'y croyiez pas absolument, que vous en jouissiez ou que vous n'en jouissiez pas parfaitement, il n’en sera pas moins vrai que vous êtes tout ce qui m'est le plus cher, et le plus nécessaire, qu'avec vous seule et auprès de vous seule je suis heureux. Je le sais, moi, je le sens ; et ni vos doutes, ni vos mauvais accès ne changeront rien ni à la réalité, ni à mon sentiment à moi. Laissez-les donc tout-à-fait, sans retour. Ayez confiance et jouissons ensemble de notre affection avec tout le bonheur que la confiance seule peut donner. Nous ne sommes que trop séparés ; trop de nécessités pèsent sur moi, et ne me laissent pas la pleine disposition de moi-même. N'y ajoutons rien dearest. Ne supposez pas que je renonce facilement à vous voir tout de suite après votre retour à Paris, que vous en êtes plus impatiente que moi. Je vous crie d’ici injustice ! Injustice ! Vous voyez ; je vais au devant des impressions qui, si j'étais près de vous me désoleraient et me charmeraient en même temps, car tout ce qui me montre votre affection me charme même votre injustice qui me désole. Mais point d'injustice ; pleine confiance. Cela est mille fois plus doux et il n’y a que cela qui ait raison. Je ne vous parle pas d’autre chose ce matin. Le beau temps est revenu, par un air presque froid. Je voudrais bien cela pour votre traversée. Et je vous voudrais bien Guéneau de Mussy. Je n’ai pas osé lui écrire pour le lui demander formellement. Il aurait été trop embarrassé à me le refuser, s'il ne l’avait pas pu. Mais je voudrais bien qu’il le pût.
Onze heures
Pas de lettre Pourquoi ? Je ne le saurai que demain. C'est bien déplaisant ; adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Dimanche 7 oct. 1849
Cinq heures
Je viens d'écrire à M. Gréterin. Vous reviendrez donc bientôt. Quel bonheur de vous ravoir en France, de ce côté-ci du Canal ! Vous y resterez tranquillement. Pas de guerre et pas d'émeute. Mon optimisme naturel, et que je retrouve bien de temps en temps, m'inspire cependant, moins de défiance parce que je n'espère pas grand-chose. Ce ne sont pas les perspectives brillantes qui me cachent les sombres. Un repos bas et précaire, voilà l'avenir que j’attends. Pour longtemps. Je sais qu'à la rue St Florentin vous vous en contenterez.
Je suis bien fâché du bien mauvais article des Débats de ce matin sur l'Empereur à propos de Constantinople. Les journalistes ne se refusent jamais le plaisir des moqueries, et des bravades, quel qu’en soit l’inconvénient. C’est pitoyable et déplorable. Il était si facile de parler de cela convenablement et avec des paroles encourageantes au lieu de paroles blessantes ! Où ont-ils pris celles qu'ils attribuent à l'Empereur ? Mais tout cela donne bien lieu de penser que l'affaire n’ira pas loin.
Ce que Lord John vous écrit est très sensé. A moins qu’il n’y ait l’arrière pensée dont je vous ai parlé, c'est une grosse faute. Et la faute est grosse même avec l’arrière-pensée, car elle change (je reviens à mon expression) le courant de l'opinion Européenne sans motif et sans profit suffisant. Encore un exemple du peu d'esprit des poltrons même gens d’esprit ; le douaire de Mad. la Duchesse d'Orléans. Passy et Dupin ont espéré escamoter l'affaire en la faisant très petite et la fourrant parmi d'autres. Ils se sont attiré un échec qui est un désagrément pour Mad. la Duchesse d'Orléans, et qui y fera regarder de beaucoup plus près. Il fallait présenter cela la tête haute comme l'exécution d’un traité et l'accomplissement d’un devoir honteusement retardé. C’est la vérité et c'était aussi le moyen de succès.
Qu'y a-t-il de vrai dans le remplacement du Prince de Schwartzemberg par M. de Schmerling et qu’elle en serait la valeur ? M. de Schmerling était, si je ne me trompe, le plus Autrichien des Autrichiens à Francfort. Ce ne serait pas là un signe qu'on est près de s'entendre avec la Prusse sur les Affaires Allemandes. Le renvoi de notre Ministre à Washington n'a d'autre gravité que celle d’un gros désagrément pour la République qui, après avoir eu le tort d'employer M. Poussin, a eu celui de ne pas le rappeler à temps. Je ne le connais pas ; mais j’ai entendu dire que c’était un étourneau prétentieux et grossier.
Lundi 6 oct. onze heures
Je compte bien que votre lettre me dira que vous avez reçu les miennes. Mais j'ai peur qu’elle n’arrive une demi-heure plus tard. Il pleut par torrents continus. Hier, mon pré dans la vallée était un parfait étang, se déchargeant par je ne sais combien de cascades. J’ai pris mon parti de ne plus me soucier de mes alleés pour cet automne.
J’attends la semaine prochaine Madame Austin qui vient passer trois semaines chez moi pour traduire, mon discours sur l'histoire de la révolution d’Angleterre. Il doit paraître en Anglais à Londres, le même jour qu'en Français à Paris. Voilà votre lettre. Bien troublée et bien courte. On a beau dire et vous avez beau craindre. La guerre ne sortira pas de là. Adieu. Adieu.
Cinq heures
Je viens d'écrire à M. Gréterin. Vous reviendrez donc bientôt. Quel bonheur de vous ravoir en France, de ce côté-ci du Canal ! Vous y resterez tranquillement. Pas de guerre et pas d'émeute. Mon optimisme naturel, et que je retrouve bien de temps en temps, m'inspire cependant, moins de défiance parce que je n'espère pas grand-chose. Ce ne sont pas les perspectives brillantes qui me cachent les sombres. Un repos bas et précaire, voilà l'avenir que j’attends. Pour longtemps. Je sais qu'à la rue St Florentin vous vous en contenterez.
Je suis bien fâché du bien mauvais article des Débats de ce matin sur l'Empereur à propos de Constantinople. Les journalistes ne se refusent jamais le plaisir des moqueries, et des bravades, quel qu’en soit l’inconvénient. C’est pitoyable et déplorable. Il était si facile de parler de cela convenablement et avec des paroles encourageantes au lieu de paroles blessantes ! Où ont-ils pris celles qu'ils attribuent à l'Empereur ? Mais tout cela donne bien lieu de penser que l'affaire n’ira pas loin.
Ce que Lord John vous écrit est très sensé. A moins qu’il n’y ait l’arrière pensée dont je vous ai parlé, c'est une grosse faute. Et la faute est grosse même avec l’arrière-pensée, car elle change (je reviens à mon expression) le courant de l'opinion Européenne sans motif et sans profit suffisant. Encore un exemple du peu d'esprit des poltrons même gens d’esprit ; le douaire de Mad. la Duchesse d'Orléans. Passy et Dupin ont espéré escamoter l'affaire en la faisant très petite et la fourrant parmi d'autres. Ils se sont attiré un échec qui est un désagrément pour Mad. la Duchesse d'Orléans, et qui y fera regarder de beaucoup plus près. Il fallait présenter cela la tête haute comme l'exécution d’un traité et l'accomplissement d’un devoir honteusement retardé. C’est la vérité et c'était aussi le moyen de succès.
Qu'y a-t-il de vrai dans le remplacement du Prince de Schwartzemberg par M. de Schmerling et qu’elle en serait la valeur ? M. de Schmerling était, si je ne me trompe, le plus Autrichien des Autrichiens à Francfort. Ce ne serait pas là un signe qu'on est près de s'entendre avec la Prusse sur les Affaires Allemandes. Le renvoi de notre Ministre à Washington n'a d'autre gravité que celle d’un gros désagrément pour la République qui, après avoir eu le tort d'employer M. Poussin, a eu celui de ne pas le rappeler à temps. Je ne le connais pas ; mais j’ai entendu dire que c’était un étourneau prétentieux et grossier.
Lundi 6 oct. onze heures
Je compte bien que votre lettre me dira que vous avez reçu les miennes. Mais j'ai peur qu’elle n’arrive une demi-heure plus tard. Il pleut par torrents continus. Hier, mon pré dans la vallée était un parfait étang, se déchargeant par je ne sais combien de cascades. J’ai pris mon parti de ne plus me soucier de mes alleés pour cet automne.
J’attends la semaine prochaine Madame Austin qui vient passer trois semaines chez moi pour traduire, mon discours sur l'histoire de la révolution d’Angleterre. Il doit paraître en Anglais à Londres, le même jour qu'en Français à Paris. Voilà votre lettre. Bien troublée et bien courte. On a beau dire et vous avez beau craindre. La guerre ne sortira pas de là. Adieu. Adieu.
Val-Richer, Lundi 1er octobre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 1er octobre 1849
6 heures
J’ai acquis la certitude qu’il n’y avait guère en effet que des commérages dans ce qu'on m’avait dit sur les démarches mutuelles des deux branches, l’une vers l'autre. Mais quand les commères ont causé avec les maîtres, et peuvent s'en vanter les commérages peuvent devenir des embarras. Le Roi a raison de dire que c’est à la branche ainée à faire les avances. Je n’ai laissé échapper aucune occasion de lui inculquer cette idée. C’est la branche ainée qui gagne au rapprochement et ce n'est pas elle qui est tombée hier. C’est donc à elle à commencer si elle veut finir, et elle le peut décemment. Je désire que le Roi et les siens agissent toujours sur ce principe. M. Achille Fould est tout au Président. Presque de l’intimité. Grande envie d'être Ministre des finances. On doute qu’il arrive. Faiseur d'affaires. Plus intelligent que capable. Toujours assez bien pour moi. Plus dans l'apparence qu'au fond. Mais ce sont des gens avec qui il ne faut pas être mal.
Je vous ai dit ce matin que j'étais rentré en possession de tous les originaux. Il n'y manque rien. J’y ai retrouvé aussi les originaux, de moi, que vous m'aviez prêtés.
Mardi 2 - sept heures
Voici mon mauvais jour. J’étais mieux à Broglie qu’ici pour les heures de poste. J’avais mes lettres de grand matin, entre 7 et 8 heures et la poste ne repartait qu'à 2 heures. Ici mon facteur ne m’arrive, à présent surtout, qu'à onze heures et repart à midi. Je suis dans les terres à trois lieues du bureau de poste. Le Duc de Broglie, est à cinq minutes. Le bourg touche le château. Je sais gré à votre famille Impériale de leur chagrin sur la mort du grand Duc Michel. Ces douleurs fraternelles fidèles et vives quoique éloignées, me touchent, et me plaisent. Un peu de cœur est si rare dans les régions hautes ! Encore un exemple là du principe qui préside dans la volonté de dieu à la distribution de ses grâces et de ses rigueurs. Les unes ne vont guères, sans les autres. Au même moment où il nous comble, et il nous frappe, comme pour ne jamais nous laisser oublier notre infirmité et notre dépendance. Aussi dans les temps prospère, je me sens toujours inquiet et dans l’attente d’un malheur. Et c’est presque toujours, dans la vie privée, au sein de la famille, que Dieu place les compensations, en bien ou en mal, qui font équilibre aux incidents de la vie publique. Je ne crois pas qu’il soit possible d'avoir plus constamment que je ne l'ai le sentiment de vivre ainsi sous une main souveraine, dont il est également impossible de méconnaitre le pouvoir et de comprendre les desseins. Les impies sont de bien pauvres esprits. Il y a une sorte d’impies que je crois assez commun dans le monde surtout dans les classes élevées et cultivées, ceux qui sont impies, au fond, et ne veulent pas le paraître ; non par hypocrisie calculée mais par embarras et convenance ; les impies honteux. Ceux-là ne font pas grand mal mais ils me déplaisent beaucoup. J’aime qu’on se connaisse et qu’on se montre tel qu’on est.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre. Je n'ai rien de Paris. Les nouvelles de Constantinople seront plus bruyantes qu'importantes. Adieu, adieu. G.
6 heures
J’ai acquis la certitude qu’il n’y avait guère en effet que des commérages dans ce qu'on m’avait dit sur les démarches mutuelles des deux branches, l’une vers l'autre. Mais quand les commères ont causé avec les maîtres, et peuvent s'en vanter les commérages peuvent devenir des embarras. Le Roi a raison de dire que c’est à la branche ainée à faire les avances. Je n’ai laissé échapper aucune occasion de lui inculquer cette idée. C’est la branche ainée qui gagne au rapprochement et ce n'est pas elle qui est tombée hier. C’est donc à elle à commencer si elle veut finir, et elle le peut décemment. Je désire que le Roi et les siens agissent toujours sur ce principe. M. Achille Fould est tout au Président. Presque de l’intimité. Grande envie d'être Ministre des finances. On doute qu’il arrive. Faiseur d'affaires. Plus intelligent que capable. Toujours assez bien pour moi. Plus dans l'apparence qu'au fond. Mais ce sont des gens avec qui il ne faut pas être mal.
Je vous ai dit ce matin que j'étais rentré en possession de tous les originaux. Il n'y manque rien. J’y ai retrouvé aussi les originaux, de moi, que vous m'aviez prêtés.
Mardi 2 - sept heures
Voici mon mauvais jour. J’étais mieux à Broglie qu’ici pour les heures de poste. J’avais mes lettres de grand matin, entre 7 et 8 heures et la poste ne repartait qu'à 2 heures. Ici mon facteur ne m’arrive, à présent surtout, qu'à onze heures et repart à midi. Je suis dans les terres à trois lieues du bureau de poste. Le Duc de Broglie, est à cinq minutes. Le bourg touche le château. Je sais gré à votre famille Impériale de leur chagrin sur la mort du grand Duc Michel. Ces douleurs fraternelles fidèles et vives quoique éloignées, me touchent, et me plaisent. Un peu de cœur est si rare dans les régions hautes ! Encore un exemple là du principe qui préside dans la volonté de dieu à la distribution de ses grâces et de ses rigueurs. Les unes ne vont guères, sans les autres. Au même moment où il nous comble, et il nous frappe, comme pour ne jamais nous laisser oublier notre infirmité et notre dépendance. Aussi dans les temps prospère, je me sens toujours inquiet et dans l’attente d’un malheur. Et c’est presque toujours, dans la vie privée, au sein de la famille, que Dieu place les compensations, en bien ou en mal, qui font équilibre aux incidents de la vie publique. Je ne crois pas qu’il soit possible d'avoir plus constamment que je ne l'ai le sentiment de vivre ainsi sous une main souveraine, dont il est également impossible de méconnaitre le pouvoir et de comprendre les desseins. Les impies sont de bien pauvres esprits. Il y a une sorte d’impies que je crois assez commun dans le monde surtout dans les classes élevées et cultivées, ceux qui sont impies, au fond, et ne veulent pas le paraître ; non par hypocrisie calculée mais par embarras et convenance ; les impies honteux. Ceux-là ne font pas grand mal mais ils me déplaisent beaucoup. J’aime qu’on se connaisse et qu’on se montre tel qu’on est.
Onze heures et demie
Je ferme ma lettre. Je n'ai rien de Paris. Les nouvelles de Constantinople seront plus bruyantes qu'importantes. Adieu, adieu. G.
Val-Richer, Dimanche 30 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, dimanche 30 sept. 1849
Huit heures
Il n'y a pas moyen de vous expliquer de si loin pourquoi ce que j'écris ne me fera pas d'ennemi ; au contraire. Mais vous le verrez. Je n'ai nulle envie de me rengager dans les luttes où j'ai vécu. La force me manquerait pour recommencer, et il ne faut jamais rien recommencer. Le monde s'ennuie de ce qu’il a déjà vu. Mais après ce que j’ai fait en luttant et ce qui est arrivé depuis que je suis tombé, il y a une position toute nouvelle à prendre, très calme et, je crois très influente qui aura quelque effet, ce que je crois toujours possible, et qui me fera honneur ce que je désire avant tout. J'ai la fantaisie d'être un peu connu, et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi on se doute un peu de cela et qu’en parlant de moi, on se dise : " C'est dommage qu’il n'ait pas fait tout ce qu’il voulait." C'est peu d'avoir été quelque chose si on ne laisse au public le sentiment qu’on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu’il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu’il entrevoie de l’inconnu qu'il n’a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sorti de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin, sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie m’en aller tout-à-fait dans cette position là. Je veux que mon pays se doute qu’il a eu tort de me laisser tomber, et qu’il me relève lui-même, non pas dans l’arène, mais dans sa pensée. Et je suis sûr que je peux lui donner ce sentiment là sans blesser son amour propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité son regret et son respect. Si cela peut lui servir, ensuite à quelque chose pour se réformer lui-même, tant mieux ; je n'y renonce pas pour lui, car je ne désespère pas de lui. Mais je n’entreprends plus moi-même de le réformer. Ce serait trop long et je suis trop vieux. Quand causerons-nous de tout cela, et de tout le reste ? J'en ai bien envie. Nous aussi nous pouvons bien dire ; " Que de bien perdu ! "
Voici votre lettre de Berlin. Vague et confuse, comme tout ce qui est allemand, mais spirituelle et sensée au fond. Je le crois du moins. On ne voit jamais bien clair dans l’esprit des gens qui n’ont pas vu clair eux- mêmes. Les Allemands ont beaucoup d’esprit ; mais on dirait qu'ils ne voient rien que de loin, et à travers les vapeurs du dernier horizon. Même quand ils sont sensés comme celui-ci, ils trouvent le moyen de noyer leur bon sens dans le brouillard. Il a certainement raison ; le Francfort nouveau est stupide ; le vieux Francfort est mort. Il y a en Allemagne un problème à résoudre que M. de Gagern n’a pas résolu. que M. de Metternich ne résoudrait pas et qu’il faut absolument résoudre. Celui-là seul qui le résoudra mettra les radicaux sous ses pieds, comme ils le méritent. Mais je doute que le moment de cette solution soit venu et nous pourrons bien revoir, en l’attendant, une nouvelle édition de la Diète de 1815.
J’ai reçu une lettre très amicale de Narvaez à qui j’avais recommandé Herbet, consul général à Barcelone. Point de politique comme de raison, mais un ton de confiance générale mêlé d’inquiétude sur sa propre santé. Il me parle des fortes indispositions qui l’ont empêché de voir personne, et il quittait Madrid pour retourner aux eaux de Puertollano. Adieu, adieu.
Moi aussi, je suis fâché que M. Gueneau de Mussy ne revienne pas à Paris. A cause de vous surtout. J'étais sûr qu’il vous plairait, et je crois qu’il aurait autorité sur vous pour votre santé, ce qui est bien nécessaire. Le Roi a raison de le garder. Adieu, adieu. G.
Huit heures
Il n'y a pas moyen de vous expliquer de si loin pourquoi ce que j'écris ne me fera pas d'ennemi ; au contraire. Mais vous le verrez. Je n'ai nulle envie de me rengager dans les luttes où j'ai vécu. La force me manquerait pour recommencer, et il ne faut jamais rien recommencer. Le monde s'ennuie de ce qu’il a déjà vu. Mais après ce que j’ai fait en luttant et ce qui est arrivé depuis que je suis tombé, il y a une position toute nouvelle à prendre, très calme et, je crois très influente qui aura quelque effet, ce que je crois toujours possible, et qui me fera honneur ce que je désire avant tout. J'ai la fantaisie d'être un peu connu, et le sentiment intérieur que je mourrai les poches encore pleines, n'ayant pas montré la moitié de ce qui valait la peine d'être vu. Je veux qu'après moi on se doute un peu de cela et qu’en parlant de moi, on se dise : " C'est dommage qu’il n'ait pas fait tout ce qu’il voulait." C'est peu d'avoir été quelque chose si on ne laisse au public le sentiment qu’on pouvait être bien davantage. Le monde dédaigne et oublie bientôt ce qu’il croit avoir mesuré jusqu'au fond et épuisé. Il faut qu’il entrevoie de l’inconnu qu'il n’a pas su voir et s'approprier. Alors il estime et admire vraiment. Je suis sorti de la scène sur un échec, très immérité, je pense, mais enfin, sur un échec. Je ne veux pas, si Dieu me donne vie m’en aller tout-à-fait dans cette position là. Je veux que mon pays se doute qu’il a eu tort de me laisser tomber, et qu’il me relève lui-même, non pas dans l’arène, mais dans sa pensée. Et je suis sûr que je peux lui donner ce sentiment là sans blesser son amour propre et réveiller sa mauvaise humeur, en excitant au contraire sa curiosité son regret et son respect. Si cela peut lui servir, ensuite à quelque chose pour se réformer lui-même, tant mieux ; je n'y renonce pas pour lui, car je ne désespère pas de lui. Mais je n’entreprends plus moi-même de le réformer. Ce serait trop long et je suis trop vieux. Quand causerons-nous de tout cela, et de tout le reste ? J'en ai bien envie. Nous aussi nous pouvons bien dire ; " Que de bien perdu ! "
Voici votre lettre de Berlin. Vague et confuse, comme tout ce qui est allemand, mais spirituelle et sensée au fond. Je le crois du moins. On ne voit jamais bien clair dans l’esprit des gens qui n’ont pas vu clair eux- mêmes. Les Allemands ont beaucoup d’esprit ; mais on dirait qu'ils ne voient rien que de loin, et à travers les vapeurs du dernier horizon. Même quand ils sont sensés comme celui-ci, ils trouvent le moyen de noyer leur bon sens dans le brouillard. Il a certainement raison ; le Francfort nouveau est stupide ; le vieux Francfort est mort. Il y a en Allemagne un problème à résoudre que M. de Gagern n’a pas résolu. que M. de Metternich ne résoudrait pas et qu’il faut absolument résoudre. Celui-là seul qui le résoudra mettra les radicaux sous ses pieds, comme ils le méritent. Mais je doute que le moment de cette solution soit venu et nous pourrons bien revoir, en l’attendant, une nouvelle édition de la Diète de 1815.
J’ai reçu une lettre très amicale de Narvaez à qui j’avais recommandé Herbet, consul général à Barcelone. Point de politique comme de raison, mais un ton de confiance générale mêlé d’inquiétude sur sa propre santé. Il me parle des fortes indispositions qui l’ont empêché de voir personne, et il quittait Madrid pour retourner aux eaux de Puertollano. Adieu, adieu.
Moi aussi, je suis fâché que M. Gueneau de Mussy ne revienne pas à Paris. A cause de vous surtout. J'étais sûr qu’il vous plairait, et je crois qu’il aurait autorité sur vous pour votre santé, ce qui est bien nécessaire. Le Roi a raison de le garder. Adieu, adieu. G.
Broglie, Lundi 24 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Broglie. Lundi 24 sept 1849 Sept heures
Je vois approcher avec plaisir le jour où je retournerai chez moi. Je suis très bien ici très choyé. Bonne conversation, et qui me plait sur toutes choses comme sur les affaires. Mais j’ai l’esprit plein de ce que je fais de ce que je veux faire. Il n’y a qu’une conversation que je préfère toujours à mes propres préoccupations. Ce que je fais me préoccupe sérieuse ment. Je me figure que ce qui manque le plus aujourd’hui en France, c’est quelqu'un qui dise la vérité avec quelque autorité ; la vérité que tout le monde croit, que tout le monde attend, et à laquelle personne n’ose toucher. Je ferais certainement cela. D’abord sous le manteau anglais ; puis et pas longtemps après, sous ma propre figure française, en parlant de mon temps et de moi- même. Il est clair que l'autorité ne me manque pas. Je voudrais que vous vissiez tous les gens qui viennent me voir. Je suis frappé surtout de ceux d’ici, que je ne connaissais pas auparavant, la plupart du moins. Conservateurs, il est vrai, mais conservateurs de toute sorte et de toute date. Vous seriez frappée de leur déférence. Et de leur curiosité pleine d’assentiment quand j'explique comme je l’entends, ce qui s’est passé, la conduite que j'ai tenue, et pourquoi je suis tombé quoique ma politique fût bonne, et parce qu’elle était trop bonne. N'ayez pas peur ; je ne suis point arrogant, ni blessant. Je ne fais que profiter du sentiment que je rencontre pour exprimer librement le mien. Si le temps et la force ne me manquent pas un moment viendra, où mon avis sera d'un grand poids. Mais le temps et la force pourront bien me manquer. Je vieillis. Je me fatigue vite, et de corps et d’esprit, par la promenade et par le travail. J’ai besoin de repos, de sommeil. Je dors quelques fois dans le jour. Je serais encore en état de donner un coup de collier. Mais à un effort soutenu, prolongé, sans relâche, et sans liberté, je pourrais fort bien ne pas suffire.
10 heures
Je suis bien aise que vous soyez allée à Claremont. Et sûr que votre observation est très juste. La mauvaise fortune n'a fait qu'accroitre la disposition ancienne et constante du Roi; se plaindre de tout le monde, et ne se louer de personne. Mauvaise disposition pour être bien servi. Je sais que l’intérieur n'est pas très harmonieux surtout en ce qui concerne le séjour de l'hiver prochain. L’Angleterre leur déplait à tous excepté au Roi. C’est lui qui a raison. A moins que l'hiver de Claremont ne convienne pas à la santé de la Reine, ce dont j'ai peur. Que dites-vous de Gustave de Beaumont à Vienne ? Au fond, peu importe. Mais le gros bavardage que vous avez entendu à Holland House sera encore plus déplacé à Vienne. M. de Falloux, est décidément hors de danger. Plus de nécessité de retraite, et sa convalescence servira à ajourner, les deux plus périlleuses discussions. Ce qui va beaucoup mieux aussi, c'est le choléra de Paris. Il s'en va. J’ai des nouvelles de plusieurs médecins, unanimes à se rassurer. Que faites-vous de M. Guéneau de Mussy ? Tant que vous resterez en Angleterre, je suis bien aise qu’il y reste. Adieu, adieu. Adieu encore. G.
Je vois approcher avec plaisir le jour où je retournerai chez moi. Je suis très bien ici très choyé. Bonne conversation, et qui me plait sur toutes choses comme sur les affaires. Mais j’ai l’esprit plein de ce que je fais de ce que je veux faire. Il n’y a qu’une conversation que je préfère toujours à mes propres préoccupations. Ce que je fais me préoccupe sérieuse ment. Je me figure que ce qui manque le plus aujourd’hui en France, c’est quelqu'un qui dise la vérité avec quelque autorité ; la vérité que tout le monde croit, que tout le monde attend, et à laquelle personne n’ose toucher. Je ferais certainement cela. D’abord sous le manteau anglais ; puis et pas longtemps après, sous ma propre figure française, en parlant de mon temps et de moi- même. Il est clair que l'autorité ne me manque pas. Je voudrais que vous vissiez tous les gens qui viennent me voir. Je suis frappé surtout de ceux d’ici, que je ne connaissais pas auparavant, la plupart du moins. Conservateurs, il est vrai, mais conservateurs de toute sorte et de toute date. Vous seriez frappée de leur déférence. Et de leur curiosité pleine d’assentiment quand j'explique comme je l’entends, ce qui s’est passé, la conduite que j'ai tenue, et pourquoi je suis tombé quoique ma politique fût bonne, et parce qu’elle était trop bonne. N'ayez pas peur ; je ne suis point arrogant, ni blessant. Je ne fais que profiter du sentiment que je rencontre pour exprimer librement le mien. Si le temps et la force ne me manquent pas un moment viendra, où mon avis sera d'un grand poids. Mais le temps et la force pourront bien me manquer. Je vieillis. Je me fatigue vite, et de corps et d’esprit, par la promenade et par le travail. J’ai besoin de repos, de sommeil. Je dors quelques fois dans le jour. Je serais encore en état de donner un coup de collier. Mais à un effort soutenu, prolongé, sans relâche, et sans liberté, je pourrais fort bien ne pas suffire.
10 heures
Je suis bien aise que vous soyez allée à Claremont. Et sûr que votre observation est très juste. La mauvaise fortune n'a fait qu'accroitre la disposition ancienne et constante du Roi; se plaindre de tout le monde, et ne se louer de personne. Mauvaise disposition pour être bien servi. Je sais que l’intérieur n'est pas très harmonieux surtout en ce qui concerne le séjour de l'hiver prochain. L’Angleterre leur déplait à tous excepté au Roi. C’est lui qui a raison. A moins que l'hiver de Claremont ne convienne pas à la santé de la Reine, ce dont j'ai peur. Que dites-vous de Gustave de Beaumont à Vienne ? Au fond, peu importe. Mais le gros bavardage que vous avez entendu à Holland House sera encore plus déplacé à Vienne. M. de Falloux, est décidément hors de danger. Plus de nécessité de retraite, et sa convalescence servira à ajourner, les deux plus périlleuses discussions. Ce qui va beaucoup mieux aussi, c'est le choléra de Paris. Il s'en va. J’ai des nouvelles de plusieurs médecins, unanimes à se rassurer. Que faites-vous de M. Guéneau de Mussy ? Tant que vous resterez en Angleterre, je suis bien aise qu’il y reste. Adieu, adieu. Adieu encore. G.
Richmond, Mercredi 19 Septembre 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond le 19 septembre 1849
Journée froide hier, & pas de visites. Je n’ai vu que les Metternich & Mad. de Caraman. Je ne devrais pas dire qu’elle m’ennuie par ce qu’enfin elle vient rompre ma solitude et qu’elle le fait avec ma nièce de dévouement et de plaisir. Mais à vrai dire si je n’étais pas rude ce ne serait guère endurable. Si peu naturelle, & si peu de fond ! Mais elle chante ; un peu faux c’est vrai mais très bien. Son talent pour le dessin est merveilleux & ses ressemblances frappantes. Seulement je n’ai Aucune patience, et je ne veux pas poser. Ah l'ennui mon ennemi !
Lord Aberdeen m'écrit souvent Il me dit : "The letter of the President, was an act of great imprudence, and a a piece of insolence offered to the whole word. His own ministere has also good cause to be offended." Quant aux conseils donnés au Pape dans cette même lettre il les trouve de nature à être parfaitement acceptés ; et dit d'eux comme Lord John qu’ils sont élastiques. Le Times de ce matin a un article admirable sur la conduite de la Russie, comparée à celle de l'Angleterre.
1 heures. Votre lettre, et Constantin, & Beauvale. Constantin décrit le désespoir de l'Empereur, énorme, déchirant. Il a dit à Constantin. "Allez chez mes sœurs, & ma fille. Dites leur mon malheur, je ne puis pas écrire." Constantin m'écrit de Weymar, et va de là à Stuftgard, & La Haye. Beauvale curieux. On a donné une constitution à Malte. Le conseil législatif composé de Jésuites intolérant. Refusant refuge même aux malades & blessés. Palmerston choqué, furieux. John Russell & Lord Grey soutenant le gouvernement que Palmerston veut faire chasser. Que va-t-il se passer Beauvale conclut. Garderons-nous Grey ou les colonies les deux ne peuvent pas exister. Le Cap & le Canada en pleine insurrection. Il me semble que je vous ai parlé hier de Malte. Vous aurez vu que John Russel approuve la conduite du gouverneur. Adieu. Adieu. Je n’ai pas lu mes lettres encore. Une longue de Berlin adressée à Beauvale & qu’il m’envoie. S'il y a quelque chose, je vous le manderai. Adieu.
Journée froide hier, & pas de visites. Je n’ai vu que les Metternich & Mad. de Caraman. Je ne devrais pas dire qu’elle m’ennuie par ce qu’enfin elle vient rompre ma solitude et qu’elle le fait avec ma nièce de dévouement et de plaisir. Mais à vrai dire si je n’étais pas rude ce ne serait guère endurable. Si peu naturelle, & si peu de fond ! Mais elle chante ; un peu faux c’est vrai mais très bien. Son talent pour le dessin est merveilleux & ses ressemblances frappantes. Seulement je n’ai Aucune patience, et je ne veux pas poser. Ah l'ennui mon ennemi !
Lord Aberdeen m'écrit souvent Il me dit : "The letter of the President, was an act of great imprudence, and a a piece of insolence offered to the whole word. His own ministere has also good cause to be offended." Quant aux conseils donnés au Pape dans cette même lettre il les trouve de nature à être parfaitement acceptés ; et dit d'eux comme Lord John qu’ils sont élastiques. Le Times de ce matin a un article admirable sur la conduite de la Russie, comparée à celle de l'Angleterre.
1 heures. Votre lettre, et Constantin, & Beauvale. Constantin décrit le désespoir de l'Empereur, énorme, déchirant. Il a dit à Constantin. "Allez chez mes sœurs, & ma fille. Dites leur mon malheur, je ne puis pas écrire." Constantin m'écrit de Weymar, et va de là à Stuftgard, & La Haye. Beauvale curieux. On a donné une constitution à Malte. Le conseil législatif composé de Jésuites intolérant. Refusant refuge même aux malades & blessés. Palmerston choqué, furieux. John Russell & Lord Grey soutenant le gouvernement que Palmerston veut faire chasser. Que va-t-il se passer Beauvale conclut. Garderons-nous Grey ou les colonies les deux ne peuvent pas exister. Le Cap & le Canada en pleine insurrection. Il me semble que je vous ai parlé hier de Malte. Vous aurez vu que John Russel approuve la conduite du gouverneur. Adieu. Adieu. Je n’ai pas lu mes lettres encore. Une longue de Berlin adressée à Beauvale & qu’il m’envoie. S'il y a quelque chose, je vous le manderai. Adieu.
Val-Richer, Mardi 11 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Mardi 11 sept. 1849
Nous ne sortons pas ici des orages. Mais soyez tranquille ; je ne me laisserai plus mouiller. Je n’avais vraiment pas eu grand tort d’oublier mon parapluie ; il faisait très beau depuis plusieurs jours, et pas la moindre apparence d’un changement de temps. Je ne me croyais plus à Londres. Je vais à Broglie après-demain 10. Je serai de retour au Val Richer le 22. J’ai promis de passer là quinze jours. Je ne veux pas me déplacer, ce qui est toujours un peu cher, même pour aller si près pour trois jours seulement. J'y vais avec mes enfants. Melle Chabaud qui est ici, est également invitée. Si vous venez à Paris à la fin de septembre, j'irai vous y voir dans les premiers jours d'Octobre, après mon retour au Val-Richer. Vous voir, quel bonheur ! Mais ne vous voir que pour vous quitter si tôt! Je devrais être fait aux sentiments combattus. Ma vie en a été et en est pleine. Je ne m’y accoutume pas du tout. Je suis vieux ; mais je jouirais encore, si vivement du bonheur complet et simple !
Duchâtel a quitté Paris, assez ennuyé et toujours perplexe. Il voudrait bien n'avoir ni doutes d’esprit, ni embarras de décision, voir toujours clair et être toujours sûr du succès. La prétention du Sybaritisme dans la vie commune est déjà beaucoup ; mais dans la vie publique, c’est trop. Du reste, je sais qu’il se promet beaucoup d’agréments de votre salon à Paris cet hiver " un salon neutre, dit-il, où nous verrons tout le monde et où nous pourrons dire notre avis à et sur tout le monde, sans nous gêner. " Les légitimistes se disent, et ont été, je crois vraiment très fâchés, que Madame la Duchesse d'Orléans et M. le Duc de Bordeaux, aient passé si près l’un de l'autre pour rien : " Mais c’est donc un parti pris, disent ils, de ne pas se rencontrer. Si nous l'avions su M. le comte de Chambord aurait attendu. C'est sûr." M. Véron parle bien de M. le comte de Chambord : " Intelligent et sympathique" ce sont les expressions.
Onze heures Voilà, mon triste courrier du Mardi. Il ne m’apporte rien de Paris. Mais j’aurai des visites ce matin. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Nous ne sortons pas ici des orages. Mais soyez tranquille ; je ne me laisserai plus mouiller. Je n’avais vraiment pas eu grand tort d’oublier mon parapluie ; il faisait très beau depuis plusieurs jours, et pas la moindre apparence d’un changement de temps. Je ne me croyais plus à Londres. Je vais à Broglie après-demain 10. Je serai de retour au Val Richer le 22. J’ai promis de passer là quinze jours. Je ne veux pas me déplacer, ce qui est toujours un peu cher, même pour aller si près pour trois jours seulement. J'y vais avec mes enfants. Melle Chabaud qui est ici, est également invitée. Si vous venez à Paris à la fin de septembre, j'irai vous y voir dans les premiers jours d'Octobre, après mon retour au Val-Richer. Vous voir, quel bonheur ! Mais ne vous voir que pour vous quitter si tôt! Je devrais être fait aux sentiments combattus. Ma vie en a été et en est pleine. Je ne m’y accoutume pas du tout. Je suis vieux ; mais je jouirais encore, si vivement du bonheur complet et simple !
Duchâtel a quitté Paris, assez ennuyé et toujours perplexe. Il voudrait bien n'avoir ni doutes d’esprit, ni embarras de décision, voir toujours clair et être toujours sûr du succès. La prétention du Sybaritisme dans la vie commune est déjà beaucoup ; mais dans la vie publique, c’est trop. Du reste, je sais qu’il se promet beaucoup d’agréments de votre salon à Paris cet hiver " un salon neutre, dit-il, où nous verrons tout le monde et où nous pourrons dire notre avis à et sur tout le monde, sans nous gêner. " Les légitimistes se disent, et ont été, je crois vraiment très fâchés, que Madame la Duchesse d'Orléans et M. le Duc de Bordeaux, aient passé si près l’un de l'autre pour rien : " Mais c’est donc un parti pris, disent ils, de ne pas se rencontrer. Si nous l'avions su M. le comte de Chambord aurait attendu. C'est sûr." M. Véron parle bien de M. le comte de Chambord : " Intelligent et sympathique" ce sont les expressions.
Onze heures Voilà, mon triste courrier du Mardi. Il ne m’apporte rien de Paris. Mais j’aurai des visites ce matin. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mercredi 22 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Mercredi 22 août 1849
Sept heures
Je n’ai aucune nouvelle à vous envoyer. Vitet, de retour à Paris, m’écrit : " Paris est plus mort que jamais. Il n'y reste absolument personne. La politique est partie pour les Conseils généraux ; je ne crois pas qu’elle y fasse grand bruit. C’est un temps de sommeil. On essaiera quelques petites parodies d’Etats provinciaux ; mais ce seront des bluettes. Il n'y a pour le quart d'heure, de sérieux nulle part. " Il en sera ainsi jusqu'au retour de l’assemblée, c’est-à-dire jusqu'aux premiers jours d'octobre. Alors commencera une crise ministérielle. L’assemblée voudra faire, un ministère plus à son image. Elle y réussira probablement. Mais l'image sera pâle, et aura peur d'elle-même en se regardant. En sorte que l'opposition y gagnera plus que la réaction ; et on entrera, dans une série d’oscillations, et de combinaisons batardes où la République modérée et la Monarchie honteuse s’useront, l’une contre l'autre, sans que ni l’une ni l’autre fasse rien de sérieux. Mon instinct est de plus en plus qu’on se traînera, tout le monde jusqu’au bord du fossé. Sautera- t-on alors, ou tombera-t-on au fond ? Je ne sais vraiment pas. Je regrette que vous ne connaissiez pas M. Vitet. C’est un des esprits les plus justes, les plus fins, les plus agréables et aussi les plus fermés, que nous ayons aujourd'hui. Et tout-à-fait de bonne compagnie, malgré un peu trop d’insouciance et de laisser aller. Voici une nouvelle. J’ai fait vendre à Paris ma voiture, mon coupé bleu. On l’a revu dans les rues. Cela a fait un petit bruit.
Je trouve dans l'Opinion publique, journal légitimiste : " Ce matin à midi et demi, un élégant et massif coupé de ville, bleu de roi, cheminait à petits pas sur la chaussée du boulevard des Capucines. La curiosité nous ayant poussé vers cet équipage que nous avions cru reconnaître, nous nous sommes en effet assurés que c'était bien comme nous l'avions jugé à distance, la voiture de M. Guizot, son écusson y est intact, avec sa devise : Recta omnium brevissima, et le cordon rouge en sautoir autour de l’écu. Pourquoi cette voiture errait-elle autour de l’hôtel qu’elle a hanté si longtemps ? Nous ne savons." Si j’avais été à Paris, j'aurais fait dire dans quelque journal, le lendemain, que ma voiture roulait parce que je l’avais vendue. Vous avez bien raison, l'immobilité et le silence me servent parfaitement.
En fait de folie, je n'en connais point de supérieure à celle de la Chambre des représentants de Turin. Elle ne peut pas faire la guerre ; elle le dit elle-même, et elle ne veut pas faire la paix. Point de dévouement à la lutte et point de résignation à la défaite ; je ne me souviens pas que le monde ait jamais vu cela. Il est probable que la nécessité finira par triompher, même de la folie. Mais il y a là un symptôme bien inquiétant pour l’Autriche, l'impuissance ne guérira point l'Italie de la rage. Le monde est plein aujourd’hui de problèmes insolubles. Insolubles pour nous, qui sommes si impatients dans une vie si courte. Le bon Dieu en trouvera bien la solution.
Vous ne me manquez pas plus que je ne croyais, mais bien, bien autant. Je parle, j'écoute, je cause sans rien dire et sans rien entendre qui mérite que j'ouvre la bouche ou les oreilles. La surface de la vie assez pleine, le fond, tout-à-fait vide. Je suis entouré d'affection, de dévouement, de soins, de respect. Il me manque l’égalité et l’intimité. Et combien il manque encore à notre intimité même quand elle est là ! La vie reste toujours bien imparfaite, quoi qu’elle aie de quoi ne pas l’être. Je m’y soumets mais je ne m'en console pas.
Onze heures
Pas de lettre. Pourquoi ? Et je l’attends plus impatiemment le mercredi que tout autre jour. Il a fait beau. Ce n’est pas la mer. Je suis très contrarié. Je me sers d’un pauvre mot. Adieu. Adieu. Adieu. Ce sera bien long d’ici à demain. Adieu. Guizot.
Sept heures
Je n’ai aucune nouvelle à vous envoyer. Vitet, de retour à Paris, m’écrit : " Paris est plus mort que jamais. Il n'y reste absolument personne. La politique est partie pour les Conseils généraux ; je ne crois pas qu’elle y fasse grand bruit. C’est un temps de sommeil. On essaiera quelques petites parodies d’Etats provinciaux ; mais ce seront des bluettes. Il n'y a pour le quart d'heure, de sérieux nulle part. " Il en sera ainsi jusqu'au retour de l’assemblée, c’est-à-dire jusqu'aux premiers jours d'octobre. Alors commencera une crise ministérielle. L’assemblée voudra faire, un ministère plus à son image. Elle y réussira probablement. Mais l'image sera pâle, et aura peur d'elle-même en se regardant. En sorte que l'opposition y gagnera plus que la réaction ; et on entrera, dans une série d’oscillations, et de combinaisons batardes où la République modérée et la Monarchie honteuse s’useront, l’une contre l'autre, sans que ni l’une ni l’autre fasse rien de sérieux. Mon instinct est de plus en plus qu’on se traînera, tout le monde jusqu’au bord du fossé. Sautera- t-on alors, ou tombera-t-on au fond ? Je ne sais vraiment pas. Je regrette que vous ne connaissiez pas M. Vitet. C’est un des esprits les plus justes, les plus fins, les plus agréables et aussi les plus fermés, que nous ayons aujourd'hui. Et tout-à-fait de bonne compagnie, malgré un peu trop d’insouciance et de laisser aller. Voici une nouvelle. J’ai fait vendre à Paris ma voiture, mon coupé bleu. On l’a revu dans les rues. Cela a fait un petit bruit.
Je trouve dans l'Opinion publique, journal légitimiste : " Ce matin à midi et demi, un élégant et massif coupé de ville, bleu de roi, cheminait à petits pas sur la chaussée du boulevard des Capucines. La curiosité nous ayant poussé vers cet équipage que nous avions cru reconnaître, nous nous sommes en effet assurés que c'était bien comme nous l'avions jugé à distance, la voiture de M. Guizot, son écusson y est intact, avec sa devise : Recta omnium brevissima, et le cordon rouge en sautoir autour de l’écu. Pourquoi cette voiture errait-elle autour de l’hôtel qu’elle a hanté si longtemps ? Nous ne savons." Si j’avais été à Paris, j'aurais fait dire dans quelque journal, le lendemain, que ma voiture roulait parce que je l’avais vendue. Vous avez bien raison, l'immobilité et le silence me servent parfaitement.
En fait de folie, je n'en connais point de supérieure à celle de la Chambre des représentants de Turin. Elle ne peut pas faire la guerre ; elle le dit elle-même, et elle ne veut pas faire la paix. Point de dévouement à la lutte et point de résignation à la défaite ; je ne me souviens pas que le monde ait jamais vu cela. Il est probable que la nécessité finira par triompher, même de la folie. Mais il y a là un symptôme bien inquiétant pour l’Autriche, l'impuissance ne guérira point l'Italie de la rage. Le monde est plein aujourd’hui de problèmes insolubles. Insolubles pour nous, qui sommes si impatients dans une vie si courte. Le bon Dieu en trouvera bien la solution.
Vous ne me manquez pas plus que je ne croyais, mais bien, bien autant. Je parle, j'écoute, je cause sans rien dire et sans rien entendre qui mérite que j'ouvre la bouche ou les oreilles. La surface de la vie assez pleine, le fond, tout-à-fait vide. Je suis entouré d'affection, de dévouement, de soins, de respect. Il me manque l’égalité et l’intimité. Et combien il manque encore à notre intimité même quand elle est là ! La vie reste toujours bien imparfaite, quoi qu’elle aie de quoi ne pas l’être. Je m’y soumets mais je ne m'en console pas.
Onze heures
Pas de lettre. Pourquoi ? Et je l’attends plus impatiemment le mercredi que tout autre jour. Il a fait beau. Ce n’est pas la mer. Je suis très contrarié. Je me sers d’un pauvre mot. Adieu. Adieu. Adieu. Ce sera bien long d’ici à demain. Adieu. Guizot.
Val-Richer, Vendredi 17 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Vendredi 17 Août 1849
Une heure
C’est certainement pas grave, et parce qu’il me connait, que Lord Nugent ne m'a pas accolé à Metternich, dans cette intrigue contre Lord Palmerston, " fostered by the criminals whe have been ejected from their own countries by revolutions. " Lord Nugent est un type de l’honnête et grossier badaud libéral. Je ne crois pas que ces meetings et ces discours troublent beaucoup Lord John. C’est une manière d’attirer ou de retenir dans le camp ministériel des radicaux toujours enclin à faire de l'opposition. Palmerston est un recruteur qui va dans des quartiers ou ses collègues ne vont point. Ces meetings ne peuvent déplaire qu'à ceux des Ministres qui ne veulent réellement pas de la politique de Palmerston et voudraient se défaire de sa personne. Mais Lord John n’est pas de ceux-là, moins unscrupulous que lord Palmerston, et plus retenu par la responsabilité de chef, mais, au fond, de son avis.
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer le Mémoire publié par M. de Lesseps sur sa mission de Rome. C'est assez curieux quoique très médiocre, et concluant contre lui. Sa conduite a été simplement le reflet des faiblesses de ses chefs de Paris ; faiblesses qui l’ont fait croire au triomphe des rouges. Il est justement puni ; mais d'autres devraient l'être comme lui. Les Lenormant sont partis ce matin fort peu légitimistes, mais bien engagés, et assez influents dans le parti catholique. La brouillerie de Thiers et de Montalembert, leur plaît et ils pousseront à ce qu’elle soit prise au sérieux. Ils reprochaient fort, à Montalembert de se laisser prendre par Thiers.
On me dit aussi ce que vous écrit Lady Holland, que Molé est désolé de cet incident et dit qu’il ne sait plus d’où peut venir le salut. Toutes les dissentions dans le parti modéré tourneront au profit du président, et du Statu quo jusqu'à l'approche des nouvelles élections. Et si le Statu quo va jusque-là, les élections seront perdues, et Dieu sait quoi après. La réflexion me plonge toujours dans le noir ; il n’y a que l’instinct qui m’en défende. M. Fould a quelque esprit à force d’égoïsme, et point de jugement à force de pusillanimité. Il est bon à vous donner des nouvelles de Paris. Il les reçoit plutôt que personne. Pas bon à autre chose, et ne lui dîtes que ce que vous voulez qu'on redise. Vous avez raison de le trouver bien laid. Lui et Crémieux sont les plus bassement laids des juifs, par conséquent des hommes.
Samedi 7 heures
Je me lève. Le soleil est superbe. Si je n’aimais pas mieux vous écrire, j'irais me promener. Dites-moi pourquoi, ou pour qui Mad de Caraman reste à Richmond. Est-ce pour lord Lansdowne ? Tirez-vous d’elle dans le tête-à-tête un peu de conversation moins arrangée et moins complimenteuse ? Voici une lettre que je reçois d'une Ecossaise, Miss Stirling, excellente personne, que je connais depuis longtemps, très bonne musicienne, par exception ce qui fait qu’elle s’intéresse beaucoup à Chopin qui lui a donné des leçons. Chopin est réellement un habile artiste, parfaitement étranger à la politique et fort malade. Pouvez-vous quelque chose pour la charité qu’il demande ? Je ne répondrai que quand vous m'aurez répondu. Après le départ des Lenormant j’ai passé hier ma journée seul, sauf quatre visites pourtant. Mais enfin, je n’avais personne chez moi, j'ai dîné et je me suis promenée sans hôtes. Cela m'a plu. La liberté de la solitude me plaît. Il n’y a que l’intimité qui vaille mieux. Le procès de Madame Lenormant pour les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier va recommencer. Girardin et Madame Colet en appellent. Derrière les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, il y a pour Girardin un autre intérêt. M. de Châteaubriand a écrit dans ses Mémoires d'Outretombe, un livre (le 10e) entièrement consacré à Mad. Récamier. Le manuscrit de ce livre daté et signé de la main de M. de Châteaubriand, a été donné par lui à Mad. Récamier pour qu’elle en fit ce qui lui plairait et il a mis en même temps dans son testament que toute autre copie de ce 10e livre n’avait aucune valeur, et ne pourrait être public. Mad. Lenormant à l’exemplaire donné par M. de Châteaubriand à Mad. Récamier et n'en veut, comme de raison, aucune publication. Girardin s'est procuré, par un secrétaire de M. de Châteaubriand des fragments, brouillon en copie de ce Livre. Il paye ce secrétaire pour qu'il étende les fragments avec ses souvenirs ou de toute autre manière, et il tient beaucoup à publier ce 10e livre, sans lequel les Mémoires d’outre tombe de son journal seraient incomplets. Le jugement qui vient d'être rendu sur les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, lui rend cela impossible s'il subsiste. Voilà pourquoi il appelle Mad. Lenormant espère bien gagner son procès en cour d'appel. Elle est très mécontente de la façon dont Chaix d’Estange a planté pour elle. Par ménagement pour Girardin, Mad. Colet, M. Cousin le chansonnier Béranger &, il n’a pas fait usage de plusieurs moyens et pièces curieuses qu’elle lui avait remis. Mad. Colet est une drôle de personne. Naguères fort belle, grande forte une quasi Corinne provençale. Elle a été au mieux avec M. Cousin on prétend même qu’il y a entre eux deux petits cousins. Elle a donné un jour un soufflet à M. Alphonse Karr (l’auteur des Guêpes) parce qu'il avait dit quelque chose dans ses Guêpes sur M. Cousin et sur elle. Il n'y a pas plus à plaisanter avec elle qu'avec M. Pierre Bonaparte. Il y a dans le 10e livre de M. de Châteaubriand des lettres insérées de beaucoup de personnes à Mad. Récamier ; entr’autres quinze lettres de Mad. de Staël. Bien des gens désirent donc que ce livre ne soit pas publié. Adieu jusqu’à la poste. Adieu, Adieu.
Onze heures
Pour Dieu, ne continuez pas à être souffrante. Et dites-moi ce que vous aura dit M. de Mussy. Adieu. Adieu. Je vous parlerai demain de Rome. Adieu, dearest. G.
Une heure
C’est certainement pas grave, et parce qu’il me connait, que Lord Nugent ne m'a pas accolé à Metternich, dans cette intrigue contre Lord Palmerston, " fostered by the criminals whe have been ejected from their own countries by revolutions. " Lord Nugent est un type de l’honnête et grossier badaud libéral. Je ne crois pas que ces meetings et ces discours troublent beaucoup Lord John. C’est une manière d’attirer ou de retenir dans le camp ministériel des radicaux toujours enclin à faire de l'opposition. Palmerston est un recruteur qui va dans des quartiers ou ses collègues ne vont point. Ces meetings ne peuvent déplaire qu'à ceux des Ministres qui ne veulent réellement pas de la politique de Palmerston et voudraient se défaire de sa personne. Mais Lord John n’est pas de ceux-là, moins unscrupulous que lord Palmerston, et plus retenu par la responsabilité de chef, mais, au fond, de son avis.
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer le Mémoire publié par M. de Lesseps sur sa mission de Rome. C'est assez curieux quoique très médiocre, et concluant contre lui. Sa conduite a été simplement le reflet des faiblesses de ses chefs de Paris ; faiblesses qui l’ont fait croire au triomphe des rouges. Il est justement puni ; mais d'autres devraient l'être comme lui. Les Lenormant sont partis ce matin fort peu légitimistes, mais bien engagés, et assez influents dans le parti catholique. La brouillerie de Thiers et de Montalembert, leur plaît et ils pousseront à ce qu’elle soit prise au sérieux. Ils reprochaient fort, à Montalembert de se laisser prendre par Thiers.
On me dit aussi ce que vous écrit Lady Holland, que Molé est désolé de cet incident et dit qu’il ne sait plus d’où peut venir le salut. Toutes les dissentions dans le parti modéré tourneront au profit du président, et du Statu quo jusqu'à l'approche des nouvelles élections. Et si le Statu quo va jusque-là, les élections seront perdues, et Dieu sait quoi après. La réflexion me plonge toujours dans le noir ; il n’y a que l’instinct qui m’en défende. M. Fould a quelque esprit à force d’égoïsme, et point de jugement à force de pusillanimité. Il est bon à vous donner des nouvelles de Paris. Il les reçoit plutôt que personne. Pas bon à autre chose, et ne lui dîtes que ce que vous voulez qu'on redise. Vous avez raison de le trouver bien laid. Lui et Crémieux sont les plus bassement laids des juifs, par conséquent des hommes.
Samedi 7 heures
Je me lève. Le soleil est superbe. Si je n’aimais pas mieux vous écrire, j'irais me promener. Dites-moi pourquoi, ou pour qui Mad de Caraman reste à Richmond. Est-ce pour lord Lansdowne ? Tirez-vous d’elle dans le tête-à-tête un peu de conversation moins arrangée et moins complimenteuse ? Voici une lettre que je reçois d'une Ecossaise, Miss Stirling, excellente personne, que je connais depuis longtemps, très bonne musicienne, par exception ce qui fait qu’elle s’intéresse beaucoup à Chopin qui lui a donné des leçons. Chopin est réellement un habile artiste, parfaitement étranger à la politique et fort malade. Pouvez-vous quelque chose pour la charité qu’il demande ? Je ne répondrai que quand vous m'aurez répondu. Après le départ des Lenormant j’ai passé hier ma journée seul, sauf quatre visites pourtant. Mais enfin, je n’avais personne chez moi, j'ai dîné et je me suis promenée sans hôtes. Cela m'a plu. La liberté de la solitude me plaît. Il n’y a que l’intimité qui vaille mieux. Le procès de Madame Lenormant pour les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier va recommencer. Girardin et Madame Colet en appellent. Derrière les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, il y a pour Girardin un autre intérêt. M. de Châteaubriand a écrit dans ses Mémoires d'Outretombe, un livre (le 10e) entièrement consacré à Mad. Récamier. Le manuscrit de ce livre daté et signé de la main de M. de Châteaubriand, a été donné par lui à Mad. Récamier pour qu’elle en fit ce qui lui plairait et il a mis en même temps dans son testament que toute autre copie de ce 10e livre n’avait aucune valeur, et ne pourrait être public. Mad. Lenormant à l’exemplaire donné par M. de Châteaubriand à Mad. Récamier et n'en veut, comme de raison, aucune publication. Girardin s'est procuré, par un secrétaire de M. de Châteaubriand des fragments, brouillon en copie de ce Livre. Il paye ce secrétaire pour qu'il étende les fragments avec ses souvenirs ou de toute autre manière, et il tient beaucoup à publier ce 10e livre, sans lequel les Mémoires d’outre tombe de son journal seraient incomplets. Le jugement qui vient d'être rendu sur les lettres de Benj. Constant à Mad. Récamier, lui rend cela impossible s'il subsiste. Voilà pourquoi il appelle Mad. Lenormant espère bien gagner son procès en cour d'appel. Elle est très mécontente de la façon dont Chaix d’Estange a planté pour elle. Par ménagement pour Girardin, Mad. Colet, M. Cousin le chansonnier Béranger &, il n’a pas fait usage de plusieurs moyens et pièces curieuses qu’elle lui avait remis. Mad. Colet est une drôle de personne. Naguères fort belle, grande forte une quasi Corinne provençale. Elle a été au mieux avec M. Cousin on prétend même qu’il y a entre eux deux petits cousins. Elle a donné un jour un soufflet à M. Alphonse Karr (l’auteur des Guêpes) parce qu'il avait dit quelque chose dans ses Guêpes sur M. Cousin et sur elle. Il n'y a pas plus à plaisanter avec elle qu'avec M. Pierre Bonaparte. Il y a dans le 10e livre de M. de Châteaubriand des lettres insérées de beaucoup de personnes à Mad. Récamier ; entr’autres quinze lettres de Mad. de Staël. Bien des gens désirent donc que ce livre ne soit pas publié. Adieu jusqu’à la poste. Adieu, Adieu.
Onze heures
Pour Dieu, ne continuez pas à être souffrante. Et dites-moi ce que vous aura dit M. de Mussy. Adieu. Adieu. Je vous parlerai demain de Rome. Adieu, dearest. G.
Val-Richer, Vendredi 10 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer Vendredi 10 août 1849
6 heures
J’ai oublié ce matin le vendredi et j’ai fait mettre ma lettre à la poste comme si vous deviez la recevoir Dimanche. Vous aurez deux volumes lundi au lieu d'un. Je reviens de la promenade avec mes hôtes, trois personnes que vous ne connaissez pas et René de Guitaut, le faire de Mad. Bresson. Joli et intelligent jeune homme, qui n’a rien fait pour être replacé, mais qui aurait assez envie de l'être. Il dit que M. Drouyn de Lhuys était très peu bienveillant pour lui, et pour tous mes protégés de prédilection : mais que M. de Tocqueville est beaucoup mieux, et le dit.
Il m'a amusé, et attristé, en me parlant de sa sœur. " Elle a beaucoup gagné, m'a-t-il dit, au moral et au physique, depuis la mort de son mari, Certainement, elle ne se remariera pas. Elle avait accepté le joug de Bresson, qui n’était pas commode. Elle l'aimait. Mais elle n’en acceptera aucun autre. Elle est forte et fière, et jouit beaucoup de son indépendance. " Evidemment le plaisir de la liberté, surpasse dans Mad. Bresson, le regret du bonheur. Bossuet dit quelque part : " Ainsi s’en vont les amitiés de la terre avec les années et les intérêts. " Je reconnais ces vérités communes générales. Je ne les et jamais acceptées, je ne les accepte point comme universelles. Je ne me fais point d'illusions sur le gros de la nature, et de la condition humaine ; mais je crois aux cœurs, comme aux esprits d'élite ; il y a de grandes affections comme de grandes idées, et tout ne se passe pas et ne passe pas pareillement dans toutes les âmes, si je n’avais pas cette confiance et cette expérience là je pourrais cacher, (il le faudrait bien), mon incurable tristesse et mépris de toute personne et de toute chose, mais je vivrais dans un complet isolement intérieur. De toutes les médiocrités, celle des affections est la seule que je ne puisse pas tolérer.
J’ai eu beaucoup de monde toute la matinée ; quatorze gros bonnets d’une petite ville des environs venus en masse, et de Caen le meneur des légitimistes les plus vifs, l’ami intime de Charles de Bourmont, homme d'assez d’esprit et qui a le verbe haut dans le pays. Je suis le même avec tous ; langage très ouvert conduite très réservée ; rien à cacher et rien à faire. L’idée de me nommer au Conseil général court toujours, bien accueillie par la masse de la population repoussée par les gros timides et les rivaux cachés. Anciens rivaux de Paris actifs partout et en toute occasion, quoique affectant une très bonne apparence. Evidemment, ils ne doutent plus que jamais de me revoir sur la scène et feront tout ce qu’ils pourront pour m'en fermer toutes les portes. Je ne me prête point à leurs manœuvres, ni ne m’en défends. Je laisse faire le public et le temps, si je dois revenir, c’est par ces deux forces là seules que je dois et que je puis revenir comme il me convient. Je ne crois pas au Conseil général.
Samedi 7 heures
Voilà M. de Guizard qui m’arrive, l’ami intime de M. de Rémusat. Je sais qu’il voit tous les jours Thiers et sa coterie. Il m'apprendra beaucoup de petites choses. Assez d’esprit et vrai gentleman.
Onze heures Moi aussi, je reçois chaque matin votre lettre avec un plaisir nouveau. Autre chose serait encore plus nouveau et encore mieux. Adieu, Adieu, adieu. Dearest, ever dearest. G.
6 heures
J’ai oublié ce matin le vendredi et j’ai fait mettre ma lettre à la poste comme si vous deviez la recevoir Dimanche. Vous aurez deux volumes lundi au lieu d'un. Je reviens de la promenade avec mes hôtes, trois personnes que vous ne connaissez pas et René de Guitaut, le faire de Mad. Bresson. Joli et intelligent jeune homme, qui n’a rien fait pour être replacé, mais qui aurait assez envie de l'être. Il dit que M. Drouyn de Lhuys était très peu bienveillant pour lui, et pour tous mes protégés de prédilection : mais que M. de Tocqueville est beaucoup mieux, et le dit.
Il m'a amusé, et attristé, en me parlant de sa sœur. " Elle a beaucoup gagné, m'a-t-il dit, au moral et au physique, depuis la mort de son mari, Certainement, elle ne se remariera pas. Elle avait accepté le joug de Bresson, qui n’était pas commode. Elle l'aimait. Mais elle n’en acceptera aucun autre. Elle est forte et fière, et jouit beaucoup de son indépendance. " Evidemment le plaisir de la liberté, surpasse dans Mad. Bresson, le regret du bonheur. Bossuet dit quelque part : " Ainsi s’en vont les amitiés de la terre avec les années et les intérêts. " Je reconnais ces vérités communes générales. Je ne les et jamais acceptées, je ne les accepte point comme universelles. Je ne me fais point d'illusions sur le gros de la nature, et de la condition humaine ; mais je crois aux cœurs, comme aux esprits d'élite ; il y a de grandes affections comme de grandes idées, et tout ne se passe pas et ne passe pas pareillement dans toutes les âmes, si je n’avais pas cette confiance et cette expérience là je pourrais cacher, (il le faudrait bien), mon incurable tristesse et mépris de toute personne et de toute chose, mais je vivrais dans un complet isolement intérieur. De toutes les médiocrités, celle des affections est la seule que je ne puisse pas tolérer.
J’ai eu beaucoup de monde toute la matinée ; quatorze gros bonnets d’une petite ville des environs venus en masse, et de Caen le meneur des légitimistes les plus vifs, l’ami intime de Charles de Bourmont, homme d'assez d’esprit et qui a le verbe haut dans le pays. Je suis le même avec tous ; langage très ouvert conduite très réservée ; rien à cacher et rien à faire. L’idée de me nommer au Conseil général court toujours, bien accueillie par la masse de la population repoussée par les gros timides et les rivaux cachés. Anciens rivaux de Paris actifs partout et en toute occasion, quoique affectant une très bonne apparence. Evidemment, ils ne doutent plus que jamais de me revoir sur la scène et feront tout ce qu’ils pourront pour m'en fermer toutes les portes. Je ne me prête point à leurs manœuvres, ni ne m’en défends. Je laisse faire le public et le temps, si je dois revenir, c’est par ces deux forces là seules que je dois et que je puis revenir comme il me convient. Je ne crois pas au Conseil général.
Samedi 7 heures
Voilà M. de Guizard qui m’arrive, l’ami intime de M. de Rémusat. Je sais qu’il voit tous les jours Thiers et sa coterie. Il m'apprendra beaucoup de petites choses. Assez d’esprit et vrai gentleman.
Onze heures Moi aussi, je reçois chaque matin votre lettre avec un plaisir nouveau. Autre chose serait encore plus nouveau et encore mieux. Adieu, Adieu, adieu. Dearest, ever dearest. G.
Val-Richer, Vendredi 3 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 3 août 1849
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
8 heures
Ceci ne partira pas aujourd’hui. Je vous assure que votre Dimanche me déplaît autant que mon mardi. Je reviens sur le Duc de Broglie. Je crois que vous vous trompez. Il vous a tout simplement exprimé son sentiment général que Paris n'a plus de quoi attirer personne, et que pour y rester il faut y être obligé. Il pense bien peu aux personnes et aux questions personnelles, et ne fait guères de combinaisons et de calculs dont elles soient le premier objet. Cependant c’est possible. Vous avez toujours inspiré à mes amis, un peu de jalousie et un peu de crainte. Heureusement ce ne sont pas eux qui décident. J’ai été charmé quand vous avez repris votre appartement pour trois ans. J’aime les liens matériels même quand ils ne sont pas nécessaires. Il faut faire le contraire de ce que pense le duc de Broglie, c'est-à-dire être à Paris autant que vous ne serez pas forcée d’être ailleurs. Je suis bien aise du reste que le duc de Broglie vous ait pleinement rassurée sur ce qui me touche, Croyez bien et que j'y regarde avec soin, et que je vous dirai toujours la vérité. Je veux que vous vous fassiez une affaire de conscience de me tout dire sur vous, et je vous promets d'en faire autant, pour vous, sur moi. C’est le seul moyen d'avoir un peu de sécurité. Sécurité bien imparfaite et moyen quelques fois triste. Mais enfin, c’est le seul.
J’écris aujourd’hui à Guineau de Mussy pour lui demander une ordonnance dont Pauline a besoin contre des douleurs de névralgie dans la tête qu’il a déjà dissipées une fois, à Brompton. Je lui dis en outre : " Je sais que vous avez vu la Princesse de Lieven. J’en suis fort aise. Vous lui donnerez de bons conseils et du courage. Elle est charmée de vous et vous ne la verrez pas longtemps sans prendre intérêt à cette nature, grande et délicate qui a toutes les forces de l’esprit le plus élevé et toutes les agitations d’une femme isolée et souffrante. Je serai reconnaissant de tous les soins que vous prendrez d'elle. " Il m'est en effet très dévoué, et je veux qu’il vous soit dévoué aussi. Je crois au dévouement, et j'en fais grand cas. C'est le service, non seulement le plus doux, mais le plus sûr le seul qui résiste aux épreuves, et aille jusqu'au bout parce qu'il trouve en lui-même son mobile et sa satisfaction. C’est une des sottises de l’égoïsme de ne pas comprendre le dévouement ne sachant pas plus, l’inspirer que le ressentir. J’ai vu des égoïstes très habiles à tirer parti, pour eux-mêmes des personnes qui les entouraient, mais forces d’y prendre une peine extrême et continue, et ne pouvant jamais compter. Avec plus de cœur, ils auraient eu moins de fatigue et plus de sécurité. Il est vrai qu’il faut deux choses avec les personnes dévouées ; il faut leur donner de l'affection et leur passer des défauts. Par goût, j'aime mieux cela, et je crois qu’à tout prendre c’est un bon calcul ! Mais on ne fait pas cela par calcul. Chacun sait sa pente et le dévouement ne va qu'à ceux qui l’inspirent et le méritent réellement.
MM. de Lavergne et Mallac sont partis hier soir. Ils ne m'ont rien dit de plus que ce que je vous ai déjà mandé. J’attends MM. Dumon, Dalmatie, Vitet, Moulin, Coste, Lenormant & & Je me réserve le matin depuis m'en lever jusqu’au déjeuner et dans le cours de l'après-midi au moins trois heures, plus souvent quatre. Je donne à mes hôtes deux heures dans la matinée, et la soirée. D'ici à un mois, je compte bien avoir moins de visites. Elles me dérangeraient trop. On vient toujours beaucoup des environs. Et je répète ce que je vous ai déjà dit, plus d’une fois peut-être ; bonne population, trop petite, d’esprit et de cœur, pour ce qu’elle a à faire. j'espère qu’elle grandira. Mais je n'en suis point sûr.
5 heures
J’ai reçu une lettre de St Aulaire qui se désole de n'avoir pu venir à ma rencontre au Havre et qui va rejoindre sa femme en Bourgogne, chez Mad d'Esterne. Ils vont tous bien. " J'avais toujours rêvé, me dit-il d'achever ma vie dans le loisir : m’ha troppo ajutato San Antonio. Mais ce n’est pas le mouvement que je regrette. Je travaille à mettre de l'ordre dans mes papiers et mes souvenirs. Mais j'ai commencé par Rome en 1831. J’ai bien du chemin à faire pour arriver à Londres en 1842. Je voudrais que Dieu m’en donnât le temps, car vous m’avez fourni de beaux matériaux à mettre en œuvre pour cette époque. Personne ne lira ce que j'écris avant trente ans. C'est quand on ne se sent plus bon à rien qu’on se rejette ainsi dans l'avenir. J'espère bien que vous nous préparez des enseignements moins tardifs. Que j'aurais envie de causer avec vous mon cher ami ! Vous l'esprit le plus net que j’ai jamais connu débrouillez-vous ce chaos ? Ne comptez pas sur moi pour mettre une idée quelconque dans la conversation. Quelque fois je pense que les socialistes ont à moitié raison, et que la vieille société finit. J'espère seulement ne pas vivre assez pour jouir de celle qu’ils mettront à la place. " Je trouve tout le monde bien découragé. Et les gens d’esprit bien plus que les autres. Et les vieilles. gens d’esprit bien plus que les jeunes. Voici ce que m’écrit Béhier qui ne manque pas d’esprit ; de votre aveu malgré votre première impression : " Nous avons ici un vent singulier qui souffle. On répète partout que le 15 de ce mois Louis Napoléon doit être proclamé Empereur. Personne n’y croit, que Nos Républicains. Ils ont l’air d'en avoir une profonde inquiétude. Ceci n’est probablement pas sérieux. Mais il en résulte ce fait démontré que personne ne croit à la durée de ceci. On parle tout nettement tout bonnement, d’une substitution. Que Dieu la retarde ! Non pas que je me préoccupe des 60 Montagnards qui, pendant les vacances de l'Assemblée vont rester à Paris pour surveiller le pouvoir. Ces vieux roquets fangeux peuvent grogner ; ils ne font plus peur à grand monde : ils ont perdre leurs crocs, et ne sont bons qu'à faire des mannequins de parade. "
C'est là l’impression qui règne autour de moi, parmi les honnêtes gens de bon sens, qui ne cherchent et n'entendent malice à rien. Plus de peur et point d'espérance. Dégoût du présent ; point d’idée ni de désir d'avenir. Le Chancelier et Mad. de Boigne disent à Trouville qu’ils désirent bien que j’y vienne, qu’ils seront bien contents de me revoir & & Je ne leur donnerai pas lieu de croire que je crois ce qu’ils disent. Je n’irai de longtemps à Trouville. Ils ont été mal pour moi. Je suis bien aise qu’ils sachent que je le sais. Adieu. A demain. Je dis cela avec un serrement de cœur. Adieu.
Samedi. 4 août. 7 heures
Je vous dis bonjour en me levant. Je vais travailler. Il faut que j'aie fait deux choses d'ici à la fin de l'automne. Pour les grandes et pour les petites maisons. Le temps est superbe. Je vous aime mille fois mieux que le soleil. Adieu. Adieu. Je dors bien mais toujours en rêvant. Décidemment la révolution de Février m’a enlevé le calme de mes nuits, bien plus que celui de mes jours. Adieu encore. Jusqu'à la poste.
Onze heures Je ne crains pas que vous deveniez bête. Mais j’aimerais infiniment mieux que nous fissions à toute minute, échange de nos esprits. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 2 août 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Jeudi 2 août 1849
7 heures
J’ai été bien heureux hier tout le jour. Je crois que mes hôtes m'ont trouvé bien gai. Comme notre âme tombe tout entière sous le joug de son impression du moment. Vous savoir un peu tranquille et être moi-même un peu tranquille, sur votre compte, me suffisait. J'étais presque content comme si vous aviez été là. Ce n’est pas vrai.
J’ai sous les yeux une image de l’extrême éparpillement et dispersion des esprits en France. Mes deux hôtes au fond, pensent et veulent tous deux la même chose; ce sont deux hommes du même parti, et deux hommes d’esprits. L’un croit au retour de la Monarchie pure, l'autre croit au succès définitif tant bien que mal de la République. L'avenir est si obscur et si incertain que des yeux qui y cherchent, et y souhaitent la même chose y voient. des choses contraires. Cela fait peur pour notre destinée et pitié pour l’esprit humain. Tous deux sont fort tristes et inquiets, à cause de la bêtise et de la platitude universelles. Un garde national de Paris disait le 25 février 1848, en criant contre les ouvriers, la populace et l’anarchie : " Puisqu'on leur livre tout, qu’ils nous laissent tranquilles. " Le pays livre soit tout volontiers, l’avenir comme le passé, pourvu qu’on le laissât tranquille. Heureusement que le bon Dieu ne se contente pas à si bon marché que les hommes ; et me permet pas qu’ils soient tranquilles à tout prix. Le Cabinet actuel moins près de tomber qu'on ne le croit. Dufaure et Tocqueville, ses vrais chefs, charmés du régime actuel, comme des acteurs d'une ville de province appelés à jouer sur le théâtre de Paris, et décidés à s'y maintenir. Sincèrement attachés à la République et à la Constitution, et se flattant qu'ils y contiendront le Président. Plus ennemis de Thiers que jamais. Tocqueville a dit à M. de Lavergne : " Il faut que M. Guizot entre dans l'Assemblée ; il n’y a que lui qui puisse nous délivrer de M. Thiers. " M. Molé renonce à l'Empire comme il a renoncé à la fusion. Il renonce même à la Présidence à vie ou décennale. Il faut rester dans la Constitution. Mais quand on en viendra à l'élection d'un président, dans trois ans, il faut que le peuple réélise Louis Napoléon malgré la Constitution qui le défend. Le peuple seul est au-dessus de la Constitution, et peut la violer s'il veut. Tout le monde se soumettra alors. C’est avec cette perspective que M. Molé tâche de calmer un peu les amis impatients du président ; et de gagner du temps, sa seule politique au milieu de toutes les impossibilités d’aujourd’hui.
J'ai vu un Belge intelligent, et fort au courant de son pays et de sa cour. Le Roi Léopold assuré et tranquille mais supportant avec humeur, quoique patiemment, le joug de son cabinet actuel, les Barrot et les Dufaure de Bruxelles, qui ne lui épargnent pas les impertinences et les désagréments. Onze heures Votre lettre confirme celle d’hier. Vous n'êtes pas mal, et vous verrez de temps en temps M. Guéneau de Mussy. Adieu Dearest, à demain la conversation. La cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu. G. Vous vous trompez sur le sentiment qui fait dire au Duc de Broglie ce qu'il vous dit. Peu importe du reste. Adieu encore et toujours.
7 heures
J’ai été bien heureux hier tout le jour. Je crois que mes hôtes m'ont trouvé bien gai. Comme notre âme tombe tout entière sous le joug de son impression du moment. Vous savoir un peu tranquille et être moi-même un peu tranquille, sur votre compte, me suffisait. J'étais presque content comme si vous aviez été là. Ce n’est pas vrai.
J’ai sous les yeux une image de l’extrême éparpillement et dispersion des esprits en France. Mes deux hôtes au fond, pensent et veulent tous deux la même chose; ce sont deux hommes du même parti, et deux hommes d’esprits. L’un croit au retour de la Monarchie pure, l'autre croit au succès définitif tant bien que mal de la République. L'avenir est si obscur et si incertain que des yeux qui y cherchent, et y souhaitent la même chose y voient. des choses contraires. Cela fait peur pour notre destinée et pitié pour l’esprit humain. Tous deux sont fort tristes et inquiets, à cause de la bêtise et de la platitude universelles. Un garde national de Paris disait le 25 février 1848, en criant contre les ouvriers, la populace et l’anarchie : " Puisqu'on leur livre tout, qu’ils nous laissent tranquilles. " Le pays livre soit tout volontiers, l’avenir comme le passé, pourvu qu’on le laissât tranquille. Heureusement que le bon Dieu ne se contente pas à si bon marché que les hommes ; et me permet pas qu’ils soient tranquilles à tout prix. Le Cabinet actuel moins près de tomber qu'on ne le croit. Dufaure et Tocqueville, ses vrais chefs, charmés du régime actuel, comme des acteurs d'une ville de province appelés à jouer sur le théâtre de Paris, et décidés à s'y maintenir. Sincèrement attachés à la République et à la Constitution, et se flattant qu'ils y contiendront le Président. Plus ennemis de Thiers que jamais. Tocqueville a dit à M. de Lavergne : " Il faut que M. Guizot entre dans l'Assemblée ; il n’y a que lui qui puisse nous délivrer de M. Thiers. " M. Molé renonce à l'Empire comme il a renoncé à la fusion. Il renonce même à la Présidence à vie ou décennale. Il faut rester dans la Constitution. Mais quand on en viendra à l'élection d'un président, dans trois ans, il faut que le peuple réélise Louis Napoléon malgré la Constitution qui le défend. Le peuple seul est au-dessus de la Constitution, et peut la violer s'il veut. Tout le monde se soumettra alors. C’est avec cette perspective que M. Molé tâche de calmer un peu les amis impatients du président ; et de gagner du temps, sa seule politique au milieu de toutes les impossibilités d’aujourd’hui.
J'ai vu un Belge intelligent, et fort au courant de son pays et de sa cour. Le Roi Léopold assuré et tranquille mais supportant avec humeur, quoique patiemment, le joug de son cabinet actuel, les Barrot et les Dufaure de Bruxelles, qui ne lui épargnent pas les impertinences et les désagréments. Onze heures Votre lettre confirme celle d’hier. Vous n'êtes pas mal, et vous verrez de temps en temps M. Guéneau de Mussy. Adieu Dearest, à demain la conversation. La cloche du déjeuner sonne. Adieu. Adieu. G. Vous vous trompez sur le sentiment qui fait dire au Duc de Broglie ce qu'il vous dit. Peu importe du reste. Adieu encore et toujours.
Val-Richer, Lundi 30 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Lundi 30 Juillet 1849
8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai très bien dormi, quoique réveillé par le bruit de la pluie, point d’orage, mais des ondées fréquentes et violentes. Les agriculteurs ne s'en plaignent pas. Moi je trouve que cela me gâte mes allées et mes fleurs, sans compter mon goût pour le beau temps et le soleil. Les petits intérêts et les petits plaisirs de la vie ont cela de singulier qu'on les sent et qu’on sent en même temps leur petitesse. Je m'occupe et je jouis de ce qui se passe dans ma maison et dans mon jardin, mais sans la moindre illusion sur le peu que cela me fait. Toutes les petites pièces ont beau être remplies. Les grandes, ou la grande, n'en restent pas moins vides. C'est comme si on ne vivait qu'à la peau. Je bois des eaux de Vichy. Je me suis senti quelques velléités de calculs biliaires. Deux verres d’eau de Vichy par jour m’en débarrasseront. C'étaient des velléités lointaines et sourdes. Dans les trois ou quatre premiers jours de mon arrivée, j'ai eu aussi un peu d’émotion dans les entrailles, un certain sentiment d'une influence atmosphérique différente. J'ai été très attentif dans mon régime de nourriture. Il n'en est plus question du tout. Je me porte très bien.
Je suis jour par jour dans le Galignani, la marche du choléra à Londres et en Angleterre. On ne cite jusqu'ici, à peu près point de noms. Je vous demande positivement, instamment en grâce, pour peu que vous vous sentiez indisposée d'envoyer chercher M. Guéneau de Mussy (26 Maddox-Street. Regent street) Vous le croirez ou vous ne le croirez pas vous lui obéirez ou vous ne lui obéirez pas mais voyez-le et entendez le en même temps que vos médecins anglais. Je le crois un excellent médecin, et je suis sûr que l'homme ne vous dégoûtera pas du médecin.
Curieux spectacle que ce mouvement d'opinion en Angleterre, en faveur des Hongrois. Mouvement naturel, car les Anglais, sont toujours portés à prendre intérêt aux causes libérales. Et factice car ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit en Hongrie ni si c’est vraiment une cause libérale ; ils sont remués aveuglément par quelques mots, et par quelques hommes qui n’en savent pas plus qu'eux, ou qui veulent tout autre chose qu'eux. Il y a bien des manières d'être un peuple d’enfant. Et tout cela est l'ouvrage de Lord Palmerston et de la Chambre des communes. Si la politique de Lord Palmerston était bonne ou si la vérité avait été dite dans la Chambre des Communes, la nation anglaise penserait et sentirait autrement. Quand l'Angleterre juge ou agit mal, ce sont toujours les chefs qui sont coupables car elle a assez de bon sens et d’honnêteté pour juger et agir bien si ses chefs lui montraient la voie. Mais elle n’en a pas assez pour trouver à elle seule la vraie voie, et pour y faire marcher ses chefs, surtout en matière d'affaires étrangères, qu’elle voit de si loin et dont au fond, elle se soucie si peu.
Onze heures
Quelle désolation! J'avais le présentiment que la lettre d’aujourd’hui me désolerait. Et je n'en aurais pas demain ! Mais je ne ne pardonne pas de penser à moi. C’est de vous qu’il s’agit, si vous pouviez être un peu moins troublée ! Si je pouvais vous envoyer, vous apporter un peu de calme et de courage ! Je suis disposé à approuver Brighton. Avez-vous quelque nouvelle de ce qui s’y passe en fait de choléra ? Si le mal se répand et augmente, quittez l’Angleterre. Il n’y en a presque plus en France. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il va souvent à St. Léonard, mais il n’y habite point. Il est de bon conseil, et même de ressource au besoin. Que je voudrais être à après-demain. Adieu. Adieu. Dearest, si j'étais là, vous auriez moins peur. G.
8 heures et demie
Je me lève tard. J’ai très bien dormi, quoique réveillé par le bruit de la pluie, point d’orage, mais des ondées fréquentes et violentes. Les agriculteurs ne s'en plaignent pas. Moi je trouve que cela me gâte mes allées et mes fleurs, sans compter mon goût pour le beau temps et le soleil. Les petits intérêts et les petits plaisirs de la vie ont cela de singulier qu'on les sent et qu’on sent en même temps leur petitesse. Je m'occupe et je jouis de ce qui se passe dans ma maison et dans mon jardin, mais sans la moindre illusion sur le peu que cela me fait. Toutes les petites pièces ont beau être remplies. Les grandes, ou la grande, n'en restent pas moins vides. C'est comme si on ne vivait qu'à la peau. Je bois des eaux de Vichy. Je me suis senti quelques velléités de calculs biliaires. Deux verres d’eau de Vichy par jour m’en débarrasseront. C'étaient des velléités lointaines et sourdes. Dans les trois ou quatre premiers jours de mon arrivée, j'ai eu aussi un peu d’émotion dans les entrailles, un certain sentiment d'une influence atmosphérique différente. J'ai été très attentif dans mon régime de nourriture. Il n'en est plus question du tout. Je me porte très bien.
Je suis jour par jour dans le Galignani, la marche du choléra à Londres et en Angleterre. On ne cite jusqu'ici, à peu près point de noms. Je vous demande positivement, instamment en grâce, pour peu que vous vous sentiez indisposée d'envoyer chercher M. Guéneau de Mussy (26 Maddox-Street. Regent street) Vous le croirez ou vous ne le croirez pas vous lui obéirez ou vous ne lui obéirez pas mais voyez-le et entendez le en même temps que vos médecins anglais. Je le crois un excellent médecin, et je suis sûr que l'homme ne vous dégoûtera pas du médecin.
Curieux spectacle que ce mouvement d'opinion en Angleterre, en faveur des Hongrois. Mouvement naturel, car les Anglais, sont toujours portés à prendre intérêt aux causes libérales. Et factice car ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit en Hongrie ni si c’est vraiment une cause libérale ; ils sont remués aveuglément par quelques mots, et par quelques hommes qui n’en savent pas plus qu'eux, ou qui veulent tout autre chose qu'eux. Il y a bien des manières d'être un peuple d’enfant. Et tout cela est l'ouvrage de Lord Palmerston et de la Chambre des communes. Si la politique de Lord Palmerston était bonne ou si la vérité avait été dite dans la Chambre des Communes, la nation anglaise penserait et sentirait autrement. Quand l'Angleterre juge ou agit mal, ce sont toujours les chefs qui sont coupables car elle a assez de bon sens et d’honnêteté pour juger et agir bien si ses chefs lui montraient la voie. Mais elle n’en a pas assez pour trouver à elle seule la vraie voie, et pour y faire marcher ses chefs, surtout en matière d'affaires étrangères, qu’elle voit de si loin et dont au fond, elle se soucie si peu.
Onze heures
Quelle désolation! J'avais le présentiment que la lettre d’aujourd’hui me désolerait. Et je n'en aurais pas demain ! Mais je ne ne pardonne pas de penser à moi. C’est de vous qu’il s’agit, si vous pouviez être un peu moins troublée ! Si je pouvais vous envoyer, vous apporter un peu de calme et de courage ! Je suis disposé à approuver Brighton. Avez-vous quelque nouvelle de ce qui s’y passe en fait de choléra ? Si le mal se répand et augmente, quittez l’Angleterre. Il n’y en a presque plus en France. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il va souvent à St. Léonard, mais il n’y habite point. Il est de bon conseil, et même de ressource au besoin. Que je voudrais être à après-demain. Adieu. Adieu. Dearest, si j'étais là, vous auriez moins peur. G.
Richmond, Samedi 28 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond Star & Garter. Samedi 28 juillet 1849
Quelle journée hier, & quelle nuit. Mon Médecin est venu m'annoncer le choléra à Richmond et qu’une dame venait d'en mourir depuis une heure à côté de chez moi. Il ajoute le conseil de partir. Partir pour aller où, avec qui ? J’ai perdu la tête, mes voisines ont été bien bonnes pour moi, moi incapables de rien faire, rien décider, non de quitter sur le champs le royal Hotel. J'ai demandé un Médecin pour me conduire à Brighton. Personne ne veut quitter. J’ai écrit à M. G. de Mussy hors de Londres à St Léonard. Je demande une chambre ici. pas un coin. Me voyez- vous au milieu de tout cela ? Enfin à 10 h. du soir on me procure une chambre et rien de plus. Je n’ai pas fermé l’œil, j’ai l'air d’un revenant ce matin, Ah mon Dieu, que faire ! Horrible isolement, & impuissance de me conduire moi-même. Je vous écris ce peu de mots. Ah que votre amitié est dure dans ce moment & comme je sens que sans vous je n’ai ni protection, ni soutien. Adieu, adieu dearest adieu, quel malheur que ce diner demain, Vous attendez de mes nouvelles & moi-même. Je ne puis rien entreprendre. Adieu. Adieu. Adieu.
Quelle journée hier, & quelle nuit. Mon Médecin est venu m'annoncer le choléra à Richmond et qu’une dame venait d'en mourir depuis une heure à côté de chez moi. Il ajoute le conseil de partir. Partir pour aller où, avec qui ? J’ai perdu la tête, mes voisines ont été bien bonnes pour moi, moi incapables de rien faire, rien décider, non de quitter sur le champs le royal Hotel. J'ai demandé un Médecin pour me conduire à Brighton. Personne ne veut quitter. J’ai écrit à M. G. de Mussy hors de Londres à St Léonard. Je demande une chambre ici. pas un coin. Me voyez- vous au milieu de tout cela ? Enfin à 10 h. du soir on me procure une chambre et rien de plus. Je n’ai pas fermé l’œil, j’ai l'air d’un revenant ce matin, Ah mon Dieu, que faire ! Horrible isolement, & impuissance de me conduire moi-même. Je vous écris ce peu de mots. Ah que votre amitié est dure dans ce moment & comme je sens que sans vous je n’ai ni protection, ni soutien. Adieu, adieu dearest adieu, quel malheur que ce diner demain, Vous attendez de mes nouvelles & moi-même. Je ne puis rien entreprendre. Adieu. Adieu. Adieu.
Richmond, Dimanche 22 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond Dimanche 22 Juillet 1849
Midi
J'ai vu hier Ellice. Il avait assisté à la séance vendredi. Brougham a été long, diffus, ennuyeux, sans effet. Le parti très mécontent de lui & disent qu’il les avait rendus à la Mallet, Aberdeen excellent, et Stanley encore plus, mais celui ci n’a commencé son discours qu’à 3 h. du matin ; les amis avaient sommeil, quelques uns sont partis, c'est ainsi que la minorité a été diminuée. En attendant le chiffre 12 a comblé de joie le ministère. Aberdeen a dit des vérités très dures. En parlant de Palmerston il a dit insanity, de Minto playing antics with [?] & & Je cherche en vain dans le Times ce qu'il a dit de vous. Je l'ai là dans le Chronicle. Ellice m’a dit qu'il a entendu ce passage, grand éloge. Il faut que je le trouve et vous l’envoie. On dit que Minto a été misérable, si misérable qu'on en était honteux pour lui.
Voilà donc le Pape proclamé. Et bien cette expédition tant critiquée et avec quelque raison, a un très beau dénouement. Et Oudinot doit être content. Tous les orateurs à la Chambre haute l'ont comblé de courage. Ce qui viendra après ? Dieu sait.
De Londres je n’ai vu qu’Ellice. Hier Madame Delmas est venue. J’ai été voir Mad. de Metternich. Elle est changée, ses cheveux sont même fort gris, elle est triste, quoique le mari soit très bien ; mais ils ne savent où aller. Ils finissent l’Angleterre, elle est trop chère. Bruxelles, mais c’est bien ennuyeux Je crois presque qu'ils se décident pour Paris au mois d'octobre. Ils essaieront au moins pendant quelques mois. J'ai été le soir chez Beauvale, avec mon Ellice. J’ai joué un peu de piano, et puis un peu Whist. A 10 heures dans mon lit. Voilà ce triste dimanche, sorte d’anticipation du tombeau. Dieu que cela est triste aujourd’hui. Il y a huit jours je vous attendais ! Ah que de bons moments finis ! Je me fais une grande pitié car je suis bien à plaindre.
J'écris aujourd’hui à Albrecht pour quelques arrangements, pas grand chose. Je vous en prie ne vous promener pas seul dans vos bois. J’ai mille terreurs pour vous. Je vous envoie cette lettre aujourd’hui. Vous me direz si elle vous arrive avant celle de Lundi ou en même temps. Dans ce dernier cas je ne ferais qu’une enveloppe pour les deux jours, à l’avenir. Car je vous promets bien une lettre tous les jours. Adieu. Adieu. Toujours ce fauteuil devant moi et vide. Comme c’est plus triste de rester que de partir. Adieu. Adieu mille fois et tendrement adieu.
5 heures dimanche. Flahaut sort de chez moi dans ce moment. Il me dit qu’à Carlton Gardens on est triomphant ; il y avait soirée hier après le dîner pour M. Drouin de Lhuys. Triomphe complet. Lord Palmerston s’était fait interpeller hier à le Chambre des Communes. Il a parlé de tout, de ses vœux pour les Hongrois ! De ses adversaires personnels, il a apellé Lord Aberdeen that antiquated imbecility. Cela vaut les gros mots de Mme de Metternich. J’ajoute ces sottises, pour avoir le prétexte de vous dire encore adieu.
Midi
J'ai vu hier Ellice. Il avait assisté à la séance vendredi. Brougham a été long, diffus, ennuyeux, sans effet. Le parti très mécontent de lui & disent qu’il les avait rendus à la Mallet, Aberdeen excellent, et Stanley encore plus, mais celui ci n’a commencé son discours qu’à 3 h. du matin ; les amis avaient sommeil, quelques uns sont partis, c'est ainsi que la minorité a été diminuée. En attendant le chiffre 12 a comblé de joie le ministère. Aberdeen a dit des vérités très dures. En parlant de Palmerston il a dit insanity, de Minto playing antics with [?] & & Je cherche en vain dans le Times ce qu'il a dit de vous. Je l'ai là dans le Chronicle. Ellice m’a dit qu'il a entendu ce passage, grand éloge. Il faut que je le trouve et vous l’envoie. On dit que Minto a été misérable, si misérable qu'on en était honteux pour lui.
Voilà donc le Pape proclamé. Et bien cette expédition tant critiquée et avec quelque raison, a un très beau dénouement. Et Oudinot doit être content. Tous les orateurs à la Chambre haute l'ont comblé de courage. Ce qui viendra après ? Dieu sait.
De Londres je n’ai vu qu’Ellice. Hier Madame Delmas est venue. J’ai été voir Mad. de Metternich. Elle est changée, ses cheveux sont même fort gris, elle est triste, quoique le mari soit très bien ; mais ils ne savent où aller. Ils finissent l’Angleterre, elle est trop chère. Bruxelles, mais c’est bien ennuyeux Je crois presque qu'ils se décident pour Paris au mois d'octobre. Ils essaieront au moins pendant quelques mois. J'ai été le soir chez Beauvale, avec mon Ellice. J’ai joué un peu de piano, et puis un peu Whist. A 10 heures dans mon lit. Voilà ce triste dimanche, sorte d’anticipation du tombeau. Dieu que cela est triste aujourd’hui. Il y a huit jours je vous attendais ! Ah que de bons moments finis ! Je me fais une grande pitié car je suis bien à plaindre.
J'écris aujourd’hui à Albrecht pour quelques arrangements, pas grand chose. Je vous en prie ne vous promener pas seul dans vos bois. J’ai mille terreurs pour vous. Je vous envoie cette lettre aujourd’hui. Vous me direz si elle vous arrive avant celle de Lundi ou en même temps. Dans ce dernier cas je ne ferais qu’une enveloppe pour les deux jours, à l’avenir. Car je vous promets bien une lettre tous les jours. Adieu. Adieu. Toujours ce fauteuil devant moi et vide. Comme c’est plus triste de rester que de partir. Adieu. Adieu mille fois et tendrement adieu.
5 heures dimanche. Flahaut sort de chez moi dans ce moment. Il me dit qu’à Carlton Gardens on est triomphant ; il y avait soirée hier après le dîner pour M. Drouin de Lhuys. Triomphe complet. Lord Palmerston s’était fait interpeller hier à le Chambre des Communes. Il a parlé de tout, de ses vœux pour les Hongrois ! De ses adversaires personnels, il a apellé Lord Aberdeen that antiquated imbecility. Cela vaut les gros mots de Mme de Metternich. J’ajoute ces sottises, pour avoir le prétexte de vous dire encore adieu.
Val-Richer, Dimanche 22 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer. Dimanche 22 Juillet 1849 7 heures
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Je n'aurai le cœur un peu à l'aise que lorsque nous nous serons mutuellement répondu à notre première lettre. Il me semble qu'alors la séparation sera un peu moindre. Vous avez raison ; je suis plus heureux que vous ; j'ai des ressources et des plaisirs qui vous manquent. Aussi je n'en jouis qu'avec un certain sentiment de remords. Mes plaisirs me rappellent à vous comme mes privations. Je viens de me lever. Il fait un temps admirable, l’air est doux et vif, le bleu du ciel aussi pur et aussi brillant que le vert de mes bois. Le climat est réellement bien différent. Je voudrais vous envoyer mon soleil à Richmond. Bien mieux, vous amener, vous, sous mon soleil. Vous y viendrez, soignez-vous bien d’ici là, c'est ma préoccupation de tous les moments.
Les visites commencent bien vite. J’en ai déjà eu quatre hier. De braves gens du pays de ceux qui m’ont été fidèles, et qui restent indignes contre ceux qui ne l'ont pas été. Je leur dis qu’ils ont raison d'être indignes, et je suis plus indulgent qu'eux. Je traiterai mal un très petit nombre d'infidèles, deux ou trois, les plus scandaleux. Amnistie pleine et entière pour tous les autres. La bonne politique est partout la même. Ne trouvez-vous pas que j'ai l’air d’un souverain restauré ? C’est un peu prompt. J'en suis fort loin ; personne n'en est plus convaincu que moi. Mais je suis décidé à prendre mes avantages c'est-a-dire l'attitude d’un homme envers qui on a eu tort, et qui n'a eu tort envers personne. C’est la visite et je crois qu’elle me réussira.
9 heures
Béhier vient de m’arriver. Vous avez lu ses lettres. Il connait bien Paris et comprend bien ma situation. Rien de nouveau dans ce qu’il me dit. Tout confirme ce que nous pensons. Du temps et de l’immobilité, à ces deux conditions, la rivière coule de mon côté. A Paris, impossibilité pour le commerce, et le crédit de se relever. Détresse croissante, après la victoire. On a commencé par s'en étonner. On commence à se l’expliquer. Mais le président est fort loin d'être épuisé comme espérance. On tournera et retournera, en tous sens cette combinaison pour essayer d'en faire sortir un gouvernement. Presque plus de choléra. Moins aujourd’hui qu'à Londres. Il a été affreux pendant cinq jours. La forte chaleur semblait un ennemi acharné à la poursuite de tout le monde. Adieu. Je vais faire ma toilette. Je vous reviendrai après la poste. Merci des détails de votre lettre de jeudi. Je sais très bien comment s’est passée votre journée.
Onze heures
Voilà votre lettre de Vendredi. Votre préoccupation du choléra me désole. Non que je vous veuille insouciante à cet égard. Vous ne sauriez prendre trop de précautions. Béhier me disait tout à l’heure que bien peu de personnes avaient été attaquées sans quelque imprudence positive et constatée. C’est un mal qui atteint rarement, très rarement ceux qui le repoussent d'avance par un régime bon et soutenu et constant. A cela la peur est utile. Gardez donc la vôtre dans cette mesure. Et puis n’oubliez pas ce que vous m’avez promis. Si le mal s’aggravait à Londres, ou si votre peur devenait un vrai mal, n’hésitez pas, partez. Il n’y a réellement plus rien à Paris. Dans l’hôpital où est Béhier, pas un seul cas depuis plusieurs jours. Je ferme une lettre avant d'avoir ouvert mes journaux. Il m'en est arrivé un paquet. L’article des Débats sur le grand duché de Bade était très bon en effet. Je ne crois pas que la Prusse ose. Adieu. Adieu.
Pas une des minutes que nous avons passées ensemble dans ces derniers jours ne me sort de la mémoire. Toutes charmantes. Adieu. Adieu, demain sera un mauvais jour. Vous aurez été un jour sans lettre de moi. Je n’ai pas pu l’éviter. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Vendredi 20 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 19 Juillet - 14 novembre ) : François de retour en France, analyste ou acteur politique ?
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Val Richer, Vendredi 20 Juillet 1849
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
2 heures
J'arrive. Point de lettre de Richmond. Ce n’est pas encore une inquiétude ; mais c’est un mécompte. Je suis sûr que le retard n’est pas de votre fait. Quelque curieux probablement. On me dit qu’il faut prendre garde au nouveau directeur de la poste de Lisieux. Je n'y prendrai point garde. On lira mes lettres si on veut. On y trouvera peut-être quelque amusement, peut-être même quelque profit. On n’y trouvera rien que je sois bien fâché qu’on ait lu. Si j’avais quelque chose à vous dire que je tinsse vraiment à cacher, je saurais bien vous le faire arriver autrement que par la poste. Faites comme moi. Ne nous gênons pas en nous écrivant. Nous n'avons aucune raison pour nous gêner, et nous avons assez d’esprit pour nous ingénier, si nous en avions besoin. Les gens d’esprit sont toujours infiniment plus francs et plus cachés que ne croient les sots.
J’ai passé ce matin du Havre à Honfleur, par une mer encore grosse. J’ai trouvé à Honfleur la calèche qui m’attendait, et je suis venu ici en quatre heures à travers la pluie sans cesse traversée par le soleil.
Ma maison et mon jardin sont en bon état, comme si j’en étais sorti hier. Des fleurs dans le salon, et dans la bibliothèque ; mes journaux sur mon bureau, les allées nettoyées les parquets frottés. Cela m’a plu et déplu. Tant de choses m'ont rempli l'âme depuis que je ne suis venu ici ; je ne puis me figurer qu’elles n'aient laissé ici aucune trace. Et puis cette tranquillité tout autour de moi, cette non interruption du passé et de ses habitudes, cela me plaît, et même me touche, car je le dois aux soins affectueux de deux ou trois personnes, amis ou serviteurs, qui ont pris plaisir à tout conserver ou remettre en ordre, et qui m’attendaient à la porte. J’ai rencontré beaucoup d'affection en ma vie ; je voudrais en être assez reconnaissant.
Je me suis vanté trop tôt hier en vous disant que je n’avais rencontré dans l’accueil du Havre rien d’agréable, ni de désagréable, de la déférence dans l’indifférence. Cela a un peu changé deux heures aprés. Cinquante ou soixante gamins se sont réunis sous les fenêtres de l’auberge où je dînais, et se sont mis à crier : « à bas Guizot ! » et à siffler. Cinquante à soixante curieux ou plutôt. curieuses se sont attroupés autour d’eux. Pas l’ombre de colère ni de menace ; une curiosité mécontente de ce que je ne paraissais pas entendre les cris, et une petite démonstration malveillante organisée par le journal rouge de la ville qui l’avait annoncée le matin en annonçant mon arrivée. J'ai dîné tranquillement au bruit de ce concert, et je suis descendu dans la rue pour monter dans la voiture qui devait me reconduire à l’auberge où je couchais. J’ai trouvé autour de la voiture une douzaine de gentlemen qui en écartant les gamins, l’un m’a dit d’un très bon air : " M. Guizot, nous serions désolés que vous prissiez ce tapage pour le sentiment de la population de notre ville ; ce sont des polissons ameutés par quelques coquins. Non seulement nous vous respectons tous ; mais nous sommes charmés de vous voir de retour et nous espérons bien vous revoir bientôt où vous devez être. " Et ses compagnons m’ont tous serré la main. Les gamins étaient là, et se taisaient. Je suis rentré chez moi, et une demi-heure après, j’y ai vu arriver ce Monsieur qui parlait bien avec cinq autres, qui venaient me renouveler leur excuses pour la rue et leurs déclarations pour eux-mêmes. L’un était le colonel de la garde nationale du Havre, l'autre le capitaine des sapeurs pompiers, deux commissaires de police de la ville et deux négociants. C'était une petite représentation de l'état du pays, les polissons aux prises avec les honnêtes gens, les vestes avec les habits. Et moi entr’eux. Cela n’avait pas la moindre gravité en soi, beaucoup comme symptôme. Rien n’est changé et je ne suis point oublié. Ce matin, sur le bateau du Havre à Honfleur, les gentlemen étaient en grande majorité et m'ont fait fête. On parlait du tapage d’hier soir. J’ai dit que j’avais trouvé au Havre des gamins et des amis. Quelqu’un m’a dit : " C'est comme partout, Monsieur ; mais soyez sûr que les amis dominaient. " A Honfleur, première ville du Calvados, plus de partage ; on est venu me voir dans le salon de l’auberge où je me suis arrêté un quart d’heure, et on a crié : " Vive Guizot ! " dans la rue quand je suis monté en voiture. Ce pays-ci est bien animé, et bien prompt à saisir les occasions de le montrer. Je n’en suis que plus décidé à rester bien tranquille chez moi. Il n’y a absolument rien de bon à faire, et ma position est bonne pour attendre.
J’ai eu au Havre d’autres visites encore Poggenpoll et Tolstoy. Poggenpol est la première personne qui soit entrée chez moi et avec un empressement, un air de plaisir à me revoir que je n'avais pas droit d'attendre. Tolstoy est venu le soir ; il était là pendant la visite des gentlemen amis. Il se trouve très bien à Ingouville, et compte y rester jusqu'à la fin de novembre. Très affectueux et vraiment très bon. Ses enfants sont à merveille. Je lui ai donné vos nouvelles de Pétersbourg et de Hongrie. A demain quelque chose de mes conversations avec les visiteurs de Paris.
Samedi 21, 9 heures
J’ai très bien dormi. J'en avais besoin. Mes bois et mes près sont vraiment bien jolis. Que n'êtes-vous là ? Je viens de relire encore votre lettre de mercredi, si tendre. Je compte bien en avoir une ce matin qui vaudra peut-être celle de Mercredi, mais pas mieux.
Je reviens aux visiteurs de Paris. Les deux principaux décidément très favorables au Président. On ne dit rien de l'avenir. Personne n'en peut rien prévoir, et n'y peut rien faire aujourd'hui. Pour le présent, et pour un présent indéfini, le président est à la fois unique et bon, seul possible pour l’ordre et vraiment dévoué à l’ordre. Point faiseur, point vain, silencieux, autant par bon sens que par peu d’invention et d'abondance d’esprit, entêté, fidèle, très courageux, ayant foi en sa cause et en son droit étranger en France, un vrai Prince Allemand. Partout les honnêtes gens se rallient à lui, et prennent confiance en lui. Mais ils n'en ont pas plus de confiance dans l'ensemble des choses et dans le régime actuel. Régime impossible et qui empêche qu'aucune prospérité, aucune sécurité, aucun crédit, aucun avenir ne recommence. Rien ne recommence en effet. En toutes choses chaque jour, on fait tout juste le nécessaire. Une société ne vit pas de cela. Il faut sortir de cet état. Quand ? Comment ? Le probable aux yeux de la raison, c'est qu’on ira comme on est jusqu'aux approches, des deux élections de l'Assemblée et du Président, et qu'alors on prendra son parti, un parti inconnu, plutôt que de subir une nouvelle épreuve du suffrage universel. Mais ce n'est pas là le probable en fait. Les choses vont plus vite dans le pays-ci. La souffrance, l’impatience et la défiance sont trop grandes. Il arrivera quelque incident qui déterminera quelque acte décisif. Peut-être une prolongation pour dix ans de la présidence, et une refonte de la constitution. Deux choses seulement peuvent être à peu près affirmées ; que la phase actuelle, la phase présidentielle n’est pas près de finir, et qu’elle ne restera pas comme elle est aujourd’hui. Ceci vous conviendra assez ; ce n'est pas bien loin de votre prévoyance, en voyant de loin.
L'impression générale de mes visiteurs surtout du Duc de Broglie toujours très sombre. Moins sombre pourtant au fond de son âme que dans ses paroles. Je reviendrai sur les détails, et sur les autres dires. J’ai trois ou quatre lettres d'affaires à écrire et le facteur qui va arriver ne m'attendra pas tout le jour, si je veux, comme jadis. Cependant il est convenu qu'il attendra une heure chez moi. Cela me suffit. Adieu. Adieu.
Je vous dirai encore un mot, quand j'aurai votre lettre.
Dix heures et demie Voilà votre lettre de jeudi bien bonne, bien douce. Mais, pour Dieu, ne soyez pas malade. C’est à quoi je pense sans cesse. A vous toujours, à vous souffrante, beaucoup trop souvent. Adieu. Adieu. A demain, hélas, seulement pour vous écrire. Adieu. G.
Richmond, Mercredi 18 juillet 1849, Dorothée de Lieven à François Guizot
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Benckendorf, Dorothée de (1785?-1857)
Richmond Mercredi 18 juillet 1849
Onze heures
Je veux encore essayer de vous faire parvenir deux mots à Londres. Cette pensée si douce que vous êtes à une heure de distance, il y faut donc renoncer. Renoncer à tant de bonheur ! Ah mon Dieu Hier mes genoux ont fléchi quand vous avez fermé la porte. Je suis restée en prières. J’ai tant prié, et toujours une seule & même prière. Je n’ai pas pleuré. Le moment même d'un grand chagrin me trouve sans larmes. C'est de l’étonne ment. Tout est suspendu en moi. Je me suis mise à la fenêtre, presque sans pensée. Je ne sais ce que j’ai fait ensuite. Je me suis couchée. J’ai dormi un peu, pas beaucoup et je me lève, la désolation dans l'âme !
Une lettre de Constantin de Berlin. L’Empereur est parti subitement de Varsovie pour aller surprendre l'Impératrice le jour de sa fête le 13. Il ne devait passer à Pétersbourg que deux ou 3 jours. Un moment de halte dans les opérations. On veut toucher en masse sur l’armée véritable des rebelles. Tout est calculé. On ne doute de rien, et dans 15 jours ou 3 semaines l’affaire de la Hongrie sera terminée. A Berlin, grand changement dans les esprit même les plus sages. L’unité, l’unité au profit de la Prusse ; les succès dans le Palatinat & dans le grand-duché de Bade ont tourné toutes les têtes. grande haine contre l’Autriche, mille soupçons. Le roi, la reine & une partie du ministère résistent seuls à cet entrainement. Mais la bourrasque est bien forte. Prokesh et Bernstorff sont incapables de rien arranger. Il faut changer ces deux instruments. L’armistice avec le Danemark mécontente beaucoup les Allemands. Enfin beaucoup de fronde à Berlin.
Adieu. Adieu, cher bien aimé, adieu. Voici les larmes. Je m’arrête. Adieu. Dites un mot, pour que je sache que vous avez reçu cette lettre. Voilà du vent. J’ai peur pour cette nuit. Passez-vous sur un bâtiment anglais ou français ? Je ferme ma lettre à 2 1/2. Je l'adresse chez Duchâtel. C’est plus sûr. Mon messager reviendra de la directement. Adieu. Adieu, mille fois. Mon cœur se brise. Adieu.
Onze heures
Je veux encore essayer de vous faire parvenir deux mots à Londres. Cette pensée si douce que vous êtes à une heure de distance, il y faut donc renoncer. Renoncer à tant de bonheur ! Ah mon Dieu Hier mes genoux ont fléchi quand vous avez fermé la porte. Je suis restée en prières. J’ai tant prié, et toujours une seule & même prière. Je n’ai pas pleuré. Le moment même d'un grand chagrin me trouve sans larmes. C'est de l’étonne ment. Tout est suspendu en moi. Je me suis mise à la fenêtre, presque sans pensée. Je ne sais ce que j’ai fait ensuite. Je me suis couchée. J’ai dormi un peu, pas beaucoup et je me lève, la désolation dans l'âme !
Une lettre de Constantin de Berlin. L’Empereur est parti subitement de Varsovie pour aller surprendre l'Impératrice le jour de sa fête le 13. Il ne devait passer à Pétersbourg que deux ou 3 jours. Un moment de halte dans les opérations. On veut toucher en masse sur l’armée véritable des rebelles. Tout est calculé. On ne doute de rien, et dans 15 jours ou 3 semaines l’affaire de la Hongrie sera terminée. A Berlin, grand changement dans les esprit même les plus sages. L’unité, l’unité au profit de la Prusse ; les succès dans le Palatinat & dans le grand-duché de Bade ont tourné toutes les têtes. grande haine contre l’Autriche, mille soupçons. Le roi, la reine & une partie du ministère résistent seuls à cet entrainement. Mais la bourrasque est bien forte. Prokesh et Bernstorff sont incapables de rien arranger. Il faut changer ces deux instruments. L’armistice avec le Danemark mécontente beaucoup les Allemands. Enfin beaucoup de fronde à Berlin.
Adieu. Adieu, cher bien aimé, adieu. Voici les larmes. Je m’arrête. Adieu. Dites un mot, pour que je sache que vous avez reçu cette lettre. Voilà du vent. J’ai peur pour cette nuit. Passez-vous sur un bâtiment anglais ou français ? Je ferme ma lettre à 2 1/2. Je l'adresse chez Duchâtel. C’est plus sûr. Mon messager reviendra de la directement. Adieu. Adieu, mille fois. Mon cœur se brise. Adieu.
Brompton, Lundi 16 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton Lundi 16 Juillet 1849
Une heure
Je fais mes affaires, je vais et viens dans la maison avec un poids sur le cœur. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin. C'est le commencement de l’épreuve. Et ce sera bien pis quand je ne pourrai plus me dire demain. Au nom de Dieu portez-vous bien. Je le lui demanderai vingt fois par jour. Portez-vous bien et n'ayez pas trop peur quand vous n'êtes pas tout-à-fait bien. La peur est mal saine.
Je viens de voir des nouvelles de Rome. D'accord avec ce que Lord John vous disait hier et ce que disent aujourd’hui les journaux. La situation de l’armée française est là très tendue. Les mesures de police qu’on prend l'indiquent assez. Je persiste à croire qu'on aura la manche très large avec le Pape, et qu’on s’en ira bientôt. La seule chose difficile, et indispensable, ce sera d'assumer la sureté du Pape quand on sera parti. On me répète quel y aura encore un incendie en Piémont, que la leçon n’y est pas suffisante et que l’Autriche sera de nouveau appelée là.
M. Gueneau de Mussy, que je viens de voir, dit que le Choléra ne s'étend pas à Londres et qu’il ne paraît qu’on ait grand chose à en redouter. Les prophéties des médecins valent-elles mieux que celles des politiques ? Je me suis fait dire les précautions à prendre, les premiers remèdes à employer. Je vous en parlerai demain. Pour ma seule satisfaction j’en suis convaincu. Vous êtes délicate mais saine et attentive sur votre manière de vivre. La chaleur diminue. On dit que c'est bon. Je n'espère guères pouvoir être à Richmond demain avant 4 heures. J’ai mille petites affaires. Je partirais par le train de 3h 25 m. qui arrive à 4 h. Vous me direz, en m'écrivant aujourd’hui, si vous avez pu sortir. Adieu. Adieu. Quand retrouverons-nous le vrai et charmant adieu ? G.
Une heure
Je fais mes affaires, je vais et viens dans la maison avec un poids sur le cœur. Je ne sais pas comment vous êtes ce matin. C'est le commencement de l’épreuve. Et ce sera bien pis quand je ne pourrai plus me dire demain. Au nom de Dieu portez-vous bien. Je le lui demanderai vingt fois par jour. Portez-vous bien et n'ayez pas trop peur quand vous n'êtes pas tout-à-fait bien. La peur est mal saine.
Je viens de voir des nouvelles de Rome. D'accord avec ce que Lord John vous disait hier et ce que disent aujourd’hui les journaux. La situation de l’armée française est là très tendue. Les mesures de police qu’on prend l'indiquent assez. Je persiste à croire qu'on aura la manche très large avec le Pape, et qu’on s’en ira bientôt. La seule chose difficile, et indispensable, ce sera d'assumer la sureté du Pape quand on sera parti. On me répète quel y aura encore un incendie en Piémont, que la leçon n’y est pas suffisante et que l’Autriche sera de nouveau appelée là.
M. Gueneau de Mussy, que je viens de voir, dit que le Choléra ne s'étend pas à Londres et qu’il ne paraît qu’on ait grand chose à en redouter. Les prophéties des médecins valent-elles mieux que celles des politiques ? Je me suis fait dire les précautions à prendre, les premiers remèdes à employer. Je vous en parlerai demain. Pour ma seule satisfaction j’en suis convaincu. Vous êtes délicate mais saine et attentive sur votre manière de vivre. La chaleur diminue. On dit que c'est bon. Je n'espère guères pouvoir être à Richmond demain avant 4 heures. J’ai mille petites affaires. Je partirais par le train de 3h 25 m. qui arrive à 4 h. Vous me direz, en m'écrivant aujourd’hui, si vous avez pu sortir. Adieu. Adieu. Quand retrouverons-nous le vrai et charmant adieu ? G.
Brompton, Samedi 14 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton, Samedi 14 Juillet 1849
2 heures
Je reviens de Kensal-Green où je suis allé dire adieu au tombeau de ma mère. Je ne regrette pas de la laisser ici, car elle-même n’a pas regretté d'y rester. Cette terre protestante, et protectrice pour moi lui plaisait comme dernière demeure. Elle me l'a positivement témoigné. Ma mère avait deux choses bien belles, et qui sont toutes deux devenues rares, de la foi et de la passion. J’ai fait mettre sur cette place une pierre, entourée d’une grille, et qui porte simplement son nom, son âge, et cette phrase de St Jean qu'elle répétait souvent : " Heureux sont dés à présent, ceux qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. "
Le Duc de Broglie m'écrit pour me demander de lui indiquer précisément quel jour, et à quelle heure j’arriverai au Havre. Il veut s’y trouver, avec Piscatory. " On a si peu de temps, dit-il, dans la maudite vie que nous menons, que peut-être ne pourrions-nous nous voir de quelque temps. " Un autre de mes amis, M. Plichon, m'écrit aussi qu’il part pour Paris afin de venir m'attendre au Havre. Je désire qu’il n’y en ait pas davantage. Je viens de voir un ancien député conservateur, M. Calmon, que je trouve excellent sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Très sensé et très fidèle. Tenant la chute de tout ceci pour certaine, mais croyant à une assez longue durée. On tombera ; on sait qu'on tombera mais comme on craint de se faire mal on chancellera longtemps. Cela me paraît dans le vrai. M. de Falloux m'écrit un billet très courtois pour me dire qu’il a fait ce que je désirais pour ma retraite de l'université. " Ce n’était pas à moi dit-il, qu’il appartenait de décerner à M. Guizot une distinction honorifique. Je dois le remercier d'avoir bien voulu ne pas tenir compte de cette méprise des circonstances." Je lui réponds : " Je vous remercie de votre courtoisie. Elle vous sied bien, et j'y comptais. Je ne sais encore à quel moment je pourrai avoir le plaisir de vous en remercier moi-même. Je compte rentrer, sous peu de jours dans mon nid du Val-Richer. Mais ce sera pour y rester avec mes enfants et mes livres. Je jouirai de l’air frais qu’on y respire et mes vœux vous suivront dans la fournaise où vous vivez. Il me semble que c’est convenable. L’air frais que je regretterai tous les jours, c’est l’air frais de la Tamise. Adieu. Adieu.
Il fait bien chaud aujourd’hui. J'espère que nous ne serez pas sortie à ces heures-ci. Rien de nouveau de Paris, vous voyez qu’Oudinot a envoyé au Pape les clés de Rome. Adieu. A demain cinq heures. Adieu. G.
2 heures
Je reviens de Kensal-Green où je suis allé dire adieu au tombeau de ma mère. Je ne regrette pas de la laisser ici, car elle-même n’a pas regretté d'y rester. Cette terre protestante, et protectrice pour moi lui plaisait comme dernière demeure. Elle me l'a positivement témoigné. Ma mère avait deux choses bien belles, et qui sont toutes deux devenues rares, de la foi et de la passion. J’ai fait mettre sur cette place une pierre, entourée d’une grille, et qui porte simplement son nom, son âge, et cette phrase de St Jean qu'elle répétait souvent : " Heureux sont dés à présent, ceux qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. "
Le Duc de Broglie m'écrit pour me demander de lui indiquer précisément quel jour, et à quelle heure j’arriverai au Havre. Il veut s’y trouver, avec Piscatory. " On a si peu de temps, dit-il, dans la maudite vie que nous menons, que peut-être ne pourrions-nous nous voir de quelque temps. " Un autre de mes amis, M. Plichon, m'écrit aussi qu’il part pour Paris afin de venir m'attendre au Havre. Je désire qu’il n’y en ait pas davantage. Je viens de voir un ancien député conservateur, M. Calmon, que je trouve excellent sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Très sensé et très fidèle. Tenant la chute de tout ceci pour certaine, mais croyant à une assez longue durée. On tombera ; on sait qu'on tombera mais comme on craint de se faire mal on chancellera longtemps. Cela me paraît dans le vrai. M. de Falloux m'écrit un billet très courtois pour me dire qu’il a fait ce que je désirais pour ma retraite de l'université. " Ce n’était pas à moi dit-il, qu’il appartenait de décerner à M. Guizot une distinction honorifique. Je dois le remercier d'avoir bien voulu ne pas tenir compte de cette méprise des circonstances." Je lui réponds : " Je vous remercie de votre courtoisie. Elle vous sied bien, et j'y comptais. Je ne sais encore à quel moment je pourrai avoir le plaisir de vous en remercier moi-même. Je compte rentrer, sous peu de jours dans mon nid du Val-Richer. Mais ce sera pour y rester avec mes enfants et mes livres. Je jouirai de l’air frais qu’on y respire et mes vœux vous suivront dans la fournaise où vous vivez. Il me semble que c’est convenable. L’air frais que je regretterai tous les jours, c’est l’air frais de la Tamise. Adieu. Adieu.
Il fait bien chaud aujourd’hui. J'espère que nous ne serez pas sortie à ces heures-ci. Rien de nouveau de Paris, vous voyez qu’Oudinot a envoyé au Pape les clés de Rome. Adieu. A demain cinq heures. Adieu. G.
Brompton, Samedi 23 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton. Samedi 23 juin 1849,
Est-ce que ce beau temps chaud vous fait mal ? J’en serais bien fâché. Je jouis du soleil et de la chaleur avec une vivacité d’enfant du midi. Il faisait pourtant trop chaud hier chez la marquise de Westminster, une vraie foule dans la galerie. La bande des Strauss, la Duchesse de Cambridge, God save the Queen. Les tableaux s'étonnaient qu’on les regardât si peu. Je n’ai pas entendu parlé là de la Duchesse de Sutherland ni de la mort de sa petite fille. On pense si peu aux morts et à la mort. C'est mon plus profond sujet de mépris contre les vivants. Personne là qui sût rien de nouveau. J’ai vu Bunsen le soir. Moins joyeux, et moins confiant. Comme Lady Palmerston plus anti- autrichien que jamais, et me faisant fort la cour pour que je sois Prussien. Très occupé de Rome. Il est établi que le Pape n’y viendra pas quand les Français y seront entrés. Quand et comment en sortiront-ils ? Le Duc de Nemours est venu me voir hier. Très amical et très sensé. On se demande évidemment un peu là pourquoi je n’y ai pas été depuis longtemps. J’irai dans les premiers jours de Juillet. Madame la Duchesse d'Orléans arrive jeudi 28. Le duc de Nemours va la chercher à Rotterdam. Elle passera à St. Léonard, tout le mois de Juillet. La Reine des Belges arrive à Londres lundi, et ira à St. Léonard quand Mad. la duchesse d'Orléans y sera arrivée. Ainsi pour un mois. Le Prince et la Princesse de Joinville ont été à Eisenach, et de là ils se promènent en Allemagne jusqu'à Munich, et ne seront de retour à St Léonard que du 8 au 12 Juillet.
2 heures
J’ai été interrompu par Vigier, et par Génie. Le dernier repart ce soir. Je suis bien aise qu’il soit venu. Il m’a remis bien au courant. Point de lettre de Paris ce matin. Vous verrez dans les Débats d’aujourd’hui la lettre financière de Dumon. Ou plutôt vous ne la verrez pas. Vous n'irez certainement pas jusqu'au bout. C’est très vrai et très bon financièrement, mais sans vigueur et sans effet politique. Je ne vous vois pas venir ce matin. J’irai dîner avec vous demain dimanche. Je suis pris toute la semaine prochaine. J'espère qu’aujourd’hui vous n'aurez pas été retenue à Richmond par votre malaise. Je dîne samedi chez Lord Aberdeen. Je crois que Duchâtel finira par aller prendre sa femme à Spa, et delà avec elle à Paris où ils ne passeront que trois ou quatre jours en traversant pour aller à Bordeaux. Il est dans tous les supplices de l'indécision. Avez-vous fait partir votre lettre à Rothschild ? Adieu. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu'à 3 heures alors je serai sûr que vous ne venez pas aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Est-ce que ce beau temps chaud vous fait mal ? J’en serais bien fâché. Je jouis du soleil et de la chaleur avec une vivacité d’enfant du midi. Il faisait pourtant trop chaud hier chez la marquise de Westminster, une vraie foule dans la galerie. La bande des Strauss, la Duchesse de Cambridge, God save the Queen. Les tableaux s'étonnaient qu’on les regardât si peu. Je n’ai pas entendu parlé là de la Duchesse de Sutherland ni de la mort de sa petite fille. On pense si peu aux morts et à la mort. C'est mon plus profond sujet de mépris contre les vivants. Personne là qui sût rien de nouveau. J’ai vu Bunsen le soir. Moins joyeux, et moins confiant. Comme Lady Palmerston plus anti- autrichien que jamais, et me faisant fort la cour pour que je sois Prussien. Très occupé de Rome. Il est établi que le Pape n’y viendra pas quand les Français y seront entrés. Quand et comment en sortiront-ils ? Le Duc de Nemours est venu me voir hier. Très amical et très sensé. On se demande évidemment un peu là pourquoi je n’y ai pas été depuis longtemps. J’irai dans les premiers jours de Juillet. Madame la Duchesse d'Orléans arrive jeudi 28. Le duc de Nemours va la chercher à Rotterdam. Elle passera à St. Léonard, tout le mois de Juillet. La Reine des Belges arrive à Londres lundi, et ira à St. Léonard quand Mad. la duchesse d'Orléans y sera arrivée. Ainsi pour un mois. Le Prince et la Princesse de Joinville ont été à Eisenach, et de là ils se promènent en Allemagne jusqu'à Munich, et ne seront de retour à St Léonard que du 8 au 12 Juillet.
2 heures
J’ai été interrompu par Vigier, et par Génie. Le dernier repart ce soir. Je suis bien aise qu’il soit venu. Il m’a remis bien au courant. Point de lettre de Paris ce matin. Vous verrez dans les Débats d’aujourd’hui la lettre financière de Dumon. Ou plutôt vous ne la verrez pas. Vous n'irez certainement pas jusqu'au bout. C’est très vrai et très bon financièrement, mais sans vigueur et sans effet politique. Je ne vous vois pas venir ce matin. J’irai dîner avec vous demain dimanche. Je suis pris toute la semaine prochaine. J'espère qu’aujourd’hui vous n'aurez pas été retenue à Richmond par votre malaise. Je dîne samedi chez Lord Aberdeen. Je crois que Duchâtel finira par aller prendre sa femme à Spa, et delà avec elle à Paris où ils ne passeront que trois ou quatre jours en traversant pour aller à Bordeaux. Il est dans tous les supplices de l'indécision. Avez-vous fait partir votre lettre à Rothschild ? Adieu. Adieu. Je ne fermerai ma lettre qu'à 3 heures alors je serai sûr que vous ne venez pas aujourd’hui. Adieu. Adieu. G.
Brompton, Mardi 19 juin 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Collection : 1849 ( 1er janvier - 18 juillet) : De la Démocratie en France, Guizot reprend la parole
Auteur : Guizot, François (1787-1874)
Brompton mardi 19 Juin 1849
3 heures
Je reviens de la Tour où j'étais allé à onze heures. J’ai revu Jane Grey, Sir Walter Raleigh, Strafford, les enfants d'Edouard, je ne sais combien de grands noms, de grands crimes et de grandes douleurs. Je vis beaucoup dans le passé et je commence à y entrer moi-même. J'ouvre hier un livre qui vient de paraître, intitulé : Prince Rupert and the Cavaliers, livre curieux et qui contient des documents nouveaux publié par un M. Elias Warburton que je ne connais pas du tout. Une des premières phrases que j'y rencontre est cette- ci : «M. Guizot's account of the trial of Lord Strafford is given with his usual perspicasity and point : but it is singularly reserved as regards expression of opinion on te merits of the case. The reader will easily supply a parallel between the fortunes of the great English Minister and those of a recent French one. The former, when his arm was paralysed in the north by the Kings want of nerve to carry out measures of which he had already reaped all the [?] and danger, and only required courage to grasp at the success for which he had so dearly paid ; the latter when his labours long directed towards the transmutation of the bases elements of France were ruined in the very moment of projection, the timidity of his master, and those, claments let loose to desolate the Empire. " Je ne me plains point de ce jugement. Mais ne trouvez-vous pas que c'est le ton de l'histoire sur les morts ? Je ne sais pourquoi je n’ai point de nouvelles de Paris. J'en attends de tout le monde. Les gens que j'ai vus hier soir, chez Lady Stanley de Alderley, et ce matin, chez moi, ne savaient rien. On croyait généralement que Ledru Rollin est à Londres. Je ne crois pas. On le saurait positivement. On parlait aussi d’une vive attaque d'Oudinet sur Rome, de monuments détruits, de statues brisées, de tableaux percés. Je ne connais pas de pire condition que celle de ce pauvre homme ; il faut qu’il prenne Rome et qu’il n’y gâte pas une image. M. Benoist Fould vient de venir chez moi pendant que j'étais à la Tour. Je le regrette. Personne n'est mieux informé que lui de Paris. Il se fait tout envoyer et quelquefois des courriers exprès. Il va aujourd'hui même s'établir à Richmond, Mansfield house, en face du Star and garter. Par M. de Stieghz, si vous voulez, vous saurez ses nouvelles. Je ne doute pas qu’il ne la connaisse. Tous ces banquiers sont compatriotes. Si, comme il m’a paru vous n’avez pas grande envie de venir demain à Pelham Crescent, je veux vous dire que je suis obligé de sorti à 3 heures avec M. et Lady Charlotte Denison, pour aller voir l’exposition des fleurs à Regent's Park. Mon désir est et mon plaisir sera de vous voir auparavant ; vous venez en général à 2 heures et demie. Mais je veux que vous sachiez à quelle heure je serai pris. Un quart d'heure en bien court. Pour moi, je l’aime infiniment mieux que rien du tout. Adieu. Adieu. Adieu. G.
3 heures
Je reviens de la Tour où j'étais allé à onze heures. J’ai revu Jane Grey, Sir Walter Raleigh, Strafford, les enfants d'Edouard, je ne sais combien de grands noms, de grands crimes et de grandes douleurs. Je vis beaucoup dans le passé et je commence à y entrer moi-même. J'ouvre hier un livre qui vient de paraître, intitulé : Prince Rupert and the Cavaliers, livre curieux et qui contient des documents nouveaux publié par un M. Elias Warburton que je ne connais pas du tout. Une des premières phrases que j'y rencontre est cette- ci : «M. Guizot's account of the trial of Lord Strafford is given with his usual perspicasity and point : but it is singularly reserved as regards expression of opinion on te merits of the case. The reader will easily supply a parallel between the fortunes of the great English Minister and those of a recent French one. The former, when his arm was paralysed in the north by the Kings want of nerve to carry out measures of which he had already reaped all the [?] and danger, and only required courage to grasp at the success for which he had so dearly paid ; the latter when his labours long directed towards the transmutation of the bases elements of France were ruined in the very moment of projection, the timidity of his master, and those, claments let loose to desolate the Empire. " Je ne me plains point de ce jugement. Mais ne trouvez-vous pas que c'est le ton de l'histoire sur les morts ? Je ne sais pourquoi je n’ai point de nouvelles de Paris. J'en attends de tout le monde. Les gens que j'ai vus hier soir, chez Lady Stanley de Alderley, et ce matin, chez moi, ne savaient rien. On croyait généralement que Ledru Rollin est à Londres. Je ne crois pas. On le saurait positivement. On parlait aussi d’une vive attaque d'Oudinet sur Rome, de monuments détruits, de statues brisées, de tableaux percés. Je ne connais pas de pire condition que celle de ce pauvre homme ; il faut qu’il prenne Rome et qu’il n’y gâte pas une image. M. Benoist Fould vient de venir chez moi pendant que j'étais à la Tour. Je le regrette. Personne n'est mieux informé que lui de Paris. Il se fait tout envoyer et quelquefois des courriers exprès. Il va aujourd'hui même s'établir à Richmond, Mansfield house, en face du Star and garter. Par M. de Stieghz, si vous voulez, vous saurez ses nouvelles. Je ne doute pas qu’il ne la connaisse. Tous ces banquiers sont compatriotes. Si, comme il m’a paru vous n’avez pas grande envie de venir demain à Pelham Crescent, je veux vous dire que je suis obligé de sorti à 3 heures avec M. et Lady Charlotte Denison, pour aller voir l’exposition des fleurs à Regent's Park. Mon désir est et mon plaisir sera de vous voir auparavant ; vous venez en général à 2 heures et demie. Mais je veux que vous sachiez à quelle heure je serai pris. Un quart d'heure en bien court. Pour moi, je l’aime infiniment mieux que rien du tout. Adieu. Adieu. Adieu. G.