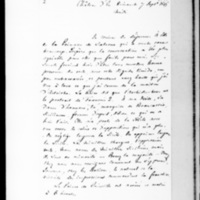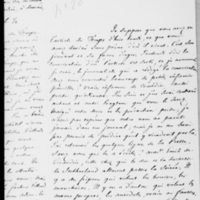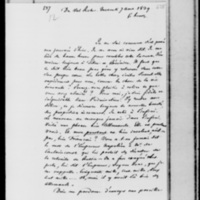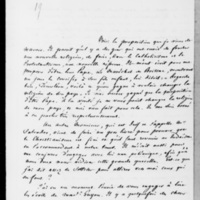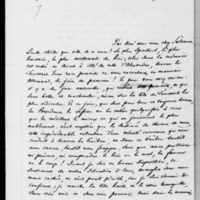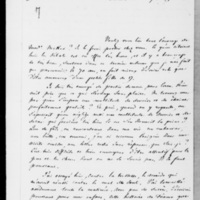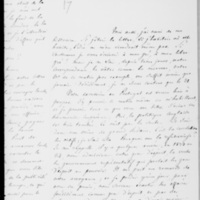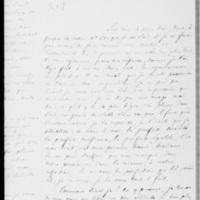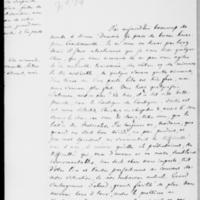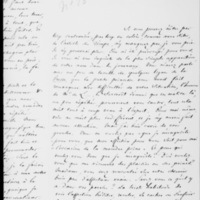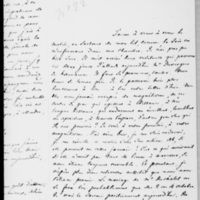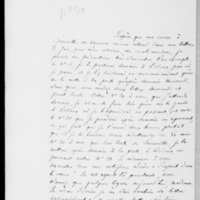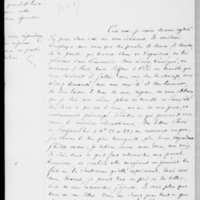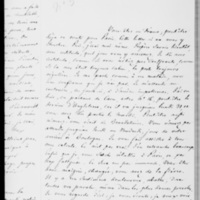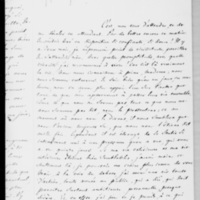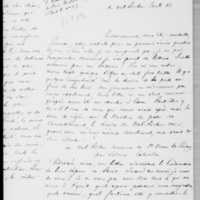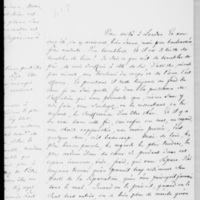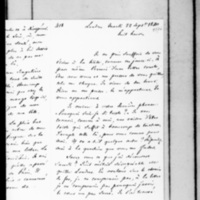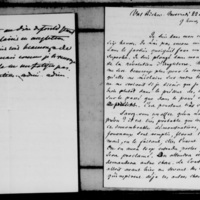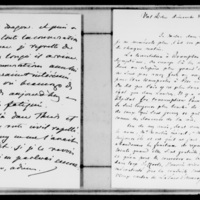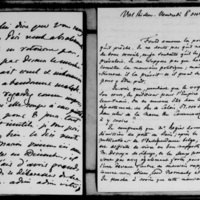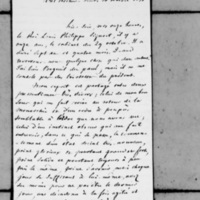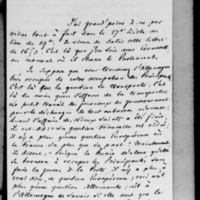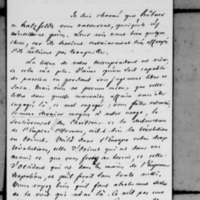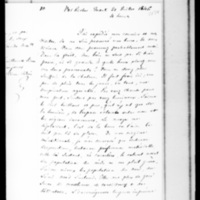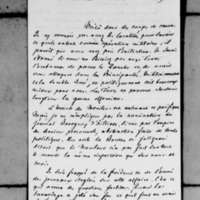Votre recherche dans le corpus : 87 résultats dans 3296 notices du site.
2. Château d'Eu, Dimanche 7 septembre 1845, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je reviens du déjeuner. A côte de la Princesse de Salerne qui a voulu causer beaucoup. J’espère que la conversation a été plus agréable pour elle que facile pour moi. Les sourds feraient bien d’être tous muets. Bonne personne du reste avec cette dignité timide, un peu embarrassée et pourtant assez haute que j’ai vue à tous ce que j’ai connu de la maison d’Autriche. La Reine dit que l'archiduchesse est le portrait de François 2. A ma droite, sa dame d’honneur, la marquise de Brancaccio, sicilienne, femme d’esprit, dit-on, et qui en a bien l’air. Elle m’a parlé de la Sicile avec une verve de colère et d'opposition qui m’a plu. " On néglige toujours la Sicile. On opprime toujours la Sicile. Les ministres changent, l'oppression reste. Nous avons des ministres siciliens mais ils sont en minorité. Prenez la majorité. Venez chez nous nous enseigner comment on s'y prend. " Souvent, chez les Italiens, le naturel et la vivacité des impressions commandent la franchise.
Le prince de Joinville est arrivé ce matin, à 6 heures. Toujours grande incertitude, sur le moment de l’arrivée de la Reine. Ou aujourd’hui, vers 6 heures ; ou demain, à 5 heures du matin, ou à 5 heures du soir. Je parie pour aujourd’hui. D’abord, parce que j'en ai envie, ensuite parce que la Reine des Belges a écrit que c'était fort possible. Ils (le Roi et la Reine des Belges) sont allés la recevoir à Anvers hier samedi entre 1 et 2 heures. Nous nous mettons en mesure ici pour toutes les hypothèses.
J’aurai bien peu de temps pour causer, avec Lord Aberdeen. Je veux pourtant lui dire tout l'essentiel. Je vous promets qu’il passera avant moi. Les peintres sont encore, à l'heure qu’il est, dans la Galerie Victoria. Si la Reine avait le temps de se promener, elle verrait réalisées, aux environs du château, toutes les idées qu’elle a suggérées, les désirs qu’elle a indiqués ; un parc fort agrandi, de belles routes au lieu des mauvais chemins & &. Mais je doute qu’on se promène une heure.
Le courrier Russe qui avait été expédié au Prince Wolkonski, l’a rencontré à Eisenach & le Prince est arrivé à Berlin où il attend l'Impératrice qui a dû y arriver avant-hier au soir et qu’il accompagnera à Palerme. Le Kamchatka après l'avoir déposée à Swinemünde, ira passer le détroit de Gibraltar et l'attendre à Gênes pour la porter en Sicile. On croit, on dit à Pétersbourg que l'Empereur s’embarquera à Sébastopol et ira voir sa femme à Palerme.
Pourquoi me cherchez vous un cache-nez brun ? Le blanc que vous m'avez donné est excellent et m’a très bien préservé. Il est parfaitement convenable.
Voilà M. Royer-Collard mort. Je pense avec plaisir que nous nous sommes séparés en vraie amitié. C’était un esprit rare, charmant et un caractère, très noble. Quatre personnes ont réellement influé sur moi, sur ce que je puis être, devenir et faire. Il est l’une de ces personnes là. Le seul homme. Il a tenu peu de place dans les événements, beaucoup dans la société et l’esprit des acteurs politiques. Il leur était un juge redouté et recherché. Adieu. Adieu. Le Roi me fait appeler en toute hâte. Adieu. G.
Mots-clés : Aristocratie, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Diplomatie (Russie), Discours autobiographique, Famille royale (France), Femme (portrait), Mort, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Italie), Portrait, Travail politique, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Vie domestique (François)
41. Val-Richer, Mardi 19 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suppose que vous avez vu l’article du Temps d’hier lundi, et que vous aurez deviné sans peine d’où il vient. C’est son journal et sa façon d’agir. J’entends d’ici la conversation d’où l’article est sorti, et je nommerais, je crois, le journaliste qui a rédigé la conversation.
Avez-vous rencontré beaucoup de petites infamies pareilles ? Vraies infamies de comédies, aussi petites qu’odieuses. J’en suis et j’en serai contrarié autant et aussi longtemps que vous le serez. Malgré votre désir et les précautions prises, je n’osais pas espérer que votre nom ne parût jamais dans un journal ; mais je ne me serait par la pas permis de prédire qu’il y viendrait par là. J’ai retrouvé les quelques lignes de la Presse. Savez-vous qui les a écrites ? Mad. Emile de Girardin, celle chez qui le Duc et la Duchesse de Sutherland allaient passer la soirée. Il y a des fripons qui volent les bourses, les mouchoirs. Il y en a d’autres qui volent les noms propres, les anecdotes vraies ou fausses. Et Chaque journal a ses coureurs de faits, de nouvelles, qui vont les recueillant et les escamotant dans tout Paris, chacun où il peut, tel dans les rues, tel dans les cafés, tel dans les salons. Et plus le non est illustre, plus le fait se paye cher. Mais ceux-ci ne sont pas des faits payés : ce sont des faits fournis gratis. Quelle honte !
Je suis préoccupé de votre contrariété. Je voudrais tant vous faire vivre dans une atmosphère parfaitement calme et douce ! Connaissez-vous en même temps rien de plus ridicule, si vous lisez ces journaux là, que tout leur ardeur à démontrer pour les matins, qu’il est impossible que M. Molé tombe, impossible que je trouve des alliés pour le renverser impossible que je revienne au pouvoir ?
Je ne pense à rien, je n’essaie rien, je ne parle ministère à personne ; les journaux qui me sont amis ne mettent aucune combinaison en avant, attaquent à peine quelques actes, quelques tendances du Cabinet. n’importe; on se démène, on crie comme des assiégés sous qui une mine va sauter, qui voient commencer un violent assaut. On semble obsédé par un fantôme. Pour les patrons de la conciliation générale, c’est bien peu de sécurité. Je ne sais pourquoi je vous parle de cela. L’article de ce matin, m’a donné de l’humeur et m’a fait penser à tout le reste. Habituellement je n’y pense guère. Rien ne me paraît plus plaisant que l’agitation sans relâche, les machinations continuelles, le tourment d’esprit qu’on m’attribue. J’ai de l’ambition toujours, j’en conviens ; de l’activité au besoin, je l’espère. Mais personne ne se remue moins que moi ; personne ne méprise davantage tout mouvement, petit, impatient, prématuré. Il faut, je crois, dans la vie politique, & sous notre forme de gouvernement, inventer très peu, frapper à très peu de portes, attendre tranquillement et se contenter d’être toujours prêt & à la hauteur de la marée montante, quand elle arrive. C’est mon goût, et je le suivrais n’eussé-je pas d’autre raison. Mais c’est aussi, je crois la vraie habilité. Je n’irai pourtant pas me coucher sur ces idées et ces paroles là.
Qu’est-ce donc que ces étouffements que vous avez eus à l’Eglise ? Certainement, il faut soigner votre santé. à chaque soin que vous prendrez, remerciez vous de ma part. Je vous soignerais si bien si j’étais toujours là ! Adieu, adieu. Il n’est pas onze heures. Vous avez encore du monde. Je vous assure que si j’y étais, je serais très aimable, aimable pour M. de Muhlinen. Adieu à demain.
Mercredi 10 heures ¼
Vous n’avez surement pas vu l’article du Temps. Vous ne m’en dîtes rien. Voyez-le. Il faut savoir où l’on en est. Je ne voudrai jamais que vous ignoriez rien de ce qui vous a touché, de ce qui nous touche de si près. Et pourtant que me fait le Temps, que me font tous les journaux du monde quand je reçois de vous une lettre comme le n° 42 ? Permettez-moi de ne pas vous en parler en ce moment. Vous savez qu’il y a des moments, bonheur ou malheur, où j’ai besoin de me taire, où je ne puis pas, où je ne veux pas parler. Mais vous m’avez ravi. Mais vous venez de me donner une joie incomparable. J’en ai besoin.
On me dit que le mariage de M. Duchâtel n’aura lieu que dans les premiers jours d’octobre. J’attends demain M. Duvergier de Lausanne qui vient passer ici 36 heures et qui m’apportera quelque chose de positif. Je n’ai pas répondu à votre question, je ne vous ai rien dit du tout. Je voulais ; je veux savoir. Je déteste les attentes vaines. Je les déteste pour moi pour vous. Mais, il faut que je donne ma lettre. Le facteur l’attend. Adieu. Adieu. Je ne sais qu’ajouter à mon adieu. Et pourtant, j’y voudrais tant ajouter. Adieu. G.
239. Val-Richer, Vendredi 9 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il n'y a de repos nulle part. Hier, il a fallu me promener toute la journée avec des visiteurs. Aujourd’hui dès que j'aurai déjeuné, je vais à deux lieues d’ici voir les jardins de deux de mes voisins qui m’ont envoyé je ne sais combien de belles fleurs. Le voisinage et la reconnaissance, deux lourds fardeaux. Hier pourtant, parmi les visites, une était assez agréable, la fille du général Caffarelli qui a épousé le receveur des finances de Lisieux, femme d’esprit et de bonne compagnie, qui s'ennuie beaucoup à Lisieux, et paraissait se plaire fort au Val-Richer. Elle m'a amené ses enfants avec qui les miens se sont parfaitement amusés, son mari est un de mes principaux Leaders d’élections. Tout cela me dérange.
Du déjeuner au dîner, j’aime à passer la matinée enfermé dans mon Cabinet. Je lis beaucoup j'écris. Je descends deux ou trois fois dans le jardin. Je me promène cinq minutes. Je remonte. De la solitude, de la liberté, l’esprit occupé, mes enfants pour société et récréation, la journée s’écoule doucement, comme une eau claire, et peu profonde. Le soir quand je n’ai personne, nous nous réunissons dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode, et de 8 à 9 heures jusqu’à ce que mes enfants se couchent, je leur fais une lecture. Nous achèverons ce soir Ville Hardouin, la conquête de Constantinople par les Français au 13e siècle. Sans allusion ni préméditation de ma part. Nous prendrons demain Joinville, St Louis. Je ferai passer ainsi sous leurs yeux les mémoires originaux et intéressants de l'histoire de France. Je m’arrête en lisant; j'explique je commente, j’écoute. Cela leur plait fort. Et puis, pour grand divertissement, j’interromps quelquefois nos lectures historiques par un roman de Walter-Scott ou une pièce du théâtre Français. En fait de lectures amusantes, je n'en connais point de plus saines pour des enfants et qui leur laissent dans l’âme des impressions plus justes et plus honnêtes que Scott. Racine, Corneille et Molière, un peu choisi. Je n'ai avec mes enfants point d'apprêt, ni de pruderie ; je ne prétends pas arranger toutes choses autour d'eux, de telle sorte qu’ils ignorent le monde et ses imperfections, et ses mélanges jusqu'au moment où ils y seront jetés. Mais je veux que leur esprit se nourrisse d'excellents aliments, comme leur corps de bon pain et de bon bœuf. L’atmosphère et le régime, c'est l’éducation morale comme physique. Je veille beaucoup à cela, et puis de la liberté, beaucoup de liberté. Cela m’avait admirablement réussi.
Il faut en effet que Félix soit fou. Du reste les maîtres n'ont pas le privilège de l’ennui. C’est la seule explication qui me soit venue à l'esprit hier. Elle m’y revient aujourd'hui. Elle vous fait peu d’honneur, et Félix n'est pas Russe. J'espère encore que ce n’est pas fini, et que vous me direz qu’il est resté. Vous dîtes donc que vous serez à Paris en septembre au commencement même. Cela me fait battre le cœur. Pour y rester ou pour aller à Londres ? Si vous le savez, dites le moi.
J’écris aujourd'hui pour faire examiner à fond, la rue Lascazes. Si vos fils sont pressés de retourner à leur poste, Alexandre ne viendrait-il pas vous voir à Baden, selon vos premiers projets ?
9 h. 1/2
Je suis charmé que Félix vous reste. Je n'avais pas pensé à l'ivresse. Et charmé aussi que vous alliez à l'hôtel Talleyrand. Le 1er étage vous convient à merveille. Adieu. Adieu. Quand tout le monde espère toutes les espérances sont des gasconnades. Je n’avais pas naturellement de pente aux gasconnades. Trop encore. On est toujours un peu de son pays. Vous m'en avez guéri tout-à-fait. Je vous en remercie. Adieu. Adieu. G.
237. Val-Richer, Mercredi 7 août 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne sais comment s’est passée ma journée d’hier. Je ne vous ai rien dit. Je me lève de bonne heure pour combler cette lacune. J'en reviens toujours à Titus et Bérénice. Il faut que ce soit bien beau pour qu’on y retrouve sans cesse son propre cœur. Les belles choses écrites s'usent-elles rapidement pour vous, comme les choses de la vie courante ! Prenez-vous plaisir à relire ce que vous avez admiré ? Pour moi, je suis fidèle et inépuisable dans l'admiration. J'y rentre avec délices, et je découvre toujours de nouvelles beautés, des perspectives inconnues. Je relis à l'infini. Le nouveau ne manque jamais dans l'infini. Voilà une phrase bien allemande. Elle est pourtant vraie. Et mon pourtant est bien insolent, n’est-ce pas, bien français ?
Vous a-t-on jamais dit le mot de l'Empereur Napoléon à M. de Caulaincourt qui lui parlait des désastres de la retraite de Russie. " On a fort exagéré les pertes, lui dit l'Empereur ; voyons donc, que je me rappelle. Cinquante mille, cent mille, deux cent mille... Oh mais il y avait là bien des Allemands. "
Dieu me pardonne d'envoyer une pareille anecdote au delà du Rhin ! J’ai tort. Je dois beaucoup à l'Allemagne. D'abord, je lui dois vous, qui n'en êtes guère, d’esprit du moins. Je lui dois une partie du mien. De 20 à 25 ans j'ai beaucoup étudié la littérature allemande et beaucoup appris de cette étude ; appris non seulement, matériellement mais moralement. Il m'est venu de là beaucoup d’idées, des jours nouveaux sur toutes choses, une certaine façon de les considérer qu’on ne trouve point ailleurs, notamment en France. Au fait, c’est une sottise de laisser pénétrer dans son jugement sur un grand peuple le moindre sentiment de dédain, je dirai plus d'orgueil national. Ils ont tous, par cela seul qu’ils ont beaucoup fait et joué un grand rôle en ce monde, de quoi mériter l’attention l'estime, le respect des plus grands esprits. Et il y a toujours dans un tel dédain, infiniment plus d'ignorance & d'irréflexion que de supériorité.
Convenez que Méhémet est un homme supérieur. Je suis charmé de ses notes à nos consuls de la forme comme du fond. Il y a beaucoup de grandeur et de mesure. Belle alliance. Nous verrons comment il dénouera sa situation à Constantinople. Il a bien commencé. Il tient la flotte et parle tout haut à son parti dans tout l'Empire turc. Je me rappelle qu’en 1833 il nous revenait fort d'Orient qu’il avait un grand parti à Constantinople, et que, s’il voulait il y exciterait une sédition très dangereuse pour Mahmoud. Il ne voulut pas. Ménagera-t-il autant Khosrer Pacha ? Avez-vous lu dans le journal des Débats la relation du couronnement du Sultan ? C'est assez intéressant. Elle est d’un M. Herbat, un jeune homme que j’avais près de mois au Ministère de l’Instruction publique et qui m’était si attaché que sous le 14 avril, M. Molé enjoignit à M. de Salvandy de le destituer. Il est parti pour l'Orient avec M. Jaubert à qui je l’ai recommandé. Et pendant qu’il voyait passer Abdul. Medgid dans les rues de Constantinople je lui ai fait rendre à Paris la place qu'on lui avait ôtée. Il la trouvera à son retour. Ce sera quelque jour mon Génie second, ou mon second Génie, comme vous voudrez.
9 heures et demie
Je ne sais pas quelles nouvelles on a d'Orient : mais on en a ! Je ne sais pas, ce que les Ministres ont demandé au Roi ; mais ils lui ont demandé quelque chose que le Roi a refusé Trois consuls ont été tenus dans la journée d’hier. Les ministres ont offert leur démission. Alors le Roi a consenti. Il n’a probablement été demandé et consenti, rien de bien grave. Mais enfin je vous donne ce que je sais. Adieu Adieu. L'heure me presse. G.
208. Paris, Vendredi 5 juillet 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Midi
Je me suis levé tard ce matin. Je dormais. Je dors assez mal, je ne sais pourquoi, car je me porte bien. Je pense beaucoup la nuit et le jour. J’ai rarement vécu aussi seul. Le monde que je vois ne rompt pas ma solitude. Le Duc de Broglie est tenu toute la journée à la Chambre des Pairs. Nous ne voyons guère qu'en dînant ensemble. Plus je suis seul, plus je vis avec vous seule. Mais je passe décidément à la présence réelle. Il n’y a que cela de vrai. Le procès ennuie tout le monde, juges et accusés. Les Pairs déclarent qu’ils n'en veulent plus de semblable. Les accusés sauf un seul ont l’attitude de gens qui ne recommenceront pas. C'est l’impression générale. Les avocats eux-mêmes sont polis. Cela finira dans huit jours. Il en reste encore près de 200 en prison. On en mettra quelques uns en liberté. Les autres attendront jusqu'au mois de novembre, au plus tard encore, pour être jugés, je ne sais pas bien par qui. Je ne suis pas aussi convaincu que tout le monde que cette échauffourée-ci soit la dernière ; mais certainement c'est une folie, en déclin. Le Chancelier aussi est en grand Déclin out le monde en est frappé. Je n’ai pas encore été dîner à Châtenay. Cela ne me plaît pas.
Madame de Boigne va mieux. Je suis très ennuyé que vos Affaires de Pétersbourg ne marchent pas plus vite, et bien aise que votre fils Paul soit si réservé. Donc il croit sa cause mauvaise. Dans cet état des choses, il me paraît impossible que les lettres de Madame de Nesselrode. Ne vous fassent pas faire un pas. Mais il y a bien des pas à faire avant que vous soyez au terme. Vous avez beaucoup d'expérience des personnes, aucune des choses. Elles sont toutes lentes, difficiles, embrouillées. Elles ne vont que lorsqu'une volonté, active et obstinée s'en mêle. Et cette volonté pour vous. Je ne la vois pas à Pétersbourg. Il y a des Abymes de la bienveillance à la volonté. Je suis donc tourmenté, et pourtant je voudrais que vous le fussiez un peu moins. Je vous voudrais moins confiante et moins impatiente. Si vous vous laissiez complètement gouverner par moi, que vous vous en trouveriez bien !
Mon discours devient très populaire. Tout le monde s’y range. Mais tout le monde est persuadé que je veux être Ministre des Affaires étrangères, et que je n’ai parlé que pour cela. J’admire tout ce qu’on suppose et tout ce qu’on ignore en fait d’intentions. J'ai dîné hier chez le Ministre de l’instruction publique avec trente personnes que vous ne connaissez pas et M. d’Arnim qui m’a demandé de vos nouvelles. De là chez le Ministre de l’Intérieur. Peu de monde partout. Je n’ai trouvé à causer chez M. Duchâtel, qu'avec un officier de marine, homme d’esprit, autrefois aide de camp de l'amiral Rigny, le capitaine Leray. Je l’ai emmené dans un coin, et j'en ai extrait tout ce qu’il a vu de l'Orient. Nous croyons de plus en plus à la sagesse du Pacha. Mais si le Sultan lui déclare une guerre à mort, l’embarras peut commencer.
La Chambre a abrégé hier la session de huit jours. Elle a décidé qu’elle ne s’occuperait pas cette année de la loi des sucres. Votre protégé M. Dufaure, n'a pas de succès dans la discussion des chemins de fer. Plusieurs de ses projets seront rejetés et il ne les défend pas bien. Vous savez surement que Lady Granville ne va pas à Kitzingen. Elle parlait de Dieppe, du Havre. Je crois qu'elle n'ira nulle part, & que Constantinople les retiendra à Paris. Nous sommes très contents de l'Angleterre, et elle de nous. Je suis charmé que Bulwer revienne à Paris. Il a vraiment de l’esprit. On dit qu'il en a eu trop quelquefois jusqu'à la fièvre. Est-ce vrai ? Adieu. Je vais à la Chambre. Que m'importe à présent que La Terrasse soit sur mon chemin ? G.
85. Broglie, Jeudi 12 juillet 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je passe ici la journée. Je retournerai demain chez moi. J’attends votre lettre de ce matin. On me l’enverra de Lisieux. Je dois l’avoir ce soir. Demain, en passant à Lisieux j’en trouverai une autre. Vous n’aurez point de dérangement non plus.
J’ai trouvé ici quelques personnes ; des députés du département qui y sont venus dîner avec moi ; tous les d’Haussenville possibles deux générations ; il me semble qu’on recommence à attendre la troisième. Le Duc de Broglie est arrivé hier matin, quelques heures avant moi. Il avait dîné la veille chez Lord Granville. Quoiqu’il soit peu bavard & moi peu questionneur, j’ai trouvé moyen d’avoir de vos nouvelles. Mais je voulais mieux. Je suis ici à sept lieues plus près de vous.
Je suis rentré dans cette maison avec émotion. J’y ai été très heureux. Il n’y a pas, dans ce parc, un coin que je n’aie visité avec quelqu’un de cher, de très cher, mon fils le dernier. Nous sommes encore là, la maison et moi rien que nous. J’ai le cœur plein, plein de choses qui vont à vous. Vous seriez bien ici, certainement bien pour quelque temps. Les maîtres sont bons simples, le cœur droit et haut. La vie est facile et assez bien arrangée Je cherche quels conforts vous manqueraient. On m’a donné l’appartement qu’on vous donnerait au rez de chaussée. Il fait un temps magnifique, trop chaud pour vous. Mais l’air est animé et les ombres du parc très épaisses. J’en ai fait le tour ce matin, à huit heures et demie. Il faut quarante minutes. Je n’aurais pas mis plus de temps avec vous. Vous marchez d’un bon pas. Mais nous nous serions arrêtés en causant. Nous nous arrêtons bien quelques fois sur le trottoir de la rue de Rivoli. Charmant trottoir !
En fait de politique, le Duc de Broglie ne m’a rien rapporté sinon le grand émoi du Cabinet, et même plus haut que le Cabinet, sur les triomphes du Maréchal Soult. C’est plus qu’on ne demandait. Et tout d’ailleurs très impérial jusqu’au vin. On n’en rit que du bout des lèvres. On croit des prétentions énormes et près de se mettre au service du parti qui leur promettra le plus. On ne songe plus du tout à lui comme simple Ministre de la guerre. On a offert ce portefeuille, là au Général de Caux qui l’a refusé. On restera comme on est.
11 heures du soir
Votre lettre n’est pas encore venue. On me dit que le courrier de Lisieux arrive le matin et que je l’aurai demain à 9 heures. J’y complais pour aujourd’hui. Il me semble que le mécompte m’est encore plus désagréable qu’il n’eut été au Val-Richer. Ce lieu, les impressions que j’y ai retrouvées tout ce qui semblerait devoir me distraire de vous m’en rapproche. Adieu. Je vous dirai bonjour demain en me levant, car cette lettre-ci partira avant que j’aie la vôtre. Probablement vous êtes déjà couchée. Vous dormez, j’espère. Adieu, Adieu.
Vendredi, 8 heures
Lady Granville part demain. Je ne puis vous dire combien je la regrette. Quel temps doivent- ils passer à Aix ? Je donnerais quelque chose de bon, comme on dit pour être un jour derrière un rideau quand vous causez avec Lady Granville. Je voudrais voir sa gaieté et la vôtre en communication. Personne, je crois n’est moins curieux que moi. Je le suis excessivement pour quelqu’un que j’aime. Il me semble que j’ai toujours, à son sujet, quelque chose de nouveau à apprendre ; et aussi que tout ce que j’en ignore tout ce qui m’en échappe est un vol qu’on me fait. C’est mon bien que je cherche à tout moment, partout. Adieu. J’aurai deux lettres aujourd’hui. Je serai au Val-Richer pour dîner. Adieu, Adieu. G. J’ai oublié de mettre de la cire noire dans mon working desk.
155. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voici la proposition que je viens de recevoir. Il paraît qu’il y a des gens qui ont envie de fonder une nouvelle religion, de faire, dans le catholicisme et le Protestantisme, une nouvelle réforme. Ils m’ont écrit pour me proposer d’être leur Pape. Le Maréchal de Brissac, montrant un jour le crucifix à son fils enfant lui disait : " Regarde bien Timoléon, voilà ce qu’on gagne à vouloir changer la religion de son pays. Je n’ai encore gagné que la proposition d’être Pape. A la vérité je ne veux point changer la religion de mon pays, et n’ai rien fait pour cela. Je me suis borné à en parler très respectueusement. " Un autre Monsieur, qui est Juif et s’appelle M. Salvador vient de faire un gros livre pour prouver que le Christianisme est fini, et qu’il faut revenir au Judaïsme en l’accommodant à notre temps. Il m’écrit aussi pour me conjurer d’engager avec lui une polémique, afin qu’à nous deux nous vidions cette grande querelle. Est-ce que j’ai dit assez de sottises pour attirer vers moi ceux qui en font ?
J’ai eu un moment l’envie de vous engager à lire les écrits de Mad. Guyon. Il y a quelquefois des choses très touchantes, très pénétrantes, très belles, qui auraient bien été à la disposition de votre âme. Mais j’ai rouvert le livre, et je ne vous en ai pas parlé C’est trop fou. Vous avez la combinaison la plus difficile à satisfaire, beaucoup d’imagination et beaucoup de bon sens, l’âme tendre et l’esprit positif, ce qui met sur le chemin de la folie et ce qui en écarte. Et puis les livres n’ont pas grand pouvoir sur vous. Il vous faut des actions et non pas des paroles. J’ai pensé à tout cela cette nuit, ne dormant pas. C’est pourquoi je vous parle.
Je viens de me lever. Le temps est admirable. Le soleil achève de dissiper un brouillard qui roule en s’en allant, sur les bois et sur les prairies. L’air et ma vallée sont pleins de mouvement, et d’un mouvement où la bonne cause triomphe. Dans une heure tout sera charmant autour de moi. Une longue promenade ensemble sous ce soleil brillant, dans cet air frais, nous ferait plus de bien à tous deux que tous les livres du monde. On dit que Louis Buonaparte est parti de Suisse. Convenez qu’il est difficile de faire plus ridiculement sa volonté et de moins bien finir une affaire qu’on finit. Si nous vivions dans un temps où les esprits fussent un peu exigeants, un peu hauts, il y aurait là de quoi perdre un Cabinet. Mais nous sommes à une époque de bon marché, comme on dit. On veut un gouvernement bon marché. on s’en contente à bon marché. Le salon de la Terrasse est-il bien arrangé ? On n’a rien changé dans le petit cabinet, n’est-ce pas ? Verrez-vous beaucoup les Holland ? Sont-ils à l’hôtel de Bath ? Que c’est ennuyeux de vous faire des questions ! Quand je serai là, je saurai tout.
10 h.
Je suis charmé que votre monde vous soit arrivé. Nous causerons ce soir. Adieu. On m’attend en bas pour je ne sais combien de petites affaires. Adieu Adieu. Dormez donc. G.
149. Val-Richer, Jeudi 4 octobre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné avec vous chez Salomon. Quelle chute que celle de ce nom ? Le plus spirituel, le plus hautain, le plus aristocrate des Rois, celui dont la mémoire est restée en orient à côté de celle d’Alexandre devenu le Turcaret d’une race proscrite et vous racontant, en mauvais allemand, ses joies de parvenu ! Et puis vous avez raison : il y a des joies naturelles, qui restent aux proscrits et qui sont belles et touchantes, même sur la tête des Turcarets les plus ridicules. Et ces joies, qui sont pour tous et toujours bonnes, la Providence les refuse ou les enlève quelques fois à ceux qui les méritent le mieux et qui en jouiraient le plus noblement. Quel mystère que la destinée de chacun de nous, cette impénétrable intention d’une volonté inconnue qui nous conduit à travers les ténèbres, et dans ces ténèbres tantôt nous caresse, tantôt nous frappe, sans que nous puissions ni prévoir ni comprendre le bien ou le mal, la faveur ou le coup ! Quand je suis en bonne disposition, ce sentiment de notre situation à tous, aveugles sous une main cachée, ne m’est point pénible, car je suis soumis et confiant ; je marche la tête haute et le cœur tranquille sans rien voir et sans rien pouvoir. Mais dans les mauvais jours, dans les heures faibles, soit pour moi-même, soit pour ceux que j’aime, je succombe sous ce fardeau sans limite comme je ferme les yeux, je prends ma tête dans mes mains, comme pour me cacher et me soustraire à cette mystérieuse et irrésistible Puissance. Oui vous dites vrai, vous êtes bien seule. Vous êtes faite pour n’être pas seule ; vous avez le cœur très ouvert, très vif pour ces affections et ces joies intimes, de tous les moments, Gnimhich und Gnimhich, qui sont le vrai, le seul bonheur. Et vous êtes bien seule. J’y pense sans cesse.
Laissez-moi vous dire tout ce que je pense. Pour ce bonheur-là comme en toute chose, vous êtes délicate, difficile ; vous ne savez vous contenter de rien de médiocre. Si le médiocre, le commun pouvait vous suffire vous l’auriez, vous l’avez. Il vous reste un mari, des enfants. Vous pourriez, avec ces liens tels quels, avoir un intérieur tel quel, comme tant d’autres. Mais vous n’acceptez pas ce que d’autres acceptent ; vous ne supportez pas ce que d’autres supportent. Vous répudiez ce que d’autres gardent. Vous résistez quand d’autres cèdent. Vous ne consentez jamais à descendre, à vous abaisser à vous mutiler ni dans vos instincts, ni dans vos jugements ni dans vos désirs, ni dans vos plaisirs, ni dans vos douleurs. Ne soyez pas autrement ; n’essayez jamais d’être autrement. C’est votre nature, c’est votre supériorité, si rare et si charmante. Quand vous le voudriez, vous n’y pourriez pas renoncer. Ne le veuillez jamais. Ce serait une abdication, une profanation. Mais c’est là ce qui fait que vous êtes seule. Dites-moi que vous n’êtes pas seule quand vous êtes avec moi. Vous vous le rappelez ; c’est ce que je vous ai promis.
9 h 1/2
J’ai aussi un soleil superbe. Réunissons-nous dans ce soleil qui brille sur tous deux. Je me suis promené hier toute la matinée. J’en ferai autant aujourd’hui, mais à pied et avec mes enfants. J’ai vu Rogers une fois ; mais je ne le connais pas. J’ai vu beaucoup de gens que je ne connais pas. Vous savez que je ne suis pas curieux. Le curiosité ne me vient qu’après autre chose. Je suis curieux de savoir comment sera Marie. Je voudrais bien que vous n’eussiez pas là une tracasserie de plus. Adieu. Le temps marche et me pousse vers vous. Adieu. Adieu. Si je m’en croyais, je ne finirais pas. G.
111. Val-Richer, Samedi 25 août 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voulez-vous lire tout l’ouvrage de Mad. Necker ? Je le ferai porter chez vous. Ce qu’en citaient hier les débats est en effet très beau, et il y a beaucoup de très beau, surtout dans ce denier volume que je n’ai fait que parcourir. A 70 ans, on fait mieux d’écrire cela que d’être amoureux d’une petite fille de 17. Je suis très ennuyé de partir demain pour Caen. Rien n’est pire que ce qui dérange sans plaire. Ne trouvez-vous pas qu’on s’impose une multitude de devoirs et de chaines parfaitement gratuits ? Et puis, quand on y regarde, on s’aperçoit qu’on néglige aussi une multitude de devoir et de soins qui feraient très bien si on s’en donnait la peine. Que de fois, en rencontrant dans ma vie, un embarras, une lutte, un ennemi, j’en ai reconnu l’origine dans une visite omise, une lettre restée sans réponse, que sais je ? C’est bien difficile et bien ennuyeux d’être attentif pour les gens et les choses dont on ne se soucie pas. Il le faut pourtant.
J’ai essayé hier, contre la tristesse le remède qui m’avait réussi contre le mal de dents. J’ai travaillé assidûment toute la matinée. Avec peu de succès. J’écrivais pourtant pour mes enfants, cette histoire de France que je veux leur raconter moi-même. Je le leur ai dit. Ils en ont sauté de joie autour de moi pendant un quart d’heure. Leur joie m’a encore attristé. J’avais eu cette idée il y a quinze ans ; pour mon fils. Je la reprends aujourd’hui pour ces trois petits. Que de choses qu’on reprend, qu’on renoue, qu’on recommence ! Toute ma vie m’est revenue à l’esprit. C’est bien ma vie. C’était bien moi. Et tout cela n’est plus ! Et toute cette immense part de moi-même a disparu ! Et je vais comme si j’étais tout entier ! Et j’ai encore soif de ce vase rempli et brisé tant de fois ! Ah, nous sommes de misérables créatures ? Nous ne pouvons conserver, & nous ne savons pas nous passer. Jeunes, nous nous épuisons à désirer et à espérer. Vieux, nous nous fatiguons à regretter et à désirer encore. Et les joies perdues sont pour nous comme si elles n’avaient jamais été. Et elles nous gâtent celles qui nous restent. Et celles qui nous restent ne nous empêchent pas de rechercher avec passion celles que nous n’avons plus comme si nous n’en avions pas eu notre part. Notre cœur est sans reconnaissance envers Dieu, sans équité envers les autres, insatiable dans son égoïsme. Je donnerais je ne sais quoi pour vous guérir de votre douleur. Et votre douleur me ramène à la mienne. Et la mienne me distrait de la vôtre. Je suis triste et mécontent de moi-même. C’est trop.
J’ai peine à croire que Mad. la Duchesse d’Orléans se soit trompée d’un mois. D’après ce qui me revient de l’intérieur de sa maison, on attend réellement d’un moment à l’autre. Du reste, c’est bien absurde, de moi de vous en parler d’ici. Vous entendez surement rabâcher tout le jour, sur ces pauvres petites nouvelles là Devinez à quoi je passe ma soirée depuis quatre jours. A coller avec de la gomme sur de grands cartons et dans de grands cadres que j’ai fait faire exprès, les portraits de tous les rois de France d’abord, ensuite de tous les députés à l’assemblée constituante. J’ai 72 portraits de Rois et 530 portraits de députés défaiseurs et faiseurs de Rois. Je veux garnir de cette collection, à la fois loyale et insolente, ma salle à manger et mon vestibule. Je fais cela avec l’aide de Mad. de Meulan, et un peu de mes enfants. Cela vaut bien vos grandes pensées.
10 heures
Ma lettre n’est pas propre à changer votre mauvaise disposition. Je voudrais trouver quelque chose à vous dire qui fût bon à écrire à M. de Lieven. Je ne trouve rien. Il y a de l’irrémédiable en ce monde. Quand il en aura fini avec le grand Duc, quand il sera oisif et seul peut-être alors sentira-t-il quelque besoin des autres, de vous, de ses enfants. Et intérêt seul, à ce qu’il me semble, peut agir, sur lui. Adieu. Je suis bien aise que Pahlen soit de retour. Il vous remplira quelques moments. Parlez-moi toujours de vous, toujours. Et toujours adieu. G.
59. Val-Richer, Dimanche 15 octobre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Moi aussi, j’ai envie de me distraire. Si j’étais la lettre, si j’habitais où elle habite, l’idée ne m’en viendrait même pas. Si seulement je vous écrivais à mon gré, à mon libre gré ! Mais je ne sais, depuis trois jours, notre correspondance, la vôtre comme la mienne votre N° de ce matin par exemple me suffit moins que jamais. Décidément, je ne serai content que le 31. Votre excursion en Portugal est venue bien à propos. J’y pensais ce matin même en m’habillant, et je pensais tout ce que vous me dites. J’aime ces harmonies imprévues. Oui, la politique Anglaise est bien tombée. Ce n’est pas la seule. Je suis dans une veine de grand dédain. C’est la consolation des oisifs ; je sais cela. Pourquoi me la refuserais-je ?
Je me rappelle il y a quelques années, en 1833 en 34 nous admirions, entre gens d’esprit, la vertu du gouvernement représentatif qui portait les gens d’esprit au pouvoir. Il me prit un remords de notre arrogance ; et je prédis qu’un jour, pour nous en punir, nous serions écartés, des Affaires précisément comme gens d’esprit, et par des adversaires dont le titre serait d’avoir moins d’esprit que nous, moins de talent que nous, moins de courage que nous, d’être des médiocrités enfin, comme dit Lord Aberdeen, la médiocrité a des droits immenses, surtout quand l’esprit démocratique prévaut. Droite précaire pourtant car l’esprit démocratique a beau être petit les affaires des peuples sont grandes, et ne se laissent pas longtemps rabaisser autant que le voudraient ceux à qui toute grandeur déplaît. Et il faut bien que tôt ou tard la taille des hommes se rajuste à la taille des affaires. Au fond Madame, je n’ai pas perdu mon arrogance. Je suis toujours sûr que le pouvoir appartient aux gens d’esprit, aux plus gens d’esprit, et qu’il ne peut manquer de leur revenir. Mais nous passons si vite, gens d’esprit ou non ! Nous avons si peu le temps d’attendre !
Je trouve ceci dans une lettre que je recevais en Octobre 1821, il y a seize ans « J’ai toujours vu tourner à ton profit, les retards même que tu n’aurais pu prévenir. Je te crois du bonheur. Cette croyance serait un enfantillage si elle ne se fondait sur ce que je le crois destiné à quelque chose en ce monde. Je sais bien cependant combien sont vains nos jugements sur les voies de la Providence. Je sais que dans sa terrible magnificence, elle peut créer et faire croître un homme supérieur pour le service d’un dessein, d’une idée destinée après d’infinies transformations à porter son fruit dans quelques milliers d’années. Je sais qu’elle peut fonder l’accomplissement de ses moindres vues sur la destruction de ses plus beaux ouvrages. Et c’est là ce qui m’épouvante sur notre petitesse, bien plus que l’immensité des cieux, le nombre et la grandeur des étoiles. Et pourtant, mon ami, j’ai sur toi, pour toi, de la confiance, beaucoup de confiance. »
Combien il faut que j’en aie en vous, moi, pour vous montrer ainsi toutes choses, tout ce qu’il y a pour moi de plus intime, non seulement dans le présent, mais dans le passé ! Mais, puisque je l’ai cette confiance, pourquoi ne vous la montrerais-je pas ? Pourquoi ne verriez-vous pas vous ce que m’écrivait sur moi-même, il y a seize ans, une âme bien noble et bien tendre ? Eh bien, cette sécurité qu’elle avait sur mon avenir, et qui la rendait patiente, même dans les plus mauvais temps, j’en ai moi-même un peu pour mon propre compte. Je me crois appelé à quelque chose qui en vaut la peine, appelé à relever quelque peu la politique de mon pays à faire rentrer dans des voies un peu régulières, et hautes les esprits et les affaires. Je ne me crois pas au bout de ce que je puis faire en ce sens. Et voulez-vous que je vous dise ? Vous avez beaucoup ajouté à ma tranquillité d’esprit. Vous m’avez donné de quoi attendre. Avant le 15 juin, ma patience était de la philosophie, de la vertu. Aujourd’hui je n’ai nul besoin de vertu, de philosophie. J’ai le fond de la vie. La broderie viendra quand elle voudra. Je la désire. J’y compte. Mais je l’attends et je l’attendrai sans le moindre effort, avec bien moins d’effort qu’il ne m’en faut pour attendre le 31 octobre. Me voilà bien distrait, n’est-ce pas ?
10 heures
Pourquoi enverriez-vous à M. de Lieven votre lettre au comte Orloff ? Pourquoi celle-là et pas les autres ? Il faut, ce me semble les lui envoyer toutes ou aucune. Et je ne vois point de bonne raison de les lui envoyer toutes. Après son procédé vous avez bien le droit de faire vous-même vos affaires sans lui en rendre compte. Si vous deviez gagner quelque chose à lui tout montrer à la bonne heure ; mais vous n’y gagneriez rien. Point de mystère et point de confiance, lui annoncer toutes vos démarches, et ne point lui en raconter les détails, qu’il sache ce que vous faites et demeure pourtant dans l’incertitude sur ce que vous dites qu’il y ait pour lui à votre égard, de la publicité et de l’inconnu, voilà, si je ne me trompe, ce qui vous convient, comme attitude, et aussi pour le succès.
J’ai bien recommandé, et je recommande de nouveau à M. Génie de vous porter lui-même mes lettres ou de vous les faire porter par quelqu’un de très sûr, qui vous les remette tout simplement ou les remporte s’il ne peut vous les remettre. Je n’ose cependant vous garantir toujours l’adresse, le tact. Donnez-moi à cet égard vos dernières instructions. Voulez-vous que j’use souvent ou rarement de ce moyen? J’ai grand peine à croire que M. de Lieven vienne à Paris, sans en avoir reçu l’autorisation formelle et je doute qu’on la lui envoie sitôt. L’affaire traînera davantage. On vous répondra. On disputera. On essaiera quelque nouveau procédé. Du reste, je ne sais ce que je dis. Vous connaissez ce monde là mieux que moi.
11 heures
’aime le N°60. J’aime beaucoup le N°60. J’aimerais encore mieux le pendant de la lettre. Ah ! Si je l’avais ! Si jamais nous nous séparons encore, il faudra que je l’aie. Mais je ne penserai plus, le 31 à aucune séparation. Adieu, Adieu. Adieu comme dans la lettre. G.
51. Val-Richer, Samedi 30 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai tant à vous dire, tant à propos de votre N°51, que je ne sais si je ne ferais pas mieux de faire comme vous voulez, et d’attendre le 6. Je pourrais même attendre plus loin et vous ajourner, pour ma réponse comme je l’ai déjà fait à un an, deux ans. Les ajournements me plaisent. Il me semble que je prends possession de l’avenir. Mais aujourd’hui ; je ne puis pas. Quand je vous vois une idée, une impression qui met entre nous, je ne dis pas un nuage, mais tout ce qu’il y a de plus léger, une plume dans l’air, un grain de sable. Sans vos pas, il faut qu’à l’instant même je la repousse, je l’écarte que je rétablisse, de vous à moi, la parfaite sérénité, la parfaite confiance, la parfaite égalité. C’est mon droit, c’est mon premier besoin, Madame. Je ne puis souffrir que rien manque, dans votre pensée ou dans la mienne à notre affection. Je ne veux la perfection que là ; mais là, je la veux, je la veux tout à fait.
Comment dirai-je ? En y pensant, je trouve ce que vous me dites un peu ridicule et bien plus ridicule d’y répondre. J’ai eu un moment envie d’y répondre en riant, de vous envoyer la lettre d’un homme de vingt ans, bien jeune, bien ignorant bien ignoré, très épris, ne sachant pourquoi, surpris en effet, comme vous dîtes autant que charmé. A coup sûr, vous me l’auriez renvoyée en me disant que la poste s’était trompée, que ce n’était pas moi qui avais écrit cela. Vous vous seriez chargée de ma réponse Madame. Mais quelque vraie que celle-là eût été, je n’en veux pas. J’en veux une sérieuse, très sérieuse. Je ne sais pas rire si près de votre cœur et du mien.
Nous sommes du même âge, Madame. Je conviens qu’à titre d’homme. je suis un peu plus jeune que vous ; et peut-être y a-t-il des mathématiciens, des Statisticiens qui sauraient évaluer en chiffres la différence. Mais moi madame, je ne suis pas un chiffre. Je suis une créature vivante gouverné par mes impressions, mes idées, mes goûts, parfaitement indifférent aux goûts, aux idées et aux impressions des autres, ne tenant nul compte, pour ma vie intime, ma vraie vie, de ce que pensent, font, aiment ou n’aiment pas les autres, ne songeant seulement pas aux conventions, aux habitudes, aux routines des autres, ne consultant que moi, ne croyant que moi et le plus tranquille, le mieux établi des hommes dans mes sentiments et mes plaisirs, quand ils sont tels que je les veux moi, pour moi. Et je suis très sûr que je suis à cet égard, plus exigeant, et plus ambitieux que qui que ce soit.
J’ai épousé une femme qui avait près de quatorze ans de plus que mois, et puis une femme qui en avait quinze de moins. Ni l’une ni l’autre, je vous en réponds, ne s’est aperçue une minute de la différence. C’est que je les aimais vraiment. C’’est qu’elles répondaient vraiment à tous mes goûts, à tous mes désirs. C’est quelles m’aimaient de toute leur âme. Et leur âme était haute, leur cœur tendre, leur esprit rare. Elles appartenaient l’une et l’autre et par leur nature et par leurs habitudes de toute sorte, à la région la plus élevée. Il me faut tout cela. Tant que j’ai vécu auprès d’elles, j’ai senti mon affection croître comme mon bonheur. Et quand Dieu me les a enlevées, j’ai senti que je perdais, non seulement le bonheur dont j’avais joui, mais, un bonheur inconnu, inépuisable, toujours nouveau qu’elles avaient à me donner et moi à recevoir.
Dieu me traite avec une bonté, une magnificence dont je suis à la fois fier et confondu. Il vous amène vers moi, vous venue de si loin, si étrangère à mon pays, à mon passé, si imprévue, pour moi, et pourtant si sympathique à moi, à mes goûts, à mes désirs, à tout mon être, vous d’une si grande nature, d’un esprit si élevé et si aimable, d’un cœur si vif, d’un caractère si passionné et si doux ! Vous arrivez où je suis en deuil, désolée, ne regardant à rien, ne vous souciant de personne, cherchant à votre peine un peu de soulagement à vos ennuis un peu de distraction que vous n’aviez jamais l’air de trouver, donnant à tout le monde, l’idée d’un mal incurable et d’une créature supérieure à jamais abattue, isolée. Et un jour, vous me laissez voir, vous me dîtes que je vous consolerai, que je vous relèverai, que vous m’aimerez, que vous m’aimez, que nous retrouverons vous en moi, moi en vous cette intimité, ce bonheur qui surpassent, qui dominent tout ce qu’il y a sur cette terre, toutes ses joies et toutes ses douleurs ! Voilà ce qui est Madame. Voilà ce qui nous est arrivé à vous et à moi. Et vous venez me dire que vous êtes de dix mois plus âgée que moi ! Et il vous vient de là un doute qui vous préoccupe, qui vous empêche d’avoir foi, pleine foi en moi, dans mon affection, dans votre bonheur. Et vous me demandez si, moi aussi, je ne m’apercevrai pas un jour que je suis dix mois, plus jeune que vous? Ah Madame, que voulez-vous que je vous dise ? En vérité, vous nous replacez trop l’un et l’autre dans la foule. Je ne suis pas modeste. Je veux être pour vous tout ce que vous êtes pour moi, que vous trouviez en moi tout ce que je trouve en vous. Mais on nous faisant trouver. vous à moi, moi à vous, hors de toute prévoyance, de toute attente, quand notre vie intime à l’un et à l’autre semblait finie. Dieu a fait pour nous un miracle. Il y aurait plus que de l’ingratitude, il y aurait de la folie à n’en pas sentir la merveille, à n’en pas jouir avec une reconnaissance, une confiance un ravissement sans mesure comme le bienfait.
10 heures 1/2
Je ne comprends rien, rien du tout à ce retard qui me désespère. Je vous ai écrit comme à l’ordinaire. Ma lettre a dû partir de Lisieux jeudi avant- hier. Vous en aurez eu deux ce matin. C’est impossible, autrement. Mais je n’en suis pas moins désolé. Adieu, Adieu. Vous avez bien raison. Il faut être ensemble. Adieu. G.
48. Val-Richer, Mardi 26 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai aujourd’hui beaucoup de monde à dîner. Demain, je pars de bonne heure pour Croissanville. Je ne vous en dirai pas long. Mais il faut absolument que je vous dise quelque chose, que je vous remercie de ne pas vous agiter de ces misérables tracasseries, des vôtres et des miennes. Je dis misérables de quelque source quelles viennent, d’un trône ou d’un parti. Cela est bien fort ; mais nous sommes plus forts. Vous lisez quelquefois Salomon n’est-ce pas ? Eh bien il a dit cette belle parole, dans le Cantique des cantiques. Fortis est ut mors dilectio. Cherchez au chapitre 8, verset 6. Vous verrez le sens car vous ne savez, dites-vous, que le latin, des Protocoles.
J’ai toujours vu Madame, que quand on était bien décidé, un peu prudent et pas mal spirituel, on surmontait les difficultés une à une à mesure qu’elles se présentaient, des difficultés qui, vues d’avance et en masse, semblent insurmontables. Une seule chose nous importe, c’est d’être l’un et l’autre parfaitement au courant de notre situation, de nos embarras mutuels. Grand soulagement d’abord, grande facilité de plus. Nous unirons tour à tour, contre le problème ou l’embarras du moment nos deux esprits et nos deux volontés. Nous en viendrons à bout, je vous en réponds. J’avais bien un peu prévu ceux qui m’arriveraient du côté de mes amis, mais prévu comme on prévoit, c’est-à-dire vaguement et dans un lointain auquel en regarde à peine. Je suis bien aise de les avoir vus de plus près, et charmé de vous en avoir parlé. Je ne m’en inquiète pas le moins du monde ; bien moins que vous ne devez que nous ne devons nous inquiéter des vôtres. Avec quelques soins, de bonnes conversations, la vérité et la tribune, je dissiperai aisément ces nuages d’intérieur. Ceux de votre horizon à vous, sont plus noirs et plus pesamment chargés. Il faudra que nous y regardions sans cesse que nous nous appliquions, à démêler de loin, à déjouer d’avance les méchancetés, les mensonges. Il y en aura beaucoup. Je vois d’ici comment on les invente, comment on les met en circulation. Je connais ce monde là. Mais, je vous le répète, nous les démêlerons, nous les déjouerons. Ce que je ne connais pas, et à quoi je ne puis pas grand chose, c’est ce qui vient de chez vous ! Vous en serez chargée. Cependant, je vous y aiderai, soyez en sûre. Je vous rendrai, même là, le succès plus facile. Je savais tout ce que vous me dites de votre situation là. Il faut que vous la conserviez cette situation, là et en Europe. Ce n’est pas votre situation, je n’ai pas besoin de vous le dire, qui m’a attiré vers vous, qui m’a attaché à vous. Mais il me plaît que vous l’ayez ; il me plaît qu’elle soit grande, très grande. Il n’y a rien de trop grand pour vous, rien de trop grand selon votre nature et selon mon cœur. Il faut que tout le monde vous voie haut et compte avec vous. Vous serez toujours au dessus de toutes les grandeurs.
Du temps, Madame, du temps et nous : nous arrangerons tout cela. Jamais parfaitement, jamais à notre pleine satisfaction ; jamais assez pour que les ennuis et la nécessité d’y prendre du soin ne recommencent pas sans cesse; c’est la condition de ce monde ; mais assez pour que notre intérêt à nous, notre intérêt si doux et si cher soit assuré et que personne n’ait le pouvoir de nous y déranger.
Mercredi 7 heures
Je partirai, tout à l’heure. J’espère cependant avoir votre lettre auparavant, Un de mes amis de Lisieux, qui vient avec moi à Croissanville, m’a promis de m’apporter ici mon courrier de très bonne heure. Je reviendrai ici ce soir. Oui j’aurais été très étonné de trouver votre salon arrangé comme vous me le dîtes. Peut-être un petit mouvement ... Comment dirai-je ? Je ne sais pas trop je ne me soucie pas d’appeler cela par son nom ...un petit mouvement d’autre chose, se serait mêlé à la surprise. Cependant, dearest continuez, quittez votre place, faites de la musique, cherchez et trouvez un peu de distraction, vous en avez besoin pour votre santé, pour le repos de votre esprit. Je veux que vous en ayez, seulement, quand vous êtes à votre piano, continuez aussi de regarder à la porte pour voir si j’entre.
9 h. 1/2 Je suis obligé de partir sans avoir votre lettre. Cela m’ennuie. J’espère qu’on me l’apportera directement à Croissanville. Adieu donc, cet adieu éternel. Plût à Dieu qu’il fût éternel, mais non pas de loin ! G.
45.Val-Richer, Samedi 23 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous pouvez n’être pas trop contrariée, pas trop en colère comme vous dites, de l’article du Temps, n’y manquez pas, je vous prie. Je n’y penserai plus. J’en ai été préoccupé pour vous. Je vous ai vue inquiète de la plus simple apparition de votre nom dans les journaux. Vous m’avez parlé avec un peu de trouble de quelques lignes de la Presse que la petite princesse vous avait fait remarquer. Les difficultés de votre situation, l’humeur de M. de Lieven le surcroît d’ennui que ces malices là, un peu répétées, pourraient vous causer tout cela, m’est tout à coup venu à l’esprit. Pour moi-même, rien ne m’est plus indifférent, et je n’y aurais fait aucune attention.
Mais j’ai bien envie de vous gronder. Vous ne voulez pas " que je m’inquiète " pour vous, que mon affection pour vous soit pour moi " l’occasion de la moindre peine". Et pour qui voulez-vous donc que je m’inquiète ? D’où voulez-vous que me viennent des plaisirs ou des peines.? Madame, vous avez rencontré sur votre chemin bien peu d’affections vraies. Savez-vous ce qu’il y a dans vos paroles ? La triste habitude de voir l’affection hésiter, reculer, se cacher ou s’enfuir devant la menace, le chagrin, un obstacle sérieux, un grand ennui, un intérêt politique, que sais-je ? J’ai été plus heureux que vous en ce genre. J’ai connu, j’ai goûté des affections étrangères à toutes les craintes supérieures à toutes les épreuves, qui les acceptaient avec une sorte de joie et comme un droit dont elles étaient fières ; des affections vraiment faites for better and for worse et toujours les mêmes en effet dans la bonne ou la mauvaise fortune, dans le plaisir ou la peine, sans y avoir aucun mérité, sans y penser seulement. J’ai appris d’elles à n’y point penser moi-même, à avoir en elles tant de foi que de trouver tout simple que le chagrin leur vint de moi comme le bonheur. Et je suis sûr qu’elles avaient en moi, la même confiance. Que le temps ne nous soit pas refusé, Madame, et cette confiance vous viendra; et vous ne songerez plus à me demander de ne pas m’inquiéter pour vous, de n’avoir point de peine à cause de vous. Et je ne vous gronderai plus comme aujourd’hui.
Dimanche 7 h 1/2 M. Duvergier de Hauranne vient de partir. Nous sommes convenus que nous nous retrouverions à Paris au moment où la dissolution serait prononcée, pour convenir à de ce que nous avions à écrire partout à nos amis. Tout indique que ce sera du 1er au 10 Octobre. Je vais m’arranger pour expédier d’ici là mes affaires électorales de Normandie, pour avoir vu qui je dois voir, être allé où je dois aller, avoir dîné où je dois dîner. Vous n’aviez pas besoin de me faire remarquer votre petite vengeance de ne me parler du retard du mariage de M. Duchâtel qu’à la quatrième page. Je l’avais remarquée dès la première ligne. Mais comment pouvez-vous dire que je vous ai annoncé ce retard froidement ? Votre pénétration est là en défaut. Si vous aviez dit timidement avec crainte à la bonne heure. J’ai craint votre injustice, la vivacité de votre injustice, et le chagrin qu’elle nous ferait à tous les deux, à part l’autre chagrin lui-même, le chagrin fondamental. C’est là, j’en conviens, le premier sentiment qui m’a préoccupé, et qui a pu percer dans ma lettre. Mais froidement ! c’est un vilain mot, Madame, un mot coupable.
Les hommes sont bien malheureux dans leurs relations les plus douces. C’est sur eux que pèsent les affaires, les affaires proprement, dites, politiques, domestiques, ou autres. S’ils ne les faisaient pas bien s’ils n’y suffisaient pas, si leur situation, en était tant soit peu abaissée, leur considération tant soit peu diminué, ils perdraient aussi un peu, beaucoup peut-être, dans la pensée, dans l’imagination, et quelque jour dans le cœur des personnes qui les aiment le plus. Il faut donc qu’ils y regardent bien, qu’ils n’oublient aucune nécessité qu’ils prennent leurs arrangements, leur temps, qu’ils pensent à tout, qu’ils suffisent à tout, que toutes les affaires soient faites, et bien faites. Et quand ils font cela et ce qu’il faut pour cela, on s’étonne, on les taxe de froideur. Ce n’est pas bien, dearest. Cela ne fait que rendre le chagrin plus triste et le devoir plus difficile. Je vous en prie ; ayez avant l’époque où je vous ai ajournée, la foi que vous aurez certainement alors.
Ma mère est mieux. Les bains de pieds et le régime ont fait disparaître les étourdissements & diminué la lourdeur de tête. J’espère que nous n’aurons pas besoin de recourir à d’autres remèdes. Mais cette disposition et ses retours répétés m’inquiètent. Mes enfants sont à merveille. Nous avons depuis quatre jours le plus magnifique temps du monde, un soleil très brillant et qui n’altère point la fraîcheur de la terre. J’ai fait hier et avant-hier avec M. Duvergier, des promenades immenses dans les vallées, dans les bois. Tout le long, tout le long de la promenade, je la faisais avec un autre qu’avec lui, je parlais à une autre qu’à lui. César dictait à quatre secrétaires à la fois. J’ai fait bien mieux que César, quoique je n’eusse que deux pensées et deux conversations. Mais il y en avait une si charmante, si puissante ? L’autre était, à coup sûr, beaucoup plus méritoire que toutes les lettres de César.
10 h 1/2 Je vous remercie mille fois de votre longue, bonne, tendre lettre. Peu m’importent les détails sur M. Molé. Nous en causerons à notre aise quand nous serons ensemble. Car nous serons ensemble. J’en suis bien plus occupé que je ne vous le dis. Je travaille à fixer le jour. J’arrange, je combine. J’espère pouvoir vous le dire positivement demain ou après-demain. Ne parlez pas mal d’Adieu. Tout à l’heure, il y a une minute, je viens de le trouver si doux ! Mais vous savez bien que je suis pour la présence réelle, si fort que vous m’avez reproché de ne pas savoir jouir d’autre chose. Adieu. Adieu. Adieu. G.
42. Val-Richer, Jeudi 21 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime à venir à vous le matin, en sortant de mon lit comme le soir en m’enfermant dans ma chambre. Je n’ai pas pu hier soir. Il m’est arrivé deux visiteurs qui passeront ici deux jours. J’attends aujourd’hui M. Duvergier de Hauranne. Il faut se promener, causer. Mon temps se trouve pris. Je le passerais bien plus doucement à lire, à lire votre lettre d’hier. Vous êtes-vous jamais occupée de magnétisme, de ces contes de gens qui agissent à distance, à très longue distance, qui endorment ou éveillent, troublent ou apaisent à travers l’espace, d’autres gens sur qui ils ont pouvoir ? Je crois à votre pouvoir, à votre magnétisme. J’ai vécu hier, je me suis endormi, je me réveille ce matin sous son action. Ah si elle pouvait ne cesser jamais ! C’est ce qui arriverait si elle n’avait pas tant de lieues à traverser, si nous étions toujours ensemble. Et pourtant, je n’espère plus vous retrouver aussitôt que nous nous l’étions promis. Le mariage de M. Duchâtel ne se fera très probablement que du 2 au 4 octobre. Je vais le savoir positivement aujourd’hui.
De plus le mouvement électoral s’anime dans le pays. On vient, de tous les environs, m’en parler, me demander conseil, chercher une direction, une impulsion. J’agis d’ici, par la conversation, par les visites que je reçois, par quelques courses que je ferai, sur toute la Normandie, c’est à dire sur l’élection de 40 députés. C’est une grande affaire. Il faut que je la mette en bon train. La présence réelle, nous le savons trop, ne peut être remplacée. Pour moi-même, j’ai du monde à recevoir, à aller voir. Mon élection est plus sûre qu’aucune autre. Aucun concurrent ne se présente, ne s’annonce. Cependant je ne serais pas surpris, à quelques petits symptômes bien cachés, bien honteux que vers les derniers jours en ameutant les républicains, les carlistes violents, quelques indices, quelques grognons, on fit une tentative, non pour m’empêcher d’être élu on n’y pense pas, mais pour m’enlever quelques voix et rendre mon élection moins brillante en lui donnant quelque apparence de contestation. Il faut que je déjoue d’avance cette malice. Si elle doit se produire. Et pour cela, j’ai besoin précisément au moment où la fièvre électorale se prononce, où les hommes se rallient et s’engagent d’être sur les lieux de voir, de causer, d’animer tous les miens d’affermir les flottants.
Il y a un canton important, car il contient près de 100 électeurs dans lequel je n’ai jamais mis le pied. Je veux y aller un de ces jours. Je crois à peu de pouvoir réel, mais à beaucoup de mauvais vouloir soufflant contre moi d’un certain point, qui n’est pas un des points cardinaux, quoiqu’il en ait l’air. Il faut que j’agisse au grand jour, pendant qu’on travaille sous terre, que je sois aigle pendant qu’on est taupe. Est- ce là de l’orgueil ou de la prudence, dites, le moi? Tous les deux probablement.
Orgueil ou prudence, dearest, cela me coûte cher, et j’ai là, pour ce moment un cruel sacrifice à faire. Le saurez-vous, le croirez-vous tout ce qu’il est ? C’est ma plus vraie, ma plus triste préoccupation. Oui, si j’étais sûr que notre réunion retardée excite en vous les mêmes sentiments, tous les mêmes sentiments qu’en moi, et point d’autres; si j’étais sûr qu’il ne vous vient aucune de ces mauvaises pensées qui me désolent, et comme injustice et comme preuve que vous ne me connaissez pas encore ; si je pouvais vous faire voir, parfaitement voir mon âme, toute mon âme, comme je vous ai fait voir avant-hier une de mes journées, et dissiper ainsi, dissiper sans retour les doutes coupables de la vôtre, à cette condition là, je n’aurais pas moins de chagrin, mais j’aurais un meilleur chagrin, un chagrin parfaitement confiant en vous, sympathique avec vous, et je ne vous parlerais que de notre chagrin. Si vous saviez qu’elle est à ce moment même en vous écrivant, mon impatience de tout ce que je vous dis là, combien, au fond de mon cœur, je me sens étonné, blessé, pour vous et pour moi de vous le dire, de pouvoir croire que j’aie à vous le dire !
Dearest, que la confiance égale la tendresse, que toutes paroles autres que des paroles de tendresse soient inutiles et ne puissent plus nous venir à la pensée ! Il en sera ainsi un jour ; j’y compte. Vous savez que je vous ai ajournée à un an à deux ans à l’époque qui vous voudriez. Que mon ajournement soit sans objet; épargnons-nous l’épreuve du temps ; soyons, dès aujourd’hui aussi surs l’un de l’autre, aussi établis dans notre foi mutuelle, que nous le serions après l’avoir subie. La vie est si courte ! N’en employons rien à essayer, à attendre ; C’est perdre du bonheur pour rien.
10h 1/2
Voilà le N° 43, que j’aime bien quoique j’aime mieux le n° 42. Oui, nous sommes bien loin. Mais vous m’avez envoyé votre Soleil, hier et aujourd’hui, il est très beau. Le petit tableau est de 1835. Gardons notre goût pour Adieu. C’est un goût d’absent mais, dans l’absence, c’est ce qu’il y a de mieux. Adieu donc Adieu, faute de mieux. G.
39. Val-Richer, Dimanche 17 septembre 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si vous étiez entrée tout à l’heure dans ma cour, vous auriez été un peu surprise. Vingt trois chevaux de selle, deux cabriolets, une calèche. Les principaux électeurs d’un canton voisin sont venus en masse me faire une visite. J’étais à me promener dans les bois avec mes enfants. J’ai entendu la cloche du Val Richer, signe d’un événement. Je ne savais trop lequel. Nous avons doublé le pas, et j’ai trouvé tout ce monde là qui m’attendait. Je viens de causer une heure et demie avec eux de leurs récoltes, de leurs impositions, de leurs chemins, de leurs églises, de leurs écoles. Je sais causer de cela. J’ai beaucoup d’estime et presque de respect pour les intérêts de la vie privée, de la famille, les intérêts sans prétention, sans ambition, qui ne demandent qu’ordre et justice et se chargent de faire eux-mêmes leurs affaires pourvu qu’on ne vienne pas les y troubler. C’est le fond de la société. Ce n’est pas le sel de la terre, comme dit l’Évangile mais c’est la terre même.
Ces hommes que je viens de voir sont des hommes sensés, honnêtes de bonnes mœurs domestiques, qui pensent juste et agissent bien dans une petite sphère et ont en moi, dans une sphère haute assez de confiance pour ne me parler presque jamais de ce que j’y fais et de ce qui s’y passe. Mes racines ici sont profondes dans la population des campagnes, dans l’agricultural interest. J’ai pour moi de plus, dans les villes, tout ce qu’il y a de riche, de considéré, d’un peu élevé. Mes adversaires sont dans la bourgeoisie subalterne & parmi les oisifs de café. Les carlistes sont presque comme des étrangers, vivant chez eux, entre eux et sans rapport avec la population. La plupart d’entre eux ne sont pas violents, et viendraient voter pour moi, si j’avais besoin de leurs suffrages. Du reste, je ne crois pas que mon élection soit contestée. Aucun concurrent ne s’annonce. Ce n’est pas de mon élection que je m’occupe mais de celles qui m’environnent. Je voudrais agir sur quelques arrondissements où la lutte sera assez vive. Je verrai pas mal de monde dans ce dessein. Si la France, toute entière ressemblait à la Normandie, il y aurait entre la Chambre mourante et la Chambre future bien peu de différence ; et j’y gagnerais plutôt que d’y perdre. Mais je ne suis pas encore en mesure de former un pronostic général. Vous voilà au courant de ma préoccupation politique du jour. Je veux que vous soyez au courant de tout.
Lundi 7 h. du matin
Je suis rentré hier chez moi vers 10 heures à notre heure à celle qui me plait le plus pour vous parler de nous. J’ai trouvé mon cabinet et ma chambre pleine d’une horrible fumée. Mes cheminées ne sont pas encore à l’épreuve. Il a fallu je ne sais quel temps pour la dissiper. Je me suis couché après. Aussi je me lève de bonne heure. Laissez-moi vous remercier encore du N°39, si charmant, si charmant ! Qu’il est doux de remplir un si tendre, un si noble cœur! Cette nuit trois ou quatre fois en me réveillant, vos paroles me revenaient tout à coup, presque avant que je me susse reveillé. Je les voyais écrites devant moi. Je les relisais. Adieu n’est pas le seul mot qui ait des droits sur moi.
Je ne vous avais pas parlé de ce petit tableau. J’y avais pensé pourtant, et j’aurais fini par vous en parler. Vous n’en savez pas le sujet. Il est plus lointain, plus indirect que vous ne pensez. En 1833, 34, 35. 36, j’ai relu et relu tous les poètes où je pouvais trouver quelque chose qui me répondit ; qui me fît ... dirai-je peine ou plaisir? Pétrarque surtout m’a été familier. C’est peut-être, en fait d’amour le langage le plus tendre, le plus pieux qui ait été parlé. J’entends parler dans les livres que je méprise infiniment en ce genre, poètes ou autres. Un sonnet me frappa, écrit après la mort de Laure et pour raconter un des rêves de Pétrarque. Je vous le traduis
Ma petite fille aussi est plus jolie que son portrait, des traits plus délicats, une physionomie plus fine. Vous la verrez elle. Je voudrais que vous pussiez la voir souvent, habituellement. Elle est si animée, si vive, toujours si prête à s’intéresser à tout gaiement ou sérieusement ! Elle vous regarderait avec tant d’intelligence. Elle vous écouterait avec tant de curiosité ! Laissons cela. Quand nous aurons trouvé ce que je cherche en Normandie, nous pourrons ne pas le laisser.
Lundi 10 heures 1/2
Voilà le N°40. Je n’ai pas vu cet article de la Presse dont vous me parlez. Je vais le chercher. Je renouvellerai mes recommandations indirectes comme bien vous pensez là du moins mais positives. Ce n’est pas aisé. Mettez sur Adieu tout ce que vous voudrez. Je me charge d’enchérir. Adieu. Adieu. G.
266. Val -Richer, Samedi 14 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Vous avez bien raison ; un bon confident général épargnerait à tout le monde bien des sottises. Que de fois je l’ai pensé sur l’heure même au milieu des affaires ! Que de fois j'ai désiré que quelqu'un fût là, qui vit les choses comme elles étaient, la vérité, et l'allât redire, à ceux qui auraient été charmés de l'apprendre et ne savaient pas la deviner ! Mais il faudrait que le confident eût bien de l’esprit et bien de l’honneur. Ce serait un rôle charmant, autant qu'utile, et qui vous croit à merveille. Que signifie notre mission en Perse ? Allons-nous là pour nous interposer entre St Pétersbourg et Londres ? Je le croirais au choix de M. de Sercey. Je ne sais qui nous allons envoyer aux Etats-Unis à la place de Pontois. Comment M. de Metternich se fait-il accompagner au Johannisberg par M. de Hügel ? Personne ne me paraît moins propre à égayer un malade. Puisque M. de Jennison s'en va décidément. Sachez-moi, je vous prie, si c'est M. de Lücksbourg qui le remplace. Il m’a paru homme d'esprit. Mais bien des gens paraissent gens d'esprit à la première conversation. Je dis de l’esprit comme Solon de la destinée des hommes. " Il n'en faut jamais juger avant la mort. "
Dimanche 7 heures
Quel temps noir et froid. De tous mes souvenirs d’enfance le plus vif est celui du soleil du midi. Je le cherche toujours au delà de ces brouillards. Un ciel sans soleil, c’est un corps sans âme. Vous m’avez bien manqué hier. J’écrivais, sur Washington une page qui m’a amené à un rapprochement entre lui et Cromwell. Le rapprochement est très piquant ; mais je ne suis pas sûr qu’il vienne à propos. Je ne suis pas très sujet au doute ; que la chose soit petite ou grande, je me décide en général, moi même et promptement. Mais quand il m’arrive d’hésiter, mon embarras est extrême, car je suis horriblement difficile, en fait de conseils. Je crois aux vôtres. Vous avez le jugement très sûr et le goût très exigeant. Et cela d’instinct sans longue méditation. Vous me direz votre avis sur la convenance de mon rapprochement.
J’espérais Lady Granville un peu plutôt, tout vient toujours trop tard. Je regrette qu'elle n'ait pas réussi dans sa négociation. En avez-vous quelque autre en vue ? Vraiment il vous faut quelqu'un. Voulez-vous que je fasse chercher ? J’y serai très difficile, aussi difficile que vous. Puis vous verrez. Votre isolement, dans votre home, pour les soin matériel de la vie, m'est insupportable.
9 heures
Je suis désolé, désolé de toute façon. Mais je ne dirai rien aujourd'hui, je ne pourrais pas. Je vous renverrai demain la lettre du Prince Mestchersky. Je veux la relire. Au nom de Dieu ne soyez pas malade. Soyez injuste tant que vous voudrez, mais non pas malade. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie, Discours autobiographique, Portrait (Dorothée)
29. Val-Richer, Lundi 28 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’espère que ma course à Trouville ne causera aucun retard dans mes lettres. Je fais, pour m’en assurer des combinaisons, je prends des précautions très savantes. Par exemple, ce N° ci, je le porterai demain à Lisieux par où je passe et je l’y laisserai en recommandant qu’on ne le mette à la poste qu’après demain mercredi sans quoi, vous auriez deux lettres Mercredi, et point jeudi. Votre n°30 à vous, que j’attends demain, je viens de faire dire qu’on me le garde à Lisieux où je le prendrai en passant ; et aussi le n° 31 que je prendrai après demain, en repassant ce qui fait que je l’aurai deux heures plutôt que si je le laissais venir m’attendre ici. Et mon N° 30 à moi, qui sera daté de Trouville, je le mettrai après demain à la poste à Lisieux en prenant votre n° 31. Je m’amuse à vous raconter tous mes artifices. Qu’on a d’esprit dans le cœur ! De cet esprit là pourtant, vous n’aurez que quelques lignes aujourd’hui, Madame.
Je viens d’écrire je ne sais combien de lettres insignifiantes de vieilles dettes ; j’en suis écrasé. Je me lèverai demain à 6 heures. Il faut que je me couche et que je dorme. Je me soigne. Non, je ne me suis jamais endormi en marchant ; Mais je conçois parfaitement que cela arrive; de tous les besoins physiques, le sommeil me paraît le plus irrésistible. N’essayez jamais d’y résister ; Dormez au bois de Boulogne chez Mad. de Castellane, même près de la petite table à thé. Vous avez si bonne grâce à avoir bien dormi ?
Il était dix heures hier et non pas 9 h. 1/2, quand votre N°28 m’est arrivé. Que n’est-il venu un peu plutôt ? Je penserais avec ravissement à la coïncidence. Mais ne me demandez pas de croire jamais que la distance s’évanouisse. Entre la réalité et le rêve il y a toujours pour moi un abyme. Je sais jouir du rêve pourtant sans m’en contenter. Adieu. Adieu.
Mardi 6 h. 1/2 Je me lève. Je ne fermerai certainement pas cette lettre sans vous dire encore adieu. Je pars dans une demi-heure. La pluie a cessé. Je déteste la pluie. Quand je suis triste, peu m’importe la pluie ou le soleil ; il n’est pas au pouvoir de l’atmosphère de changer ma disposition intérieure. Mais quand j’ai le cœur serein, je veux que l’atmosphère le soit aussi. Le contraste me choque. Il me semble que j’ai en moi de quoi dissiper tous les nuages, et que, s’ils demeurent, c’est moi qui suis vaincu. Dans quelques heures, je me promènerai le long de la mer. Elle n’aura plus pour moi deux rives. Tout est sur la même. Qu’il serait charmant de s’y promener avec vous ! Adieu enfin. Adieu pour tout de bon. G.
27. Val-Richer, Samedi 26 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Me voici rentré dans mon Val-Richer. Le lieu me plaît ; mais qu’importe ? Je vous ai dit, je crois, qu’au milieu des plus grandes scènes politiques en y prenant la part la plus active, l’intérêt le plus vif en y désirant ardemment le succès, jamais je n’avais vu là, jamais je n’avais reçu de là le bonheur, rien qui méritât le nom de bonheur. Il m’est arrivé aussi d’être fatigué, très fatigué de souhaiter le repos, le repos de l’esprit et du corps loin des affaires, loin des hommes, l’oisiveté complète et sinon la complète solitude, du moins sa paix et son silence. Et quand j’ai pu me donner ce repos, j’en ai joui très doucement, presque puérilement. Mais là non plus, je n’ai jamais senti, ni attendu le bonheur. Les hommes se croient heureux à bien bon marché ! Aux uns du pouvoir aux autres du calme ; à ceux-là les applaudissements de la ville à ceux-ci les charmes de la campagne; et ils se disent contents ! Et il y a des philosophes et des poètes pour célébrer l’une ou l’autre de ces situations comme la plus belle ou la plus douce destinée humaine !
Madame, j’ai entendu retentir les applaudissements ; j’ai vu le soleil briller, et la lune dormir sur les plus tranquilles, les plus gracieuses prairies; j’ai connu les joies puissantes du succès et les plaisirs suaves du repos. Tout cela est très superficiel, très incomplet ; tout cela, ne m’a jamais donné que des impressions dont je sentais l’insuffisance en même temps que la douceur. Il n’y a qu’une impression complète, suffisante pour notre âme. Et l’instinct universel, le dit comme moi. Voilà deux créatures qui s’aiment; elles sont ensemble ; elles se partent. Personne ne les a entendues ; elles n’ont parlé à personne. Dites au premier venu qu’elles s’aiment, qu’elles s’aiment vraiment ; et demandez-lui, s’il croit que tant qu’elles s’aiment quelque chose leur manque. Sans hésiter il vous dira non. Allez à elles ; et, si vous avez le courage de les déranger, demandez leur à elles. Même si quelque chose leur manque ; elles vous regarderont en pitié. Prenez toute autre face de la vie, ce qui vous plaira, le pouvoir, la gloire, la science, la retraite, y a-t-il une autre situation à laquelle on puisse adresser la même question et recevoir la même réponse ? Princesse, je dis du repos du Val-Richer comme du bruit de la salle du Palais Bourbon, c’est quelque chose, mais peu bien peu. Je le dis encore bien plus aujourd’hui qu’il y a huit jours.
Quels huit jours ! Les retrouverons-nous ? Nous retrouverons nous jamais à ce point libres et seuls ? C’est là notre plus beau moment m’avez-vous dit une fois ; il est passé ! Dearest, cela n’est pas vrai, quoique vous l’ayez dit. Il y a un genre et un degré de bonheur où il n’y a point de plus beau moment où aucun beau moment ne passe. On ne mesure point ce qui est infini. On ne compare point ce qui est parfait. Il n’en faut croire en de telles choses, ni le raisonnement, ni le langage humain. Le langage est borné et grossier. Le raisonnement est borné et grossier. Il faut s’en rapporter au mouvement instinctif, à la foi intérieure, à la voix inarticulée, de notre cœur. Là, dearest, tout moment près de vous est infiniment doux, parfaitement beau. Et non seulement les plus beaux moments ne sont jamais passés ; mais les moments actuels, les moments qui sont là, sont toujours les plus beaux. Ce qui est vaut toujours mieux que ce qui a été. Ce qui sera au moment où ce sera, vaudra mieux que ce qui est. L’âme ravie et à peine capable de suffire à son ravissement ne conçoit rien de supérieur, rien d’égal. Voilà la vérité, la pure vérité, la vérité de l’amour et du Ciel mille fois plus sûre, plus réelle, que toutes les appréciations, toutes les comparaisons où notre intelligence et notre langage s’épuisent, et s’épuisent sans succès.
Dimanche 9 heures et demie
Je sors de mon lit. J’ai très bien dormi. J’étais fatigué hier au soir. Je me suis couché à 9 heures. Je ne me suis réveillé qu’une fois à 2 heures et pour une demi-heure. Que je voudrais vous savoir un tel sommeil ! J’ai encore un peu d’enrouement bien peu, et de plus en plus en déclin. C’est le seul mal auquel je sois réellement sujet, le seul dont j’aie été une fois assez gravement atteint en 1832, six semaines après mon entrée au Ministère de l’instruction publique. J’ai passé plus d’un mois dans mon lit, complètement dans mon lit. A la vérité je ne m’y étais mis qu’après avoir lutté contre le mal avec une assez sotte obstination, au moins autant par amour propre et pour ne pas céder que par la nécessité des Affaires. J’ai tenu un grand conseil de l’instruction, publique, qui a dure près de deux heures, une demi-heure après m’être fait mettre 40 sangsues et pendant qu’elles coulaient encore. Il y a en nous bien de l’enfantillage. J’ai beaucoup usé de ces organes là ; j’en userai encore beaucoup. Il faut que je le ménage. Il n’est pas du tout affecté en lui-même ; mais toute affection générale s’y porte aussi le repos général me fait-il toujours plus de bien que tout remède particulier.
10 h. Voilà votre N° 28. Moi aussi ce samedi sans lettre me parait horriblement pour vous et pour moi. Mais dormez, dormez ; je vous le demande en grâce. Cela vous va si bien d’avoir bien dormi ! Seulement, dormez dans votre chambre plutôt qu’au bois de Boulogne. Adieu. C’est le vôtre que je vous renvoie avec le mien de plus.
23. Val-Richer, Dimanche 13 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est vrai ; je crains de vous agiter. J’y pense sans cesse en vous écrivant. Je voudrais n’employer avec vous que des paroles, si douces, si douces, de ces paroles qui bercent l’âme et l’apaisent, en lui plaisant sans l’émouvoir. Vous m’avez témoigné, en arrivant à Paris, tant d’effroi à l’idée du trouble qui vous saisirait si j’allais vous voir sur le champ, vous m’avez demandé avec une anxiété si douloureuse, de vous laisser le temps de vous reposer, de vous calmer que je suis moi-même plein de trouble et d’anxiété sur tout ce qui va à vous même de ma part, et constamment préoccupé d’éviter ce qui pourrait vous causer le moindre ébranlement.
Vos lettres d’hier et d’aujourd’hui (N° 22 et 23) me rassurent, un peu. J’en trouve le ton plus tranquille, plus fermé. Cependant j’hésite encore ; je retiens encore mon cœur, ma voix. Je sais tout ce qu’il faut retrancher aux paroles humaines, et combien elles exagèrent en général les faits ou les sentiments qu’elles expriment. Mais avec vous, dearest, je prends tout au pied de la lettre, loin de rien retrancher, j’ajoute. Je crois plus que vous ne me dîtes. Vous ne savez pas tout ce que je vois dans une phrase de vous. J’y vois non seulement ce qu’il y a mais tout ce qu’il y avait en vous au moment où vous l’avez écrite, si votre main tremblait, si votre cœur battait, si vos regards étaient troublés ou sereins, votre contenance animée ou abattue. Et sans y songer, par instinct, je réponds moins à ce que vous me dites qu’à ce que j’ai vu dans votre écriture, dans vos paroles ; en sorte que je réponds peut-être à une impression, très fugitive à un nuage sur votre front à un frisson dans vos nerfs.
Ah l’absence. l’absence ! Madame, la moins lointaine est toujours l’absence avec tous ses vides, tous ses ennuis ! Je vous aime pourtant infiniment mieux à Paris qu’à Londres, Dussé-je ne pas aller vous y voir. Et j’irai cette semaine ; et vendredi, à une heure, je serai hôtel de la Terrasse dans le cabinet devant la fenêtre duquel je me suis tant promène le vendredi soir 30 Juin ! Que vous avez bien fait de vous y rétablir.
10 heures 1/2 du soir
Je vous ai dit que ceci était mon heure mon heure à moi. Tant que le jour dure, quoi qu’on fasse, on appartient un peu aux autres. Les autres dorment. Mes fenêtres sont ouvertes. Il n’y a pas plus de mouvement, pas plus de bruit dans la campagne que dans ma maison. Rien ne vit plus excepté la lune qui regarde tout dormir, et moi qui pense à vous. C’est une étrange impression qu’une joie qui commence et ne s’achève pas, un flot de bonheur qui monte dans l’âme et retombe sur elle ne trouvant pas où se répandre. Le ciel est si pur, l’air si doux, la lune si claire, la vallée si tranquille ! Que je jouirais de tout cela, si vous étiez là ! Mais vous n’y êtes pas. Cet autre soir quand nous sommes revenus de Châtenay, j’étais près de vous ; je vous parlais, vous me parliez. Je n’ai pas regardé le ciel, la lune, la vallée. Je ne leur ai pas demandé de compléter ma joie. Elle était complète, immense. Et tout cela, n’y entrait pour rien, et je n’avais besoin de rien, & cette boite où nous roulions ensemble était pour moi toute la nature. Ne retournerons-nous jamais à Châtenay ?
Lundi 8 heures 1/2
Vous me demandez d’être toujours pour vous ce que j’étais en vous écrivant les N°12 et 13. Dearest, j’ai éprouvé bien rarement en ma vie les sentiments que ces lettres-là vous expriment sans doute, comme toutes les autres ; mais quand ces sentiments sont nés en moi, ils n’ont jamais changé, jamais faiblis. La cause en est si rare, l’effet si puissant et si doux ! Je suis, en fait d’affection et de bonheur mille fois plus difficile que je ne le puis dire. J’y veux, j’y veux instinctivement, absolument des conditions que Dieu ne réunit guère. Et quand il lui a plu, quand il lui plaît de ne traiter avec cette faveur immense, je vivrais mille ans sans épuiser son bienfait. Ceci est la dernière lettre à laquelle vous répondrez. Elle vous arrivera Mercredi, et j’aurai votre réponse. Jeudi à Lisieux où je la prendrai avant de partir pour Paris. Quelle parole! Adieu. Adieu. G.
21. Val-Richer, Vendredi 11 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ne me redites pas, ne me dites jamais ce que vous me dites aujourd’hui ce que Lady Granville vous a dit, ne vous disais-je pas moi, il y a quelques jours, que j’ai l’imagination malade sur la santé de ce que j’aime ? Mon plus jeune enfant ce bon petit garçon, qui un air si doux, si gai, de si beaux yeux bleus, presque les yeux de sa mère, que de temps, il m’a fallu pour le regarder sans le plus douloureux sentiment d’indignation, de révolte contre moi-même ! Voir mourir en couches la femme qu’on aime ! Madame, c’est affreux, c’est abominable ! Comment s’en console-t-on ? Quand j’ai vu ensuite mourir mon fils, si jeune, si beau, si fort, j’ai été saisi d’horreur ; j’ai regardé avec effroi mes autres enfants tout ce que j’aimais au monde ; dix fois, vingt fois, je les ai vus mourir. Vous avez fait rentrer dans mon cœur d’autres impressions, des impressions douces, heureuses, presque confiantes. Et voilà que d’un mot vous touchez à ma plus sécrète, à ma plus cruelle blessure ! Dieu m’aurait destiné à entrevoir sans cesse ses Chefs-d’œuvre, son Paradis, pour les voir, sans cesse disparaître. Il m’aurait choisi pour ce supplice là ! Il ne me donnerait que pour m’ôter ! Cela ne se peut pas. Je n’ai pas mérité cette malédiction.
Au nom de Dieu ne me dites pas cela, ne le pensez pas surtout. Il y a des choses qu’il ne faut pas penser. Mais vous ne le pensez pas. Pourquoi le penseriez- vous ? On vous assure, vous m’assurez qu’il n’y a rien de grave. On ne vous prescrit aucun remède qui indique une vraie maladie. Il vous faut du repos, beaucoup de repos, de l’air, pas de mouvement. On peut s’assurer cela. Enfin, dans huit jours, j’irai y voir. Hélas, je sais trop qu’il ne sert à rien d’y voir ! Mais je compte sur le repos, le repos doux, prolongé de l’âme comme du corps. Il faut que vous l’ayez. Je veux que vous l’ayez. Je ferai ce qu’il faudra pour que vous l’ayez. Je m’en irai, je resterai, je parlerai, je me tairai. Je comprends que ce qui vous émeut, ce qui vous occupe un peu sérieusement ne vous vaille rien. Nous y pourvoirons de près, de loin, dans nos conversations, dans mes lettres, je ne ferai que vous distraire rien que vous distraire, amuser doucement votre imagination, votre esprit. L’ennui ne vous est pas meilleur que l’excitation. Nous les éviterons l’un et l’autre. Dearest, ayez courage, ayez confiance, pour moi comme pour vous. Pensez à l’avenir. Nous avons tant de choses à nous dire, tant de choses à faire l’un pour l’autre, l’un près de l’autre dans l’avenir !
En les attendant ces belles ces bonnes choses-là, savez-vous ce que je fais ici aujourd’hui ? Je fais nettoyer, dégager de roseaux, de plantes aquatiques, de vase, une pièce d’eau qui sera dans mon jardin et sur laquelle je vais établir deux cygnes qu’un de mes voisins à élevés pour moi. Des cygnes ce sont des oiseaux de votre pays, des pays du Nord, s’il est vrai que là soit votre pays. Dans les grands hivers, quand ces beaux oiseaux trouvent en fin leur climat trop froid, ils prennent leur vol, ils viennent chez nous. J’en ai vu arriver ainsi à tire d’aile un peu fatigués, un peu maigris, mais toujours si beaux ! Nous les accueillons nous les attirons ; nous leur arrangeons, des pièces d’eau bien calme, bien pure, sous un ciel bien doux, au milieu de gazons bien verts. Ils s’y trouvent bien ; ils ne s’en vont plus; ils ne volent même jamais bien loin. Ils ont raison; et nous aussi Madame, qui prenons, à les recevoir et à les garder, tant de plaisir. Certainement, je vous écrirai, je vous écris tous les jours.
Rappelez-vous que je vous ai demandé compte de l’emploi de votre journée, un vrai compte pour moi comme celui que je vous ai rendu de la mienne. Il y aura dans le vôtre, sinon plus de visites, du moins plus de conversations que dans le mien. Je ne cause ici avec personne, quoique je parle beaucoup et à beaucoup de gens. Vous me ferez aimer Lady Granville que je connais à peine après l’avoir tant lue. Comment se fait-il qu’on se demeure à ce point étrangers en vivant si près ; tandis qu’ailleurs un moment suffit ? J’ai tort de demander ce pourquoi-là, car je le sais.
Adieu. On vient me chercher pour voir quelque chose au travail de la pièce d’eau. Il est bien convenu que je partirai le 17 pour être à Paris le 18. Vous m’écrirez donc jusqu’au 16 inclusivement, car votre lettre du 16, je l’aurai le 17, avant de partir. G.
20. Val-Richer, Jeudi 10 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Non Dearest vous ne rêvez point. Je l’espère bien. Qui perdrait plus que moi au réveil ? Que vous êtes aimable! Ce n’est point à St Ouen que m’a femme s’occupait de charité. Je n’avais point le Val-Richer alors. Je l’ai acheté l’année dernière. C’est à Paris, d’ans le faubourg St Honoré, où elle s’était chargée des pauvres d’un côté de la rue de la Madeleine et où pendant le choléra elle les soignés si bien que de ses pauvres, il ne mourut qu’une vieille femme de 32 ans. Ici, il y a peu de charités à faire. Les moindres paysans possèdent et cultivent quelques champs qui leur suffisent. Ils sont assez fiers d’ailleurs, et tiennent à ne rien recevoir. L’école; qui n’est pas mauvaise est située dans un village voisin où les enfants se rendent ; en hiver surtout ,car pendant l’été ils sont occupés aux travaux de la campagne. Le cottage dont je vous ai parlé appartient à un habitant de là commune qui l’a prêté au curé jusqu’à ce qu’un presbytère soit construit. C’est de ce presbytère que nous avons besoin, et c’est là que vous m’aiderez puisque vous le voulez. Nous en causerons quand je vous verrai. Car je vous verrai, J’ai mon jour devant moi ; j’y marche.
Si je pouvais presser le temps comme l’aiguille de ma pendule ! Il faut que j’en convienne. Dieu à bien fait de ne pas nous laisser régler l’allure du temps. Comme nous la précipiterions tantôt pour fuir la douleur tantôt pour arriver à la joie ! Employez bien du moins toutes vos journées d’ici au 18. Reposez-vous calmez vous, promenez-vous, fortifiez-vous. Je répète toujours la même chose. Comment faire autrement quand il n’y en a qu’une ?
Vous voulez savoir comment ma journée à moi, est réglée, quelles sont mes habitudes. Les voici. Je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais voir ce que font mes ouvriers, car j’en ai encore. Je me promène un moment. J’entre chez ma mère, chez mes enfants. Il sont encore aux bains de mer pour tout ce mois. Remonté dans mon cabinet j’écris mes lettres ; j’attends la poste. Je l’attends toujours même quand elle arrive plutôt que je ne dois l’attendre. La poste venue, je me donne plein loisir, pleine liberté jusqu’au déjeuner; je lis, je relis, je marche, je m’assieds, je rêve, c’est mon moment de plus grande complaisance pour moi-même.
Nous déjeunons à 11 heures. Après le déjeuner, on passe une demi-heure, une heure ensemble dans le salon ou dans le jardin. Vrai jardin de curé encore je ne me suis ruiné cette année que dans la maison, je me ruinerai l’année prochaine au dehors, à faire un jardin. J’ai du gazon, des arbres, de l’eau qui court de l’eau qui dort, du mouvement de terrain, des points de vue. L’espace est petit ; cinq ou six arpents seulement ; mais les près et les bois l’entourent et l’étendent indéfiniment. Je ferai quelque chose de gracieux au milieu d’une solitude assez sauvage.
Vers une heure tout le monde est rentré chez soi. Mes filles viennent dans mon cabinet, lire avec moi de l’anglais, et causer. Je crois à la conversation, surtout quand elle est affectueuse quand un peu d’émotion se lie aux idées, et les fait pénétrer plus avant que dans l’intelligence seule. Ma fille aînée, elle a huit ans, aime passionnément la conversation, & la sienne en est presque déjà une pour moi.
Il y a quelques jours à Trouville, j’étais préoccupé, triste. Je ne sais plus de quoi. Elle était là; elle vint tout à coup se jeter dans mes bras en me disant tout bas et toute rouge; « Mon père, à quel age aurai-je toute la confiance ? Elle appartient à la petite armée des natures d’élite. Mes filles parties, je m’occupe, je lis, j’écris. Je reçois qui vient. Nous dînons à 6 heures.
Après dîner, on se promène on on reste ensemble ou seuls, chacun à son gré. Je protège la liberté des autres pour garder la mienne. Le soir, quand il n’y a point d’étranger on se réunit dans la chambre de ma mère, à qui cela est plus commode. Je fais une lecture, pour l’amusement de mes enfants, un romans de Walter-Scott, un voyage. Ils vont se coucher à 9 heures ; et avant 10 heures, je rentre chez moi; j’ouvre mes fenêtres. Le ciel est souvent beau. Le calme profond : la lune éclaire et endort toute ma vallée. C’est mon heure à moi. Prenez-la, Madame ; mettez-y ce que vous voudrez ; à coup sûr, je l’y mettrai ; je l’y ai déjà mis.
16. Val-Richer, Samedi 5 août 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes en France, peut-être déjà en route pour Paris. Cette lettre-ci va vous à chercher. Puis, j’irai moi-même. J’espère savoir bientôt avec certitude, quel jour vous y arriverez. Je dis avec certitude, comme si vous n’étiez pas souffrante, comme si la mer était toujours calme, la poste toujours régulière. Je me parle comme à un malade, avec une confiance que je n’ai pas. Je m’attends au contraire, ces jours-ci à d’amères impatiences. J’ai eu hier, en partant de Caen votre N°16, peut-être le dernier d’Angleterre, car il va jusqu’au lundi 31 et vous avez dû partir le mardi. Peut-être aussi m’aurez-vous écrit de Broadstairs. Vous n’aurez pas attendu jusqu’au jeudi ou vendredi, jour de votre arrivée à Boulogne.
Je vous fais assister à tous mes calculs. Ce n’est pas vrai. J’en retranche beaucoup. Enfin, que je vous sache rétablie à Paris, et pas trop fatiguée. Ce sera un pas immense. Vous êtes donc maigrie, changée, vous avez de la fièvre. Il y a en sentiment douloureux, abattu dans toutes vos paroles même dans les plus douces paroles. Je vous regarde d’ici ; je vous écoute ; je veux voir ce qui se passe en vous, au fond de votre santé. Dearest, que Dieu vous garde, et vous soigne et veille sur vous à toute heure ! Nous avons tant souffert l’un et l’autre avant de nous rencontrer! Il ne se peut pas que nous soyons destinés à devenir, l’un pour l’autre, une cause de souffrances nouvelles.
J’en devrais être bien désabusé, cependant, je ne puis me persuader que notre cœur soit sans pouvoir sur le sort, la santé, la vie de la créature, à qui il se donne, que cet élan si passionné si continu, de toutes les pensées, de tous les vœux ne monte pas aussi haut qu’il faut monter pour se faire entendre et obtenir quelque chose. Personne n’est plus convaincu que moi que les décrets de la Providence sur chacun de nous sont un mystère, un mystère impénétrable aux plus perçants, aux plus ardents regards humains. Mais précisément parce qu’il y a là un mystère nous ne pouvons, nous ne devons jamais être sûrs que nos efforts et nos désirs soient vains. J’ai vu le succès manquer aux plus tendres soins aux plus vives prières. Mais j’ai vu aussi le salut venir à leur suite. Et qui sait ? ... Madame les ténèbres, nous ne savons pas. C’est là le principe de ma confiance. J’ai vécu avec tous les gens d’esprit voix de mon temps et de tous les temps. J’ai beaucoup entendu, beaucoup lu sur les rapports de l’homme avec Dieu, sur l’action de Dieu dans les destinées de l’homme sur l’efficacité ou la vanité de nos efforts, de nos prières. J’y ai moi-même beaucoup pensé, et aussi rigoureusement que les plus rigoureux philosophes. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Croyants où incrédules avec ou sans espérance, nous agissons, nous prions. Quand le mal est là, quand le besoin du secours nous presse, il n’y a personne qui ne prie ne fût-ce qu’en levant les yeux au ciel, et par un de ces élans soudain, involontaires, que la réflexion ne gouverne point. Où vont, que font nos prières? Le croyant les voit avec confiance monter jusqu’à Dieu qui les exaucera. L’incrédule les voit tomber à ses pieds et sourit orgueilleusement de sa propre faiblesse. Le croyant se trompe dans sa sécurité et l’incrédule dans son orgueil. Encore une fois, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. Mais cette ignorance insurmontable, native, finale n’est pour moi qu’une raison de plus de m’efforcer et de prier d’agir de tout mon pouvoir et de demander de tout mon cœur. Je suis dans les ténèbres devant le sanctuaire où la lumière est renfermée et d’où elle ne sortira point à ma voix. Mais je sais qu’elle est là, et je l’invoque ; et j’attends le résultat avec une anxiété douloureuse mais non glaciale sans certitude, mais non sans espoir.
2 heures
Je comprends parfaitement l’impression que vous a faite la musique. Il m’est arrivé quelque chose de semblable, pas tout à fait cependant. J’avais été près de trois ans sans entendre aucune musique. J’en avais peur. Une circonstance obligée me fit aller aux Italiens. On jouait Otello. Ma première impression fût extrêmement douce, une impression de laisser-aller, de détente, d’attendrissement sans retour sur moi-même. J’écoutais, je recueillais avidement les sons, comme une plante la rosée. Tout à coup je me rappelai qu’un jour, quand je n’étais pas seul, dans une loge voisine j’avais entendu ce même Otello, j’avais joui de mon plaisir et d’un autre plaisir qui me plaisait encore plus que le mien. Toute impression douce s’évanouit. Je sentis le mal remonter dans mon cœur. Je m’en allai. Depuis, je suis retourné deux fois, je crois, aux Italiens, mais sans plaisir ni peine. Aux concerts des Tuileries, la musique ne m’atteint pas. Vous m’avez parlé un jour de votre musique à vous, de votre manière de jouer, d’appuyer doucement et profondément sur les passages propres à saisir l’âme ! Voilà ce que je voudrais entendre, entendre seul avec vous !
On vous portera cette lettre. On vous la remettra à vous-même, Lundi soir ou mardi matin, si comme je le pense, vous êtes arrivée à Paris. Répondez moi tout de suite. Si je recevais plutôt un avis certain de votre arrivée, je partirais peut-être un jour plutôt. Enfin le temps marche. Que de choses à nous dire. Adieu. Adieu.
13. Val-Richer, Samedi 29 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
C’est mon tour d’attendre et de me désoler en attendant. Pas de lettre encore ce matin. Je m’étais levé en disposition si confiante, si douce ! Il y a deux mois, je n’éprouvais point de vicissitudes, pareilles. Je n’attendais rien. Avec quelle promptitude, avec qu’elle vivacité j’ai recommencé à vivre ! Car c’est là vraiment la vie. Nous nous connaissons à peine, Madame; nous nous sommes entrevus. Je sais bien qu’en un jour en une heure, nous en avons plus appris l’un sur l’autre que tant de gens n’en apprennent à passer leur vie ensemble. Tout ce que nous ne savons pas, tout ce que nous ne nous sommes pas dit, nous le pressentons ; et au moment où nous nous le dirons, il nous semblera que nous l’avions toujours su, que nous nous l’étions dit mille fois. Cependant il est étrange de se sentir si intimement uni à une personne qu’on a vue, qui vous a vu quinze jours.
Si ma vie extérieure, et ma vie intérieure étaient bien semblables, j’aurais moins ce sentiment là ; je pourrais me croire plus connu de vous. Mais, à la voir du dehors j’ai mené une vie toute d’action, toute vouée au public, qui a dû, qui doit paraître surtout ambitieuse, personnelle, presque sévère. Et en effet j’ai pris et je prends à ce qui m’a occupé aux études, aux Affaires, aux luttes politiques un grand, très grand intérêt. Je m’y suis adonné, je m’y adonne avec grand plaisir comme à un emploi naturel et satisfaisant de moi-même. J’y désire vivement l’éclat et le succès. Et les douloureuses épreuves que Dieu ma fait subir n’ont point changé en cela ma disposition, ni mon goût. Aux jours mêmes de l’épreuve je ne me suis point senti indifférent aux incidents de ma vie publique ; et tout en en portant le poids avec le plus pénible effort, j’y ai toujours trouvé une diversion puissante et librement acceptée. Et pourtant, j’ai le droit de le dire après ce que je dis là et pourtant là n’est point du tout, là n’a jamais été ma véritable vie ; de là je n’ai jamais reçu aucune émotion, aucune satisfaction qui atteignit jusqu’au fond de mon âme ; de là ne m’est jamais venu le sentiment du bonheur. Le bonheur, Madame, le bonheur qui pénètre partout, dans l’âme, qui la remplit et l’assouvit tout entière est quelque chose de bien étranger de bien supérieur à tout ce que la vie publique peut donner. Au delà bien au delà de tous les désirs d’ambition et de gloire, de tous les plaisirs de domination, de lutte, d’amour propre et succès, il y a un désir, il y a un plaisir qui a toujours été pour moi le premier, tellement le premier que j’aurais droit de le dire le seul ; le désir, le plaisir d’une affection infinie, parfaitement égale de cette affection qui unit et confond deux créatures de cœur, d’esprit, de volonté, de goût, qui permet à l’âme de se répandre dans une autre âme comme la lumière dans l’espace, sans obstacle, sans limite, et suscite dans l’une et l’autre toutes les émotions, tous les développements dont elles sont capables, pour leur ouvrir autant de sources de sympathie, et de joie.
Vous êtes-vous jamais figurée, Madame, vous qui sentez si vivement la musique, vous êtes-vous jamais figuré quel serait le ravissement de deux harpes bien harmonieuses & jouant toujours ensemble, si elles avaient la conscience d’elles-mêmes et de leurs accords ? Voilà le bonheur, voilà le seul sentiment, le seul état auquel je donne ce nom. Eh bien madame, j’ai cru entrevoir que vous aussi, vous étiez de même nature, que pour vous aussi, les préoccupations et les intérêts extérieurs, politiques, quelle qu’eût été leur part dans votre vie, ne suffisaient point à votre âme, que vous y trouviez un bel emploi de votre esprit si actif, si élevé, si fin ; mais que vous aviez en vous bien plus de richesses que vous n’en pouviez dépenser là, et des richesses, qui ne se dépensent point à cet emploi-là. En sorte que vous m’avez apparu comme une personne qui comprendrait et accueillerait en moi ce qui se montre et ce qui se cache, ce qui est pour le monde et ce qui est pour une seule personne au monde. Voilà par où Madame vous avez eu pour moi tant d’attrait ; voilà pourquoi d’instinct comme de choix, je me suis engagé si avant et si vite dans une relation si nouvelle. Je ne me suis point trompé, je ne me trompe point n’est-ce pas ? Ni vous non plus ? Nous sommes bien réellement tels que nous nous voyons ? J’en suis sûr, très sûr ; mais à chaque nouveau gage de certitude, à chaque fait, à chaque parole qui vous révèle de nouveau à moi telle que je vous sais à chaque pas de plus que je fais dans un si beau et si doux chemin, je suis ravi comme si je découvrais de nouveau mon trésor. Que vos lettres m’arrivent donc ; il ne m’en est pas venue une seule qui n’ait ajouté à ma foi, et à ma joie. Dimanche, 1 heure. La poste n’arrive pas. D’après les arrangements que j’ai pris elle doit être ici tous les jours, à 10 heures.
Décidément les champs, les bois, les lieux solitaires, tout cela ne vaut rien ; tout cela jette dans les relations une irrégularité, une incertitude que rien ne peut compenser. A Paris tout est ponctuel, assuré. A Paris j’aurais votre lettre depuis plus de trois heures. Car j’en aurai une aujourd’hui. J’y compte. Je vais demain mener ma mère et mes enfants aux bains de mer à Trouville. J’en reviendrai le surlendemain par Caen où l’on veut me donner un banquet. Il y aura encore là des dérangements, des retards.
Quel ennui ! Madame il ne faut par se séparer. Demain, je serai au bord de cette mer qui nous sépare. Mes regards, ma pensée, s’élanceront à l’horizon, vers l’autre bord. C’est là que vous êtes, là que je vous trouverais. Je ne puis m’accoutumer à l’impuissance, humaine, à ce perpétuel et vain effort de la volonté contre des obstacles qu’après tout, si elle voulait bien presque toujours elle pourrait surmonter. Mais les impossibilités morales, les convenances, les liens, les devoirs ! Madame, il me faut une lettre.
4 heures La voilà, et je n’en ai jamais reçu une qui valut celle-là. Vous revenez plutôt, bien plutôt ! Je me tais, je me tais. Mais c’est le N°14 qui vient de m’arriver. Je n’ai pas eu le n° 13. C’est ce qui m’explique le retard. Je l’aurai probablement demain. Je n’en veux perdre aucune. Je vois que vous avez eu mon N°6 car cette lettre-ci porte l’adresse que je vous y donnais.
Adieu adieu. Que l’air est doux et léger ! G.
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
4. [Paris], Vendredi 7 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous voilà à Londres. Et vous avez été, en y arrivant bien émue, mais pas bouleversée pas malade. J’en tremblais. Et il est si triste de trembler de loin ! Je sais ce que c’est de trembler de près, de voir souffrir à côté de soi, d’assister minute par minute aux douleurs du corps et de l’âme. C’est affreux. Et pourtant il reste toujours au fond du cœur je ne sais qu’elle foi dans la puissance de l’affection qui vous persuade que, même sans y rien faire, vous soulagez, en les ressentant, en les voyant, les souffrances d’un être chéri. Et il y a du vrai dans cette foi, car enfin, un mot, un regard. une chaise rapprochée, une main pressée, C’est quelque chose, c’est beaucoup. Mais de loin, les plus douces paroles, les regards, les plus tendres, les plus ardents élans du cœur se perdent dans ce espace immense, vide, froid, qui vous sépare. J’ai toujours trouvé qu’on prenait trop aisément son parti de la séparation, qu’on n’en prévoyait jamais tout le mal. Quand on le prévoyait, quand on le sent tout entier, on a bien plus de mérite qu’on ne croit à y consentir, car on fait bien plus de sacrifices qu’il ne paraît. Le pauvre Brutus se trompait beaucoup s’il est vrai qu’il ait dit en mourant : " Ô vertu, tu n’es qu’un vain nom ! " Il faut que la vertu soit au contraire quelque chose de bien réel, car elle impose, et on accepte, pour lui obéir, de bien lourds fardeaux.
J’aime John Bull de vous avoir si bien reçue. Mais une autre fois, ne prenez personne pour votre fils. Comme à vous, les cottages de votre route me paraissent charmants, et j’y vois tout ce que vous avez pu y voir. Cependant. croyez-moi quelque heureuse que vous y fussiez, votre pensée votre caractère, toute votre âme se trouveraient bien à l’étroit dans un cottage. Il faut que le chêne s’étende, que le palmier s’élance, que la rose s’épanouisse. Nul n’est bien que dans un habit à sa taille ; et notre taille, Madame ce n’est ni vous, ni moi qui la réglons ; nous n’y pouvons pas plus retrancher qu’ajouter une coudée. Acceptons donc, quelque lourd qu’il puisse être quelques fois. l’habit qui nous va. Mais sous tous les habits, dans toutes les situations, les sentiments simples naturels, les sentiments primitifs et puissants qui sont le fond de l’âme humaine doivent trouver leur place et garder leur empire. Je ne sais ce qui a pu arriver à d’autres ; pour moi, je n’ai jamais éprouvé que les grands désirs, les grands travaux de la vie publique étouffassent, altérassent le moins du monde en moi, le besoin d’affection bien reçue, passionnée de sympathie intime, les joies du cœur et de la famille, tout ce qui remplit et anime la vie privée des hommes. Plus au contraire mon esprit s’est élevé et ma destinée s’est étendue, plus ces sentiments se sont développés en moi: plus ils me sont devenus chers ; plus même ils ont gagné, je crois en énergie, en fécondité en délicatesse! Il me semble qu’ils ont toujours participé au progrès général de mon être, et qu’en montant un échelon de plus, je n’ai jamais laissé en arrière aucune partie de moi-même. Il est vrai aussi que je suis devenu de plus en plus difficile pour la satisfaction intérieure de ces sentiments si doux de plus en plus exigeant quant aux mérites, aux perfections de leur objet. En ceci comme ailleurs, mon ambition a toujours été croissante, et je n’ai jamais accepté ni mécompte ni décadence. Mais en ceci surtout, ma plus haute ambition est satisfaite, car il a plu à Dieu de placer sur ma route des créatures dont la rencontre est de sa part, un bienfait infiniment supérieur à tous ses autres dons.
Samedi 8. Je n’ai pas eu de lettre hier. Vous l’avez peut-être adressée au Val Richer, m’y supposant déjà. Elle m’y attendra ; mais en attendant elle me manque beaucoup. J’espère que les miennes vous arrivent exactement Je ne sais que vous dire de ma course à Châtenay. J’ai été là dans l’état intérieur le plus mêlé, le plus combattu, tantôt charmé d’y être tantôt m’y trouvant plus seul que partout ailleurs. "Cette fois vous venez pour moi.» m’a dit Mad. de Boigne. Elle m’a parlé de vous, très bien, selon le monde. Le monde vous trouve très aimable Madame mais il vous craint un peu. Il lui semble que vous le regardez d’en haut, vous mettant plus à l’aise avec lui que vous ne lui permettez de l’être avec vous. Il soupçonne qu’au fond vous êtes un peu autre que vous ne lui paraissez. N’y ayez point de regret. La familiarité du monde n’est pas bonne ; il faut toujours se montrer à lui un peu dans le lointain et lui rester un peu inconnu.
Les bruits de dissolution prennent ici depuis deux jours, assez de consistance. Je suis allé avant. hier soir à Neuilly prendre congé du Roi et de la Reine. Le Roi, n’y était pas. Je n’ai donc point eu de conversation sur laquelle je puisse former quelque conjecture. En tout cas, les élections n’auraient probablement lieu qu’au mois d’Octobre. L’indisposition de M. le Duc d’Orléans n’était rien du tout, un pur accès de fièvre éphémère. Il passe demain une revue de la garnison de Paris. Les propos qui couraient sur son désir de commander lui-même, l’expédition de Constantine étant tout à fait tombée. Adieu., Madame. Je vais recommencer à trier dans ma bibliothèque les livres que je veux envoyer à la campagne. C’est un travail presque mécanique qui me convient à merveille. Mon âme pendant ce temps pense à qui elle veut. va où il lui plaît. Adieu. G.
3. [Paris], Mardi 4 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Princesse
Ni moi non plus, je n’aime pas les souliers étroits. Vous pouvez vous en apercevoir. à dire vrai, et vous me passerez le terme, ce qu’il y aurait de plus agréable, ce serait de marcher pieds nus. Mais comme cela ne se peut, comme il faut avoir des souliers, je les aime mieux étroits que de ne pas marcher du tout. Y pensez-vous de me demander s’il ne vaudrait pas mieux laisser-là notre correspondance ? Madame on ne laisse pas comme on veut ce qu’on n’a pas pris parce qu’on le voulait. J’ai bien mis quelque chose du mien dans ma propre destinée ; et pourtant ce que j’y ai mis est bien peu à côté de ce qui m’est venu d’en haut... oui d’en haut, sans que je le demandasse et quand je n’y songeais pas. J’ai joui très vivement du bonheur. Le bonheur perdu, le vide est resté tet qu’il s’était fait ; je l’ai senti tous les jours sans chercher à le combler. Quand je l’aurais voulu, je ne l’aurais pas pu. Nous sommes, vis-à-vis de notre cœur malade, comme les Danaïdes vis-à-vis de leur tonneau ; ce que nous y mettons nous-mêmes ne le remplit pas. A une main plus puissante et plus riche il appartient de fermer l’abyme et d’y verser de nouveaux dons. Irons-nous, s’il lui plait de s’étendre avec bonté sur nous, irons-nous retuser son bienfait ou disputer sur le prix ? Non, Madame, non, il faut accepter, et jouir, et payer aussi cher que celui qui donne l’exigera. Vous allez retrouver, vous aurez retrouvé, quand cette lettre vous arrivera, de déchirants souvenirs ; mais tout déchirants qu’ils sont, à coup sûr vous ne voudriez pas les arracher de votre âme, vous ne voudriez pas ne pas avoir possédé les nobles enfants que vous avez perdus.
Un homme qui honorerait, il y a bientôt 200 ans le pays où vous êtes, le Duc d’Ormond, l’ami de Charles 1er disait, à la mort de son fils le comte d’Ossory tué en duel par le Duc de Buckingham. " Jaime mieux, mon fils mort que tout autre fils vivant. " C’est ce que je dis tous les jours du mien, et vous des vôtres; et nous aimons mieux ces maux, ces joies et ces douleurs inséparablement unis et confondus, que toute autre vie qui ne serait pas nous et ceux que nous avons aimés. Et si un beau jour se lève encore sur notre horizon, si une douce musique comme vous dites, vient encore frapper notre oreille, nous l’accueillerons nous en jouirons avec transport, qu’elles que soient les lacunes et les chances que la Providence y voudra attacher. En tout cas je réponds du manteau de Raleigh. C’est à vous, Madame, de me dire si vous croyez à sa puissance. N’ayez du moins à ce sujet que des émotions douces. J’ai le droit de vous le demander. Et puis, ne pensez jamais le moindre mal du 15 juin. Et puis encore écrivez-moi toujours comme vous m’avez écrit d’Abbeville et de Boulogne, dites-moi, taisez-moi tout ce que vous voudrez. Je jouirai des paroles; j’aurai foi au silence. Je vous défie d’inventer dans votre esprit, de trouver dans votre cœur de femme, quelque chose que je ne comprenne pas, si tant est que je ne l’ai pas devancé.
Mercredi 5 Je n’ai pas de lettre aujourd’hui. Je n’en espérais pas. Demain, j’y compterai. Je passe mes matinées d’une façon utile j’espère, mais bien monotone. Tout ce monde qui part, les députés surtout, viennent me dire adieu. Et la même conversation recommence avec chacun. Que le cercle où vivent la plupart des hommes est éteint et pauvre ! J’en suis toujours frappé à la fin d’une session. Ils sont tous épuisés, exténués d’esprit et de cœur. Ils ont évidemment dépensé, et au delà tout ce qu’ils avaient d’idées, de volonté, de force. Ils se traînent, ils baillent ; ils ont hâte d’aller se coucher et dormir. De toutes les conditions de la supériorité et de la puissance, l’activité, l’activité inépuisable est peut-être la première. J’ai beaucoup vécu avec le Maréchal Soult ; nous avons été près de trois ans ministres ensemble ; et pendant ce temps, j’ai vu tomber. l’une après l’autre devant moi toutes les qualités qu’on lui attribue ; il n’a ni esprit de suite, ni jugement sûr, ni vraie finesse d’intelligence, ni capacité efficace, c’est un grossier brouillon, un bizarre mélange du Gascon et du Barbare. Mais il est inventif, actif, infatigablement actif d’esprit, de corps, de volonté ; il projette, il combine, il trame, il pousse, il remue sans relâche. Il est important, il le sera toujours. Je doute qu’il y ait désormais grand chose à tirer de lui, mais son activité encore plus que son nom, lui donne une force avec laquelle tout le monde doit compter. Rien de nouveau d’ailleurs au milieu de ce décampement général. Ce que je sais de plus divertissant à vous mander, c’est la goutte de M. de Salvandy. Il avait l’autre jour un grand dîner, de la bonne compagnie des femmes, M. et Mad. Molé, M. Pasquier, Mad. de Boigne & & La goutte l’a pris : quand on est arrivé pour dîner, il n’avait pu quitter sa chambre ; M. Molé l’a remplacé à table ; et au sortir de table en rentrant dans le salon, tout ce beau monde a trouvé M. de Salvandy étendu sur un canapé, et faisant du soin de son immobilité, les honneurs de sa maison. Les mauvaises langues vont jusqu’à dire qu’il était là, en magnifique robe de chambre, un bonnet grec sur la tête en Sultan malade. Mais je n’en crois rien.
Savez-vous ce que je fais aujourd’hui? Je vais dîner à Chatenay. Cela me plaît-il ? Cela ne me plait-il pas? Je ne sais pas bien. Je vous le dirai après. Mad. de Boigne m’a écrit avant-hier. Enfin j’y vais. Mon départ est encore retardé de trois jours, jusqu’à lundi. L’envoi de 6 ou 7000 volumes à la campagne en est la cause. Adieu, Madame Certainement, j’irai m’asseoir au bord de la mer. Vous voulez que je la regarde. Je crois que je regarderai au delà. G.
2. Paris, Dimanche 2 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre de ma promenade solitaire. Il n’y a presque plus personne à Paris, et je ne vais pas chercher ce qui y reste. Le bonheur, les affaires ou la solitude. C’est un blasphème de placer ces trois mots l’un à côté de l’autre. Le bonheur ne doit jamais être nommé que tout seul ; rien ne lui ressemble. Mais sans bonheur, et à défaut des affaires, j’aime bien mieux la solitude que le bavardage des indifférents. Je sais qu’on ne la supporterait pas longtemps, que l’âme s’userait vite à vivre ainsi à ses propres dépens et de sa seule substance. Mais finir seul sa journée se promener deux heures sans rien regarder, sans rien dire, n’entendant que le bruit de ses pas n’écoutant que cette voix intérieure qui nous entretient de notre passé ou de notre avenir, c’est assez doux. Dans les affaires mêmes, un peu de solitude est bonne ; il faut un moment chaque jour, secouer tous les jougs ne relever que de soi-même, permettre à sa pensée cette liberté insouciante qui lui conserve seule toute son originalité et sa grandeur. Gouverner n’est pas labourer. On s’hébête à avoir toujours la main sur la charrue et l’oeil sur le sillon. C’est un grand vice de notre organisation politique en France que ce travail incessant, ce défaut absolu de loisir auquel nous nous sommes condammés. A faire un tel métier, on se sent devenir machine soi-même et on tombe bientôt au dessous de sa tâche pour n’avoir pas su ou pu, de temps en temps, la laisser là et n’y plus songer. Je vous assure Madame qu’au milieu des plus pressantes affaires, une heure de conversation avec vous n’importe sur quoi serait, tout plaisir à part, le régime le plus sain du monde. à la vérité, ce n’est pas là de la solitude.
Ces chances lointaines, inconnues, tout cela refoule dans le cœur les choses qui auraient le plus envie d’en sortir. Il y a un degré de vérité, de liberté, qui ne souffre aucune entremise. C’est déjà trop quand on est ensemble, que la nécessité de rédiger ses sentiments en phrases et de les envoyer à deux pas en entendant le bruit de sa voix. L’âme ne passe jamais tout entière dans cette manifestation extérieure, et au moment même où elle parle, elle aspire. Surtout à être devinée dans ce qu’elle retient. Je ne sais lequel de nos poètes pour peindre la conversation. intime de deux amants a dit :
Cachés, et se parlant tout bas, quoique tout seuls. Il savait ce que c’est que l’intimité.
A tout prendre cependant, je me sens un peu plus à l’aise par M. Nettement que par la poste. Je lui remets donc cette lettre. Si vous êtes encore à Londres quand il en partira, il ira vous demander vos ordres pour moi. Vous pouvez les lui donner en sûreté. J’étais sûr que les volumes vous plairaient beaucoup. Si je n’en avais été sûr, je ne vous les aurais pas envoyés. Je ne déteste rien tant que la profanation d’un souvenir. A présent, quand vous reviendrez (car vous reviendrez) je vous parlerai librement de ces deux nobles créatures qui ont tenu tant de place dans ma vie. Il n’y a jamais eu, entre elles et moi, cinq minutes de roman. Je m’éprise le roman. Il a la prétention de surpasser la réalité et il lui est bien inférieur. L’amour vrai l’admiration vraie le dévouement vrai sont très rares, c’est pourquoi les gens qui ne s’y connaissent pas les appellent romanesques. Ils ne le sont pas du tout ; ils sont au contraire, quand ils existent tout ce qu’il y a de plus simple de plus positif, de plus pratique. Seulement il ne faut pas s’y tromper et prendre pour les sentiments-là, les fantaisies qui s’en attribuent le nom. Les feux follets qui traversent l’air s’appellent aussi des étoiles ; mais ils n’en ressemblent pas d’avantage aux étoiles véritables, et celles-ci n’en sont pas moins hautes et fixes parce que des traits de flamme apparente courent et brillent un moment dans les régions inférieures de l’atmosphère. Pourquoi vous parlerais-je aujourd’hui d’autre chose? J’ai le cœur joyeux et profondément indifférent à tout ce qui n’est pas ma joie. J’attendais votre première lettre avec une inexprimable impatience. J’avais soif de rentrer par ce simulacre, en possession de nos longs et doux entretiens. Dans une charmante habitude la première interruption a quelque chose de très amer. L’âme se précipite pour ressaisir le fil qui lui a échappé un moment. Adieu, dearest Princess. Soignez-vous comme vous me l’avez promis. Je serai charmé que vous me donniez des nouvelles ; mais sachez bien que j’aime infiniment mieux autre chose.
Adieu. Adieu. Guizot Je suis obligé de rester deux ou trois jours de plus à Paris. Moi aussi, j’ai négligé mes affaires et comme il y en a qui intéressent mes enfants je veux les faire avant de partir. Remarquez mon cachet. C’est celui dont je me servirai habituellement.
418. Londres, Mardi 22 septembre 1840, François Guizot à Dorothée de Lieven
huit heures
Je ne puis souffrir de vous écrire à la hâte, comme ces jours-ci. A part même l’ennui d’une lettre courte, être avec vous et me presser de vous quitter, cela me choque. Je viens de me lever. Rien ne me presse. Je m’appartiens. Je vous appartiens. Je reviens à votre dernière phrase.
" Pourquoi suis- je si triste ? " Je vous connais comme à moi, une raison d’être triste qui suffit à beaucoup de tristesse. J’accepte celle-là, pour vous comme pour moi. Y en a-t-il quelque autre ? Répondez- moi à la question que vous me faites. Savez-vous ce que j’ai découvert samedi ? Qu’il m’était désagréable de quitter Londres. En roulant sur le chemin de fer, je ne comprenais pas, à la lettre, je ne comprenais pas pourquoi j’avais le cœur un peu serré. Je l’ai trouvé en y pensant, et cela m’a soulagé de le trouver. J’aime Londres. Londres ou Paris. Quand un sentiment possède le coeur, que de mouvement instinctifs, irréfléchis, obscurs, il y fait naître ! On est triste ou joyeux sans savoir pourquoi. Puis on comprend. N’y a-t-il pas bien des chansons qui ont dit ce que je dis-là ? Voi che sapete & & Les chansons ont raison.
Je suis très préoccupé des affaires. La phase où nous entrons et la manière dont nous y entrons ne me plaît pas. Je suis convainecu qu’en France, comme en Europe on désire la paix, et qu’en France comme en Europe, on n’accepterait franchement, on ne soutiendrait ardemment la guerre qu’autant qu’elle serait née d’elle- même, par un accident imprévu, par une nécessité soudaine inévitable. Il faut ne pas vouloir la guerre, même eût-on la prévoyance qu’elle viendra. Car si le monde, qui n’en veut pas, peut soupçonner qu’elle est venue par la volonté ou par la faute de quelqu’un, ce sera, pour celui-là un affaiblissement immense impossible à mésurer. Vous le savez ; j’ai toujours cru, je crois toujours la guerre évitable ; mais quand je croirais, le contraire, et tout en m’y préparant, je m’appliquerais sans relâche, sérieusement, sincèrement à l’éviter jusqu’au moment où elle viendrait tomber sur moi comme la foudre. Si l’incendie doit éclater, il faut que ce soit par le feu du ciel, non pas d’une main d’homme. Personne hier à Holland house. J’ai tort ; lord Jeffrey, qui arrive d’Edimbourg. Je persiste dans ma première impression ; l’homme le plus spirituel que j’aie vu ici. Un peu d’humeur, et de découragement dans l’esprit ce qui en ôte beaucoup, car cela donne l’air vieux, et la vieillesse ne va pas mieux à l’esprit qu’au corps. Je ne sais ce qui m’arrivera ; jusqu’à présent, l’âge, en m’apportant de l’expérience, m’a paru n’apporter que de la lumière et de la force. J’ai appris à mieux penser et à mieux agir, non à douter et à désespèrer. Un moment viendra, je le sais, où mon esprit conservât-il sa pleine santé, mon corps affaibli ne suffira plus à lui servir d’instrument. Je tâcherai de ne pas me faire illusion sur ce moment là.
Depuis quelques jours une singulière envie de dormir me prend tout de suite après dîner, presque à table. Beaucoup moins quand je dîne chez moi que chez les autres. Je soupçonne qu’on mange trop ici, même moi, et que la fatigue de mon estomac fait la lourdeur de ma tête. Une tempête affrense. La pluie bat mes vitres à les casser. Les arbres de mon square baissent la tête jusque sur la grille qui l’entoure. Je crains bien que ceci ne me coûte demain ma lettre. La poste ne passera pas aujourd’hui. Je vois par les journaux anglais qu’elle a passé hier. Ils ont leur exprès de Paris. Il faisait beau hier. La pluie a commencé le soir, quand je suis revenu de Holland house. une heure Cette irrégularité des lettres me désole autant pour vous que pour moi. Quand aurez-vous eu celle de Dimanche ? Quand c’est-à dire à quelle heure, car certainement vous l’aurez eue. Je regarde au vent ; je le trouve tombé. J’espère que ma lettre à moi, passera aujourd’hui et que je l’aurai demain. Pendant qu’on espère une transaction à Paris, j’y travaille ici de tout mon pouvoir. Travail difficile dans cette saison. Où saisir les gens pour les chauffer ? Et les rapports obscurs, contradictoires, embrouillent tout. On a dévié de cette grande idée qui présidait depuis dix ans à la conduite de l’Europe. Aucune question particulière ne vaut la guerre générale. Le mal est là. On n’a plus de boussole ! Et on a dévié pour la plus petite, la plus lointaine des questions, pour une question que bien peu d’années de patience devaient emporter. Je ramène sans relâche, devant tous les yeux, l’idée grande, l’idée simple qui a tout sauvé. C’est en son nom que je prêche la transaction. L’obstination est grande. Obstination d’aveugle, et d’aveugle piqué qu’on le soupçonne de ne pas voir. Je m’obstine aussi. Vous savez que je suis peu accessible, au découragement. Adieu. Je vous redemande, en finissant la réponse à votre question de samedi. Adieu. Adieu.
265. Val -Richer, Vendredi 13 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous avez bien tort de ne pas savoir dicter. C’est une habitude qu’il faudrait toujours prendre quand on est jeune. Vous pourriez sans fatigue employer une ou deux heures le soir à recueillir vos souvenirs, ce qui vous a occupée ou amusée dans votre vie. Vous vous en amuseriez encore. Je me promets bien de le faire un jour pour mon compte. A défaut de dictée ne vous conviendrait-il pas qu'une personne un peu intelligente, une femme, une jeune fille vint vous lire le soir quand vous êtes seule et que vos yeux sont fatigués ? Je vous trouverais cela, soit par moi-même d’ici, soit par Génie. Votre solitude me pèse inexprimablement. Chagrin même à part, je suis choqué comme d’une absurdité, que vous soyez seule quand il y a dans le monde, et pas au bout du monde, quelqu'un qui se plaît tant à être avec vous.
Samedi matin 6 h et demie
Je me suis couché hier de très bonne heure. La vie que je mène ici est parfaitement calme et très occupée. Je donne à mes enfants presque tout le temps que je ne passe pas dans mon Cabinet dès que je suis seul, je lis ou j'écris. Rarement il fait assez beau pour que je reprenne mes grandes promenades solitaires. Quand le soir arrive, je suis comme mon fermier qui a labouré tout le jour ; j’ai envie de dormir.
Je vois, dans mes nouvelles de l'Intérieur que la conférence sur les affaires d'Orient pourrait se tenir à Constantinople, que la Porte le demande. Je croyais cette idée tout-à-fait abandonnée. Elle avait été d'abord suggérée par vous. En entendez-vous parler de nouveau ? Que dit-on de la déconfiture de D. Carlos? S'achemine-t-on à petit bruit vers la reconnaissance de la Reine Isabelle ? Certainement, il y a là un dernier coup à donner, pas bien fort, et sans guerre aucune, qui terminerait l'affaire d’Espagne comme on a terminé celle de Belgique, et ferait rentrer toute la Péninsule dans l'ordre européen. Mais vous verrez qu'on laissera encore traîner. Les événements n’arrivent plus aujourd'hui qu’à condition d’arriver tout seuls. Les hommes ont abdiqué. Il n'y a plus que Dieu qui gouverne.
Aimez-vous la lecture des voyages ? Vous avez là, je crois, les lettres de Jacquemont sur l’Inde. Mais ce que vous n’avez certainement pas lu, c'est le Journal même de son voyage, qui se publie par livraisons, avec de grandes images et dans un très beau caractère, Ouvrage très spirituel, et plein d’intérêt. Voulez-vous le lire quoiqu'il ne soit pas fini ? On peut très bien faire, cela pour un voyage qui n’a ni commencement ni fin, et où chaque jour se suffit à soi-même. Si vous en avez envie, dites à Génie de le faire prendre chez moi dans ma chambre à coucher, parmi les livraisons non reliées. Les cahiers détachés ne sont pas bien commodes à manier ; mais du moins la lecture ne vous fatiguera pas les yeux. Je voudrais chaque matin, vous envoyer d’ici de quoi remplir votre journée.
9 heures
La lettre de votre frère est très bien. C'est le moins possible. Mais la brièveté douce et froide convient en pareille occasion. Faites la partir tout de suite et dormez. En vérité, je m'indigne de penser qu’il dépend de telles sottises de vous ôter le sommeil. Je suis charmé que M. Jennison, soit plus traitable. Adieu. Adieu. Il n'y a de bon adieu que ceux qui ne finissent pas. G.
144. Val-Richer, Vendredi 28 septembre 1838, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais vous avoir parlé de ma mère. Elle a été un peu souffrante. Elle est bien aujourd’hui, quoique très, très affligée. Mad. de Broglie était avec elle filialement. Mais je suis sûr que je vous en ai parlé. Ma mère d’ailleurs a une attitude admirable envers la douleur ; elle la supporte sans s’en défendre. Je n’ai jamais vu personne qui l’acceptât plus complètement sans s’y abandonner, qui en parût plus rempli et moins abattu. Elle y est comme dans son état naturel. Il n’y survient rien de nouveau pour elle et le plus ou le moins ne change pas grand chose à sa disposition, toujours triste mais toujours forte. Je l’ai fait beaucoup promener ces jours-ci. Je l’ai fatiguée. Et puis mes enfants ne la quittent guère. J’ai beaucoup travaillé ce matin. J’avais besoin aussi de me fatiguer. J’en suis convaincu comme vous. On ne comprend que les maux qu’on a soufferts. A ce titre, j’ai bien quelque droit à vous comprendre, pas assez peut-être. Il est vrai que je suis moins isolé. Que ne puis- je vous guérir au moins de ce mal-là ! L’autre resterait. Je l’ai vu rester. Mais ce serait celui-là de moins. Je ferai mieux de ne pas vous écrire ce soir. Je suis si triste moi-même que je ne dois rien valoir pour consoler personne, pas même vous que je voudrais tant consoler, un peu !
Samedi 7 heures
Je suis frappé du peu que nous pouvons, du peu que nous faisons pour les autres, et pour nous-mêmes. Dieu m’a traité plusieurs fois avec une grande faveur. Il m’a beaucoup ôté mais il m’avait beaucoup donné et souvent il m’a beaucoup rendu. J’ai reçu le bien, j’ai subi le mal. J’ai très peu fait moi-même dans ma propre destinée. Nous ne réglons pas les événements. Nous sommes pris dans les liens de notre situation. Nous oublions cela sans cesse. Nous nous promettons sans cesse que nous pourrons, que nous ferons. C’est notre plus grande erreur que l’orgueil de nos espérances. Voilà Louis Buonaparte éloigné. C’est une grande épine de moins dans le pied de M. Molé. La marque, en restera, mais pour le moment, il n’en sent plus la piqûre. Entendez-vous dire que la session soit toujours pour le 15 Décembre ?
Vous êtes bien bonne d’attendre mes lettres avec impatience. Qu’ai je à vous mander ? Point de nouvelles. Mon affection n’en est pas une. De près, tout est bon, la conversation donne une valeur à tout. De loin, si peu de choses valent la peine d’être envoyées !
9. 1/2
Je ne comprends, rien à cette incartade. Est-ce en effet une intrigue cosaque ou bien seulement quelque commérage subalterne qui sera monté haut, comme il arrive souvent aujourd’hui ? Je penche pour cette dernière conjecture. En tout cas, vous avez très bien fait d’aller droit à M. Molé. Il est impossible qu’il ne comprenne pas l’absurdité de tout cela et n’empêche pas toute sottise, au moins de ses propres journaux. Ne manquez pas de me dire la suite, s’il y en a une. Quelles
pauvretés !
Je suis bien aise que vous ayez un N°2. Je vous renverrai demain la lettre de Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Je reçois je ne sais combien de lettres qui me demandent des détails sur cette pauvre Mad. de Broglie. Est-il possible qu’on soit contraint de rabâcher, sur un vrai chagrin. Adieu. G.
Val Richer, Mercredi 22 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures et demie
Je suis dans mon Cabinet depuis six heures. Je n'ai pas encore mis le pied dans le jardin quoiqu’il fasse un soleil superbe. Je suis plongé dans mon histoire de la révolution d'Angleterre. Notre temps me sert beaucoup plus pour la comprendre qu’elle ne m'éclaire sur notre temps. Personne, ne me croirait si je disais que je cherche bien plutôt dans le présent des lumières sur le passé que dans le passé des allusions au présent. C'est pourtant très vrai.
Savez-vous un effet qu’on n’a pas prévu ? Il est très probable que ces bruyantes et innombrables démonstrations dont les journaux sont remplis, feront l'Empire ; mais en le faisant, elles l’usent d'avance. On en aura trop entendu parler quand il sera proclamé. On attendra et on demandera autre chose.
Le Constitutionnel allait avant hier au devant des craintes qu'inspirent déjà ces autres choses ; il promettait un Empire qui ne serait pas l'Empire, qui ferait des sociétés de crédit foncier et des chemins de fer une monarchie pacifique et bourgeoise. C’est trop de bruit pour arriver là. Il fallait attendre plus patiemment la nécessité de la monarchie ; elle serait venue, et elle serait venue plus tranquillement, sans blaser d'avance et sans exciter outre mesure. J'en reviens toujours, au chancelier Oxenstiern, qu’il y a peu de sagesse, même dans ce qui réussit !
C'est probablement par mauvais vouloir pour Lord Douro que le Duc de Wellington n’a pas fait de testament ; il a voulu que son second fils, qu’il aime mieux, et qui a des enfants, ont la moitié de sa fortune. Peel et Wellington, jamais les fils n'ont moins ressemblé aux pères ; le contraste est choquant.
Je suis convaincu qu’il y a de la faute des pères en cela, et que des enfants vraiment bien élevés, et en intimité avec leur père, n'en sont jamais si loin, quelque différente que Dieu ait fait la pâte, de toutes les jalousies, celle de père à fils est la seule que je ne comprenne pas du tout. Je ne conçois pas de plus grande satisfaction que de se survivre, et de la perpétuer soi-même dans ses enfants. J’ai pourtant vu de grands exemples de cette jalousie là, et dans de bien frappantes occasions.
Je vous quitte pour faire ma toilette. Je suis impatient de savoir Aggy revenue.
Onze heures
Je remercie Aggy de ses quelques lignes, quoiqu’elles me chagrinent. J’espère qu’un peu de nourriture vous relèvera de votre abattement. Le temps mou et pluvieux paraît vouloir casser ; peut-être qu’un air plus sec et plus vif vous vaudra mieux. Adieu, Adieu, en attendant demain. G.
Mots-clés : Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Education, Empire (France), Famille royale (France), Fusion monarchique, Histoire (Angleterre), Parcs et Jardins, Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Presse, Régime politique, Santé (Dorothée), Travail intellectuel
Val Richer, Jeudi 23 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le discours du Président à Lyon très bien fait, le meilleur qu’il ait fait. On ne tire pas mieux parti de sa situation et de son nom. On ne fait pas mieux servir les faits passés aux intérêts présents. Toutes les paroles répondent à des dispositions instinctives du peuples, réelles et bien comprises. Je n’y vois qu’une faute ; c’est la malice contre la légitimité à propos de la statue équestre de Napoléon. Cela n’est ni grand, ni juste. Le gouvernement de Juillet a remis la statue de Napoléon sur la colonne de la place Vendôme, et Napoléon lui-même sous le dôme des Invalides. Cela vaut bien une statue équestre. J'étais ministre à l’une et l'autre époque et j’ai bien le droit de dire que jamais gouvernement ne s’est plus généreusement conduit envers la mémoire d’un prédécesseur dont les descendants restaient des rivaux. Cela m'amuse de prendre, en ceci, fait et cause pour la légitimité et de reporter sur elle le mérite des actes du gouvernement de Juillet. Mais je n’ai pas tort.
Au fond, ce n’est pas contre la branche légitime seulement, c’est contre les deux monarchies précédentes, contre toute la maison de Bourbon que l'allusion est dirigée, et là est l'injustice comme l’artifice ; à cela près, le discours est habile et a très bon air.
Voilà la guerre commerciale engagée entre la France et la Belgique. On vient. de doubler les droits d’entrée, sur les houilles et les fontes belges. La nouvelle négociation a donc tout-à-fait manqué. Cela peut devenir sérieux. Mais rien ne devient sérieux maintenant, rien du moins de ce qui peut aboutir à la guerre.
Je vous parle toujours des Feuilles d’Havas. Je suis frappé d’un petit article que je trouve dans celles d’hier, pour prendre le parti du Duc de Wellington contre les journaux qui l'ont attaqué, en attaquant l’article de l'Assemblée nationale. La défense est très convenable, de fond et de ton. On veut évidemment n'être point responsable des mauvais procédés et du mauvais langage envers l’Angleterre.
Vous ne lisez plus le Journal des Débats. Faites-vous lire pourtant, dans le numéro d’hier mercredi, un article de M. St Marc Girardin sur les Mémoires de Mallet Dupan. Très sensé, très spirituel et très piquant. Avez vous lu, ou du moins parcouru ces Mémoires de Mallet Dupan ? C'est, sans aucune comparaison, ce qui a été écrit de mieux sur la Révolution Française. C'est la vérité vue et entendue au milieu de la fumée et du bruit du canon.
Je ne vous parle que de discours et de journaux, et c’est à votre santé que je pense surtout. J'espère avoir ce matin de vos nouvelles, par vous et que vous me direz que vous recommencez à manger. Adieu, en attendant je vais faire ma toilette.
Onze heures
Voilà une lettre qui me fait bien plaisir. Mangez et dormez. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Vendredi 24 septembre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aurais voulu être là quand Montalembert s’est trouvé entre Fould, et Hackeren ; j’aurais tâché de le faire rester, un quart d’heure du moins, et nous nous serions amusés. Soignez-le un peu. Je me reproche, dans le passé, de n'avoir pas tenu assez de compte de lui, même comme adversaire. Par ses bon côtés, comme par ses faiblesses, il est de ceux sur qui on peut toujours agir. Du reste je suppose qu’il ne fait, en ce moment, que traverser Paris.
Avez-vous lu, dans les Débats d’hier, l'article de John Lemoinne sur le Duc de Wellington ? Il n’y a pas le good sens, mais il y a l’intelligence du good sense et de la grande folie. Tout comprendre sans bien juger, c’est une qualité française ; John Lemoine la possède à un degré peu commun et il écrit avec un certain éclat familier qui plaît au moment où on lit. Je ne crois pas du tout que les Princes aient acheté le Times. Ce serait beaucoup trop cher pour leur bourse et pour leur goût.
Dit-on qui ira dans l’Inde à la place de Lord Dalhousie ? Je vois dans les journaux anglais qu’il reviendra au terme de son temps, malgré son envie de doubler le relai. J’avais toujours cru que Lord Palmerston finirait par là, pour arranger ses affaires ; mais Lady Palmerston n'ira pas dans la patrie du choléra. Et lord Derby, sera-t-il chancelier de l’université d'Oxford ? Ce serait très convenable. Qu'y a-t-il de vrai dans l’entrevue de Bulwer avec le cardinal Antonelli et dans sa demande de la communication des pièces du procès Murray ?
En fait d'impertinences, il ne faut faire que celles qui sont de bon goût, et qui réussissent. Rome a fait d'énormes fautes, depuis quelque temps, dans ses rapports avec l’Angleterre ; il ne faudrait pas que l’Angleterre en fit beaucoup de son côté pour lui rendre ses avantages. Un italien n’a que son esprit pour se défendre contre un Anglais ; mais il en a toujours assez pour cela, même quand l’Anglais en a.
Onze heures
Vous voyez que j’avais remarqué Bulwer et Antonelli. Je suis bien aise que vous ayez vu le duc de Noailles. Vous aurez causé avec lui comme nous avons causé dans notre dernière promenade au bois de Boulogne. Adieu, adieu. Moins vous me parlerez de votre santé, plus je croirai que cela va bien. Adieu. G.
Val Richer, Lundi 30 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai dîné hier à Lisieux avec l'Évêque, son clergé et les gros bonnets de la ville. Le clergé toujours bienveillant, pour le président. Les laïques sans enthousiasme pour l'Empire et craignant qu’il n’amène la guerre. Tout le monde sensé dans un horizon bas et court. La conversation ne s’arrêtant pas sur la politique et cherchant, d’un sentiment général à se porter ailleurs ; tantôt sur les questions économiques, tantôt sur les questions religieuses. C’est un assez amusant spectacle que de voir ces bourgeois au fond très peu dévots quoique respectueux essayer de prendre intérêt à la querelle des auteurs chrétiens et des auteurs païens, aux citations des pères de l'Eglise, et à la tenue des synodes des prêtres du diocèse.
Avez-vous lu un article du Globe sur les affaires d'Orient, France and Turkey, bien fait et curieux ? Il me paraît que le renvoi de Rachid Pacha, s'il est sérieux ne tournera qu’à votre profit. Plus on ira, plus on sentira la faute d'avoir relevé solennellement cette question des Lieux Saints. La politique de la France en Turquie depuis vingt ans est un tissu d'inconséquences et d'étourderies.
J’étais moi-même dans cette mauvaise voie, en 1840, jusqu'à mon ambassade en Angleterre. J’ai essayé d'en sortir de 1840 à 1848 en me tenant tranquille en Orient, et en n'y traitant aucune question que de concert soit avec la Porte elle-même, soit avec toutes les grandes puissances Chrétiennes quand il fallait agir contre la Porte, c’est-à dire sur la Porte, malgré elle. Il n’y a pas autre chose à faire, tant qu’on ne sera pas décidé à fondre, avec du canon, la cloche. de ce pauvre Empire. On s'en apercevra. pour la seconde fois, lorsqu’on se sera mis, pour la seconde fois, dans quelque mauvais pas, comme il nous est arrivé en 1840 à propos de Mehemet Ali.
Le Moniteur, est un peu embarrassé à parler convenablement du déplacement du monument élevé au Duc d'Enghien dans la chappelle de Vincennes. C’est une pauvre raison à donner de ce déplacement que la nécessité de faire plaisir aux artistes " en rétablissant la symétrie des belles lignes architecturales du temple bâti par St. Louis. " Une phrase sur " le respect qu’on doit à la cendre des morts " n’est pas une compensation suffisante. Il ne fallait pas toucher du tout à la cendre de ce mort-là. Elle brûle encore et brûlera toujours quiconque y touchera.
Pourquoi M. de Persigny est-il à Londres ? Est-ce, comme, on l’a dit, pour le traité de commerce qu’on a tout récemment démenti ? J’ai peine à le croire. Il y a là des intérêts puissants, et auxquels il est aussi imprudent de toucher qu'au monument du Duc d'Enghien
11 heures
Voilà le facteur et le général Trézel qui m’arrivent à la fois. Je n'ai que le temps de vous dire Adieu, et adieu. G.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français) -- Retour des cendres (1840), Opinion publique, Politique (Analyse), Politique (Normandie), Politique (Russie), Politique (Turquie), Posture politique, Presse, Réseau social et politique
Val-Richer, Dimanche 8 août 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je rentre dans nos habitudes ; je ne numérote plus. C’est un petit travail de chaque matin.
La translation à Brompton est un triste symptôme. On envoie là les [?] dont on n'espère plus grand chose, et qui ne sont pas assez forts ou assez riches pour être transportés à Pise où à Madère. On dit que l’air y est plus doux, et plus égal que dans Londres. Il y a un bal hôpital for consumption.
Pauvre Fanny ! Je suis toujours plus touché de la mort de ceux qui sont jeunes, et qui n’ont pas connu les douceurs de la vie.
Un de mes amis dont vous connaissez le nom, M. Moulin m'écrit : " Mon avis a toujours été et est qu’il ne faut pas abandonner les fonctions de représentation locale quand elles sont gratuites, électives et qu’on peut les conserver ou les obtenir sans trop d'effort."
J'aurais vivement mécontenté par la conduite contraire mon vieux canton de La Tour d'Auvergne que je retrouve fidèle à toutes mes fortunes aujourd’hui comme après 1848, et qui va probablement me réduire à la presque unanimité. J’ai compris d'abord les instructions de Venise comme moyen de modérer l'ardeur du parti légitimiste à se porter vers les fonctions publiques dont il a été si longtemps privé, mais je ne m'explique pas l’insistance avec laquelle, on vient de les reproduire à la veille des élections des conseils généraux. En Auvergne, elles n'ont reçu, elles ne reçoivent aucune exécution ; pas un légitimiste ne s’est retiré ; tous les légitimistes de nos conseils électifs vont y rentrer. Comme nous ne sommes pas un pays de grande propriété, le parti ne peut avoir influencé que par le patronage des intérêts locaux ; il perd toute autorité, toute importance s'il se retire sous sa tente, et sa retraite inspire plus de sarcasmes que de regrets.
Je suis bien aise que Cromwell vous amuse. Je vous en envoie sous bande un exemplaire. Cela a été inséré dans la Revue contemporaine, et ne se vend point séparément. On m'écrit que cela fait quelque bruit à Paris, et j'en juge par la fureur avec laquelle Emile Girardin l’attaque dans la Presse. Les amis du Président, ont tort de s'en fâcher. Cela n'a été écrit, ni pour lui, ni contre lui. J’ai pensé à son oncle en l'écrivant, à lui pas du tout. Il est vrai que l'allusion subsiste à la seconde génération, et que la conclusion est que Cromwell fit bien de ne pas se faire Roi. Si j'étais l’un des conseillers du Président, je lui conseillerais de faire comme Cromwell, qui mourut dans son lit, à Whitehall tranquille, et puissant. Mon conseil déplairait probablement, ce qui n'empêcherait pas qu’il ne fût bon.
Adieu. Je passe mon temps à me promener et à causer avec mes Anglais qui ont l’air de se plaire ici. Ils me quittent, le 15, et je pars le même jour pour aller près de Caen marier M. de Blagny. Je rentrerai chez moi le 13 pour n'en plus bouger. Adieu, adieu.
J’espère que la lettre de ce matin me dira que vous avez marché.
11 heures
Malgré votre lettre, j'adresse encore à Dieppe, Pour vous, je crois que vous serez mieux à Paris d’autant que les chaleurs de l'été me semblent passées. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Vendredi 1er octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un spectateur sensé m’écrit d'Avignon : " Tout s’est très bien passé ici ; au moin 100 000 âmes ; peu de cris, sauf de la part des gendarmes et des membres du Corps législatif ; mais l’absence d'enthousiasme ne laissait pas à sa place le moindre air de mécontentement. Quant aux rois et au barrières des communes des campagnes, c'était Louis-Napoléon et qu'elles demandaient ou saluaient. Le Prince avait fort bon air, gracieux et d’un accès simplement bienveillant. Notre ciel brillant, notre beau fleuve, notre rocher, nos créneaux et nos quais couverts de monde, tout cela ferait une grande fête. "
Evidemment, il n'y a point eu de discours à Marseille ; seulement la réponse du président à l'Evêque. Il aurait tort de faire un autre discours ; il ne paraît pas si bien qu'à Lyon. D'ici au fait de l'Empire, il n’y a plus de place pour des paroles.
Le Roi Léopold doit être bien embarrassé. Un ministère ainsi renversé de l’épaisseur d’un cheveu est difficile à remplacer. Le Cabinet nouveau sera évidemment obligé de dissoudre et de faire des élections. Peut-être lui donneront elle, une meilleure majorité. En tout cas ceux qui tombent ne sont pas regrettables. Ils ont rendu service en Février 1848.
Le lac français est une de ces hâbleries dont les Français se repaissent, et qui sont à la fois ridicules et compromettantes. L'Empereur Napoléon a mis celle-là en circulation, et elle pèse sur vous depuis. Je l’ai ouvertement attaqué un jour à la Chambre des Députés et on a beaucoup murmuré, à peu près autant que lorsque j'ai maintenu le mot sujets dans une Monarchie.
Les Américains ont beaucoup de ces hâbleries là, et les Anglais eux-mêmes, en ont eu ; j'en trouve pas mal du temps de Cromwell. Il faut un bon sens et un bon goût très développés pour que les peuples y renoncent.
Voici le plan qu’on m'envoie de Paris quant à l'Empire. Le Président abrège son voyage de trois jours. Il sera à Paris, le 18. La Sénat ne sera pas convoqué officiellement, mais il sera là. Il se réunira spontanément et portera au Président. Le sénatus consulte déjà rédigé par M. le Premier président. Trop long. Aussitôt après le Sénatus consulte, on fera l’appel au peuple pour battre le fer pendant qu’il est chaud.
Mardi soir, chez vous, M. Fould promettait 10 millions de vous. Est-ce bien cela ?
Onze heures
Je n’ai rien à vous dire qu'adieu. Je vois que vous croyez toujours que le Président ne reviendra que le 16. Adieu, Adieu. G.
Val Richer, Vendredi 8 octobre 1852, François Guizot à Dorothée de Lieven
Fould annonce la politique qu’il prêche. Je ne doute pas qu’il ne donne de bons conseils, et je souhaite qu’il les fasse prévaloir. Je ne suppose pas que Heeckeren conseille la mauvaise politique ; mais probablement, il la prévoit, et il prend ses mesures pour y être prêt. Je vois que, pendant que le voyage suit son cours, les pétitions pour l'Empire vont leur train. On en annonce 521 dans le seul département du Pas de Calais, 51 000 signatures, dans celui de la Marne & Commencez-vous à y croire ?
Je comprends que M. Hogier donne sa démission du poste de Paris ; après les dernières publications de l'Indépendance belge, il lui est difficile de vivre en bons rapports avec M. Drouyn de Lhuys, et les deux partis ne sont pas assez également fortes pour rester l’une devant l'autre en mauvais rapportss comme nous étions, lord Normanby et moi. Je penche à croire que cette mauvaise humeur officiellement affichée sont le commencement de quelque chose de pire.
Avez-vous des nouvelles d’Ellice et compte-t-il toujours venir à Paris à Noël ? Il aura, je suppose, un peu plus d’embarras à être toujours de l’avis de son petit ami, car Ellice est très pacifique et ne se soucie pas de se faire de mauvaises affaires.
J’avais ici hier un petit anglais fort obscur et assez intelligent, traducteur de mes ouvrages en Anglais, qui m’a dit que l'opinion publique en Angleterre était toujours très malveillante, et que le Times, la suivait bien plus qu’il ne la poussait.
J’ai eu avant hier à dîner les gros bonnes négociants et manufacturiers de Lisieux, tous contents et présidentiels, acceptant l'Empire sans le désirer. Les agriculteurs eux-mêmes commencent à être un peu contents ; leurs denrées se vendent mieux.
Je suis vraiment très fâché pour vous du départ de Kisseleff. Je suis moi-même bien plus tranquille sur vous quand il est là. La petite Princesse va donc mieux puisqu’elle sort. Adieu, Adieu.
J’espère que l'ouragan a cessé à Paris, comme ici. C’est un temps qui ne vous vaut rien. G.
275. Val -Richer, Mardi 24 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je croyais avoir le talent de tout lire. Vous me coûtez la perte de cette illusion. En retour vous me faites connaitre un singulier monde. Sous Louis 14 même sous Louis 15 beaucoup de femmes, de très bonne compagnie, ne savaient pas l'Orthographe ; ma belle-mère Mad. de Meulan était encore de ce nombre ; mais elles étaient spirituelles, élégantes ; à travers l’irrégularité de leurs phrases elles avaient le cour d’esprit fois, délicat ; la grande civilisation était partout, excepté dans leur grammaire.
Cuisinière au fond et dans la forme, c’est drôle pour votre sœur ; passez moi la brutalité de l’expression. Du reste, à force d’étude, j’ai tout lu, excepté les mots que j’ai soulignés. Ayez la bonté de m'en envoyer l’interprétation pour que la peine que j’y ai prise ne soit pas tout-à- fait perdue.
Je suis curieux de savoir comment on s'y prendra pour vous empêcher d'avoir l’argenterie qui vous convient, quand vous ne la demandez qu'en en payant la valeur, au taux de l'estimation. Est-ce que Paul veut aussi l'avoir et l'emporter en Angleterre ? Je vois qu’on trouve tout simple, votre frère même, qu’il ait donné sa démission. Je suppose que c’est la nomination de M. de Brünnow qui l'a déterminé et lui sert d'excuse auprès des moins rebelles. Plus j’y pense, plus il me semble que puisque vous avez demandé les letters of adm., ce que vous avez de mieux à faire, c’est de donner vos pleins pouvoirs à Rothschild, et de faire toucher, par lui, le capital, quand vos fils seront arrivés, à Londres, de telle sorte que jusqu'à leur retour l’argent reste où il est, et que vous et eux, vous touchiez chacun votre part au même moment, mais par votre fondé de pouvoirs direct. Il n'y a là, si je ne me trompe, rien à dire pour personne. Et c’est plus sûr.
9h 1/2
Il me paraît impossible que Démion soit menteur à ce point. Il n’a point d’intérêt commun avec M. de Jénnison. Son intérêt à lui, c’est que vous ayez l’appartement. Vous êtes un bon locataire. Vous me direz cela demain. Certainement, si j'étais là, vous auriez l’appartement. Vous auriez tout ce qui vous plairait. Dîtes-le moi toujours. Je suis charmé de le croire.
Adieu. Adieu. J’ai deux lettres d'affaire à répondre sur le champ. Adieu. G.
Val-Richer, Jeudi 30 octobre 1851, François Guizot à Dorothée de Lieven
Hier soir, vers onze heures, le Roi Louis Philippe, signait, il y a onze ans, le Cabinet du 29 octobre. Il a duré sept ans et quatre mois. Quand reverrons-nous quelque chose qui dure autant. J’ai bien l'orgueil du passé, mais il ne me console pas des tristesses du présent. Mon esprit, est partagé entre deux pressentiments, très divers ; celui de mon bon sens qui me fait croire au retour de la monarchie et d’un ordre à peu près semblable à l'ordre que nous avons vu ; celui d’un instinct obscur qui me fait entrevoir, dans ce qui se passe, le commencement d'un état social très nouveau, point glorieux, et pourtant grand et fort, point solide et pourtant toujours à peu près le même, point d'avenir, mais chaque jour se suffisant à lui-même assez du moins pour ne pas être le dernier jour, une décadence à la fois agitée et monotone et durant des siècles.
Je suis très préoccupé de ce qu'on fera de ce qu'on doit avoir déjà fait à Claremont. Et non pas sans inquiétude. Ce sera inconcevable et impardonnable. Mais je crains qu’ils ne craignent qu'on n’exploite ce qu’ils feront, pour les lier plus qu’ils ne veulent être liés. Ils trouveront peut-être quelque biais indirect et disgracieux pour s'acquitter strictement. La poste de ce matin m'en apprendra peut-être quelque chose.
Je trouve toujours qu'on ne sait pas tirer parti, contre Lord Palmerston de ses démarches et de ses paroles. Sa réponse à Fortunato est un acte d’insolence effrontée vraiment, sans exemple. Si, en Angleterre même, l'opposition faisait bien comprendre au peuple anglais ce qu'il y a de frivolement pervers et de dangereux, en définitive pour l'Angleterre elle-même, dans ce patronage affiché, indistinct, de tous les ennemis de tous les gouvernements du continent, je suis convaincu que le peuple Anglais comprendrait et finirait par le trouver mauvais. Mais l'opposition attaque en passant, tel ou tel acte de Palmerston et ne fait point de charge à fond contre l'ensemble et le caractère permanent de sa politique ; et le peuple anglais croit que Palmerston est une espèce de grand patriote anglais, uniquement préoccupé, comme Lord Chatham ou M. Pitt, de la grandeur de l'Angleterre et à qui l'on ne peut reprocher que ce qui se pardonne toujours, la passion de l’égoïsme national. C’est cet absurde mensonge qu’il faudrait mettre en lumière. Je souffre toutes les fois que j'en vais manquer l’occasion.
On m'a envoyé, hier le récit des derniers moments de la Dauphine. C'est beau, précisément parce que ce n'est pas orné du tout. Son testament est admirable de simplicité et de vérité, me disant, ni plus, ni moins que ce qu'elle pensait, et sentait réellement. Cette phrase-ci surtout me frappa : " à l'exemple de mes parents, je pardonne de toute mon âme, et sans exception, à tous ceux qui ont pu me nuire et m'offenser demandant sincèrement à Dieu d’étendre sur eux sa miséricorde aussi bien que sur moi-même, et le suppliant de m'accorder le pardon de mes fautes. "
Il y a de sa part, une charité et une humilité Chrétiennes vraiment sublimes à se confondre ainsi elle-même avec ses bourreaux, et à implorer en même temps, pour eux et pour elle, le pardon de Dieu.
Onze heures
Je ne suis plus préoccupé que de vous. Vous faites bien de rester dans votre lit ; mais il faut que votre lit vous repose. Enfin, j'y verrai moi-même dans quelques jours. Hélas, la présence n’est pas la puissance. Adieu, Adieu.
Val-Richer, Jeudi 19 septembre 1850, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai fait vingt lieues hier pour ne trouver qu'une seule des personnes que j’allais chercher. Peu m'importe ; ma visite est faite. C’était une visite, non seulement de convenance mais de conscience. Les Banneville ont été très bien pour moi dans les plus mauvais jours quand beaucoup d'autres étaient mal, ou tremblaient d'avoir l’air d'être bien. Je suis très fidèle à ces souvenirs. J’ai rencontré dans ma vie beaucoup d’ingrats et de lâches, mois toujours aussi quelques cœurs reconnaissants et courageux ; et quelques uns de ceux-là suffisent pour faire oublier beaucoup des autres et sauver l'honneur de l'humanité.
Je comprends qu’on s'inquiète à Berlin de Cassel et de Darmstadt ; mais j'ai quelque penchant à croire qu’on fait autre chose que de s'en inquiéter. Ces désordres des petits états Allemands, cette incurable impuissance ou sottise des petits Princes, servent au fond les vues de la Prusse et poussent vers elle les populations. L’ambition prussienne est craintive, mais obstinée. Le Gouvernement de Berlin a peur pour lui-même, mais sans cesser de convoiter le bien d'autrui. Je ne crois pas qu’il excite les insurrections badoises, hessoises ou autres, mais je doute qu'il s'en afflige à tout prendre, il en espère plus qu’il n’en craint.
Il m’est venu ces jours-ci assez du monde de mes environs ; mais je n'ai rien à vous en dire. Grande stagnation des esprits comme des faits. Grande prospérité de l’industrie et du commerce qui ne demandent que le statu quo. Grande détresse de l'agriculture qui voudrait bien un changement, mais qui n'ira point au devant. Les légitimistes voient cela ; ils ont le sentiment que eux seuls ils ne peuvent rien ; je ne dis pas seulement rien faire mais rien tenter ; quand on le leur dit, ils en conviennent sur le champ. Et pourtant ils parlent, ils s'agitent comme s'ils pouvaient et faisaient quelque chose. Cela leur fait grand mal dans le pays ; leur agitation incommode ; leurs paroles déplaisent. C’est un grand art que de savoir se tenir tranquille et se taire. Les partis n’ont jamais cet art là ; surtout les partis qui sont à la fois nobles et faibles. Ils se remuent et bavardent pour oublier un peu leur impuissance.
Soyez tranquille ; je n'oublierai point que c'est moi qui ai au la première idée de René de Fleischmann, et qui ai pris l'initiative. J’ai envie qu’en fin de compte la chose réussisse. Mais je ne puis ni ne veux forcer la main aux intéressés. Quant à la dot, je vous ai dit au premier moment, mais à vous seule, ce qu’il en pourrait être dans l'avenir avec quelques bonnes chances de famille ; mais quand il a été question d'en parler à d'autres, j'ai été très précis ; 10,000 liv. de rente en se mariant, et 5 ou 6000 de plus assurées. Cela est très exact.
10 heures
Merci de votre soin à recueillir pour moi toutes les nouvelles, grandes ou petites, tristes ou gaies. Je serais bien curieux de savoir si Thiers à réellement passé par Paris pour aller à Richmond. Je n’y crois pas. Ce serait, de la part de Richmond le symptôme d'une politique plus à part et plus hardie, que je ne le suppose. Je crois au travail constant, mais hésitant, embarrassé, timide et ménageant tous les avenirs. Adieu, adieu., adieu.
Ma fille Pauline ne sera à Paris qu'après-demain matin samedi. Elle en partira dimanche soir. Adieu. G.
Broglie, Mardi 18 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Lisez dans la Revue des deux Mondes, du 15 sept un article de M. de Sainte Beuve (que vous trouviez si laid et avec raison) sur Madame de Krudener, et sur une Vie de Madame de Krudener que vient de publier, M. Charles Eynard. Cela vous amusera. Je suppose que la Vie même est amusante, et je vais me la faire prêter. En 1805, quand je suis arrivé à Paris Valérie me charmait. On me dit que j’avais tort, c'est possible ; mais je conserve de Valérie, un souvenir agréable que les révélations de M. Eynard et les demi-moqueries, de M. de Ste Beuve, ne détruiront pas.
Je viens de faire une grande promenade dans la forêt de Broglie, moitié en voiture avec la princesse de Broglie et mes filles, moitié à pied avec le duc et son fils, sur un bon gazon et sous de beaux hêtres. Nous avons beaucoup plus pensé à l'art qu'à la nature, et à un art très difficile, celui de changer les constitutions, sans y toucher, et de défaire légalement la légalité. Le Duc de Broglie m’a exposé, pour cela. Un plan très ingénieux et, au fond, très praticable quoi qu'un peu subtil. Il y a des moments où les hommes veulent absolument qu'on leur donne, pour faire ce qu'ils ont besoin et envie de faire, des raisons autres que le franc bon sens. Il ne faut pas leur refuser le plaisir. Voici le problème. On veut refaire une légalité autre que celle qui existe, sans sortir de celle qui existe. S’il vous vient de votre côté, à l’esprit, quelque bon expédient, envoyez-le moi, je vous prie.
Mercredi 19-10 heures
Décidément le Mercredi est le jour où je vous aime le mieux. Vous avez bien fait de me dire ce que Lord John vous avait dit du duc de Broglie. Cela lui a fait plaisir. Une ou deux fois, dans sa dernière ambassade Lord John a été sa ressource contre Lord Palmerston, et une ressource efficace. Two letters at once. C’est dommage qu’elle ne le soit pas plus souvent. Je suis convaincu que vous avez raison : vous vous amusez mutuellement sans vous changer. Je vois que le Globe dément formellement la révocation du Gouverneur de Malte Est-ce aussi là un effet de Lord John ?
La question allemande est maintenant la seule à laquelle je pense sérieusement. Il y a vraiment là quelque chose à faire quelque chose de nouveau et d’inévitable. Il vaut la peine de tâcher de comprendre et de se faire un avis, Pensez-y aussi je vous prie, et mandez-moi ce que vous apprendrez ou penserez. Je suis bien aise de ce que Collaredo vous a dit de Radowitz. Je suis enclin à attendre de lui une bonne conduite, et à lui souhaiter du succès. Il m’a paru n'être ni un esprit fou, ni un esprit éteint. Il n’y a plus guères que de ces deux sortes là. La maladie de M. de Falloux retardera ou rendra insignifiants les premiers détails de l'Assemblée. J’ai cru d'abord qu’il lui convenait d'être malade ; mais il l'est bien réellement. Un visiteur arrivé hier soir ici dit que les derniers orages ont fait du bien au choléra, c’est-à-dire contre le choléra à Paris. Les cas diminuent et s'atténuent. Cependant on retarde de huit jours la rentrée eu classe des Collèges pour ne pas faire revenir sitôt les écoliers, Guillaume restera huit jours de plus au Val Richer. Que fait M. Guéneau de Mussy ? Reste-t-il encore un peu à Londres ?
Adieu, adieu. Je travaille avec un assez vif intérêt. Cela me plaît de concentrer, en un petit espace tout ce qu’une grande révolution peut jeter de lumière sur les autres. Je persiste à croire que s’il faisait très clair, il y aurait moins d'aveugles. Adieu, adieu. G.
5. Val Richer, Mercredi 1er juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si j’avais besoin d'être confirmé dans ma sécurité, le Journal de Francfort me rendrait ce service. Evidemment vous le dictez. Il indique déjà à la Porte un moyen de sortir d’embarras en réclamant de vous pour l'indépendance de sa souveraineté, des stipulations qui compenseraient le droit de protection que vous lui demandez pour l'Eglise grecque. Réciprocité très illusoire, mais qui sauverait la dignité apparente et faciliterait la transaction. Ce moyen-là ou tout autre certainement on en trouvera un, avant ou après quelques coups de canon.
Entre les cent raisons qui m'ont décidé à ne jamais rechercher ni accepter aucune affaire ni aucun avantage d’argent, j'ai toujours compté pour beaucoup celle-ci ; conserver en tous cas la pleine liberté de mon jugement et de mes actions. L'argent, c’est les fers aux pieds et aux mains, et à l’esprit.
La rentrée du Roi Léopold à Bruxelles est aussi belle que son entrée à Berlin et à Vienne. Les discours des Belges, laïques ou ecclésiastiques, ont un caractère de satisfaction sensée, et vraie qui me plaît beaucoup. Il y a deux sortes de mensonges publics qui me donnent des nausées, ceux où l'on ne trompe personne et ceux où l’on se trompe soi même. Rien de semblable ici. C’est un pays et un Roi content l’un de l'autre, et qui ont raison.
Je ne m'étonne pas que vos grandes Duchesses n'aillent plus en Angleterre, ni à Vichy. Je lis dans les feuilles d'Havas des articles plus aigres, sur vous qu’il n’est, à mon avis, nécessaire ni convenable. L'Empereur d’ici à certainement dans cette affaire, un avantage, sur le vôtre ; il serait de meilleur goût, et plus habile d’en profiter pour se montrer courtois et bien disposé en général. C'est la seule espèce de revanche qui soit digne et qui serve. A coup sûr, le Duc de Gênes ne part pas de Paris content du corps diplomatique. Je comprendrais Hübner ; mais je ne comprends pas Cowley.
Onze heures
Je suis charmé que votre fils vous accompagne de bonne grâce. Je vous souhaite le retour du beau temps ; il est bien mauvais depuis hier. Adieu. Adieu. G.
Broglie, Lundi 17 septembre 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous êtes devenue d’une grande intimité avec Lord John. Vous le voyez tous les jours. C’est très bien fait malgré son attachement à Kossuth. Lady John mérite que vous causiez avec elle. Elle a assez d’esprit pour se plaire avec ceux qui en ont plus qu'elle. Et son mari is very uxorious. Je me figure que si j’avais été là Madame de Metternich n'aurait pas. retenu cette expression de sa colère contre Lord Palmerston qu’elle vous a soustraite. Vous voyez ce que j'en pense. Je regrette que son mari devienne si ennuyeux. Les décadences me déplaisent toujours. Soyez tranquille ; je ne redeviendrai pas doctrinaire. Fatuité à part, je ne voudrais pas redevenir rien de ce que j’ai été. Je crois que ce serait déchoir. Redevenir jeune en restant ce que je suis à la bonne heure. Et si je ne me trompe, vous en diriez autant. J’ai écrit hier une longue lettre à Lord Aberdeen. Et aussi à Claremont.
M. Dufaure fait en ce moment une chose qui fera plaisir au Roi. Il a demandé au duc de Broglie de présider une commission chargée d'examiner et de trier tous les papiers enlevés aux Tuileries après Février et déposés aux archives générales. " Il est temps, dit-il de trier ces papiers, et de rendre à la famille royale, ce qui lui appartient. Le Duc de Broglie a accepté, comme de raison. Les journaux légitimistes qui m’arrivent ce matin me frappent assez. Ils détournent leur parti de l'attaque contre le Cabinet au retour de l'Assemblée. C'est M. de Falloux qui fait cela. Il n’espère pas refaire à son gré le Cabinet nouveau, et il aime mieux maintenir celui-ci, où il est plus gros qu’il ne serait avec Molé et Thiers. En tout les légitimistes travaillent plus encore que tout autre parti, à ajourner les grosses questions. Il ne se sentent pas en état de profiter des solutions. Ils veulent pénétrer plus avant dans le pouvoir sous le manteau de la République. Sans compter qu'ils sont comme des affamés qui depuis longtemps n'approchaient pas de la table, et qui ne veulent pas risquer la part qu’ils sont en train de reprendre du gâteau. J'ai lieu de croire qu'il y a eu entre les deux branches de la famille royale quelques paroles même quelque démarche réelle de réconciliation, pour arriver du moins aux apparences de la réconciliation. Les légitimistes se vantent de quelque chose parti de Claremont. Pouvez- vous sonder un peu ce qui en est ? Par la Duchesse de Glocester, ou la Duchesse de Cambridge, ou les aboutissants légitimistes ?
Est-il vrai que vous laissez en Hongrie 40 ou 50 000 hommes ? Je ne puis pas mettre la moindre importance à Céphalonie. J’en suis fâché pour ces pauvres grecs, qui certainement seront rudement punis. Les Anglais sont d'admirables égaux et de terribles maîtres. Avez-vous remarqué deux grands articles des Débats, l’un sur l’Autriche l’autre sur la Prusse ? Je serais assez curieux de savoir ce qu'en pense M. de Metternich s'il pouvait ne pas vous le dire si longuement.
Adieu, Adieu. Je ne sais rien de précis. Mais je suis sûr que le Cabinet est plus content de ses nouvelles de Rome. Adieu. Je ramasse toutes les petites choses que j'ai à vous dire ; mais je ne vous dis pas les grandes, c’est-à-dire la grande. Adieu. Adieu. G.
Val-Richer, Mardi 31 juillet 1849, François Guizot à Dorothée de Lieven
Qu'aurez-vous fait ? Où êtes- vous ? Comment êtes-vous ? Je ne puis pas penser à autre chose. J'espère que vous serez allée à Brighton. J'en ai eu hier des nouvelles. Sir John Boileau y est. Il parle du bon état de l’endroit, de la bonne disposition de ceux qui y sont, sans doute le choléra n’y est pas. Et la peur que vous avez du choléra m'inquiète autant que le choléra même. Quand je l’ai eu en 1832. Mes médecins, Andral et Lerminier, ont dit que, si j'en avais eu peur il aurait été bien plus grave. Je n'en avais point peur. Que je voudrais vous envoyer ma disposition ! Et aujourd’hui mardi, je n'aurai même pas de nouvelles de ces nouvelles déjà vieilles de 48 heures. J’espère que vous aurez vu M. Guéneau de Mussy. Il me paraît bon pour donner un bon conseil et de l’appui, aussi bien que des soins. Je serais étonné s’il ne s’était pas mis complètement à votre disposition. Demain, demain enfin, je saurai quelque chose. Quoi ?
Dearest, je veux parler d’autre chose. Voilà l'Assemblée prorogée. Avec une bien forte minorité contre la prorogation. Je doute que ce soit une bonne mesure. Dumon, qui va venir me voir, m'écrit : " Vous êtes arrivé au milieu d’une crise avortée. Le Président ne fera pas son 18 Brumaire dans une inauguration de chemin de fer et l’Assemblée n'a d’énergie que pour aller en vacances. Le parti modéré n'a ce me semble, que les inconvénients de sa victoire. A quoi lui serviront les lois qu’il fait si péniblement ! Est-ce le mode pénal qui nous manque ? Mais déjà les dissentiments percent, dans la majorité. Elle se divise comme si elle n’avait plus d'ennemis. Je crains bien que le parti légitimiste ne soit avant longtemps, un obstacle à la formation, si nécessaire du grand parti qui comprendrait les libéraux désabusés, les conservateurs courageux, et les légitimistes raisonnables. Il a bien bonne envie d'exploiter à son seul profit, cet accès de sincérité qui fait faire depuis huit jours tant de confessions publiques, et il semble disposé à marchander l'absolution à tout le monde, sans vouloir l'accepter de personne. Tout ce que je vois, tout ce que j’entends dire me donne une triste idée de la situation du pays. Avec l'économie sociale d’une nation civilisée nous avons l’état politique d’une nation à demi barbare. L'industrie et le crédit ne peuvent s’accommoder de l’instabilité du pouvoir ; la douceur de nos mœurs est incompatible avec sa faiblesse. Nous ne pouvons rester tels que nous sommes ; il faut remonter ou descendre encore. Notre faiblesse s'effraie de remonter ; notre sybaritisme s'effraie de descendre. Il faut bien pourtant ou travailler pour le mieux, ou se résigner au pis : tout avenir me semble possible excepté la durée du présent. Je ne crois pas que la prolongation (je ne dirai pas la durée) du présent soit si impossible. Le pays me paraît précisément avoir assez de bon sens et de courage pour ne pas tomber plus bas, pas assez pour remonter. On compte beaucoup, pour le contraindre à remonter sur l’absolue nécessité où il va être de retrouver un peu de prospérité et de crédit qui ne reviendront qu’avec un meilleur ordre politique. Je compte aussi, sur cette nécessité ; mais je ne la crois pas si urgente qu’on le dit. Nous oublions toujours le mot de Fénelon : " Dieu est patient parce qu'il est éternel. " Nous croyons que tout ira vite parce qu’il nous le faut, à nous qui ne sommes par éternels. Je suis tombé dans cette erreur-là, comme tout le monde. Je veille sans cesse pour m’en défendre. Je conviens qu’il est triste d'y réussir ; on y gagne de ne pas désespérer pour le genre humain ; mais on y perd d’espérer pour soi-même.
Dîtes-moi qu’il n’y a plus de choléra autour de vous et que vous n'en avez plus peur, je serai content, comme si j’espérais beaucoup, et pour demain.
Onze heures Je n'attendais rien de la poste et pourtant. il me semble que c’est un mécompte. Adieu, adieu, adieu, dearest. God bless and preserve you, for me ! Adieu.
18. Val Richer, Vendredi 17 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai grand peine à ne pas vivre tout-à-fait dans le 17e siècle au lieu du 19e. Je viens de dater cette lettre de 1653. C'est là que j'en suis avec Cromwell, au moment où il chasse le Parlement.
Je suppose que vous trouverez l'Allemagne très occupée de votre occupation des Principautés. C'est là que la question se transporte. C’est là du moins qu’on s'efforce de la transporter. Le petit travail des journaux du gouvernement pour le décharger de tout embarras m'amuse. Quand l'affaire de Lieux Saints a été finie, ils ont dit : " La question française est vidée, il n’y a plus qu’une question Européenne ou la France n’a plus que sa part " Maintenant, ils disent : " Puisque la Russie déclare qu’elle se barrera à occuper les Principautés, sans faire la guerre à la Porte, il n’y a plus à vrai dire, de question Européenne ; ceci n’est plus qu’une question allemande, c’est à l'Allemagne de savoir si elle veut que la navigation et le commerce du Danube passent tout à fait dans les mains de la Russie. Vous me direz si l'Allemagne est disposée à se charger ainsi seule du fardeau.
Il y a entre la politique de mon temps et celle qui lui a succédé cette différence que l’une à besoin de placer l’intelligence publique trop bas et que l’autre avait besoin de la placer trop haut.
Je vous suppose établie d’hier à Ems Bayrischer hof. Garderez-vous votre fils Paul un peu de temps ? Je le voudrais pour vous et aussi pour lui. Sa société vous est agréable et je crois que la vôtre lui est bonne.
Je ne comprends pas Hélène Kotschoubey de venir à Paris dans cette saison, à moins que ce ne soit pour s'y arranger pendant qu’il fait beau et y passer l'hiver prochain.
Je n’ai absolument rien de Paris depuis votre départ. Personne n’y est plus, que mon petit ami qui me dira bien de temps en temps quelque chose. Je ne sais pas quand Duchâtel et Dumon reviendront de leur voyage, l’un à Vichy, l'autre dans le midi. Le Duc de Broglie a été content de son séjour à Claremont. Les Princes très sensés et bien disposés ; mad. la Duchesse d'Orléans toujours la même ; il n’a point eu de conversation sérieuse avec elle. Le comte de Paris en grand progrès d’intelligence, de taille, de manière et d’apparences fermes et franches. Puisque vous aurez passé un jour plein à Bruxelles, vous y aurez vu du monde intéressant.
Midi
Je n’attendais pas de lettre aujourd’hui. Adieu. Adieu.
30. Val Richer, Lundi 11 juillet 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis charmé que Hübner et Hatzfeld vous rassurent, quoiqu'ils n'y réussissent guère. Leur avis vaut bien quelque chose, car ils seraient certainement très effrayés s'ils n'étaient pas tranquilles.
La lettre de votre correspondant est vive ; et cela m'a plu. J’aime qu’on soit capable de passion en gardant, son jugement libre et sain. Mais rien ne prouve mieux que cette lettre dans quelle mauvaise affaire vous êtes engagés là, et mal engagés ; vous faites entrevoir, comme dernier moyen à votre usage, le soulèvement // des chrétiens et la destruction de l'Empire Ottoman, c’est-à-dire la révolution en Orient. Voilà donc l'Europe entre deux révolutions, celle d'Orient qui est dans vos mains et que vous feriez au besoin, et celle d'Occident qui est dans les mains de l'Empereur Napoléon, et qu’il ferait sans doute aussi vous voyez bien qu’il faut absolument sortir de la voie qui mène là. Ce n’est pas une situation digne de votre Empereur. Il ne peut pas pratiquer une politique telle qu’elle puisse le mettre dans la nécessité de devenir un révolutionnaire.
Certainement on croit toujours, à Londres, qu’on arrivera à une solution pacifique. Le renvoi répété de la discussion dans les deux Chambres prouve plus que les prédictions de Greville. Voilà du reste l’entente cordiale de la France et de l'Angleterre solennellement déclarée par Lord Palmerston. Je ne me refuse pas le plaisir d’un retour sur moi-même ; si je n'ai pas réussi à fonder la monarchie de 1830, j’ai bien réussi du moins à fonder sa politique extérieure, car elle lui survit et se maintient à travers toutes les révolutions. démocratiques, ou impériales. // Avez-vous des nouvelles de votre fils Alexandre est-il remis de son indisposition ?
10 heures et demie
Le facteur ne m’apporte de lettres de nulle part. C'est rare. Adieu. Adieu. J’espère que vous avez, comme moi, retrouvé le beau temps. G.
Mots-clés : Bonaparte, Charles-Louis-Napoléon (1808-1873), Circulation épistolaire, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Guerre, Nicolas I (1796-1855 ; empereur de Russie), Politique (Internationale), Réseau social et politique
11. Val-Richer, Mardi 21 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai expédié mon courrier et mes visites. Je me suis promené une heure. Je vous reviens. Vous vous promenez probablement aussi dans la forêt. Mes bois ne sont pas si bien percés, ni si grands. A quelle heure placez-vous vos deux promenades ? Vous ne devez plus souffrir de la chaleur. Il fait frais ici ; un peu de pluie tous les jours. En tout, une température agréable. Pas assez chaude pour mon goût. Surtout pas assez lumineuse. J'aime le ciel brillant et pur, qu’il n’y ait que de la lumière, de l’espace éclairé entre nous et les régions inconnues. Les nuages me déplaisent. C’est de la boue en l’air. Ce n'est pas là sa place. De mon origine méridionale, je n'ai conservé que certaines dispositions, certaines préférences matérielles celle-là surtout. Le caractère, le naturel moral des populations du midi ne me plaît guère. J’aime mieux les populations du Nord, du semi, nord s’entend. Elles ont plus de good sens, de mastliness, de consistency et de délicatesse. L'inconséquence toujours imprévue et la familiarité grossière des méridionaux me déplaisent souverainement bien que spirituelles et amusantes. Mais le ciel, le ciel ! Il n’y a de ciel que dans le midi.
Je repense à la lettre de Lady Palmerston. J’en suis frappé comme vous. Point de confiance ni d’en train. Que dites-vous de la quasi-nouvelle de Brougham. Palmerston leader des Protectionistes dans les Communes ? Je n'y crois pas. Brougham n’y croit pas. Surtout, il n'en veut pas. Mais il ne repousse pas cela absolument. Avec la confusion des Partis et l’inconsistency hardie de Lord Palmerston, tout est possible. Vous avez raison. Le prochain Parlement ramènera Peel. Et par conséquent Aberdeen, quoiqu’il en dise aujourd’hui. Pourquoi, ce humboy inutile ? Je lis nos journaux ici bien plus attentivement qu'à Paris. En avez-vous plusieurs à St Germain, et lesquels de l’opposition ? Je les trouve bien froids, et décolorés, et déroutés au fond, malgré la violence et la grossièreté de leurs injures. Evidemment le parti n'espère pas grand chose des élections. Je ne me fie point à son propre découragement, même sincère, au découragement du parti de Paris, des meneurs et des journalistes. Je suis convaincu que sur les lieux, dans chaque arrondissement parmi les hommes qui ont réellement la main à la pâte électorale, il y a beaucoup plus d’ardeur, et que rien ne manque à leur travail, et qu’ils trouvent dans les préjugés, dans les habitudes, dans les penchants critiques, et radicaux des masses beaucoup plus de moyens d'action et de chances de succès qu’on ne le croirait d'après les journaux du centre. Je n’ai donc pas une pleine confiance bien s'en faut. Cependant j’en ai. Ce sera un grand succès s’il arrive. Aussi grand que nouveau. Et la question bien personnelle, bien posée sur mon nom. Il n'y a que vous au monde avec qui je me laisse aller aux satisfactions orgueilleuses. Plus je vais plus mon orgueil devient intérieur et a moins besoin de paraître. Il est ridicule de le montrer avant, subalterne de le montrer après. Mais à vous, je montre tout.
Mercredi 22, 8 heures
Je me suis levé tard. J’ai éternué. L’humidité est, l’inconvénient de ce pays-ci. Pour peu que je me promène après dîner, mon cerveau s'en ressent. Ce n’est rien du tout, comme vous savez ; seulement un peu d'ennui. J’attends mon courrier. Adieu, en attendant. 9 heures Voilà votre lettre. Courte, mais tendre ; et pas de mal d'yeux et pas d’abattement ; les deux maux que je crains le plus. De quoi s'avise Mad. Danicau d'être malade ? Le courrier ne m’apporte rien d'ailleurs. Sinon beaucoup de signatures à donner. Toujours bonnes nouvelles électorales. Adieu. Adieu. Adieu G.
Mots-clés : Ambition politique, Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Elections (France), Nature, Politique (Angleterre), Politique (femme), Presse, Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Santé (François), VIe quotidienne (Dorothée), Vie quotidienne (François)
305. Val-Richer, Vendredi 1er novembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous voilà dans le bon mois. En 1815, à Gand, Louis 18 sortant de son cabinet et traversant le salon, le matin même du jour où il répartit pour rentrer en France me disait : " Eh bien M. Guizot, nous voilà du bon côté de la glissoire. " J'aurai certainement, à vous retrouver, plus de plaisir que lui à reprendre la route de Paris. Que de joies différentes en ce monde, comme de douleurs ! J’en ai connu de toutes sortes ; et bien décidément c’est de l'affection que viennent les plus vives, les seules qui aillent toucher jusqu'au fond de l'âme, & l’ébranlent, et la satisfassent toute entière.
Je partirai le 13. Il n'y a pas moyen de presser davantage, ma mère. Je serai à Paris le 14 pour dîner, et je vous verrai dans la soirée. Il fait aujourd'hui un temps affreux, le vent, la pluie, le froid. Il fera beau, le 14. Je voudrais qu’il fit beau après-demain. J’ai tout mon Lisieux à déjeuner. Ce sont mes adieux. J’ai refusé absolument leurs dîners, leurs parties de campagne, leurs toasts. Ils m'auraient donné dix rhumes. Ils auront les primeurs de Ma route neuve. Elle est finie. On la livre dimanche matin à la circulation. Il ne me reste plus à faire qu’une avenue de la route à ma porte. On la fera cet hiver. L’entrepreneur me la promet pour le 15 avril prochain. Que les plus petites choses sont lentes quand il faut créer !
J’ai envie de quelque chose de M. de Bacourt. Je me crois sûr qu’il a entre les mains, je ne sais comment tous les papiers du comte de La Marck, (d’Aremberg) l’ami intime de Mirabeau et à qui Mirabeau laissa en mourant presque tous les siens, les plus confidentiels. Je voudrais bien voir, ces papiers. Je suis dans Mirabeau jusqu'au cou, par curiosité après Washington. Croyez-vous que je puisse demander à Mad. de Talleyrand de demander cela à M. de Bacourt ? Est-ce convenable ? Ou faut-il que je m'adresse directement à M. de Bacourt ?
10 heures
Votre lettre à votre frère est à merveille, très douce et très ferme, très précise. S'il a, comme j'en ai peur, oublié ou abandonné vos intérêts sur les points que vous touchez, il en ressentira quelque embarras... si quelque embarras est possible. Je n'hésite pas quant à vos fils, d'après ce que vous avez écrit à votre frère, vous devez attendre sa réponse avant de partager le capital. Vous vous le devez à vous-même. Je suis un grand partisan de la consistency. Si vous aviez renoncé à toute observation, il faudrait vider sur le champ l’affaire du capital. Mais vous avez voulu rappeler votre droit méconnu, constater du moins qu'on l’avait méconnu. Le capital est votre seul moyen d'action. Il faut le retenir jusqu'à ce qu’on ait répondu à vos observations, soit pour les accueillir quelque peu, soit pour vous dire nettement. que vous êtes liée par l’arrangement, et que vous ne devez attendre rien de plus. A votre place j’écrirais tout simplement cela à Alexandre. Mais comme ce sera Paul qui répondra par Alexandre, je comprends votre crainte de réponse inconvenante. Ne pourriez-vous pas écrire à Benkhausen, et le charger de dire à vos fils vos intentions ? Voilà mon avis à la première vue. Si quelque autre idée me venait, je vous la dirais demain.
Adieu. Adieu. A dater d'aujourd'hui les Adieux valent mieux. G.
276. Val-Richer, Mercredi 25 septembre 1839, François Guizot à Dorothée de Lieven
Mes hôtes me quittent ce matin. J’en suis bien aise. J’aime mieux la solitude que l'ennui des hommes. D'ailleurs, je parle de solitude, bien à mon aise au milieu d’une famille nombreuse, et animée, et qui m’aime. C’est curieux à quel point on se laisse aller à se servir des mots complaisamment pour soi-même et sans prendre la peine de regarder, s’ils sont vraiment vrais.
Je me séparerai aussi cette semaine de Washington. Je vais finir. A regret. C’est une grande âme, et qui a fait bien simplement de grandes choses par de grands motifs. J’ai pris plaisir à vivre en intimité avec lui.
Voici ce que m'écrit de Londres un jeune Dillon, homme d’esprit établi en France par mes soins et qui est allé y passer quinze jours. Il connait bien du monde.
I have been several influential Whigs who are unonimous in regarding their cause as in the atmost peril. The Tories must get into office within a very short space of time. They have been gaining ground slowly but surely within the last twelve monthes. Tthe blunders of L. Palm and the excesses of the Chartists have frightened many among the moderate Whigs into the arms of the Tories. The great and indeed, the only support of the Ministry are the Irish party and the court ; but both are, as you know, far from popular en England. The affair of Lady Flora Hastings, has decidebly brought the Queen into great national disreporter. It is almost needless to speak of the detestation in which O'Connell, the priests and the entire Irish party are held by the great bulk of the English and scotch people. It is a sort of phrenzy, the like of which has not bien witnessed since the days of the League or the Paritans. Really, were it not for a few scattered rays of the philosophy of the 18th century that occasionnally illumine the intellectual gloom ot the British Empire we should witness today scenes that have not been surpassed even by the Inquisition. The fanaticism of the Tories is not one bit greater, than that of their antagonists, tre Papists. Both would burn, main and crucify, il they could, as in the old orthodox times of Bonner or of King Edward. The Tories have great advantage, on their side. They have wealth, talent and political organization. They are, if we forget for a moment, the crudity of some of their political tonets an admirable model as a political party. Still, although, they seem destined to enjoy a passing triumph soon, they will, I feel convinced, be ultimately discomfited. O'Connell is a knotty block. He yields to none of the Tories, in energy, and he has proved himself latterly te be an able statesman. As he is hardened against defeats, 80 he is not likely to be intimidated by that with which he is now menaced. His cause is a good one, and he has behind him seven or eight millions of miserable but resolute zenlots in whose hands the British Constitution has latterly placed a formidable and destructive weapon. O'Connell backed by these will always be able to elog and retard the working of the British constitution. The English people who are not disposed to drive Ireland into open insurrection, will at length grow tired with these and similar embarrassments. They will seek again to remove them by destroying their cause, and a tardy justice will at length be rendered to Ireland.
En voilà bien long. J’ai fini parce que j’avais commencé. Mais pour un jeune Irlandais, ce n'est pas mal de pénétration, et de sens. 9 h. 1/2 Je suis charmé que vous ayez enfin ce bail. Et si Jennison ne veut rien vendre, ce ne sera que mieux. Vous vous meublerez tout-à-fait à votre gré. Plus le Cabinet deviendra radical, plus les Torys acquerront de chances. Adieu. Adieu. Je n’ai pas de soleil aujourd'hui. Mais l'adieu est le même. G.
Val-Richer, Dimanche 30 octobre 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Voilà donc des coups de canon. Je ne connais pas assez les localités pour savoir ce qu’ils valent comme opération militaire ; il paraît que vous avez pris l’initiative. Je serais étonné si vous ne laissiez pas aux Turcs l’embarras de passer le Danube, et de venir vous attaquer dans les Principautés. Militairement cela semble sensé, et politiquement, c’est beaucoup mieux pour vous. Les Turcs ne peuvent soutenir longtemps la guerre offensive. L’article du Moniteur est calmant et pacifique. Mais je ne m'explique pas la nomination du général Baraguey d’Hilliers, sinon par l'Empire des services personnels, abstraction faite de toute politique. Du reste la Bourse et Galignani disent que le Moniteur n’a pas fait sur tout le monde la même impression que sur vous et moi.
Je suis frappé de la froideur et de l’ennui des journaux Anglais sur cette affaire. C'est ce qui arrive des questions factices. Quand le bavardage a jeté son feu, et qu’il faut en venir à l'action sérieuse, il n’y a plus rien, et en voudrait bien n’y plus penser.
J’ai quelque peine à écrire ce matin. Je suis pris, dans l’épaule, d’une douleur rhumatismale assez vive quand je fais un mouvement. Je connais cela. J'en ai été atteint un jour où j’avais à parler à la Chambre des Paires, et j’ai parlé quand même, l’épaule et le cou de travers. Je n'ai plus besoin de si maltraiter mon mal. Cela passera avec quelques frictions et deux ou trois jours.
Onze heures
Voilà une lettre qui me déplait beaucoup. Mais vos impressions sont bien en contradiction avec cette suspension momentanée des hostilités dont les journaux m’apportent le bruit. Je ne crois pas à l'attaque dans la mer Noire. Que tout cela est fou et triste ! Adieu, adieu. G.