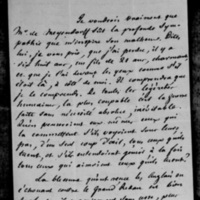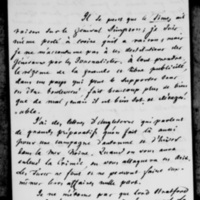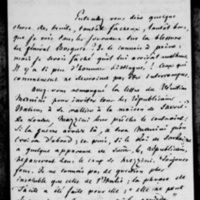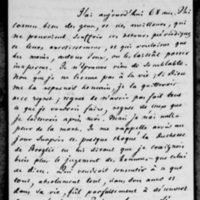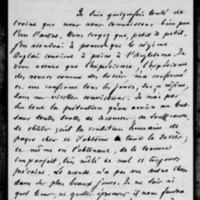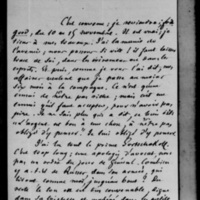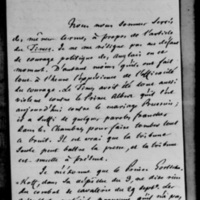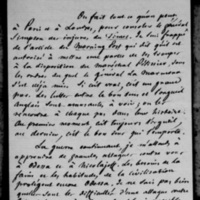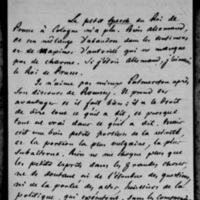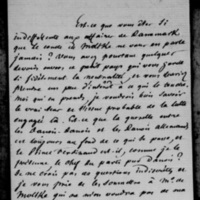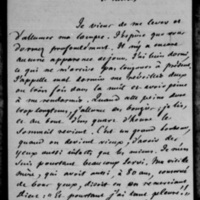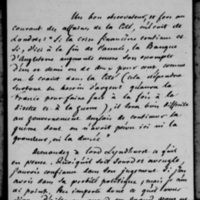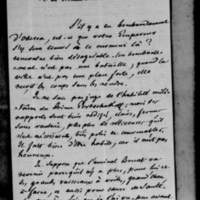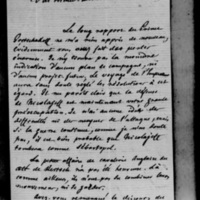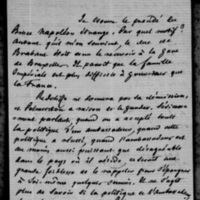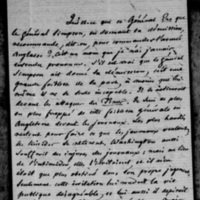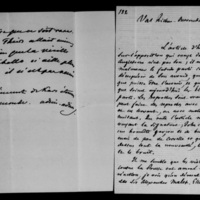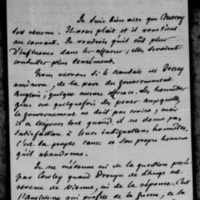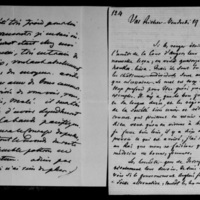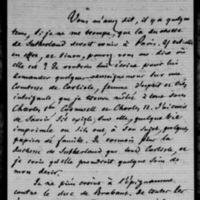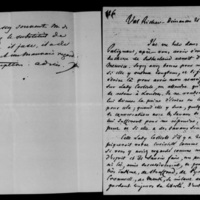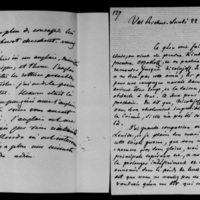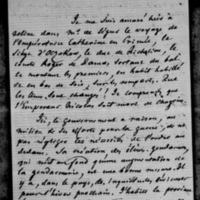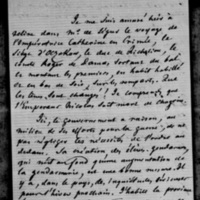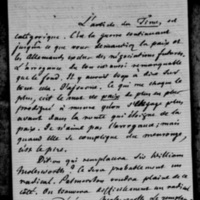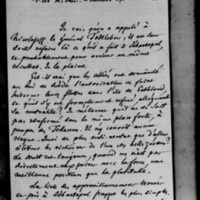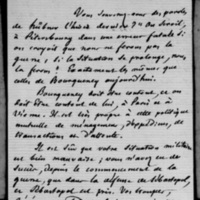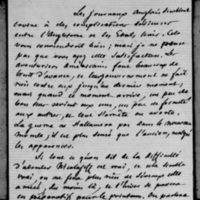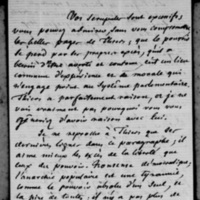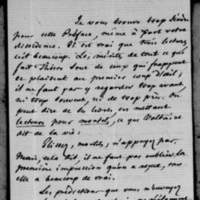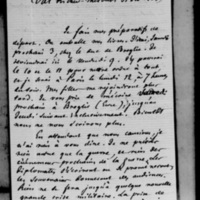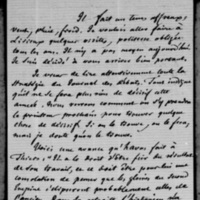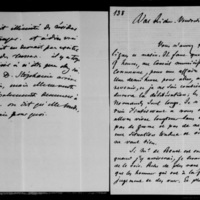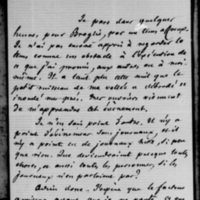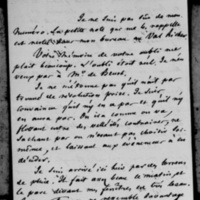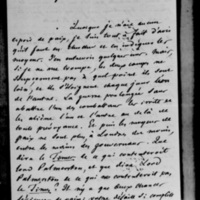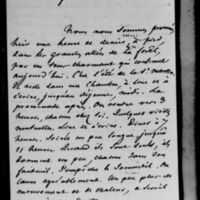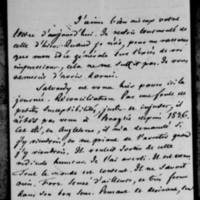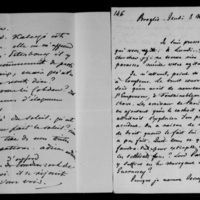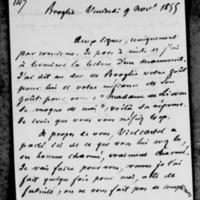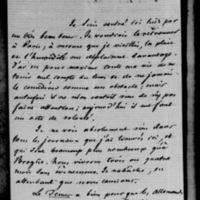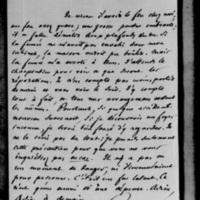Votre recherche dans le corpus : 292 résultats dans 6062 notices du site.Collection : 1855 (18 mai - 10 novembre) : Espérer la paix (1850-1857 : Une nouvelle posture publique établie, académies et salons)
106. Val-Richer, Lundi 1er octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je voudrais vraiment que M. de Meyendorff sût la profonde sympathie que m'inspire son malheur. Dites lui, je vous prie, que j’ai perdu, il y a dix huit ans, un fils de 21 ans, charmant, et que je l'ai devant les yeux comme s’il était là, à côté de moi. Il comprendra que je le comprends, de toutes les légèretés humaines, la plus coupable, c’est la guerre faite sans nécessité absolue véritable. Qu'en penseraient eux-mêmes ceux qui la commettent, s'ils voyaient sous leurs pas, d’un seul coup d’oeil, tous ceux qu’ils tuent et s'ils entendaient gémir à la fois, tous ceux qui aimaient ceux qu’ils tuent.
La blessure qu’ont reçu les Anglais en échouant contre le grand Redon est bien profonde ; ils y reviennent sans cesse, plus qu’il ne convient à des gens d’esprit et vraiment fiers. Il est vrai qu’il y a eu là autre chose qu’un accident de guerre ; en comparant les rapports des deux généraux et les lettres des deux camps, il est impossible de n'être pas frappé de l’inégalité, pas du tout de bravoure personnelle, mais d’intelligence, de prévoyance, d'action bien ordonnée et bien conduite, de fermeté d’esprit et d'habitudes, militaires, les qualités éclatent dans les rapports du Maréchal Pélissier, et du général Niel ; elles manquent dans tout ce qui vient des Anglais, rapports au récits ; le courage et le débouement y abondent, mais tout y semble marcher au hasard, sans préméditation sans plan, sans ensemble, sans commandement. Dieu veuille qu’ils ne prennent pas, dans la politique, leur revanche de leur intériorité dans la guerre ? Vous savez mon estime et mon goût pour eux, et que je ne leur veux que du bien, mais pas à nos dépens.
Il est fort possible que le voyage de Walewski à Bruxelles ne soit qu’une affaire privée ; on entend souvent malice où il n’y en a point. Mais c’est singulier. Et pourquoi le Duc et la Duchesse de Brabant, n’arrivent pas ? Viendront-ils aux Tuileries, le lendemain du jour où la Reine leur grand mère aura quitté Lacken ?
Je me justifie ; voici votre phrase sur le mariage Anglo-Prussien exactement copiée : " le mariage cependant ne pourra guère se faire." Vous avez oublié le mot encore.
Onze heures
Je n’apprends rien. Nous aurons mille choses, à nous dire quand nous causerons. Adieu. G.
107. Val-Richer, Mardi 2 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il se peut que le Times ait raison sur le général Simpson ; je suis même porté à croire qu’il a raison ; mais je ne m'accoutume pas à ces destitutions des généraux par les journalistes. A tout prendre le régime de la grande et libre publicité dans un pays qui peut le supporter sans en être bouleversé, fait beaucoup plus de bien que de mal ; mais il est bien sot et désagréable.
J’ai des lettres d'Angleterre qui parlent de grands préparatifs qu’on fait là aussi pour une campagne d'automne, et d'hiver dans la Mer Noine. Quand on vous aura enlevé la Crimée, en vous attaquera en Asie Les Turcs ne font et ne peuvent faire eux mêmes leurs affaires nulle part.
Je ne m'étonne pas que Lord Stratford reste. Je n’ai jamais cru à son rappel. Le cabinet anglais ne poussera pas jusque là la complaisance, et elle lui couterait trop cher. Lord Stratford, dans la Chambre des Pairs, serait tant que durera la guerre d'Orient, un voisin trop incommode ; il en sait plus, sur ces affaires là, que tous les ministres, et ne leur laisserait pas un instant de repos.
Je suis comme les diplomates ; je ne crois pas à la bonté de Waleski ; mais je ne comprends pas son voyage à Bruxelles ; ni pourquoi le Duc et la Duchesse de Brabant ne viennent pas. Si l'alliance Anglo-Française n'était pas si intime, le Roi Léopold pourrait s’inquièter ; mais il n’a rien à craindre ; sa neutralité est bien gardée.
Onze heures
Voilà le facteur, et point de lettre. J'espère bien que ce n'est qu’un retard et que j'en aurai deux demain. Mais je n’aime pas les retard. Adieu, Adieu. G.
108. Val-Richer, Mercredi 3 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Entendez-vous dire quelque chose des bruits, tantôt fâcheux, tantôt bons que je vois dans les journaux sur la blessure du général Bosquet. Je le connais à peine ; mais je serais fâché qu’il lui arrivât malheur. Il y a si peu d'hommes distingués ? Ceux qui commencent ne devraient pas être interrompus.
Avez-vous remarqué la lettre du Vénitien Manini pour inviter tous les républicains Italiens à se rallier à la maison de Savoie de Londres. Mazzini leur prêche le contraire. Si la guerre arrive là, ce sera Manini qu’on croira d'abord ; et puis, si le Roi de Sardaigne a quelque apparence de succès, les républicains repasseront dans le camp de Mazzini. Toujours fous. Je ne connais pas de question plus insoluble que celle de l'Italie ; la phrase de Tacite a été faite pour elle ; " Elle ne peut supporter ni ses maux, ni les remèdes."
A défaut de nouvelles, je viens de lire le feuilleton des Débats sur l'opéra du Duc de Coburg ; il sert quelquefois à quelque chose d'être Prince. Evidemment, sans cette qualité, l'opéra serait tombé.
Midi
Voilà vos deux lettres qui me troublent, l’une et l'autre. Je vous prie de m'accepter du 15 au 20 octobre. Voici ma situation. Je suis en train de terminer mon histoire du rétablissement des Stuart, très en train ; mais il me faut évidemment six semaines de travail ici où rien ne me dérange, où rien ne me fatique, où j’ai toute ma journée. Si je rentre à Paris avant d'avoir fini, j'en aurai pour trois mois, pour quatre mois ; je ne sais combien, et avec beaucoup moins d’entrain et de suite. Vous ne pouvez vous figurer la différence qu’il y a, pour quelqu’un qui travaille, entre la vie de campagne et la vie de Paris. Or je tiens beaucoup à avoir fini et ouvrage, et à le publier cet hiver. Je ne veux à aucun prix, être ces six semaines là, sans vous voir. Je puis prendre quelques jours ; mais j’ai besoin de tous les autres, ce qui me mène du 15 au 20 novembre pour mon retour définitif. Je n’ai jamais espèré mieux et je ne comprends pas ou Génie a pris que je rentrerais dans les premiers jours de Novembre. Je ne lui ai rien dit de semblable. Je vais voir encore si je pouvais aller plus vite, si je pourrais ajourner la fin. Rien ne me déplaît plus que de vous attrister et votre impatience me plaît. Adieu, adieu. G.
109. Val-Richer, Jeudi 4 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai aujourd’hui dans. J’ai connu bien des gens, et des meilleurs, qui ne pouvaient souffrir ces retours périodiques et leurs avertissements, et qui voulaient que du moins, autour deux, on les laissât passer inaperçus. Je n'éprouve rien de semblable. non que je ne tienne pas à la vie ; si Dieu me la reprenait demain, je la quitterais avec regret, regret de n'avoir pas fait tout ce que je voudrais faire, regret de ceux que je laisserais après moi. Mais je n’ai nulle peur de la mort. Je me rappelle avoir un jour surpris, et presque choqué la Duchesse de Broglie, en lui disant que je craignais bien plus le jugement des hommes que celui de Dieu. Qui voudrait consentir à ce que tout absolument tout dans son âme et dans sa vie, fût parfaitement à découvert devant les hommes nous sommes, si imparfaits que nous avons besoin de secret les uns avec les autres, et nous ne saurions nous rendre mutuellement justice, si nous voyons à nu toute notre imperfection. Dieu, qui saura tout, sera en même temps parfaitement juste. C'est pourquoi je ne le crains pas. Quand je rentre en moi-même quand je me sonde en tous sens, quand je me rappelle tout, je trouve en moi, à tout prendre, plus de bien que de mal ; j’ai voulu et fait dans ma vie, publique et privée, plus de bien que de mal. Et j’ai toujours aimé le bien, même quand j’y ai manqué. Voilà ma sécurité en voyant les années s'écouler. Des deux sentiments qu'éveille la pensée de la mort, le regret et la crainte, je ne connais que le premier ; le second m’est étranger.
Il m'est venu hier, par Londres, une lettre assez curieuse de Florence, toujours grande inquiétude en Italie, et encore plus à Rome qu'à Naples ; le Pape semble se croire aussi menace que le Roi Ferdinand ; non pas menacé d’un successeur, mais menacé de se voir demander des choses impossibles, impossibles, en elles-mêmes, impossibles pour lui. L'Italie est impossible ; c’est le pays du rêve et de l'impuissance, des douleurs légitimes et incurables, de l'assassinat et de la mollesse. Quiconque y touchera pour y faire autre chose que l'amélioration lente et molle des gouvernements établis, n’amènera que des secousses inutiles, ces [?] du résumé qui devastent sans féconder.
Onze heures
Cela m'amuse de voir comment j’ai répondu à ce que vous dites de mon âge avant d'avoir reçu votre lettre. Moi aussi j'estimais, et je regrette sir Henry Ellis. Adieu, adieu. G.
110. Val-Richer, Vendredi 5 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis quelquefois tenté de croire que nous nous connaissons bien peu l’un l'autre. Vous croyez que petit à petit j'en viendrai à penser que le régime Anglais convient à peine à l'Angleterre. Je vous assure que l'expérience, l'expérience des revers comme des succès, m'a confirmé et me confirme tous les jours, sur ce régime dans mes vieilles convictions. Je n’ai pas du tout la prétention qu’on arrive au but sans toutes sortes de secousses, de souffrances, de chutes ; c’est la condition humaine de payer cher et d'obtenir tard le succès et même en l'obtenant, de le trouver imparfait, très mêlé de mal et toujours précaire. Le monde n’a pas vu autre chose dans ses plus beaux jours. Je ne sais ni quel temps, ni quelles épreuves, il nous faudra encore pour arriver à ce régime, ni à quel point et par quels côtés, il différera du régime anglais. Je demeure convaincu que nous y arriverons, et que bien d'autres, qui en sont bien plus loin que nous y arriveront aussi. Je ne verrai pas ce jour là, mais j'y crois. Où en serions nous donc si, pour croire, il fallait voir.
Je crois encore à autre chose, c’est que dans le fond de votre âme, comme goût, sinon comme espérance, vous pensez comme moi et ne faites cas que du même régimes, dont je fais cas. Vous aurez bien de la peine à me faire revenir de ma croyance.
Je suis protestant, et vous aussi. Croyez vous que Luther, quand il a commencé la réforme, se doutât de ce qu’elle coûterait d'efforts et de maux, et du temps qu’il lui faudrait pour s’établir, et de l'imperfection où elle resterait même en triomphant. Il a vu tout cela avant de mourir ; il n'en a pas moins persisté à croire que sa réforme était bonne et qu’elle triompherait et il a eu raison. Et vous et moi, nous sommes protestants aujourd’hui parce qu’il a eu raison.
L’attaque du Journal des Débats, contre Lord Stratford n’est pas sans importance, ils ne l’ont certainement pas faite, sans être surs que cela convenait. Je n'en persiste pas moins à douter que le Cabinet anglais cède ; faible vis à vis de Lord Stratford et orgueilleux, vis à vis de l'étranger, c’est plus qu’il n'en faut pour ne pas aider.
Midi
J’allais vous proposer ce que vous me proposez Je l’aime mieux aussi. C'est donc convenu. d'ailleurs je ne peux pas me changer. Adieu. Adieu. G.
111. Val-Richer, Samedi 6 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
C'est convenu ; je reviendrai for good, du 10 au 15 novembre. Il est vrai ; je tiens à mes travaux. J’ai la manie de l'avenir ; nous passons si vite, il faut laisser trace de soi, dans les événements ou dans les esprits. Et puis comme je vous l’ai dit, mes affaires veulent que je passe au moins six mois à la campagne. Ce n'est qu’un ennui de n'être pas riche ; mais c’est un ennui qu’il faut accepter, pour n'avoir pas pire. Je ne sais plus qui a dit, et bien dit. " L'argent est bon à une chose, à n'être pas obligé d'y penser." Je suis obligé d'y penser.
J’ai lu tout le prince Gortschakoff. C’est trop long ; une apologie d'avocat, non pas un ordre du jour de général. Combien y a-t-il de Russes dans son armée, qui diront comme moi, jusqu'au bout ? Du reste le ton est est très convenable, digne dans sa tristesse et modéré dans les petites misrepresentations dont il a besoin pour soutenir le courage de son monde. Il aura encore bien des ordres du jour à faire, car il me paraît démontré que vous continuerez à nous défendre en Crimée, disputant le terrain pied à pied. La guerre deviendra plus difficile pour nous à mesure que nous nous éloignerons des côtés. Et puis, je suppose la Crimée conquise, et je répète ce que je disais à propos de Sébastopol et après ? La question est toujours de savoir si vous voudrez faire la paix après un revers, car je ne vois pas comment on vous infligerait un revers assez grand pour vous y forcer.
Le Times est vraiment stupide dans sa fureur contre la Prusse. Je ne comprends pas que personne en Angleterre Ministre ou journaliste, ne se donne le plaisir de le traiter comme il le mérite, et de lui, mettre sa bêtise sous le nez encore plus que sa violence. L'alliance Prussienne est si évidemment dans l’intérêt anglais ! Les Whigs ont oublié la politique de Lord Chatham, comme les Torys, celle de M. Pitt.
Voilà le dernier des vieux Whigs mort, ce pauvre sir Robert avait. Il avait à un moindre degré, le même défaut que Lord Grey ; il ne savait pas être vieux ; bien aimable du reste et bien noble.
La lettre de votre Empereur au gouverneur de Moscou est tranquillement pieuse et obstinée ; elle doit faire effet sur votre peuple. Rien de remarquable d'ailleurs. Pas un mot qui frappe et reste.
Heckeren m'amuserait comme vous, mais pas longtemps. Je suis très vite las des charlatants vantards qui veulent amuser bien plus que tromper.
Onze heures
On m'écrit de Londres qu’il n’est pas et ne sera pas sérieusement question de rappeler Lord Stratford, quelque envie qu’on en aie à Paris et à Constantinople. On dit que le sultan ne veut plus avoir avec lui de communication directe et l’a invité à traiter avec le Reiss Effendi.
Adieu, Adieu. G.
112. Val-Richer, Dimanche 7 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous nous sommes servis des mêmes termes à propos de l'article du Times. Je ne me résigne pas au défaut de courage politique des Anglais en ce moment. D'autant moins qu’ils ont fait tout à l'heure l'expérience de l'efficacité du courage. Le Times avait été tout aussi violent contre le Prince Albert qu’il l’est aujourd’hui contre le mariage Prussien, il a suffi de quelques paroles franches dans les Chambres pour faire tomber tout ce bruit. Il est vrai que la tribune seule peut battre la presse, et la tribune est muette à présent.
Je m'étonne que le Prince Gortschakoff dans sa dépêche du 3, ne dise rien du combat de cavalerie du 29 sept. Les résultats matériels prouvent qu’il n’a pas été sans importance. Peut-être ces mots de sa dépêche : " Hier, l'ennemi a fait un mouvement contre notre flanc gauche, se rapportent-ils à cela. Je ne sais ce que je dis ; votre 3 oct répond à notre 21 sept ; le Prince Gortschakoff ne pouvait parler le 21 de ce qui s'est passé le 29. Quand adopterez-vous le calendrier Européen ? Nous ne sommes pas en voie d’union quelconque. Voilà toute la division Chasseloup Laubat qui part du camp de St. Omer pour la Crimée. Je fais grande attention aux mouvements de troupes ; il part, en ce moment, des renforts, très considérables.
Le Morning Post est aussi violent contre vous que le Times contre le mariage Prussien.
Je suis fâché de ce qu’on vous a dit sur le ménage Brabant. Je souhaite du bien à ces Princes là. Je ne m'étonne pas que le Roi Léopold n'ait pas bien élevé ses enfants. Il faut, avec les enfants, de la sympathie, un mouvement communicatifs, comme il faut de l’air et du soleil aux jeunes plantes. Les grandes personnes ne supportent guère l'ennui ; les enfants bien moins encore ; il les glace et les hébète. La Reine Christine, m'expliquait un jour la médiocrité de la plupart des Princes Espagnols par les vices, de leur éducation. Point d'études et point d'amusements ne rien apprendre et ne se point divertir ; la discipline immobile dans l'oisiveté. L'étude du moins n’a pas manqué au Duc de Brabant ; mais ce n'est que la moitié de ce qu’il faut.
Onze heures
Moi aussi j’ai été fâché que le Journal des Débats ait reproduit l'article du Times au moins fallait-il le blâmer sévèrement. Adieu, Adieu. G.
113. Val-Richer, Lundi 8 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
On fait tout ce qu’on peut à Paris et à Londres, pour consoler le général Simpson des injures du Times. Je suis frappé de l'article du Morning Post qui dit qu’il est autorisé à mettre une partie de ses troupes, à la disposition du Maréchal Pélissier, sous les ordres duquel le général La Marmona s'est déjà mis. Si c’est vrai, c’est un grand pas. Les luttes entre le bon sens et l’orgueil anglais sont amusantes à voir ; on les rencontre à chaque pas dans leur histoire. Au premier moment, c’est toujours l'orgueil au dernier, c’est le bon sens qui l'emporte.
La guerre continuant, je m'attends à apprendre de grandes attaques contre vous à Odessa et à Nicolajeff. Les besoins de la faim et les habitudes de la civilisation protégent encore Odessa. Je ne sais pas bien quelles sont les difficultés d’une attaque autre Nicolajeff ; mais il me semble impossible qu'ayant détruit votre port dans la Mer Noire, on vous laisse votre chantier.
La petite histoire de votre ministre au dîner du Roi de Portugal est drôle.
Connaissiez vous ce M. d'Anaroff qui vient de mourir ? Il m’a écrit trois au quatre fois, comme ministre de l’instruction publique, et une fois, privately, une lettre assez spirituelle, sur l'Etat comparatif des études historiques, en France et en Russie, exempte, à coup sûr de tout préjugé national.
Vous m'avez dit, je crois, que Lord Lyndhurst passerai l'hiver à Paris. Je serai bien aise de le voir. Je lui dirai sans me gêner, ce que je pense de sa campagne de politique étrangère. A l’âge et avec l’esprit et l’expérience de Lord Lyndhurst, on devrait se donner le plaisir de ne parler que raison et de dire la vérité à tout le monde. La vieillesse est bonne à cela, et pour elle, la considération est à ce prix.
Votre lettre de 1799 m’a amusé. Vous vous trouverez quelqu’un à qui faire aujourd’hui. l'aumône qu’on vous demandait alors.
Onze heures
Vous avez raison sur d'Haubersaert. Il a de quoi faire rire. Mais il est très honnête, spirituel, courageux et fidèle. Je passe beaucoup à ces qualités là. Adieu, adieu.
Mots-clés : Armée, Diplomatie, Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), histoire, Histoire (Angleterre), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Italie), Politique (Prusse), Portrait, Posture politique, Réseau scientifique, Réseau social et politique
114. Val-Richer, Mardi 9 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’aime pas mieux Palmerston après son discours de Rome. Il prend ses avantages et il fait bien ; il a le droit de dire tout ce qu’il a dit, et presque tout est vrai dans ce qu’il a dit. Mais c’est une bien petite portion de la vérité, et la portion la plus vulgaine, la plus subalterne. Rien ne me choque plus que les petits esprits dans les grandes choses, ne se doutant, ni de l'étendue des questions ni de la portée des actes, huissiers de la politique, qui exécutent, sans les comprendre les arrêts de Dieu sur les rois et sur les peuples. Palmerston est de ceux là. Une chose de lui m'amuse pourtant ; c’est Lady Palmerston qu’il mène partout avec lui pour prendre sa part du triomphe ; Lady Palmerston saluant et remerciant par des signes de tête quand son mari a cessé de parler. C’est un peu jeune, ce qui est un peu ridicule quand on est vieux ; mais cela me touche, et je sais gré à Lady Palmerston de cet infatigable dévouement, quoique je ne puisse y regarder sans rire.
La note du Moniteur sur Naples est bonne. Si j'étais, le Prince Murat je la trouverais bien dure. Et même, comme simple lecteur, je crois qu’il y avait une rédaction plus convenable que ces mots ; certaines prétentions.
Vous ne lisez pas l'Union. Elle attaque Lord Stratfond avec une vivacité singulière au nom de l'indépendance de l'Empire ottoman, et en le comparant à Thouvenel qui est plein, pour le sultan, d’égards et de respect. Le travail contre Lord Stratford a évidemment son foyer à Paris. Je doute toujours du succès. Du reste vous avez raison, peu vous importe aujourd’hui.
Midi
Pas de lettre. Adieu.
115. Val-Richer, Mercredi 10 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Est-ce que vous êtes si indifférente aux affaires de Danemark que le comte de Moltke ne vous en parle jamais ? Vous avez pourtant quelques devoirs envers ce petit pays qui vous garde si fidèlement la neutralité, et vous devriez prendre un peu d’intérêt à ce qui le touche. Moi qui en prends, je voudrais bien savoir le vrai sens et l’issue probable de la lutte engagée là. Est-ce que la querelle entre les Danois-Danois et les Danois Allemands est toujours au fond de ce qui se passe, et le Prince Ferdinand est-il, comme je le présume, le chef du parti pur Danois ? Je ne crois pas les questions indiscrètes, et je vous prie de les soumettre à M. de Moltke qui ne m'en voudra pas de ma curiosité.
Le sultan a bien traité le Maréchal Pélissier. Je suppose qu’en le faisant Maréchal de l'Empire Ottoman, il a voulu pouvoir mettre Omer Pacha sous les ordres. Voilà un homme en train de faire une bien grande fortune militaire, s'il est en état de soutenir son succès.
J’attends deux lettres ce matin.
Onze heures
Il faut bien que je vous pardonne ; mais vous avez sur les lettres courtes et insignifiantes, trop de scrupules. Je vous aime mieux que vos lettres. Adieu, adieu.
116. Val-Richer, Jeudi 11 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures
Je viens de me lever, et d'allumer ma lampe. J'espère que vous dormez profondément. Il n’y a encore aucune apparence de jour. J’ai bien dormi, ce qui ne m’arrive pas toujours à présent. J’appelle mal dormir me réveiller deux ou trois fois dans la nuit et avoir peine à me rendormir. Quand cette peine dure trop longtemps, j'allume des bougies ; je lis et au bout d’un quart d'heure, le sommeil revient. C’est un grand bonheur quand on devient vieux, d'avoir des yeux aussi intacts que les miens. Je m'en suis pourtant beaucoup servi. Ma vieille mère, qui avait aussi à 80 ans, conservé de bons yeux, disait en en remerciant Dieu : " Et pourtant j’ai tant pleuré." Je ne puis pas dire que j’ai beaucoup pleuré ; je pleure peu. Mais j’ai eu de quoi ; ce qui revient au même pour l’âme sinon pour les yeux. Savez-vous une question sur laquelle j'hésiterais infiniment, s’il plaisait à Dieu de me la poser, ce qui n’arrivera pas ? C'est la question de savoir si je voudrais recommencer la vie. J'y retrouverais bien des joies dont la pensée me charme, mais aussi des douleurs, des jours, des minutes par lesquelles je ne supporte pas l’idée de repasser. J’aime mieux que Dieu ne me pose pas la question.
Comme je suis dans mes jours de désintéressement et de bon sens, j’aime mieux que Hübner soit content. La brouillerie avec l’Autriche, c’est la guerre révolutionnaire et tout l’inconnu du chaos. Tant qu’on sera bien de ce côté, on fera des notes comme celle du Moniteur sur les prétentions du Prince Murat, et on se tiendra tranquille, même en Italie. Je crois que cela vaut mieux pour la France et pour le monde.
Pouvez-vous me répondre à une question plus frivole ? Est-il vrai que Mlle Rachel, fasse fiasco en Amérique pendant que Mad. Ristori fait flores dans les provinces de France ? Aussi quelle idée a Mlle Rachel, de prétendre passionner des Américains avec Corneille et Racine ? Il leur faut du rien plus épais et plus noir. Je me figure que les fureurs jalouses de ces deux femmes, quand elles seront de retour à Paris, seront un des amusements de l'hiver prochain. Il est bien probable que je n’y prendrai aucune part. Je n'ai nulle envie de retourner au spectacle, et quand j’y suis retourné, je l’ai trouvé mauvais. Quand l'habitude n’y est plus, les meilleurs acteurs sont toujours très inférieurs à ma conception et à mon désir.
Midi.
Mon facteur arrive très tard et je n'ai que le temps de vous dire adieu, et adieu. G.
117. Val-Richer, Vendredi 12 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Un bon observateur et fort au courant des affaires de la cité, m'écrit de Londres : " Si la crise financière continue et Si, d’ici à la fin de l’année, la banque d'Angleterre augmente encore son escompte d'un et demi ou de deux pour cent comme on le craint dans la cité (cela dépendra surtout du besoin d’argent qu'aura la France pour faire face à la fois à la disette, et à la guerre), il sera bien difficile au gouvernement anglais de continuer la guerre dont on n’avait prévu ici ni la grandeur, ni la durée.
Demandez à Lord Lyndhurst ce qu’il en pense. Quoiqu’il soit sourd et aveugle. j’aurais confiance dans son jugement si j’en avais dans sa probité politique ; mais je n’en ai point. Peu importe donc ce qu’il vous dira. D'ailleurs, quand un grand pays est engagé dans une grande affaire, ce ne sont jamais les difficultés d’argent qui l’arrêtent ; elles n'équivalent jamais à l'impossibilité. On paye plus cher et on souffre davantage, voilà tout. La guerre actuelle n'imposera pas à l’Angleterre la moitié des sacrifices que lui a coutés la guerre contre Napoléon. Il est vrai que la première était une guerre de nécessité et que celle-ci est une guerre de luxe.
Je trouve que la visite du Duc et de la Duchesse de Brabant à Paris valait bien que la Reine Marie Amélie fût libre de recevoir à Bruxelles les visites qu’elle voudrait.
Je voudrais bien savoir s’il est vrai comme le disent quelques journaux, que les Puissances belligérantes, vous comme nous ont autorisés, pour tous les neutres, le libre commerce des grands dans la mer d'Agoff et la mer Noire. Ce serait très civilisé et très sensé. Nous y gagnerions du pain et vous de l'argent. Ce ne serait d'ailleurs que conforme aux bons principes, en fait de commerce des neutres.
Onze heures
Je vois qu’on attend tous les jours le bombar dement d'Odessa. Adieu, Adieu. G
118. Val-Richer, Samedi 13 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
S'il y a eu bombardement d'Odessa est-ce que votre Empereur s'y sera trouvé à ce moment là ? Rencontre bien désagréable. Un bombarde ment n’est pas une bataille quand la ville n’est pas une place forte, elle reçoit les coups sans les rendre.
Je ne suis pas juge de l'habileté militaire du Prince Gortschakoff ; mais ses rapports sont bien rédigés clairs, fermes, sans vanterie, pas plus de réticences qu’il n'est nécessaires, très polis et convenables. Il fait bien d'être habile, car il n’est pas heureux.
Je suppose que l’amiral Bruat va revenir parce qu’il n’y a plus, pour lui et ses grands vaisseaux à voiles, grand chose à faire, et aussi pour cause de santé. La dernière fois que je l’ai vu, peu avant son départ, il était criblé de rhumatisme. J’ai rencontré peu d'hommes en qui l’énergie de l’âme supplée autant à la force du corps.
Je doute que les Etats Unis consentent à en passer par les décisions d’un congrès Européen sur l'affaire du Tund. Ils régleront eux-mêmes leur question, et l'Europe ne prêtera pas au Danemark des vaisseaux et des canons pour soutenir la guerre contre eux.
La proclamation du général Kalergis à l’armée Grecque, en sortant du Cabinet, est bien superbe. Le Roi Othon a bien fait, de tenir bon pour s'en débarrasser. Il fera bien à présent d'observer strictement la neutralité qu’on lui demande sans quoi Lord Palmerston remettrait le général Kalergis au pouvoir.
Mazzini est plus étourdi que je ne le croyais. Qu'avait-il besoin de dire qu’il était prêt à recevoir votre argent, que vous ne lui donnerez pas, pour affranchir l'Italie ? Cette phrase fera plus, contre les réfugiés, en Angleterre, que tous les principes de droit public. Mais il est plaisant que les Anglais tonnent avec fureur contre la Belgique pour laisser faire, dans ses journaux, ce que les leurs font hardiment depuis tant d’années.
Onze heures
Pourquoi Morny ne revient-il pas ? Est-ce qu’il est encore malade ? Adieu, adieu. G.
119. Val-Richer, Dimanche 14 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Le long rapport du Prince Gortschakoff ne m’a rien appris de nouveau évidemment vous avez fait des pertes, énormes. Je n'y trouve pas la moindre indication d'aucun plan de campagne, ni d'aucun projet futur. Le voyage de l'Empereur aura sans doute reglé les résolutions à cet égard. Il me paraît clair que la défense de Nicolajeff est maintenant votre grande préoccupation. Je n’ai aucune idée des difficultés, ni des moyens de l’attaque ; mais si la guerre continue, comme je n'en doute pas, il est bien probable que Nicolajeff tombera comme Sébastopol.
La petite affaire de cavalerie anglaise du côté de Kertsch n’a pas été heureuse. Là comme ailleurs, ils n’ont pas su combiner leurs mouvements, ni se garder.
Avez-vous remarqué le discours du Maire de Liverpool dans le banquet donné du duc de Cambridge, et son compliment à la Reine Victoria pour la visite qu’elle a fait au tombeau de Napoléon ? Quand les intérêts présents sont prenants, combien le passé s'éloigne vite ! Il faut deux conditions pour rendre acceptables les concessions faites à la politique aux dépens de la dignité. 1° Quelles soient indispensables ; 2° Qu’on y gagne plus en sécurité matérielle qu’on n’y perd en force morale. On croit souvent trop aisément que ces deux conditions se rencontrent. Je ne connais pas beaucoup d'exemples de gouvernement qui se soient réellement compromis par trop de soin de leur honneur. On l'oublie bien plus pour se débarrasser de la peur que pour échapper à un vrai danger.
Qu’est-ce qu’un comte Van der Straten Pouthoz, ministre de Belgique à Madrid ? Je croyais que c'était le Van der Straten que je connais et qui est souvent venu chez moi ; mais il faut que c’en soit un autre, car il m’écrit pour m'envoyer un ouvrage de lui, et il me dit que je ne le connais pas. Soyez assez bonne, je vous prie pour me tirer cela au clair, afin que je sache à qui je réponds quand je répondrai.
Onze heures
Merci de votre lettre intéressante, au milieu de votre précipitation. Adieu, Adieu. G.
Mots-clés : Alexandre II (1815-1881 ; empereur de Russie), Armée, Correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Napoléon 1 (1769-1821 ; empereur des Français), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (Russie), Réseau scientifique, Réseau social et politique, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
120. Val-Richer, Lundi 15 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je trouve le procidé du Prince Napoléon étrange. Par quel motif ? Autant qu’il m'en souvient, le Duc de Brabant était venu le recevoir à la gare de Bruxelles. Il paraît que la famille Impériale est plus difficile à gouverner que la France.
Redcliffe ne donnera pas sa démission, et Palmerston a raison de le garder, sérieuse ment parlant quand on a accepté toute la politique d’un ambassadeur, quand cette politique a réussi, quand l’ambassadeur est au moins aussi puissant que désagréable dans le pays où il réside, ce serait une grande faiblesse de le rappeler pour s’épargner à soi-même quelques ennuis. Il ne s’agit plus de savoir si la politique et l’ambassadeur sont bons ou mauvais ; Palmerston est marié, à l’une et à l'autre, et il faut qu’ils vivent ensemble, for better and worse.
Reeve m'écrit : " J’ai pris le parti de me retirer tout-à-fait de la presse quotidienne. Cette décision de ma part a été un peu hâtée par la conduite extraordinaire et inqualifiable, du Times, dans les derniers temps, qui semble avoir pris à tâche d’amoindrir les forces de ce pays et d’outrager tout le monde. Je n'aime pas cela et je me retire." Je vous le dis parce que je présume qu’il est bien aise qu’on le sache.
Les journaux Ecossais et Anglais mettent une grande affectation à répéter que le Prince royal de Prusse est très anti-russe, et que son fils partage ses sentiments. Midi C'est sans le Prince Gortschakoff qui défraye ces journaux. Je persiste dans mon avis. J’ai été accoutumée à voir et à subir de bien autres mensonges. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Armée, Circulation épistolaire, Diplomatie, Diplomatie (Angleterre), Femme (politique), France (1852-1870, Second Empire), Napoléon III (1808-1873 ; empereur des Français), Politique (Analyse), Politique (Angleterre), Politique (France), Politique (Prusse), Politique (Russie), Presse, Réseau social et politique, Salon
121. Val-Richer, Mardi 16 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quest-ce que ce général Ere que le général Simpson, en donnant sa démission, recommande, dit-on, pour commander l’armée Anglaise ? C’est un nom que je n’ai jamais entendu prononcé. S'il est vrai que le général Simpson ait donné sa démission, c’est une grande faiblesse de sa part, à moins que lui- même il ne se sente incapable. Il se retirerait devant les attaques du Times. Je suis de plus en plus frappé de cette faiblesse générale, en Angleterre devant les journaux. Les plus hardis restent pour faire ce que les journaux veulent ; les timides se retirent. Washington aussi souffrait des injures des journaux ; mais au lieu de l’intimider, elles l'irritaient et il n’en était que plus obstiné dans son propre jugement. Seulement cette invitation lui rendait la vie publique désagréable, et lui aussi, il aspirait à la retraite. C'était là sa faiblesse. Mais il ne se retirait qu'après avoir vaincu. Je ne connais pas de meilleur exemple pour les hommes de notre temps que celui de Washington ; il servait une grande société démocratique, mais il la servait avec autant d’indépendance que de fidélité, un aristocrate honnête et fier, n'ayant et ne faisant point d'autres affaires, que celles du peuple, mais décidé à les faire toujours, selon son bon sens, non selon la fantaisie populaire. Sinon, non.Seule situation digne, auprès des peuples comme des rois. Et aussi la seule efficace, quoiqu’elle ne le soit pas toujours.
Je ne comprends pas Lord Cowley, avec ses compatriotes. A moins qu’il n’y ait de leur part à eux, c’est-à-dire de la part de la plupart pas plus d'envie de le voir, lui, qu’il n'en a de les voir, et d'aller à la cour que lui de les y mener. S'ils le voulaient bien ils le feraient vouloir à Lord Clarendon, qui le ferait vouloir à Lord Cowley.
Combien de temps peuvent durer encore les opérations de guerre en Crimée ? A en juger par le grand nombre de troupes qu’on y envoie, il faut qu’on croit pouvoir agir. encore pendant deux ou trois mois. Si on était sur le point de prendre des quartiers d'hiver on ne se presserait pas tant de faire partir tant de régiments pour aller les prendre en Crimée, où ils sont infiniment plus chers. Je me figure qu’il y aura encore de grands coups ports ou tentés avant qu’on se repose.
Je serais assez curieux de savoir s’il se trouvera une compagnie sérieuse pour faire le chemin de fer que propose la Porte, de Belgrade à Constantinople. C'est l’Autriche qui y gagnerait le plus ; mais elle n’a pas d'argent à jeter là.
Onze heures
Merci de vos renseignements très précis. Je vais répondre au Vanderstraten que je ne connais pas. Adieu, adieu. G.
122. Val-Richer, Mercredi 17 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
L’article d’hier dans les Débats sur l'opposition qui essaye de s'organiser en Angleterre n’est pas bon ; il ne faut pas malmener le futur parti conservateur, ni désespérer de son avenir quelque éloigné que puisse être l'avenir, et quelque incohérents que soient aujourd’hui les éléments du parti. Les reproches sont vrais ; mais on peut faire des reproches avec bienveillance et en servant, ou avec malveillance et en nuisant. Du reste l'article ne m'étonne pas voyant la signature John Lemoinne est un honnête garçon et de beaucoup d’esprit mais de peu de cervelle et qui aime par dessus tout la nouveauté, le mouvement et le bruit.
Il me semble que les violences du Times, contre la Prusse ont amené un peu de réaction, je vois qu’on dément les brutalités de Sir Alexander Malet. Elles sont probablement très vraies, mais le démenti n'en vaut que mieux.
Les Turcs n'ont décidément de bonheur, que lorsqu’ils sont tout seuls en face de vous et vous, on dirait que vous les ménagez, et que vous ne voulez pas, même en vous battant, vous brouiller sans retour avec eux.
Soyez assez bonne pour remercier, de ma part, M. de Moltke d'avoir dissipé mon ignorance. Si j'étais Danois, je ne comptais pourtant guère sur ce que fera le Prince Ferdinand quand il sera roi ; il fera comme les autres ; il donnera ou acceptera au constitution, en tâchant de s'en tirer au meilleur marché possible. Les Rois ne sont aujourd’hui, ni fous, ni braves.
Avez-vous fait attention aux derniers document publiés à Turin et reproduits à Paris sur la tentative d'alliance contre vous, et dans l’intérêt de la Turquie, avant 1789 ? Ils font honneur à l’intelligence Piémontaise. L’analogie des situations est singulièrement frappante. Seulement était alors la France qui prenait l’initiative, dans un intérêt Français ; et l'Angleterre s'y refusait, tenant plus de compte de l’intérêt anglais d'alors que de l’équilibre Européen. La France a été plus désintéressée. aujourd’hui.
Onze heures
La cloche du déjeuner sonne. Adieu, adieu.
123. Val-Richer, Jeudi 18 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis bien aise que Morny soit revenu. Il vous plaît, et il vous tient au courant. Je voudrais qu’il eût plus d'influence dans les affaires ; elles seraient conduites plus sensément.
Nous verrons si le scandale de Jersey amènera de la part du gouvernement Anglais, quelque mesure efficace. Les honnêtes gens ont quelquefois des peurs auxquelles le gouvernement ne doit pas croire ; mais il a toujours tort quand il ne donne pas satisfaction à leurs indignations honnêtes. C'est la propre cause et son propre honneur qu’il abandonne. Je ne m'étonne ni de la question posée, par Cowley quand Drouyn de Lhuys est revenu de Vienne, ni de la réponse. C’est l’Angleterre qui profite de la guerre, et la France ne se séparera point d'elle. Je n’entrevois toujours pas plus d’issue. On fera de Nicolajeff, un second Sébastopol, et il faudra encore dire après ?
J’ai un petit fils de 3 ans et demi qui est très guerrier, et très anti-russe ; il était très décidé à prendre Sébastopol ; quand je lui ai dit qu’il était pris : " Eh bien j'en prendrai un autre !" C'est toute notre politique.
Onze heures
Ni moi non plus, je n’ai rien de nouveau à vous dire. Adieu, Adieu. G.
124. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Si les rouges étaient corrigibles, l’arrêt de la cour d’Angers leur serait une nouvelle leçon ; en voilà quatre envoyés à Nouka Hiva. Mais ils sont incorrigibles ; les châtiments individuels sont aussi insuffisants que nécessaires. Le mal est trop étendu, et trop profond pour être guéri par quelques exemples. Il n’y a que le bon gouvernement et sa longue durée, et les régions supérieures de la société bien unies et résistant de concert qui puissent en venir à bout, si Dieu veut qu’on en vienne à bout. Quoique je fasse bien loin, il y a dix ans, de prévoir ce qui est arrivé, j’ai souvent dit au Roi que nous ne faisions que de la médecine de bonnes femmes.
Les honnêtes gens de Jersey font très résolument leur devoir. Je suis curieux de voir si le gouvernement anglais fera le sien. Toute alternative, tantôt les honnêtes gens manquent au pouvoir, tout le pouvoir aux honnêtes gens.
Je suis frappé de ces officiers Français enlevés par des brigands à la porte du Pirée. C'est pis que les brigands dans les Etats du Pape. La Grèce n’est pas en meilleur état que la Turquie, et le résultat de la guerre d'Orient pourrait bien être une occupation permanente d'Athènes comme de Constantinople. Voilà deux rayaumes dont l'Europe proclame, et poursuit depuis trente ans, l’intégrité et l'indépendance.
On me dit qu’il y a plus de monde à Paris, dans le moment-ci que jamais ; surtout des provinciaux de France, ce qui ne vous est bon à rien. On s'empresse pour voir encore l'exposition. Il me semble qu'à tout prendre, après avoir commencé par a failure, elle finit par un succès.
Je vous quitte pour aller faire un tour de jardin. Il fait un temps admirable, après trois semaines de pluie. Je voudrais que les jours que je passerai encore ici fussent beaux. J’irai peut-être en passer quelques uns à Broglie. Je me propose d'être à Paris le lundi 12 novembre. Qu'il y ait ou qu’il n’y ait pas d'événements d’ici là, nous causerons abondamment.
Onze heures
Je voudrais bien croire au sérieux et à l'efficacité des bonnes paroles que vous me répètez ; mais je n'y crois pas. Adieu, adieu.
125. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous m'avez dit il y a quelque temps, si je ne me trompe que la Duchesse de Sutherland devait venir à Paris. Il est-elle en effet et sinon, pouvez-vous me dire ou elle est ? Je voudrais lui écrire pour lui demander quelques renseignements sur une comtesse de Carliale, femme d’esprit et très intrigante, que je trouve mêlée à tout sous Charles 1er, Cromwell, et Charles II. J’ai envie de savoir s'il existe, sur elle, quelque Vie imprimée, ou s'ils ont à son sujet, quelques papiers de famille. Je connais plus la Duchesse de Sutherland que Lord Carlisle, et je crois qu’elle prendrait quelque soin de mon désir.
Je ne puis croire à l’épigramme contre le Duc de Brabant de toutes les épigrammes, elles là sont celles qui se pardonnent le moins. Je crois plutôt au défaut de bon goût et à d'inadvertance ; faute très commune dans le choix des spectacles de cour. Au château d’Eu, le roi voulait un jour devant la Reine Victoria, le Minuit d'Arnal la Reine Amélie ne voulait pas, trouvant Minuit peu convenable. Je ne connais ni l’une ni l’autre pièce ; il me semble que Les premiers armes de Richelieu doit beaucoup surpasser Minuit.
Tout le monde, excepté vous, restera à Constantinople. Greville a raison ; les alliés auront grand peine à s'accorder pour la paix. Quand une guerre n’a plus qu’un objet vague et qu’on s’est promis. " Point de conquête", comment s'entendre pour la finir ? Il n’y a point de parti à donner à chacun.
A en juger par l'article du Times, les mesures du cabinet anglais contre les Jacobins de Jersey se borneront, quant à présent, à une menace, on ne les expulsera que s'ils recommencent. Ils recommenceront et on ne les expulsera pas.
Onze heures
J'arriverai à Paris, le 12, comme je vous l’ai dit hier. Je serai charmé de causer avec Lord Lyndhurst. Pourquoi donc s’est-il engagé si avant dans la mauvaise politique ? Adieu, Adieu.
Mots-clés : Affaire d'Orient, Archives, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (politique), Femme (portrait), France (1830-1848, Monarchie de Juillet), France (1852-1870, Second Empire), Guerre de Crimée (1853-1856), Histoire (Angleterre), Ministère des affaires étrangères (France), Politique (Russie), Politique (Turquie), Réseau social et politique, Salon, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
126. Val-Richer, Vendredi 19 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’ai vu hier dans mon Galignani, après vous avoir écrit, que la Duchesse de Sutherland venait d’arriver à Meurice. Soyez assez bonne pour me dire si elle y restera longtemps, et si je dois lui écrire là pour avoir mon renseignement sur Lady Carlisle, ou attendre qu’elle soit de retour à Londres. Je ne voudrais pas lui donner la peine d'écrire en Angleterre, pour cela, quand elle y sera, quelques mots de conversation avec les savants de sa famille, lui suffiront pour me répondre, si elle le peut et si elle a des savants sous sa main.
Cette Lady Carlisle, d'il y a 200 ans piquerait votre curiosité comme la mienne. Si vous y aviez regardé comme moi. Beaucoup d’esprit et de savoir faire, un peu sans foi, ni loi, amis successivement, et probablement très intime, de Stratford, de Pym, de Cromwell, de Monk se mêlant de tout, en gardant toujours sa liberté. J’entrevois qu’elle était bonne, obligeante, pas plus haineuse que fidèle, quelque fois très impertinente, l'impertinence est l’une des petitesses des femmes, même distinguées ; elles y prennent un plaisir d'enfant ; c’est leur manière d'étaler le pouvoir qu'elles ont ou d'affecter, celui qu'elles n’ont pas. Bref, j'en voudrais savoir davantage sur Lady Carlisle. Je doute que personne en sache assez pour m’apprendre ce que je voudrais, tant de personnes, très distinguées ; les femmes surtout, tombent si vite dans un si profond oubli, mais enfin, je veux questionner.
Si j'étais votre Empereur, je trouverais mauvais que votre neveu Constantin eût été mal pour Rodolphe Appony. La Russie doit savoir gré à l’Autriche de sa neutralité, et conserver soigneusement les liens, de politique ou de personnes, qu’elle a encore avec Vienne.
Après le concordat qu’elle vient de conclure avec le Pape, l’Autriche doit être très bien en cour de Rome. Joseph II, et même Marie Thérése, seraient un peu étonnés et irrités s'ils lisaient cela ; tout d’indépendance. à l'Eglise ! J’aurais objection à plus d’un article, mais à tout prendre, je crois que le jeune Empereur a eu raison et que s’il perd à ce concordat, quelque autorité dans l’Eglise, il y gagnera beaucoup d’appui pour son autorité dans l'Etat.
Onze heures
Je suis bien aise que votre neveu vous ait écrit sur ce ton et très fâché qu’il rentre dans la guerre active. Dieu sait qui en reviendra Adieu, adieu. G.
Vous savez bien que je vais, tous les ans passer quelques jours chez Broglie. Ordinairement quinze jours. Beaucoup moins cette année-ci. Je ne sais pas encore quel jour j’irai. Je veux finir ici ce que j'ai commencé. Adieu. G.
127. Val-Richer, Lundi 22 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Ce qu’on veut faire me semble clair, on vient de prendre Kimburu, ou prendre Oczakoff, et on partira de là pour remonter jusqu'à Nicolajeff. Je me figure que ce ne sera pas cette année ; les préparatifs pour une campagne navale dans un fleuve, doivent être long et la saison fera bientôt, obstacle à tout. Ce sera pour le printemps prochain. On dit que, Nicolajeff tombé, il vous sera absolument impossible de défendre la Crimée, si elle n’a pas été conquise d’ici- là.
J’ai grande compassion de votre nièce Louise, et je plains son mari d'aller faire cette triste guerre, que vous ne ferez certain nement pas sans gloire, mais où votre principale espérance est, ce me semble, de la prolonger indéfiniment et de lasser vos ennemis sous le poids de leurs succès. On dit que vous ne voulez pas de la paix. Je voudrais qu’on me dit qui en veut.
Vous devriez faire, demander, à la circulating Library de Galignani, deux nouveaux romans anglais, North and South, de Mistriss Gaskall, ce Merkland, par l’auteur de Margaret Maitland que je vous engage aussi à lire. Tous les trois sont pleins de vérité et d'intérêt. Les éditions que mes filles ont ici sont si fines qu'elle ne vous serviraient à rien ; mais les éditions originales Anglaises sont en assez gros caractères, et Galignani doit les avoir à la fin de la matinée vers 6 heures quand je suis las de travailler, je lis les romans qui m'intéressent vraiment beaucoup.
J'ai vu deux lettres de Constantinople, assez curieuses, en ce qui touche l’armée anglaise, elle se fortifie, et se reforme. Il y a beaucoup d’ardeur parmi les officiers, un désir passionné de retrouver leur part de succès, et les nouveaux soldats profitent des exemples Français. Ils travaillent davantage, supportent mieux la fatigue. Ceux qui écrivent sont des officiers français blessés et point suspects de complaisance anglaise.
Onze heures
Brougham pacifique, Lyndhurst pacifique, Gladstone pacifique, d'Israeli pacifique. Qu'importe ? J'écrirai à la Duchesse de Sutherland. Adieu, adieu. G.
128. Val-Richer, Mardi 23 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je me suis amusé hier à relire dans M. de Ségur le voyage de l'Impératrice Catherine en Crimée, le siège d'Oczakow, le Duc de Richelieu, le comte Roger de Damas, sortant du bal et montant les premiers, en habit habillé, et en bas de soie, sur les remparts. Que les temps sont changés ! Je comprends que l'Empereur Nicolas soit mort de chagrin.
Ici, le gouvernement a raison, au milieu de ses efforts pour la guerre, de ne pas négliger les nécessités de l’ordre au dedans sa création des élèves gendarmes, qui n’est au fond qu’une augmentation de la gendarmerie, est une bonne mesure. Il y a dans le pays, des inquiétudes sérieuses, pour l'hiver prochain. J'habite la province, la plus tranquille de France, quoique ce soit en même temps celle où le blé est le le plus cher. Je ne crois pas qu’il y ait de désordre ici ; mais on le devra au bon esprit des habitants et à l'étendue de la charité publique. On ne se pas aussi sage partout.
On m’écrit de Paris, et je vois dans Havas que Bourqueney retournera à Vienne comme ambassadeur. Cela ne peut arriver sans qu’on en fasse autant pour Hübner. Il serait bien content.
Est-il vrai que Richard. Metternich aille à Madrid, et que sir William Molesworth soit très mal ? Pure curiosité de conversation, car ni l’une ni l'autre n'a d'importance politique, et ne m'inspire vraiment d'intérêt personnel. Dans trois semaines, je n'écrirai plus mes questions.
Onze heures
Pas de lettre. C'est certainement encore une irrégularité de la poste, service mal fait-ici. Adieu, Adieu. G.
129. Val-Richer, Mercredi 24 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vois dans les journaux que votre Empereur vient d’aggraver encore la loi contre les Russes qui restent à l'Etranger au delà du terme de leur passeport, et qu’au bout d’un an leurs biens seront confiqués. Est-ce vrai ? Il ne doit pas y avoir, en ce moment, grande nécessité d’une telle aggravation. On fait, ce me semble, de part et d'autre, en Crimée ses préparatifs pour l'établissement d'hiver. C'est un fait rare dans l’histoire qu’une guerre si lointaine ainsi prolongée, sans interruption, à travers toutes les saisons. Après l’incendie de Moscou, le vieux comte Daru conseilla à l'Empereur Napoléon de s’y établir, d'y passer l'hiver, et de recommencer la guerre au printemps en partant du coeur de la Russie : " C'est un conseil et l'Empereur ; mais nous sommes loin de chez nous que deviendrons nous si nos communications avec la France sont coupées ? " On n’a rien de semblable à craindre en Crimée, sauf la dépense, on peut rester chez vous tant qu’on voudra. Je viens d'écrire à la Duchesse de Sutherland à Meurice. C'est bien là qu'elle est, est-ce pas ?
Midi
Voilà votre lettre d’hier. Je ne pensais pas du tout, à propos de Lady Carlisle, aux petites, et très licites impertinences dont vous vous accusez ; une impertinence, pour se défaire d’un ennuyeux, c’est comme le mensonge qu’on fait quand on ferme sa porte pour ne pas le recevoir. Je pensais à des impertinences plus sérieuses, en même temps que plus spécialement féminines dont j’ai entrevu la trace chez Lady Carlisle, et où perce vraiment tantôt l’une, tantôt l'autre de ces fantaisies, étaler le pouvoir qu’on a, où affecter celui qu’on n’a pas. Les Brabant ont tout Adieu. Adieu. G.
130. Val-Richer, Jeudi 25 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
L'article du Times est catégorique. C'est la guerre continuant jusqu'à ce que vous demandez la paix et les Allemands exclus des négociations futures. L’arrogance du ton est aussi remarquable que le fond. Il y aurait trop à dire sur tout cela. J’ajourne. Ce qui me choque le plus, c’est le mot de paix de plus en plus prodigué à mesure qu’on s’engage plus avant dans la route qui éloigne de la paix. Je n'aime pas l’arrogance ; mais quand elle se complique du mensonge, c'est le pire.
Dit-on qui remplacera sir William Molesworth ? Ce sera probablement un radical. Palmerston voudra plaire de ce côté. On trouvera difficilement un radical aussi modéré que Molesworth. Le remplaçant m’a aucune importance pour la politique étrangère ; mais il peut en avoir pour les questions intérieures.
Sir Hamilton Seymour, comme remplaçant de Lord Westloreland à Vienne, me paraît assez vraisemblable. Je comprends que le comte de Colloredo soit fort dégagé ; on fait en Orient les affaires de l’Autriche et on ne les lui dérange point en Italie. Pourvu que cela continue, elle peut consentir à être pour rien dans les négociations futures.
Onze heures
Pas de lettre. C'est ennuyeux. Adieu, adieu.
131. Val-Richer, Vendredi 26 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vois qu’on a appelé à Nicolajeff, le général Tollien ; il va sans doute refaire là ce qu’il a fait à Sébastopol et probablement pour arriver au même résultat. Je le plains.
Est-il vrai que les alliés ont demandé au Roi de Suède l'autorisation de faire hiverner leurs flottes dans l’ile de Gothland et qu’il s’y est formellement refusé, alléguant sa neutralité. Je m'étonne qu’il ne se soit pas renfermé dans la même place forte, à propos des Tedeum. Il n'y courait aucun risque. Quoi de plus anti neutre que d'aller célébrer les victoires de l’un des belligérants ? Le droit est toujours, quand on n’est pas directement aux prises avec la force, une meilleure position que la platitude.
La liste des approvisionnements trouvés et pris à Sébastopol frappe les plus simples. C'est la mesure, disent-ils, de vos projets et de votre échec.
Il me semble que le Roi de Prusse doit être content du résultat de ses élections, et qu’il aura, dans ses Chambres prochaines, un appui décidé pour sa politique.
Je n’ai rien de plus à vous dire et j'attends mon facteur.
Onze heures
Je reçois le N°130 d’hier, et point de N°129. Que veut dire cela ? Rien de nouveau. Tout ce qu’on dit ou annonce est en effet triste pour vous. Je ne crois à la paix que lorsque vous la demanderez, et quand la demanderez vous ? Adieu, adieu. G.
132. Val-Richer, Samedi 27 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous souvenez-vous les paroles de Hübner l'hiver dernier. " On serait à Pétersbourg dans une erreur fatale si on croyait que nous ne ferons pas la guerre ; si la situation se prolonge, nous la ferons ? Exactement les mêmes que celles de Bourqueney aujourd’hui.
Bourqueney doit être content, et on doit être content de lui, à Paris et à Vienne. Il est très propre à cette politique mutuelle de ménagements d'expédients, de transactions et d'attente.
Il est sûr que votre situation militaire est bien mauvaise ; vous n'avez eu de succès, depuis le commencement de la guerre que dans la défense de Sébastopol et Sébastopol est pris. Vos troupes, généraux et soldats doivent avoir peu d’entrain. Combien de temps le dévouement et le courage opiniatre peuvent ils tenir lieu d’entrain ?
Voilà ce pauvre Normanby qui a son tour dans les gracieusetés du Times. Il me semble que tout le monde a eu tort, Piémont et Toscane, dans cette petite affaire, le Piémont d'envoyer un réfugié Lombard à Florence, la Toscane de le refuser après l'avoir accepté. Je doute que l’Autriche fasse bien de faire ainsi sentir, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sa prépondérance sur les gouvernements Italiens de les pousser aujourd’hui à la résistance et demain à la concession. C’est un mauvais jeu. Je vois que le Times recommence à menacer le Roi de Naples. Il n’a donc pas fait ce qu’on lui demandait. Je croyais cette querelle là finie. Il y aura toujours du reste quelque querelle en Italie ici ou là. Les volcans n'ensevelissent plus les villes, mais ils fument toujours.
Onze heures
Décidément le N°129 ne viendra pas. Je n’ai pas encore vu ici le 12° volume de Thiers, car il m'envoye aussi son ouvrage. Il est peut-être chez moi à Paris. Je suis sûr que je serai de votre avis sur les deux pages dont vous me parlez. Il y en a probablement plus de deux. Adieu, adieu. G.
133. Val-Richer, Dimanche 28 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Les journaux Anglais semblent croire à des complications sérieuses entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Cela vous conviendrait bien ; mais je ne pense pas que vous ayez cette satisfaction. Les aventuriers amérais font beaucoup de bruit d'avance, et leurgouvernement ne fait rien contre eux jusqu'au dernier moment ; mais quand ce moment arrive, un peu de bon sens revient aux uns un peu de fermeté aux autres et tout s’arrête ou avorte. La guerre ne s'allumera pas dans le nouveau monde ; il est plus sensé que l’ancien malgré les apparences.
Si tout ce qu’on dit de la difficulté d'abonder Nicolaleff est mai, et cela semble vrai, on ne fera plus rien de sérieux cette année, du moins là, et l’hiver se passera en préparatifs, pour le printemps. On parlera de paix pendant ce temps là, mais pour rien Fâcheuse condition, j’ai autant de peine à croire à la paix que j'en ai eu à croire à la guerre. Votre Empereur ne restera certainement pas longtemps à Nicolajeff, s'il ne s'y passe rien.
Rappelez, je vous prie à Lord Lansdowne ce qu’il nous disait à Bruxelles, que la paix devait se faire quand Sébastopol serait pris et détruit : " Nous aurons alors, me disait-il, de la récurité pour 25 ans. Qui peut prétendre plus ?
Je suis bien aise que les Brabant soient partis. La durée ne fait pas oublier, l'inconvenance. Celle là a été sentie plus loin que je ne l'aurais cru ; je suis allé dîner mecredi dernier à Lisieux ; tout le monde m'en a parlé pour s'en étonner.
La Reine Amélie est établie à la Villa Pellegrini, tout près de Gênes. Le Roi de Sardaigne lui a offert avec beaucoup d’instances son palais à Gênes. Le Roi de Naples a insisté encore plus pour qu’elle vint à Naples, dans son propre palais, ou dans tout autre qu’elle préférerait. Elle a tout refusé, et elle a eu raison. Elle a vu en passant à Francfort sa fille la Princesse Clémentine avec ses enfants, son petit-fils Philippe, de Wurtemberg avec le Duc son père, et la Duchesse d'Orléans qui a voulu venir, avec ses fils, lui renouveler les adieux.
La Duchesse de Sutherland m'a répondu très gracieusement. Comme de raison, elle ne sait rien elle-même de ce que je lui ai demandé ; mais elle me promet un livre et des questions à son frère. Je désire qu’elle n'oublie pas, si elle quitte Paris avant que je n’y arrive, soyez assez bonne pour le lui rappeler.
Je vous envoie une lettre qui vous touchera. Bonne impression à recevoir. Le pasteur de notre église, M. Adolphe Monod, est mourant, tout-à-fait mourant ; homme d’un talent, et d’un caractère vraiment rares. Le Protestantisme Français aura fait, en dix huit mois des grande pertes, M. Verny et lui. La lettre est écrite à mon gendre Cornélis, par un jeune homme de ses amis, fort malade lui-même. Renvoyez- la moi, je vous prie, dés que vous l'aurez lu. Cornélis tient à la garder.
Onze heures
Voilà votre lettre. Cela m'amuse que vous retiriez votre admination aux dernières pages de Thiers ; comme si vous ne l’aviez pas éprouvée. Voici, M. de Talleyrand: " Ne croyez jamais les premiers mouvements car ils sont toujours bons." C'est votre étourderie. Adieu, Adieu.
134. Val-Richer, Lundi 29 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos scrupules sont excessifs vous pouvez admirer, sans vous compromettre les belles pages de Thiers que le pouvoir se perd par ses propres excés, qu’il a besoin d'être averti et contenu, c’est un lieu commun d'expérience et de morale qui n’engage point au systême parlementaire. Thiers a parfaitement raison, et je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous géneriez d'avoir raison avec lui. Je ne reproche à Thiers que ses dernières lignes dans ce paragraphe ; il aime mieux les excés de la liberté que ceux du pouvoir. Non sense démocratique l’anarchie populaire est une tyrannie, comme le pouvoir absolu d’un seul, et la pire de toutes ; il n’y a pas plus de liberté dans l’un que dans l'autre cas. L’anarchie populaire n’a qu’un avantage c’est d'être de toutes les tyrannies, la moins durable, étant la pire.
La Préface de Thiers est excellente et charmante, parfaitement, sensée et naturelle. très souvent spirituelle, quelquefois trop vraie, cest-à-dire un peu commune au fond, en étant toujours d’une forme, très agréable. Parfaite image de lui-même de son esprit, de son caractère vif, facile, souple, étendu, comprenant tout propre à tout. Mais je ne comprends pas comment n'ayant mis dans ce volume que les trois chapitres dont en donne les têtres, il enfermera toute la fin de cette grande histoire dans les deux ou trois volumes qu’il annonce encore. Je suis curieux de son chapitre sur le blocus continental.
Je vois avec plaisir que vous n'avez pas de vide. L'affluence des étrangers vous profite, et vous ne savez à quelle heure placer toutes vos visites. Est-ce qu’on prolongera comme on dit, l'Exposition jusqu’au printemps ? Je ne trouverais pas cela bien calculé ; il vaut mieux s'en aller au milieu du regret qu’au bout de la satiété.
Onze heures
Si nous avons l’air de ne pas nous entendre sur le pouvoir absolu, nous sommes parfaitement d'accord sur la tyrannie démagogique. Et d'accord comme il faut l'être, sans nous être rien dit. Adieu, adieu. Je crois à la guerre acharnée dont vous me parlez, et je la trouve de plus en plus absurde et coupable. Adieu, adieu. G.
135. Val-Richer, Mardi 30 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je vous trouve trop sévère pour cette préface, même à part votre dissidence. Il est vrai que trois lectures c’est beaucoup. Les mérites de tout ce que fait Thiers sont de ceux qui frappent et plaisent au premier coup d’oeil ; il ne faut pas y regarder trop avant, ni trop souvent, ni de trop près. On peut dire de ses livres en mettant lecteurs pour mortels, ce que Voltaire dit de la vie :
Glissez mortels n’appuyez pas. Mais cela dit, il ne faut pas oublier la première impression qu’on a reçue, car elle a beaucoup de vrai.
Les prédictions que vous m'envoyez pour le printemps prochain ne m'étonnent pas ; c’est la conséquence naturelle, nécessaire forcée de la politique qui a fait entreprendre cette guerre et qu’on a proclamée en l’entre prenant. Il n’y a de sensé et de pratique que la paix ou la conquête ; quand on ne veut ni l’une ni l'autre, comment en finira-t-on et quand aura-t-on fait ce qu’on veut ?
Je ne comprends pas qu’on hésite à détruire radicalement Sébastopol ; à moins qu’on ne veuille s’y établir et le garder contre vous comme on a garde Gibraltar toute l’Espagne et la France. La destruction de Sébastopol est le sine qua non de la destitution de la Crimée.
L’article du Times sur la guerre d’Asie me paraît significatif. La aussi, on fera au printemps, quelque grand effort.
Le Moniteur a payé hier au Duc de Brabant le prix de son voyage. Je souhaite que maintenant la Belgique reste et soit laissée tranquille dans sa neutralité.
Onze heures
Absolument rien dans les journaux. Lord Lansdowne ne me surprend pas. Moins sérieux, qu’il n'en a l’air. Adieu, adieu.
136. Val-Richer, Mercredi 31 octobre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je fais mes préparatifs de départ. On emballe mes livres. J’irai samedi prochain, 3, chez le Duc de Broglie. Je reviendrai ici le vendredi 9. J'y passerai le 10 et le 11 pour mettre ordre à tout, et je serai à Paris le lundi 12 à 7 heures du soir. Mes filles me rejoindront plus tard. Je vous prie de m'écrire vendredi prochain à Broglie (Eure), jusqu’au jeudi suivant inclusivement. Bientôt nous ne nous écrirons plus.
En attendant que nous causions, je n’ai rien à vous dire. Je ne prévois rien autre que la guerre et rien des événements prochains de la guerre. Les diplomates s'écriront ou se promèneront, les souverains donneront des audiences. Rien ne se fera jusqu'à quelque nouvelle grande crise militaire. La prise de Sébastopol n'ayant pas suffi à rien décider, je ne vois plus ce qui suffira.
Pourquoi vous enlève-t-on de Sébastopol les statues de St Pierre et St Paul. Je trouve cela de mauvais gout. On peut dépouiller les arsenaux et même les plais, mais non pas les Eglises. L'Empereur Napoléon qui vous a fait rendre avec tant de convenance les ornements sacrés pris à Bomarsund devrait bien vous laisser en Crimée vos saints.
Onze heures
Vous avez tort, M. Molé et vous d'être inquiets de moi, et je vous le reproche. Adieu, Adieu. G.
137. Val-Richer, Jeudi 1er novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il fait un temps affreux ; vent, pluie, froid. Je voulais aller faire à Lisieux quelques visites, politesse obligée tous les ans. Il n’y a pas moyen aujourd’hui. Je suis décidé à vous arriver bien portant.
Je viens de lire attentivement toute la Stratégie du Journal des Débats. Tout indique qu’il ne se fera plus rien de décisif cette année. Nous verrons comment on s'y prendra le printemps prochain pour trouver quelque chose de décisif, si on le trouve, on le fera mais je doute qu’on le trouve. Voici une avance qu'Havas fait à Thiers : " Il a le droit d'être fier du résultat de son travail et ce doit être pour lui une consolation de penser que les gloires du second Empire éclipseront probablement celles de l’ancien dans sa retraite, l’historien n’a donc pas besoin de jeter sa plume." Je doute que Thiers se charge d'écrire l’histoire de la guerre de Crimée.
Que signifie ce décret de votre Empereur qui confirme à la noblesse Russe dans ses anciens privilèges ? Y a-t-il là quelque chose de nouveau, et qui remette en vigueur. des privilèges tombés en désuétude ?
Onze heures
Je souhaite de tout mon coeur que les dispositions pacifiques qu’on vous exprime aboutissent à des actes réels. On aura le temps cet hiver de prendre son tournant. Adieu, Adieu.
138. Val-Richer, Vendredi 2 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vous n'aurez que quelques lignes ce matin. Il faut que je soit à 9 heures au Conseil municipal de ma commune, pour une affaire de chemin. Une demi heure pour aller, autant pour revenir, et je ne sais combien de temps durera la délibération ; les paysans Normands sont longs.
Je n’ai d'ailleurs rien d’intéressant à vous dire. Nous allons vivre longtemps sans événements pas de guerre et pas de négociations ; une situation tendue et oisive. Cela ne vaut bien. Si M. de Beust est encore à Paris quand j’y arriverai, je serai fort aisé de le voir. Rien de plus rare, de tout temps que les hommes qui ont à la fois du jugement et des vues. Et plus rare encore de notre temps où le bon sens est stérile et les vues folles. Adieu, Adieu. Je vous écrirai encore d’ici, demain, avant de partir pour Broglie. où je ne vais que pour l'heure du dîner.
139. Val-Richer, Samedi 3 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je pars dans quelques heures pour Broglie, par un temps affreux. Je n’ai pas encore appris à regarder le temps comme un abstacle à l'exécution de ce que j’ai promis aux autres ou à moi- même. Il a tant plu cette nuit que le petit puisseau de ma vallée à débordé et inondé mes près. Mes ouvriers viennent de m’apprendre cet événement. Je n'en sais point d'autre. Il n’y a point d’évènements sans journaux, et il n’y a point eu de journaux hier, si peu que rien.
Que deviendraient presque toutes choses, et aussi toutes les personnes, si les journaux n'en parlaient pas. Adieu donc.
J'espère que le facteur arrivera avant que je ne parte, et que j'aurai votre lettre. Adieu. Voilà votre terre. Je vous écrirai demain de Broglie. G.
142. Broglie, Dimanche 4 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je ne suis pas sûr de mon numéro. La petite note qui me les rappelle est restée dans mon bureau au Val Richer.
Votre Mémoire de votre oubli me plaît beaucoup. L'oubli était réel. Je n’en veux pas à M. de Beurt. Je ne m'étonne pas qu’il n'ait pas trouvé de résolution prise. Je suis convaincu qu’il n’y en a pas et qu’il n’y en aura pas. On ira comme on va, flottant entre des velléités contraires, ne sachant pas ou n'osant pas choisir soi-même et laissant aux événements à en décider.
Je suis arrivé ici hier par des torrents de pluie. Il fait assez beau ce matin, et le parc devant mes fenêtres est très beau. Rien en France ne ressemble davantage à un grand parc d’Angleterre, sauf les daims qui n’y sont pas. Personne que la maison. Les visites viennent plutôt. Le Duc de Broglie occupé de son discours de réception à l'Académie qu’il vient de terminer et qu’il me donnera à lire aujourd’hui. Une biographie de Ste Aulaire, me dit-il. Nous avons causé longtemps hier soir. Parfaitement sensé et triste ; désirant la paix autant que moi, et n’y croyant pas davantage. D'ailleurs ne sachant rien du tout.
Je n’ai rien entendu dire de la Reine Amélie. Mes dernières nouvelles la disaient arrivée, bien portante en Italie. On n'en sait rien non plus ici. Adieu, Adieu, et adieu.
Je n’ai pas encore vu un journal. Broglie me les enverra tout à l'heure. Mais certainement il n’y a rien. G.
143. Broglie, Lundi 5 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quoique je n’ai aucun espoir de paix, je suis tout-à-fait d’avis qu’il faut en chercher et en indiquer les moyens. J'en entrevois quelques uns. Mais Si je ne me trompe, les deux camps ne soupçonnent pas à quel point ils sont loin, et ils s'éloignent chaque jour bien de l'autre. La guerre prolongée, sans abattre l’un des combattants, les irrite et les aliène l’un et l'autre au delà de toute prévoyance. Et puis les moyens de paix ne sont plus à Londres du moins entre les mains des gouvernants. Que dira le Times de ce qui contenterait Lord Palmerston, et que dira Lord Palmerston de ce qui ne contenterait pas le Times. Il n’y a que deux chances sérieuses de paix ; votre défaite si complète que vous vouliez la paix à tout prix, ou un revirement d'opinion en Angleterre. Je ne vous demande pas de me pardonner la première hypothèse, car je n'y crois pas. Je compte un peu plus sur la seconde.
Soyez assez bonne, je vous prie, pour demander à Dumon. S’il sait quelques détails sur la santé de la Reine Amélie et d’où ils lui viennent. Ceux que j’avais et qui étaient de bonne source, ne faisaient pressentir rien de semblable. On dit que le climat de la Rivière de Gênes ne vaut rien pour les personnes qui ont la poitrine délicate.
Voilà votre N°140. Cette énorme série de numéros va enfin finir.
Je ne peux pas croire qu’on veuille chasser le Roi et la Reine de Grèce. Les dominer, les empêcher d'être ou de paraître à vous, à la bonne heure. C’est naturel et nécessaire. Mais les chasser, ajouter cet embarras de plus à ceux que donne la guerre, et à ceux que donnera l'Empire Ottoman quand on fera la paix, c’est impossible. Ce serait trop absurde. Votre enfant sera sauvé. Vous avez tort de ne pas lui porter plus d’intérêt. Il y a de la race dans ce peuple-là, et là où il y a de la race, il y a de l'avenir.
Adieu. J’ai devant moi, un soleil qui fait effort pour percer un brouillard blanc, mais épais. Il y réussira. Le brouillard est plus froid qu'humide. Le sel est couvert de gelée blanche. C’est un commencement d’hiver. Adieu, adieu.
144. Broglie, Mardi 6 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Nous nous sommes promenés hier une heure et demie, à pied dans les grandes allées de la forêt, par un temps charmant qui continue aujourd’hui. C'est l'été de la St Martin. Je reste dans ma chambre à lire et à écrire, jusqu'au déjeuner, midi. La promenade après. On rentre vers 3 Quelques visites heures, chacun chez soi. mutuelles. Lire et écrire. Dîner à 7 heures. Soirée un peu longue, jusqu’à 11 heures. Quand ils sont seuls, ils dorment un peu, chacun dans son fauteuil. J'empêche le sommeil. On cause agréablement. Un peu plus de mouvement et de chaleur, à servit une vie excellente.
Je me figure que l'hiver prochain, ce sera aussi à la conversation à animer la vie. Nous n'aurons, en fait d’évènements rien à regarder et rien à attendre. C’est pourtant beaucoup quatre ou cinq mois sans événements. Contre ma prévoyance raisonne, mon instinct est qu’il y en aura.
Je ne puis pas ne pas croire que si comme je l'espère, votre neveu Constantin revient sain et sauf de Crimée, vos rapports avec lui resteront bons, et convenables, comme ils sont maintenant rétablis. Pourquoi aurait-il saisi cette occasion de les rétablir s’il n’avait pas dessein de continuer ? Sans nul doute s'il en était autrement, rien ne vous conviendrait que de rentrer dans le silence.
9 heures
Voilà votre lettre qui me tourmente d’autant plus que je la comprends moins et qui me tourmenterait encore davantage, Si je ne vous connaissais pas comme je vous connais. Vous m'avez certainement écrit sous l'empire de quelque impression très excessive, à quoi vous êtes si sujette. Mais enfin, vous aviez l'impression ; vous en étiez triste et agitée. Pourquoi ? Ce n’a pas l’air d'être une affaire de santé. Enfin, j’y verrai lundi, dans six jours. J'espère bien que d’ici là, l'impression sera passée ou à peu près. Votre raison ne domine pas vos impressions ; mais vos impressions ne tuent pas votre raison. Grace à Dieu ! Adieu, Adieu.
145. Broglie, Mercredi 7 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
J’aime bien mieux votre lettre d'aujourd’hui. Je restais tourmenté de celle d’hier. Quand je n’ai pour me rassurer que mon idée générale sur l'excés de vos impressions, cela ne me suffit pas. Je vous remercie d'avoir dormi.
Salvandy est venu hier passer ici la journée. Réconciliation. Par une foute de petites susceptibilités, justes et injustes, il n'était pas venu à Broglie depuis 1836. Cet été, en Angleterre, il m’a demandé si j’y viendrais, en me priant de l'avertir quand j’y viendrais. Il voulait sortir de cette ridicule humeur. Je l’ai averti. Il est venu. Tout le monde est content. Il ne savait rien. Fort sensé d'ailleurs, et très fermé dans son bon sens. Pensant et désirant, sur la guerre, comme nous.
Quoique a soit peu, ce que vous me dites de la Reine me fait plaisir. Je lui souhaite du fond du cœur, tout ce qu’elle peut avoir encore de bon en ce monde, la santé, le repos et les douceurs de la famille.
Je viens de lire les journaux. L’ordre du jour an prince Gortschakoff pour annoncer à son armée qu’il continuera de défendre la Crimée est très convenable dans sa fermeté modeste. Tout le monde s’arrange pour le repos de l'hiver. Si la paix ne se fait pas d’ici au mois d'Avril, comme j'en ai bien peur, la campagne prochaine sera bien rude.
Peu importent le Portugal et l’Espagne. La Suède est le seul petit neutre qui vaille la peine qu’on y regarde. Etrange prétention que de contraindre les petits Etats à sortir de la neutralité quand les grands Etats y restent tant qu’il leur plaît. C'est l’un des plus choquants abus de la force qui se rencontrent dans l’histoire.
Adieu, Adieu. Je retourne après demain Vendredi au Val Richer, et toujours Lundi à Paris.
146. Broglie, Jeudi 8 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis pressé de savoir ce qui vous agite. A Lundi. J’ai beau chercher, je ne trouve rien qui me paraisse mériter votre agitation.
Je n'attends point de nouvelles d’ici, à longtemps. Le bruit courait ici hier soir qu’on avait de nouveau tiré sur l'Empereur à Fontainebleau, pendant la chasse. Les arrivants de Paris le disaient, en ajoutant qu’on le cachait et qu’on attribuait l'explosion d’un pistolet à un accident. On a raison de n'en pas faire de bruit quand le fait lui-même n'en a pas fait. Quel temps et quels événements faudra-t-il, pour extirper de notre société ces scellérats fous.
Lord Palmerston croit-il y suffire en les renvoyant de Jersey à Guernesey ?
Puisque je nomme Jersey, je ne vois pas comment Lady Jersey vous ennuyerait beaucoup. Elle ne vous demandera pas de la conduire à l'Exposition. Vous n'aurez pas, avec elle, de longs tête-à tête. Quelques moments de commérage anglais ne vous déplairont pas. Certainement Lord Stanhope n’a pas beaucoup d’esprit. La culture a plus fait pour lui que la nature. Je ne m'étonne pas qu’il soit un peu pour la guerre. Il n’est pas de ceux qui rament contre le courant. Pour moi, sa société m'a plu et me plairait. Il est éclairé, instruit, conservateur et libéral Je suis très difficile pour l’intimité ; pas beaucoup en passant.
On m’apporte les journaux. Je vois dans le Constitutionnel l'explication du coup de pistolet. Je souhaite qu’elle soit vraie. Point de nouvelles d'ailleurs. Est-il vrai qu’on ait donné l’ordre de faire sauter les docks et tout ce qui reste des fortifi cations de Sébastopol ? Adieu, Adieu. G.
Je vous prie de m'écrire demain au Val Richer. J'y retourne pour dîner. Adieu encore. G.
147. Broglie, Vendredi 9 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Deux lignes, uniquement par conscience. Je pars à midi et j’ai à terminer la lecture d’un manuscrit.
J’ai dit au Duc de Broglie votre goût pour lui et votre méfiance de son goût pour vous : " Madame de Lieven se moque de moi." Voilà sa réponse. Je crois que vous vous méfiez trop à propos de vous, Viel Castel a parlé ici de ce que vous lui avez lu en homme charmé, vraiment charmé. Je vais faire pour vous, comme je l’ai fait quelque fois pour moi, acte de fatuité ; on ne vous fait pas de compliment parce qu’on vous ferait trop et parce qu’on croit que vous n'avez pas besoin qu’on vous en fasse.
Vous n'êtes pas plus pressée que moi. A lundi soir, dans quatre jours. Envoyez-moi, je vous prie, votre voiture à 8 heures. Je vous écrirai encore demain et après demain, au Val Richer. Adieu, Adieu. G.
148. Val Richer, Samedi 10 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je suis rentré ici hier pas un très beau temps. Je voudrais le retrouver à Paris ; à mesure que je vieillis, la pluie et l'humidité me déplaisent davantage. J’ai eu pour maxime toute ma vie de ne tenir nul compte du temps et de ne jamais le considérer comme un obstacle ; mais autrefois, il ne m'en contait rien de n’y pas faire attention aujourd’hui, il me faut un acte de volonté.
Je ne vois absolument rien dans tous les journaux que j’ai trouvé ici, et qui sont beaucoup pus nombreux qu’à Broglie. Nous vivons trois ou quatre mois sans événements. Je rabâche, en attendant que nous causions.
Le Times a bien peur que les Allemands ne recommencent leur médiation, et qu’on ne les écoute. Vous avez sous certainement de la surprise du commandant d'Odessa en entendant dire que l’amiral Bruat commandait les bâtiments Anglais aussi bien que les Français : " C'est-il possible ? "
Risible exemple du lieu commun auquel vous vous êtes laissé tromper" jamais la France et l'Angleterre ne s'allieront sérieusement dans la voie, où nous sommes aujourd’hui, l'alliance peut aller bien loin et durer bien longtemps.
Onze heures
Moi qui ne suis pas la cour, je rentre en ville, le même jour qu'elle, après demain 12. C'est ce qui fait que je n’ai rien à vous dire qu'adieu, et adieu. G.
149. Val Richer, Dimanche 11 novembre 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je viens d'avoir le feu chez moi un feu assez grave ; une grosse poutre embrasée. Il a fallu démolir deux plafonds & & la fumée ne m’avait pas envahi dans mon cabinet, la maison aurait pu brûler. Mais la fumée m’a averti à temps. J’attends le charpentier pour voir ce que seront les réparations. Je n'en compte pas moins partir demain et vous voir le soir. J'y compte tout-à-fait, et tous mes arrangements restent les mêmes. Pourtant, si quelque accident nouveau survenait, si je découvrais un foyer inconnu, je serais bien forcé d'y regarder. Je ne le crois pas du tout ; je prends seulement cette précaution pour que vous ne vous inquiétiez pas en cas. Il n’y a pas eu un moment de danger, ni d’inconvénient pour personne. C’était un feu latent. Ce n'est qu’un ennui et une dépense. Adieu. Adieu, à demain. G.
Mots-clés : France (1852-1870, Second Empire), Vie domestique (Guizot)