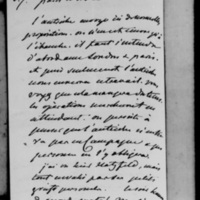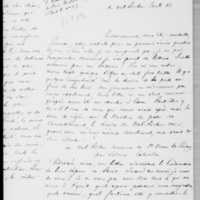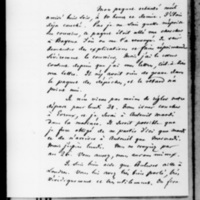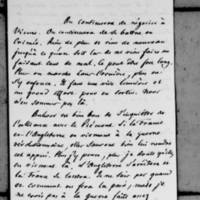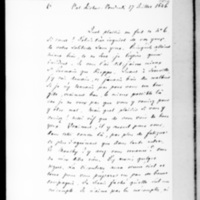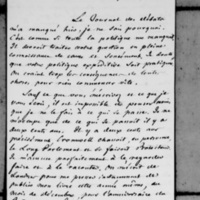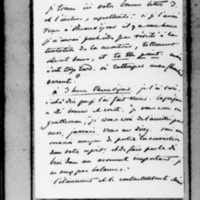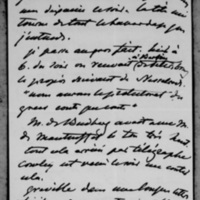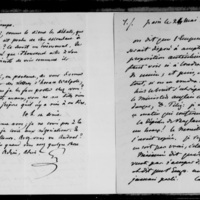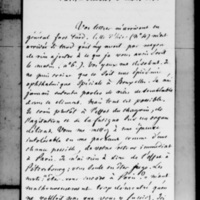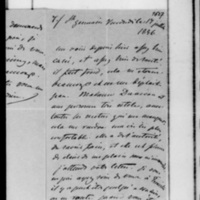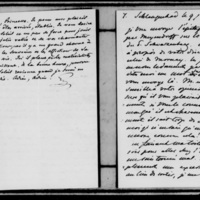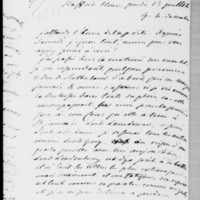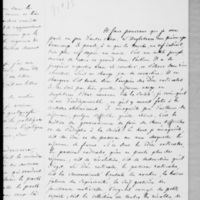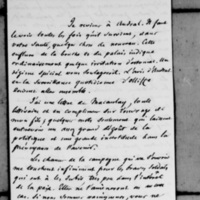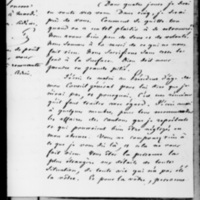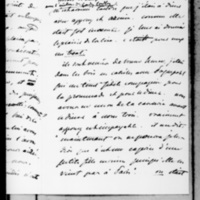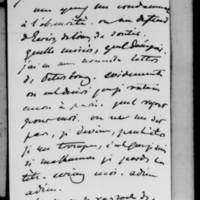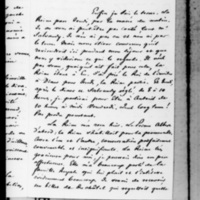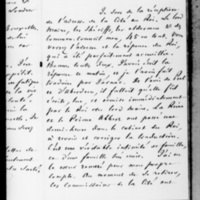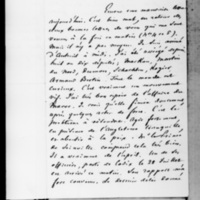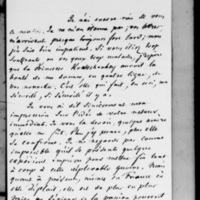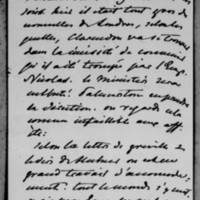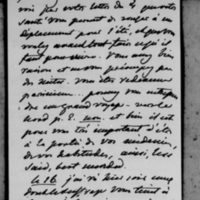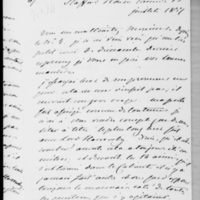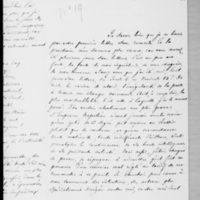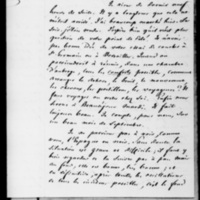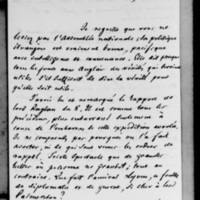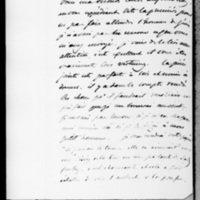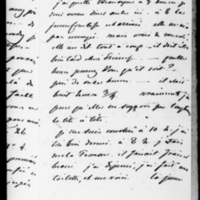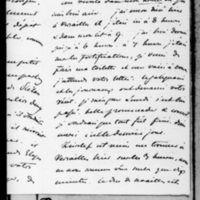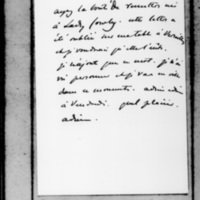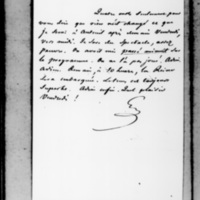Votre recherche dans le corpus : 3330 résultats dans 6062 notices du site.Collection : La correspondance croisée entre François Guizot et Dorothée de Lieven : 1836-1856
6. Paris, Mercredi 23 mai 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
L’Autriche envoie ici de nouvelles propositions. On n’en est encore qu'à l’ébauche. Il faut s’entendre d’abord avec Londres & Paris. Et puis seulement l’Autriche nous enverra ce travail. Vous voyez que cela mangera du temps. Les opérations marcheront en attendant. On persiste à penser que l’Autriche n'entre ra pas en campagne & que Personne ne l’y obligera.
J’ai vu hier Hatzfeld, mais tout envahi par ses petits griefs personnels. Le soir beaucoup de monde quatre ! Molé, Montebello Viel Castel & Merode. Tous en grand éloge de notre écrivain. Vous êtes plus en critique, mais je suis d’avis de ce que vous me dites.
Quel radotage que le rapport de Raglan du 8 mai. Lisez-le jusqu'au bout. C'est si bête. Vous voyez l’avortement de la motion Gibson. Lord Harry Vane devait second the motion. Evidement ils ont tous eu peur. Le speech des Cabarets est contre. J’ai vu mon dentiste ce matin. Cataplasmes, bêtises, la prison, tout cela pour m'épargner une dent. Je suis d’avis de la perdre ça m’est égal. Mais tout cela m'ennuie bien.
Je ne sais pas de nouvelles. Duchâtel chante ce soir. Molé passe sa journée à Champlatreux. Adieu. Adieu. On parle mal de l'exposition, plus qu'il ne faut je crois. Mais enfin le début n'est pas brillant.
6. Schlangenbad, Mardi 8 juin 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
Onze heures
De 10 à 1 on se rassemble à l'ombre de superbes tilleuls à la porte de l’appartement de l’Impératrice. Là Meyendorff vient de faire lecture du testament du duc d’Orléans, (que j’avais apporté). Cette lecture a produit un effet prodigieux. Le Prince de Prusse qui partage beaucoup les idées de sa femme en est resté stupéfait. L’Impératrice vous concevez !
Vous ne me donnez aucune nouvelle. Je crois que le monde veut rester tranquille pendant mon éclipse. De ce côté rien ne se passe non plus. Les Princes et princesses se croisent ici sans ajouter à l’élément de la conversation. Meyendorff est un trèsor très abondant, et si naturel. L’Impératrice prend intérêt à tout sans se fixer à rien. Mais elle n'oublie rien non plus. Et je vois avec plaisir que mes lettres vertes lui restent dans la mémoire. La grande duchesse Olga est charmante et bien belle. La suite de l’Impératrice est bien composée hommes & femmes.
5 heures J’ai pris mon premier bain avec plaisir & frayeur. Je ne sais jamais si ce que j’entreprends me réussira. Je commence déjà à m'inquiéter de ce que je deviendrai après ceci, & puis avec qui m'en retourner, car plus que jamais j’ai vu qu'il me faut quelqu'un. A propos quand je vous reverrai j’aurai quelque chose de drôle à vous raconter. L’Allemagne se brouille. On ne parvient pas à l’arranger, la presse veut avant tout reconstruire le Zollverrein et cela ne va pas. Adieu. Adieu.
J’espère que votre fille va bien. Adieu.
6. Stafford House, Mardi 11 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 h. du matin.
Je suis malade Monsieur, je m’en vais rester couchée au moins toute la matinée. Me voilà comme vous m’avez vue après la promenade au jardin des plantes. Je voudrais bien, comme alors, vous écrire pour vous prier de passer chez moi, et puis préparer un cahier rouge comme excuse à cette indiscrétion. Vous y avez peu regardé le premier jour, et plus du tout le second. Ah que c’étaient déjà de bons moments ! Mais j’attends jeudi jour de ma régénération. Voyez comme je suis faible tout à coup. Il est midi, rien & personne ne m’a empêchée de continuer ma lettre et je n’ai pas eu la force de rester à mon bureau. Je vous écris de mon lit. On me dit de rester tranquille, c’est bon de rester calme, c’est difficile. Comme il ne s’agit donc que du plus ou du moins, je me décide. Je ne le serai pas du tout. Je vais vous le prouver.
Voici ma journée hier. Lord Grey, lord Aberdeen, le prince de Hesse (cousin de la Reine) Pozzo, lady Jersey, lord Sefton, lord Carlisle, lord John Russell, lord Holland, quelques femmes à vous inconnues, mon fils avant tous les autres, voilà ce qui a garni quatre heures de l’avant dîner. Je ne suis seule qu’avec Paul & lord Aberdeen. Lord Grey est de bien mauvaise humeur de ce que je reçois tant de monde. Jadis il me voyait seule souvent, maintenant ces hasards sont rares. Hier je lui annonçai que je n’irai pas à Howick. Je lui fis bien de la peine. Il revint cependant le soir car il est sur le pieds de venir deux fois par jour. (ne vous inquiétez pas de mon écriture. On veut pour moi une position horizontale. Cela gêne ma main. Voilà tout.)
Nous eûmes un dîner ministériel. Lord Lansdown me parla beaucoup de vous. Tout ce qu’il me dit me plut. Mais je n’osai rien ajouter. J’eus peur de moi-même. Tous les jours j’entends prononcer votre nom. Le duc de Sutherland s’amuse toujours à dîner de penser aux voisins qu’il vous donnerait à sa table si vous étiez venu avec moi. Il choisit fort convenablement. Ainsi vous auriez eu la petite princesse et lord Harrowly avant hier. Hier John Russell & lady Holland. Il n’a pas encore songé à vous placer près de moi. Mais vous seriez vis-à-vis. Nous ne songerions pas à nous plaindre. Il croit que ceux-là vous amuseraient davantage.
Comme je vous conte des bêtises ! Monsieur, aujourd’hui acceptez tout, car je suis souffrante après le dîner il vient du monde à mon adresse. Je ne me sentais déjà pas bien à la chaleur de ces salons & de ces galeries, éclairés toujours comme pour des fêtes, c’est pour moi intolérable. J’allais ouvrir l’une des portes qui donne sur la terrasse; je sortis. Je me trouvai en face d’un commencement de lune bien belle, bien claire. Il était juste 10 heures. Les Lundi jour de départ, il me semble extrêmement paisible que d’autres que moi pensassent à la lune dans cet instant. Il n’y a rien de plus banal & de plus rabattu que toutes ces pensées là, & cependant, je m’y livrai comme à une découverte. J’entendis, je sentis cette musique que j’aime tant, & deux grosses larmes roulèrent dans mes yeux. Il parait que la trace n’en était pas bien effacée quand je rentrai dans le salon, car je vis quelques personnes qui me regardaient avec pitié & intérêt. Leurs regards m’apprirent qu’ils songeaient à ce que moi j’avais pu oublier un instant. Je joignis machinalement les mains je demandai pardon à ces êtres chéris de ce qu’un rayon de consolation a pu pénétrer dans mon cœur. Je sentis des remords, de la honte, une profonde tristesse. Monsieur tout cela fut l’affaire d’un moment. Quelques propos indifférents vinrent couvrir tout cela.
Votre cœur doit tout comprendre, je ne m’arrête pas un instant. Je vous dis tout. Je me couchai avec le cœur bien serré. Vous ai-je assez dit combien j’aime le N°4 et combien avant lui j’aimais le N°3 ? Je sens tellement mon insuffisance pour vous exprimer cela que je fais mieux peut être de ne pas m’en mêler. Je lis, je lis sans cesse. Monsieur il me semble que je traite la poste avec bien du dédain !
Mercredi 12 à 9 h.
Je vais mieux ce matin. Je commence par vous le dire avant de passer au récit de ma journée d’hier. Je restai sur mon lit jusqu’à huit heures. J’avais fermé ma porte, je ne vis que mon fils & mes hôtes. La duchesse de Sutherland me parait être déjà un peu accablée du rôle dont elle s’est chargée. La reine est infatigable pour grandes & petites choses. Elle est aussi absolue. Ainsi on lui avait représenté qu’elle ne pouvait pas entrer demain comme elle le voulait dans son nouveau palais, parce qu’il y avait encore beaucoup à faire. Pour toute réponse elle a dit : " J’y entrerai." et elle y entrera. J’aime cela assez. On ne veut pas qu’elle passe la revue des troupes à cheval, parce qu’on craint qu’elle ne soit pas assez bon cavalier. Elle a dit : " Je serai à cheval." Enfin la reine le veut est toujours là. Et il n’y a rien à faire. Nous allons dîner hier chez M. Ellice. Je n’avais pas pu lui refuser cette satisfaction. Il avait prié pour moi des gens qui ne se rencontrent guère. Lord Grey, lord Aberdeen, lord Durham. Je dînai dans un grand fauteuil. Je rentrai de bonne heure pour me coucher. Le dîner fut silencieux comme toujours en Angleterre et je n’eus pas la force de le rendre autrement. Lord Melbourne qui devait en être est dans son lit. Lord Palmerston dans le Devonshire pour son élection. On n’entend parler que des élections. C’est un peu ennuyeux mais je conçois que ce soit d’un grand intérêt. Il me parait que la nouvelle chambre ressemblera fort à celle-ci. Les ministres gagneront quelque voix en Irlande et en Écosse, et les Tories en Angleterre. Cela rendra toujours la marche du gouvernement difficile. Le duc de Wellington pense mal de l’avenir de ce pays. Peel ne partage pas son opinion sur ce point. Cette différence vient tout naturellement de la différence de leurs âges.
Le comte Orloff arrive ici lundi pour complimenter la Reine. C’est le même dont je vous ai parlé et auquel j’avais voulu écrire. La parole viendra mieux. Je serai curieuse des explications que nous aurons ensemble. Mon parti est arrêté au fond de mon cœur, mais je crains d’être trop sûre de mon fait. Il y va de ma vie, car ma vie sans bonheur, c’est la mort. L’idée de mourir m’est pénible aujourd’hui. Quel changement dans mon existence depuis si peu de temps ! Dieu a voulu tout ce qui est arrivé. Il m’a châtié avec sévérité. J’ai accepté avec résignation mes malheurs. J’accepte avec transport les joies qu’il m’ en voie. Je me fie à sa bonté. Il a écouté les prières de mes anges. Tous les jours je les ai envoyées. Je leur ai demandé de prier Dieu pour moi ; de lui demander d’adoucir mes peines ou de me rappeler à lui. Mes peines sont adoucies. Mon cœur connait encore la joie. Quel bienfait ! Il ne me le retirera pas si tôt après me l’avoir accordé ? Midi J’ai eu une lettre de Thiers de Florence. Il y restera deux mois. Il est mécontent du traité avec Abdel Kader. Il m’appelle Madame et cher amie. Concevez-vous rien de plus bourgeois que cela ?
Je vais fermer cette lettre, et vous l’envoyer tout droit. La prochaine vous parviendra par Paris ! La petite princesse veut vous être nommée. La duchesse aussi. La duchesse s’exalte à votre nom. Je l’en aime mieux. C’est une fort noble dame, & une fort noble âme. Adieu. Adieu Monsieur. J’espère une lettre demain.
6. Val-Richer, Jeudi 13 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Certainement vous êtes malade, Princesse, assez malade pour ne pouvoir écrire quatre lignes. Sans cela, je ne comprends pas, je ne puis comprendre comment je n’ai point de lettres. Quelle ressource pour me rassurer ! J’en ai une autre moins triste quoique l’effet en soit fort triste. Il y a quelque irrégularité dans le service de la poste au fond de mes bois. Mes journaux ne m’arrivent pas encore exactement. Deux lettres ne me sont revenues qu’après avoir été me chercher à Caen. Peut-être y en a-t-il une de vous qui court ainsi après moi. Je viens de régler avec le Directeur des postes de l’arrondissement le service du Val-Richer, voici, quand vous voudrez m’écrire directement, ma vraie et sure adresse. Au Val-Richer, Commune de St Ouen le Paing. par Lisieux. Calvados. Adressées ainsi mes lettres m’arrivent le lendemain de leur départ de Paris. Quand en aurai-je une de vous ?
Je ne veux pas vous dire tout ce qui me vient à l’esprit, quel espace parcourt mon imagination, quels ennemis, quel fantôme elle y rencontre. Je n’ai pas en général l’imagination inquiète et noire : mais quand une fois elle prend ce tour là, elle échappe tout à fait à l’empire de ma raison, tout devient possible, probable, réel. Il faut se taire alors, se taire absolument, ne pas se parler à soi-même. Je vous quitte donc Madame. Pourquoi êtes-vous devenue un si grand intérêt dans ma vie ?
Vendredi 14. Voilà une lettre, une longue, un excellente lettre. Et c’est bien celle que j’attendais. Il n’y en a point de perdue. Celle-ci est allée en effet me chercher à Caen, le service encore mal réglé de la poste a causé le retard. Un nom de village pour un autre, une négligence de commis, cinq minutes de sommeil d’un courrier qui passe, sans s’en apercevoir, devant une route de traverse, qu’il faut peu de chose pour faire beaucoup souffrir ! Enfin, la voilà. Et j’espère que les autres viendront plus régulièrement.
Vous n’êtes point malade. On vous trouve bonne mine. Ne permettez pas à tout ce monde de vous accabler de fatigue ; ils n’ont pas de quoi vous en dédommager. Ils vous aiment pourtant et ils ont raison ; et vous avez bien raison aussi d’accueillir toutes les amitiés, quels que soient leur nom et leur drapeau.
Entre nous, j’ai plus d’une fois regretter de ne pouvoir être avec mes adversaires politiques, aussi cordial aussi, bienveillant que je m’y serais senti enclin. J’en sais plus d’un en qui, politique à part, j’aurais trouvé peut-être un ami du moins une relation facile et douce. Mais le soin de la dignité personnelle, les devoirs envers la cause, les exigences et les méfiances de parti, tout cela jette entre les hommes, une froideur, une hostilité souvent sans motifs individuel et intimes. Il faut s’y résigner ; c’est la loi de cette guerre, car il y a là une guerre.
Mais vous, Madame, profitez, profitez toujours et sans hésiter de votre privilège de femme; soyez juste envers tous, bonne pour tous, amicale pour tous ceux qui le mériteront de vous. C’est quelque chose de si beau et de si rare que l’équité et l’amitié ! Je suis charmé que vous en jouissiez, et plus charmé encore que vous soyez si capable d’en jouir, que vous ayez l’esprit si libre et le cœur si affectueux. Je n’y mets qu’une condition Vous la devinez et elle est bien remplie, n’est-ce pas ? Pendant que vous retrouvez à Londres, vos douleurs, pendant que vous n’y pouvez faire un pas, regarder à rien sans avoir le cœur bouleversé au souvenir de vos fils, moi j’achève ici, dans ma maison, les arrangements que le mien y avait commencés. Je fais descendre dans ma chambre son fusil de chasse, je me promène suivi de son chien.
C’est un lien puissant entre nous, Madame, que cette triste ressemblance de nos destinées, et cette parfaite intelligence que nous avons l’un l’autre de nos peines. Il me semble que j’ai connu vos enfants ; je leur prête les traits, les qualités qui me charmaient dans le mien ; je les unis à lui dans mes regrets. Ne vous défendez pas, Madame, du sentiment qui vient émousser ce que les vôtres ont de plus poignant ; laissez-vous guérir autant que se peut guérir une vraie blessure. A mesure que nous avançons dans la vie, c’est la condition de notre âme d’éprouver et d’associer dans je ne sais qu’elle mystérieuse unité, les émotions les plus contraires, de souffrir et de jouir, de regretter, et de désirer à la fois, et avec la même vérité, la même énergie. Acceptons ces secrets de notre nature. Si vous étiez là, si nous causions en liberté, vous me parleriez de vos fils, je vous parlerais du mien. Nous nous raconterions toute leur vie, toute la nôtre, et un sentiment d’une douceur infinie et souveraine se répandrait sur notre entretien. Que mes lettres vous en apportent l’ombre ; les vôtres ont pour moi tant de charme !
Samedi 15, 9 h 1/2 du matin.
Que je dis vrai dans ces derniers mots, & bien plus vrai que je ne dis ! Voilà, le N° 5 qu’on m’apporte. Dearest Princess, je crains qu’à votre tour vous n’éprouviez quelque retard pour mes lettres, pour celle-ci du moins. Je m’en désole. Pardonnez le moi. J’aurais dû la faire partir avant-hier ; mais j’étais si impatienté de ne voir rien arriver que j’ai attendu. Je vous aurais écrit en trop mauvaise disposition. Aujourd’hui je ferais peut-être mieux d’attendre aussi. Ma disposition est trop bonne.
Tout à l’heure Madame j’irai me promener dans les bois qui m’entourent. Ils sont bien verts, bien frais, bien sombres, quoiqu’un beau soleil brille au dessus et les enveloppe de sa lumière. Ce lieu-ci est très solitaire, très sauvage. Autrefois quelques moines y venaient orner. Aujourd’hui quelques bûcherons y travaillent. J’y serai bien seul. Je n’y entendrai rien. Je n’y verrai personne. Je relirai vos lettres. Je serai charmé. Et pourtant, que le fond du jardin de la Duchesse de Sutherland me fera envie ! Et ma pensée tantôt m’y transportera, tantôt vous amènera vous-même dans les bois du Val-Richer. Et je me laisserai bercer à ces doux rêves jusqu’à ce que j’en sente le mensonge. Je rentrerai alors dans ma maison.
Je suis très préoccupé de ce que vous me dites des projets de M. de Lieven. Vous ne pouvez songer, ce me semble, à aller le rejoindre à Carlsbad. Vous voilà à peine en Angleterre. La saison des eaux serait passée avant que vous arrivassiez, en Bohème. Après les eaux, s’il y va M. de Lieven retournera sans doute auprès du grand duc. Non, Madame, il ne faut pas chercher le bonheur à tout prix ; mais il faut penser sans relâche aux moyens de lever les obstacles. Vous ne pouvez ni vous fier à Pétersbourg, ni errer sans cesse en Europe. Que ces deux points là soient bien arrêtés ; ils feront le reste.
Midi. C’est trop de bien en un jour. Je tremble pour les jours qui vont suivre. Je reçois à l’instant votre N°6. Mon pressentiment ne me trompait pas tout à fait quand je vous craignais malade. Reposez-vous, beaucoup, beaucoup. Je suis charmé que vous n’alliez pas à Howick.
Que je vous remercie d’avoir pensé à me rassurer sur votre mauvaise écriture ! Elle m’eût inquiété en effet. Je vais attendre bien impatiemment vos prochaines lettres. Je les crains pourtant un peu. Vous aurez attendu celle-ci. Vous vous serez, comme moi naguère, impatientée, tourmentée. Vous voyez que j’ai aussi ma fatuité. C’est un lieu commun que je dis là, Madame. Non, je n’ai avec vous, point de fatuité. Ce mot ne convient ni à vous, ni à moi. Mais j’ai confiance, je crois. Et vous aussi, n’est-ce pas ? Nous avons donc bien le droit de nous parler comme gens qui croient, c’est-à-dire tout simplement et en disant les choses comme elles sont, non pas comme on est convenu de les dire quand elles ne sont pas. Il faut pourtant que je finisse si je veux que ma lettre parte !
Il me semble que j’ai à peine commencé que je ne vous ai parlé de rien. Je vais au plus pressé à ce qui me touche vraiment ; et je laisse en arrière (comme je laissais le cahier rouge) la politique anglaise, la politique française, votre jeune Reine, la dissolution de son parlement, celle du nôtre, que sais-je ? Tout cela cependant m’intéresse beaucoup, et je lis très curieusement les détails que vous me donnez, et j’ai sur tout cela, des milliers de choses à vous dire. Et ma prochaine lettre, si dans celle-là encore, j’en trouve le temps. Adieu Madame.
Remerciez, je vous prie, la petite Princesse de son bon souvenir. J’y tiens beaucoup et j’en suis très touché. C’est à vous de lui demander pardon, pour moi d’un langage si familier. Je copie. Je suis bien heureux d’apprendre que Madame la Duchesse de Sutherland veut bien se rappeler mon nom. C’est du luxe en vérité d’être si bonne quand on est si belle. Mais le luxe qui vient de Dieu est charmant ; et il a comblé votre noble hôtesse de tant de dons qu’en effet elle nous doit peut-être à nous autres pauvres mortels de nous traiter avec un peu de bonté. Quelque place qu’elle me donnât à sa table, je serais ravi de m’y asseoir. G.
Mots-clés : Autoportrait, Conditions matérielles de la correspondance, Deuil, Diplomatie, Discours autobiographique, Enfants (Benckendorff), Enfants (Guizot), Parcs et Jardins, Politique (Angleterre), Politique (France), Portrait (Dorothée), Relation François-Dorothée, Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Séjour à Londres (Dorothée), Vie familiale (Dorothée)
6. Val-Richer, Jeudi 17 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Mon paquet retardé m’est arrivé hier soir, à 10 heures et demie. J'étais déjà couché. Par je ne sais qu’elle méprise du courrier, ce paquet était allé me chercher à Bayeux d'où on me l’a renvoyé. Je vais demander des explications et faire reprimander sévèrement le courrier. Mais j’ai le cœur content depuis que j’ai mes lettres, c’est-à-dire ma lettre. Il n’y avait rien de grave dans le paquet des dépêches, et le retard n’a point nui. Je n'en viens pas moins de régler notre départ pour lundi 21. Nous irons coucher, à Evreux ; et je serai à Auteuil mardi dans la matinée. Il serait possible que je fusse obligé de ne partir d’ici que mardi et de n’arriver à Auteuil que Mercredi. Mais j’espère lundi.
Vous ne croyez pas au 26. Vous aurez, nous aurons mieux. Je suis bien aise que Bulwer aille à Londres. Vous lui avez très bien parlé très véridiquement et très utilement. On fera une faute énorme si on fait du bruit contre le mariage Aumale. Au fond, si nous voulions ce mariage, si les raisons françaises et Espagnoles étaient en sa faveur, je n'aurais pas grand peur de ce bruit Européen. Je le crains parce qu'il est inutile et deviendrait fort dangereux s’il faisait de ceci, pour la France et pour l'Espagne, une question d’indépendance et de dignité nationale. Du reste, je ne sais pourquoi je vous répète là ce que vous avez dit à Bulwer. M. de Metternich, sous des apparences réservées et douces, me paraît bien préoccupé du comte d'Aquila, préoccupé surtout de la crainte que le Roi de Naples ne reconnaisse, avant l’Autriche, la Reine Isabelle, et ne s'échappe ainsi du bercail, comme fit, il y a quatre ans le Roi Guillaume. Il y aurait là, en Italie un acte et un germe d'indépendance qui lui déplairait fort. C’est évidemment une affaire qu’il faut conduire sans en parler beaucoup, et sans admettre une discussion préalable. En tout, je ne m’engagerai dans aucune discussion de noms propres. Je resterai établi dans mon principe, les descendants de Philippe V. C'est à l'Espagne à prononcer et à débattre les noms propres. Votre Empereur a déclaré aux Arméniens Schismatiques, dont le Patriarche est mort dermièrement qu’il ne consentirait à une élection nouvelle qu'autant que la nation entière reconnaitrait la suprématie spirituelle du Synode de Pétersbourg. La nation a refusé. L'Empereur a interdit toute élection et confisqué en attendant les biens du Patriarche, qui sont considérables, dit-on. Cela fait du bruit à Rome. Le Pape protégera les Schismatiques contre l'Empereur.
La lettre d'Emilie est bien triste. Et celle de Brougham bien vaniteuse.
10 heures
Voilà les numéros 7 et 8. Vous avez très bien fait. Je crois comme vous, à la vertu de la vue de ce qui a été écrit sans intention. Je ne réponds plus sur le 20. Il est devenu le 22. Je vous quitte. J’ai à écrire à Génie et à Désages. Je ne crois pas à Espartero sur un bateau à vapeur entre à Bayonne. Ce serait trop drôle. Adieu. Adieu. Je suis charmé que l’air de Versailles vous plaise. G.
6. Val-Richer, Mercredi 23 mai 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
On continuera de négocier à Vienne. On continuera de se battre en Crimée. Rien de plus et rien de nouveau jusqu'à ce qu’on soit las de ne rien faire en faisant tant de mal. Ce peut être fort long. Plus on marche dans l’ornière, plus on s’y enfonce. Il faut une vive lumière et un grand effort pour en sortir. Nous n'en sommes pas là. Bulwer est bien bon de s’inquiéter de l'alliance avec le Piémont. Si la France et l'Angleterre en viennent à la guerre révolutionnaire, elles sauront bien lui rendre cet appui. Plus j'y pense, plus je doute qu'elles en viennent là. L’Angleterre s’arrêtera et la France se lassera. Je ne sais pas quand et comment on fera la paix ; mais je ne crois pas à la guerre faite assez audacieusement et énergiquement pour bouleverser l'Europe. Est-il vrai, comme le disent les Débats, que Lord Stratford ait perdu de son ascendant à Constantinople ? Ce serait un événement. Je suis assez pressé que Thouvenel aille à son poste, par curiosité de voir comment ils s’arrangeront. J’ai oublié, en partant, de vous donner les six volumes des lettres d'Horace Walpole, voulez-vous que je les fasse porter chez vous ? Dans vos petits maux, vous ne me dites rien de vos yeux ; j'espère qu’il n’y a rien à en dire.
10 h. et demie
Je suis comme vous ; je ne crois pas à la paix, quoique je croie aux négociations. Je n’ai rien d'ailleurs. Avez-vous vu Andral ? Il faut le voir quand vous avez quelque chose de nouveau. Adieu, Adieu. G.
6. Val-Richer, Vendredi 17 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Quel plaisir me fait ce N°6, si court ! J’étais tres inquiet de vos yeux de votre solitude sans yeux. Puisqu'ils allaient mieux hier, ce ne sera, je l’espère, qu’un incident. Je vous l’ai dit ; j’aime mieux St Germain que Dieppe. Quant à Trouville j’y vais demain, et j'aurais bien du malheur si je n’y trouvais pas pour vous un bon gite vraiment bon, le mieux possible là, car je ne veux pas que vous y veniez pour y être mal. Mais quel plaisir si vous y veniez ! Aussi vif que de vous voir de bons yeux. Vraiment, il y aurait pour vous dans cette course-là, pas plus de fatigue et plus d’agrément que dans toute autre. El Mouchy ? Y avez-vous renoncé ? Vous ne m'en dîtes rien. J’y aurais quelque regret. La vicomtesse aura remué ciel et terre pour vous préparer un peu de bonne compagnie. Je serais fâché qu'elle eût un mécompte. Je n'aime pas les mécomptes, ni donnés, ni reçus. Comme il vous conviendra du reste. Merci de la lettre de Greville. Intéressante. Je vous la renvoie avec une de Reeve que vous me renverrez. A peu près la même chose. Le parti Tory se réformera. Et un jour, il s’y formera un chef. Peel ne le redeviendra pas. A moins d’incidents bien imprévus. Et de l’autre côté les nuances se fondront dans un grand parlé libéral, qui n’en sera pas plus homogène. Et le jour qui ne sera pas très loin, ou l’esprit radical y prévaudra trop les Torys reprendront le pouvoir. Je doute que Gladstone, leur soit un chef dans les Communes. Je voudrais bien. Il est très honnête et d’un esprit doux et élevé. Nous verrons. Il y a bien à regarder là.
Le courrier d’aujourd’hui ne m'apporte rien du tout. Sinon le mouvement des élections qui s'anime un peu. Je suis charmé que Casimir Périer se porte candidat à Paris, et je désire beaucoup qu’il réussisse. Cela me convient électoralement et diplomatiquement. Adieu. Je serai court aussi aujourd’hui. J’ai un énorme paquet de signatures à donner. Je ne suis pas aussi oisif ici que l’an dernier. J’ai gardé les affaires. Je me promène pourtant beaucoup. En bien bon air. Point trop chaud. Hier il a beaucoup plu. Adieu. Adieu. Merci de vos yeux. G.
6. Val Richer, Jeudi 2 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Le journal des Débats m’a manqué hier, je ne sais pourquoi. C'est comme si toute la politique me manquait. Il devrait traiter votre question en pleine connaissance de cause et sensément. Je doute que votre politique expéditive soit pratiquée. On craint trop les conséquences de toutes choses pour rien commencer vite. Sauf ce que vous m'écrivez, et ce que je vous écris, il est impossible de penser moins que je ne le fais à ce qui se passe.
Je ne m'occupe que de ce qui se passait il y a deux cent ans. Il y a deux cent ans précisément, Cromwell chassait, en personne le Long Parlement et se faisait Protecteur. Je m'amuse parfaitement à le regarder faire et à le raconter. On m'écrit de Londres pour me presser instamment de publier, mon livre cette année même, au mois de décembre, pour l’anniversaire du protectorat. Partout on se plaît aux coïncidences de dates. Je crois que je leur donnerai cette satisfaction.
Vous ne vous souciez guère de la Chine. Cependant le Galignani me dit que les agents anglais et Français ont promis le secours de leurs vaisseaux pour empêcher cet Empire là de tomber. Soutenir deux Empires à la fois en Orient, c’est beaucoup. La coïncidence est singulière. Je suppose qu’elle ne vous plait pas davantage dans l'Orient asiatique que dans l'Orient européen. Mais vous n'êtes pas engagés à protéger les Chinois contre les Tartares comme les Grecs contre les Musulmans. Bizarre spectacle que celui du monde aujourd’hui ! Ce sont des hérétiques, et des schismatiques qui s'en partagent ou s'en disputent la domination. Le Pape ferait plus sagement de voir en eux des Chrétiens que de s'obstiner à les anathématiser, comme au temps où les catholiques dominaient partout. Je suis encore plus frappé de la décadence d’esprit de la cour de Rome que de celle de sa force. C'est dommage.
Onze heures
Le rappel de Brünnow serait drôle. J’ai point à y croire. Les Débats sont curieux en effet. Ils ont raison. Adieu, adieu. Vous avez raison de ne prendre personne à la place de votre Allemand. Marion vaut un homme et une femme. Adieu. G.
6. Versailles, Lundi 4 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
9 heures
Quel charmant récit ! Votre N°4 est une peinture vivante de cette magnifique rencontre. Je suis ravie. La Chaloupe est bien à la bonne heure. Et puis quand elle partira la Chaloupe encore s'il fait beau et pas plus et pas autre chose, je vous en prie.
J’ai eu votre lettre à 5 heures par un spécial que m’a envoyé Génie. Il s’offrait à venir lui même après son dîner, mais je lui ai mandé le principal de ce que vous me dites pour l’en dispenser.
Avant cela, à 3, est venu Fleichman. Bon homme et même pas sot mais trop peu au courant. Ainsi ébahi quand je lui dis qu’Aberdeen était du voyage. Il a ouvert ses plus grands yeux, c'est alors seulement qu'il a compris que ce voyage était quelque chose, au reste il parle bien, et il n'a jamais mal parlé car il n’était même pas à cette fameuse soirée de mardi chez Appony qui a fourni de si curieuses observations à Molé. Il trouve que c’est immense. Il croit que son Roi rira de ce que cela vexera les autres. C’est tout-à-fait dans le caractère du Roi de Wurtemberg.
La jeune comtesse est arrivée ici avec du monde russe, elle m’a amusée et m’amusera encore jusqu’à ce soir. Elle retourne à Paris. Mes voisins les Locke m'ennuient moins. Ils sont bonnes gens. Je les ai vus hier plusieurs fois. Je suis un god send pour eux avec mes nouvelles sur leur reine.
Je trouve les premières paroles d'Aberdeen excellentes, vous aurez soin que le remplissage ressemble au cadre. J'espère bien que vous lui parlez Français. Un Anglais s’offense quelque fois quand un étranger lui parle autrement. Pour le Roi c'est autre chose, c'est sa coquetterie et il fait bien. Fleichman nie fort et ferme le mariage de son prince royal avec une fille du grand duc Michel. Porte-t-on à dîner la santé de la reine d'Angleterre. Je crois que vous aviez oublié de mettre cela sur votre mémorandum. On dit que les deux voleurs sont très ennuyeux. C'est de l'opéra comique.
1 heure. Voici le N° 5. Merci toujours merci car au milieu de tant de distractions et d’affaires vous m'écrivez de bonnes lettres. Dites-moi quand vous revenez. Quel jour, quelle heure. Je ne m’ennuie pas ici, mais je ne me porte pas bien, je ne sais ce que c’est, peut-être la chaleur ne m’a-t-elle pas convenu. Aujourd'hui il fait frais. J’attends Appony et Armin. Comment trouvez-vous l’adresse de la fête à Espartero ? Adieu. Adieu, j’irai voir Trianon avec la jeune comtesse. Adieu tendrement, adieu.
7. Baden, Mardi 6 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’attends, j’attends Hennequin & je grille. Mon frère est plus mal aujourd’hui il y a eu une consultation, un nouveau médecin, la guérison impossible. Le soutenir plus ou moins longtemps voilà tout ce qu'on peut espérer. Son médecin ordinaire vient de me dire qu'il doute qu'on le ramène vivant en Russie, en même temps il presse ce départ et nous verrons le médecin et moi d'écrire à Madame de Krudener pour la prier d'arriver à Francfort, Heidelderg, ou tout autre point de rendez-vous et épargner ainsi à mon frère le voyage de Bavière. Bade est impraticable pour la rencontre, à cause des deux filles. J’ai passé ma matinée à ces consultations & arrangements. J’ai peu vu mon frère. Il n’avait pas la force de parler. C’est bien triste ce que je suis venu trouver ici.
4 heures
J'ai reçu le n°4 par la poste. Hennequin n’a pas encore paru. J’ai lu la séance de samedi à la Chambre des Pairs. J’approuve fort votre réserve, bonne leçon à Peel (je suis enragée contre Peel) et Molé qui se mêle de cela aussi. Je suis bien aise de ce que les Débats en disent. Au demeurant cependant, c’est une bien détestable affaire, rendue détestable par Peel. Il vous sera fort difficile ou même impossible de le satisfaire. L'amènerez vous à fléchir ? Vous ne pouvez pas destituer d'Aubigny. Je cherche, je creuse, je ne trouve rien que de très mauvais. Mais ce qui me trouble beaucoup surtout c’est cet esprit des journaux si vivement excité. J’ai peur. Je ne veux pas qu’on vous rencontre à pieds dans les rues de Paris. Promettez le moi. Dites à Génie que j'ai peur, et que je le conjure de me rassurer de veiller sur vous. Je prie Dieu, je ne cesse de penser à vous. Je suis désolée d'être loin. Vous aimeriez que je fusse là à Beauséjour, vous vous contenteriez même de Paris. Ah que ce voyage est malencontreux. Il me déplairait beaucoup quand même je vous saurais tranquille, content, sans souci, et que je n’aurais pas moi même ce triste spectacle de mon frère mourant sous mes yeux. Aujourd’hui tout se réunit, quelle fatalité. Je déteste Bade. Je partirai dès que je pourrai.
5 1/2
Voici Hennequin. Que je vous remercie de votre lettre ! Comment au milieu de ce feu croisé, de toute cette avalanche de tracasseries vous avez pu me faire une pareille lettre ! Que vous êtes bon ! Vous allez vous fâcher de ce bon. C’est égal. Merci, merci. Vous me soulagez un peu. Il me semble que l’affaire ne sera pas si grosse. J’approuve tout ce que vous me dites. Vous ne souffriez pas que Peel retourne, vous ne le pouvez pas. Il faut déclarer cela net. Et je suis tout-à-fait de votre avis, bonne occasion pour vous de refuser quelque chose et d'être raide. Tant pis pour eux, ils vous ont rendu la tâche plus difficile, qu'ils en portent la peine. Peel verra l’explosion que ses paroles ont provoquée ici. He will hold his tong next time. Le petit Hennequin trouve ici votre ministre ce qui l’arrange. Il a remis votre lettre au préfet de Strasbourg. Il trouve Bade charmant. Il va se divertir. Il m’est arrivé bien lavé et bien propre.
Le grand duc Constantin qui est encore un enfant est là dans le sand avec la flotte comme il y est tous les ans et la flotte aussi pour se promener quand notre mer n’est pas prise par la glace. Il avait été envoyé à aourre? assister au départ du vaisseau l’Imper ? qu'on a construit après le naufrage du vaisseau de ce nom l’année dernière. De là il a fait le tour de la Scandinavie, et est venu rejoindre notre flotte de la Baltique. Cela n’est pas autre chose. Ils vont retourner à Kronstadt.
Mercredi 7 août.
7 heures 1/2 du matin. Je viens de relire vos deux dernières lettres 3 et 4. Je répète, vous avez raison votre conduite est bonne ; et celle de Peel vous force à plus de raideur que vous n’auriez eu sans cela peut être. C’est impossible qu'il ne comprenne pas cela. Lui avez- vous fait quelques observations sur son discours ?
La journée hier a été bien mauvaise ici et on vient de me faire dire que la nuit a été de même. Vraiment, si je vous contais ce qui est cause de ce redoublement vous ne croiriez pas !! Il est mourant hélas cela n’est pas douteux. Hélène est arrivée hier, il l’a embrassée mais ne lui a pas dit deux paroles. Il n’a plus la force de se réjouir de rien. Le premier jour il était venu chez moi à pied les deux suivants il était assis dans sa chambre hier, couché sur son lit, étendu comme un mort, les yeux fermés, et c’est à moi seule qu'il a dit huit mots de suite. Ainsi la progression du mal est rapide.
La beauté de Bade surpasse tout ce qu'on peut imaginer en fait de pittoresque et de riant. C'est un enchantement de quelque côté qu’on se tourne. J’en jouis peu, je suis triste, les seules personnes que je vois (ma famille) n’ont qu’une seule et même parole & pensée ; il est bien aimé par tout ce qui l’entoure. Il y a entre autre un brave homme et homme d'esprit avec un nom barbare qui me touche par l'affection, le dévouement extrême qu'il lui montre. Avant hier on a écrit à l’Empereur pour le prévenir des dangers. Je ne sais si lui-même se croit aussi mal. Constantin est parfait, c'est une angélique créature, et si affectueux. Il est plus affligé que les propres enfants. Annette qui est bonne est un peu insouciante parce qu’elle a la vue basse. Rodolphe spécule. Hélène est très très triste, mais toujours aigrie sur Madame de Krudener. Cela vaut bien la peine à présent ! Moi, ce qui me frappe c’est cette pauvre brave femme, ma belle sœur à qui personne ne donne avis du danger et qui ne reverra plus son mari. Elle qui l’a toujours adoré maussadement peut-être, mais enfin elle est irréprochable. Je crois que mon frère apprécie nos soins et notre présence, mais voilà tout.
Adieu. Adieu. Oui, je vous aime autant au moins autant que vous m'aimez et vous me manquez bien plus que je ne vous manque. C'est bien clair, c’est bien entendu. Car vous avez tant ! Et moi je n'ai rien rien que vous, vous seul au monde. Adieu Adieu. Adieu.
7. Beauséjour, Mardi 15 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je trouve ici votre bonne lettre 3. et l’incluse, excellente. Si je l'avais reçue à Beauséjour il y a une heure. Je n’aurais peut-être pas résisté à la tentation de la montrer, tellement elle est bonne, et to the point. Mais c’est trop tard. Où rattraper man chevalier errant ?
A 3 heures Beauséjour, je l'ai reçu c'est-à-dire que je l'ai fait venir. La préface a été bonne et courte. " Je vous crois un gentleman, je vous crois de l’amitié pour moi, jamais vous ne direz. Voici une occasion unique de porter la conviction dans votre esprit, et de faire par là du bien dans un moment important. Je ne veux pas balancer. "
L’étonnement et le contentement étaient visibles. Je crois, je suis sûre que j'ai bien fait. Il y a des occasions où le noir sur blanc, fait une impression bien autre que la parole. C'était comme mon K. il y a quelques semaines. Je vous renvoie, ce sera remis dans les mains de Génie. Il ne se doute pas comme de raison. Je l’ai vu ce matin, nous sommes convenus qu’Etienne ira tous les matins à onze heures prendre ses ordres c. à. d. ma lettre et qu'il viendra me l’apporter et reprendre ma réponse, demain à Versailles, après demain à St Germain. Adieu. Adieu. Je vais partir. Dites moi que vous recevez exactement mes N° celui-ci surtout. Adieu. Que j'aime votre N°3 !
7. Bruxelles, Dimanche 5 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous écris un mot pour vous prévenir que Madame Hatzfeld aura à vous remettre une lettre. Je la croyais partie hier & j’apprends que ce n’est que demain qu'on vous l’envoie. J’ai vu des lettres de Berlin selon lesquelles la Prusse nous reste très fidèle. Quant à l’Autriche, il y aura plus à la surface qu’au fond, et on aurait tort de se trop fier [à] l'exaltation de Hubner. L'air est bien froid ici. J’ai passé ma soirée hier seule avec Van Praet. Je me couche de bonne heure. Hélène se promène avec moi en voiture. Mon fils va et vient. Les diplomates viennent tantôt le matin, tantôt le soir. Il n'y a pas de quoi composer un salon ici et jusqu’à présent je n’y ai pas goût. Adieu. Adieu, tous les jours mes regrets sont plus grands, plus profonds. Adieu.
Je crois que je me suis trompée de N° & que ceci est 7.
7. Château d'Eu, Lundi 4 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je pense beaucoup à ce qui se passe ici, si je ne consultais que mon intérêt, l’intérêt de mon nom et de mon avenir, savez-vous ce que je ferais ? Je désirerais, je saisirais, s’il se présentait un prétexte pour me retirer des affaires et me tenir à l'écart. J’y suis entré, il y a trois ans, pour empêcher la guerre entre les deux premiers pays du monde. J’ai empêché la guerre. J’ai fait plus. Au bout de trois ans à travers des incidents, et des obstacles de tout genre, j’ai rétabli entre ces deux pays la bonne intelligence l'accord. La démonstration la plus brillante de mon succès est donnée en ce moment à l’Europe. Et elle est donnée au moment où je viens de réussir également sur un autre théâtre dans la question qui divisait le plus profondément la France et l'Angleterre, en Espagne. Je ne ressemble guères à Jeanne d’Arc ; mais vraiment ce jour-ci est pour moi ce que fut pour elle le sacre du Roi à Reims. Je devrais faire ce qu’elle avait envie de faire, me retirer. Je ne le ferai pas et on me brûlera quelque jour comme elle. Pas les Anglais pourtant, je pense.
Aberdeen a causé hier une heure avec le Roi. C'est-à-dire le Roi lui a parlé une heure Aberdeen a été très très frappé de lui, de son esprit, de l'abondance de ses idées, de la fermeté de son jugement de la facilité et de la vivacité de son langage. Nous sommes montés ensemble en calèche au moment où il sortait du Cabinet du Roi. Il était visiblement très préoccupé, très frappé, peut-être un peu troublé, comme un homme qui aurait été secoué et mené, très vite en tous sens, à travers champs, et qui bien que satisfait du point où il serait arrivé, aurait besoin de se remettre un peu de la route et du mouvement. The king spoke to me un very great earnestness, m’a-t-il dit. Et je le crois car, en revenant de la promenade, j’ai trouvé le Roi, très préoccupé à son tour, de l'effet qu’il avait produit sur Aberdeen. Il ma appelé en descendant de calèche pour me le demander. " Bon, Sire, lui ai-je dit ; bon, j’en suis sûr. Mais Lord Aberdeen ne m’a encore donné aucun détail. Il faut que je les attende. "
Il les attend très impatiemment. Singulier homme le plus patient de tous à la longue et dans l’ensemble des choses, le plus impatient le plus pressé, au moment et dans chaque circonstance. Il est dans une grande tendresse pour moi. Il me disait hier soir : " Vous et moi, nous sommes bien nécessaires l'un à l'autre ; sans vous, je puis empêcher du mal ; ce n’est qu’avec vous que je puis faire du bien. "
Il fait moins beau aujourd’hui. J'espère que le soleil se lèvera. Nous en avons besoin surtout aujourd’hui pour la promenade et le luncheon, dans la forêt. Le Roi a besoin de refaire la réputation de ses chemins. Il a vraiment mené hier la Reine victoria par monts et par vaux, sur les pierres, dans les ornières. Elle en riait, et s'amusait visiblement de voir six beaux chevaux gris pommelés, menés par deux charmants postillons et menant deux grands Princes dans cet étroit, tortueux et raboteux sentier. Au bout, on est arrivé à un très bel aspect du Tréport et de la mer. Aujourd’hui, il en sera autrement. Les routes de la forêt sont excellentes. Du reste il est impossible de paraître et d’être, je crois, plus contents qu'ils ne le sont les uns des autres. Tous ces anglais. s'amusent et trouvent l’hospitalité grande et bonne. J’ai causé hier soir assez longtemps, avec le Prince Albert. Aujourd’hui à midi et demie la Reine et lui me recevront privatily. Ce soir spectacle. Débat entre le Roi et la Reine (la nôtre) sur le spectacle. La salle est très petite. Jean de Paris n'irait pas. On a dit Jeannot et Colin, beaucoup d'objections. Le Roi a proposé Joconde. La Reine objecte aussi. Le Roi tient à Joconde. Il m'a appelé hier soir pour que j'eusse un avis devant la Reine. Je me suis récusé. On est resté dans l’indécision. Il faudra pourtant bien en être sorti ce soir. Adieu.
J'attends votre lettre. J'espère qu'elle me dira que vous savez l’arrivée de la Reine et que vous n'êtes plus inquiète. Je vais faire ma toilette en l’attendant. Adieu. Adieu.
Midi
Merci mille fois de m'avoir écrit une petite lettre, car la grande n’est pas encore venue et si je n'avais rien eu j'aurais été très désolé et très inquiet. A présent, j’attends la grande impatiemment. J'espère que je l’aurai ce soir. Ce qui me revient de l'état des esprits à Paris me plait beaucoup. Tout le monde m'écrit que la Reine y serait reçue à merveille. On aurait bien raison. Je regrette presque qu'elle n’y aille pas. Pourtant cela vaut mieux. Mad. de Ste Aulaire est arrivée ce matin. Voilà le soleil. Adieu Adieu. Je vais chez la Reine et de là chez Lord Aberdeen. Adieu Cent fois. J’aime mieux dire cent que mille. C'est plus vrai. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Discours autobiographique, Discours du for intérieur, Louis-Philippe 1er, Opinion publique, Parcours politique, Politique (Espagne), Politique (France), Portrait, Posture politique, Théâtre
7. Château de Windsor, Vendredi 11 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
4 heures
Votre pauvre frère est donc mort. Tristesse ou joie, toute chose m'est un motif de plus de regretter l'absence. Loin de vous ce qui vous afflige me pèse ; ce qui me plaît à moi, me pèse. Je ne puis souffrir cette rupture de notre douce et constante communauté. Je suis vraiment triste que votre frère n'ait pas eu la consolation de mourir chez lui, dans sa chambre au milieu des siens. Il semble qu’on ne meure en repos que là. Et cette pauvre Marie Tolstoy ! Je ne lui trouvais point d’esprit. Mais elle a un air noble et mélancolique qui m’intéressait. Non, vous n’êtes pas seule, car je vais revenir.
Nous partons toujours lundi 14, pour nous embarquer à Portsmouth vers 5 heures et arriver au château d'Eu mardi 15 à déjeuner. J’y passerai le reste de la journée du mardi et je serai à Paris mercredi soir. Bien profonde joie.
Le voyage est excellent et laissera ici de profondes traces. Mais cinq jours suffisent pleinement. Je sors de la cérémonie de la Jarretière. Vraiment magnifique et imposante, sauf toujours un peu de lenteur et de puérilité dans les détails, 14 chevaliers présents. Le Roi, très bonne mine, très bonne tenu ; point d'empressement et saluant bien. Lord Anglesey a failli tomber deux ou trois fois en se retirant. Je ne vous redis pas ce que vous diront les journaux.
Hier à dîner entre la Duchesse de Mecklembourg et la Duchesse de Norfolk. La première spirituelle, et gracieuse ; la seconde pompeusement complimenteuse. Après dîner, Lord Stanley. Longue et très bonne conversation. Il m'a dit en nous quittant : " Je vous promets que je me souviendrai de tout ce que vous m'avez dit. " Je crois avoir fait impression. Le Roi en croit autant pour son compte. Quel dommage de ne pas voir les hommes là tous les trois mois ! Qu'il y aurait peu d'affaires. Lord Stanley m’a fait à moi l'impression d'une grande franchise & straightforwardness. Le tort des Anglais, c'est de ne pas penser d’eux mêmes à une foule de choses, et de choses importantes. Il faut qu'on les leur montre.
Outre Stanley, un peu de conversation avec M. Goulburn. Je les ai soignés, tous. Voilà deux soirées où je vous jure que j’ai été très aimable. Hier trois heures avec Aberdeen. Parfait sur toutes choses. Nous sommes de vrais complices. Nous nous donnons des conseils mutuels. Il est bien préoccupé de Tahiti et bien embarrassé du droit de visite. Ce matin deux heures et demie avec Peel. Remarquablement amical pour moi. Les paroles de la plus haute estime, de la plus entière confiance. Il a fini par me tendre la main en me demandant mon amitié de cœur. A un point qui ma surpris. Du reste très bonne intention ; plus d'humeur. Le voyage en effacera toute trace : mais des doutes, des hésitations et des inquiétudes dans l’esprit qui est plus sain que grand. Il m'a répété deux fois, qu’il s’entendait parfaitement et sur toutes choses avec Lord Aberdeen. Se regardant comme brouillé avec une portion notable de l’aristocratie anglaise, & le regrettant peu.
L'Empereur et M. de Nesselrode ont pris plus d’une demi-heure de notre temps. Les choses sont parfaitement tirées au clair. Il a fort approuvé ma conduite de ce côté depuis trois ans. Que de choses j'aurais encore à vous dire. Mais il faut finir. Mon courrier part dans une demi-heure et j’ai à écrire à Duchâtel. Adieu. Adieu. Dearest ever dearest.
J'oublie toujours de vous dire que je vais bien. Un peu de fatigue le soir. Je suis toujours charmé de me coucher. Mais je suffis à chaque jour, et mieux chaque jour. Je mange, quoique je ne puisse pas avoir un bon poulet. Demain, la Cité de Londres envoie à Windsor son Lord Maire, ses douze Aldermen et 18 membres de son common council pour présenter au Roi une adresse excellente pour lui, excellente pour la France. N'ayant pu obtenir le banquet à Guildhall ils n'en ont pas moins voulu manifester leurs sentiments. Ici, cela fait un gros effet. J’espère que chez nous, il sera très bon. Je n'écris pas à Génie dites-lui je vous prie ceci et quelques autres détails pour sa satisfaction. Adieu adieu. G.
7. Paris, Jeudi 2 juin 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’ai vu hier matin 18 personnes une dizaine ce soir. La tête me tourne de tout le bavardage que j'entends. Je passe au gros fait. Hier à à Berlin 6 du soir on recevait de Pétersbourg le propos souvent de Nesselrode. " Nous aurons le protectorat des Grecs coute que coute. " M. de Budberg avait avec M. de Manteuffel le ton très haut. Tout cela arrive par télégraphe.
Cowley est venu le soir me conter cela. Greville dans une longue lettre finit par ces mots-ci. The flut will not sail until we give order et puis. “The emperor has promised that he will in no case have recourse to ulterior measures without giving us ample notice of his intention. " Il me mande que Brunnow est dans le dernier embarras. Les Allemands ici parlent de désavouer Menchikoff, (vous voyez que le télégraphe de Berlin dément cela) et disent que l’Emp. n’a pas bien compris la portée de ce qu’il exige de la porte. Tout ceci prouve seulement que nous n’avons l’appui de personne. "
Nous amusons L. Radcliffe de tout le mal. Cowley me le dit aussi à l’oreille. Mais Greville maintient qu'il s’est parfaitement conduit & son cabinet l’approuve. Je suis inquiète de cette situation. Nous ferons la guerre sans le moindre doute à moins que la porte ne cède.
Adieu. Adieu.
7. Paris, Jeudi 24 mai 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
On dit que l’Empereur (le vôtre) serait disposé à accepter la proposition autrichienne ; il faut voir si à Londres on pense de même, et puis et par dessus tout, si on en voudra à Pétersbourg. Hier le bruit s’est répandu que le ministère anglais était en danger, D. Télég : Je ne vois rien ce matin qui confirme ce bruit. La dépêche de Raglan était donc un houx. Le Moniteur aussi l’avait copié. Je regrette que ce ne soit pas vrai, c’était drôle. Mérimée dit que Fould ne veut pas s’occuper de l’Académie et dit que l’Emp. ne lui en a jamais parlé. La tirade de l’autre jour était donc très personnelle à lui. Depuis, il s'ex prime avec plus de douceur dit-on. Voilà l’Indépendance qui reproduit la dépêche de Raglan tirée de la gazette de Londres, ce qui est officiel. Je ne demande pas mieux que de la rescuciter.
Je vais un peu mieux. On veut me conserver ma dent. J’ai main tenant deux dentistes, Dieu sait pourquoi.
Mad. de Boigne est venue hier. Je ne l’ai pas trouvée trop changée. Quoiqu'il se fut passé 1 an 1/2. Je n’ai rien à vous dire de nouveau du tout. Je n’attends rien de la motion de Disraeli, tout avorte. Adieu. Adieu.
7. Paris, Vendredi 3 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Vos lettres m’arrivent, en général fort tard. Celle d’hier (N°4) m'est arrivée si tard qu’il n’y avait pas moyen de rien ajouter à ce que je vous avais écrit le matin (N°6).
Vos yeux me désolent. Je ne puis croire que ce soit une épidémie ophtalmique spéciale à Bruxelles. Je n’ai jamais entendu parler de rien de semblable dans le climat. Mais tout est possible. Je crois plutôt à l'effet du chagrin, de l’agitation et de la fatigue sur un organe délicat. Vous me mettez à une épreuve intolérable en me parlant, comme d’une chance possible de votre retour immédiat à Paris. Je n'ai rien à dire de l'effet à Pétersbourg, vous seule en êtes juge. Les mots : " êtes-vous encore à Paris ? " m'ont malheureusement trop démontré qu’on ne voulait pas que vous y fussiez ici. On serait certainement étonné, et comme on ne comprendrait pas, on chercherait, à ce retour, d’autres motifs que le véritable ; on ne croit guère en général aux motifs de santé, quoique ce soient les meilleurs. Trop de gens s'en servent pour me nier.
Quoiqu’on ne soit pas ici, plus en goût de la guerre qu’il y a deux mois, on y croit, et on en prend son parti, et on s'y prépare, et tout le monde règle, sur le fait, ses relations et ses plans. Je vous dis, malgré moi et tristement, mes premières idées ; je n'ai encore causé avec personne ; mais je doute que, parmi vos amis sensés et sincères, il y ait une autre impression que la mienne. Vient toujours, en première ligne votre santé, et dans ce fait là, j’ai tant de peine à voir clair, quand vous êtes ici, qu’il m’est impossible de l’apprécier de loin. Que tout cela est triste !
Demain, plus encore que tout autre jour, je voudrais être avec vous, et vous donner quelques douces distractions. Votre fidélité à de chers souvenirs m'a profondément touché dès le premier jour où je vous ai connue. C'est une vertu qui coûte cher, mais que j’aime et que j'honore infiniment. Les coeurs sont si légers, et tout passe si vite dans ces ombres chinoises de la vie !
Autre tristesse en pensant à vous. Vous avez de la religion, et elle ne vous sert pas à grand chose dans vos épreuves, vous n'y puissiez guère de consolation ni de force. En tout, le mal vous fait plus de mal que le bien ne vous fait du bien, et vous souffrez plus de vos défauts que vous ne profitez de vos qualités. Que de choses il aurait fallu pour mettre en vous l’équilibre et l'harmonie dont vous auriez besoin. Adieu, adieu.
Je ne vous dis rien du discours Impérial. Il ne faisait pas grand effet hier, ni le matin, ni le soir. Il aura le sort de presque tout ce que dit et fait son auteur ; il réussira plus dans les masses que dans les esprits difficiles. Si j'étais allemand, j'en serais mièvrement content. Adieu.
J’ai vu hier Montalembert qui m'a beaucoup parlé de vous, avec un intérêt dont je lui ai su gré.
7. Saint-Germain, Vendredi 17 juillet 1846, Dorothée de Lieven à François Guizot
Me voici depuis hier assez bien casé, et assez bien de santé ! Il fait froid. Cela m’étonne, beaucoup et ne me déplait pas. Madame Danicau est une personne très utile, avec toutes les vertus qui me manquent. Cela me rendra ma vie ici plus confortable. Elle a de l’autorité du savoir faire, et elle est pleine de désir de me plaire sans m’incommoder. J'attends votre lettre. Je vous en prie ayez soin de vous. A Trouville il y a peut être quel qu'assassin, ou en route. Quand vous êtes loin j’ai peur de tout pour vous, quand vous êtes près j’ai peur aussi mais cela va mieux, il me semble que je suis là pour parer le coup. Voici votre lettre d’hier. Certainement faites dire à Palmerston par Jarnac exactement ce que vous m'écrivez. C'est de la franchise, de la loyauté, dans ma première affaire, & la plus grosse entre vous. Cela éclaire d'emblée votre position avec l'Angleterre sur ce point capital, & vous donne une bonne base. Tout le tort sera à lui s’il n’accepte pas cela. Fleichman vient dîner avec moi aujourd’hui. Hervey viendra diner dimanche. Dites moi si vous avez quelque chose à les faire insinuer ou dire. Il est très confiant, très bien, & moi aussi je suis bien pour lui, en m'observant toujours comme avec tout le monde. Il n’aime pas beaucoup Palmerston. Cowley lui a dit que ses amis à Londres n'aiment pas qu'il donne sa démission, et au fait il ne l’a pas donné d'une manière franche. Lettre particulière simplement et en demandant à Palmerston si cela lui convient. Adieu. Adieu. On demande ma lettre. Je vous prie, je vous prie, prenez soin de vous. Mes yeux vont mieux, mais je les ménage beaucoup. Adieu encore. Êtes-vous un peu surveillé ? Adieu.
7. Schlangenbad, Mercredi 9 juin 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
Je vous envoie l’épitaphe fait par Meyendorff sur le tombeau du D. Schwarzenberg. Cela vient à propos de votre discours sur celui de Morny. Les journaux ne nous le donnent pas encore dites-moi un mot sur ce que je vous envoie là.
Meyendorff est bien sensible à votre opinion. Je suis sûre qu’il vous plairait extrêmement si vous le connaissiez. A mon gré il est charmant seulement il sait trop de choses et moi je n’en sais qu’une c’est encore comme cela ! En faisant ma toilette hier soir pour aller chez l’Impératrice je me suis trouvée mal. Tout simplement une excessive fatigue. Au lieu de sortir, je me suis couchée. Je n’ai pas dormi ou très mal. J’ai l’esprit tracassé de deux choses mes fils, c’est la plus grosse et puis que devenir, où aller, avec qui ? Qui me ramènera à Paris ? Qui prendra pitié de moi jusque là ? Pour toute ressource Emilie, Jean & Auguste.
Pauvre femme d'esprit, comme je sais arranger mes affaires ! Et bien voyez-vous tout cela m'empêche de dormir. Je m'agite, & je crois fermement que je suis venue mourir à Schlangenbad. Ecoutez, à toute extrémité, si suis absolument privée de toute ressource pourrez-vous m'envoyer votre petit ami ? Vous comprenez les inconvénients, mais j’aime tout mieux que l’abandon total absolu et c'est là où je vais être plongée dans 18 jours. Ceci est un tourbillon, après le néant.
Je viens de causer avec quelqu’un qui a parlé avec l’Empereur il y a 3 jours à Varsovie. L’Empereur très content du Président souhaitant vivement qu'il continue comme il fait.
8 heures. J’ai été couchée tout le jour, quoique toujours en causeries. Je me relève pour aller chez l’Impératrice. J’espère ne pas tomber comme hier. Vos lettres m’arrivent bien, mais les nouvelles, vous n'en faites pas. Adieu. Adieu.
7. Stafford House, Jeudi 13 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
J’attends 1 heure de la poste, depuis Samedi j’ignore tout, même que vous ayez pensé à moi ! J’ai passé hier la matinée sur mon lit. Je vis cependant quelques personnes. Le duc de Sutherland d’abord qui ne manque jamais de venir s’assurer si je vis encore. La duchesse dans toute sa gloire car elle accompagnait la reine pour la première fois à une cour qu’elle a tenu à de St James. Lord Lansdowne, et puis lord Aberdeen. Je refusai tous les autres même lord Grey, au risque d’une grosse querelle avec lui aujourd’hui. Lord Londonderry est déjà prêt à se battre. Il m’écrit les lettres les plus extravagantes mais vraiment il me fatigue, son esprit est lent comme sa parole, comme ses gestes et je n’ai pas de temps à perdre. Nous sommes un peu sortis de la politique hier Lord Aberdeen et moi. C’est un homme avec lequel il serait possible. de causer comme on cause avec vous mais cela demande un peu de travail. D’ailleurs quoique il vous ressemble en fait d’infortunes, & les siennes surpassent toutes les autres. C’est un sujet qui lui fait horreur. Il renferme tout, et son visage d’ Othello va fort bien avec ce mouvement d’épouvante sombre par lequel il repousse toute allusion à ses malheurs. je m’arrête tout court.
La poste est venue, et je n’ai pas de lettres ! Me voilà démoralisée pour le reste de la journée. Je serai mauvaise pour vous pour tout le monde. Monsieur ne me laissez pas sans lettre. Mon imagination cherche le choléra, la peste, un accident de route, la main droite foulée. Elle rencontre tout, elle ne saurait rencontrer l’oubli, mais Je suis triste jusqu’au fond de l’âme.
Faut-il reprendre ma journée d’hier. Vous intéresse-t-elle ? Monsieur vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas comment l’inquiétude peut s’emparer de mon âme & comme un rien peut faire naître cette inquiétude, et ce que je deviens alors ? La petite princesse vint me voir hier deux fois. Nous parlâmes de mon coin autour du tapis rouge. Que je le regrette ! Je dînai seule avec Lady Cowper. Elle est à peu près consolée. Elle l’est trop. Elle a été mariée 35 ans. Je crois qu’elle se mariera dans dix mois ! Je ne vis mon fils hier qu’à 10 heures du soir. Je le renvoyai à onze pour me coucher. Tout le monde était hier à un grand bal. On m’accable d’invitations à dîner surtout je ne suis pas capable. de tout cela. Je n’accepte que les plus indispensables. Je suis fatiguée, je suis triste, comment ai-je pu quitter Paris ? Me connaitre si peu ? Ah que de pensées qui m’étouffent. J’écrirais des volumes, que je n’expliquerais pas tout ce qui remplit mon cœur. Je ne me crois pas capable d’attendre la fin de septembre. Je ne comprends plus aucun obstacle. Ah Monsieur la pauvre tête que la mienne et que j’ai tort de me montrer à vous si faible, si faible ! Qu’allez-vous penser de moi ?
4 heures. Voici un mot, un seul mot de dimanche soir sans N°. Mais quel bonheur qu’un mot, & comme celui que vous me dites me prouve que nous nous entendons ! Car vous étiez inquiet. Alors comme je l’étais ce matin. Monsieur que je vous remercie d’avoir été inquiet, cela m’enchante. Vous n’en avez pas plus de raison que moi, et cette ressemblance aussi est bonne.
Vendredi 14 9 h. Lord Grey entrait lorsque je traçais hier les derniers mots. " You seem in great spirits, shall you be more gracious to me to day ?" Je ne vois pas de raison pour remplir ce voeu, mais il est vrai que j’étais in great spirits. Un rien m’abat, un rien me relève. Mais ce n’était pas rien hier. C’était bien une petite feuille de papier que je tenais. serrée entre mes doigts, & qui valait pour moi tous les trésors.
Le P. Esterhazy m’a tenu longtemps hier matin. Il a réclamé la chambre à coucher parce qu’on est à l’abri des interrupteurs. C’est un homme d’esprit, pas du tout de l’école du prince de Metternich dans la manière, mais avec beaucoup de finesse, toute le finesse de son chef & moins de vanité & de préventions que lui. Il me fit faire quelques découvertes dans un horizon lointain. Il n’y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Après lui vint votre Ambassadeur ; celui-là n’ont pas les privautés (dit-on privautés) du bed room. Cela ne va ni à son air solennel ni notre courte connaissance. Il me fit plaisir hier cependant, car nous arrivâmes naturellement sur un sujet qui me fait bondir le cœur. Ce sujet fut traité du côté le plus grave ; j’écoutais avec curiosité & joie. Quand on est bien écouté, on parle... J’aime beaucoup M. Sébastiani. Après tout ce monde j’eus quelques autres visites & puis je fermai ma porte pour aller faire un tour en phaéton avec lady Clanricarde qui m’avait attendue dans le jardin pendant une heure. Je reçus d’étranges confidences qui me prouvent qu’il y aura bien des défections dans les rangs réputés ministériels et que les élections peuvent avoir un résultat inattendu par les ministres dans 15 jours tout sera résolu, & ce sera un moment grave.
Hier il y eut un grand dîner Tory à Stafford house. Nous reprîmes le duc de Wellington et moi, nos vieux souvenirs de la cour de George IV. Lui et moi nous sommes inépuisables sur ce chapitre et tous nos souvenirs sont communs. Il a bien baissé cependant le duc. Il me fait l’effet d’un vieux cheval arraidi (sic) par l’âge, ce qui ne l’empêche pas d’avoir encore l’air galant. Lord Aberdeen ne me quitte pas de toute la soirée. Il fut d’un profond étonnement lorsque je lui dis, ce qui était vrai, que j’avais souvent Milton le matin. Je vous l’annonce Monsieur j’y avais cherché ce que vous me citiez un jour. Je sus répéter quelques vers à Lord Aberdeen. Cela le mit dans de véritables transports. Je ne pensais pas à lui en les disant. Il ne songeait sans doute pas à moi en les écoutant. Mais je vis que j’étais pour lui une nouvelle découverte, que je lui apparaissais sous un jour si inattendu que sa surprise pouvait prendre toutes les formes. " God is thy law, then mine." Voilà sur quoi ma mémoire s’était le plus fixée. Il trouvait plus beau ceci. "He for god only, she for god in him" J’aime la seconde idée de ce vers, je ne suis pas aussi contente de la première je crois que vous serez de mon avis. Quoi ? Elle n’aurait rien en donnant tout ? Retournez à ma première citation & continuez les trois vers qui suivent, je les aime, je les comprends. A propos et pour terminer tout à fait le sujet, Milton est bien heavy, & je crois que j’ai fini avec lui, à moins que vous n’en ordonniez autrement.
J’ai eu des nouvelles de M. de Lieven. L’Empereur n’avait pas encore décidé entre Kazan & Carlsbad. Moi il me vient quelques fois à l’idée que ce pourrait bien n’être ni l’un ni l’autre, mais la Tamise.
Ah Monsieur, imaginez que mon cœur se serre à cette pensée- là. Mon Dieu pardonnez-moi. Il me semble qu’il me pardonne, car je ne trouve rien que de pur, si pur au fond de mon âme. Je la regarde bien mon âme. Je l’aime. Je la trouve meilleure qu’elle ne m’a jamais semblé. Monsieur donnez-moi du courage. Dites moi que j’ai raison. Je vous écris de la plus étrange manière du monde. On m’interrompt vingt fois, je change de résidence emportant partout ma feuille de papier avec moi & la continuant tantôt dans le salon tantôt dans le jardin où il y a un petit établissement pour écrire. Voilà ce qui fait que vous verrez une phrase écrite avec deux encres différentes. Ces interruptions sont insoutenables. & Dieu sait les sottes lettres que je vous fais en conséquence. Mais cela vous est égal n’est-ce pas ?
Hier le jardin fut illuminé. Il l’est au gaz. C’est magnifique. Rien de plus. Compte tenez que tout cet établissement. C’est royal. Le jardin me parût de trop hier au soir. J’y aurais été si c’était Chateney quand on alla s’y perdre Je rentrai dans mon appartement, mais je ne dormis pas Je rêvai éveillée, de quatre à 6 heures. Je crois que j’ai eu la fièvre, mais elle ne me fit pas de mal. Je pensai au mois de septembre il y a quelque idée d’envoyer la jarretière au roi Louis-Philippe. Mais cette idée rencontre une forte opposition de la part de quelques vieilles têtes. Je vous parle toujours du quartier ministériel. Car les autres ignorent tout. La Reine ne consulte sa mère en rien. Elle est très absolue la Reine. Cela pourra donner du souci. je fais demander aujourd’hui à la reine de me recevoir. Je me sens mieux. & il faut que je fasse ma tournée de principes.
Adieu. Monsieur Adieu. Le petit mot me suffisait pour hier, mais vous ne me laisserez pas vivre longtemps sur cela seulement. Adieu.
7. Val-Richer, Dimanche 16 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il faut pourtant que je vous parle un peu d’autre chose. L’Angleterre me préoccupe beaucoup. Je prends à ce qui la touche, un vif intérêt, bien plus vif depuis un mois. C’est un noble peuple moral de cœur et grand dans l’action. Il a su jusqu’ici respecter sans se courber, et s’élever sans rien abaisser. Qu’il ne change pas de caractère. Il en changera, s’il tombe sous l’empire des idées radicales. Je ne sais pas bien quelles réformes exige en Angleterre l’état nouveau de la société. Je crois qu’il en est d’indispensable, et qu’il y aurait folie à les contester obstinément. Je m’inquiète peu d’ailleurs des réformes, quelque difficiles qu’elles soient. C’est le métier des gouvernements de faire des choses difficiles et de s’adapter à la société ! Ce dont je m’inquiète c’est des idées et des passions au nom desquelles les réformes se feront. Si ce sont les idées radicales, les passions radicales, qu’on ne parle plus de réforme; c’est de révolution, c’est de destruction qu’il s’agit. Les idées radicales, les passions radicales c’est la souveraineté brutale du nombre, la haine jalouse des supériorités, la soif grossière des jouissances matérielles, l’orgueil aveugle des petits esprits ; c’est la collection de toutes les révoltes, de toutes les ambitions basses contenues en germe dans toute âme humaine et que l’organisation sociale a précisément pour objet d’y comprimer, d’y refouler incessamment. Ambitions, révoltes dont jamais un gouvernement, quelques réformes qu’il fasse ne doit arborer le drapeau, emprunter le langage, accepter l’impulsion ; car ce jour là, il n’est plus gouvernement ; il abdique sa situation légitime, nécessaire ; il parle d’en bas il est dans la foule, il marche à la queue. Et toutes les idées, tous les sentiments naturels, instinctifs, sur lesquels reposent la force morale du pouvoir et le maintien de la société, s’altèrent, se perdent ; et, spectateurs ou acteurs, les esprits se pervertissent, les imaginations s’égarent, les désirs désordonnés s’éveillent ; et un jour arrive où l’anarchie éclate comme la peste, où non seulement la société mais l’homme lui-même tombe en proie à une effroyable dissolution. Les Whigs, à coup sûr, ne veulent rien de tout cela et très probablement beaucoup de radicaux eux-mêmes n’y pensent point.
Mais tout cela fond des idées et des passions radicales ; tout cela montera peu à peu du fond à la surface, et se fera jour infailliblement si les idées et les passions radicales deviennent de plus en plus le drapeau et l’appui du pouvoir. Les Whigs, en s’en servant, les méprisent ; les Whigs sont éclairés, modérés, raisonnables. Je le crois, j’en suis sûr. Et pourtant quand j’écoute attentivement leur langage, quand j’essaye d’aller découvrir au fond de leur pensée leur credo politique, je les trouve plus radicaux qu’ils ne s’imaginent, je trouve qu’ils prêtent foi, sans s’en bien rendre compte, aux théories radicales, qu’ils n’en mesurent pas du moins avec clarté et certitude, l’erreur et le danger. Leur modération semble tenir à leur situation supérieure, à leur expérience des affaires, plutôt qu’au fond même de leurs idées. Ils ne font pas tout ce que veulent les radicaux ; mais, même quand ils les refusent, ils ont souvent l’air de penser comme eux. Et c’est là ce qui m’inquiète, c’est sur cela que je voudrais les voir inquiets et vigilants eux-mêmes. Car il y a beaucoup de Whigs, et beaucoup de choses dans le parti Whig, que j’honore, que j’aime, que je crois très utiles, nécessaires même à l’Angleterre dans le crise où elle est entrée. J’ai un désir ardent qu’elle sorte bien de cette crise qu’elle en sorte sans bouleversement social, que son noble gouvernement, mis à cette rude épreuve s’y montre capable de se conserver en se modifiant, et de défendre la société moderne contre les malades qui la travaillent en réformant lui-même ses propres abus. Ce serait là, Madame, une belle œuvre, une œuvre de grand et salutaire exemple pour tous les peuples. Mais elle est difficile, très difficile ; et elle ne s’accomplira qu’autant que le venin des idées et des passions radicales, qui s’efforce de pénétrer dans le gouvernement en sera au contraire bien connu et bien combattu. Que Whigs et Tories se disputent ensuite le pouvoir, ou (ce qui serait plus sage) se rapprochent pour l’exercer ensemble, tout sera bon, pourvu que les vieilles dissidences, les vieilles rivalités, les aigreurs & les prétentions purement personnelles se laissent devant le danger commun.
Vous voyez Madame, que moi aussi j’ai mes utopies. Si vous étiez ici je vous les dirais. Vous êtes loin; je vous les écris. Quelle différence ! vos lettres sont charmantes ; mais votre conversation c’est vos lettres plus vous.
Lundi 17. Dix heures du matin.
Je continue, Madame, seulement je reviens d’Angleterre en France. Vous m’avez quelques fois paru étonnée de l’ardeur des animosités politiques dont je suis l’objet. Laissez-moi vous expliquer comme je me l’explique à moi-même, sans détour et sans modestie. Je n’ai jamais été, avec mes adversaires violent, ni dur. A aucun je n’ai fait le moindre mal personnel. Avec aucun je n’ai eu aucune de ces querelles d’homme à homme qui rendent toute bonne relation impossible. Mais le parti révolutionnaire radical, qui s’appelle le parti libéral, avait toujours été traité, par ceux-là même qui le combattaient avec un secret respect. On le taxait, d’exagération, de précipitation ; on lui reprochait d’aller trop, loin trop vite. On ne lui contestait pas la vérité de ses Principes, la beauté de ses sentiments et l’excellence de leurs résultats quand le genre humain serait assez avancé pour les recevoir. Les partisans absolus de l’ancien régime étaient seuls, quant au fond des choses, ses antagonistes déclarés, et ceux-là, il ne s’en souciait guère. Le premier peut-être avec un peu de bruit du moins, j’ai attaqué le parti de front ; j’ai soutenu que presque toutes ses idées étaient fausses, ses passions mauvaises, qu’il manquait de lumières politiques, qu’il était aussi incapable de fonder les libertés publiques que de manier le pouvoir; qu’il n’avait été et ne pouvait être qu’un artisan passager de démolition, que l’avenir ne lui appartenait point ; qu’il était déjà vieux, usé ne savait plus que nuire, et n’avait plus qu’à céder la place à des maîtres plus légitimes de la pensée et de la société humaine. C’était là bien plus que combattre le parti ; c’était le décrier. Je lui contestais bien plus que le pouvoir actuel ; je lui contestais tout droit au pouvoir. Je ne lui demandais pas d’ajourner son empire ; j’entreprenais de le détrôner à toujours.
La question entre le parti et moi, n’a peut-être jamais été posée aussi nettement que je le fais là. Mais il a très bien démêlé la portée de l’attaque. Il s’est senti blessé dans son amour propre menacé dans son avenir; et il m’en a voulu infiniment plus qu’à tous ceux qui demeuraient courbés sous son joug en désertant sa cause et le flattaient en le trahissant. Je ne parle pas des accidents que j’ai essuyés dans cette lutte, ni des rivalités où je me suis trouvé engagé. Ce sont là des causes d’animosité qui se rencontrent à peu près également dans la vie de tout homme politique. Mais s’il y en a une qui me soit particulière et vraiment personnelle, c’est celle que je viens de vous indiquer.
Croyez-moi Madame ; n’ayez nul regret, pour moi à cette situation. Sans doute elle m’a suscité et me suscitera peut-être encore des difficultés graves. Mais elle fait aussi ma force; elle fait s’il m’est permis de le dire, l’originalité et l’énergique vitalité de mon influence. Dans cette guerre raisonnée systématique, que je soutiens contre l’esprit révolutionnaire, les chances, j’en suis convaincu, sont pour moi comme le bon droit.
L’esprit révolutionnaire, nous menacera encore longtemps ; mais il nous menace en reculant, & l’avenir appartient à ceux qui le chasseront en donnant à la société nouvelle satisfaction et sécurité. Et puis vous savez bien que vous m’apprendrez tous les soins, toutes les douceurs par lesquelles on peut prévenir les animosités politiques, ou les atténuer quand elles existent déjà.
2 heures Quelle lettre, bon Dieu ! Un vrai pamphlet politique ! Mais aussi pourquoi m’avoir fait si rapidement contracter l’habitude, et bien plus encore le besoin de penser tout haut avec vous et sur toutes choses ? Pourquoi mon esprit va-t-il à vous des qu’il se met en mouvement ? Je sais bien le parce que de tous ces pourquoi ; mais je ne vous le dirai pas aujourd’hui. Et pourtant c’est ce qui me plairait le plus à vous dire. Mais c’est aussi ce qui m’ entraînerait plus vite & plus loin que toute la politique du monde.
Adieu donc, Madame adieu, quoiqu’en vérité je ne vous aie rien dit aujourd’hui qui réponde à ce qui remplit et occupe réellement mon âme. G.
7. Val-Richer, Jeudi 24 mai 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je reviens à Andral. Il faut le voir toutes les fois qu’il survient, dans votre santé quelque chose de nouveau. Cette enflure de la bouche et du palais indique ordinairement quelque irritation d'estomac. Un régime spécial vous soulagerait. L’avis d’Andral et la surveillance quotidienne d'Olliffe doivent aller ensemble.
J’ai une lettre de Macaulay, toute littéraire et en compliments sur l'ouvrage de mon fils quelques mots seulement qui laissent entrevoir un assez grand dégoût de la politique et une grande incertitude dans la prévoyance de l'avenir. Les chances de la campagne qui va s'ouvrir me touchent infiniment pour les braves soldats qui ont à les subir très peu dans l’intérêt de la paix. Elles ne l’amèneront en aucun cas. Si nous sommes vainqueurs, vous ne céderez point ; si vous êtes vainqueurs, nous ne céderons point. Nous ne pouvons nous faire réciproquement assez de mal pour que l’un ou l'autre parti soit forcé à la paix. Il n'y a point d’issue à la voie dans laquelle on s’est engagé. On vous demande une garantie matérielle que vous ne donnerez pas, et qu'à moins de prendre Sébastopol on ne se donnera pas soi-même. Il faut en revenir aux garanties diplomatiques aux engagements de votre part aux traités d'alliance entre les puissances occidentales contre vous, si vous manquez à vos engagements. Cela seul peut conduire à la paix. Plus j’y pense, plus la neutralité de la Turquie, acceptée par les uns et garantie par quatre, ou par trois, ou seulement par deux, me paraît la seule solution praticable et efficace, autant qu’il peut y avoir quelque chose d'efficace pour prolonger la vie d’un mourant incurable.
Je regrette que M. Gibson et ses amis n'aient pas un peu poussé les ministres pour leur faire dire, si leurs perspectives de paix étaient vraiment sérieuses. Ils n'auraient dû renoncer à la motion qu’en obtenant à cet égard, des paroles un peu signi ficatives. Onze heures Je suis encore bien plus fâché du retrait de la motion Gibson si c’est l'effet de la peur devant les journaux et les cabarets. Quelle pitié ! Adieu, Adieu. G.
7. Val-Richer, Samedi 18 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Où êtes-vous à St Germain ? Je suppose au Pavillon de Henri 4. Vous ne me l’avez pas dit. J'espère que vous y avez plus beau temps qu’il ne fait ici ce matin. Ma vallée est sous un voile de pluie. C'est ennuyeux pour aller à Trouville. J’y vais pourtant. Je pars à onze heures. Le soleil percera peut-être d’ici-là. Le temps est très variable depuis deux jours. Je vous dirai demain matin ce que j'aurai trouvé pour vous à Trouville. On dit que la maison où ma fille, et Mlle Wislez vont s’établir est la meilleure de l’endroit, la plus confortable, par la vue, et au dedans. Elles ont le projet de s’établir au second étage et de laisser le premier disponible. Je vous dirai quand j'aurai vu. L’aide de Guillet y sera. Facilité de plus.
Le Roi fait venir du château d’Eu son portrait en pied par Winterhalter, et le donnera à Lord Cowley. A propos de portrait, il a fait faire, en porcelaine, à Sèvres, d’après Winterhalter, deux très beaux portraits de la Reine Victoria et du Prince Albert, pour Windsor. Mais à la dernière cuisson, une crevasse s’est déclarée dans celui du Prince Albert, ce qui sera difficile à réparer. Peut-être faudra-t-il recommencer ? En attendant. celui de la Reine est parti. On dit que c’est un chef d’œuvre.
Le Roi a été frappé de la dépêche de M. de Nesselrode sur les croix. Voici sa phrase : " Cela est gracieux. Il y a quelque progrès ; mais je doute fort que cela aille plus loin. " L’idée de l’initiative franche avec Londres pour l’un des fils de D. François de Paule est fort approuvée. Je vais la mettre à exécution, lundi probablement. J'en écrirai en même temps à Madrid et à Naples. La Reine Christine m’a mis bien à l'aise à Naples en faisant attaquer elle-même dans ses journaux, par son secrétaire Rubio, la candidature de son frère Trapani, et en en rejetant sur nous la responsabilité. C'est bien elle qui l'abandonne et la tue. Je réserverai pour cette combinaison-là, comme pour celle de Montemolin, les chances de retour, toujours possibles avec un tel monde. Je maintiendrai notre principe tous les descendants de Philippe V si seulement, nous nous portons selon les termes, vers celui qui peut réussir, favorable à celui-là sans en abandonner aucun. Rien encore de Londres qui indique avec un peu de précision ni sur cette question-là, ni sur aucune autre, le tour que va prendre Palmerston. La réserve des Whigs est extrême. En tout, la situation donnée, je ne trouve pas leur début malhabile. Ni de mauvais air. C’est assez tranquille, et sensé. Avez-vous remarqué ces jours-ci un article du Morning Chronicle qui n'aura pas fait plaisir à Thiers ? On lui donne poliment son congé, comme War-party. N’avez-vous rien reçu de Lady Palmerston ? Avez-vous écrit à Byng ? Mad. Danicau sait-elle vous lire le Galignani ? Le Prince de Joinville et sa flotte, et sa rencontre là, avec le Duc d’Aumale, ont fait grand effet à Tunis. Nos affaires sont bonnes à l'est et à l’ouest de l'Algérie. Après son apparition devant Tripoli, il (Joinville) ira à Malte, de là à Syracuse, de là une visite au Roi de Naples, puis une au grand Duc à Florence, puis une au Pape à Rome. Tout sauvages qu’ils sont, ces Princes là se montrent volontiers quand il y a quelque effet à faire. Ils se regardent bien comme les serviteurs du pays et obligés de soigner ses intérets et sa grandeur. Le comte de Syracuse passera, dit-il, l’hiver prochain à Paris. Il va parcourir la France, en attendant. Voilà mon sac vidé. Mon cœur reste plein. Loin de vous, il se remplit de plus en plus. Nous nous croyons bien nécessaires l’un à l'autre. Nous le sommes plus que nous ne croyons.
9 heures Je vais déjeuner et partir pour Trouville. Bon petit billet de St. Germain. Je suis content de vos yeux et de Mad. Danicau. Bonnes nouvelles de Londres même sur l’Espagne. Ce demain les détails. Je suis pressé. Soyez tranquille. Rien à craindre que la pluie. Adieu. Adieu. Adieu. G.
7. Val-Richer, Vendredi 18 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
7 heures
Dans quatre jours, je serai en route vers vous. Dans cinq. je serai près de vous. Comment se quitte-t-on quand on a un tel plaisir à se retrouver ? Nous avons bien peu de sens et de volonté. Nous sommes à la merci de ce qui ne nous fait rien. Nous sacrifions sans cesse le fond à la surface. Dieu doit nous prendre en grande pitié. J'écris ce matin, au Président d’âge de mon Conseil général pour lui dire que je n'irai pas, et pourquoi. C’est une réunion qu’il faut traiter avec égard. J'écris aussi à quelques membres, pour leur recommander les affaires des cantons que je représente et qui pourraient bien être négligées en mon absence.
Vous ne comprenez rien à ce que je vous dis là, et cela ne vous fait rien. Vous êtes la personne la plus étrangère aux détails de toute situation, de toute vie qui n’a pas été la vôtre. Et pour la vôtre, personne ne comprend et ne soigne mieux que vous les détails, et la pratique de tous les moments. Vous resterez comme vous êtes, et c’est ce qui me plaît. J’ai renvoyé hier à Désages ma dépêche pour Chabot avec le changement désiré. J’avais voulu que le changement fût approuvé à Eu précisement parce que la dépêche n’avait été vue qu'après avoir été envoyée. Elle sera de retour, à Londres après demain, et j'espère qu’elle y sera le point de départ d’une politique un peu nouvelle. Je mets beaucoup de prix à changer, sur l’Espagne la vieille politique de l'Angleterre par intérêt public et par orgueil personnel.
Vos conversations avec Bulwer ont été excellentes. J’ai écrit à Flahault pour qu’il se gardât un peu du Prince de Metternich à qui évidemment notre succès ne plaît guères, et qui veut trop le mariage D. Carlos et pas du tout le mariage Aguilla. J'ai peur que Flahault ne soit aussi trop bien avec lui et n'évite trop d’avoir un autre avis que le sien. Espartero est donc décidément à Bayonne. S'il ne fait comme sa femme, que traverser la France pour aller en Angleterre, peu m'importe. Mais s’il entendait rester en France, il y aurait à y bien regarder D. Carlos, Christine et Espartero ! En attendant, j’ai écrit au Ministre de l’Intérieur qu'il ne fallait à aucun prix, le laisser séjourner près des Pyrénées. Au moins aussi loin de l’Espagne que Bourges. On m'écrit de presque tous les points de l’Espagne que sa fuite précipitée, quand la dernière bombe venait à peine de tomber sur Séville fait baisser la tête de honte à tous ses partisans.
10 heures et demie M. de Beauvoir, un jeune attaché fort intelligent m’arrive à l’instant de Londres. Chabot me dit de le faire causer et qu’il est fort au courant. Sa conversation est bonne. Lord Aberdeen ne demande pas mieux que de se concerter avec nous et de nous aider en fait, à réussir dans le mariage Philippe V. Tout ce qu’il désire, c’est que nous lui épargnions le calice du principe. J’en suis d'accord et ma dépêche est partie. M. de Beauvoir croit qu’elle sera acceptée avec joie et mise en pratique. Sur ce adieu, car il faut que je renvoie le jeune homme à Paris, et j’ai encore plusieurs lettres à écrire. Adieu. A mardi. Je serai à Auteuil avant 4 heures. Adieu. G.
Voilà votre n°9. N'ayez donc pas de point de côté. Ne vous levez pas sans vous couvrir. Il ne faut pas être si remuante quand on est si délicate. Adieu. Adieu.
7. Val Richer, Vendredi 3 juin 1853, François Guizot à Dorothée de Lieven
Il y a trop d'humeur dans cette parole : " La Belgique épouse l’Autriche ; moi j'épouserai la Suisse. " Pourquoi épouser quelqu'un ? Il y a des situations, où un gouvernement doit savoir vivre en garçon, et où il peut trouver beaucoup de force dans la vie de garçon. Pourvu qu’il soit un garçon sensé et rangé. D'ailleurs, il n’y a pas moyen d'avoir de l'humeur contre la Belgique sans en avoir contre l’Autriche et l'humeur contre l’Autriche me paraît bien mal entendue. C’est en Autriche, qu’on trouve le meilleur vouloir parce que c'est elle qui a le plus peur. Rien n’est plus sage et plus profitable que d'être amical pour ceux qui ont peur de vous ; ils vous en savent un gré infini.
Je ne comprends pas le dernier incident de l'affaire suisse. A quoi bon le départ du ministre autrichien s’il n’amène rien de nouveau ? Ce n’est que de l’excitation de plus pour le patriotisme suisse qui est très réel, quoique très vantard. Il ne faut pas animer les gens avec qui on ne veut pas se battre. Je ne m'expliquerais l'acte de l’Autriche que si elle avait envie d'être provoquée par la Suisse, ce que je ne suppose pas. Les feuilles d'Havas me disent qu’on recommence à négocier entre Vienne et Berne. Combien de temps faut-il au Prince Mentchikoff pour aller d'Odessa à Pétersbourg ? Nous n'avons rien à attendre de là avant qu’il y soit arrivé. Brunnow n’est pas propre à prendre le ton haut. Pour être digne, ce n’est pas assez de savoir être insolent. En revanche, il est très propre à supporter une mauvaise situation. Il a tout ce qu’il faut, pour cela, d’esprit, de souplesse et d’aplomb subalterne. Heeckeren à travers ses mauvaises manières, a plus d’esprit et de bon sens que la plupart de ceux qui se moquent de lui.
On m’écrit que M. Hébert a plaidé avec un grand succès dans l'affaire des correspondants des journaux étrangers. La cour me paraît avoir jugé avec équité et prudence ; elle a modéré les prétentions du gouvernement sans le désarmer. M. Villemain a lu chez son beau frère Desmousseaux de Givré devant une réunion nombreuse et varié, la seconde partie de son récit du 20 mars cette tragique séance de la Chambre des Pairs, après Waterloo, où le maréchal Ney proposa la déchéance de l'Empereur, contre les emportements du pauvre La Bédoyère. On dit que la lecture a eu du succès ; un mélange très piquant d'éloquence et de malice.
Onze heures
Pas de lettre, sans doute les embarras du départ. Vous me direz demain quel jour vous partez. Adieu. G.
Mots-clés : Politique (Analyse), Politique (Internationale), Politique (Russie)
7. Versailles, Mardi 5 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Merci de deux bonnes lettres hier. La seconde avec l'incluse de lady Cowley m'est arrivée tandis que j’étais à dîner avec Appony et Armin. Comme elle était fort innocente. Je leur ai donné le plaisir de la lire. C'était pour eux un treat. Ils sont venus de bonne heure, j’étais dans les bois en calèches avec Pogenpohl qui me tient fidèle compagnie pour la promenade et pour le dîner. Nous avons eu encore de la causerie avant le dîner à nous trois.
Vraiment Appony est impayable. Il me dit maintenant on ne pourra plus dire que c'est un caprice d'une petite fille curieuse puisqu’elle ne vient pas à Paris. On était tout juste lui il y a 3 jours. C'est de moi qu'ils ont su qu’elle n’y venait pas. car en ville on l’attend encore. Tous les deux m'ont dit avec bonne grâce " c’est plus flatteur puisque c’est personnel. " Enfin le ton était tout-à-fait changé. Mais j’arrive à l’essentiel. Tous deux m'ont parlé du mariage Espagnol. Vous ne serez pas sorti de votre voiture en arrivant à Paris qu’ils seront là pour vous presser au sujet du mariage Don Carlos. Armin en a reçu l’ordre formel de sa cour. Appony s’est longuement étendu sur le fait. Bon pour tout le monde. Bon pour l’Espagne puisque cela confond et réunit les droits et écarte les dangers d’une guerre civile que ferait naître un prétendant. Bon pour l'Angleterre pour la France (qui veut un Bourbon) pour toutes les puissances puisqu’elles sont d’accord sur la convenance et l’utilité de ce mariage. Bon encore pour l'Espagne puisque c’est la seule combinaison qui lui assure la reconnaissance immédiate de la reine par les 3 cours. Enfin rien de plus correct, de plus irréprochable, de plus désirable. J’ai dit amen. Mais deux choses, l’Espagne voudra-t-elle ? & Don Carlos voudra-t-il ? pour l'Espagne nous en sommes presque sûrs pour Don Carlos c’est difficile, mais si l'Angleterre & la France voulaient seulement concourir, l’Espagne serait sûre & on pourrait l’emporter à Bourges. Au reste ajoute Appony je vous dirai que Lord Aberdeen est excellent et qu'il a dit à Neumann qu’il était tout-à-fait pour le mariage Don Carlos, en êtes-vous bien sur ? Parfaitement sûr.
Nous sommes revenus à la visite de la Reine, à l’effet que cela ferait en Europe. Ils en sont tous deux curieux, au fond ils conviennent que cela ne plaira pas, que c’est comme une consécration de la diplomatie et que certainement pour ce pays-ci c’est un grand événement ; nous avons parlé de la Prusse, et moi j’ai parlé. du peu de courtoisie des puissances envers ceci. Appony s’est révolté ; comment ? Au fond la France nous doit bien de la reconnaissance si nous ne lui avons pas fait des visites au moins l’avons- nous toujours soutenue, toujours aidée. Le solide elle l’a trouvé en nous. C’est vrai mais les procédés n’ont pas été d’accord. Les princes français ont été à Berlin, à Vienne, d’ici on a toujours fait des politesses. On n’en a reçu aucun en retour, et depuis quelques temps vous devez vous apercevoir que le Roi est devenu un peu raide sur ce point. Alors Armin est parti. Le Roi a été très impoli pour nous. C'est une grande impolitesse de n’avoir envoyé personne complimenter mon roi quand il s’est trouvé l’année dernière sur la frontière. Nous avons trouvé cela fort grossier & M. de Bulow l’a même dit à M. Mortier (quelque part en Suisse) mais votre Roi n’avait pas été gracieux six mois auparavant. Il a passé deux fois à côté de la France sans venir ou sans accepter une entrevue. Oh cela, c'est Bresson qui a gâté l’affaire. Il a agi comme un sot. Il a voulu forcer la chose et l’a fait échouer par là. Je vous répète tout. Ensuite rabâchant encore sur Eu, Appony me dit au moins la Reine ne donnera certainement pas la jarretière au Roi. C’est cela qui ferait bien dresser l’oreille dans nos cours ! Pourquoi ne la donnerait-elle pas ? Vous verrez que non.
Ils ont ensuite parlé de la légion d’honneur au prince Albert comme d’un matter of course Je crois que j’ai expédié mes visiteurs dans ce qu’ils m’ont dit de plus immédiat. Faites donner la jarretière au Roi. Vous avez tous les moyens pour faire comprendre que cela ferait plaisir ici. Commencez par donner le cordon rouge au Prince. Mandez-moi que vous n'oubliez pas cette affaire. Car c’est une affaire.
Direz-vous quelque chose à Aberdeen de vos dernières relations avec ma cour ? Il ne faut pas vous montrer irrité, mais un peu dédaigneux ce qu'il faut pour qu'il sache que vous voulez votre droit partout. Cela ne peut faire qu'on bon effet sur un esprit droit et fier comme le sien. J'espère que vous êtes sur un bon pied d’intimité et de confiance et qu'il emportera l’idée qu'il peut compter en toutes choses sur votre parole. Faites quelque chose sur le droit de visite. N'oubliez pas de dire du bien de Bulwer. C'est bon pour lui en tout cas qu’Aberdeen sache que vous lui trouvez de l'esprit et que vous vous louez de son esprit conciliant.
Après le dîner que je fais toujours ici à cinq heures, j’ai été avec mes deux puissances faire une promenade charmante mais un peu fraîche en calèche. Ils m'ont quitté à 8 1/2 et comme je n’ai plus retrouvé Pogenpohl je suis allée finir ma soirée chez Madame Locke. J’ai passé une très mauvaise nuit. Mes attaques de bile. Décidément les dîners d'Auberge ne me vont pas et j’ai envie de m’en retourner aujourd'hui à Beauséjour.
10 heures. Génie, notre bon génie m’envoie dans ce moment votre n°4 excellent je vous en remercie extrêmement. Je suis bien contente de penser que tout va bien. Quelle bonne chose qu'Aberdeen ait vu le Roi, vous. Quel beau moment pour vous en effet. Je me presse, je remets ceci à ce messager, sauf à vous écrire plus tard par le mien. Adieu. Adieu. Adieu.
N’allez pas dire un mot à Aberdeen des vanteries d'Appony. C'est-à-dire ne dites pas que c'est moi qui vous le dis. Ne prononcez pas mon nom quand vous parlez affaires. Pardon vous savez tout cela, mais j’aime mieux tout vous dire, tout ce qui me traverse l'esprit. Adieu. Adieu à tantôt.
Pourquoi ne faites-vous pas donner la part du Diable ? C'est décidément charmant. Opéra comique.
Mots-clés : Circulation épistolaire, Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Diplomatie (Russie), Europe, Louis-Philippe 1er, Mariages espagnols, Politique (Espagne), Portrait, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Santé (Dorothée), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
8. Baden, Jeudi 8 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres m’arrivent ici à 2 heures c’est un charmant moment, j’ai bien soin de le passer seule. J’attends aujourd'hui les journaux avec impatience pour lire la discussion de lundi. Plus je pense à Tahiti et plus je me fâche. Vous vous êtes donné là une place éternelle, je ne crois pas que l’avantage de cette possession ou protectorat peut valoir les inconvénients incessants qu’elle vous suscitera. Il y aura d’autres Pritchard. Je suis curieuse des explications qui auront été échangées. Le blâme ou le regret de la conduite incivile de M. d’Aubigny peut bien se trouver dans une note, mais son éloignement ultérieur ne devrait pas s’y trouver, à moins que les Anglais ne vous aient dans le temps promis par note aussi l’éloignement de Pritchard, ce que j'ignore. Dans tous les cas ils ont bien peu tenu parole, et vous avez tout-à-fait le droit de les imiter certainement ni vous ni aucun ministre quelconque en France ne pourrait risquer. Je ne dis pas même le désaveu mais seulement l'éloignement de M. d'Aubigny dans ce moment. Vous savez bien cela. Vous savez aussi que les Anglais ne se feront aucun scrupule de publier votre note. Vous avez été plein de procédés et de ménagements pour eux. Ils ne vous imiteront pas, j'espère donc que votre réponse si elle est faite peut risquer le grand jour sans me faire évanouir de terreur. Je suis bien fâchée d’être loin car tout ceci me tracasse bien fort. Rassurez-moi un peu. Je crois que je vous ai écrit une lettre quelque peu anglaise, mais j’étais sous l'impression que Pritchard avait well deserved ce qui lui est arrivé ; j’avoue que je ne trouve pas cela dans ce que je lis dans les journaux. je suppose que les rapports officiels sont plus positifs. Je rabâche, vous n'avez pas besoin que je vous redise de Bade l’affaire de Tahiti. Lady Cowley wishes the whole island at the bottom of the sea !
La journée a été moins mauvaise hier. Il a parlé, & à deux reprises, j’ai même eu une assez bonne conversation avec lui. Il est possible que je le laisse ici vivant. Il est décidé que Constantin ne le quittera plus, que Mad. de Krudner viendra le rejoindre à Hambourg, et qu’il se rendra d'ici là à très petites journées. Il est très impatient de reprendre ses affaires. L'habitude de l'occupation et de l’agitation est plus forte que la maladie. Je le trouve sensé, modéré, et d’après ce qu’il me dit courageux. Le seul qui ose parler et qui le fasse.
Nesselrode bien poltron Orloff secondant mon frère mais en auxiliaire. Il déteste Brunnow et ne lui pardonne pas mon affaire. En tout il se montre non seulement quand il me parle, mais lorsqu'il cause avec Constantin, tout-à-fait mon ami et mon frère. Je ne sais pas vous rendre compte de mon temps. J’en ai de reste, et en même temps la journée est bien vite finie. Je vais chez mon frère trois, quatre fois le jour. Constantin, Hélène, Annette vont et viennent de chez lui chez moi. Et puis les médecins, les courtisans, on se redit chaque impression. Je me promène avec Constantin, à pieds ou en calèche. Je vais m'asseoir sous les arbres. Je dine seule. Je lis, si on me laisse seule. J’ai reçu un ou deux russes de la dernière insignifiance. Bacourt vient une heure avant mon dîner me raconter tout ce qu’il a lu dans tous les journaux. Nous rabâchons Tahiti ou autre chose. Voilà tout. Je me couche à 9 heures. Je me lève avent 7. Je pense à vous, je rêve à vous, je prie pour vous. Soyez bien sûr qu’à quelque moment du jour que vous pensiez à moi, vous me rencontrez. Adieu. Adieu. Adieu mille fois.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Diplomatie (France-Angleterre), Eloignement, Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Politique (France), Politique (Internationale), Pratique politique, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Réseau social et politique, Santé (famille Benckendorff), VIe quotidienne (Dorothée)
8. Bruxelles, Mardi 7 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Mes yeux me condamnent à l’obscurité. On me défend d'écrire, de lire, de sortir. Quelle misère, quel désespoir. J'ai eu un homme de lettre de Pétersbourg. Evidemment on eût désiré que je restasse encore à Paris. Quel regret pour moi. On ne le dit pas, je devine, peut être je me trompe, c’est que je suis si malheureuse je perds la tête. Ecrivez-moi. Adieu. Adieu.
La Prusse se rapproche de nous.
Mots-clés : Eloignement, Guerre de Crimée (1853-1856), Santé (Dorothée)
8. Château d'Eu, Mardi 5 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
6 heures et demie
Enfin j'en sais le terme. La Reine part jeudi par la marée du matin. Je ne vous ai peut-être pas conté, tout M. Salvandy. Je n’en ai pas eu et n’en ai pas le temps. Mais nous étions convenus qu’il reviendrait ici pendant mon séjour et que nous y viderions ce qui le regarde. Il n’est pas venu, quoiqu’il ait fait pour cela, la Reine étant à Eu. J’ai prié le Roi de l’inviter à dîner pour jeudi, la Reine partie. Et jeudi après le dîner et Salvandy réglé de 8 à 10 heures, je partirai pour être à Auteuil de 10 heures à midi vendredi. Quel long temps ! Pas perdu pourtant.
La Reine m'a reçu hier. Le Prince Albert d'abord ; la Reine s'habillait pour la promenade. Avec l’un et l'autre conversation parfaitement convenable et insignifiante. La Reine très gracieuse pour moi, je pourrais dire un peu affectueuse. Elle m’a beaucoup parlé de la famille Royale qui lui plaît et l’intéresse évidemment beaucoup.
Je venais de recevoir un billet de Duchâtel qui regrettait qu'elle n’allât pas à Paris où l'accueil serait excellent, brillant. Elle en a rougi de plaisir. Ceci m'a plu. Un seul mot de quelque valeur : " J'espère que de mon voyage, il résultera du bien. - Madame, c’est à vous qu'on le rapportera. "
Le soir, Lord Aberdeen s’est fait valoir à moi de n'avoir pas assisté à mon audience de la Reine. Elle l’en avait prévenu : " Notre règle voulait que je fusse là, mais j'ai dit à la Reine qu'avec un aussi honnête homme je pouvais bien la laisser seule. " Je lui ai garanti l’honnêteté de ma conversation. Sous son sombre aspect, Lord Aberdeen est, je crois, aussi content que la Reine de son voyage : " Il faudrait absolument se voir de temps en temps, me disait-il hier ; quel bien cela ferait ! " Nous avons causé hier de Tahiti et de la Grèce. Tahiti n’est pour lui qu’un embarras ; mais les embarras lui pèsent plus que les affaires. C’est un homme qui craint beaucoup ce qui le dérange, ou le gêne, ou l'oblige à parler, à discuter, à contredire et à être contredit. Il voudrait gouverner en repos. Evidemment la session n’a pas été bonne à Peel. Aberdeen m'a dit que sa santé en était ébranlée. " Pauvre Sir Robert Peel m'a dit le Prince Albert il est bien fatigué. " On en parle d’un ton d'estime un peu triste et d’intérêt un peu compatissant. Comme d'un homme qui n’est pas à la hauteur de son rôle et qui pourtant est seul en état de le remplir.
La promenade a été belle ; quelques belles portions de forêt, quoique très inférieure à Fontainebleau et à Compiègne. Mais les forêts sont nouvelles pour les Anglais. Un beau point de vue du Mont d'Orléans où le luncheon était dressé ; et là autour des tentes comme sur la route, beaucoup de population, accourue de toutes parts, très curieuse et très bienveillante.
De la musique le soir, Beethoven, Gluck, et Rossini, très peu de chants ; quelques beaux chœurs. On n’avait pas pu venir à bout de s'entendre sur l'opéra Comique. Au vrai, les acteurs voulaient jouer Jeannot et Colin, et n'avaient apporté que cela. Le Roi n’a pas voulu et il a eu raison. Mais il fallait qu'ils eussent apporté autre chose.
L’amiral Rowley à dîner. Son vaisseau, le St Vincent était venu saluer le château. Bonne figure de vieux marin Anglais ; bien ferme sur ses jambes et très indifférent. Le Duc de Montpensier a beaucoup de succès auprès de la Reine. Hier, pendant le dîner, il la faisait rire aux éclats. Il est le plus gai et le plus causant, de beaucoup. On voit que tout l'amuse. Mad. la Duchesse d'Orléans était de la promenade, et au luncheon, à la gauche du Roi. Avec M. le comte de Paris qui a infiniment gagné. Il a une physionomie sereine et réfléchie. Son précepteur m'en a bien parlé. La grande lettre n’est pas encore venue. Cela me déplait. Je n’aime pas à rien perdre.
Décidément Mad. la Princesse de Joinville est charmante. Tout le monde, vous le dira. Charmante de tournure et de physionomie. La mobilité d'un enfant avec la gravité passionnée d’un cœur très épris. Elle prend, quitte et reprend les regards de son mari, vingt fois dans une minute, sans jamais, s'inquiéter de savoir si on la regarde ou non, sans penser à quoi que ce soit d'ailleurs. Et cela avec un air très digne, ne paraissant pas du tout se soucier, si elle est Princesse et l'étant tout-à-fait.
Le Roi fait aujourd’hui présent à la Reine de deux grands et très beaux Gobelins (15 pieds de large sur 9 de haut) la chasse et la mort de Méléagre, d'après Mignard, e& d'un coffret de sèvres qui représente la toilette des femmes de tous les pays. C’est un présent très convenable. Une heure Le présent vient d'être fait et vu de très bon œil. Les deux tableaux sont vraiment beaux. Ils ont été commencés il y a trente ans encore sous l'Empire.
Le N°4 est enfin venu avec le 6. A ce soir ce que j’ai à vous répondre. Je vous quitte pour aller chez Lord Aberdeen. Adieu. Adieu. Adieu. G.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Description, Diplomatie (France-Angleterre), Famille royale (Angleterre), Famille royale (France), Femme (portrait), Musique, Nature, Opinion publique, Politique (France), Politique (Grèce), Portrait, Récit, Théâtre, Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne)
8. Château de Windsor, Samedi 12 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je sors de la réception de l'adresse de la Cité au Roi. Le Lord maire, les Sheriffs, les aldermen, & des common Council men, 45 en tout. Vous verrez l'adresse et la réponse du Roi, qui a été parfaitement accueillie. Bonnes toutes deux. J’avais écrit la réponse ce matin, et je l’avais fait traduire par Jarnac. De l’avis de Peel, et d'Aberdeen il fallait qu’elle fût écrite lue et remise immédiatement par le Roi au lord Maire. La Reine et le Prince Albert ont passé une demi-heure dans le cabinet du Roi à revoir et corriger la traduction. C'est une véritable intimité de famille et d’une famille très unie.
J’ai eu le cœur remué pour mon propre compte. Au moment de se retirer les commissaires de la Cité ont demandé tout bas qu’on leur montrât M. Guizot, et à peu près tous m'ont salué avec un regard respectueux et affectueux qui m’a vraiment ému. Au dire de tous ici, cette adresse, votée à l’unanimité dans le Common Council est un évènement sans exemple et très significatif. Peel répète souvent qu’il en est très frappé. Plus j’avance plus je suis sûr qu'ici le voyage est excellent, excellent dans le Gouvernement et dans le public. Le Duc de Wellington est venu ce matin passer une heure chez moi. Nous avons causé de toutes choses, même du droit de visite ; évidemment ma conversation lui plaisait, et j'espère qu’il s’en souviendra.
Vous avez raison ; il faudrait que Cowley fût Earl. Je tâcherai de faire arriver cela. J'en parlerai au Roi, qui a déjà très bien parlé des Cowley. Le Roi vient de partir pour une visite à Eton. Il est infatigable. Je suis resté pour écrire, pour vous écrire.
Ne vous enfermez pas dans votre deuil au delà de ce que veut la convenance. Je ne doute pas que la lettre de Constantin ne me touche. C’est un bon jeune homme. J'espère qu’à partir de demain Dimanche, vous aurez l’esprit de m'écrire au château d’Eu et non plus en Angleterre. Lundi encore, écrivez-moi à ici. J’aurai votre lettre mardi, et Mercredi j'irai vous chercher vous même au lieu d'attendre vos lettres.
Nous quitterons Windsor Lundi à midi. La Reine, avec le Prince Albert, reconduira le Roi à Portsmouth. Là vers 3 ou 4 heures elle montera à bord du Gomer, où le Roi lui donnera un luncheon. Après le luncheon, elle quittera le Gomer pour monter sur son yacht, le Victoria Albert et les deux bâtiments sortiront ensemble du port de Portsmouth la Reine pour aller à l’île de Wight, nous pour faire voile vers le Tréport. On ne peut pas pousser plus loin la bonne grâce, et l’amitié. On dit que tout Londres sera lundi à Portsmouth.
Bacourt peut aller à Bruxelles. Je ne crois pas avoir besoin de lui avant le 1er Déc. Et en tous cas Bruxelles est si près. Je vais vraiment très bien. J'en suis frappé surtout pour l’appétit. Il y a bien encore un fond de fatigue surmonté par l'excitation de la vie que je mène et par ma volonté. Pourtant je sens aussi revenir la force, la force vraie et naturelle. Je suis sûr qu'à mon arrivée vous serez contente de moi. Adieu. Adieu. Votre lettre de ce matin m'a bien plu. Seulement vous ne me dîtes rien de votre santé. Adieu, dearest.
8. Paris, Mercredi 7 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
5 heures
Encore une mauvaise lettre aujourd'hui. C’est bien mal en retour des deux bonnes lettres de vous qui me sont venues à la fois ce matin (N°4 et 5). Mais il n’y a pas moyen. Je suis arrivé d’Auteuil à midi. J’ai été assiégé depuis. huit ou dix députés ; Mackan, Martin du Nord, Dumon, Schachten, Rozier, Armand Bertin. Tout le monde est curieux. C’est vraiment un mouvement vif. J’ai très bon espoir de l'affaire du Maroc. Je crois qu’elle finira doucement après quelques actes de force. C'est le problème à résoudre. Agir fortement en présence de l'Angleterre, tranquille, et aboutir à la paix. M. le Prince de Joinville comprend cela très bien. Il a vraiment de l’esprit. Un de ses officiers, parti de Cadix, le 28 Juillet est arrivé ce matin. Son rapport m'a fort convenu. Le dernier délai donné expirait le 2 août. Ne vous ai-je pas déjà dit cela deux fois ? Nouvelle menace d'une apparition de la flotte Turque devant Tunis. Nous y envoyons de nouveau trois ou quatre vaisseaux. Rien sur Tahiti. Je ne veux suivre un peu activement la correspondance sur ce point que lorsque le Parlement Anglais sera clos, comme le nôtre. Je ne puis courir le risque d’un second discours de Peel.
Ce que vous me dîtes de votre frère est bien triste. Ne vous enfermez pas trop dans cette chambre. Vous êtes bien, n’est-ce pas ? Je veux que vous vous portiez bien. J’y pense encore plus quand vous n'êtes pas là. Pauvre lettre. J’aurais tant à vous dire. Il faut que je passe par Neuilly pour retourner à Auteuil. Le Roi vient de me demander. Adieu
8. Paris, Samedi 4 mars 1854, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je n’ai encore rien de vous ce matin. Je ne m'en étonne pas ; vos lettres m’arrivent presque toujours fort tard ; mais j'en suis bien impatient. Si vous étiez trop souffrante, ou vos yeux trop malades, j'espère que la Princesse Kotchoubey aurait la bonté de me donner, en quatre lignes, de vos nouvelles. C'est elle qui fait, en ceci, ma sécurité, si sécurité, il y a.
Je vous ai dit sincèrement mon impression sur l’idée de votre retour immédiat. Je vous la devais, quelque amère qu'elle ne fût. Plus j’y pense, plus elle se confirme. Je ne regarde pas comme impossible qu’il se présente quelque expédient imprévu pour mettre fin tout à coup à cette déplorable guerre. Mais quant à présent, même en France, où elle déplait, elle est de plus en plus prise au sérieux, et la passion pourrait bien ne pas tarder à s'y mettre.
M. de Flavigny me disait hier qu'à la séance Impériale, en entendant le discours, le sénat et la magistrature avaient été froids, mais le corps législatif, les gens des provinces, approbateurs et assez animés. Ils ont pris leur parti de la guerre. Ils prennent au pied de la lettre les paroles de paix prochaine et point de conquêtes qui contient le discours. Ils soutiendront sans rien objecter.
Je reçois ce matin une lettre de Piscatory, qui m'écrit : " C'est maintenant le succès qu’il faut souhaiter, et en toute sincérité, je le souhaite ardemment ; le drapeau est engagé ; et puis honneur et intérêt du pays à part, la défaite n'est jamais bonne à rien, ni à personne. Avec de bonnes dispositions, et dans le monde du gouvernement et dans celui de l'opposition la Russie n'est pas populaire.
Je ne me représente pas agréablement vous au milieu de cette atmosphère là ; votre repos et votre dignité en souffriraient également. Restent les maisons de santé, les raisons impérieuses. Celles-là l'emportent surtout.
3 heures
Je rentre et je trouve votre lettre qui me fait grand plaisir parce qu'elle est bien moins abattue. Dieu veuille que vos yeux aillent mieux. Dans le public indifférent, le discours impérial a assez peu de succès. Je ferme ma lettre. J’ai là du monde. Adieu, Adieu. G.
8. Paris, Vendredi 3 juin 1853, Dorothée de Lieven à François Guizot
Heckern vient chez moi tous les soirs. Hier il était tout gros de nouvelles de Londres, selon les quelles, Clarendon va se trouver dans la nécessité de convenir qu'il a été trouvé par l’Emp. Nicolas. Le ministère sera culbuté. Palmerston en prendra la direction. On regarde cela comme infaillible aux affaires étrangères. Selon la lettre de Greville & le dire de Hubner on est en grand travail d’accomodement. Tout le monde s’y met. Mais mon Emp. ne peut pas reculer. C’est impossible le ton du Times du 1er juin est remarquable. On ne peut pas faire d’affaires avec la France. Après tout, il n’y a pas d'intérêt direct anglais. Les bouches du Danube cela regarde les allemands qu’ils s’en tirent. Il conclut à l'abstention. Point de nouvelles hier. [Drouin] de [Lhuys] fait un secret de la dépêche télégraphique dont je vous ai parlé hier. Elle est vraie cependant, c'est Cowley qui me l’a dit. J'ai remis mon départ à la semaine prochaine. Il fait trop laid. Lord Cowley m’a interrompue. Je n’ai plus un moment à moi. Adieu.
8. Paris, Vendredi 25 mai 1855, Dorothée de Lieven à François Guizot
Pétersbourg 15 mai. Je suis heureux de voir par votre lettre du 4 que votre santé vous permet de songer à un déplacement pour l’été, et que vous voulez avant tout faire ce qu’il faut pour vivre. Vous avez bien raison et ne vous préoccupez pas des suites. Vous êtes redevenu parisien. Pouvez-vous entrepen dre un grand voyage ? Vers le nord p. e. non, et bien, il est pour vous très important d’être à la portée de vos médecins, de vos habitudes, ainsi less said, best inconded.
Le 16. J’ai vu hier soir ceux dont le suffrage vous tient à cœur. Je leur ai annoncé votre petit voyage à Schlangenbad et retour. Cela n’a pas motivé d'observation à cette soirée, il padrone a lu votre lettre avec beaucoup d’intérêt, et sa mère vous fait dire mille choses affectueuses.
Voilà ce côté assuré je pense vous le pensez aussi n’est-ce pas ? Dites-moi votre avis Point de nouvelle à vous dire. Cowley a donné hier soir birthday dinner. Le ministère Français, les autorités, & les Anglais de rang pas beaucoup, pas un seul diplomate. Cette ommission est contre tous les usages. On me mande de Bruxelles " l’Autriche est bien bien mécontente", & on ajoute, c’est toujours très grave quoique cela ne change pas le fond des choses. mais les derniers incidents sont facheux. " qu’est-ce que cela veut dire ? Facheux pour quoi ? Mécontente de quoi ? on ne m’explique rien. Le duc de Cobourg ne revenant de Londres a dit que tout et tous étaient là à la guerre. J’entends le canon. Je suppose que c'est pour le roi de Portugal qui arrive aujourd’hui.
J’ai vu bien peu de monde hier. Je suis sortie en voiture un moment, mais j’ai peur. Adieu. Adieu.
Meyendorff me demande quelques titres de Livres pour l'Impératrice, et pour lui même. Pourriez-vous m’indi quer ?
Le canon est pour Makan au lieu du roi.
8. Saint-Germain, Samedi 18 juillet 1846, Dorothée de Lieven à François Guizot
Voici donc huit jours de passés dieu merci. Quelle longueur que cette semaine ! Fleichman est venu hier dîner avec moi, très fidèle et très soigneux. Il avait été juré à Neuilly. Kisseleff y était. Le Roi lui a parlé de notre dernière dépêche avec des expressions succulentes, c’est le terme dont s’est servi Fleichmann, des protestations d’amitié, enfin on eût dit les deux monarques les plus unis, les plus intimes. Fleichmann c’est fort égayé sur ce sujet. Et puis sont venus des compliments personnels pour Kisseleff. Surabondance. Thom dit que l’élection du Pape n’a pas plu du tout à Vienne. La Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hess vont demander à la diette l'abolition des lois de censure, & un nouveau règlement très libéral. Armin est fort peu aimé ici dans la diplomatie. Voilà toute ma récolte d’hier. Je vais devenir bien inutile. Le temps est abominable, froid et de la pluie & du vent. C’est un peu ridicule d’être à St Germain pour cela. Et votre course à Trouville tombe mal aussi.
Bacourt me mande que notre nouveau gendre est un très mauvais sujet et que tout à l’heure avant de partir pour se marier, il a eu des senées[?] à ce sujet avec son père. Vous ai-je dit que le roi de Wellington se traîne à Bade avec une maîtresse. On ne le voit pas du tout. Je n’ai donc pas à le regretter.
Midi. Voici votre lettre. Je vous renvoie Reeve. La situation anglaise n'est pas du tout de mon goût, je n’aime pas voir Peel et Aberdeen ainsi de côté. Je voudrais bien la dissolution. Il me semble qu’elle sera mauvaise aux Whigs. Je pense certainement à Trouville. J’y resterais deux jours dont une demie journée au Val-Richer. Nous arrangerons cela pour après vos élections. Je trouverai le temps long aujourd’hui. Rodolphe qui devait venir dîner avec moi est malade. Personne, & du mauvais temps. J'ai fait venir un piano. Madame Danicau est utile à tout. A practical woman. Adieu, dites-moi toujours que vous vous portez bien. Comment se portent vos élections ? Adieu. Adieu, dearest. Adieu.
8. Schlangenbad, Jeudi 10 juin 1852, Dorothée de Lieven à François Guizot
Après une journée de repos j’ai pu finir ma soirée chez l’Impératrice. Au moment de se séparer le Prince de Prusse est arrivé, il avait fait une absence de deux jours. Aujourd'hui reviennent les jeunes grands Ducs qui ont fait une pointe aux petites cours du Midi, & qui repartent demain pour la Hollande, tout ce mouvement est fatigant à regarder.
Saztinsky est ici. L’Impératrice. est bien gardée. Elle vient de m'envoyer son médecin Maudt. Je ne sais s'il est bon médecin, mais je sais qu'il a bien de l’esprit, & que cela me fait une précieuse et utile connaissance. Vous savez que quand je parle d’utilité c’est de mes fils qu'il est question.
2 heures. Voici votre lettre. Tout m'arrive plus régulièrement cette année. Je reçois votre lettre du 8, le 10. Cela ne peut pas être mieux. Je suis bien fâchée de ne pas avoir les Débats. Je viens de lire votre discours dans le Galignani, en Anglais par conséquent. Quel dommage. Ce doit être si beau !
J’ai passé ma matinée couchée, beaucoup de visites, une longue du Prince de Prusse. J’ai été dîner chez l’Impératrice, rien que la famille. Elle me dispense de la soirée aujourd’hui, mes forces ne suffisent pas. Je suis bien plus faible qu’à Paris. Léopold arrive demain à Coblence. Il dîne et couche chez le Prince de Prusse. Mes jeunes grands ducs y seront aussi et passeront la nuit sous le même toit ; c'était une visite arrangée. Le roi Léopold s’est invité depuis. La rencontre est imprévue mais cela se passera bien. Tout est difficile dans ce genre. Je doute que l'Impératrice puisse recevoir sa visite. Elle pourra le rencontrer.
L'affaire du Constitutionnel est bien curieuse Adieu, je sens que je n’ai absolument pas une nouvelle à vous dire. Je voudrais vous en donner de meilleures sur ma santé. Je voudrais aussi avoir une meilleure mémoire. Je fais ici une grande confusion de princesses. Il y en a trop. Ma grande Duchesse Olga est vraiment charmante. Naturelle, fine, bonne & si belle. Son mari m’intéresse, car il est un peu délaissé par tout le monde. Le roi de Wurtemberg viendra la semaine prochaine, cela a couté de la peine de le faire admettre. Adieu, adieu, encore.
8. Stafford House, Samedi 15 juillet 1837, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vous me maltraitez Monsieur, depuis le N°4. Je n’ai rien rien qu’un très petit mot de dimanche dernier. Reprenez je vous en prie vos bonnes manières. J’essayai hier de me promener un peu. Cela ne me réussit pas ; il survint un gros orage. Ma porte fut assiégée comme de coutume. Je n’ai à vous rendre compte que de mes tête à têtes. Le plus long hier fut avec Lord Harrowby. Dieu, qu’il est sombre ! Au reste cela a toujours été son métier. Et durant les 18 années qu’il s’est trouvé dans le Cabinet il n’y a jamais fait autre chose que d’exposer toujours le mauvais côté de toutes les questions qui s’y agitaient. Eh bien, c’est d’une grande utilité. De cette façon les mauvaises chances ne manquaient jamais d’être prévues et écartés si faire ce pouvait. C’est un des hommes d’État de ce pays qui a le plus d’expériences des affaires. Il était ami intime de Pitt. il voit la fin du monde bientôt. Il a un mépris. profond pour les Ministres, & il exprime tout cela dans les termes les plus doux. Cela est fort peu Anglais. J’aime mieux les vérités brutales dans leurs boucles. Alors, ils sont charmants.
Lord John Russell vient souvent causer avec moi il est d’une familiarité & d’une naïveté charmantes. Nous rions un peu de tout. Le duc de Devonshire arriva hier de la campagne pour faire les arrangements avec moi. Il veut absolument septembre à Chathworth. Moi je voudrais septembre autre part, la poussière de Paris me parait charmante enfin je verrai,.Je ne veux me lier par aucun engagement. Monsieur je m’interromps vingt fois pendant que je vous écris. Me voici dans une exclamation & un soupir d’avant hier.
Point de lettres ? Comment m’expliquer cela. Comment supporter tous ces mécomptes ? Les idées les plus extravagantes s’emparent de mon esprit. Quelques unes atroces ; d’autres tellement enivrantes que j’en perds la tête. Il me semble que un tête à tête aujourd’hui ne seront pas seulement avec des Anglais. La mer est le vite franchie ! Et puis je me figure tout. Monsieur est-il bien raisonnable de se livrer à son imagination ? Vous m’avez fait du mal en me disant un jour que vous la laissiez-vous accuser quelques fois. Prenez garde Monsieur à tout ce que vous me dites. Ma foi ne vous est si grande que je ne crois jamais mal faire en vous imitant. De même que je crois que je saurais réprimer tout ce qui pourrait vous déplaire. Cette poste venue sans lettre de France m’en a portée une de Pétersbourg. Mon mari allait s’embarquer le 8 pour venir à Lubek. Il se borne à cet avis. Je me figure quelques fois qu’il ne serait pas impossible qu’il vint me voir pour quelques jours seulement. Le bateau à vapeur de Hambourg arrive après demain. S’il l’amenait ! J’ai l’imagination toute sombre comme celle de lord Harrowby. Il me semble que l’atmosphère anglais y dispose. Tout me fait peur.
Je fis hier un grand dîné chez Lady Jersey. Votre Ambassadeur fut encore mon voisin. Il me parla de tout. Nous devenons familiers. Combien je pense à l’interrogation prophétique que vous me fîtes il y a deux ans à d’ici chez Mad. de Boigne. Vous en souvenez- vous ? Je passai après le dîné c.a.d. à onze heures du soir chez lady Holland. J’entrai & je trouvai le mari tout seul, Madame était au spectacle dans ces cas là où lui laisse à lui une bougie, ses lunettes & du papier pour écrire. Pas autre chose. Il trouva ma visite fort agréable. Sa bonne humeur me plut.
J’ai vu ce matin, lord Grey, Pozzo, & lord Aberdeen chacun bien longtemps. Ellice & quelques autres par dessus le marché. Monsieur, il est arrivé quelque chose d’étrange entre Lord Aberdeen et moi. Vous le connaissez un peu par ce que je vous ai dit de lui. Moi je le connais & je l’aime beaucoup ma société lui a toujours plu, & voilà tout. Il a été bien heureux dans sa vie. Heureux comme vous l’avez été. Il a tout perdu. Deux femmes, quatre enfants chacun à l’age de 16 ans. C’est une tragédie ambulante. Mes malheurs ont pu accroître le goût qu’il a toujours trouvé dans ma société, car les malheureux se cherchent. Il aura trouvé en moi maintenant quelque chose de plus que ce qu’il y avait autre fois. Je vous l’ai dit, je vaux mieux de mille manières. Et bien Monsieur, toute cette préface est pour arriver à ce que vous devinez. J’ai reconnu dans lord Aberdeen les mêmes symptômes que j’ai surpris en moi depuis quelques mois. Mon cœur s’est révolté à l’idée de laisser un instant d’illusion à une âme bien noble, bien malheureuse. Hier je lui ai conté l’histoire de mes sensations depuis les malheurs dont le ciel m’a frappée. Il a tout compris plus que compris, hors la force de ces expériences. Et mon dieu ce n’est pas de la force, c’est de la faiblesse. C’est parce que je suis femme, parce que mon cœur a besoin de secours, que ma voix sait trouver des paroles. Je demandais à Dieu du secours ou la mort. Il m’a secouru. Je le lui ai dit. Il sait maintenant que je ne suis pas seule sur la terre, qu’un noble cœur a accepté la mission de consoler le mien. Je me suis sentie soulagée après cet aveu. Il l’a reçu en véritable Anglais quelques mots sans suite. Un serrement de main plus fort que de coutume et il m’a quittée.
Dimanche 16 Je vous écrivais encore tard hier à 6 heures. Je ne sais pas me séparer d’une feuille de papier commencée. Je vis le Duc de Sutherland à ma toilette. Je ne l’avais pas vu de tout le jour. Il avait été à Windsor chercher les diamants de la couronne dont sa femme doit avoir la garde. Il vient les étaler sur ma table. Ces diamants sont aujourd’hui l’objet d’un procès entre la couronne d’Angleterre & de Hanovre. celle ci les réclame en vertu d’un testament de la reine Charlotte. La reine d’Angleterre n’aurait rien. Au reste si le roi Ernest ne faisait que cela à la bonne heure, mais sa proclamation ? Voilà une belle affaire. Ici les Tories en sont consternés. Elle fera le plus grand tort au parti dans les prochaines élections. Savez-vous qui est son conseiller intime ? Ce fou de Londonberry. Ce fut chez lui que j’allai dîner hier à la campagne, un dîner d’ultra, beaucoup de violence de langage, beaucoup de roses. Un chien énorme établi sur le genou droit de la maîtresse de la maison & le genou gauche d’un jeune lord son amant. Une promenade au clair de Lune sur le bord de la Tamise. Voilà ce que j’ai à vous raconter de mon dîner.
A propos lord Aberdeen devait en être. Il a envoyé ses excuses. un moment avant de nous mettre à table. J’ai passé une très manvaise nuit. Aujourd’hui dimanche point de poste. Le cœur un battra demain matin bien fort. Il me semble que je ne vous parle que de moi. Mes lettres vous ennuient-elles ?
Monsieur tout autre sujet me passe de l’esprit avec vous. Cependant l’Angleterre vous intéresse je sais assez intimement tout ce qui s’y passe. Si je vous en entretenais peut être cela m’attirerait-il de plus fréquentes lettres de votre part ! Je vais essayer. Il y a eu comme je crois vous l’avoir dit déjà quelques mécomptes dans les calcule des Whigs pour les élections, les membres les plus impertants du parti sont allés feel the pulse de leurs commettants. Le Conservatisme est fort à la mode. J’ai vu cela hier au visage moins arrondi de M. Ellice. Cependant on ne peut rien préjuger. Dans trois semaines vous y verrez très clair.
La reine veut jouir de tout à la fois et prend en même temps la royauté en gaieté & au sérieux. On dit que rien n’est plus curieux que les grands jours d’audience. Ainsi les Universités sont venues lui porter leur adresse. Le duc de Wellington a lu celle d’Oxford avec une voix très sévère, un peu tremblante, enfin beaucoup d’embarras ; le Clergé a fait de mêmes, toutes ces vieilles perruques tous ces vieux costumes rangés autour de ce vieux trône occupé par une jeune fille, tout le monde en respect, en silence, quite awfull à ce que l’on m’a dit ; & la reine assise sur ce trône avec son manteau royal, un sourire d’enfant, une voix argentine des plus claires des plus douces, on dit que cette voix est charmante, lisant ses réponses lentement appuyant avec emphase. sur my, mine, élevant la voix alors & jettant ses regards sur toute la salle. Prononçant avec humilité & onction, les passages du discours qui ont rapport à la religion. Faisant tout cela avec calme, dignité, répos. En vérité lord Grey, lord Aberdeen, le duc de Wellington qui m’ont tous raconté cela en sont confondus. Au sortir d’une corvée qui a duré quatre heures, & après avoir reccueilli en allant en revenant de St James, les applaudissements les plus enthousiastes de la foule elle donne à dîner à quelques uns de ces ministres, menant la conversation à table. Après le dîner ; elle a demandé à lord Landsdowne s’il aime la musique & s’il aimait l’entendre. & la voilà chantant des airs italiens seule, des duos avec sa mère & tournant la tête de ce pauvre lord Landsdowne. Tout cela n’est-il pas curieux, bizarre. J’ai demandé quarante fois si elle a de l’esprit. On ne m’a jamais fait de réponse bien claire. Je verrai cela moi même. Je vous ai dit que la mère est en dehors de toute affaire ; même des affaires de cour, La Duchesse de Sutherland me paraît prendre beaucoup d’ascendant sur la Reine, mais elle a peur de la maitresse. C’et étrange tout le monde en a peur. Lord Melbourne un peu plus que les autres. Il aime il admire cette volonté absolue, mais il n’a pas bien démêlé encore jusqu’où elle peut aller. Il n’est pas question de mari. Les ministres n’en sont pas pressés. Elle n’a pas l’air de l’être. Cependant une fantaisie de salon pourrait tout à coup associer quelqu’un au trône. Voilà ce qui fait plisser le front de lord Melbourne.
6 heures Lord Aberdeen m’a fait prier de le recevoir seul un moment. Je l’ai reçu. Il m’a demandé de le laisser s’exprimer en Anglais parcequ il voulait être compris. Il craignait que je n’eusse pas entendu son silence hier. Dans cette séparation de 3 ans il n’a jamais cessé de penser à moi avec une affection vive. Nul n’a compris & partagé mes malheurs comme lui. Il veut que je sache le sentiment bien intime, bien profond qu’il me porte. Il est heureux de penser que mes peines sont adoucies. Il me prie de ne pas l’oublier, & puis il me déclare que sa voiture de voyage est à ma porte, qu’il part pour ses montagnes en Écosse & qu’il ne me demande qu’une chose c’est de baiser ma main pour la première fois de sa vie. Tout cela s’est dit comme je viens de vous le dire. Il a pris ma main, il l’a retenue un moment et il est sorti, & en effet le voilà en route. Je vous ai tout dit Monsieur, savez vous qu’ici encore je reconnais la singularité de notre sort, & cette providence qui a fait le 15 de juin, & décidé du sort de ma vie.
Lundi 17. Au milieu de ce monde immense qui m’environne de ces intérêts si curieux mais qui nous sont si étranters, de ces conversations tout anglaises, de ses grands dîners où rien ne me rappelle ce que j’ai quitté, mon esprit, mon cœur ne sont préoccupés que d’une seule pensée quelle puissance que cette pensée unique qui m’absorbe aujourd’hui ! Je vis hier pendant deux heures la Duchesse de Glocester, sœur du feu roi, elle me raconta tous les gossips de cour, & d’intérieur. Deux heures aussi d’entretien intime avec lord Melbourne. Il m’en est resté tout un trésor de découvertes. Vous les aurez demain jusqu’à un certain point. Je fis hier un immense dîner chez le prince Estérhazy. Ces dîner me fatiguent extrêmement. On ne se met plus à table avant 9 heures. Il faisait chaud. Je priai qu’on ouvrit la fenêtre. Ma belle lune bien ronde, bien claire me donna des distractions abominables. Monsieur pardonnez-moi, la lune. Dans une heure, le postman fera sa tournée. Une heure d’angoisse encore et puis vendra-t-elle ? Adieu Monsieur, adieu. La poste est venue. Point de lettres ! Mon Dieu que penser ? Ayez pitié de moi.
8. Val-Richer, Dimanche 19 juillet 1846, François Guizot à Dorothée de Lieven
Temps affreux hier pour aller à Trouville. Grande pluie, grand vent. Pourtant quelques coups de soleil et un vif plaisir à revoir la mer. Vraiment cette plage est très jolie. Peu de baigneurs encore. Personne de votre connaissance. C’est au mois d'août que doivent venir Mad. de Boigne, Mad. d’Haussonville, Mad. de Ségue & M. Molé et Mad. de Castellane devaient venir ces jours-ci. Ils avaient loué la moitié de la maison du Dr. Olliffe qui a là une assez bonne maison, confortable. Ils lui ont écrit qu'ils ne viendraient pas. Le bruit de Trouville était qu’ils ne venaient pas à cause de moi, parce qu'on leur avait écrit que je venais à Trouville, que j’y étais très populaire, qu’on devait m'y faire des fêtes &. Il est sûr que je suis là très populaire, et que j’y ai été reçu avec tous les témoignages possibles de toute la population, tous les bateaux du port pavoisés, tous les notables du bourg réunis dans ma maison. Bonne maison, la meilleure de Trouville ; très simple et très propre assez bien pourvue de meubles, linge & sur la plage, n'ayant que la mer sous vos fenêtres ; si bien qu’hier, de la salle à manger, au rez-de chaussée, pendant le dîner, à la marée haute, on ne voyait absolument que la mer sans rivages, pas plus le rivage près que le rivage loin. Vous y seriez très passablement, au 1er étage, trois chambres, avec cabinets de toilette et des chambres de domestique en haut. Pauline et Mlle Wislez seraient au second. L’aide de Guillet est là, suffisant. La maison appartient à l’un de mes amis de Lisieux qui me la prête tout entière, tant que je voudrai. Si vous en aimiez mieux une autre, il y a celle d’Olliffe, tout ou partie de ce qu’avait loué M. Molé et qui est encore vacant. Vous voyez qu’en tous cas, vous ne manqueriez pas de ressources. Pour de la société jusqu'à présent, je ne vous en vois guère là. J’irai vous y voir et vous y chercher pour vous amener au Val Richer où vous pouvez, soit coucher, soit ne passer que la journée, comme vous voudrez. On y vient de Trouville par une très jolie route en poste en moins de trois heures. Quel plaisir de vous avoir ici, malgré mes commentaires par avance ! Avec quel plaisir, nous nous y promènerions comme vous voudriez, ni plus, ni moins ! Voyez. Dites-moi. Mes descriptions sont exactes, sans omission, ni exagération. J’étais parti de Val-Richer à onze heures. J'y suis rentré à neuf heures et demie. La route est partout une allée de jardin.
Jarnac a eu une longue conversation avec Palmerston sur les affaires d’Espagne. Pure conversation, sans proposition, ni conclusion de part ni d’autre mais bonne. Notre principe des descendants de Philippe V bien maintenu. Ni admis, ni contesté comme principe ; mais approbation très explicite des fils de D. François de Paule, avec pente indiquée vers D. Enrique. Le Coburg tout-à-fait écarté avec quelque surprise que la France n'en veuille pas, car il est plus français qu'anglais. Pas un mot, sur l'Infante déclaration très expresse que les deux seuls alliés de l’Espagne doivent être là d'accord et agir de concert. Disposition annoncée, à me communiquer ses instructions à Bulwer et à continuer l’entente intime, comme Aberdeen. Tout cela assez superficiel et réservé, mais dans la bonne voie. Je vais écrire aujourd’hui à Jarnac avec détails. Lord John très bien avec Peel me dit Jarnac. Il a rencontré chez ce dernier, le Duc de Bedford, en intimité marquée. Tout le monde se concerte pour surveiller Palmerston. Pourvu qu'il n'en prenne pas de l'humeur, et ne s'amuse pas à attraper ses duègnes. J’ai peur qu’il n’y ait jamais entre lui et nous, qu'un mariage de raison. Croyez-vous que cela suffise jamais ? Deux idées, je crois à bien inculquer à W. Hervey. L’une, qu’il faut se hâter de saisir le moment où nous sommes bien disposés pour les Infants D. François de Paule, le mariage, après tout, qui convient le mieux à l'Angleterre puisque c’est un mariage purement Espagnol. L'autre, qu’il faut bien se garder de recommencer en Espagne, l’antagonisme des deux patronages, Français et Anglais, au profit des deux partis, modérés et progressistes. Ce serait la ruine du mariage François de Paule de l’ordre naissant en Espagne et de la bonne intelligence entre nous. S’il parle de l'Infante dites que le Duc de Montpensier, s'il l’épouse, est bien décidé à l'emmener en France et à vivre en France avec elle à en faire une Princesse française. Il a grand dégout et grande méfiance des Cours du midi de leurs mœurs de leurs Camarillas &. C'est le sentiment de toute la famille royale. En voilà bien long pour vos yeux, quoique bien peu pour mon plaisir. Ah, l’absence, l'absence. J’y fais tous les jours des découvertes.
9 heures Voilà le N°8. Il n’y aura de bon numéro que le dernier. Je me porte bien. Les élections aussi, comme on se poste bien au milieu d’une bataille. La lutte est très vive. Il y aura bien des morts de part et d’autre. Mais tout continue, à présager que le champ de bataille nous restera. Adieu. Adieu. Je suis accablé ce matin de signatures à donner et de lettres à écrire. Et c’est dimanche, jour de visites. Adieu. Adieu. Charmante parole dans le N°8. Vous viendrez au Val Richer. Adieu donc.
8. Val-Richer, Mercredi 19 juillet 1837, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je savais bien que je ne lirais pas votre première lettre sans remords. Et la prochaine m’en donnera plus encore, car vous aurez été plusieurs jours sans lettres. C’est un peu ma faute, la faute de mon inquiétude, de mon chagrin, de mon humeur. Savez-vous que j’ai été, moi, huit jours sans lettres, du jeudi 6 au vendredi 14 ? De toutes les raisons de retard, l’irrégularité de la poste à travers mes champs normands était à coup sûr, la plus vraisemblable. C’est celle à laquelle j’ai le moins pensé. J’en voulais absolument une plus grave. L’Empereur Napoléon, n’avait jamais voulu croire qu’une gelée de 25 degrés pût arriver en Russie plutôt que de coutume, et qu’une circonstance, toute matérielle, toute indifférente d’ailleurs, vint, paralyser les combinaisons de sa haute intelligence, de sa puissante volonté. Moi aussi, j’étais choqué de penser, je répugnais à admettre qu’il fût au pouvoir d’un courrier mal réglé ou tardif de me tourmenter à ce point. Je cherchais pour cause à mon tourment des intentions, des actions plus spécialement dirigées contre moi, contre moi seul. On ne se rend pas, de tout ce qui se passe dans l’âme ainsi troublée, un compte bien net ; mais que d’idées, que d’émotions la traversent que de conjectures elle invente qui frapperaient d’une surprise infinie si elles paraissaient au jour ! Que la vie extérieure, la vie qui se voit est lente, et froide, et vide, à côté de la vie intérieure, de la vie secrète ! Ce n’est pas là une des moindres causes du charme de l’intimité ; elle soulève aux yeux d’un seul être, le voilà qui couvre ce théâtre si animé, si varié, mais sans spectateurs.
J’ai lu, dans quelque vieille chronique, qu’un roi Barbare, très avisé et qui avait amassé d’immenses trésors, disait à sa femme qu’il l’aimait parce qu’elle était la seule personne à qui il les montrât. On montre son âme à la personne qu’on aime ; et entre mille raisons de l’aimer. On l’aime, en effet pour celle là. On répand devant elle tous ses trésors cachés, et elle les connait, et elle en jouit ; et du moins auprès d’elle tout ce qui est paraît ; le dehors et le dedans se confondent ; la vie éclate avec vérité et liberté.
Malgré mon remords, Madame, votre lettre me charme. Moi aussi, je vous remercie de votre inquiétude, et puis de vos great spirits. et puis encore de votre poésie. Vous avez mille fois raison. Milton a grand tort de dire. "He for God only." C’en un reste d’arrogance puritaine. Et le langage universel du genre humain proteste contre cette arrogance, car de tous temps et en tous pays, hommes et femmes également se sont dit, en s’aimant, je l’adore, ne se faisant pas plus de scrupule les uns que les autres de se parler comme s’ils parlaient à Dieu. J’ai beaucoup de foi à ces instincts spontanés et généraux du langage humain. La vérité s’y révèle presque toujours.
Jeudi 20
Je viens de m’impatienter à chercher mon Milton. Je ne l’ai pas trouvé. Il est dans des caisses de livres, qui ne me sont pas encore arrivées. J’étais pressé de relire les trois vers auxquels vous me renvoyez. Je suis bien sûr que je les aimerai comme vous. Est-il rien de plus doux que cette confiance dans une prompte et complète similitude d’impressions ? Milton est en effet un peu heavy. Cependant si nous le relisions ensemble nous y rencontrerions encore bien des vers qui vous iraient au cœur. La poésie fait bien autre chose que m’élever et me calmer au besoin ; elle m’entretient, dans le plus charmant langage, de tout ce qui a pu de tout ce qui peut charmer ma vie. Elle n’a pas toujours été pour moi ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai appris à la comprendre. J’en jouis bien plus que je ne faisais à vingt ans. J’y découvre tous les jours des intentions, des émotions qui avaient passé inaperçues devant moi, et qui maintenant me saisissent car je les reconnais ; c’est mon âme qu’on me raconte. Voici des vers de Moore qui me sont retombés avant hier sous la main. Blessed meetings after many a day
Of widowhood past far away ;
When the loved face againts seen
close, close with not a tear between ;
Confidings frank without controul,
Pour’d mutually from soul to soul ;
As free froms any fear or doubt,
As is that light from chill, or stain
The sun into the Stars Sheds out,
So be by them shed back again !
Faites comprendre tout ce qu’il y a dans ces vers à qui n’a pas goûté tout le charme de l’intimité et senti tout le poids de l’absence ! Les émotions même les plus personnelles, des émotions qu’en les éprouvant on a été tenté soi-même de regarder comme étranges, comme vouées, au plus profond secret, on les retrouve quelquefois dans les poètes et précisément telles qu’on les a éprouvées. Vous m’avez parlé un jour du besoin impérieux qui vous avait quelquefois poussée, quand vous étiez seule, à appeler à haute voix, à bien haute voix, les êtres chéris que vous aviez perdus. Je ne sais quelle réserve, quel embarras m’empêcha de vous dire alors que moi aussi j’avais parlé, et appelé et crié comme vous. Eh bien, Madame, ce que nous avons senti l’un et l’autre, ce que nous ne nous sommes dit qu’à voix basse et en hésitant, le Dante l’a mis en beaux vers dans une canzone sur la mort de sa Beatrix : « Quelquefois, dit-il, mon imagination devient si vive, et en même temps la douleur me presse tellement de toutes parts, que je tressaille, je m’enfuis avec honte loin de toute vue ; et seul, pleurant, gémissant, j’appelle Béatrix, et je lui dis.« Beatrix es-tu morte ? Et quand je l’appelle ainsi, elle me console.»
Poscia, piangendo sol nel mio lamento,
Chiame Beatrice, e dico. Or, sei tu morta ?
E mentre ch’io la chiamo, mi comforla.
Et le Dante a cru peut-être, et nous avons peut-être cru, vous et moi, qu’une telle impression, un tel cri ne pouvaient appartenir qu’à un cœur déchiré. Le Dante s’est trompé, nous nous sommes trompés. Le bonheur aussi, un bonheur profond, saisissant, a produit les mêmes effets. Le méthodiste passionné ce John Newton dont je crois vous avoir parlé, écrit à sa femme :
« It is my frequent custom to vent my dearest
thoughts aloud when I am sure that no one
is within hearing. I have had many a tender
soliloquy concerning you, and in the height
of my enthusiasm, have often repeated your
dear name, merely to hear it returned by
the echo.
N’est-ce pas un plaisir pour vous, Madame, de retrouver ainsi, dans des cœurs si inconnus de vous à des siècles de distance, vos plus chères pensées ; vos émotions les plus intimes ? Et loin d’y rien perdre ne reçoivent-elles pas en quelque sorte par là, à vos propres yeux une nouvelle et puissante sanction. Je crois en vérité Madame, que je me suis persuadé que vous étiez là, car je vous raconte tout ce qui me vient à l’esprit ou à la mémoire, absolument comme si nous causions. Mais mon rêve s’évanouit. Vous me quittez. Adieu. Je n’aurai le cœur à l’aise que lorsque, pour vous comme pour moi, notre correspondance se sera rétablie dans sa douce régularité.
8. Val-Richer, Samedi 19 août 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
8 heures
Je viens de dormir neuf heures de suite. Il y a longtemps que cela ne m'était arrivé. J’ai beaucoup marché hier. Le soir, j'étais rendu. J'espère bien qu'il n’est plus question de votre point de côté.
Je n’avais pas bonne idée de votre essai de coucher à St Germain ou à Versailles. Quand on parviendrait à réunir, dans une chambre d’auberge, tous les conforts possibles, comment arranger le dehors, le bruit, le mouvement, les chevaux, les postillons, les voyageurs ? Il faut voyager ou rester chez soi. Enfin nous serons à Beauséjour, mardi. Il fait toujours beau. Je compte, pour nous, sur un beau mois de septembre.
Je ne parviens pas à voir comme vous l’Espagne en noir. Sans doute la situation est grave et difficile ; il faut y bien regarder, et la suivre pas à pas. Mais au fond, elle est bonne, très bonne ; et en définitive, après toutes les oscillations et tous les incidents possibles, c’est le fond des choses qui décide. La conduite sera bonne aussi. J’ai de plus maintenant l'autorité car j'ai réussi. Je m’en servirai au dedans et au dehors. Au dedans, je crois à ma force dans la discussion. Au dehors, je crois au bon sens anglais. Voilà ma confiance. Voici mes craintes, car j’en ai plus d'une. Je crois que les Espagnols les vrais meneurs ne veuillent absolument un grand mari, et que ne pouvant avoir Aumale, ils ne reviennent au Cobourg. Je crains que malgré le bon sens de Londres, les vieilles routines Anglaises et Palmerstoniennes ne persistent dans les agents secondaires et éloignés, que l’esprit d’hostilité contre la France ne les porte à fomenter toujours en Espagne, les intrigues Espartéristes et radicales. Je crains que la bouffée de raison et de modération qui souffle en ce moment en Espagne, ne soit courte, et qu’on n’y retombe bientôt dans l’anarchie des passions et des idées révolutionnaires. Trois grosses craintes, n'est-ce pas ? Je m'y résigne. Il y a, dans le fond des choses de quoi lutter contre ces périls-là. Je sens tout le poids du fardeau que je porte. Mais je suis convaincu que les hommes qui ont gouverné leur pays, dans les grands temps n’en portaient pas un plus léger. Il faut accepter sa condition.
10 heures Voilà le 10. Je suis charmé que le point de côté soit passé. Vous avez toute raison de ne pas choquer la jeune comtesse. Je ne partirai d’ici que mardi, et ne serai à Auteuil que mercredi. Je reçois à l’instant même une lettre du Roi, qui m'avertit que Salvandy est parti d'Eu hier soir et viendra demain au Val-Richer. Tout n'est pas arrangé, bien s'en faut d'après ce que me mande le Roi. Pourtant il y a du progrès. Il faudra que j'aille faire une course à Eu dans les premiers jours de septembre ! Je l’ai promis au Roi et il me le rappelle encore aujourd'hui. Ce sera deux nuits en voiture et 36 heures de séjour. Je vais lire le discours de Palmerston sur la Servie. On m'écrit de Londres qu'il a fait de l'effet, et la réponse de Peel pas beaucoup. Adieu. Adieu. Je n’aime pas ces 24 heures de séparation de plus, mais il le faut.
Adieu. Cent fois G.
8. Val-Richer, Vendredi 25 mai 1855, François Guizot à Dorothée de Lieven
Je regrette que vous ne lisiez pas l'Assemblée nationale ; sa politique étrangère est vraiment bonne, pacifique avec intelligence et convenance. Elle dit presque tous les jours aux Anglais des vérités qui seraient utiles, s’il suffisait de dire la vérité pour qu’elle soit utile.
J’avais lu et remarqué le rapport de Lord Raglan du 8. Il est comme tous les précédents, plus embarrassé seulement à cause de l’embarras de cette expédition avortée. Je ne comprends pas pourquoi on l’a fait avorter, ni de qui sont venus les ordres de rappel. Triste spectacle que de grandes luttes où personne ne grandit ; tout au contraire. Que fait l’amiral Lyons, ce foudre de diplomatie et de guerre, si cher à Lord Palmerston ?
Cette incapacité et cette mollesse générale sont ma seule raison sérieuse de croire à la paix ; on baissera la toile pour ne pas montrer indéfiniment au public de si pauvres acteurs.
Je suis de votre avis sur votre dent si elle est vraiment gâtée. Faites la ôter dans ce cas ; elle gâterait les autres ; mais si elle n’est pas gâtée, si c’est une irritation du moment résignez-vous un peu et attendez. J’ai ma petite infirmité aussi ; je suis enrhumé. Le temps très variable en est la cause. Ce ne sera pas long. A tout prendre il ne fait pas froid.
10 heures
Je suis au milieu des ouvriers pour faire poser les tableaux et les gravures dans mon cabinet. On m’apporte là mes lettres. J’avais raison de tenir pour votre dent. Je tiens aussi pour la dépêche de Lord Raglan. Il faut qu’elle soit vraie. Adieu, Adieu. Quelle pitié de se dire si peu ! Adieu. G.
8. Versailles, Mardi 5 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Midi
Voici ma seconde lettre aujourd’hui en vous expédiant vite la première pour ne pas faire attendre l’homme de Génie. Je n’avais pas lu encore ce que vous m'avez envoyée. Je viens de le lire avec attention, c’est excellent et vous êtes vraiment très vertueux. La pièce jointe est parfaite à lire et même à donner. Il y a dans le compte-rendu des choses qu'il faudrait soustraire ce qui fait que je me bornerai au récit. Je ne sais pas encore, si je m'en chargerai moi-même où si le dirai à mon petit homme. Je vous rendrai votre papier " Si j'avais le temps, elle m'aimerait " vous me disiez cela hier en me parlant de Lady Cowley. C'est charmant et cela a fait éclater de rire l'Autriche et la Prusse.
Une heure.
Vraiment je me sens très souffrante, et je partirai. J’attendrai 5 heures parce que je crois que le duc de Noailles doit venir me voir. Adieu Je n'ai rien à ajouter. Je trouve tous les journaux aujourd’hui fort bons. Les fonds ont beaucoup haussé. Enfin ce voyage est ce qu’il devait être un grand et bon événement. God bless you et revenez. Je vous conjure de ne point vous embarquer du tout jeudi si le temps était gros ou seulement pas bon. C'est des bétises. Il ne faut rien rien risquer. Que je serai heureuse de vous revoir ! Vous ne me dites pas quand ? Je doute que vous reveniez avant jeudi minuit ainsi vendredi de bonne heure. Mais vous me ferez dire que vous êtes arrivé vendredi à mon reveil n’est-ce pas ? Ayez bien soin de vous je vous en conjure. Adieu. Adieu. Vous concevez que si vendredi à 8 h. du matin, je n’ai pas un billet de vous qui me dise que vous êtes à Auteuil j'irai me jeter dans la Seine. Adieu.
8. Versailles, Mercredi 16 août 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Le 16 août 1843
J’ai quitté Beauséjour à 4 heures. Je suis venue dîner seule ici, à 8 la jeune contesse est arrivée. Elle ne m’a pas ennuyée. Mais voici de son côté. Elle me dit tout à coup - Il doit être bien tard chère Princesse. - Quelle heure pensez-vous qu'il soit ? Près de onze heures. Il était huit heures 3/4. Vraiment j’ai peur qu’elle ne supporte pas longtemps le tête-à-tête.
Je me suis couchée à 10 h. J'ai très bien dormi. A 8 h, j'étais sur la Terrasse. Il faisait frais et beau. J’ai déjeuné, j’ai fait une toilette et me voici. La jeune comtesse est allée se promener dans les galeries, déjeuner chez Mad. de la Tour du Pin. J’y étais conviée aussi, mais je reste. Je vous écris et j’attends votre lettre.
Bulwer parle très sérieusement. Au fond il trouve le Cadiz ce qu’il y a de mieux et de plus pratique surtout. Le fils de Don Carlos impossible. Naples peu vraisemblable comme disposition espagnole. Dieu garde dit-il que qui que ce soit mette en avant un prince étranger quel qu'il soit. Car aussitôt la France serait forcée de lui opposer un Prince d’Orléans. Il ne faut pas à tout prix que la lutte de candidats s'engage. Il ne faut se mêler de rien. Il dit cependant que l'Angleterre doit agir pour empêcher que les Cortès ne nomment le duc d’Aumale, car malgré la résolution du Roi le cas pourrait devenir embarrassant. Si l'Angleterre veut en finir, je crois bien qu’elle arriverait au résultat contraire, mais enfin ce n’est que le dire de Bulwer. Il a beaucoup répété que son gouvernement était dans les meilleures dispositions d’entente avec la France. Il a insisté sur le bon effet qu’aurait la présence de Sébastiani, fort respecté à Londres. Cependant ne sera-t-il pas un peu trop Whig pour les gouvernements actuels ?
Tout ce que vous me dites dans votre N°3 me plaît. Vous avez pris si doucement mes reproches. De la manière dont vous me répondez, je trouve bon toutes vos faiblesses. Mais voici ce que je ne pourrais jamais trouver bon c’est que je fusse renvoyée au delà du 26. Vous pouvez être faible pour votre mère, mais vous ne serez pas injuste et dur pour moi. Je reste donc ferme dans ma foi pour le 26.
Midi et demie. Voici le N°4. Je comprends fort bien la première page, car Génie m’avait confié ce qui était venu de Londres. J’espère que vous aurez consenti à rétrancher le petit mot déplaisant. Il ne faut pas que vous ayez à vous reprocher un seul fait ou geste qui empêche de s’entrendre. Mais quel dommage que vous ne soyez pas ici. Je le répète : un jour de retard dans des affaires comme celle-ci c’est beaucoup risquer et vous dites mieux que moi. Je vous copie. " tout cela a besoin d'être conduit avec un grande précision et heure par heure." Et vous êtes à 46 lieues ! Mais au moins vous reconnaissez l’inconvénient, tout le monde le pensait, et moi aussi, par dessus toutes les autres choses. Revenez, revenez. Ceci est votre grand moment vous n'avez rien eu de si grave, de si important, et de si directement posé sur vos épaules depuis 3 ans bientôt que vous êtes ministre. Et c’est là le moment que vous avez choisi pour vos vacances. Pardonnez-moi si je reviens. Mais vraiment je voudrais impress upon your mind combien cela est sérieux pour vous. Je comprends toutes vos jouissances au Val-Richer, & j’essaie même de n'être pas jalouse ; mais je suis désolée de ce que votre sommeil soit toujours troublé. Enfin votre mère en vous voyant comme cela accablé de travail, vous laisserait bien partir, car elle reconnaîtrait que la politique est sa vraie rivale Adieu. Adieu.
Je renvoie Etienne avec ceci. Je regrette que mon N°7 soit arrivé à Génie trop tard pour vous être envoyé par la poste. Je l’avais donné à [?], à 4 pour le poster de suite. Il ne s’est présenté qu’après 6. Nouveau grief. Par dessus la glace & & Adieu. Adieu. Aujourd’hui variante avant le 26. Adieu.
Mots-clés : Conversation, Diplomatie, Famille Guizot, Mariages espagnols, Parcours politique, Politique (Angleterre), Politique (Espagne), Politique (France), Posture politique, Pratique politique, Relation François-Dorothée (Dispute), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon
9. Auteuil, Jeudi 8 août 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
une heure
Le Maroc va bien et Tahiti va un peu mieux. Les Marocains commencent à se persuader que nous voulons sérieusement ce que nous leur avons demandé, et il faut avoir plus peur de nous que d'Abdel Kader. Nous ferons là, j’espère, en face de l'Angleterre inquiète et immobile, un acte de puissance sur notre voisin, son client, et en même temps nous ferons acte de retenue et de loyauté. C'est là le problème à résoudre. M le Prince de Joinville le comprend très bien et ne perd de vue ni l’un ni l'autre but. Bien certainement, la qualité de Prince donne plus d’esprit à ceux qui en ont. La difficulté de cette affaire, c’est de faire marcher de concert et de front la terre et la mer, Joinville et Bugeaud. Pourtant cela va. J'attends à présent tous les jours la nouvelle de ce que l'Empereur a répondu au Prince et de ce que le Prince fait à Tanger. Si l'Empereur n’a pas bien répondu, le Prince aura agi. Soyez tranquille ; il ne bombardera pas Tanger. Du côté de la terre, si les Marocains ne mentent pas, s'ils ne veulent pas uniquement gagner du temps, le fils de l'Empereur, marche, avec un gros corps de troupes contre Abdel Kader, pour l'expulser du Maroc, disent-ils. Ce qui me paraît indiquer qu’ils disent vrai, c’est qu'Abdel Kader s'est mis en garde contre eux, et a déjà fait tirer un courrier marocain pour lui enlever ses lettres. Attendons. En attendant, le Maréchal Bugeaud agit de son côté, comme le Prince de Joinville du sien. Si le Maroc veut gagner du temps, nous ne consentirons pas à en perdre. Suivez-vous bien ce plan de campagne ?
Quant à Tahiti, le Standard vous dit le mieux qui commence. On commence à sentir à Londres qu'on a parlé bien vite, et bien fort, et sans bien savoir. J’ai été réservé. Je reste tranquille, j’espère que les fautes qu'on a faites tourneront à mon profit, et seront prises en compensation des brutalités de notre lieutenant de vaisseau. Bruat s’est bien conduit. Il a fait cesser sur le champ le tort de Daubigny et il avait, au fond, raison contre Pritchard. Z et 99 se désolent d'avoir Tahiti. Il n'y a pas moyen d'avoir des terres et point d'affaires. Je conviens que celle-ci est très délicate. Pourtant je persiste à penser et à dire qu'il est impossible que le mauvais vouloir ou les mauvais procédés d'un prédicateur et d’un lieutenant de vaisseau compromettent sérieusement les rapports de deux grands pays et de deux grands gouvernements dont tous les intérêts sérieux et toutes les intentions réelles tendent à la paix. Il n’y aurait pas, dans le monde, assez de sifflets pour une telle sottise. J’ai fait mon chemin en ayant confiance dans le good sense. Je suis décidé à continuer. J’espère qu’à Londres on en fera autant & qu’en donnant à la foule des deux côtés de la Manche, le temps de sentir le good sense, elle finira par là. Voilà donc un Prince de plus à Windsor. La Princesse de Joinville attend toujours. Et le Chancelier et le grand référendaire aussi qui se désolent de ne pouvoir partir, l'un pour Châtenay, l'autre pour Bordeaux. Je ne suis pas allé dîner hier à Châtenay. J’ai écrit que j'étais enrhumé. Je le suis en effet, par la grâce de Dieu, car cela m'est venu en sortant de la Chambre close. Ce ne sera rien. Je me couche de bonne heure et je dors immensément. Adieu.
Je trouve que vous ne vous portez pas mal. C'est l’air de vos lettres. Nous avons donc manqué bien belle la réconciliation de 86 et de 74. C'est dommage à eux deux, ils auraient fait 160. Jusqu'à ce que je vous aie vue, je ne crois pas à ce coup manqué. Adieu. Adieu. Que je vous dis peu, et que je vous désire ! Adieu. G.
9. Baden, Jeudi 8 août 1844, Dorothée de Lieven à François Guizot
Vos lettres m’arrivent ici à 2 heures c’est un charmant moment, j’ai bien soin de le passer seule. J’attends aujourd'hui les journaux avec impatience pour lire la discussion de lundi. Plus je pense à Tahiti et plus je me fâche. Vous vous êtes donné là une place éternelle, je ne crois pas que l’avantage de cette possession ou protectorat peut valoir les inconvénients incessants qu’elle vous suscitera. Il y aura d’autres Pritchard. Je suis curieuse des explications qui auront été échangées. Le [blâme] ou le regret de la conduite incivile de M. d’Aubigny peut bien se trouver dans une note, mais son éloignement ultérieur ne devrait pas s’y trouver, à moins que les anglais ne vous aient dans le temps promis par note aussi l’éloignement de Pritchard, ce que j'ignore. Dans tous les cas ils ont bien peu tenu parole, et vous avez tout-à-fait le droit de les imiter certainement ni vous ni aucun ministre quelconque en France ne pourrait risquer. Je ne dis pas même le désaveu mais seulement l'éloignement de M. d'Aubigny dans ce moment. Vous savez bien cela. Vous savez aussi que les Anglais ne se feront aucun scrupule de publier votre note. Vous avez été plein de procédés et de ménagements pour eux. Ils ne vous imiteront pas, j'espère donc que votre réponse si elle est faite peut risquer le grand jour sans me faire évanouir de terreur. Je suis bien fâchée d’être loin car tout ceci me tracasse bien fort. Rassurez-moi un peu.
Je crois que je vous ai écrit une lettre quelque peu anglaise, mais j’étais sous l'impression que Pritchard avait well deserved ce qui lui est arrivé ; j’avoue que je ne trouve pas cela dans ce que je lis dans les journaux. je suppose que les rapports officiels sont plus positifs. Je rabâche, vous n'avez pas besoin que je vous redise de Bade l’affaire de Tahiti. Lady Cowley wishes the whole island at the bottom of the sea ! La journée a été moins mauvaise hier. Il a parlé, & à deux reprises, j’ai même eu une assez bonne conversation avec lui. Il est possible que je le laisse ici vivant.
Il est décidé que Constantin ne le quittera plus, que Mad. de Krudner viendra le rejoindre à Hambourg, et qu’il se rendra d'ici là à très petites journées. Il est très impatient de reprendre ses affaires. L'habitude de l'occupation et de l’agitation est plus forte que la maladie. Je le trouve sensé, modéré, et d’après ce qu’il me dit courageux. Le seul qui ose parler et qui le fasse. Nesselrode bien poltron Orloff secondant mon frère mais en auxiliaire. Il déteste Brunnow et ne lui pardonne pas mon affaire. En tout il se montre non seulement quand il me parle, mais lorsqu'il cause avec Constantin, tout-à-fait mon ami et mon frère.
Je ne sais pas vous rendre compte de mon temps. J’en ai de reste, et en même temps la journée est bien vite finie. Je vais chez mon frère trois, quatre fois le jour. Constantin, Hélène, Annette vont et viennent de chez lui chez moi. Et puis les médecins, les courtisans, on se redit chaque impression. Je me promène avec Constantin, à pieds ou en calèche. Je vais m'asseoir sous les arbres. Je dine seule. Je lis, si on me laisse seule. J’ai reçu un ou deux russes de la dernière insignifiance. Bacourt vient une heure avant mon dîner me raconter tout ce qu’il a lu dans tous les journaux. Nous rabâchons Tahiti ou autre chose. Voilà tout. Je me couche à 9 heures. Je me lève avant 7.
Je pense à vous, je rêve à vous, je prie pour vous. Soyez bien sûr qu’à quelque moment du jour que vous pensiez à moi, vous me rencontrez. Adieu. Adieu. Adieu mille fois.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie (France-Angleterre), Enfants (Benckendorff), Famille Benckendorff, Femme (diplomatie), Politique (Internationale), Pratique politique, Presse, Relation François-Dorothée, Relation François-Dorothée (Diplomatie), Santé (famille Benckendorff), VIe quotidienne (Dorothée)
9. Beauséjour, Mercredi 6 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
Me revoilà dans mon home et j'en suis bien aise. J’ai encore dîné hier à Versailles et j’étais ici à 8 heures, & dans mon lit à 9. J'ai bien dormi jusqu'à 6 heures. à 7 heures j’étais sur les fortifications, je viens de faire ma toilette et me voici à vous. J’attends votre lettre. Le Galignani et les journaux ont devancé votre récit. Je sais que Lundi s’est bien passé. Belle promenade & concert. Je voudrais que tout fut fini. Dieu merci c'est le dernier jour.
Kisseleff est venu me trouver à Versailles hier sur les 3 heures, nous ne nous sommes vus seuls que dix minutes. Le Duc de Noailles est arrivé. Dans les 10 minutes il m’a dit qu'il avait écrit à Brünnow ceci : " On dit que le corps diplomatique (de Paris) montre quelque dépit de l’entrevue royale, quant à moi je me tiens dans un juste milieu. Je dis que c'est un événement très favorable au Roi et à son gouvernement et voilà tout. Si les autres disent plus ou autrement je trouve que c’est de la gaucherie. " Je l'ai encore loué. Il me dit qu'Appony avait changé de langage. Je le savais moi-même de la veille. Il est évident que c’est le rapportage de Molé et La confidence que je lui en ai faite qui ont amené ce changement. C'est donc un service que je lui ai rendu. Mais il n'en sort pas sans quelque petits blessure.
J’ai régalé le duc de Noailles de tout ce récit qui l’a fort diverti. Il a jugé l'homme comme vous et moi. Je lui ai dit qu’on savait que son langage à lui était très convenable. Cela lui a fait un petit plaisir de vanité. Il est évident que tous les jours ajoutent à son éducation politique, et qu’il meurt d’envie de la compléter. Je lui ai lu ainsi qu'à Kisseleff les parties descriptives de vos lettres. Cela les a enchantés surtout le duc de Noailles. Il trouve tout cela charmant, curieux, historique, important. Non seulement il n’y avait en lui nul dépit mais un plaisir visible comme s’il y prenait part. Je lui ai lu aussi un petit paragraphe, où vous me parlez du bon effet du camp de Plélan. Il m’a prié de le lui relire deux fois. Il est évident qu'il voudrait bien qu'on se ralliât. Il suivrait, il ne sait pas devancer. Il m’a parlé avec de grandes éloges du Roi, et de vous, de votre fermeté de votre courage, de votre habileté, de votre patience sur l’affaire d’Espagne. Il est très Don Carlos il a raison, c’est la meilleure combinaison parce qu'elle finit tout et convient à tous. Mais se peut-elle ? Il regrette que la Reine ne soit pas venue à Paris. " Un jour pour Paris, un jour pour Versailles. Elle aurait été reçue parfaitement. Le mouvement du public est pour elle aujourd’hui tout à fait. Une seconde visite sera du réchauffé. Aujourd’hui tout y était, la surprise, l’éclat. " C’est égal j’aime mieux qu’elle n'y soit pas venue. Kisselef m’avait quittée à 4 1/2 pour s’en retourner par la rive droite. Comme le Duc de Noailles partait par la gauche nous avons eu notre tête-à-tête jusqu'à cinq. Kisseleff partait triste, il avait peu recueilli. Tous les deux avaient dû dîner en ville et n'ont pas pu rester. J’ai dîné ave Pogenpohl que j’ai ramené jusqu’ici. J’ai remarqué qu'il en avait assez de Versailles. Un peu le rôle de Chambellan. La promenade et le dîner, et encore par la promenade quand j'en avais un autre. Mais c’est juste sa place.
Onze heures. Voici le N°8 merci, merci. Que vous avez été charmant de m'écrire autant ! Enfin vendredi je vous verrai c’est bien sûr n’est-ce pas ? Passez-vous devant Beauséjour ou bien y viendrez-vous après avoir été à Auteuil ? Vous me direz tout cela. Que de choses à me dire ; nous en avons pour longtemps. Et puis, l’Europe a-t-elle donc dormi pendant Eu ? Comme nous allons nous divertir tous les jours des rapports de partout sur l'effet de la visite ! J’irai ce matin en ville mais tard. Je passerai à la porte de Génie pour causer avec lui. Et puis commander ma robe de noce pour lundi. Ensuite en Appony pour voir le trousseau. J’y resterai pour dîner. Voici donc ma dernière lettre. Adieu. Adieu. Adieu. Apportez-moi moi la jarretière, je m’inquiète que vous ne m'en parlez pas. Ce que vous dites de la princesse de Joinville est charmant ! Adieu encore je ne sais pas finir. Adieu. Prenez soin de vous demain. J’ai si peur de la mer. Et puis j’ai peur de tout. Revenez bien portant, revenez. Adieu. Je me sens mieux aujourd'hui.
Mots-clés : Conditions matérielles de la correspondance, Conversation, Diplomatie, Diplomatie (France-Angleterre), Femme (diplomatie), Femme (politique), Inquiétude, Louis-Philippe 1er, Politique (Espagne), Politique (France), Portrait (François), Réception (Guizot), Relation François-Dorothée (Politique), Réseau social et politique, Salon, Santé (Dorothée), Santé (François), Victoria (1819-1901 ; reine de Grande-Bretagne), Voyage
9. Beauséjour, Mercredi 6 septembre 1843, Dorothée de Lieven à François Guizot
3 heures
Ayez la bonté de remettre ceci à Lady Cowley. Cette lettre a été oublié sur ma table à Versailles et je voudrais qu’elle l’eût. Je n’ajoute que ce mot. Je n’ai vu personne et je vais en ville dans ce moment. Adieu. Adieu.
A vendredi. Quel plaisir. Adieu.
9. Bruxelles, Jeudi 9 mars 1854, Dorothée de Lieven à François Guizot
Jeudi
Je vous prie écrivez-moi toujours où vous allez le soir. Je pense sans cesse à tout. Voici mes nouvelles. Nous avons envoyé à Vienne des propositions sur lesquelles on délibère là, & qui ont en attendant fait ajourner l’envoi de l’ultimatum anglais français. Vous savez que l’Autriche & la Prusse étaient invitées à s’y joindre. La Prusse ne le fera pas, l’Autriche, oui mais avec des modifications. On n’a donc pas envoyé cet ultimatum encore. Il est venu hier un courrier de [Pétersbourg] : nous désirons fort éviter la guerre. Comment cela sera-t-il possible après tout ce qui s’est fait et dit ?
Je fais mal à mes yeux en vous écrivant. Quel désespoir que mes yeux. Quel horrible climat que ceci, et quel ennui de toutes sortes. Kisseleff a l'ordre de rester indéfiniment ici, & Brunnow d'y venir pour y rester aussi. Nous ne voulons pas encore entendre parler de guerre. Adieu. Adieu.
9. Château d'Eu, Mercredi 6 septembre 1843, François Guizot à Dorothée de Lieven
10 heures et demie
Un mot puisque j'ai une lettre de Lady Cowley à vous envoyer ; un seul car je suis fatigué et je meurs de sommeil. Ce matin une promenade d’une heure et demie par un mauvais chemin, pour arriver à un joli point de vue. C’est notre Reine qui a le goût de ce point de vue, et n’a pas songé au mauvais chemin. L'autre Reine s'en est amusée. Avant la promenade, une très bonne conversation avec Lord Aberdeen sur l'Espagne. L'affaire ira. Ce soir une bonne aussi sur toutes choses, dans le salon de la Reine : salon sévère, comme le Sabbath. On a regardé des images et fait des patiences. M. le duc de Montpensier y excelle. A dîner en revanche, la Reine V.. s’était parfaitement amusée ; le Roi l’a fait rire tout le temps, je ne sais avec quoi. Moi, j’ai amusé Lady Cowley. Si j’avais le temps, elle m'aimerait. Adieu. Adieu.
Dieu nous garde ce beau temps la semaine prochaine, pour notre dîner de St Germain. Quel plaisir ! Adieu. Adieu. G.
9. Château d'Eu, Mercredi 16 octobre 1844, François Guizot à Dorothée de Lieven
9 heures
Je vous en conjure, ne soyez pas malade ; que je ne vous trouve pas malade. Vous ne savez pas à quel point j'ai besoin d'être tranquille sur vous, avec quel sentiment, chaque fois que je vous vois, j’interroge votre physionomie. Que sera-ce quand je vais vous revoir ? Vous le voyez ; je suis prudent je suis clever. J’ai ramené le Roi par Calais. Je reste un jour ici à me reposer. C’est vous qui êtes chargée de m’en récompenser. Portez-vous bien. Je suis bien, très bien. J’ai bien dormi de 5 à 10 heures. J’ai très bien déjeuné dans ma chambre. Quand ma toilette a été faite, l’heure du déjeuner du Roi était passé. Et puis, j'ai besoin et soif de solitude. J’ai donc préféré ma chambre. Une côtelette, une aile de poulet, des asperges, du raisin, et du thé. Est-ce bien ?
Cela vaut mieux que la cuisine de Windsor. Pas de légumes mangeables, excepté les pommes de terre. Pas un bon poulet. Et toutes les peines du monde à avoir du riz ou du vermicel, pour potage, au lieu de turtle. Vous auriez ri du luncheon que nous avons mangé à Portsmouth chez un bon M. Grant, Store keeper qui l’avait préparé pour ses amis de Londres venus pour assister à l'embarquement du Roi. Plus de 10 mille personnes étaient là dans cet espoir. L’amiral Cockburn, était au désespoir de notre changement de plan. Il a lutté obstinément pour le premier projet. Il regrettait. passionnément son spectacle sur mer. Puis, quand on lui a demandé d’envoyer un canot au Gomer, qui était en rade à Spithead il y en a envoyé deux successivement qui sont revenus, tous deux sans avoir pu franchir la barre. Il aurait fallu rester à Portsmouth à attendre que le temps changeât.
En débarquant en France à Calais, à Boulogne, à Montreuil, à Abbeville, partout sur la route, j’ai trouvé l’état d’esprit des populations excellent. Vive joie de revoir, de reprendre le Roi. Vif orgueil de l’accueil qu’il venait de recevoir en Angleterre. Vive satisfaction de la consolidation de la paix. Voilà les sentiments vrais, naturels, spontanés. Je les jetterai à la tête de ceux qui essaieront de les obscurcir, de les dénaturer, de mettre à la place les stupidités routinières et les animosités factices des journaux. Vous avez mille fois raison. Je prendrai ma position et les choses sur un ton très haut. J’en ai le droit, et c’est la bonne tactique. Adien. Adieu.
Dear, dear, infinitely dear. Encore une fois, ne soyez pas malade. Si vous m’aimez, c’est tout ce que je vous demande. Adieu. Je suis charmé que Marion soit là. Adieu. à demain. Charmante parole ! G.